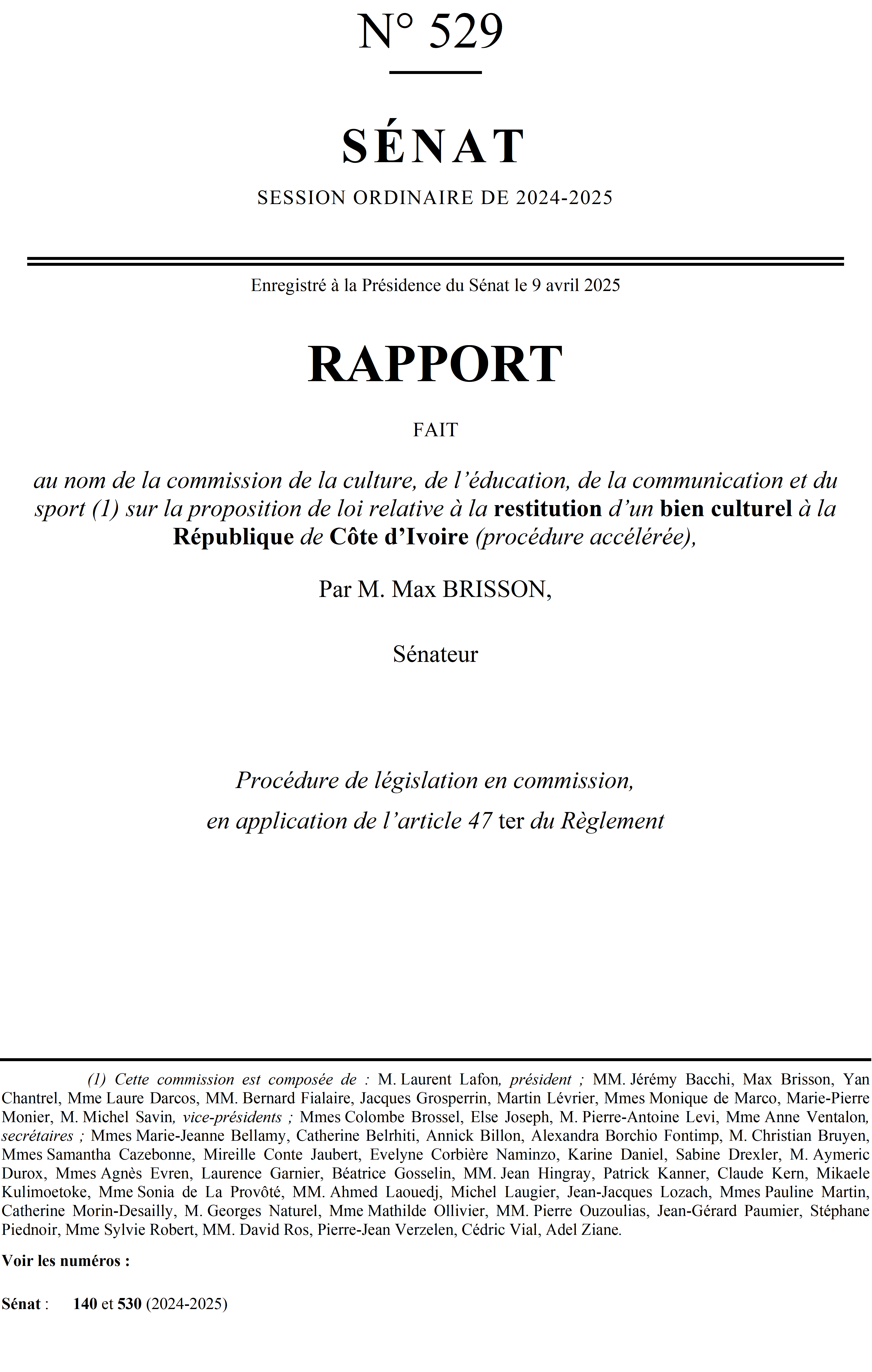|
La commission a examiné cette proposition de loi
selon la procédure de législation en commission, En conséquence seuls sont recevables en séance, sur cette proposition de loi, les amendements visant à : - assurer le respect de la Constitution, - opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur, - procéder à la correction d'une erreur matérielle. |
L'ESSENTIEL
La proposition de loi relative à la restitution d'un bien culturel à la République de Côte d'Ivoire vise à répondre à la demande de restitution du tambour parleur dit « Djidji Ayôkwê » formulée par les autorités ivoiriennes en 2019. Alors que la France s'est engagée à y satisfaire en 2021, le processus juridique de sortie du tambour des collections publiques n'a pas été enclenché depuis cette date.
Présenté par plusieurs membres de la commission à la suite d'un déplacement sur le terrain1(*), ce texte transpartisan tire les conséquences de l'ancienneté de la demande ivoirienne ainsi que des engagements diplomatiques, opérationnels et financiers de la France. Il prend également appui sur l'exemplarité du projet scientifique et muséal développé par la Côte d'Ivoire.
Examinée dans le cadre de la procédure de législation en commission (LEC), la proposition de loi a été adoptée sans modification, le 9 avril 2025, par la commission, qui a cependant émis des réserves sur le cadre méthodologique actuel des restitutions.
I. L'IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ DE RÉPONDRE À LA DEMANDE DE RESTITUTION LÉGITIMEMENT PORTÉE PAR LA CÔTE D'IVOIRE
A. UNE TRÈS FORTE ATTENTE DE LA PARTIE IVOIRIENNE, CONSÉQUENCE DE LA NATURE DU TAMBOUR ET DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA FRANCE
Confisqué en 1916 à l'ethnie atchan par l'administrateur Simon et conservé depuis 1930 dans les collections françaises, le tambour Djidji Ayôkwê est réclamé depuis plusieurs décennies par sa communauté d'origine. Officiellement demandée par la République de Côte d'Ivoire en 2019, sa restitution suscite depuis lors une forte attente parmi la population et les autorités de Côte d'Ivoire.
Cette attente résulte tout d'abord de la nature du tambour, qui est considéré comme une entité spirituelle par sa communauté d'origine. Selon la Dre Silvie Memel Kassi, ancienne directrice du musée des civilisations de Côte d'Ivoire (MCCI) et experte nationale pour le retour des biens culturels en Côte d'Ivoire, sa fonction excède celle d'un simple instrument de musique. Également outil de communication, ayant eu à ce titre un rôle central dans la résistance contre l'armée française, et moyen de gouvernance, en ce qu'il rythmait les temps forts de la vie publique, il incarne plus largement l'esprit de la communauté atchan.
Cette attente résulte ensuite des engagements diplomatiques de la France. Après le discours de Ouagadougou de 2017, par lequel il avait souhaité « permettre aux Africains, en particulier à la jeunesse, d'avoir accès en Afrique et non plus seulement en Europe, à leur propre patrimoine et au patrimoine commun de l'humanité », le Président de la République Emmanuel Macron a en effet spécifiquement indiqué, lors du sommet Afrique-France tenu à Montpellier en octobre 2021, que le tambour avait vocation à être restitué à la République de Côte d'Ivoire.
Alors que les relations diplomatiques entre la France et la Côte d'Ivoire sont excellentes, l'absence de concrétisation juridique de cette restitution annoncée est mal acceptée par les autorités du pays, et alimente un ressentiment de sa population envers la France. L'incompréhension est d'autant plus forte que le Sénégal et le Bénin voisins ont bénéficié de restitutions de biens culturels en novembre 2021, sur le fondement de la loi d'espèce n° 2020-1673 du 24 décembre 2020. Lors de son entretien du 17 septembre 2024 avec la délégation de la commission, la ministre de la culture ivoirienne Françoise Remarck a en conséquence rappelé sa demande de restitution.
* 1 La commission a approfondi ses travaux relatifs aux restitutions d'oeuvres d'art par un déplacement en Côte d'Ivoire et au Bénin du 15 au 21 septembre 2024, dont le compte rendu est accessible sur le site Internet du Sénat.