4. Préserver le patrimoine national dans un marché ouvert
Ainsi
qu'on l`a déjà rappelé, la France a choisi de s'aligner
sur les dispositions libérales définie au niveau communautaire.
Elle a choisi une solution à l'anglaise plutôt qu'à
l'italienne, dans laquelle presque tout le patrimoine à caractère
mobilier est pour ainsi dire gelé par une politique de classement
systématique. Elle a préféré un régime de
liberté au système italien, très protecteur, certes, mais
débouchant sur un important commerce parallèle.
Mais si elle a choisi la liberté des échanges, elle ne s'est pas
donné les moyens financiers de sa politique.
Il en résulte une hémorragie, qui se traduit par des
"
excédents
"
records en matière
d'échanges d'oeuvres d'art
, qui culminent au niveau
désormais de 2 milliards de francs
par an.
M. Chandernagor, notamment, l'a clairement énoncé devant le
rapporteur : dans un régime ouvert, la protection du patrimoine
coûte cher ; il faut donc s'en donner les moyens ".
C'est ce que propose le rapporteur en reprenant notamment certaines des
propositions de M. Aicardi, qui sont toujours aussi actuelles, anticipant sur
le projet de loi envisagé par le les gouvernements successifs mais qui
n'en finit pas de rester dans les cartons.
Ces propositions devraient s'inscrire dans le cadre d'une évolution plus
générale de la politique d'enrichissement du patrimoine national
faisant plus de place au temps et moins à l'urgence, plus aux
collectionneurs privés et moins à l'Etat.
a) Un principe pour l'État : faire acheter plutôt qu'acheter
La
défense du patrimoine suscite naturellement dans les pays latins des
attitudes protectionnistes. Il faut empêcher les oeuvres de sortir, tel a
été longtemps le leitmotiv de tous ceux qui se voulaient les
défenseurs des arts.
Hier, il suffisait d'interdire, aujourd'hui, il faut acheter et c'est beaucoup
plus difficile voire impossible, vu l'ampleur de l'hémorragie .
D'où le cri d'alarme des conservateurs qui assistent, impuissants, au
vidage de la France de son patrimoine, dont on retrouve l'écho dans un
éditorial non signé de la Revue de l'art qui, témoigne de
ce que la France alimente les ventes d'art ancien à Londres comme
à New-York.
"
Les deux ventes de tableaux anciens de New York du mois de janvier, chez
Christie's (29 janvier 1998) et chez Sotheby's (30 janvier), ont fait
sensation. Les prix atteints ont confirmé la vigueur du marché.
On a pu lire que de nombreux acquéreurs estimaient que les tableaux
anciens demeuraient bon marché, à qualité égale
(l'expression mériterait un commentaire), par comparaison avec la
peinture postérieure à 1800, à plus forte raison avec les
Impressionnistes. D'où provenaient ces tableaux ?
Christie's, n° 118 : une Nature morte de Juan van der Hamen y
Leon (1596-1631), se vendit pour 662 500 dollars (environ 4 millions
de francs). Le 16 juin 1997, à Lille, le même tableau
avait été adjugé pour 600 000 francs (hors
catalogue dans cette vente).
Sotheby's, n° 43 : L'archange saint Michel était vendu
sous le nom de Carlo Dolci (1616-1686) pour 354 500 dollars (environ
2 200 000 francs). A Drouot, le 30 mai 1997, mais sous une
attribution à Cesare Dandini (n° 5 du catalogue reproduit), le
tableau avait été adjugé au prix de
240 000 francs. Le catalogue de New York précisait que le
tableau provenait de France.
Sotheby's, n° 54 : un Joueur de luth chantant de Hendrick Ter
Brugghen (1588-1629) se vendit pour 321 500 dollars (2 millions
de francs environ). Le commissaire-priseur en avait obtenu à Rouen,
moins d'un an auparavant, le 9 février, 810 000 francs
(n° 51, reproduit en couleurs).
Autre cas bien plus modeste, mais exemplaire. Il s'agit, cette fois-ci, d'un
dessin : vendue chez Christie's le 30 janvier 1998 (n° 59,
reproduit) comme de Turchi (1578-1649) pour 6 900 dollars, cette
Vierge à l'Enfant accompagnée d'une sainte avait
été adjugée à Drouot, le 14-16 mars 1994
(n° 298, reproduit au catalogue), pour 3 800 francs.
Dernier exemple, particulièrement frappant : Sotheby's,
n° 137, Rubens : la Tête de saint Jean-Baptiste
présentée à Salomé. Ce chef-d'oeuvre de la jeunesse
du grand maître flamand se vendit pour 5 500 000 dollars
(environ 33 millions de francs). En vente publique à Fontainebleau
le 14 juin 1987, le même tableau avait été
adjugé pour 1 558 000 francs avec les frais.
Et pour faire bonne mesure, interrogeons-nous sur le prix que le musée
de Kansas City aux Etats-Unis a pu offrir pour un Saint Jérôme du
rare Tanzio da Varallo (1575/80-vers 1635 ; l'artiste semble absent des
collections publiques françaises). L'oeuvre, reproduite au catalogue
(n° 20) s'était vendue à Drouot le
11 décembre 1996 pour 1 100 000 francs (hors
frais) comme " Ecole flamande du XVII
e
siècle ".
Il serait fastidieux de multiplier les exemples. Contentons-nous de quelques
remarques, brutales dans leur sécheresse.
Ces cas sont contrôlables. Nous ignorerons toujours le nombre exact de
tableaux des ventes de Sotheby's et de Christie's qui provenaient de France,
qu'ils aient été exportés légalement ou
frauduleusement, qu'ils soient passés en vente publique ou qu'ils
proviennent du commerce, de foires de toutes natures ou de collections
particulières. D'après les rumeurs du commerce parisien, ce
serait près de la moitié des 550 lots des deux ventes de New
York qui auraient une provenance française récente.
Nous avons insisté sur les ventes publiques car elles étaient
" vérifiables ". Mal attribués, mal catalogués
(ou non catalogués), vendus sans publicité, ces tableaux se sont,
en France, mal vendus. Au détriment de leurs propriétaires.
Comment, dès lors, s'étonner, que ceux-ci se tournent, de plus en
plus nombreux, vers les salles de ventes anglaises ?"
Face à cette situation critique, le rapporteur voudrait faire
évoluer les esprits en développant l'idée selon laquelle,
non seulement l'État ne peut mais surtout il ne doit pas tout acheter.
Il faut, en effet, faire plus de place aux collectionneurs privés et
à l'initiative privée, en général, dans la
protection et l'enrichissement et la protection du patrimoine mobilier de la
France.

(1) L'État ne peut et ne doit pas tout acheter
L'État ne peut pas tout acheter pour des raisons
financières évidentes. Les crédits d'acquisitions des
musées, tous secteurs confondus, atteignent à peine 130 millions
de francs en 1997 ; si l'on ajoute, la dépense fiscale
correspondant à la valeur des dations acceptées, la somme totale
atteint une somme de 300 millions de francs la même année, qui est
manifestement, une des années les plus fastes de la décennie.
L'année précédente, en 1997, le montant des oeuvres
acceptées en dation ne se montaient qu'à 28 millions contre 163
millions de francs en 1997, ce qui témoigne on peut le noter au passage
le bon fonctionnement de la dation qui consiste pas à dépenser
une somme déterminée mais à tenir compte des
opportunités. C'est ce non plafonnement de la dépenses fiscale
sur laquelle a insisté M. Jean-Pierre Changeux, lors de son audition et
qui fait toute la force et l'intelligence de la procédure.
Or, si l'on additionne les valeurs de toutes les oeuvres dont le certificat a
été refusé par la commission des "trésors
nationaux" et qui vont très certainement être
représentées et qui vont donc sortir avec les conséquences
que l'on sait pour les finances publiques - cf. encadré ci-contre sur
l'affaire Walter - on aboutit à
un montant total d'oeuvres
en
attente
de l'ordre
d'un milliard de francs
.
Au surplus, dans le régime actuel, l'État ne peut pas acheter
l'oeuvre si son propriétaire refuse de la lui vendre en spéculant
sur le fait qu'on n'engagera pas de procédure de classement pour
éviter que l'État soit amené à payer des sommes
importantes pour une oeuvre dont il n'est même pas propriétaire.
Le projet de loi en cours d'élaboration devrait mettre un terme à
cette anomalie en mettant en place un système inspiré de la
législation britannique.
Mais surtout l'État ne doit pas tout acheter :
•
il ne faut pas d'abord négliger l'impact sur le rayonnement
culturel de la France des oeuvres prestigieuses qui partent à
l'étranger
: il est particulièrement souhaitable que le
musée Getty expose et achète des oeuvres françaises, car
dans cette région des États-Unis, la France est presque
totalement absente sur le plan culturel. La France a perdu des oeuvres, voire
des collections entières qu'elle aurait pu acheter ou qui aurait pu lui
être données, mais force est bien d'admettre que les grandes
baigneuses de Cézanne ou la Madeleine de Georges de La Tour,
respectivement à Philadelphie et Washington, font, au-delà de
l'émotion initiale, beaucoup pour l'image de la France et le prestige de
la culture française ;
• on ne peut manquer de souligner
un biais important dans la
politique d'achat des musées qui ont tendance à retenir ce qui
est déjà sur le territoire français, alors même
qu'il serait parfois plus opportun de rapatrier des oeuvres essentielles ou de
faire rentrer des oeuvres qui nous font cruellement défaut
si l'on
veut que le musée du Louvre notamment puise présenter comme
devait le faire le Museum de Napoléon, le plus beau rassemblement de
chefs-d'oeuvre du monde entier. A cet égard, il faut sans doute faire
preuve d'esprit critique et considérer que certains exemples de
mobilisation au niveau national pour empêcher le départ d'une
oeuvre, au demeurant austère, d'un peintre dont les musées
français sont largement dotés est moins utile à
l'enrichissement du patrimoine national que l'achat d'un beau tableau figuratif
de tel ou tel peintre de la Sécession viennoise, ou .des beaux paysages
de l'école anglaise qui manquent aux collections nationales.
M. Neil Mac Gregor, Directeur de la National Gallery de Londres pose à
cet égard une question fondamentale :
"
Est-ce qu'on cherche principalement à protéger ou
à enrichir le patrimoine
? Le choix anglais reconnaît
que fort souvent, les oeuvres d'art qui se trouvent dans les collections
privées sont du même type que celles que possèdent
déjà les musées nationaux, pour la raison très
évidente que ceux-ci ont été en grande mesure
formés de celles-là. Si l'on veut que les collections publiques
se dotent d'oeuvres jusqu'ici peu appréciées ou peu
collectionnées par les amateurs dans notre pays, il faut réserver
une partie des fonds disponibles pour acheter au-delà des
frontières. C'est ce qu'a fait récemment The Heritage Lottery
Fund, permettant à la Tate Gallery d'acheter à l'étranger
un beau Mondrian, alors qu'il n'avait pas aidé un peu plus tôt
à empêcher le départ d'un portrait britannique, beau,
certes, mais infiniment moins rare dans les collections anglaises que Mondrian.
C'est-à-dire que le but principal n'est pas de retenir ce qui se
trouver, souvent par hasard, sur le sol national, mais de créer, avec le
fonds de la loterie, les meilleures collections possibles pour les
générations futures
".
De toute façon, pour avoir ce recul et cette
sérénité que suppose la stratégie exposée
ci-dessus, il convient de
mettre en place un système
qui
permette enfin aux Musées de France de cesser d'intervenir
très souvent dans l'urgence
et à mener une politique d'achat
constamment sous pression.
(2) La collectivité a tout intérêt à inciter les collectionneurs privés à se porter acquéreurs des " trésors nationaux "
Faire
faire plutôt que faire, tel est le principe qui devrait guider, chaque
fois que cela est possible, la politique de préservation du patrimoine
national.
L'intérêt est d'abord financier, puisque l'on soulage d'autant des
budgets d'acquisitions, dont on sait qu'ils sont toujours insuffisants.
A cet égard, le rapporteur tient à indiquer que s'il approuve
l'idée d'imiter les anglais en prélevant sur les ressources du
Loto
81(
*
)
, à l'instar de
ce qui se fait pour le sport les crédits nécessaires aux
acquisitions, il reste sceptique sur ses chances d'aboutissement et
considère qu'il vaut mieux fonder ses espoirs sur d'autres
mécanismes pour protéger le patrimoine national.
En particulier, il semble préférable d'accorder des avantages
fiscaux à toutes les personnes qui contribueront au maintien sur notre
sol de nos "trésors nationaux". Il y a là un effet de levier
d'autant plus important que le niveau d'imposition dans notre pays est -
malheureusement - élevé. On pourrait même y voir une
tactique consistant à faire d'une faiblesse - notre niveau
élevé de taxation - une force au service de
l'intérêt national.
Le rapport Aicardi rappelle à cet égard : "
c'est
une évidence que de la dire mais on peut la rappeler :
toute
grande oeuvre détenue par un résident français reste dans
le patrimoine national et son maintien ne nécessite pas de la part de
l'État une intervention toujours onéreuse pour les finances
publiques. On peut ajouter que la détention privée d'une oeuvre
plutôt que publique, décharge l'État du soin d'assurer son
entretien et sa surveillance et la transfère au propriétaire qui
participe ainsi à la politique de maintien du patrimoine.
"
Et, qui sait, peut-être réussira-t-on par l'octroi de ses
avantages fiscaux à créer une dynamique de la collection en
France et que les personnes qui rechercheront les oeuvres d'art "trésors
nationaux" pour les avantages fiscaux qui leur sont attachés, se
prendront au jeu et se transformeront en véritables
collectionneurs.
b) Un premier moyen : assortir le classement d'avantages fiscaux
Le classement emporte dans certains cas déjà l'octroi d'avantages fiscaux. Mais on peut aller sensiblement plus loin pour favoriser le maintien des oeuvres classées sur le territoire national.
(1) Les avantages accordés au mobilier de certains monuments historiques en matière de droits de mutation
La loi
du 5 janvier 1988 a prévu " l'exonération des droits de mutation
pour les immeubles classés ou inscrits ainsi que les meubles,
classés ou non, inclus dans le circuit de visite, qui en constituent le
complément artistique ou historique, ". Cette mesure a pour but
d'éviter que le mobilier et les collections rassemblées ne soient
dispersés par les héritiers pour payer les droits de succession.

Pour bénéficier de cette exonération, les héritiers
doivent souscrire une convention à durée
indéterminée, dans les conditions prévues par un
décret du 21 avril 1988, avec le ministre de la Culture et le ministre
des Finances qui décrit l'immeuble et énumère les biens
meubles et immeubles par destination complémentaire
82(
*
)
.
Cette convention entraîne des obligations à la charge des
héritiers, qui doivent maintenir sur place les décors et objets
énumérés et permettre au public d'accéder au moins
cent jours par an entre avril et octobre aux biens exonérés
faisant l'objet de la convention. Cette durée de visite peut
éventuellement être diminuée si les héritiers
permettent à des collectivités publiques ou à des
associations sans but lucratif de présenter gratuitement au public ces
objets mobiliers. Les héritiers doivent également s'engager
à entretenir les biens et assurer le contrôle des dispositions de
la convention par les services du Ministère de la Culture et du
Ministère de l'Économie et des Finances.
Entre 1990 et octobre 1998, 34 conventions ont été conclues au
titre de la procédure prévue à l'article 795 A du code
général des impôts. 16 d'entre elles comportent une
liste d'éléments de décor (meubles et immeubles par
destination
).
Il s'agit d'immeubles par destination comme les boiseries, cheminées,
vitraux, fresques murales, lambris, dessus de portes ou des meubles se
composant de tableaux, de statues, de mobilier (lit, table, ... ), de lustres,
de glaces et de vases.
Six conventions sur les seize ne mentionnent pas d'évaluation des
éléments de décor (généralement
constitués d'immeubles par destination). Sur les dix autres conventions,
la valeur des biens mobiliers va de 60 000 F à 2 489 750 F pour un
total de 8 Millions de francs environ.
Le rapport Aicardi a considéré, comme ont l'a déjà
indiqué succinctement, que le système est très
pénalisant pour le propriétaire, lorsqu'il rompt la convention
avec l'État
.

"
A l'heure actuelle, le système est très
pénalisant pour le propriétaire lorsqu'il décide de rompre
la convention avec l'État.
Les droits de succession sont alors rappelés après application
d'intérêts de retard qui courent à compter du jour de la
signature de la convention (et non du jour de sa dénonciation) et sur la
base de la valeur actualisée du bien en question (au jour où la
convention n'est pas respectée),
"
Trois éléments donnent un caractère dissuasif
à ce régime :
le prix du temps écoulé est pris en compte deux fois par le
biais des intérêts de retard et de la -valeur actualisée.
Le montant cumulé des intérêts de retard peut doubler la
valeur du bien ;
ce système équivaut à considérer que la
convention, en cas d'extinction., n'a jamais été respectée
alors que, pourtant, elle l'a été temporairement ;
enfin, les droits sont d'autant plus lourds que la convention a longtemps
été respectée. Celui qui a respecté sur une longue
période la convention qu'il a signée est moins bien traité
que tel qui a renoncé plus rapidement à ses engagements.
Pour "adoucir" la sortie du dispositif, il conviendrait d'abandonner
l'actualisation de la base, qui fait double emploi avec le calcul des
intérêts de retard. On mettrait ainsi fin à l'anomalie que
constitue la double facturation du temps.
Quant au paradoxe qui conduit à d'autant plus taxer le
propriétaire qui a longtemps respecté la convention, il pourrait
être levé en plafonnant le montant des intérêts de
retard. "
(2) L'exonération des biens classés des droits mutations et accessoirement de la taxe forfaitaire
La
différence de niveau entre le marché mondial et le marché
français est considérable :
le prix d'un objet peut
varier de 1 à 2 voire de 1 à 5, selon qu'il peut ou non
être négocié sur le marché international
.
L'affaire du tableau de Van Gogh, le Jardin à Auvers, qui fait l'objet
de l'encadré ci-contre - montre que le classement est une mesure
coûteuse, puisqu'en l'état actuel du droit, il faut donner au
propriétaire de l'oeuvre classée une indemnité
représentative de la différence de prix, soit en l'occurrence 140
millions de francs.
Au système actuel, qui place l'Etat dans une situation impossible
où il lui faut soit classer l'oeuvre avec toutes les conséquences
financières ou de laisser sortir l'oeuvre dans la cas où le
propriétaire se refuse.
AFFAIRE WALTER
" LE JARDIN À
AUVERS "
L'analyse de la direction des musées de France
M. Jacques Walter a acquis en 1955 un tableau de Vincent
Van
Gogh intitulé " Jardin à Auvers ". A la suite d'une
demande d'autorisation d'exportation en Juin 1982, refusée, le tableau a
été classé d'office parmi les monuments historiques
confirmé par décret du 28 juillet 1989, décret contre
lequel M. Walter a exercé un recours, rejeté par
l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 juillet 1992.
M. Walter a ensuite demandé à l'Etat l'indemnisation du
préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de la décision de
classement, à hauteur de 250 millions de francs. Il fondait sa
demande sur l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 relatif
à l'indemnisation du préjudice résultant de l'application
de la servitude de classement d'office.
L'Etat fut condamné à payer la somme de 422.187.693 francs
(jugement du TGI Paris 22 mars 1994), indemnisation réduite
à la somme de 145 millions de francs par arrêt de la cour
d'appel de Paris du 6 juillet 1994. La cour de cassation ayant rejeté le
pourvoi formé contre cette décision, le ministère de la
culture a versé une indemnité de 147.920.657,54 francs. Les
frais de procédure ont été pris en charge par l'agent
judiciaire du Trésor (ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie) qui a assuré la défense de l'Etat
dans le cadre de son mandat légal.
Par sa jurisprudence, le juge a donné la priorité au respect des
droits du propriétaire sur la protection du patrimoine. Pour la
première fois le juge se prononce en faveur de l'octroi d'une
indemnité du propriétaire en la matière. Cet arrêt
revêt une importance tout à fait particulière, à la
fois sur le plan juridique et par ses conséquences pratiques.
Sur le plan juridique, la cour de cassation a opéré un revirement
de jurisprudence et a confirmé la méthode des juges du fond quant
à l'évaluation de l'indemnité résultant d'un
classement d'office.
En effet la cour de cassation a rejeté le moyen avancé dans son
pourvoi par l'Etat, à savoir que le dommage subi par M. Walter avait un
caractère incertain dès lors qu'à défaut du
classement d'office, le ministre de la culture aurait pu, de manière
discrétionnaire, sur le fondement de la loi du 23 juin 1941 (en
vigueur à l'époque des faits), refuser l'autorisation d'exporter,
ce qui aurait provoqué un préjudice identique, non indemnisable.
Ce moyen rencontrait pleinement la jurisprudence de la cour de cassation qui
avant l'affaire en question avait cassé le 28 mai 1991 l'arrêt
rendu dans l'affaire Schlumpf, allouant une indemnité pour le classement
d'office d'une collection de voitures.
Dans son jugement la cour de cassation a relevé que la cour d'appel a
souverainement retenu que le refus d'autorisation d'exportation notifié
à M. Walter en octobre 1989 se fondait sur la seule mesure de
classement d'office du tableau et qu'elle en a justement déduit que le
préjudice avait pour seule origine cette mesure de classement d'office,
qui en vertu de l'article 16 de la loi de 1913 ouvrait au
propriétaire un droit à indemnisation et que dès lors le
préjudice étant né du seul fait que le bien ne peut
quitter le territoire national, sa cause n'est rien d'autre que la perte du
marché international et il s'évalue en comparant le prix de vente
du tableau en France avec ceux d'oeuvres comparables vendues sur le
marché international à la date du classement.
On peut regretter que le juge ne se soit pas interrogé plus avant sur
l'existence avérée du préjudice et le caractère
certain et direct de celui-ci, qui ne pouvait naître qu'avec la
volonté d'exporter (affirmée, il est vrai, par M. Walter), et
qu'il n'ait pas interprété l'existence de ce préjudice au
regard du contexte de l'affaire. En outre, l'appréciation de la
servitude due à un classement parmi les monuments historiques doit
prendre en considération les autres conséquences de cette mesure.
E n présence d'une interdiction d'exportation la décision de
classement en elle-même n'ajoutait aucun effet juridique
spécifique, hormis les autres conséquences plutôt positives
pour le propriétaire.
Sur le montant de l'indemnité, il est intéressant de rappeler
enfin que dans l'affaire en question il y a eu une seule expertise, produite
par M. Walter. Or, M. Walter avait, en 1981 lors d'une première
demande d'autorisation d'exportation, fixé le prix du tableau à
6 millions de francs, et par ailleurs il n'avait pas opposé un
quelconque prix de réserve lors de la vente aux enchères de 1992,
pratique pourtant très courante.
Enfin, la cour de cassation en 1996 a estimé que le classement
créait un préjudice intangible, à l'inverse du refus de
certificat d'exportation qui ne créerait qu'un préjudice
temporaire, alors que le tableau avait l'objet de refus de certificat et que
par ailleurs la loi de 1913 prévoit une procédure de
déclassement.
Cette jurisprudence a rendu de fait quasiment impossible la procédure du
classement pour protéger le patrimoine mobilier national. Il peut en
effet paraître dès lors déraisonnable de faire courir au
budget de l'État le risque d'avoir de lourdes indemnités à
supporter, alors que le bien demeure entre des mains privées et n'a pas
vocation à être exposé publiquement.
Cependant, il y aurait peut-être lieu de s'interroger sur la
pérennité de cette jurisprudence, dans la mesure où la loi
du 31 décembre 1992 et ses décrets d'application sont venus
changer radicalement le régime d'exportation des biens culturels, en
prévoyant que le certificat d'exportation ne peut être
refusé une seconde fois pour le même bien si l'administration n'a
pas procédé à son classement (cf. article 9).
En tout état de cause, le ministère de la culture et de la
communication a préparé un projet de loi modifiant les lois du
31 décembre 1992, relative à la circulation des biens
culturels, et du 31 décembre 1913 relative aux monuments
historiques, qui vise à tirer les conséquences de ce contexte et
à rechercher un meilleur équilibre entre protection de droit de
propriété et protection du patrimoine national.
Il faut éviter que ce différentiel de prix ne se traduise par un
courant de sortie des oeuvres attirées par les " hautes
pressions " des marchés extérieurs.
On pourrait ainsi pour retenir les oeuvres :
• sortir les oeuvres classées de celles ayant fait l'objet
d'un refus de certificat dans des conditions à définir par la
loi, de l'assiette de l'impôt sur les mutations à titre
gratuit : en totalité pour le propriétaire de l'oeuvre au
moment du classement, en partie pour les acquéreurs
ultérieurs ;
• alléger les frais de mutation pour ce type d'oeuvres qui
pourraient être exonérées de taxe forfaitaire de l'article
150V bis
Il convient en effet de distinguer dans les avantages dont on assortirait les
oeuvres classées ou n'ayant pas obtenu de certificat, le
propriétaire de l'oeuvre au moment de la mesure des propriétaires
ultérieurs : les uns subissent de plein fouet la diminution de la
valeur de l'oeuvre ; les autres ont acheté une oeuvre
déjà frappée d'une servitude de non exportation ce qui ne
justifie pas un régime fiscal aussi avantageux.
On note que favoriser les acquéreurs ultérieurs est une
façon d'aider les détenteurs qui subissent le classement de la
conséquence du refus de certificat puisque cela crée une demande
de nature à faire augmenter le prix de marché et donc diminuer
d'autant la pénalisation consécutive à l'interdiction de
sortie résultant de la mesure de classement.
Deux points peuvent encore être précisés.
D'une part, il pourrait être opportun comme cela avait été
fait pour d'autres actifs en leur temps sortis de l'assiette des droits de
mutation, d'exiger un minimum de durée de détention avant la
mutation pour éviter un détournement de procédure, bien
évidemment contraire aux objectifs recherchés par le
rapporteur ;
De même, et sans que cela soit indispensable, il ne serait pas
inconcevable d'assortir le bénéfice de l'avantage fiscal d'une
obligation de prêt pour des expositions publiques selon un régime
allégé qui ne crée pas de gêne pour les
propriétaires des oeuvres.

c) Un second moyen : assouplir et étendre le régime de la dation
(1) La procédure actuelle
La loi
du 31 décembre 1968 a institué la dation en paiement qui permet
à " tout héritier, donataire ou légataire d'acquitter les
droits de succession par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de
collection, ou de documents de haute valeur artistique ou historique ".
La définition des oeuvres est la même que celle applicable aux
donations
83(
*
)
, mais s'agissant
d'un paiement et non d'une libéralité, l'offre de dation doit
être pure et simple, et ne peut être assortie d'aucune
réserve ni condition.
Le champ d'application de la dation a été étendu par la
loi de finances rectificative n° 82-540 du 28 juin 1982 qui accorde
désormais le bénéfice des dations au paiement des droits
de mutation ou de partage et au paiement de l'impôt de solidarité
sur la fortune. Le régime est fixé par l'article 1716 bis du code
général des impôts.
Les objets qui peuvent être offerts en dation, sont ceux
mentionnés ci- dessus à l'exclusion des oeuvres d'artistes
vivants dont la valeur est plus incertaine
84(
*
)
.
Selon une pratique aujourd'hui établie, l'acceptation d'une dation est
soumise à une série de conditions restrictives. L'oeuvre doit
présenter un intérêt culturel majeur et venir combler une
lacune au sein des collections nationales.
La procédure de dation en paiement précisée à
l'article 384 A de l'annexe II du code des impôts, comporte quatre phases
principales.
L'initiative d'une proposition de dation en paiement appartient au
débiteur des droits qui s'adresse avant le terme des délais de
règlement à la recette des impôts ou à la
conservation des hypothèques territorialement compétentes, une
offre dans laquelle il précise la valeur artistique ou historique de
l'objet, la valeur libératoire proposée et justifie de son titre
de propriété sur l'objet. La proposition a pour effet de reporter
le paiement jusqu'à une réponse de l'administration, mais en
l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an,
l'offre est réputée avoir été refusée.
L'offre de dation est ensuite transmise par l'intermédiaire du
Ministère des Finances à la Commission interministérielle
d'agrément
85(
*
)
pour la
conservation du patrimoine artistique, appelée couramment " Commission
des dations " qui comprend un représentant du Premier ministre,
assisté de deux représentants du ministre de la Culture ainsi que
de deux représentants du ministre des Finances.
La Commission vérifie la régularité formelle de l'offre -
et notamment l'origine de propriété - ; elle prend l'attache
pour les dations importantes le Comité consultatif des musées
nationaux et le Conseil artistique des musées nationaux.
La décision finale qui fixe la valeur libératoire de l'oeuvre
proposée en dation relève du ministre des Finances. Celui-ci a
toujours suivi dans les faits l'avis de la Commission. Cette décision
précise toujours l'affectataire des oeuvres acceptées en dation -
ce qui ne permet pas toujours de préciser la localisation effective de
l'oeuvre. Dans la réponse écrite fournie au rapporteur par le
ministère de l'Économie et des Finances, il est
précisé :
"
La dation est la remise à l'État d'un bien pour une
valeur libératoire de l'impôt. La valeur libératoire n'est
pas une valeur marchande. C'est l'estimation de la valeur objective d'une
oeuvre qui tient certes compte de la valeur de marché mais aussi
d'autres éléments comme :
•
l'appréciation du complément que le bien
constituerait pour les collections nationales;
• la commodité pour les héritiers demandeurs de ne pas
organiser une vente qui demande du temps et induit des frais
supplémentaires;
• l'intention libérale des offreurs de voir une oeuvre entrer dans
les collections nationales.
La référence à la valeur libératoire et non
à un prix de marché évite d'ailleurs que la valeur
fixée ne serve de référence ou de cote sur le
marché de l'art, l'État n'étant pas en l'espèce un
simple acheteur participant au mouvement spéculatif de ce
marché
".
La Commission des dations qui donne son avis sur la valeur libératoire
des oeuvres offertes en dation, s'entoure de plusieurs experts,
généralement des conservateurs de musées
spécialisés en fonction de la nature de l'oeuvre offerte.
Ces experts publics rédigent une fiche d'appréciation comportant
notamment les prix obtenus en ventes publiques. Ils portent cette
appréciation sur la valeur libératoire compte tenu notamment de
l'état de l'oeuvre, de son importance pour les collections nationales et
de son intérêt artistique.
La décision d'acceptation ou de refus d'agrément de l'offre de
dation est notifiée au demandeur. Lors de son audition par le rapporteur
M. Jean-Pierre Changeux, Président de la Commission des dations,
" a souligné le caractère fondamentalement volontaire de la
procédure, dans la
mesure où l'offre initiale, qui est
assortie d'une évaluation chiffrée de l'oeuvre et d'une
expertise, peut toujours être retirée, même après
l'acceptation du ministre
. "
La Cour des comptes avait formulé les observations suivantes sur le
fonctionnement de la procédure de dation :
• l'acceptation de la procédure de dation pour les
donations-partages en l'absence de disposition législative l'autorisant ;
• l'inobservation de certaines dispositions réglementaires,
telles que l'acceptation d'offres de dation déposées plus de 6
mois après le décès du " de cujus ", l'absence d'octroi
d'un délai de 30 jours à l'offreur pour qu'il accepte
définitivement la décision ou le dépassement d'un
délai d'un an à compter du dépôt de l'offre pour la
notification de la décision définitive;
• l'imprécision des décisions d'agrément sur
des points comme la désignation des oeuvres ou documents objets de la
dation, l'origine de propriétés des biens offerts ou la preuve du
transfert de propriété à l'État des oeuvres ou
documents acceptés en dation ;
• les modalités de détermination de la valeur
libératoire, trop souvent égale au montant des droits dus.
Après les observations de la Cour des comptes, la procédure a
fait l'objet d'une série d'aménagements :
• l'application des majorations de retard, lorsque l'offre est
déposée après le délai de 6 mois à compter
du décès, sur la période courant de la fin du délai
de 6 mois jusqu'au dépôt de l'offre ;

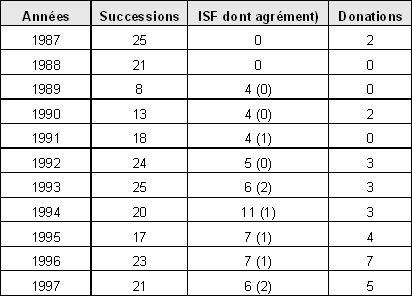
• l'intégration d'un délai de 30 jours d'acceptation
de la décision d'agrément par l'offreur de la dation ;
• la mention dans les décisions d'agrément de la
consistance de la dation en joignant une liste annexe si besoin est ;
• la recherche de l'origine de propriété des biens
offerts en dation ;
• la délivrance d'une décision d'agrément
seulement après prise en charge des oeuvres par leur
établissement affectataire ;
En ce qui concerne la valeur d'agrément, la commission prend bien garde
de distinguer, valeur libératoire et prix du marché, même
si en pratique, comme l'a indiqué M. Jean-Pierre Changeux devant le
rapporteur, la commission "
prenait toujours comme
référence le prix du marché international. La commission a
d'ailleurs constitué une banque de données lui permettant de
juger des propositions faites à la commission. Il a rappelé que
l'oeuvre faisait l'objet d'un double examen portant d'abord sur la valeur
artistique et, ensuite, sur la valeur de marché. Globalement, il a
indiqué que le bilan de la commission faisait apparaître que les
valeurs libératrices préparées par les offreurs
étaient, en général, raisonnables mais parfois
révisées à la baisse et que dans certains cas, même
révisées à la hausse par souci d'équité et
de façon à éviter toute contestation
.
Lorsque la valeur libératoire est inférieure à la dette
exigible, le débiteur s'engage à verser un complément de
droits mais dans le cas contraire l'État ne verse pas de soulte au
débiteur.
(2) Les propositions du rapporteur
On
trouve dans le rapport de la commission Aicardi exprimée l'idée
que le régime de la dation pourrait être assoupli et en quelque
sorte généralisé: les personnes privées seraient
incitées à acheter des trésors nationaux en vue de les
donner à une collectivité publique. Dans ce cas,
l'acquéreur devrait bénéficier d'un crédit
d'impôt (sur le revenu, sur le fortune, sur les sociétés,
droits de mutation) égal selon les cas à la totalité, si
la donation est pure et simple, ou à une fraction du prix d'acquisition,
s'il se réserve un usufruit limité dans le temps.
Si le crédit ne peut être épuisé dés la
première année, ce qui n'est pas improbable, ce surplus serait
reportable dans une limite à déterminer cinq à dix ans,
cette période coïncidant éventuellement avec celle de
l'usufruit). Si le crédit n'a pas été utilisé par
le donateur pour cause de décès, il serait donc transmissible aux
héritiers et dans ce cas pourrait, une fois actualisé, servir
à régler en tout ou en partie les droits de mutation.
L'idée avancée par le rapporteur est assez voisine dans son
principe mais moins ambitieuse dans la mesure où elle constitue non une
généralisation la dation à tous les impôts mais une
simple extension de la dation aux cas où la valeur des biens offerts et
acceptés en dation excéderaient - dans une proportion
raisonnable, fixée à 30 % - les droits dus.
Le régime prévoit également que pour une période de
temps limitée - fixée à 10 ans, le contribuable puisse
conserver l'
usufruit
de l'oeuvre acceptée pour laquelle il n'a
pas épuisé son crédit d'impôt.
Enfin, on pourrait songer, toujours en suivant la voie ouverte par le rapport
Aicardi à permettre à un contribuable qui ferait don à une
institution publique d'une oeuvre classée ou n'ayant pas obtenu le
certificat, de bénéficier d'un crédit d'impôt sur
les droits de mutation ou l'ISF - calculé par rapport à la valeur
de son usufruit. Une idée de ce type viendrait utilement compenser le
maigre bilan de l'exonération de l'article 1131
86(
*
)
d) Un problème grave: les mécanismes de la TVA interne jouent contre le patrimoine
La TVA
est un mécanisme qui, traditionnellement, taxe les importations et
subventionne les exportations ; en matière d'oeuvres d'art, cette
logique aboutit à des résultats particulièrement
désastreux du point de vue du patrimoine national : elle freine
l'entrée sur le territoire d'oeuvres, qui pourraient venir enrichir le
patrimoine national ; elle incite aussi les marchands à exporter.
Avant 1991, les antiquaires qui faisaient vendre aux enchères, en
France, des objets leur appartenant, ne devaient pas acquitter la TVA sur ces
ventes. Mais la loi du 26 juillet 1991 a supprimé cette
exonération. Les antiquaires doivent acquitter la taxe sur lesdites
ventes sauf si les objets en question sont exportés par les
adjudicataires.
Dans une profession où les consommations intermédiaires sont
faibles et où les possibilités de se faire rembourser la TVA sont
limitées, l'exportation présente, indépendamment des
questions de clientèle, un avantage décisif : on ne paie pas
de TVA (à 20,6 %) sur la marge.
Le tableau de Poussin vendu pour quelques centaines de milliers de francs
à l'Hôtel Drouot dans une vente sans catalogue ne sera jamais
remis en vente en France par le marchand qui l'a acheté en faisant le
pari de son authenticité ; son intérêt commercial de
marchand talentueux est bien de le remettre - directement ou indirectement - en
vente à New-York.
A supposer même que la personne qui l'a acquis, l'aurait fait au
même prix à Paris, le marchand, lui, aurait, pour un prix de vente
de près de 40 millions de francs dû payer plus de 6 millions de
francs de TVA !
Or c'est le vendeur qui, on le répète, décide de la
localisation des ventes. Même intégré dans le
bénéfice imposable, le gain est trop substantiel pour qu'un
professionnel y renonce.. Ceci pourrait même être un des facteurs
accessoires du déclin de la Grande-Bretagne par rapport aux
États-Unis dans les exportations françaises puisque depuis que le
premier pays applique la TVA quel qu'en soit le taux, les ventes à
Londres ne sont plus considérées comme des exportations.
A l'attraction naturelle du marché américain due au dynamisme de
la demande, s'ajoute une incitation fiscale. La TVA fonctionne donc, dans le
cas particulier des oeuvres de prix élevé mises en vente par les
marchands, et surtout s'il s'agit une oeuvre redécouverte, comme une
pompe qui viderait la France de son patrimoine.
Le rapporteur n'a pas de solution pour pallier les effets pervers
inhérents au mécanisme de bas de la TVA, mais il convenait
d'attirer l'attention sur un phénomène particulièrement
grave.







