Marché de l'Art : les chances de la France
GAILLARD (Yann)
RAPPORT D'INFORMATION 330 (98-99) - COMMISSION DES FINANCES
Table des matières
-
INTRODUCTION
-
I. LE DÉCLIN DU MARCHÉ DE L'ART EN FRANCE
- A. UN MARCHÉ NATIONAL EN VOIE DE MARGINALISATION ?
-
B. UN MARCHÉ MONDIAL EN VOIE DE GLOBALISATION
- 1. Un marché international dès l'origine
- 2. La nouvelle donne mondiale
- 3. La bulle spéculative des années 80
- 4. La marche vers la globalisation
- C. DES ENJEUX RÉELS OU VIRTUELS POUR LA FRANCE ?
-
II. LES VOIES DE LA RENAISSANCE
- A. LA PROBLÉMATIQUE DE LA COMPÉTITIVITÉ
- B. DES ATOUTS DIFFUS MAIS RÉELS
-
C. L'ACCUMULATION DE HANDICAPS PONCTUELS
- 1. La fiscalité et les charges
- 2. L'instabilité liée aux interventions de l'administration
- 3. La stabilité juridique incertaine
- 4. Les structures
-
D. LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
- 1. Tenir compte de la marge de manoeuvre restreinte en matière de charges
- 2. Dynamiser les structures
-
3. Assurer le bon fonctionnement du marché
- a) Écarter une fois pour toutes l'application de l'impôt sur la fortune
- b) L'aménagement de la taxe forfaitaire et le relèvement de son seuil à 60 000 francs
- c) Ne pas appliquer le droit de reproduction aux catalogues de vente
- d) Renforcer la fiabilité juridique, améliorer la transparence
- e) Améliorer l'environnement des marchands et collectionneurs
- 4. Préserver le patrimoine national dans un marché ouvert
- 5. Encourager la création contemporaine
-
I. LE DÉCLIN DU MARCHÉ DE L'ART EN FRANCE
- DIX PROPOSITIONS POUR RELANCER LE MARCHÉ DE L'ART ET SAUVEGARDER LE PATRIMOINE
- EXAMEN EN COMMISSION
-
COMPTES-RENDUS DES ENTRETIENS
DU RAPPORTEUR
N°
330
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 avril 1999
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur les aspects fiscaux et budgétaires d'une politique de relance du marché de l'art en France ,
Par M.
Yann GAILLARD,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.
|
Arts et spectacles. |
"Cette oeuvre, que j'avais vendue 500 francs",
maugréa
Degas en apprenant que ses "Danseuses à la barre" venaient d'être
adjugées, en cet après-midi de 1912 à l'hôtel
Drouot, pour 430.000 francs. Il ajouta : "Je ne crois pas que celui qui a peint
ce tableau soit un sot, mais ce dont je suis certain, c'est que, celui qui l'a
acquis est un con."
Maurice Rheims - Les collectionneurs
Lettre de Degas à Ludovic Halevy
"Tu vois que malgré cette fétide chaleur et la lune pleine, je ne
puis quitter ce sombre atelier où m'attachent l'amour et la gloire"
Septembre 1895
INTRODUCTION
Quelle
importance attacher au marché de l'art ? Au-delà du
retentissement des grandes ventes, des ressauts de la cote, des
déclarations et polémiques savantes, ce qu'on appelle LE
" marché de l'art ", a-t-il une dimension économique
suffisante pour retenir durablement l'attention des pouvoirs publics
?
Combien d'entreprises, combien d'emplois, combien de milliards
? Ou,
s'il faut dépasser cette vue terre à terre, s'agissant d'une
activité qui touche aux plus hautes productions de l'esprit humain, et
singulièrement du génie français, comment traduire en
décisions pratiques cette valeur reconnue aux symboles ?
Toute réflexion sur le marché de l'art
en France
-" Mère des arts " -
doit éviter deux écueils
symétriques
: une
approche par trop réaliste
,
qui conduit à
l'indifférence
, voire au
laisser-faire ; une
exaltation esthétique qui peut conduire
,
au nom du prestige,
à conférer une importance
exagérée
au marché de l'art, eu égard à
d'autres urgences, plus générales ou plus pressantes, qui
requièrent l'attention du pays, et l'allocation des moyens
budgétaires.
L'attention renouvelée que la France apporte au fonctionnement de son
marché de l'art -dont témoigne modestement le présent
rapport d'information- est due à deux événements :
l'un juridique, l'autre psychologique. Le premier, c'est l'obligation dans
laquelle notre pays s'est trouvé, de par les règles de la
concurrence à l'intérieur de l'Union européenne, de mettre
fin au monopole de commissaires-priseurs. Le second, c'est la
prise de
conscience
-que la longue maturation de ce texte n'a fait
qu'approfondir-
d'un fait hélas ! regrettable
:
notre
marché de l'art
,
jadis glorieux
, voire le premier du monde,
s'est depuis un
demi-siècle affaissé
, et Paris a fortement
reculé par rapport à Londres, sans même parler de New-York.
Faut-il pour autant sonner le tocsin ? Nombre de spécialistes et de
professionnels éminents le pensent. Encore faut-il pouvoir proposer des
mesures politiquement réalistes (en interne et sur le plan
européen). Il ne suffit pas d'affirmer, par exemple, que la
fiscalité ou la parafiscalité européenne doivent s'aligner
sur les pratiques anglo-saxonnes, pour que cette prise de position, gratifiante
sur le plan intellectuel, puisse déboucher sur des décisions
effectives, si lourds sont les facteurs de blocage, politiques,
économiques, diplomatiques.
Il convient donc
,
de se frayer un chemin à égale
distance des deux
tentations
qu'on vient d'évoquer ; de
prendre son parti avec réalisme
des dommages historiques
, sans
doute irréversibles, subis par notre marché de l'art ;
mais de définir
pour celui-ci une
vocation
et un
créneau " tenables ", compte tenu de la
spécificité des différents segments de ce marché,
et de la position plus ou moins favorable qui reste celle de notre pays (forte
pour le mobilier XVIII
ème
, moins forte déjà
pour les grands impressionnistes et les classiques de l'art moderne, faible
pour l'art contemporain) ; défendre becs et ongles la
3
ème
position, qui est celle de la place de Paris, en
veillant à ne pas laisser accroître exagérément la
distance qui la sépare de celle de Londres, sachant que New-York est
désormais hors d'atteinte. Dans la définition d'une telle
politique, le texte qui vient devant le Parlement sur la réforme du
marché de l'art et les ventes volontaires joue un rôle central
mais non exclusif. Non moins importants, sont les problèmes fiscaux et
parafiscaux :
pour les deux questions-clés, TVA à
l'importation et droit de suite, c'est à Bruxelles que la partie se
dispute
, et, compte tenu de la détermination britannique à
conserver son avantage relatif, elle est loin d'être gagnée.
Une telle ligne est difficile à définir, plus encore à
maintenir compte tenu de la multiplicité des catégories
professionnelles, aux intérêts souvent contradictoires, qui
animent ce marché de l'art (commissaires-priseurs, auctioneers,
marchands, experts, galeristes - sans oublier les artistes eux-mêmes et
leurs ayants-droit). Elle ne peut, en outre, se complaire dans la contemplation
du fonctionnement interne du marché de l'art lui-même, car il ne
faut pas oublier ce à quoi, en principe, il sert, ou que, du moins, il
ne doit pas desservir : la protection du patrimoine national, et le
développement de la création artistique sur notre sol.
Il convient enfin de signaler une difficulté :
le marché
de l'art en France
est mal connu
, faute d'enquêtes
statistiques analogues à celles auxquelles les professionnels
britanniques procèdent (que résume cette année " The
british art market ").
Ce n'est qu'un indice de plus de notre trop long
laisser-aller
. Cette lacune est dommageable : si elle n'était
pas comblée rapidement, nous continuerons à agir - ou à ne
pas agir - en aveugle.
*
* *
L'art
est un signe extérieur de richesse culturelle et matérielle.
C'est de cette double nature que résulte toute l'ambiguïté
de la question de l'imposition des oeuvres d'art, que certains sont
tentés de taxer au nom de la nécessaire contribution de tous aux
charges publiques, alors qu'il est non moins légitime de les soustraire
à l'impôt au nom de la sauvegarde du patrimoine national.
Au-delà des échéances politiques, ce rapport veut replacer
le problème de la relance du marché de l'art en France dans son
contexte historique et économique, quitte à remettre en cause un
certain nombre d'idées reçues, qu'il s'agisse de faits ou de
principes ; car
il ne faudrait pas que le Parlement ne
légifère sur fond de mythes ou de croyances, entretenues pour des
raisons diverses et parfois contradictoires
.
Sur le plan des faits, on peut souligner que :
• le marché de l'art français a toujours eu une place
éminente mais moins dominante qu'on le dit souvent, dans la mesure
où un certain nombre de facteurs politiques et économiques ont
toujours amené la France à partager son leadership avec
l'Angleterre : c'est dans cette perspective structurelle, qu'il faut se
demander dans quelle mesure il est possible d'en revenir à l'âge
d'or du début des années cinquante - si tant est qu'il ait jamais
existé ;
•
la hausse des prix
sur le marché de l'art
est, sur le
long terme
, et dès lors que l'on prend en compte l'ensemble des
oeuvres,
loin d'être évidente
: la
conviction du
rapporteur est bien que l'art est un jeu de loterie ou les gains parfois
très élevés des uns, sont compensés par les
pertes plus ou moins importantes des autres
; d'où l'importance
dans ce rapport, des développements empiriques sur l'évolution
des prix de l'art ;
En ce qui concerne les principes, il convient aussi de s'interroger sur la
validité d'idées ou d'attitudes, aussi largement répandues
chez nous qu'ignorées à l'étranger, le plus souvent
imprégné du pragmatisme anglo-saxon :
• il faut se poser la question
: peut-on garantir
l'authenticité des oeuvres par des moyens juridiques
, alors que les
professionnels affirment qu'il est, dans la plupart des cas, difficile
d'apporter pour les oeuvres anciennes une certitude d'authenticité
absolue, en dépit des progrès de la science ?
• enfin, le marché de l'art a une importance
économique mais surtout une
fonction culturelle essentielle
, qui
en fait autre chose que le terrain de jeu d'une petite minorité de
privilégiés : il y a des synergies et des
complémentarités entre marché et collections
privées, entre collections privées et collections publiques,
entre le marché et l'histoire de l'art, dont les progrès ne
tiennent pas qu'à l'action désincarnée des seuls
professeurs et conservateurs.
Le problème est donc
de définir une fiscalité du
marché de l'art
qui
, sans méconnaître sa valeur
économique,
tienne compte de sa valeur culturelle
. Il ne faudrait
pas que, par une sorte de politique de gribouille, une fiscalité
excessive ou maladroite aboutisse à encourager l'exode massif hors de
nos frontières d'oeuvres pour lesquelles nous mobilisons par ailleurs
des moyens budgétaires croissants mais toujours insuffisants.
Le présent rapport doit beaucoup à l'abondante littérature
universitaire existant sur le sujet, ainsi qu'aux personnalités, qui ont
accepté de rencontrer le rapporteur, marchands experts ou
commissaires-priseurs, fonctionnaires de toutes les administrations,
journalistes ou artistes, parmi lesquelles il convient de rendre un hommage
tout particulier aux auteurs des rapports qui ont contribué à
faire évoluer les esprits, MM. Aicardi et Chandernagor, qui retrouveront
ici l'écho de leurs réflexions.
I. LE DÉCLIN DU MARCHÉ DE L'ART EN FRANCE
Au
début des années cinquante, la France était au coeur du
marché de l'art mondial. Deux facteurs expliquaient cette position
exceptionnelle, généralement présentée comme
dominante : la tradition de compétence de ses professionnels,
marchands ou commissaires-priseurs ; une hégémonie
culturelle, tant pour les valeurs du passé que pour celles du
présent.
Aujourd'hui, la place de la France, sans être négligeable,
apparaît sinon marginale, du moins modeste sur un marché
désormais mondial. Quantitativement notre pays est désormais loin
derrière les États-Unis et l'Angleterre.
D'un point de vue qualitatif, la situation de notre pays est cependant plus
contrastée.
D'une part, la distance apparaît encore plus importante si l'on examine
les rapports de force économiques entre les agents opérant sur le
marché mondial de l'art. D'un côté, il y a les
commissaires-priseurs français en ordre dispersé,
cantonnés de facto en leurs lieux de résidence ; de l'autre,
de grandes sociétés commerciales intégrées,
présentes dans tous les pays et sur tous les compartiments du
marché.
D'autre part, surtout pour l'art ancien, on ne peut manquer de relever le
dynamisme des opérateurs de nationalité française, qu'il
s'agisse des marchands ou des experts travaillant dans les deux grandes maisons
de vente anglo-saxonnes. En outre, sur le marché de l'art comme dans
d'autres secteurs, on est amené, lorsque l'on tient compte des
participations au capital, à relativiser la notion de nationalité
des opérateurs.
A. UN MARCHÉ NATIONAL EN VOIE DE MARGINALISATION ?
On a de
plus en plus tendance à réduire le marché de l'art aux
ventes aux enchères. Or, celles-ci ne sont que la partie
émergée de l'iceberg, par rapport à l'ensemble du commerce
de l'art et des antiquités.
Un certain nombre de membres de la commission ont insisté sur la part
non visible, comme immergée du marché de l'art, dite " en
chambre ". Ainsi l'importance de l'économie informelle liée
au marché de l'art vient se surajouter à la mauvaise
qualité des informations dont on dispose sur l'activité
elle-même, souvent mal isolée dans les statistiques officielles.
Compte tenu de ces incertitudes, il est nécessaire de raisonner plus en
termes de tendance que de niveau absolu. L'évolution récente,
marquée par la crise profonde des années 90, conduit à
distinguer l'art ancien qui se maintient et même se développe, de
l'art contemporain, dont le recul est particulièrement sensible
après l'engouement spéculatif de le fin des années
80.
1. L'état des lieux statistique
Que
l'art comme les activités artistiques en général
entretiennent des rapports ambigus avec les chiffres, n'est que la
manifestation des ses relations paradoxales avec l'argent.
D'un côté, l'art, célébré comme une des
expressions de l'esprit humain les plus nobles et les plus achevées,
fait partie du patrimoine de l'Humanité et est donc, à proprement
parler, hors de prix ; de l'autre, il fait l'objet d'échanges
marchands, parfaitement mesurables ponctuellement, même si la
détermination des prix ne semble répondre à aucune
règle objective. Comme l'ont noté très tôt les
économistes classiques que le cas d'espèce intéressait
comme l'exception qui confirme la règle, chaque oeuvre est unique et
échappe à ce titre aux lois communes de la valeur.
Plusieurs facteurs expliquent qu'il est difficile d'approcher la
réalité du marché de l'art à partir des chiffres.
1. D'abord, parce que du fait même de l'évolution de l'art
,
il n'y a plus de frontière objective au champ artistique
:
• autrefois, l'Académie était là pour faire la
part de ce qui appartenait au domaine de l'art de ce qui n'en faisait pas
partie, c'est elle qui détenait le monopole du cursus des artistes, dont
elle assurait la formation puis la consécration à travers
l'institution des Salons officiels ;
• à l'heure actuelle, il suffit de visiter une foire ou des
galeries pour constater qu'il n'est plus possible de définir
objectivement de façon simple ce qu'est l'art, si ce n'est par
l'intention des auteurs ou de ceux qui les montrent : aujourd'hui,
être artiste est la combinaison d'une vocation intérieure, d'une
reconnaissance par les pairs et/ou par les institutions muséales
publiques et de l'existence de revenus tirés de cette
activité ;
• cette frontière entre l'art et le non-art ne peut que
rester floue, mouvante et en tout cas peu propice à des statistiques
fiables et significatives : on l'a laissé entendre pour l'art
contemporain où nombre d'artistes ne vivent pas de leur art mais
d'activités annexes dans l'enseignement ou dans
l'éducation ; mais cela est vrai aussi dans l'art ancien où,
comme le montre l'exemple des marchés aux puces, il n'y a pas de
séparation nette entre la brocante en provenance des greniers et le
marché des antiquités au sens le plus noble.
2. Ensuite, parce que sur le marché de l'art les échanges se
font à des prix dont on ne peut jamais, compte tenu de l'unicité
de chaque oeuvre, être vraiment sûr qu'il soient significatifs,
même si la notion même de cote et surtout d'estimation s'agissant
d'objet mis en vente publique, montre qu'il existe une certaine
rationalité, que des arbitrages se font. Il en résulte plusieurs
conséquences :
• Il est difficile, indépendamment même des
problèmes de dispersion autour de la moyenne, de donner une
portée générale à une cote ou à un indice,
qui recouvrent des choses diverses, bien qu'en statistique on agrège
rarement des produits ou des activités homogènes :
• l'absence de lien objectif entre prix et caractéristiques
de l'oeuvre rend opaque le processus de détermination du prix de l'art.
Comme l'écrivait Raymonde Moulin, le marché de l'art est
"
le lieu de cette secrète alchimie qui opère la
transmutation d'un bien de culture en marchandise. Un mystère savamment
entretenu entoure les combinaisons mercantiles, économiquement
valorisantes mais culturellement dévalorisantes : les prix ne sont
pas transparents ; une partie des transactions s'effectue dans la
clandestinité ; les phénomènes inquantifiables ou
invisibles l'emportent sur les données apparentes et
mesurables.
1(
*
)
"
• Parallèlement, ce manque de transparence dans la formation
des prix se double d'un certain flou des circuits des transactions laissant
supposer que l'économie de l'art est en partie souterraine, soit du fait
de l'origine des oeuvres, soit du fait de celle de l'argent.
3. A ces facteurs d'incertitude, s'ajoutent les conséquences d'une
logique administrative qui n'appréhende pas bien l'activité
artistique sa diversité ; nul doute que l'une des premières
conclusions de ce rapport sera d'inviter le Gouvernement à rechercher
les moyens d'affiner l'appareil de mesures statistique et d'établir les
liens qui relient le marché de l'art aux autres activités
économiques.
a) Le commerce de l'art
Les données relatives au commerce sont rares anciennes et d'interprétation difficile. On a d'abord fait état de chiffres communiqués par l`INSEE ; on les a complété par des éléments d'origine sociale grâce aux informations fournies par la sécurité sociale des artistes.
(1) Les antiquaires et brocanteurs (données INSEE)
Les
antiquaires et les marchands de tableaux n'ont pas de véritable statut.
Ils procèdent à des ventes "de gré à gré" et
ont pour ce faire, la qualité de commerçant. Dès l'instant
où ils ont pour activité "la vente ou l'échange d'objets
mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les
fabriquent ou en font le commerce", ils sont soumis aux dispositions de la loi
du 30 novembre 1987 qui prévoit l'obligation d'une inscription à
la préfecture
2(
*
)
et la tenue d'un
registre spécial dit "livre de Police".
On distingue traditionnellement les antiquaires, les brocanteurs et les
marchands de tableaux modernes ou contemporains. La loi ne différencie
pas les antiquaires, des brocanteurs. Mais le Syndicat National des Antiquaires
a publié les "Us et coutumes" de la profession. Il y est
précisé que ses membres doivent se considérer d'abord
comme des spécialistes de la recherche, de l'identification des objets
de façon à être en mesure de formuler un diagnostic sur son
authenticité.
On doit admettre, par opposition, que les brocanteurs peuvent se contenter de
proposer des objets dont ils ignorent l'auteur et l'époque de
création et pour lesquels ils ne donnent aucune garantie.
Combien existe-t-il en France d'antiquaires et de brocanteurs ? On avance le
chiffre de quinze mille. Mais, à côté de ces quinze mille
professionnels régulièrement inscrits au registre du commerce, il
existerait vingt-cinq mille professionnels non déclarés.
L'INSEE fournit cependant quelques indications plus précises sur
l'activité " Antiquaires, brocante, dépôts
vente " (code : 52.5 Z).
Cette classe comprend :
- le commerce de détail de livres d'occasion, y compris les
" bouquinistes "
- le commerce de détail d'autres biens d'occasion (brocante, fripes,
meubles, matériaux de démolition etc.)
- le commerce de détail d'antiquités et objets anciens
- le commerce de détail en magasin de dépôt vente
- cette classe ne comprend pas le commerce de détail de
véhicules automobiles d'occasions, le commerce de détail de
timbres et pièces de collection, les services offerts par les ventes
publiques, la restauration d'objets d'art et de meubles.
Les tableaux ci-joints montrent que selon l'enquête commerce de 1996 de
l'INSEE, le secteur ainsi défini comptait 12 532 entreprises pour un
chiffre d'affaires de 10.686 milliards de francs et un effectif salarié
à la fin de 1996 de 10 768 personnes pour un nombre de personnes
occupées, en équivalent temps plein, de 20 931.


On note que 80 % des entreprises du secteur font moins de 1 million de
francs de chiffre d'affaires et seulement 0,3 % plus de 10 millions de francs.
Les dix plus grandes entreprises dans cette activité classées
dans l'ordre des numéro SIREN étaient en 1996 :
- Galerie Hopkins-Thomas
- Galerie Ratton Ladrière
- Habib SA
- Gismondi galeries
- Art conseil international
- Bouquin Institut librairie Mazo Lebouc
- Société Didier Aaron et Cie
- Société Kraemer Cie
- Galerie Daniel Malingue
Ce " top 10 " des entreprises du secteur de l'antiquité et de
la brocante ne donne sans doute pas une image actuelle de l'importance
réelle des différents agents. D'abord, parce que le chiffre
d'affaires est dans ce secteur particulièrement fluctuant et il n'est
pas certain que l'on retrouve dans ce classement les mêmes
sociétés tous les ans ; ensuite, parce qu'il est bien connu
qu'un certain nombre de professionnels travaillent à partir de
sociétés implantées à l'étranger au nom
desquelles elles font rentrer la marchandise en importation temporaire.
Les antiquités, objet d'art et meubles anciens représenteraient
60 % du chiffre d'affaires total hors taxes du secteur.
(2) Les données sociales en provenance la maison des artistes
Il
existe
deux catégories de diffuseurs
qui contribuent au
régime de protection sociale des artistes.
Il s'agit, tout d'abord, du diffuseur qui revend l'oeuvre originale au public
et qui doit verser une
contribution de 3,30 % sur 30 % de son
chiffre d'affaires TTC
ou, s'il a perçu une commission sur vente,
sur la totalité TTC de la commission.
Il s'agit du
galeriste
, de
l'éditeur d'art
, de
l'agent
artistique
, du courtier en oeuvres d'art, également de
l'antiquaire
ou du
brocanteur,
car l'oeuvre vendue, même
tombée dans le domaine public, est assujettie à la contribution,
des commerces divers et associations qui exposent les artistes et
perçoivent une commission sur les ventes, quel que soit leur statut
juridique.
Il s'agit ensuite du diffuseur qui exploite commercialement l'oeuvre originale
ou l'expose au public (État, Collectivités publiques,
Éditeurs, Publicistes, Sociétés, PME, Association...) sans
que celle-ci soit revendue au public. Il se doit de déclarer à la
Maison des Artistes les rémunérations ou les droits d'auteur
versés à l'artiste ou à ses ayants-droit.
Il est redevable d'une contribution d'un
taux de 1 % calculée
sur la rémunération hors TVA de l'artiste
ou de ses
ayants-droit.
Nous dénommerons, pour la lisibilité des tableaux, les premiers
" diffuseurs commerciaux " et les seconds " diffuseurs non
commerciaux ".
Le premier tableau ci-après fait apparaître
l'évolution
de l'effectif global des diffuseurs commerciaux et de celui des galeries
de 1989 à 1997
, et de leur chiffre d'affaires respectif.
Il apparaît clairement que la fracture liée à la crise du
marché de l'art a eu lieu en 1991, du moins à travers les
chiffres d'affaires. En effet, le chiffre d'affaires global comme celui des
galeries chute d'environ 1,5 milliard de francs en un an. Cette crise
économique du secteur ne se traduit pas par une fermeture
proportionnelle des galeries pour la simple raison que seules quelques grandes
galeries à très fort chiffre d'affaires ont fermé leurs
portes.
La crise n'a pas eu réellement d'effet sur le flux moyen annuel de
création et de fermeture de galeries.
Comme l'indique le tableau ci-dessous, le chiffre d'affaires des galeries d'art
n'a fait que chuter depuis 1991, une légère amorce de reprise
semble s'ébaucher en 1997.
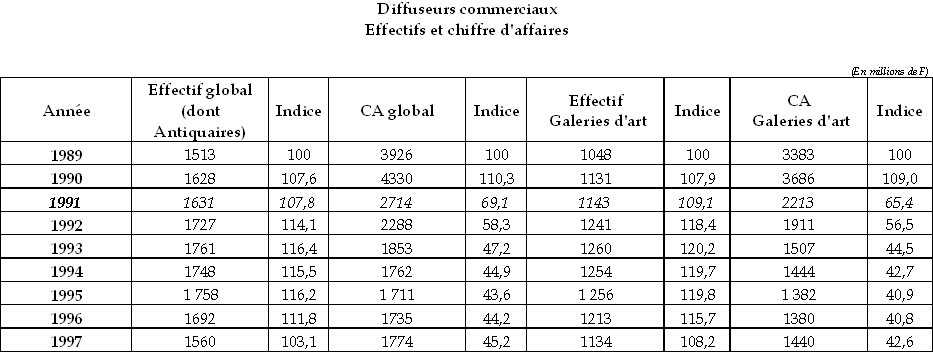
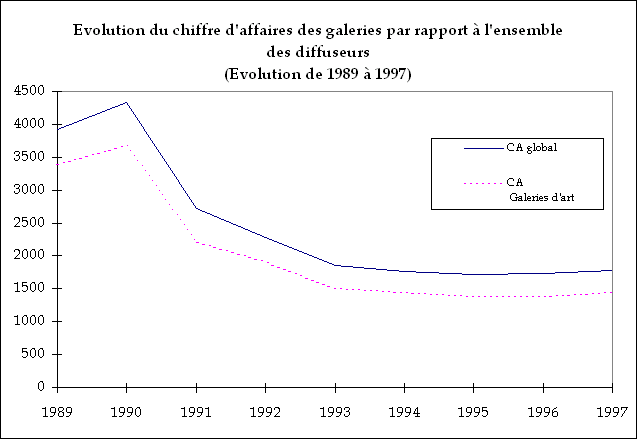

Les différentes données chiffrées de la maison des
artistes nous ont permis de faire apparaître la part des deux types de
contributeurs au régime de protection sociale des artistes. Il est
intéressant de noter que la part des diffuseurs
" commerciaux " ne fait que décroître jusqu'en 1996 et
amorce une légère progression au cours des deux dernières
années, traduisant sans doute le début d'un nouveau cycle de
croissance pour le marché de l'art.
Les contributeurs " non commerciaux " voient leur participation
croître régulièrement, mais leur contribution est
inversement proportionnelle à leur nombre, 5.142, sur un
effectif
total de 6.775 diffuseurs en 1998
.



Enfin, un dernier tableau fait apparaître la part des contributions des
diffuseurs et des artistes au régime de protection sociale de ces
derniers.
Les chiffres montrent que la participation des diffuseurs ne correspond
qu'à une contribution de solidarité. D'ailleurs, il faut
souligner qu'une loi du 27 janvier 1993 a modifié la nature de
la contribution des diffuseurs qui, depuis lors, n'ont plus à contribuer
à l'équilibre du régime de protection sociale des artistes.


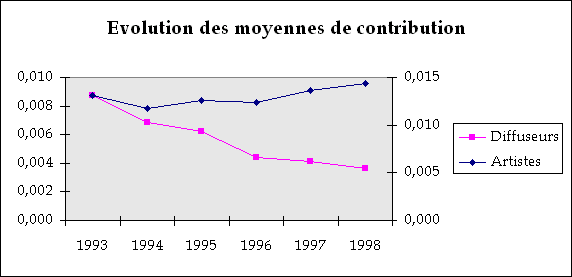
b) Les artistes
Les
données chiffrées concernant les artistes sont à
interpréter avec la plus grande précaution, tant les
frontières de la population artistique sont devenues floues, qu'il
s'agisse de la frontière entre l'art et les métiers d'art ou de
l'artiste professionnel et de l'amateur.
Les seuls chiffres dont nous avons pu disposer sont ceux des artistes
recensés par la maison des artistes et qui sont donc affiliés
à la sécurité sociale. En effet, le ministère de la
culture ne dispose d'aucun autre recensement et n'exploite pas les
données brutes que reçoit la maison des artistes.
En 1998, le nombre des artistes recensés s'élève à
15.001 contre 10.640 en 1988, soit une augmentation d'environ 40 %. Cette
progression apparemment importante, est moins satisfaisante que celle
observée entre 1981 et 1988 où le nombre total des artistes
affiliés à la sécurité sociale avait
augmenté de 50 %.
On peut cependant évaluer le nombre total d'artistes, sous les
réserves évoquées ci-dessus, entre 25 et 30.000, soit le
double du nombre des artistes affiliés.
Parmi ceux-ci, les peintres restent toujours largement en tête,
puisqu'ils représentent la moitié de la population des
créateurs (7521), mais leur progression est largement distancée
par les trois disciplines qui " montent ", et qui sont d'ailleurs les
plus récemment entrées dans la " nomenclature "
artistique. Il s'agit, par ordre décroissant, des dessinateurs
textiles, des plasticiens et des graphistes.
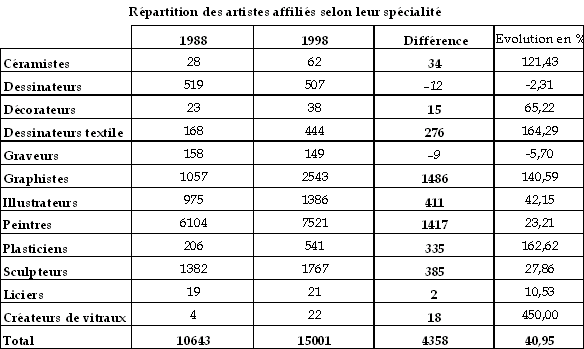


On peut
ensuite constater que la crise du marché de l'art a affecté le
revenu des artistes, d'une part, à travers la moyenne de leur revenu,
qui est passé de 117.000 francs en 1991 à environ 100.000
francs en 1996. On observe cependant une légère
amélioration depuis deux ans à peine.
Concernant la répartition par tranche de revenu, nous ne disposons que
d'une photographie 1997, mais il est intéressant de constater par
rapport aux données partielles dont nous disposons en 1988 (Raymonde
Moulin : l'Artiste, l'Institution et le marché) que toujours
moins de 6 % des créateurs
déclarent un revenu annuel
supérieur à 300.000 francs (dont 2 % plus de 500.000 francs),
soit un total de 891 artistes.
En revanche, les artistes déclarant un revenu annuel inférieur
à 50.000 franc, sont passés de 50 % en 1988 à
44 % en 1997. Ils représentent cependant plus du tiers (5953) des
artistes recensés. La précarité des revenus reste donc une
caractéristique du métier d'artiste.




|
(1) Les assiettes sont constituées du forfait d'affiliation pour les revenus < 46 4004 F et du bénéfice fiscal + 15% |
|
* Comprend des artistes exonérés de cotisations (prestataires autres régimes sans bénéfice artistique et artistes sans assiette de cotisations en attente de traitement) |
S'agissant enfin de la répartition par sexe et par
âge.
Sur le premier point, on constate une lente, mais sûre, progression des
femmes, dont le pourcentage était de 23 % en 1981, 27 % en
1988 et 33 % en 1998, ce qui ne préjuge pas toutefois du taux de
réussite à un haut niveau qui reste beaucoup plus faible pour
elles que pour les hommes.
Sur le second point, la population âgée de 60 ans est la plus
importante (2360) et passe de 12,2 % à 15,7 %, soit une
augmentation de 3,5 %, une des plus fortes avec celle de la population des
45-49 ans, qui passe de 11,3 % à 15,5 %, soit une augmentation
de plus de 4 %. Les populations les plus en diminution sont celles des
moins de 29 ans, qui sont passées d'environ 700 en 1988 à 629 en
1998, traduisant probablement le trop haut niveau du seuil d'affiliation
(46.404 francs) au régime pour les artistes débutants. Sur ce
dernier point, une réflexion conjointe était à
l'étude au ministère des affaires sociales et de la culture
visant à diminuer de moitié (23 000 francs) ce seuil
d'affiliation. Cependant l'examen du projet de loi sur la couverture maladie
universelle conduit à suspendre pour le moment toute décision sur
ce sujet.
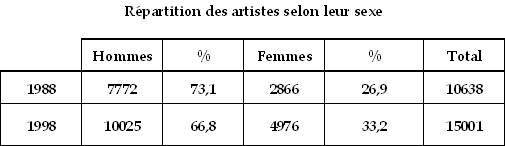

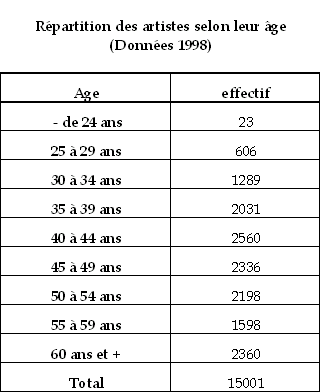

c) Les ventes publiques
La
croissance du marché français des ventes publiques, qui a connu
un taux d'accroissement de presque 6 % depuis 1987 - mais une relative
stagnation depuis 1991 - a plus profité à la province qu'à
la capitale.

Le tableau ci-dessus témoigne d'un certain tassement de la place de
Paris depuis 1987. La compagnie des commissaires-priseurs de Paris perd plus de
6% en termes de part de marché, passant de 46,76 % en 1987 à
40,47 % en 1997. Le taux de croissance du chiffre d'affaires de Paris est
d'ailleurs inférieur de moitié à celui de la compagnie de
la région Lyon sud-est, et plus nettement encore, à celui de la
compagnie Anjou-Bretagne, dont le taux de croissance dépasse 12,5 % par
an.
L'examen des chiffres globaux confirme cette tendance. Ainsi, les ventes des
commissaires-priseurs parisiens sont passées en dix ans, de 1987
à 1997, de l'indice 100 à l'indice 155, contre l'indice 200 pour
les ventes dans le reste de la France, qui ont atteint plus de 5 milliards de
francs, soit un point haut historique, supérieur de 400 millions au
niveau de 1990.
La province a donc mieux résisté que Paris
à la crise.
Comment expliquer cette différence ? Il faut d'abord souligner que
le marché parisien est sans doute assez différent de celui du
reste de la France. D'un côté, il y a un marché
concentré géographiquement, ouvert sur l'extérieur,
naturellement plus spéculatif ; de l'autre, un ensemble de petits
marchés locaux, qui sont restés relativement à l'abri de
la vague spéculative de la fin des années 80, mais qui se sont
trouvés, également, épargnés par le reflux brutal
qui a suivi.
Il faut souligner - et cette remarque est également importante, lorsque
l'on analyse la place du marché français sur le plan mondial -
que les chiffres d'affaires publiés par les commissaires-priseurs
français sont sans doute plus hétérogènes du point
de vue de la nature des lots vendus.
Il n'y a pas que des oeuvres d'art dans le chiffre d'affaires ; cette
proportion serait de 80% pour Paris et 60% pour la province, pourcentages
sensiblement inférieurs à ceux du début de la
décennie, qui était de l'ordre de 90% pour Paris et 75% pour la
Province.
Eu égard au caractère arbitraire de la frontière entre
meuble meublant et oeuvre d'art ainsi qu'à la conjoncture exceptionnelle
de ces années, il faut accueillir ces données avec une certaine
prudence, mais elles témoignent de la part plus importante des oeuvres
et objets d'art dans le chiffre d'affaires des commissaires-priseurs
parisiens
3(
*
)
.
Ces précautions étant prises, on peut néanmoins avancer
des éléments pour expliquer cette meilleure résistance des
commissaires-priseurs de province à la crise.
D'abord, il y a, au delà des différences de marchés, un
phénomène de rattrapage : la profession s'est
rajeunie ; ensuite, elle a manifestement importé les
méthodes " commerciales " plus agressives des
commissaires-priseurs parisiens, au point que les commissaires-priseurs de
province tirent, à l'échelle de leurs affaires, un meilleur parti
de la globalisation du marché : il n'est plus nécessaire de
faire

monter à Paris les oeuvres " saines ". Une bonne photographie dans la Gazette de l'Hôtel Drouot, assortie parfois de l'envoi de l'oeuvre aux fins d'exposition dans les cabinets d'experts parisiens, suffit à assurer un prix au moins aussi élevé qu'à Paris. Les clients des commissaires-priseurs le savent et ont vu qu'il était bien souvent de leur intérêt de confier leur bien à une étude décidée à concentrer ses efforts sur lui, plutôt que de s'en remettre à une vente parisienne où l'objet, certes placé dans une vente spécialisée et donc visible, pourrait faire l'objet d'un traitement moins attentif.
d) Les échanges extérieurs
L'évolution de la balance des échanges
extérieurs d'oeuvres d'art est marquée par un
déséquilibre croissant entre exportations et importations.
En la matière,
on raisonne à front renversé
par
rapport aux autres
secteurs économiques
: un taux de
couverture trop largement positif est non synonyme de performance mais, au
contraire, un phénomène inquiétant, qui témoigne de
l'appauvrissement de notre pays
.
Non seulement, le taux de couverture a tendance sur une quinzaine
d'années à s'accroître passant de 2 à 3 entre 1983
et 1998, mais encore, en dépit de la crise, les montants absolus
recommencent à augmenter au moins pour les exportations.
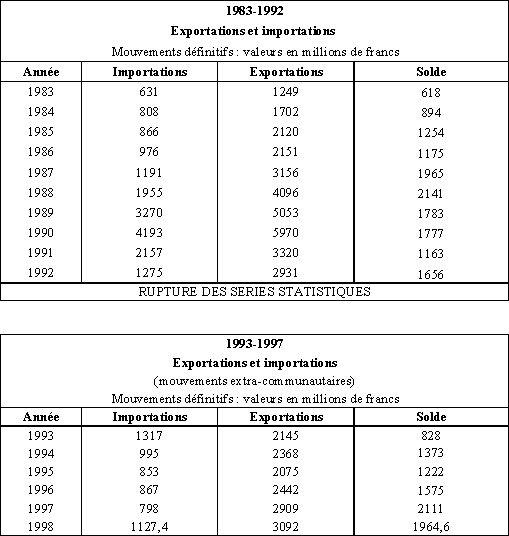
Il en résulte que,
pour la balance globale, l'excèdent passe
d'à peine plus de 600 millions de francs en 1983 à près de
2 milliards de francs en 1998
; c'est un montant proche de ceux des
années 1987 à 1990, mais acquis à des niveaux
d'importations et d'exportations bien supérieurs.
En termes géographiques, cette évolution correspond à
l'explosion des exportations à destination des États-Unis.
Pour des raisons conjoncturelles et structurelles, sur lesquelles l'on
reviendra, mais aussi pour des raisons fiscales qui seront
développées en seconde partie de ce rapport, le marché
américain exerce un effet d'aspiration apparemment irrésistible,
comme le montrent les tableaux ci-dessous.
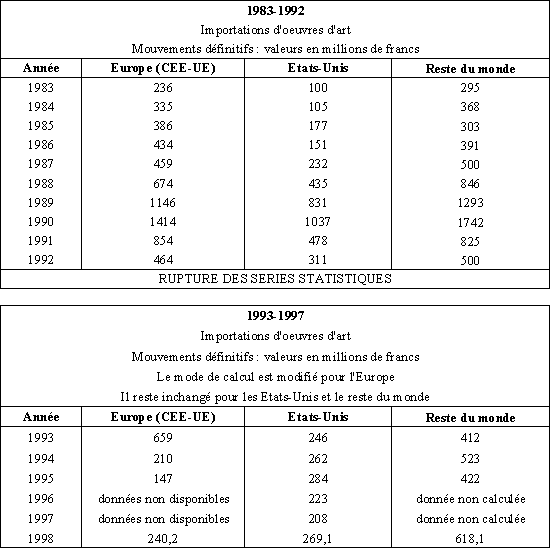
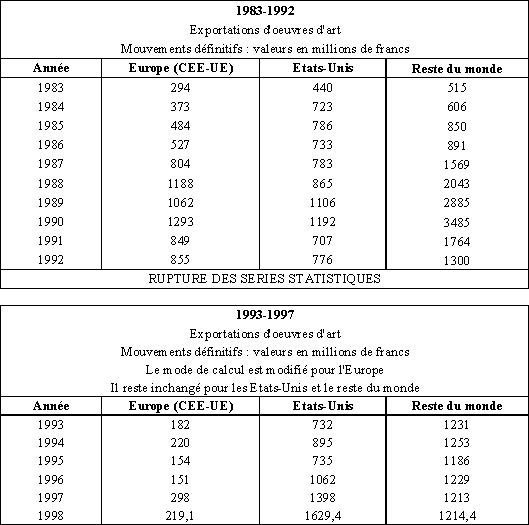
Le tableau de la page suivante montre clairement que le solde positif
vis-à-vis des États-Unis - pour l'interprétation duquel il
n'y a pas de rupture de séries statistiques - passe d'un ordre de
grandeur de l'ordre de 300 à 600 millions de francs de 1983 à
1995 à des montant approchant puis dépassant le milliard de
francs pour culminer en 1998 à 1, 38 milliard de francs.
Un autre tableau relatif aux échanges bilatéraux entre la France
et le Royaume uni, s'il doit être interprété avec plus de
circonspection compte tenu de l'effet de rupture de séries statistiques,
montre que, désormais, les oeuvres d'art vont directement aux
États-Unis, alors qu'une bonne partie d'entre elles transitaient
auparavant par la Grande-Bretagne
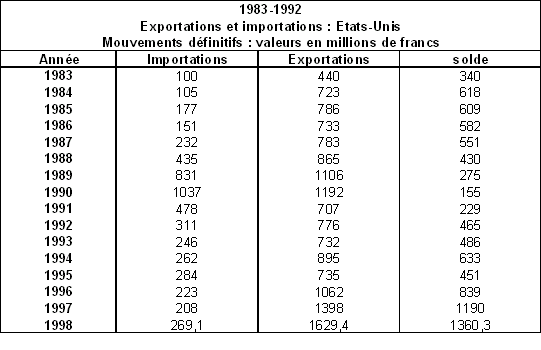
En 1990, juste avant le krach du marché de l'art, les exportations
à destination des États-Unis atteignaient presque 1200 millions
de francs, soit une augmentation de près de 52 % en trois ans ; les
exportations à destination de l'Angleterre atteignaient près de
800 millions de francs en croissance de seulement 36 % sur les trois
années précédentes

Pour les années suivantes, on constate qu'en deux ans de 1990 à
1992, les exportations vers l'Angleterre diminuent de moitié en passant
de près de 800 millions à près de 400 millions de
francs ; on note que la régression est sensiblement moins forte
pour les exportations à destination des États-Unis, qui passent
au cours de la même période de près de 1200 millions
à 776 millions de francs. Les effets de la crise sont manifestement
moins sensibles de l'autre côté de l'Atlantique.
La rupture des séries statistiques rend certes difficile
l'interprétation des années suivantes mais il semble bien que la
régression des exportations outre-Manche qui passent d'un niveau de
l'ordre de 400 à celui d'à peine 100 millions, ne doit pas
constituer une régression significative. En revanche le passage entre
1994 et 1995 de 95 à 64 millions de francs des exportations
françaises d'oeuvres d'art à destination de la Grande-Bretagne
constitue une chute significative d'environ un tiers, à
l'évidence consécutive à l'introduction de la TVA dans ce
dernier pays, même si l'on note que pour la même année les
exportations à destination des États-Unis régressaient
elles aussi. Il faudrait également examiner l'évolution des flux
temporaires.
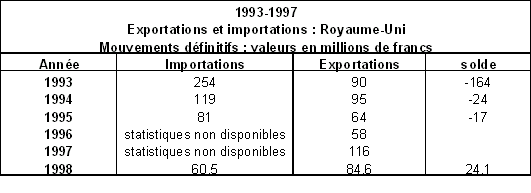
Ces statistiques éclairent
le débat sur les effets pour la
Grande-Bretagne de l'introduction de la TVA à compter de 1995
. La
baisse de 40 % de leur importation dont font état les Anglais et que
l'on trouve reprise et développée dans le rapport de la
fédération britannique du marché de l'art - qui figure
parmi les documents joints en annexe - doit s'interpréter avec
circonspection compte tenu des éléments suivants :
• la baisse des flux d'oeuvres en provenance de France, dont on sait
qu'elle a alimenté longtemps le marché de l'art londonien, au
moins pour l'art ancien, a commencé avant 1995, date d'introduction de
la TVA, tandis que les exportations vers les États-Unis ont toujours
mieux résisté. Il y a dans la baisse relative des exportations
vers l'Angleterre par rapport à celles à destination des
États-Unis, un phénomène lié à l'excellente
conjoncture américaine qui font des États-Unis un marché
porteur ;

Ensuite et surtout, on ne peut pas incriminer la TVA, à l'importation,
dans les échanges entre la France et la Grande
-
Bretagne. Or les
exportations vers ce dernier pays baissent de 1997 à 1998 de 27 % tandis
que celles à destination des États-Unis augmentaient de 32 %.
Votre rapporteur estime que ce phénomène pourrait bien traduire
un autre aspect moins connu de l'introduction de la TVA : les marchands
français et sans doute aussi d'autres pays d'Europe, n'ont pas
intérêt à exporter vers l'Angleterre, car les exportations
vers ce pays sont désormais soumises au régime de TVA interne sur
les marges. On reviendra en seconde partie sur ce phénomène.
Au delà de ce point somme toute technique mais révélateur
des effets de la fiscalité sur les échanges,
il y a une
situation d'urgence, car, en attendant les réformes, l'hémorragie
continue et même s'accentue, au rythme de désormais près de
2 milliards de francs par an
.
e) Les comparaisons internationales : un poids limité en dépit de succès ponctuels
En terme de chiffres d'affaires, le marché de l'art est relativement important : ses faiblesses n'apparaissent que si l'on cherche à isoler les segments du marché les plus représentatifs des oeuvres d'art de haut niveau susceptibles de faire l'objet de commerce international.
(1) Des chiffres globaux apparemment rassurants
Des
statistiques globales
de chiffres d'affaires apparaissent de prime abord
relativement rassurantes
en ce qui concerne les rapports de force sur le
marché mondial de l'art.
Depuis 1990, c'est-à-dire le sommet de la vague spéculative, le
marché se répartit en trois grandes masses à peu
près équivalentes
4(
*
)
: ainsi
en 1990, le chiffre d'affaires des commissaires-priseurs français
frôlait les 10 milliards de francs avec 9,7 milliards de francs, se
comparait aux ventes de Sotheby's, alors supérieures à 13,3
milliards de francs et à celles de Christie's qui étaient proches
de 11 milliards de francs avec 10,8 milliards de francs.
De 1991 à 1994, le chiffre d'affaires des commissaires-priseurs
français était, avec des montants compris entre 7,3 et 8
milliards de francs, supérieurs à ceux des deux grandes maisons
de vente aux enchères anglo-saxonnes, de l'ordre de 6 à 7
milliards, aussi bien pour Sotheby's que pour Christie's.
Ce n'est qu'en 1995 et en 1996 que la situation se renverse au détriment
des commissaires-priseurs : Sotheby's passe en tête la
première année, puis est rejointe par Christie's la seconde
année, les deux firmes se situant toutefois, avec un chiffre d'affaires
légèrement supérieur à 8 milliards, à peine
au-dessus des commissaires-priseurs français.
En revanche, l'écart recommence à se creuser
en
1997
: avec respectivement 10,8 et 11,7 milliards de francs,
les
deux " majors " anglo-saxonnes distancent à nouveau leurs
concurrents français
, dont le chiffre d'affaires n'est que de 8,5
milliards de francs.
Il y a, à l'évidence, dans ce résultat,
l'effet
déprimant de l'incertitude réglementaire qui pèse sur le
marché français
. Mais, il faut, au delà de cet aspect
conjoncturel, souligner des phénomènes structurels.
Certes, on peut d'abord remarquer que si le marché français
résiste mieux à la crise, il profite moins de la reprise.
Ce constat tient au fait que l'on se trouve dans le cas d'un marché,
sinon administré du moins compartimenté, relativement
protégé de la concurrence internationale.
(2) Des faiblesses sur les marchés des objets de très haut de gamme
Mais il
y a aussi dans ces chiffres l'indice que le maintien des performances
quantitatives masque des
faiblesses qualitatives
. Il faut d'abord
rappeler que les statistiques de ventes des commissaires-priseurs incluent des
objets sans rapport avec le marché de l'art, qu'il s'agisse de mobilier
courant, de voitures ou de surplus divers, vendus dans le cadre de Drouot Nord
ou de Drouot Véhicules, qui représentent près de 25 % du
chiffres d'affaires de la compagnie de Paris .
Les chiffres des maisons anglo-saxonnes, en revanche, sont beaucoup plus
proches de l'idée que l'on se fait d'oeuvres ou d'objet d'art,
même si l'image haut de gamme qu'ont ces maisons sur le continent doit
être nuancée quand on évoque les activités des
branches " milieu de gamme ", qu'il s'agisse de Christie's South
Kensington à Londres ou Sotheby's Arcade Auctions à New-York.
A ne considérer que le haut de gamme, c'est-à-dire la marchandise
dont les prix sont relevés et consignés dans les annuaires
annuels des ventes - qu'on trouve désormais tant sous forme d'ouvrage
" papier " que de bases de données consultables en lignes ou
sur cédéroms -, il est frappant de constater que la France
n'occupe, sur la base de critères quantitatifs, qu'une place minime sur
le marché mondial de l'art.
Ainsi, à ne prendre en compte que
la peinture et le dessin
, le
marché français
ne représenterait en 1997/1998,
selon l'Art sales Index,
que 5,6 % du marché mondial très loin
derrière les États-Unis et la Grande Bretagne, dont les parts de
marché atteindraient respectivement, 49,8 % et 28,75 %.
Selon cette définition le marché mondial de l'art ne se monte
qu'à 15 milliards de francs pour la saison 1997/1998, ce qui
montre, lorsqu'on rapproche ce chiffre de ceux mentionnés plus haut que
la couverture du marché par les annuaires n'est pas exhaustive,
même si l'on peut penser que pour les objets de niveau international -
niveau estimé à 500 000 F, dans le rapport précité
de M. André Chandernagor - les omissions doivent être assez
rares.
PLACE
DE LA FRANCE SUR LE MARCHÉ MONDIAL DE L'ART
(peintures et dessins)
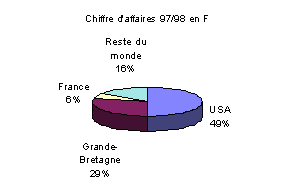
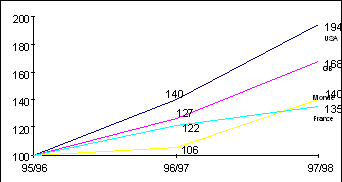


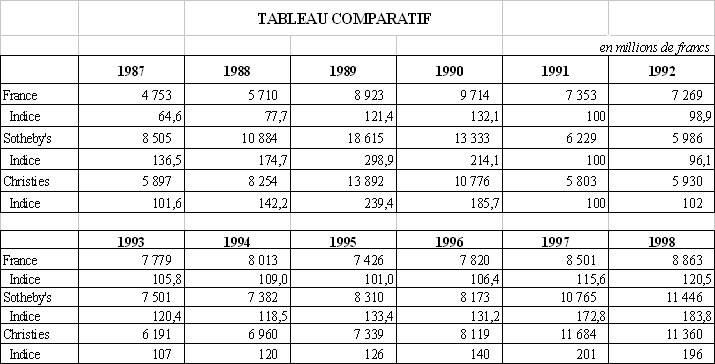
Christies
Commissaires priseurs

f) Le marché mondial selon la Commission de Bruxelles
La
Commission des communautés estime qu'au niveau mondial le volume des
ventes d'oeuvres d'art est de l'ordre de 8 000 millions d'euros. Ces ventes se
répartissent entre les marchands, qui réalisent annuellement des
ventes d'une valeur d'environ 6 200 millions d'euros, et les maisons de vente
aux enchères, qui réalisent des ventes représentant
environ 1 800 millions d'euros.
Elle considère que les données peuvent être
" faussées " (sic) par un petit nombre de ventes de
très grande valeur. C'est ainsi, par exemple, qu'aux États-Unis,
en 1997, deux ventes ont atteint plus de 263 millions d'euros, l'une d'entre
elles ayant même dépassé les 180 millions d'euros (il
s'agit de la vente Ganz).
Prenant en compte l'ensemble du marché et pas seulement les statistiques
de vente aux enchères, la Commission aboutit à une
géographie du marché mondial de l'art très
différente de celle à laquelle le rapporteur a abouti à
partir des chiffres d'Art sales Index.
|
PAYS |
Parts de marché |
Parts de marché |
Parts de marché |
|
|
Estimation
|
Estimation
|
Art
Sales Index
|
|
USA |
18 % |
38,2 % |
49,9 % |
|
Grande-Bretagne |
12,7 % |
33,5 % |
28,7 % |
|
France |
7 % |
6,6 % |
5,6 % |
|
reste du monde |
62,3 % |
21.7 % |
15,8 % |
|
TOTAL |
100 % |
100 % |
100 % |
Chiffres 97/98 * à l'exception de deux grandes ventes
exceptionnelles ayant eu lieu aux États-Unis
Les meilleures estimations indiquent que la Communauté compte pour 26%
dans le total des ventes réalisées par les marchands d'art et les
États-Unis pour 18 %. Le Royaume-Uni est le plus grand marché de
la Communauté puisqu'il représente 48 % des ventes qui y sont
réalisées ; il est suivi par la France avec 26 % et par
l'Allemagne avec 7 %.
Le décalage avec les chiffres d'Art Sales Index vient de ce que, a
priori, on ne parle pas en fait du même marché : il ne s'agit
pas de la simple conséquence de différences dans le mode de
commercialisation, les ventes aux enchères s'opposant au négoce,
mais tout simplement du fait qu'on ne considère pas des mêmes
produits. Dans un cas, on parle d'oeuvres d'art et dans l'autre, pour une bonne
part, de biens d'occasion.


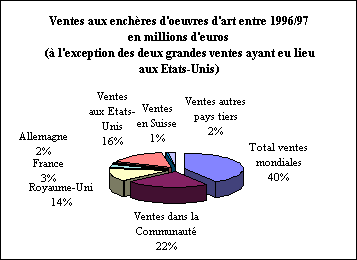
Mais, même en ce qui concerne les chiffres donnés par la
Commission pour les seules ventes aux enchères (Tableau 3 du rapport
page 19 du rapport de la Commission), la différence avec les chiffres
tirés d'Art sales Index qui ne concernent que les tableaux et dessins,
reste considérable.
En ce qui concerne les ventes aux enchères, la Commission constate que
la Communauté européenne et les États-Unis se partagent le
marché mondial presque à égalité, avec pour l'une
comme pour les autres, quelque 47 % de toutes les ventes aux
enchères de tableaux réalisées pendant la saison 1996-1997.
Dans la Communauté, le principal marché est le Royaume-Uni, avec
61 % des ventes réalisées dans les États membres; il est
suivi par la France avec 12 % et par l'Allemagne avec 7 %.
Selon les chiffres de la Commission, entre 1993/1994 et 1997/1998, en valeur
les ventes de tableaux aux enchères ont augmenté de 30 % dans la
Communauté mais de 41 % sur les marchés des pays tiers. Pendant
cette même période, sur les principaux marchés
européens, les ventes ont augmenté de 51 % au Royaume-Uni,
tandis qu'elles ont chuté de 28 % en France et augmenté de 13 %
en Allemagne.
On remarque non sans un certain étonnement que la Commission a
estimé qu'elle pouvait ne pas tenir compte de deux ventes
exceptionnelles réalisées aux États-Unis : dans cette
perspective, la part relative de la Communauté européenne passe
à 55 %, tandis que celle des États-Unis tombe à 38 %.
Pour les besoins de la démonstration, la Commission va même
jusqu'à faire abstraction des deux grandes ventes en question, pour
démontrer que la valeur des ventes de tableaux aux enchères
réalisées aux États-Unis a diminué de plus de 1 %
entre 1993/1994 et 1996/1997 !
Il en résulte que les tendances dégagées par
l'étude commandée par la Commission - au même organisme
d'ailleurs que celle de la Fédération britannique du
marché de l'art, déjà mentionnée - doivent
être prises avec précaution.
La Commission note que, bien que le marché communautaire de l'art
connaisse une croissance continue, il est évident qu'il ne progresse pas
au même rythme que celui des pays tiers, du fait de l'augmentation des
ventes des marchands d'art dans les pays tiers, notamment d'Asie du sud-est,
d'Europe orientale et d'Amérique latine. De même, la croissance
dans la Communauté est inégale, le Royaume-Uni dépassant
de loin les autres États membres.
En outre, en ce qui concerne le marché global, il est tout à fait
remarquable que la Commission ait pu obtenir des chiffres pour le monde entier
au vu des difficultés que le rapporteur a rencontrées pour
trouver des données significatives et actuelles pour notre pays.
D'après les estimations, la valeur des ventes d'oeuvres d'art
réalisées dans la Communauté par des marchands d'art entre
1993/1994 et 1997/1998 a augmenté de 17 %, tandis que l'accroissement en
valeur au niveau mondial a été de 37 %.
On observe, toutefois, de très fortes différences entre les
États membres pendant toute cette période, puisque la valeur des
ventes réalisées au Royaume-Uni a augmenté de 50 %, alors
que la valeur des ventes réalisées en France a diminué de
23 %, tandis qu'elle s'est accrue de 11 % en Allemagne. La tendance
constatée pour la France, contraire à celle que le rapporteur
avait cru dégager avec les informations disponibles, mériterait
un examen plus approfondi.
2. L'état des lieux psychologique
Toute
politique de relance du marché doit tenir compte, au-delà des
chiffres, de la situation psychologique des opérateurs. A cet
égard, le rapporteur estime qu'il faut distinguer radicalement la
situation de l'art ancien de celle de l'art contemporain : l'un a
confiance dans son marché ; l'autre pas.
La crise de 1990, qui a joué, une fois de plus, un rôle de
révélateur, fait, en effet, apparaître un moral très
différent, même si comme dans d'autres domaines, les personnes
rencontrées par le rapporteur ont manifesté plus
d'inquiétudes que de confiance dans l'avenir.
a) L'art ancien : un secteur porteur en dépit des inquiétudes des professionnels
Les
auditions comme la lecture d'articles de presse ou d'interventions dans les
colloques auxquels ont donné lieu les réformes en cours, ont
montré que les opérateurs ont confiance dans leur avenir,
même s'ils ne se sentent pas écoutés par les pouvoirs
publics.
Le marché de l'art ancien est perçu comme un marché
porteur ; les opérateurs ont le sentiment d'être
compétitifs et, simplement, d'être entravés par une
fiscalité paralysante.
C'est ainsi que le président du syndicat des antiquaires pouvait
déclarer en évoquant les parts de marché établies
à partir des données de Art Sales Index : "
ces
chiffres, qui sont dramatiques, prouvent que L'Europe continentale se meurt et
que, surtaxés, nous allons tous disparaître
5(
*
)
".
Pour lui, "
les antiquaires se réjouissaient de l'arrivée
des commissaires-priseurs étrangers en France, car nous pensions
effectivement que cela serait l'occasion de redynamiser tout ce marché.
Mais, compte tenu de la situation actuelle, il est évident que nous
allons aboutir à un phénomène de désertification et
que l'on ne pourra plus récupérer notre patrimoine parti à
l'étranger
".
Avant de pousser ce " cri d'alarme ", le président du syndicat
national des antiquaires avait dénoncé une
"
véritable coupure entre les pouvoirs publics et les agents
actifs du marché de l'art
".
Devant le rapporteur, le président du syndicat national des antiquaires
s'est toutefois montré moins alarmiste, en indiquant que la situation de
la France n'était pas désespérée en raison de la
qualité de ses professionnels et de l'importance de son patrimoine, tout
en incriminant la fiscalité et les charges qui fragilisent le secteur de
l'antiquité.
b) L'art contemporain : un secteur encore sous le choc de la crise
L'art
contemporain se posait de façon très différente, comme a
pu le constater le rapporteur lors de l'audition des représentants des
galeries d'art. Ce secteur aurait à l'évidence, au vu de sa
spécificité comme de l'importance de l'effort public qui y est
consacré, mérité une étude à part que le
rapporteur se réserve la possibilité d'entreprendre
ultérieurement.
Manifestement, la crise actuelle est d'autant plus démoralisante et la
chute d'autant plus dure, que l'euphorie de la fin des années 80 avait
laissé espérer que la France avait surmonté sa mise
à l'écart de la création contemporaine.
(1) La France en marge ?
Il avait
d'abord fallu que la
France
admette qu'elle n'était plus au coeur
de la création contemporaine, qu'elle
était passée du
statut de pays centre, à celui de pays de pays
périphérique
.
Comme tout marché, celui du marché de l'art écrit, Paul
Ardenne
6(
*
)
a "
un centre, une
périphérie, des zones non fréquentées. Le centre,
incontestablement en est New-York. Situation acquise dès la fin des
années quarante, d'abord avec un marché " patriotique "
puis à partir du mi-temps des années soixante,
irréversiblement international. L'entrée tapageuse des
Américains à la Biennale de Venise, en 1964, scelle pour un quart
de siècle le destin funeste tant de l'École de Paris que du
marché franco-français. En 1990, la domination new-yorkaise est
impressionnante.
La raison pour laquelle il n'y a pas de foire d'art
contemporain stricto sensu à New York est limpide : la foire y a lieu
toute l'année
7(
*
)
. Plus de sept cents
galeries servant pour la plupart l'extrême-contemporain en art, ne
manquant pas une occasion de relayer l'institution muséale ou de la
devancer; des immeubles dont on fait la tournée en car lors des fameux "
saturdays " de Soho (South of Houston Street, Manhattan : 300 galeries)...
Bourdonnement continu, digne du Manhattan Transfer de Dos Passos! Les plus
importants galeristes du village global ont élu domicile à New
York. Castelli, Sonnabend, Mary Boone, représentant la tradition, y ont
été rejoints par Lelong, Sperone et bien d'autres. Le tarif du
mètre carré de galerie est exorbitant mais les affaires plus
juteuses qu'ailleurs. Aux États-Unis mêmes, Chicago et sa foire
sont un challenger de peu de poids, quoique impressionnants pour les
Européens.
Sauf exception, le galeriste new-yorkais, appelé
sur toutes les foires, se déplace peu. Il est d'usage qu'on vienne
à lui
.
8(
*
)
"
Les représentants des galeries ont manifesté devant le rapporteur
une certaine forme de désarroi face à la
désintégration de la demande intérieure et
extérieure pour l'art français. Mme Anne Lahumière,
Présidente du Comité des Galeries d'art, a reconnu que,
"
en dehors de toute conjoncture économique, l'art contemporain
n'intéressait pas les collectionneurs français
". De son
côté, M. Patrick Bongers a fait observer que "
la
création française se vendait mal à l'étranger
également
" ; il a fait remarquer que "
la
création allait là où était le
marché
"...
Au traumatisme du déclassement, s'ajoute celui de la crise du
début des années 90. Les galeries françaises, qui avaient
cru pouvoir jouer " dans la cour des grands ", reconquérir
New-York, se sont comme écrasées au décollage.
Le marché de l'art apparaît déprimé
économiquement, certes mais aussi psychologiquement. Le pessimisme
ambiant pourrait empêcher les galeries de voir frémir la demande
comme cela semble être le cas, au moins pour les jeunes artistes que le
rapporteur a rencontrés à l'occasion de cette étude.
Votre rapporteur a bien noté que l'action de l'État était
critiquée. En dépit de l'importance de l'aide, dont
bénéficie l'art contemporain en France, sans doute sans
équivalent, les opérateurs se sentent manifestement
délaissés : M. Patrick Bongers a déploré,
lors de son audition, "
le manque de moyens mis à la disposition
des créateurs et des galeries ainsi que le manque d'intérêt
des médias à leur égard et mis en cause l'éducation
scolaire, tournée vers la littérature, qui ne donnait aucune
culture artistique aux enfants : Tout cela contribuait à
décourager le public
".
Et ce n'est pas le moindre des paradoxes de voir un certain nombre de galeries
regretter la part excessive de l'État dans leur
clientèle.
(2) Trop d'État dans l'art contemporain ?
Trop ou
pas assez d'État en matière d'art contemporain ? Le
débat dépasse le cadre de ce rapport même s'il a paru
intéressant d'en rappeler les termes à l'occasion d'une
controverse où était en question " l'État
culturel " :
Tandis que M. Philippe Dagen, journaliste au Monde, dénonce ceux qu'il
considère comme des "
maîtres censeurs
",
pratiquant "
approximations et interprétions
hâtives
", M. Marc Fumaroli de l'Académie
française défend la position de ceux qui voudraient une image
moins uniforme de la modernité. M. Philippe Dagen résume la
polémique en ces termes dans un article du Monde en date du 17
février 1997 :
" Y a-t-il encore des artistes en France ? La question vous
paraît loufoque ? Vous haussez les épaules ? C'est que vous ne
lisez pas certains journaux. Un quotidien, un hebdomadaire, une revue se posent
la question. A vrai dire, on ne se la pose même plus. Après le
temps des doutes, voici venu celui des faire-part de deuil adressés par
des auteurs connus, des savants, tous très respectables.
Le 22 janvier, Le Figaro publie un entretien entre Marc Fumaroli,
académicien, professeur au Collège de France, et Jean Clair,
directeur du Musée Picasso, historien de l'art et essayiste. Il
s'intitule " L'art contemporain est dans une impasse " . On y lit que "
l'enfermement de l'art contemporain, son autosuffisance et son autocomplaisance
sont une catastrophe intellectuelle " (Jean Clair), et que " si l'art est
éducation du sensible, il faut l'encourager à emprunter d'autres
chemins que ceux dont le médiatiquement correct contrôle
actuellement l'accès " (Marc Fumaroli).
" EXPLOSION DE NIHILISME "
Le lendemain, dans L'Événement du jeudi, Jean Clair
répond à des questions de Jean-Louis Pradel. Il ne cultive pas la
nuance : " L'art contemporain français n'a plus ni sens ni existence ",
assène-t-il au lecteur hébété. Précision
complémentaire : " La création plastique n'est plus dans les
galeries d'art, elle est au cinéma, dans la danse, dans l'art
vidéo. Et l'acharnement thérapeutique que met l'État
à prolonger l'agonie, à travers un appareil coûteux, n'y
peut rien : l'art français contemporain, contrairement à l'art
italien, anglais ou germanique, n'a plus d'existence. "
De son côté, M. Marc Fumaroli, réplique à ce qu'il
considère comme une caricature de sa pensée, en posant notamment
la question de l'intervention de l'Etat en matière d'art
contemporain :
"
J'ai constamment dénoncé l'usage médiatiquement
correct, à New York comme à Paris ou à Cassel, de cette
expression, comme d'ailleurs du mot "modernité" : ces mots de passe
recouvrent un système étroit, étouffant et trompeur, qui
circonscrit d'autorité la diversité des poétiques
possibles aujourd'hui et fige l'évolution des goûts. J'ai
constamment regretté que l'" art contemporain ", entendu en ce sens
intolérant et jaloux, soit devenu en France l'idéologie
officielle de la délégation aux arts plastiques, de ses FRAC et
de ses vedettes attitrées.
S'il s'agissait de discussion, je reconnaîtrais volontiers qu'il n'est
pas facile, en tous temps et peut-être surtout aujourd'hui, dans cette
fin de siècle trouble et troublée, de discerner la juste mesure
entre deux excès, le " laisser faire " qui abandonne le sort des arts au
marché des loisirs démocratiques, et le protectionnisme
d'État qui, sous couleur de protéger les arts, crée une
clientèle captive, étouffe consciencieusement toutes les
poussées d'invention et de goût qui dérangent sa propre
ligne politique, et qui tente maintenant de déshonorer toute orientation
critique qui décoifferait la perruque des nouveaux Boileau.
Depuis le XIXe siècle, il y a eu très souvent tension, et tension
très vive, entre les goûts, qui sont par essence divers, les
modes, qui sont par définition changeantes, et l'Etat, par
définition conservateur, même lorsqu'on prétend maintenant
en son nom " dynamiser " la culture. Aujourd'hui, quand les goûts et les
modes évoluent très vite, et dans un émiettement qui prend
de vitesse les éclectismes les plus laxistes, la définition
même des arts a perdu de son évidence.
Plus encore qu'autrefois, il est paradoxal et dangereux qu'une administration,
et plus spécialement une administration française, c'est -
à - dire jalouse et tenace, tranche de son propre chef, au nom d'un
protectionnisme des arts, dans cette diversité : elle se fait ainsi le
dépositaire d'une orthodoxie esthétique, et elle trouve sans
peine des publicistes pour la célébrer ou pour la
préserver de tout chagrin.
Cela ne veut pas dire que l'État, sa délégation aux arts
plastiques, sa direction de l'architecture, n'aient pas un grand rôle
à jouer, un rôle d'intérêt général et
de bien public, au-dessus des intérêts marchands bien sûr,
mais au-dessus aussi des intérêts bureaucratiques. Les
écoles, les conservatoires, les musées, les salons d'exposition,
les achats d'oeuvres d'art (autant que possible de chefs-d'oeuvre) à des
artistes d'aujourd'hui, répondent tout naturellement à la
vocation de l'État conservateur et éducateur.
Je souhaiterais pour ma part, et c'est ce que j'ai toujours soutenu, qu'il
exerce ce rôle avec prudence, de façon plus indirecte et plus
libérale. Bien gouverner, en tous ordres, c'est savoir bien
déléguer. Ce principe vaut plus qu'ailleurs dans le domaine des
sensibilités et des goûts. L'action de l'Etat serait d'autant plus
féconde et intelligente qu'elle passerait, aussi souvent que possible,
par des institutions et des fondations moins soumises à des
fonctionnaires d'autorité purement et simplement nommés.
Ces nominations répondent à un jeu de chaises musicales propre
à la haute fonction publique, et elles n'ont très souvent qu'un
lointain rapport avec l'intérêt des arts et de leur public.
Institutions publiques, privées ou mixtes, à finalité dite
" culturelle ", devraient se pourvoir de conseils d'administration
responsables, cooptés dans les diverses professions et familles
d'esprit, et élire leur propre président, lui-même
responsable. Ainsi le système protectionniste actuel serait-il
desserré, et il pourrait s'ouvrir à des secteurs, à des
écoles, à des tendances, à des individualités
créatrices qui, à l'heure actuelle, sont soigneusement tenus
à l'écart du cercle bien protégé et limité
de " l'avant-garde " officielle.
Le faible intérêt du public français et étranger
pour l'art d'aujourd'hui en France n'est pas dû aux artistes, mais
à l'écran trop visible, trop sophistiqué, et peu attrayant
dressé devant eux par un système de protection des arts qui
fonctionne en circuit fermé, sans racines dans la variété
des talents et les multiples orientations sincères du goût.
Un peu moins d'arrogance et de volonté de puissance administratives, un
peu plus de tolérance et de modestie, un appel plus confiant aux
professionnels, aux grands amateurs, permettraient de ménager des
médiations plus souples, des formes de financement plus
diversifiées (le fisc peut beaucoup pour favoriser le véritable
mécénat privé) entre le public et des institutions des
arts que l'on voudrait nombreuses, et riches, mais non pas
régentées par un État jaloux et doctrinaire. Nous nous
trouvons en France devant le paradoxe d'un " centralisme démocratique "
des arts imposé à des artistes et à un public qui, en
réalité, sont essentiellement divers, et qui seraient d'autant
plus hardis et fertiles dans l'expression de leurs talents et de leurs
goûts qu'ils auraient affaire à une multiplicité de
formules, publiques et privées, elles-mêmes éclectiques ou
diversement orientées, prêtes à les soutenir.
Sortir de ce " centralisme démocratique " qui coupe la France des arts
entre pays légal et pays réel, entre un pays réel
censuré et un pays légal qui profite seulement à des
minorités surévaluées et surprotégées, cela
suppose un " dégel " auquel le système résiste avec
agressivité et de toutes ses forces. Ces forces sont grandes et
nombreuses, autant que les intérêts investis dans ce
système qui, en trente ans, n'a fait que croître et embellir. Le
résultat est une déplorable provincialisation de Paris
lui-même, dont le constat met hors d'eux ses profiteurs et
thuriféraires. Il va de soi, mais mon dénonciateur insinue le
contraire, que j'ai toujours distingué, comme tout le monde aujourd'hui,
art moderne (de Manet à Matisse) et art contemporain. L'art moderne a
déjà des historiens, des musées, une hiérarchie de
valeurs, et même ses grands classiques ; l'art d'aujourd'hui, en train de
se faire, devrait jouir de la plus grande liberté de recherche et de
jugement, jusques et y compris lorsqu'il s'avise de redécouvrir à
contre-courant un métier, une mémoire et des poétiques
oubliés. Ce serait le rôle de l'État que d'encourager, sans
se fier à sa propre bureaucratie, des formules variées d'accueil
et de soutien qui donneraient une chance à toutes les tendances
artistiques. Que les meilleures gagnent. Ce serait le rôle du critique
indépendant d'explorer et d'évaluer sans préjugé,
avec culture et goût, les avenues de cet univers en devenir. Il se renie
lui-même lorsqu'il s'abaisse à jouer les Javert d'une chasse
gardée. "
Dans un article du Monde en date du 8 mars 1997, intitulé " le
mythe de l'âge d'or culturel " Jean-Jacques Aillagon,
président du centre national d'art et de culture Georges-Pompidou,
souligne les
effets négatifs d'une telle polémique sur l'image
et la réputation de la création en France
:
" Comment mieux affirmer que l'art n'est pas mort, qu'il n'est pas
mort en France ? A ce sujet, comment ne pas s'étonner que ce soient les
mêmes coteries qui s'affligent du déclin présumé de
l'influence artistique de la France et qui, dans le même temps,
s'activent à en déstabiliser la réputation et la
perception par leurs prises de position défaitistes, si complaisamment
relayées par une presse étrangère à l'affût
des signes de notre possible effacement culturel ? Il y a là une
véritable entreprise de démolition qu'il convient de stigmatiser
parce qu'elle contrarie le patient travail de tous ceux, artistes, galeristes,
responsables des institutions publiques,... qui s'attachent à affirmer
la pérennité et la force de la création dans notre
pays.
"
A la résistance critique doit s'ajouter une résistance
politique, une résistance fondée, dans l'esprit qui anime de
façon constante dans notre pays la politique culturelle, sur la
conviction que la création est un enjeu majeur, au même titre que
la conservation du patrimoine ou que la mise en oeuvre d'une
démocratisation de plus en plus grande de l'accès à la
culture. Elle doit s'appuyer sur une réaffirmation sans
ambiguïté de la confiance de la société et, parce
qu'ils sont l'expression de son destin, des pouvoirs publics et des
institutions à l'égard de la vitalité de la
création d'aujourd'hui dans tous les domaines de son expression.
Affirmer cette confiance, c'est affirmer de façon plus
générale que le temps à venir n'est pas un temps à
subir mais un temps à construire, le domaine non de la fatalité
mais de la liberté, que demain a un avenir, que le monde n'est pas fini,
que de vastes espaces s'ouvrent encore à l'invention, à
l'imagination, à la création, que ces espaces ont vocation
à être partagés par tous. "
Le débat existe. Votre rapporteur ne pouvait occulter une
polémique qui met en cause, au delà de la controverse sur la
valeur et le sens des créations actuelles, le rôle de
l'État sur le marché de l'art contemporain.
B. UN MARCHÉ MONDIAL EN VOIE DE GLOBALISATION
Le marché de l'art au sens moderne date du XVIII e siècle. Pour qu'il y ait marché à proprement parler, il fallait que se constituent progressivement une offre et une demande indépendantes ; que se distendent les liens entre les patrons et leurs peintres ; que les uns produisent pour le marché et les autres acceptent des sujets qu'ils n'avaient pas choisis ; que l'évolution économique entraîne la dispersion de grandes collections ; que se fasse sentir, enfin, le besoin d'intermédiaires spécialisés ; que la demande d'objets de curiosité qui formaient l'essentiel des cabinets du XVII e9( * ) , fasse plus de place à la peinture ancienne, qui, au XVIII e , était, il faut le rappeler, largement constituée de peinture hollandaise. Un bref rappel historique montre que le marché de l'art a été, dès l'origine, international.
1. Un marché international dès l'origine
Quel que soit son mode de fonctionnement ou sa logique, négoce traditionnel, ventes publiques, ou promotion d'une esthétique nouvelle, le marché de l'art s'est développé dans une logique mondiale.
a) Le triangle Paris Londres Amsterdam
Le
commerce de l'art naît avec celui des reliques puis des antiques ;
ce n'est que dans le courant du XVI
e
siècle que l'on
commence à voir circuler des tableaux, car, jusqu'à cette
époque, les artistes circulent plus que les oeuvres : les peintres
d'une certaine notoriété, sont le plus souvent au service des
princes, tandis que leurs oeuvres résultent de commandes et font partie
intégrante de la décoration des lieux, palais ou églises
pour lesquels elles ont été faites.
C'est en Italie que se trouve aux débuts des temps modernes la
principale source d'approvisionnement du marché de l'art : c'est
là que se font les fouilles pour les antiques, que se trouve la plus
grande concentration d'artistes de tous les pays, que commencent à se
défaire les premières grandes collections et, donc, que
sillonnent les agents des princes allemands ou des nobles français,
puis, les riches Anglais.
Mais le marché italien est à l'image de son espace politique,
morcelé éclaté, sans la lisibilité d'un vrai
marché unifié. Bien que les premières ventes publiques
aient eu lieu à Venise au tout début du XVI
e
, elles ne
s'organisent de façon systématique qu'à partir du XVII
e
en Hollande puis à Londres.
Même si, historiquement le marché de l'art moderne est né
quelque part entre la Hollande, l'Angleterre et la France, la primauté
semble appartenir à Paris à partir de la fin du XVIII
e
. C'est en France qu'ont exercé leur activité, les
grands marchands qui ont fait sortir le marché de l'art de la
préhistoire, et progresser l'histoire de l'art, les Gersaint,
Rémy, Basan, Joullain ou Paillet et surtout Le Brun. Ceux-là
méritent bien l'appellation de connaisseurs. Krzysztof Pomian expose
ainsi la situation.
" ...
C'est au cours des années soixante-dix qu'à cause
des noms des collectionneurs
10(
*
)
dont les
collections ont alors été dispersées, de leur statut
social très élevé et souvent de leur exceptionnelle
richesse, de la légende qui entourait de leur vivant les oeuvres qu'ils
ont réunies, en particulier les tableaux, certaines ventes sont devenues
des événements mondains qu'on commentait ensuite longuement dans
les lettres et dans les gazettes. Et ce n'était pas que des
événements parisiens. Car Paris dans la deuxième
moitié du XVIII
e
siècle est au centre d'un
marché des oeuvres d'art devenu désormais européen.
Européen, parce qu'on revend à Paris des objets achetés en
Italie en Belgique, dans les Provinces Unies. Et parce que les acheteurs
viennent de tous les pays du continent....Il en est ainsi jusqu'à ce que
la révolution mette un terme à la domination du marché
parisien "
11(
*
)
Dès sa naissance, le marché de l'art a donc été
international. Une peinture pouvait être vendue à Amsterdam et,
quelques mois plus tard être remise en vente à Paris, avec le cas
échéant la mention des provenances étrangères.
Toutes les caractéristiques du marché de l'art, ses pratiques
complexes se mettent en place à cette époque et, notamment, des
réseaux internationaux de marchands.
En ces temps là, le marchand vendeur aux enchères, agit en tant
que mandataire mais achète aussi pour son compte dans ses propres
ventes ; ce qui ne les empêchait pas non plus de procéder
à des transactions privées, à l'achat comme à la
vente. Les marchands commissaires-priseurs, même les plus actifs ne
faisaient guère plus de 5 ou 7 ventes par an, qui duraient plusieurs
jours
12(
*
)
.
C'est dans la seconde moitié du XVIII
e
siècle que
firent leur apparition des catalogues détaillés, à
l'orthographe moins fantaisiste, qui au delà de l'emphase propre aux
notices de l'époque, commençaient à apporter des
renseignement précis sur le titre, les dimensions, l'état ou la
provenance de l'oeuvre.
Ainsi, voit-on, à la fin du siècle, apparaître des
professionnels de l'art, qui, indépendamment de toute formation de
peintre - beaucoup de marchands étaient peintres et
réciproquement au siècle précédent -, fondent leur
négoce sur des aptitudes commerciales et sur des capacités de
connaisseur. Cette tendance à la professionnalisation s'est
accompagnée d'une interaction croissante entre marchands et historiens
d'art et entre marché et musées.
b) L'ascension de Londres au XIXe : les chocs de la politique, le poids de l'économie
Avec la
Révolution, Londres reprend le flambeau du marché de l'art. C'est
à Londres que seront vendues les collections des émigrés
et, en premier lieu, la collection du duc d'Orléans. Avec celle, un
siècle et demi plus tôt de la collection de Charles Ier, cette
dernière vente constitue une date majeure dans le développement
du goût en Angleterre.
Mais
la Révolution ne s'est pas contentée d'avoir pour effet
de déplacer le centre de gravité du marché de l'art de
Paris à Londres ; elle a aussi eu pour conséquence un
brassage d'oeuvres sans précédent
: des oeuvres,
enchâssées dans leurs écrins depuis des siècles
étaient jetées sur les routes ou dans les cales des navires, soit
pour approvisionner le muséum central de Napoléon, soit comme
butin des soldats, soit parce que nombre de propriétaires ruinés
par les contributions forcées de Napoléon durent se
résoudre à les vendre.
"
Que les membres de la haute et petite noblesse
, écrit
l'historien Francis Haskell,
puissent décorer leurs demeures dans le
même style que les patriciens de Rome, de Venise et de Gênes
auxquels ils avaient rendu visite durant leur " Grand tour ", aurait
semblé inimaginable une dizaine d'années plus tôt
seulement. Tout cela devenait possible, et presque facile pour peu qu'on
eût l'argent - et l'appétit vint en mangeant. Des nuées
d'agents, de marchands, d'artistes ratés et d'aventuriers de tout poil
fondirent sur l'Italie comme une nuée de vautours pour tirer
pâture de l'aristocratie locale, contrainte de payer les amendes
exorbitantes que lui infligeaient les armées de l'envahisseur
français. Pendant plus d'une décennie, on put croire que toute
l'Europe, depuis les ducs et les généraux jusqu'aux moines et aux
vulgaires voleurs, était engagée dans une seule et vaste campagne
de spéculation sur le marché de l'art. Le roi George III en fit
la remarque et observa ironiquement que tous ses gentilshommes étaient
devenus des marchands de tableaux.
A Londres arrivaient chef-d'oeuvre après chef d'oeuvre en un afflux
apparemment inextinguible, et le phénomène commençait
à sembler naturel. Au plus fort du blocus, des marchands y compris
français accouraient en Angleterre avec leurs stocks et retournaient
aussitôt pour le renouveler
. "
13(
*
)
Des collections françaises purent se constituer à l'occasion des
guerres napoléoniennes : le cardinal Fesch, l'oncle de
Napoléon, son frère Lucien, le maréchal Soult en Espagne,
furent les plus célèbres, à côté d'autres
plus modestes comme celles de Cacault ou de Wicar que l'on redécouvre
aujourd'hui, à Nantes ou à Lille ; mais, c'est à
peine forcer le trait que de dire que
la Révolution a fait la fortune
des marchands et des collectionneurs anglais
. Tandis que les
Français prélevaient - ce qu'ils durent rendre en quasi
totalité après Waterloo - ou pillaient le plus souvent sans
discernement, les Anglais achetaient, ce qui a fait la richesse des
châteaux anglais puis le bonheur des musées américains.
Même si à certains égards on peut dire que l'Angleterre a
toujours profité de l'instabilité politique
française
14(
*
)
, la raison fondamentale du
développement des ventes Outre-Manche reste la montée en
puissance économique de l'Angleterre qui alimenta une forte demande
interne.
c) La révolution du marchand - découvreur
C'est aussi en France qu'est apparu le prototype du marchand visionnaire, Le Brun - le mari de madame Vigée - découvreur notamment de Vermeer. C'est aussi dans notre pays qu'exerceront leur talents, quelques décennies plus tard, les Durand-Ruel, Vollard ou Kahnweiler, qui ont constitué, quelques décennies plus tard, les exemples mêmes de ces marchands, qui ont fondé leur commerce sur la promotion d'esthétiques nouvelles.
(1) L'apparition d'entrepreneurs innovateurs
Désormais, comme l'a souligné Mme Raymonde
Moulin, le
marchand de tableaux se comporte comme un entrepreneur au sens que lui donne
Joseph Schumpeter.
Dans l'analyse de ce classique de l'économie politique, l'objectif n'est
plus seulement de produire moins cher compte tenu de l'état des
techniques ou de répondre au mieux à la demande, compte tenu des
goûts existants des consommateurs. Il s'agit d'innover, de trouver les
technologies et les produits de demain et donc de s'engager dans une forme de
concurrence radicale, qui restructure l'ensemble de l'appareil de production.
Ce processus de destruction créatrice, qui caractérise le
capitalisme, selon Joseph Schumpter, se retrouve dans le marché de
l'art. Le rôle du marchand d'art est moins de servir
d'intermédiaire que de modeler le goût de ses clients dans un
processus de subversion des valeurs esthétiques dominantes.
Cette transformation du fonctionnement du marché de l'art a
été précédée, au début du XIX e
siècle, d'une révolution silencieuse : délivré
des contraintes de l'Académie ou des corporations, dégagé
des obligations vis-à-vis de ses patrons, le peintre est devenu
" libre " de répondre à la demande du marché.
Au début, celui-ci a fonctionné alors que les normes
esthétiques étaient définies par des instances
d'État, salons ou Académie. L'État s'était
attribué de droit d'émettre seul les valeurs esthétiques,
qui avaient cours légal. Mais, de même que dans une approche ultra
libérale, la monnaie ne se définit pas par le fait d'avoir cours
légal mais celui d'être accepté, le privilège
d'émission esthétique des autorités
institutionnalisées a été contesté puis
renversé par un groupe d'artistes qui, grâce au marché et
à ses marchands, a tenté et réussi un véritable
putsch esthétique.
Cette mutation du marché de l'art mais aussi du fondement des valeurs
esthétiques, on la doit largement à Paul Durand-Ruel. Celui-ci
soutint l'impressionniste en dépit de l'hostilité ambiante, et
acheta, du moins tant qu'il le put, une grande quantité d'oeuvres de
peintres qu'il soutenait. Jouant à la fois le rôle de banquier et
d'agent de publicité, il mourra presque ruiné, avec dans ses
réserves quelque 800 Renoir et 600 Degas.
Son audacieuse politique l'a amené à utiliser toutes les
ressources de publicité et à mobiliser la critique
15(
*
)
. Il organisa à partir de 1883, une
série d'expositions personnelles, ce qui est une méthode qui
allait se généraliser dans toute l'Europe, à Londres,
Rotterdam et Boston avant d'ouvrir une galerie sur la V
ème
avenue à New-York en 1888 ; et c'est aux États-Unis
qu'apparaissent leur premiers grands collectionneurs fortunés et
notamment Mme Potter-Palmer et M. et Mme HO Havemeyer.
(2) Un processus permanent de création et de redécouvertes de nouvelles valeurs esthétiques
Cette
stratégie consistant à imposer une nouvelle esthétique
s'est généralisée et a engendré un
processus de
renouvellement perpétuel des mouvements artistiques
, un processus de
" coup d'état permanent " pour l'art contemporain,
doublé d'un processus de redécouverte successive de maîtres
moins connus pour l'art ancien.
Dans ce secteur du marché que Mme Raymonde Moulin qualifie
d'art
" classé ",
la
fixité de l'offre
et
même sa raréfaction du fait des destructions et de l'augmentation
de la part de ces oeuvres détenues par les musées, conduisent les
marchands à chercher dans le passé les artistes méconnus
voire inconnus : la liste est longue de ces redécouvertes qui va
des " petits maîtres " aux " pompiers " pour le
XIX
ème,
mais aussi plus tôt avec la
réévaluation déjà ancienne des " peintres de la
réalité " et, notamment, de Georges de La Tour, ou plus
récemment de la peinture maniériste.
(3) Marché et musées : des relations de dépendance réciproques
Si les
marchands se sont imposés aux institutions d'État, comme les
éclaireurs indispensables des valeurs esthétiques, c'est pour
s'empresser de s'en servir comme caution de la justesse de leurs choix.
D'où une relation complexe mais étroite entre marché et
musées, surtout dans le domaine de l'art contemporain.
"
Le marché de l'art dépend ici du musée comme
il dépend d'un hôtel des monnaies s'agissant du numéraire
qui lui sert de mesure des valeurs
",
écrit Krzysztof
Pomian, dans le livre précité sur le commerce de l'art, pour
ajouter plus loin : "
la National Gallery de Londres doit son
existence à un acte du Parlement qui a décidé d'acheter
pour la nation, une collection particulière, celle de Juluis Angerstein,
réputée déjà du vivant de son propriétaire
pour ne contenir que des chefs-d'oeuvre....Or il est significatif que les
promoteurs de la création de la National Gallery ont été,
dans leur majorité, les acteurs du marché de l'art. En ce sens,
il est permis d'affirmer qu'elle est une émanation de celui-ci. Il n'en
a pas été autrement, environ cinquante ans plus tard, avec le
Metropolitan Museum de New-York. "
16(
*
)
.
Dans le domaine de l'art contemporain,
les liens fonctionnels entre
marché et musées
sont encore plus évidents, alors que
l'on se trouve dans "un " champ artistique dépourvu
d'esthétique normative ", pour reprendre l'expression de Raymonde
Moulin à laquelle sera empruntée l'analyse qui va suivre.
Le marchand américain Léo Castelli a été
après la seconde guerre mondiale le type même, de l'entrepreneur
découvreur. Il a fait connaître - même s'il n'a pas toujours
été leur premier marchand - Robert Rauschenberg, Jasper Johns,
Frank Stella et les grands mouvements, pop art, art minimal et art conceptuel.
"
Son goût des apparitions (épiphanies) et du pari
constamment renouvelé
, écrit Raymonde Moulin,
est en
affinité élective avec l'esthétique de la priorité
et du changement continu. La référence à l'histoire de
l'art et aux grands artistes fondateurs de l'art moderne, Cézanne,
Matisse, Picasso, cautionne sa dernière découverte et constitue
son principal argument de vente. "
D'une certaine façon, les galeries actuelles s'inspirent largement de la
stratégie de Léo Castelli. "
Pour créer la demande
en faveur d'un courant artistique nouveau,
poursuit Raymonde Moulin
, les
techniques du marketing commercial et de la publicité se combinent avec
celles de la diffusion culturelle. La probabilité de succès d'un
marchand dans l'organisation, en un temps limité, d'une stratégie
de promotion dépend du soutien financier dont il dispose, et de sa
réputation culturelle, c'est-à-dire de la capacité qu'il a
eue dans le passé de faire accepter les nouveaux produits par la
fraction moderniste de l'establishment artistique. "
Le succès de la stratégie de promotion d'un artiste ou d'un
mouvement suppose une " visibilité internationale ", qui est
le préalable à la reconnaissance et à la
consécration officielles.
Ainsi la logique du marché de l'art est-elle, indépendamment
même des tendances en cours avec l'expansion des ventes publiques,
essentiellement internationale.
2. La nouvelle donne mondiale
A
l'heure actuelle, on pense d'abord ventes publiques quand on parle de
marché de l'art. Cela est tout à fait significatif d'un
renversement du rapport de force entre les marchands et les vendeurs aux
enchères,
qui
intervient dans un
contexte
d'internationalisation et,
aujourd'hui,
de globalisation du
marché de l'art
.
Sotheby's et Christie's ont compris le processus en cours de globalisation du
marché de l'art. Ils n'ont eu de cesse que de l'accélérer
pour leur plus grand profit.
Comme dans beaucoup de domaines, nos compatriotes ont exercé le
métier de la vente aux enchères, les uns comme un artisanat, les
autres comme une profession libérale, en tout cas, ni comme un commerce
et ni comme une activité de services.
a) L'irrésistible ascension des maisons de vente anglo-saxonnes
A
l'origine de la conquête du marché de l'art mondial par les deux
majors britanniques, il y a une
révolution dans l'organisation des
ventes publiques
. Et cette mutation,
on la doit essentiellement à
un homme Peter Cecil Wilson
, dont l'histoire mérite d'être
brièvement racontée car, même si elle ne concerne que
Sotheby's, elle est significative des raisons pour lesquelles les maisons
anglo-saxonnes dominent aujourd'hui le marché de l'art mondial.
Né en 1913, cet Anglais, fils d'un aristocrate désargenté,
fut le premier à comprendre que l'on pouvait faire concurrence aux
grands marchands en organisant les ventes à l'échelle mondiale.
Des années passées à Washington au service du
contre-espionnage britannique
17(
*
)
, il avait
retenu l'ambition de faire de Sotheby's plus qu'une affaire purement
britannique pour lui donner une dimension internationale.
C'est lui semble-t-il qui eut l'idée, en 1956, à l'occasion de la
vente d'un tableau de Poussin,
l'Adoration des bergers
, d'attirer les
vendeurs par des
conditions commerciales attractives : garantie de
prix, aménagement de la commission payée par le vendeur
. En
dépit de l'échec commercial - le prix de garantie ne fut pas
atteint et Sotheby's dut payer la différence -, l'objectif publicitaire
avait été réalisé :
une maison de vente
avait montré qu'elle était en mesure de proposer et de garantir
aux particuliers un prix supérieur à l'offre des marchands.
C'est lui aussi qui encouragea le développement du
recours à
des historiens d'art comme experts
: Hans Gronau, émigré
venu d'Allemagne poursuivit, après la guerre, le travail
compétent et méticuleux, fondé sur de rigoureuses
recherches documentaires, de Tancred Borenius. Et c'est à ce niveau que,
pendant longtemps, les maisons de vente britanniques s'assurèrent un
avantage sérieux sur les commissaires-priseurs français, qui ne
purent que récemment s'assurer la collaboration d'experts de
qualité équivalente.
L'autre révolution dans les pratiques commerciales de Sotheby's semble
due au hasard des circonstances, lorsque l'exécuteur testamentaire d'un
collectionneur américain de peinture impressionniste imposa par contrat
à Sotheby's de
faire appel
aux services d'une agence de
publicité et de relations publiques
. La vente fut un succès
et l'affluence fut telle qu'on vit, pour la première fois,
apparaître une télévision en circuit fermé.
Lors de la grande vente suivante de peinture impressionniste, en 1958, le
système se sophistiqua : il fut convenu que les commissions,
minimales, jusqu'aux prix de réserve, augmenteraient par la suite dans
certains cas 100 % au dessus d'un certain niveau de prix ; par ailleurs,
une fois encore, le vendeur avait imposé un
gros budget de
marketing
, la
vente en soirée
, ce qui était une
première à Londres, et la tenue de soirée obligatoire pour
tous les participants.
La vente devenait un événement mondain
où il fallait voir et être vu.
L'installation aux États-Unis est un autre coup de génie de Peter
Wilson
, dont l'histoire est significative.
Au départ, il y avait à New-York, une firme Parke-Bernet, qui n'a
pas pu profiter de la proximité de la demande des collectionneurs
américains pour se développer. Cette entreprise avait deux
handicaps majeurs, indépendamment de son infériorité en
matière d'expertise ou de relations publiques : elle prenait des
commissions élevées pouvant aller jusqu'à 25 % et ne
pouvait pratiquer des prix de réserve, car compte tenu de la
mentalité américaine, le concept de minima secrets
présentait un caractère quasi frauduleux.
Conséquence : "
Grâce aux prix de réserve
pratiqués en Angleterre, il était devenu avantageux pour
Sotheby's et dans une moindre mesure pour Christie's, à la fin des
années cinquante d'expédier à Londres des peintures
d'outre-Atlantique et, comble de l'absurdité, pour les vendre à
des acheteurs américains, qui avaient fait exprès le voyage
à Londres et feraient expédier leurs achats aux
États-Unis
"
18(
*
)
.
Au début des années soixante, la concurrence était rude
entre les représentants aux États-Unis de Sotheby's - qui en
tirait déjà un cinquième de son chiffre d'affaires -, ceux
de Christie's et la maison Parke-Bernet, qui avait fini par adapter ses
méthodes aux besoins du marché.
Mais, il semble qu'en dépit du suicide de son président et de
difficultés financières certaines, les actionnaires de la maison
de vente américaine souhaitaient conserver leur indépendance
comme le note Robert Lacey dans le livre qu'il a consacré à
l'histoire de Sotheby's :
" Parke-Bernet n'entendaient pas
être absorbés par les Anglais, dont la piraterie sur le
marché américain semblait avoir causé tant de
dégâts
". Mais, en 1964, les actionnaires durent se faire
une raison . "
un déluge de manchettes de la presse
américaine annonçait l'invasion des Anglais appuyés par
leur puissance de feu financière, et les espérances d'un
investisseur secourable nourries par Parke-Bernet
s'écroulèrent...les porteurs de78 % des parts avaient consenti
à céder ces parts à Sotheby's pour un total de 1,5 25
millions de francs
", ce qui converti en francs en 1998, correspond
à un peu plus d'une centaine de millions de francs.
La somme n'était pas si considérable. Les commissaires-priseurs
français, un moment intéressés par l'opération, et
qui étaient passés par l'intermédiaire du banquier
André Meyer, en avaient-ils les moyens techniques et financiers ?
Certains y voient l'occasion manquée de s'adapter à la nouvelle
donne du marché de l'art ; d'autres plus sceptiques, peuvent faire
remarquer que pour réussir l'opération, il fallait disposer non
seulement de capitaux mais aussi d'un réseau local ainsi que de
personnels parlant l'anglais....
D'autres innovations apparurent pour répondre aux besoins des clients
comme la
publication d'estimation dans les catalogues
au début
des années 70 ou l'organisation de cours. Ceux-ci avaient l'avantage de
permettre aussi bien la formation de futurs clients que le recrutement de
futurs employés alliant compétence personnelle et relations dans
les milieux où la firme cherchait vendeurs ou acheteurs.
Mais, du moins si l'on en croit Robert Lacey et son ouvrage déjà
cité, c'est aussi à Peter Wilson que Sotheby's doit d'avoir comme
son concurrent - mais aussi comme dans beaucoup d'autres secteurs -
décidé de faire preuve d'une
discrétion professionnelle
à toute épreuve
: "
Aux yeux de Wilson, une
bonne maison de vente était pareille à une bonne banque suisse.
Elle arrangeait les choses. C'était au client qu'elle était
d'abord redevable, et si elle pouvait aider ce client à contourner
certaines lois et impôts fâcheux, cela faisait partie de ses
attributions.... Londres représentait le terminus du blanchiment. Le nom
ancien et respecté de Sotheby's assurait la couverture idéale
pour les acheteurs notamment les musées, qui exigeaient une provenance
respectable. La complaisance de Peter Wilson à faciliter des
exportations d'art compliquées contribua sans aucun doute à la
remarquable expansion de sa maison de vente dans les années
1960
. "
Maintenant, si ce genre de pratique doit être mentionné, il ne
peut pas être considéré comme monnaie courante. Le fait
pour Sotheby's de s'être fait piéger pour la sortie
illégale d'Italie d'un tableau vénitien du
XVIII
ème
a dû rendre les maisons de vente britanniques
encore plus prudentes. Il reste, cependant, significatif du pragmatisme
anglo-saxon. On est loin de l'environnement français, a priori
plutôt rigide, où la multiplicité des
réglementations en tous genres rend, semble-t-il, plus nette la
frontière entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas.
Pour conclure, on doit admettre que ces développements sur les raisons
de l'irréversible ascension des maisons de vente publiques
anglo-saxonnes ne semblent concerner que Sotheby's et donc ne traiter que la
moitié du sujet ; mais c'est méconnaître le fait que
toutes ces innovations commerciales qui ont fait la fortune cette maison de
vente se sont très rapidement étendues à sa concurrente.
Et c'est là, l'occasion d'insister sur
la supériorité
structurelle des opérateurs anglo-saxons, l'existence d'un duopole qui a
fonctionné en général dans le sens d'une concurrence
accrue, mais aussi, parfois en période de crise, dans le sens d'une
collusion au moins objective
.
Plusieurs fois, les deux maisons ont eu des projets de fusion, en 1933 puis au
début de la Guerre, sans que les pourparlers aboutissent.
Les deux
firmes sont restées concurrentes et c'est cette compétition
acharnée qui est sans doute à l'origine de leur domination
conjointe sur le monde de l'art
.
b) La fin de l'ère des grands marchands et l'avènement du règne des " auctioneers "
En
principe les ventes aux enchères ne constituent qu'une fraction du
marché de l'art à côté du négoce,
lui-même composé d'une variété d'agents allant du
consultant, au marchand avec ou sans galerie. Mais il en est devenu la partie
la plus visible sous l'effet d'une tendance lourde au déclin des grands
marchands, surtout si on la compare à l'état du marché
avant la seconde guerre mondiale.
Ce n'est qu'assez récemment, au cours des cinquante dernières
années, que les maisons de vente se sont imposées pour le
négoce des oeuvres de qualité internationale.
(1) Un espace de plus en plus restreint pour les marchands
Jusqu'à la seconde guerre mondiale
, les oeuvres
les
plus importantes étaient presque toujours vendues par les marchands. En
Angleterre, du moins, les maisons de vente ne dispersaient que des tableaux
moyens.
Les seigneurs du monde de l'art étaient les marchands
, les
Duveen, Knoedler ou Wildenstein, par lesquels il fallait passer pour constituer
une collection digne de ce nom : ainsi en 1929, Duveen paya-t-il
620 000 livres pour la collection de chefs-d'oeuvre de la Renaissance
de Robert Benson, soit à peu de chose près le chiffre d'affaires
de Sotheby's pour l'ensemble de l'année.
Longtemps ces marchands ont régné sur la marché. Leur
flair artistique, leur sens commercial, leur capacité à
s'attacher les services des grands historiens d'art - et notamment d'un des
plus célèbres d'entre eux Bernard Berenson (1865 -1959), leur
discrétion enfin, en faisaient les fournisseurs incontournables des
grands collectionneurs. Dans son histoire de Sotheby's, Robert Lacey
décrit ainsi la situation : "
la discrétion
participait à la séduction du marchand. Les gens riches
visitaient ses caves pour y voir des splendeurs dont le monde n'imaginait
même pas qu'elles fussent à vendre, et dont les vendeurs ne
souhaitaient pas faire savoir qu'ils avaient été contraints ou
tentés de les vendre. Le marchand savait où trouver un chef
d'oeuvre particulier et il savait où le placer. Il se servait des
maisons de vente que pour faire une affaire ou se débarrasser de ses
erreurs
. "
De ce point vue, les propos de John Walsh, directeur du Musée Getty,
tenus lors d'un colloque de 1989, juste avant l'effondrement du marché
mettent bien en évidence les changements. "
Le rapport des
forces a changé : aujourd'hui les maisons de vente sont en position
dominante, alors qu'il y a 20 ans une part beaucoup plus importante des oeuvres
les plus importantes du marché étaient possédées
par les marchands ou détenues par eux en dépôt. ".
Il poursuit en indiquant que surtout si la marchandise de qualité
est mise aux enchères, il faut que les marchands trouvent des capitaux
accrus
: " des prix de plus en plus élevés
signifient des investissements de plus en plus importants pour les marchands
qui achètent, ce qui veut dire qu'il faut une syndication plus vaste
pour partager les risques et que le rôle des financiers et de leurs
comptables s'accroît.
"
19(
*
)
Mais le vrai paradoxe souligné par John Walsh est que "
souvent les
marchands se trouvent en train de mettre des enchères contre le
collectionneur qu'ils auraient aimé avoir comme client
".
L'exemple pris par le directeur du Getty illustre la nouvelle logique telle
qu'elle résulte des comportements des collectionneurs induits par les
stratégies des grandes maisons de vente anglo-saxonnes.
"
Prenons un collectionneur, appelé Mme Haveamanet
[ jeu de
mot signifiant " Jai-un-manet " à rapprocher du nom de celui
de Havemayer, couple de collectionneurs, qui figurent parmi les grands
mécènes du Metropolitan Museum de New-York ],
qui
possède un tableau de Manet qu'elle a acheté du marchand Sam
Pfeffer pour 200 000 dollars en 1955. Elle se sent âgée, le Manet
est sale, elle veut de l'argent pour le donner à ses enfants, et c'est
la raison pour laquelle elle retourne à la maison Pfeffer. Celle-ci lui
indique qu'elle rachèterait bien le Manet pour 3,3 millions de dollars,
estimant qu'elle pourrait bien, après l'avoir fait nettoyer et
réencadrer, le revendre pour 4 millions de dollars. Christie's lui
annonce que la tableau pourrait bien atteindre 3,5 à 4 millions de
dollars et peut-être plus aux enchères et lui offre de lui
garantir un prix de 3 millions de dollars pour le jour de la vente. Mme
Havemanet aurait sans doute bien voulu éviter toute publicité et
procédera une discrète transaction privée, mais pourquoi
se priver ? Toutes ses amies font de cette façon et donc le tableau
est mis en vente. Le Manet fait 3,8 millions de dollars. Le
sous-enchérisseur était la maison Pfeffer, qui s'est
arrêtée parce que l'écart lui a paru insuffisant entre le
prix à payer et celui auquel il est susceptible de le vendre.
L'adjudicataire est un client de la maison Pfeffer, un jeune goldenboy de 36
ans, qui a été dans la galerie plusieurs fois et a
déjà acheté un Renoir mineur. Ainsi est
évincé l'intermédiaire. "
Et John Walsh de conclure : "
Les maisons de vente ont habilement
réussi à transformer les salles des ventes en
théâtre pour une large audience, prompte à vibrer par
procuration. Elles ont réussi à gagner la confiance des
collectionneurs sans expérience, qui ont peur de se faire rouler par les
marchands et qui croient que les ventes aux enchères reflètent le
juste prix d'une oeuvre d'art, et c'est ainsi que l'on a toute une population
de collectionneurs, banquiers et juristes, qui ne s'y connaissent pas beaucoup
en art mais qui lisent les journaux... "
Cet exemple pédagogique, et sans doute un peu caricatural, met l'accent
sur
deux phénomènes qui expliquent l'irrésistible
ascension des maisons de vente aux enchères au détriment des
marchands traditionnels :
• La diffusion, auprès d'une élite, de plus en plus
engagée directement dans les affaires, de
l'idée selon
laquelle les prix de vente publique sont les vrais prix de
marché
;
• Le développement d'une
activité de consultant en
achats auprès de cette même clientèle de
collectionneurs
, qui sont donc en mesure de se passer des conseils des
marchands - et ce d'autant plus facilement qu'ils bénéficient,
surtout aux États-Unis, de ceux de conservateurs, qui espèrent
une donation pour leur musée.
Les grandes maisons de vente ont su imposer une image d'objectivité
et de professionnalisme, à laquelle sont sensibles une nouvelle race de
collectionneurs, plus proches des milieux des affaires, animés par des
objectifs moins philanthropiques que leurs grands prédécesseurs,
et donc plus sensibles à des préoccupations de liquidité
et de rentabilité au moins à moyen terme.
Entre les maisons de vente et les marchands la lutte était trop
inégale, pour que ces derniers ne finissent pas, pour beaucoup d'entre
eux, par faire allégeance aux premières. Ces " grands
féodaux " sont aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux, des grandes
maisons de vente plus ou moins obligés d'appartenir à leur
" clientèle ".
Face à ces nouveaux collectionneurs, aux préoccupations
axées sur le court terme et soucieux de mobilité, les maisons de
vente offrent des conseils gratuits à l'achat, des possibilités,
au moins dans un marché porteur, de réaliser son bien dans de
bonnes conditions rapidement.
Les marchands n'ont plus guère d'atouts structurels : leur
compétence est battue en brèche par celle des experts
salariés, dont la qualité est notoire, le paiement comptant par
le système d'avance et de prix garanti, le paiement à
tempérament par les avances des maisons de vente. Reste la
discrétion, qui en dépit des efforts des maisons de vente, reste
le point fort des marchands.
(2) Encore quelques atouts pour le négoce
Les
marchands ne sont pas pour autant exclus du marché pour un certain
nombre de raisons.
D'abord, parce que dans des domaines très spécialisés,
pour lesquels les niveaux de prix ne sont pas très élevés,
certains marchands peuvent conserver des
sources d'approvisionnement
propres
et une clientèle qui ne peut suivre les ventes publiques et
qui, par ailleurs, est en mesure de constater que les prix de ventes publiques
ne sont pas forcement plus élevés que ceux de galeries.
Ensuite, parce qu'en période de crise comme celle qu'on a connu depuis
le début des années 90
, le collectionneur redécouvre
les charmes discrets du négoce
, qui paie immédiatement ou du
moins qui a l'avantage, même s'il ne prend l'oeuvre qu'en
dépôt, de ne pas faire perdre à l'oeuvre trop de sa
" fraîcheur ".
Mettre en vente publique, c'est risquer de " griller " une oeuvre,
si elle est ravalée
. En général, il faudra attendre
plusieurs mois, changer de lieu, voire de maison de vente, pour remettre sur le
marché une oeuvre invendue, avec le risque que, les catalogues et les
annuaires des ventes aidant, les collectionneurs potentiels s'en rendent compte
et que l'oeuvre fasse encore moins cher à la seconde mise aux
enchères qu'à la première.
Enfin, il convient de noter
que les modes d'intervention des marchands
évoluent
sous l'effet de la crise mais aussi pour des raisons
structurelles : de plus en plus de marchands, à Londres comme
à Paris, ont tendance à restreindre leurs surfaces d'exposition
sur rue pour se concentrer sur leur clientèle privée - ils
travaillent alors en appartement.
Grâce à la logique de l'événement qui les anime,
grâce à la concentration de marchandise qu'ils suscitent, les
foires et salons constituent les seules structures de ventes de nature à
faire concurrence aux maisons de vente aux enchères.
Ainsi, apparaissent, de nouveaux marchands, souvent d'anciens experts
salariés des grandes maisons de vente anglo-saxonnes, qui trouvent dans
le négoce une façon plus lucrative d'exercer leurs talents et de
valoriser un carnet d'adresses, qu'ils procèdent à des
opérations d'achat et de vente ou qu'ils se contentent de jouer les
intermédiaires s'ils ne peuvent ou ne veulent pas investir trop de
capitaux.
(3) Les marchands comme agents de régulation nécessaires des ventes publiques
Même si les marchands vont continuer à jouer un
rôle important, nul doute que leur métier se définit
désormais par rapport aux ventes publiques et plus
précisément en fonction de la stratégie des grandes
maisons de vente.
Le développement du marché de l'art repose sur une relation de
dépendance réciproque entre marchands et maisons de vente aux
enchères, qui si elle n'est pas nouvelle - les marchands ont toujours
acheté et vendu aux enchères - prend une nouvelle dimension dans
la mesure où elle devient fondamentalement inégalitaire.
Le marché mondial de l'art forme une sorte d'écosystème au
centre duquel se trouvent Sotheby's et Christie's et qui fait intervenir un
ensemble de
marchands qui assurent les fonctions de régulations
nécessaires au système
, dans le cadre de stratégies de
plus en plus définies par les grandes maisons de vente.
Il n'est d'ailleurs pas étonnant de constater, à un autre niveau
moins structurel mais non moins significatif, (les marchands les plus
liés aux ventes aux enchères n'ayant pas forcément pignon
sur rue), que la perspective de l'installation des deux majors dans le quartier
du faubourg Saint-Honoré ait entraîné une modification de
la géographie du commerce d'art et d'antiquité à
Paris
20(
*
)
.
Pour des raisons de confidentialité évidentes, aucun chiffre n'a
été publié ni par les maisons de vente anglo-saxonnes, ni
par les commissaires-priseurs parisiens, mais il est généralement
estimé que
le négoce constitue
à la vente comme
à l'achat une part importante de la clientèle,
généralement estimée selon les périodes et les
spécialités à
entre 30 et 50 % du volume des achats et
des ventes aux enchères.
Indépendamment du fonctionnement pervers des relations entre marchands
et maisons de vente aux enchères pendant les folles années de la
deuxième partie des années 80, sur lesquelles on reviendra, il
faut noter que surtout ces dernières années
le dynamisme des
ventes publiques notamment à Paris faisait contraste avec le peu
d'empressement des acheteurs dans les galeries
. Ainsi non seulement les
ventes publiques permettent aux marchands de mobiliser leurs stocks mais
encore, il est maints exemples d'objets qui sont vendus beaucoup plus cher en
vente publique qu'il n'étaient proposés - sans succès -
dans les galeries.
Aussi,
certains marchands
vendent-ils moins dans leur magasin -
lorsqu'ils en ont -, qui n'est là, pour ainsi dire, que pour la galerie,
et ont-ils pris
l'habitude de mettre leur trouvailles aux
enchères
, pour profiter soit du goût du jeu des acheteurs que
cela amuse plus d'acheter aux enchères que de marchander dans une
galerie, soit lorsque l'oeuvre est dirigée sur l'étranger, du
différentiel de niveau de prix entre la France et l'étranger.
Indépendamment des phénomènes d'arbitrage entre les
marchés qui donnent des possibilités de gains parfois
considérables pour les marchands, le négoce part donc avec un
handicap face aux
maisons de vente, qui conservent leur image d'arbitre,
alors qu'elle sont de plus en plus de parties prenantes
.
Celles-ci ont réussi, on l'a vu, à faire accepter comme une
évidence que le prix de vente publique est un prix de concurrence,
reflétant la libre confrontation de l'offre et de la demande dans un
marché transparent. A cela s'ajoute la conviction chez un certain nombre
d'amateurs, certes non dépourvue de fondement mais certainement à
nuancer, que le marché des ventes publiques est un marché de gros
où s'approvisionnent les marchands et où les particuliers - pour
peu qu'ils soient bien conseillés - peuvent acheter à des prix de
marchands.
Or, si le développement des ventes publiques a certainement
contribué à l'unification du marché de l'art et à
la constitution de prix plus objectifs, il ne faut pas en déduire que
tous les prix enregistrés reflètent une réalité
durable.
c) Les deux lectures d'un décrochage annoncé
La
France, dont la position était sinon dominante du moins éminente
au début des années cinquante, se trouve aujourd'hui largement
distancée
.
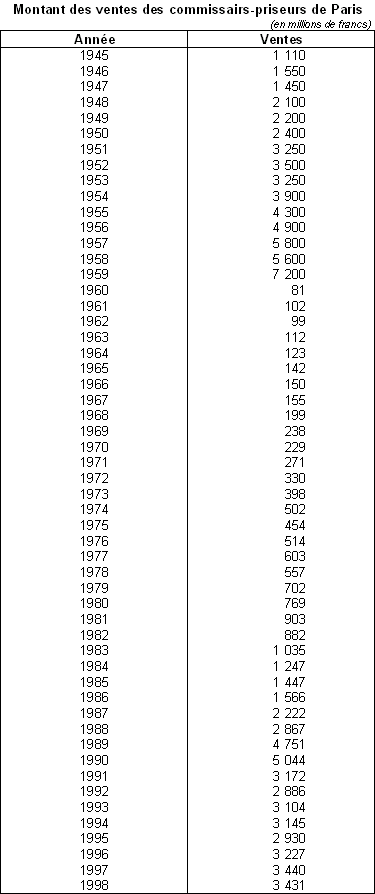 Le décrochage est d'autant plus
déconcertant qu'il était annoncé
, de nombreux
observateurs ont très tôt pressenti une telle évolution.
Le décrochage est d'autant plus
déconcertant qu'il était annoncé
, de nombreux
observateurs ont très tôt pressenti une telle évolution.
(1) Un recul perceptible dès le milieu des années 1960
Dans un
ouvrage publié en 1964, " Les 400 coups du marteau
d'ivoire "
21(
*
)
M. François
DURET-ROBERT, spécialiste du marché de l'art, pouvait
déjà en conclusion, constater que "
Paris a perdu sa
place de leader ".
Il poursuivait : "
Dans la course au
chiffre d'affaires, c'est Londres qui a endossé le maillot jaune ;
il existe dans cette ville plusieurs maisons spécialisées dans
les ventes aux enchères. Les deux plus importantes, Sotheby et Christie,
réalisent respectivement 148 et 52 millions de francs de chiffre
d'affaires annuel (chiffres de la saison octobre 1962-juillet 1963).
" Celui de l'ensemble des ventes parisiennes n'atteint que
110 millions de francs (chiffres de la saison octobre 1962-juillet
1963). "
" Dès maintenant, Parke-Bernet, la principale galerie de New-York,
s'inscrit comme un concurrent dangereux avec 59 millions de francs (chiffres de
la saison octobre 1962-juillet 1963)...
" Si nous jetons maintenant un coup d'oeil sur le classement des
concurrents, il y a dix ans, nous constatons que Paris était alors le
leader indiscuté avec un chiffre d'affaires de 3 milliards de francs
(légers) (chiffres de la saison 1952-1953) "
" Très loin derrière lui, arrivait le peloton, qui groupait
Sotheby, Christie et Parke-Bernet - chacune de ces maisons réalisant un
chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard de francs (chiffres de la saison
1952-1953) ".
L'auteur posait alors la question : " Pourquoi le marché
parisien est-il, depuis 10 ans en perte de vitesse ? ", en faisant
les deux réponses suivantes : " Première raison :
dans notre pays, les frais de vente sont trop
élevés ; " ; " Seconde raison :
l'organisation française des ventes aux enchères est beaucoup
plus rigide que celle des pays anglo-saxons ".
La comparaison des chiffres que l'on peut tirer du graphique de la page 168 du
tome 2 du présent rapport montre que c'est de 1958 à 1967 que les
deux firmes britanniques commencent à se détacher
nettement ; le chiffre d'affaires passe, pour Chrsitie's, d'un niveau de
d'un peu moins de 30 millions de francs à 150 millions de francs de
chiffre d'affaires, tandis que Sotheby's passait de 60 millions de francs
à 300 millions de francs de chiffres d'affaires. De leur
côté les commissaires-priseurs de Paris passaient en nouveaux
francs de 72 à 155 millions de francs de chiffre d'affaires. Ainsi
déjà une fois et demie plus gros que les commissaires-priseurs
parisiens en 1958, les " auctioneers " britanniques le sont trois
fois plus en 1967.
Un autre observateur, M. Laurent de GOUVION SAINT-CYR, portait un diagnostic
semblable, dans un ouvrage publié en 1969 aux éditions de La
Pensée moderne, " Le marché des antiquités en
Europe " :
"
Si la France fut la terre d'élection du plus beau mobilier du
monde, les États-Unis, le plus important acheteur d'oeuvres d'art, c'est
à Londres que se négociaient ces dernières années
les pièces les plus rares et les plus chères. "
" Premier marché international d'objets anciens, Londres avait
quelques raisons d'accéder à cette place : sa position
géographique, son influence, mais surtout, la souplesse et le
libéralisme de son régime en matière de commerce d'art.
Les ventes anglaises sont parfaitement organisées et servies par une
information efficace ; les frais y sont réduits, les
facilités d'importation et d'exportation réelles. Quant aux
garanties réservées aux objets mis en vente, elles peuvent
paraître assez imprécises : elles reposent, en fait, sur le
standing des maisons et le soin qu'elles apportent à entretenir leur
réputation ".
On ne pouvait mieux exprimer les raisons de la supériorité des
maisons de vente anglo-saxonnes. Alors pourquoi n'a-t-on pas réagi et
a-t-on attendu que Bruxelles nous contraigne à nous aligner sur la loi
commune et encore, à chaque fois, en essayant de gagner du temps, ce qui
fut fait mais au détriment du marché de l'art français
dans son ensemble.
(2) Le combat d'arrière-garde
Par
l'effet d'un paradoxe classique,
les commissaires-priseurs et, en
définitive, le marché de l'art français dans son ensemble
furent d'une certaine façon victimes du monopole et donc de la
protection qui leur était conférée
.
A l'exception d'une poignée d'entre eux, ils avaient, individuellement,
intérêt au maintien du statu quo.
Collectivement, s'ils étaient assez largement conscients des limites
résultant de leur statut d'officiers ministériels, la plupart
d'entre eux considéraient qu'ils pouvaient avoir les coudées plus
franches sans les risques d'une concurrence accrue ; qu'il suffisait donc
du cadre juridique pour leur permettre de trouver des capitaux, mais sans
ouverture réelle de la profession ; qu'ils pourraient continuer
à exercer le même métier, comme une profession
libérale, avec des facilités supplémentaires en
matière de mobilisation de capitaux et de la publicité, tout en
faisant l'économie d'une réforme radicale transformant les
offices en véritable entreprise.
Or, la compétition n'est pas équilibrée entre des
professions exerçant longtemps leur activité dans un esprit
libéral, presque comme des dilettantes, et le professionnalisme
anglo-saxon.
328 offices, dont 68 à Paris, ces seuls chiffres sont significatifs de
la dispersion de la profession.
Il faut souligner que les
deux " petites " maisons de vente
anglaises Phillips (1200 millions de CA en 1998) et Bonhams (450 millions de
francs)
font plus que jeu égal
avec l'étude Tajan :
361 millions de francs en 1998
Le tableau ci-après montre que les résultats de l'étude
Tajan ont sensiblement fluctué avec la crise du début de la
décennie, puisque le chiffre d'affaires a presque été
divisé par trois depuis le sommet historique de 1990, année au
cours de laquelle il avait atteint près de 1,15 milliards de francs.
Il est néanmoins remarquable, qu'en dépit de cet effondrement du
chiffre d'affaires l'étude ait pu redresser ses recettes nettes.
Le déséquilibre des forces est évident. Qu'une bonne
partie des membres de la profession aient cherché à retarder
l'échéance de l'alignement sur le droit commun européen,
ne l'est pas moins. Dans l'ensemble, la profession ne souhaitait pas
accélérer la mise en oeuvre de la réforme ; mais la
question reste entière de savoir si les commissaires-priseurs avaient
les moyens et la capacité de faire concurrence aux anglo-saxons, s'ils
avaient pu être soustraits aux contraintes de leur statut d'officier
ministériel.

(3) Les deux interprétations
A cet
égard, l'irrésistible ascension des deux majors anglo-saxonnes et
le décrochage des commissaires-priseurs français peuvent faire
l'objet de deux interprétations.
Il y a ceux qui en font la
conséquence du statut d'officier
ministériel
sclérosant à force d'être
protecteur : interdiction de la publicité ;
impossibilité de lever les capitaux nécessaires... La
dégressivité (jusqu'en 1993) des frais acheteur, enfin,
étant venue priver les commissaires-priseurs des marges
nécessaires à leur développement et les empêcher de
faire porter leurs efforts commerciaux sur le
vendeur aujourd'hui,
maître de la localisation des ventes.
Et puis, il y a une autre
lecture plus structurelle
: certains
atouts des firmes anglo-saxonnes : professionnalisme des catalogues
(publication d'estimations, sérieux des études documentaires sur
les oeuvres, en dépit de l'absence de toute garantie
d'authenticité.....) Relations publiques sur tous les continents,
médiatisation, saisonnalisation des ventes - janvier et mai à
New-York, décembre et juin à Londres -, toutes innovations qu'on
doit largement à Peter Wilson de Sotheby's, étaient accessibles
aux commissaires-priseurs, qui pourtant ne l'ont pas fait ou qui n'y sont venus
que très tardivement : longtemps, ils en sont restés aux
temps des mondanités, alors que l'on était entré dans
celui des relations publiques.
Inversement, d'autres atouts comme l'ouverture sur l'extérieur et
l'immersion dans le milieu des riches américains susceptibles de devenir
sinon des collectionneurs du moins des acheteurs, restaient largement hors
d'atteinte des commissaires-priseurs parisiens
: à supposer
qu'ils aient pu racheter Parke-Bernet, ils auraient sans doute bien du mal
à le gérer. L'expérience des années 70, a
montré, en d'autres domaines, que l'aventure américaine
n'était pas sans risques pour les entreprises françaises.
Le choix entre ces deux interprétations peut varier selon
l'expérience de chacun. Une chose est sûre, cependant : c'est
ce que, si sur leur propre sol des individus peuvent utiliser leur connaissance
du terrain pour résister, si, ponctuellement, des individus peuvent
réussir des " opérations commandos ", comme ce fut le
cas avec les
Noces de Pierrette
de Picasso, des individus, quels que
soient leurs talents, ne résistent pas durablement à des
organisations, lorsqu'il s'agit de la conquête des marchés
extérieurs.
d) Les causes structurelles de la migration vers les États-Unis
La
vitalité du marché de l'art aux États-Unis
a des
causes structurelles qui tiennent sans doute au nombre de ses collectionneurs
mais aussi et surtout au dynamisme de son économie : une
croissance exceptionnelle depuis 10
ans
, plus de richesse
accumulée (l'aspect conjoncturel est très important dans l'envol
du marché américain),
plus de fortunes en cours de
constitution
qu'ailleurs, crée les conditions d'une demande forte
pour les objets d'art, indépendamment de tout système fiscal
favorable.
Les facteurs économiques généraux sont importants soit
directement en favorisant l'envol des cours de bourse dont il a
été démontré que leur évolution était
assez bien corrélée à celle des prix des oeuvres d'art,
soit indirectement en favorisant le développement des collections.
A la question posée à un jeune marchand parisien d'art ancien qui
avait une importante clientèle américaine, de savoir pourquoi il
y avait beaucoup plus de collectionneurs aux États-Unis qu'en Europe et
notamment en France, la réponse fut nette : ce n'est pas tellement
qu'il y a plus de collectionneurs, il y a tout simplement plus d'acheteurs qui
paient sans marchander et sans demander d'interminables délais de
paiement....
Mais l'atout majeur, qui concerne essentiellement l'art contemporain, mais qui
se répercute également sur l'art ancien est le fait que
les
États-Unis sont aujourd'hui le lieu naturel des avant-garde
, ce qui
est important pour toute une certaine élite .
La France des années 50, c'était encore un pôle
d'attraction culturel majeur, notamment pour les Américains,
intellectuels ou milliardaires. C'était le temps où les riches du
monde entier - et notamment les Grecs - avaient un pied-à-terre dans la
capitale. Paris était comme le New-York d'aujourd'hui, décrit
dans le texte précité de Paul Ardenne : aucun effort
n'était nécessaire puisque le monde était à ses
pieds.
A partir des années 60/70, il est clair que c'est de l'autre
côté de l'Atlantique que se trouve concentrées richesse
matérielle et créativité artistique.
Il n'en faut pas
plus pour que, sous l'effet de facteurs macro-économiques, cet avantage
structurel des États-Unis ne se renforce au détriment de
l'Europe.
3. La bulle spéculative des années 80
A
l'origine de l'envolée des prix dans les années 80, il y avait
l'idée que l'art était une marchandise comme les autres et le
marché de l'art une sorte de bourse sur laquelle on pouvait
spéculer
, sans risque ou presque,
compte tenu des facteurs
fondamentaux faisant escompter une raréfaction croissante des
oeuvres
.
Que cette analyse soit, sinon fausse du moins discutable - comme on va le
montrer -, importe peu ; ce qui compte, c'est qu'elle ait convaincu de
nouveaux acheteurs de se porter sur le marché de l'art et ait induit des
modifications du comportement d'un nombre important de collectionneurs, au
point d'aboutir à une hausse des prix dans un
processus classique de
prophétie auto-réalisante
.
Un tel processus est apparu d'autant plus irrésistible qu'il a pu
s'alimenter d'une pluie de
prix records largement répercutés
par les médias
à l'initiative des grandes maisons de vente,
d'autant plus objectifs et incontestables apparemment, qu'ils semblaient le
résultat de la libre confrontation de l'offre et de la demande.
Mais l'éclatement de la bulle spéculative en 1990 n'a pas
emporté les grandes maisons de vente ; bien au contraire, il leur a
donné l'occasion de se restructurer, à l'inverse des
commissaires-priseurs français figés dans l'attente d'une
réforme.
a) Le niveau élevé et la croissance des prix des oeuvres : mythes ou réalités ?
La
hausse inéluctable des prix de l'art est apparue surtout, à la
fin des années 80, comme une de ces évidences, dont on ne pouvait
raisonnablement douter.
L'objet d'art étant la rareté par excellence
22(
*
)
, son prix ne pouvait être
qu'élevé et la hausse de celui-ci absolument inévitable.
Cela paraissait encore plus évident pour l'art ancien, dès lors
qu'à la fixité de l'offre s'ajoutaient les destructions du temps
et l'absorption par la main morte des musées : " dans le
marché de l'art consacré par l'histoire, l'offre potentielle est
fixée et la raréfaction croissante "
23(
*
)
.
Faute de recul et, à certains égards, d'esprit critique, on ne
voyait pas que cette hausse n'était peut-être pas
générale et n'est sans doute pas fatale.
D'abord
, le caractère limité de l'offre d'oeuvres historiques
est relatif
: toute l'histoire de l'art depuis le
XIX
ème
siècle est caractérisée, comme on
l'a déjà vu à propos du rôle des marchands, par un
processus permanent de réévaluation qui va des primitifs aux
peintres académiques du siècle dernier, en passant par les
" peintres de la réalité ". On note incidemment que,
plus encore que les musées, c'est le marché qui est à
l'origine de ces redécouvertes et qui fait donc progresser l'histoire de
l'art.
Ensuite,
les records affichés et médiatisés par les
maisons de vente, étaient sinon des exceptions du moins des cas
particuliers qu'on ne pouvait considérer comme donnant une image de la
tendance de l'ensemble du marché.
Toute la question est de savoir si
les hausses mises complaisamment en avant, ne cachaient pas des baisses en
monnaie constante, moins spectaculaires mais non moins réelles.
Enfin, on aurait considéré qu'au moins à court et moyen
termes, la tendance pouvait s'inverser et les évolutions se corriger.
Pourtant, des travaux d'une série d'économistes auraient dû
faire douter de ce que les arbres puissent, monter jusqu'au ciel. On dispose en
effet d'une série d'études sur l'évolution des prix des
oeuvres d'art, qui bien que différentes par la période de
référence vont à l'encontre de l'idée d'une forte
hausse des prix des oeuvres d'art dans leur ensemble.
(1) L'approche de William J. Baumol
William J. Baumol
, professeur des universités de
Princeton et de New-York, a ainsi étudié les prix sur une
très longue période allant de 1652 à 1961 en relevant 641
transactions permettant de comparer les prix pour les mêmes
oeuvres
24(
*
)
. Il conclut que les
résultats de l'étude statistique semble confirmer
l'hypothèse selon laquelle, en situation d'équilibre à
long terme,
le rendement des oeuvres d'art "
doit présenter
une corrélation étroite avec celui des placements financiers, le
premier étant systématiquement inférieur aux seconds, de
sorte que la somme des bénéfices psychologiques et
monétaires est égale pour les deux formes
d'investissement
".
En d'autres termes, l'économiste canadien a testé
l'hypothèse selon laquelle,
les agents sont prêts à
accepter un rendement faible pour les oeuvres d'art dans la mesure ou la
possession de celles-ci leur apportent d'autres satisfactions d'ordre
psychologique
. A contrario, cela veut dire qu'il ne serait pas normal que
la rentabilité des oeuvres s'établisse durablement au-dessus de
celle des titres.
En fait, et sans tenir compte ni des coûts de transaction ni des risques
de destruction, le rendement des oeuvres d'art sur la base d'un taux annuel
actualisé serait de 0,55 % par an en termes réels, ce qui
représenterait un coût d'opportunité de 2 % par an par
rapport aux obligations d'État prises comme valeur de
référence des actifs financiers
25(
*
)
.
W.J. Baumol souligne également
l'extrême dispersion des
rendements
, dont il remarque que ils sont plus importants lorsque la
durée de détention est plus courte.
Ce type d'approche présente une série de biais de nature
à surévaluer nettement le rendement du placement en oeuvres
d'art
:
• Il se fonde sur
une sélection ex post des peintres
" les plus connus du monde ",
par Reitlinger
26(
*
)
, dont on comprend intuitivement qu'elle consiste
à ne retenir pour calculer le rendement du pari sur les courses que les
chevaux placés à l'arrivée ;
• il
ne tient pas compte des coûts de transactions
et du
fait que la plupart des acheteurs sont à cette époque des
marchands.
L'analyse de Philippe Simonnot mérite d'être rapportée en
ce qu'elle explicite le biais des analyses effectuées sur la base de la
compilation de Gerald Reitlinger : "
Quant au processus
aléatoire de formation des cotes artistiques, il n'est pour ainsi dire
jamais pris en considération. Or raconter l'histoire financière
merveilleuse d'un tableau de Van Gogh ou de Picasso équivaut à
calculer la rentabilité d'un billet de loterie en ne retenant que le
billet gagnant...Le collectionneur qui a acheté un tableau au temps
où la cote de cet artiste était encore faible, s'est aussi
procuré à la même époque une multitude d'oeuvres,
qui depuis sont tombées dans l'oubli ; par conséquent, pour
calculer réellement la rentabilité de l'investissement, il serait
nécessaire de connaître le destin financier de l'ensemble de la
collection
"
27(
*
)
.
L'investissement en oeuvres d'art est une loterie, dont on ne peut se contenter
de calculer la rentabilité en ne prenant en compte que les billets
gagnants : citer le cas d'une oeuvre de David Hockney achetée 200
dollars en 1961 et vendue 2,5 millions de dollars en 1995, n'a guère
plus de signification que d'évoquer le cas d'un joueur qui a
gagné le tiercé ; ce qu'il faudrait prendre en
considération, c'est l'ensemble des dépenses faites par le
gagnant - le coût de tous les tickets achetés par l'ensemble des
parieurs.
On comprend d'ailleurs en poursuivant la comparaison avec le loto, que
les
gains sont nécessairement compensés par les pertes de autres,
sauf à considérer que la masse des paris croît de
façon régulière et irréversible et/ou que le stock
d'oeuvres " artistiques " tend à diminuer avec le temps.
De ce point de vue, il semble que l'on puisse soutenir que le jeu est à
somme positive en cas de croissance du revenu global et de maintien de la part
de celui-ci consacrée à l'achat d'oeuvres d'art, ainsi que, a
fortiori, s'agissant d'un bien de luxe ayant une élasticité
revenu positive, si cette -proportion tend à s'accroître.
Quant à la diminution du nombre d'oeuvres d'art sous l'effet des
destructions du temps et des retraits dus aux achats des musées, il faut
la mettre en rapport avec les adjonctions au stock d'oeuvres nouvellement
créées, susceptibles de venir augmenter l'offre, sans que l'effet
net soit forcément positif en toutes les périodes.
L'autre biais peut également être brièvement
commenté en soulignant que presque 60 % des acheteurs recensés
dans la compilation de Reitlinger sont des marchands, ce qui veut dire si l'on
prend en compte les prix de ventes des collectionneurs on ne connaît pas
leur prix d'achats. En d'autres termes, en comparant sans les distinguer prix
de gros et prix de détail,
on confond variation des prix et
rentabilité.
(2) Les autres études économétriques
Deux
économistes, MM. Frey et Pommerhene, ont repris cette
méthodologie pour, à partir de 1200 transactions correspondant
à la revente d'un même objet, entre 1961 et 1987, dégager
un rendement de 1,5 %, moitié moindre de celui de 3 % offert par des
placements financiers sans risques. Une telle approche restreinte à la
période récente évite certains défauts de celle de
W.J. Baumol, bien qu'elle continue de faire l'impasse sur le problème
des coûts de transaction et donc persiste à assimiler hausse des
prix et rentabilité.
Une dernière étude, enfin, apporte un éclairage
intéressant sur la question, dans la mesure où ses
résultats suscitent des réflexions méthodologiques de
nature à mieux comprendre les mécanismes du marché de
l'art.
Trois économètres, MM. O. Chanel, L.A. Gérard-Varet et
V. Ginsburgh, ont, dans un article publié dans la revue
" Risques " défendu des résultats très
différents, puisqu'ils aboutissent à des taux de rendement
réel de 10,7 % par an entre 1957 et 1988
28(
*
)
.
Les raisons de cette divergence tiennent à une méthodologie
consistant à prendre en compte, pour un ensemble d'artistes
sélectionnés - au nombre de 32 -, non les seules
transactions correspondant à la revente de la même oeuvre, mais
l'ensemble des transactions constatées tous les ans pour chaque artiste.
Par un traitement économétrique, les auteurs s'efforcent alors de
tenir compte des caractéristiques des oeuvres vendues (taille ;
année ; date de la vente, maison de vente.. seules
caractéristiques effectivement disponibles.... ) pour aboutir à
dégager, pour chaque année, la valeur de l'oeuvre type
" corrigée " des caractéristiques propres et
aléatoires des oeuvres réellement vendues.
Comment expliquer une telle divergence entre 5,5 % et 1,5 %, soit une
différence de 4 % pour une période analogue ? A
l'époque où cette étude a été pour la
première fois présentée, en 1991, elle semblait pour
beaucoup intuitivement, plus conforme à la réalité d'un
marché en plein boom spéculatif que les analyses prudentes de
W.J. Baumol et de MM. Frey et Pommerhene. Elle venait à point pour
accréditer " scientifiquement "
29(
*
)
le fait que la hausse que chacun pouvait constater
était à peine supérieure à la tendance et que de
tels rendements étaient à la portée d'investisseurs
raisonnablement informés.
En fait, l'approche économétrique globale encourt les mêmes
reproches que les précédentes études -
méconnaissance des frais de transaction et de détention, biais
dû à une sélection rétrospective des artistes -
auxquels s'ajoute le défaut de ne pas étudier, pour chaque
artiste retenu, les variations de prix d'oeuvres déterminées mais
celles du prix moyen des oeuvres vendues en ventes publiques.
En d'autres termes, on croit mesurer la cote moyenne d'un artiste alors que
l'on mesure
le prix moyen de ses oeuvres portées en ventes
publiques
. Or celui-ci
varie en fait pour d'autres raisons que la cote
de l'artiste et en particulier à cause du partage du marché entre
ventes publiques et négoce
. Si, comme on l'a indiqué plus
haut, un nombre croissant d'oeuvres de qualité, autrefois
négociées exclusivement par les marchands sont dirigées
vers les ventes aux enchères, le prix moyen des oeuvres vendues en
ventes publiques pourra augmenter, sans que les rendements
dégagés à la revente d'une même oeuvre soient
nécessairement aussi importants.
Une autre raison pour laquelle l'augmentation des prix moyens même
corrigées des variations individuelles (mais cette correction ne peut de
toute façon que prendre en compte des caractéristiques
éminemment sommaires) peut être supérieure aux rendements
dégagés sur des oeuvres spécifiques vient du
phénomène de circulation des oeuvres, dont
l'accélération peut, si elle porte surtout sur des oeuvres de
niveau de qualité et donc de prix élevé, accroître
encore le prix moyen des oeuvres vendues aux enchères
.
(3) L'art peut-il être un bon investissement ?
Des
études complémentaires sont bien entendu nécessaires,
notamment pour voir l'évolution des prix des oeuvres de l'art. Mais de
ces considérations techniques, il résulte les observations
suivantes :
•
Il faut accueillir avec la plus grande prudence aussi bien les
succès, nécessairement ponctuels
, claironnés par les
maisons de vente
que les prétendus indices établis par des
organismes de recherche indépendants
. Sans même parler de
l'expérience controversée du Times Sotheby's index
30(
*
)
, on a tout lieu de penser que les indices
publiés dans la presse spécialisée présentent les
mêmes défauts que ceux des études
économétriques précitées et, notamment, qu'ils font
état de prix moyens et pas de rendements réels..
"
La bourse a son CAC 40 ou son Dow Jones, le marché de l'art
a désormais son JDA art 100 "....peut-on lire dans le Journal des
Arts n° 81 du 16 au 29 avril 1999, qui poursuit : " à force de
parler de crise, on avait tendance à se convaincre que la
dépression des années 1990-1996 avait ramené le
marché très loin en arrière. En fait le JDA Art 100 sur
plus de vingt ans de 1975 à 1998 montre qu'au plus bas en 1995, avec un
indice à 1651 le niveau de prix atteint en ventes publiques
n'était guère inférieur à celui de 1987
(1690) "
31(
*
)
.
Il est difficile de juger d'un tel indice (cf. graphique tome 2
page 167) dès lors qu'on manque d'éléments sur les
spécialités concernées (cet indice comprend-il les arts
graphiques et les arts décoratifs ?) et sur ses modalités de
calcul, dont il est seulement dit que les prix étaient calculés
en monnaie courante. On note le contraste entre le profil de la courbe annuelle
et celui de la courbe mensuelle - l'idée même d'indices mensuels
en la matière est étonnamment ambitieuse - ainsi que le
commentaire général sur la conjoncture qui tient sans doute
autant de témoignages que de l'observations des courbes :
"
L'indice calculé début avril démontre que dans
le mouvement de reprise générale du marché ces deux
dernières années, les évolutions à très
court terme restent encore hésitantes et les situations
contrastées selon les spécialités. "
• Il est probablement inexact de considérer que les oeuvres d'art
constituent un bon placement, à court terme comme sur le long
terme : certes certains acheteurs ou collectionneurs gagnent, parfois
beaucoup, s'ils ont eu de la chance ou ont été bien
conseillés ; d'autres, sans doute sensiblement plus nombreux,
devraient perdre, s'ils prennent bien en compte l'érosion
monétaire, les frais de transaction et les coûts
d'entretien : on a tendance à claironner les hausses, on est
naturellement plus discret sur des pertes qui pourraient témoigner des
fautes de goûts de leur auteur ; en outre, beaucoup de ventes
intervenant sur successions, les héritiers sont naturellement moins
attentifs à la rentabilité de l'investissement ;
• Il n'y a
pas de consensus sur la stratégie
gagnante
; pour les uns, la seule règle est de toujours acheter
la qualité, au détriment de l'objet simplement moyen, car c'est
toujours l'exceptionnel que s'arracheront les collectionneurs ; d'autres
comme Maître Maurice Rheims pensent qu'on "
peut sans se tromper
affirmer que les objets usuels et de qualité ont vu croître depuis
soixante ans leur valeur moyenne dans des proportions incroyables ; mais
les objets exceptionnels, compte tenu des fluctuations monétaires, ont
souvent à peine conservé leur prix... Quel est le directeur de
Grand magasin parisien qui oserait payer 1 200 000 francs [ plus de 180 000
millions de francs d'aujourd'hui ] un tableau contemporain ? Pourtant,
c'est ce qu'a fait M. Chauchard, propriétaire des magasins du Louvre
lorsqu'il acquit vers 1890 la Bergère de Millet ".
Aujourd'hui,
ce pourrait bien être le cas de du portrait du docteur Gachet, le tableau
le plus cher du monde, d'une qualité exceptionnelle mais qui devrait
sans doute attendre du temps avant de trouver sa rentabilité.
En conclusion, il faut souligner que
le gain qu'il faut attendre d'une
oeuvre d'art est avant tout une satisfaction esthétique
.
Espérer y trouver une source de profit est un objectif difficile
à atteindre pour des particuliers qui doivent supporter des coûts
de transactions importants, soit qu'ils vendent leurs biens aux marchands, soit
qu'ils les mettent en vente aux enchères avec le risque s'il reste
invendu, de garder l'objet sur les bras ou de ne pouvoir s'en séparer
qu'au prix d'une décote substantielle.
Bref, on a toutes les raisons de croire que
l'art n'est pas un aussi bon
investissement
qu'on le dit généralement
:
•
les " valeur sûres " conserveront toujours, par
définition, de la valeur, mais les risques de perte en francs constants
ne sont pas négligeables
: ainsi le mobilier ancien qui
régnait sur les intérieurs bourgeois jusqu'au milieu de ce
siècle, est aujourd'hui délaissé au profit du mobilier
contemporain et a vu sa cote baisser sensiblement sauf pour les pièces
vraiment exceptionnelles ;
• quant au reste, il s'agit
d'investissements très
aléatoires
, qui s'apparentent à du capital risque ; cela
n'en vaut la peine que si une part de jeu vient augmenter les
bénéfices - psychologiques - attendus du placement :
à défaut du gain monétaire, à défaut de
toucher le gros lot, l'investisseur aura eu le plaisir de participer au
jeu
de hasard qu'est devenu le marché de l'art
et à la
satisfaction d'être admis dans la petite communauté des parieurs.
L'idée d'une augmentation irrésistible du prix de l'art ancien
et plus généralement de l'art historique fait partie de notre
mythologie
, au même titre que le caractère " hors de
prix " des oeuvres d'art. On oublie que nombre d'achats par les
musées ne dépassent pas 50 000 Francs
32(
*
)
.
Un oeuvre d'art, c'est cher, et son prix ne peut qu'augmenter, voilà
deux idées reçues, qui entretiennent la fascination collective et
justifient une fiscalité élevée.
A cet égard,
la taxe forfaitaire que beaucoup payent sans demander
à bénéficier du régime d'imposition au réel,
correspond moins à une plus-value effective qu'à une forme de
taxe indirecte sur des biens de luxe ou de prélèvement sur les
jeux de hasard.
b) La logique boursière du marché, l'apparition des collectionneurs spéculateurs
Le
comportement des collectionneurs privés s'est profondément
modifié depuis l'après-guerre.
D'abord, on assiste, surtout outre-Atlantique, à l'apparition d'une
nouvelle génération de collectionneurs.
Aux États-Unis, les collectionneurs fondateurs aux moyens immenses et
souvent plutôt cultivés comme l'était notamment J.P. Getty,
ont laissé la place à de nouveaux types de collectionneurs, moins
riches, moins attentifs aux oeuvres, plus prompts à procéder
à des arbitrages financiers.
Les motivations du collectionneur surtout aux États-Unis étaient,
à la fin des années 70, en train, d'évoluer. John Walsh
parle, lors du colloque déjà cité, de la "
fin de
l'ère des philanthropes...les comportements ont changé,
remarque-t-il : les nouveaux collectionneurs semblent considérer
l'art comme une marchandise comme une autre, pouvait faire l'objet de
spéculation. Leur compréhension des oeuvres, le genre de
satisfaction qu'ils retirent de leur possession et de leur contemplation, leur
champ d'attention, est rarement à l'égal des grands
collectionneurs du passé. "...
Avec ces nouveaux collectionneurs, il semble que l'on se trouve face une
logique souvent plus spécialisée, en tous cas non portée
par un projet de constitution d'une collection destinée à
être donnée à des musées : l'ère des
Frick, des Morgan, des Rockefeller, des Widener, des Havemeyer, des Wrightsman,
et, plus près de nous des Hammer, Kress ou Norton Simon, pour
évoquer les grands collectionneurs qui n'ont pas été
cités à un titre ou à un autre, s'achève.
Ces collectionneurs achetaient pour la plupart peu en vente publique et
faisaient confiance à des marchands : ainsi, Andrew Mellon, le
fondateur de la National Gallery de Washington, a longtemps acheté ses
oeuvres uniquement chez Knoelder à New-York, avant de partager,
après la seconde guerre mondiale, sa clientèle entre ce dernier
et le futur Lord Duveen.
Le prototype du nouveau collectionneur issu des milieux d'affaires, moins
soucieux de constituer une collection que de diversifier son patrimoine, enclin
à faire confiance aux experts-conseils des grandes maisons de vente aux
enchères, quand il n'est pas directement conseillé par des
conservateurs de musées, a peu recours aux grands marchands et se porte
sans doute volontiers vers les ventes publiques ; d'où l'attention
croissante portée par les grandes maisons de vente au marché
américain, indépendamment de toute question fiscale.
Ensuite,
surtout dans l'art contemporain
,
certains
collectionneurs
, parmi les plus importants, jouent un rôle actif dans
la constitution de leur collection, et
ne répugnent pas,
par
l'affichage volontiers médiatisé de leur engagement, à
exercer un pouvoir de marché
.
Ce constat est confirmé par l'analyse que fait Mme Raymonde Moulin du
comportement d'un certain nombre de grands collectionneurs d'art contemporain,
- dont les prototypes sont M.M Ludwig ou Saatchi - qui sont devenus capables
d'assumer les rôles de tous les acteurs des mondes de l'art :
"
ils achètent et vendent comme le marchand ; ils
organisent des expositions comme le conservateur de musée. Ils
enrichissent les musées existants ou créent à leur nom des
institutions s'apparentant, par leur vocation publique, à des
musées d'art contemporain... Quelle que soit la relation psychologique
que le grand collectionneur d'art contemporain entretient avec l'art, il est
condamné à gagner deux paris étroitement solidaires l'un
de l'autre, l'un sur la valeur esthétique, l'autre sur la valeur
financière, chacun devant garantir l'autre
"
33(
*
)
.
Enfin, on a vu apparaître de nouveaux comportements parmi les
collectionneurs, qui en ont fait des spéculateurs. Car, et ceci est plus
important du point de vue du fonctionnement des marchés, "
fait
absolument nouveau, décisif ",
souligne
Maître
Maurice Rheims dans son livre Les collectionneurs publié en 1981
,
l'amateur de 1980 éduqué par la presse d'information artistique,
piqué par le microbe de la curiosité, entre dans la lice et se
transforme bien souvent en amateur marchand, encouragé par l'exemple des
centaines de collections constituées ces cinquante dernières
années, avec des moyens très réduits. Des gens
passionnés et émerveillés par les succès qu'ils
accumulent se mettent en dehors de leur occupation quotidienne, à
exercer accessoirement un métier qui était, il y a quelques
années, l'apanage exclusif de spécialistes ".
En définitive, l'avènement de ces nouveaux collectionneurs a eu
pour conséquence de
généraliser les comportements
d'arbitrages
, ce qui s'est traduit par
l'augmentation de la vitesse de
circulation des oeuvres.
Une des caractéristiques des périodes de spéculation
intense est l'accélération de la rotation des biens qui changent
facilement de mains et, corrélativement la diminution de la durée
de détention des oeuvres.
Autrefois, on pouvait dire qu'en moyenne, les oeuvres repassaient sur le
marché tous les 20 à 30 ans ; aujourd'hui, cette
durée de détention est sans doute passée à moins de
10 ans
. Nul doute qu'elle a été plus courte pendant la
période de folle spéculation de la fin des années 80.
L'autre changement important qui est à l'origine de l'explosion puis de
l'effondrement du marché de l'art, c'est le mode de financement du
marché avec le
développement de facilités
financières spécifiques et l'intervention des banques.
Deux phénomènes ont profondément affecté à
ce niveau le fonctionnement du marché de l'art dans la seconde
moitié des années 80 :
•
la tentation pour les maisons de vente de financer et, donc, d'une
certaine façon de " monter ", leurs records de prix
;
•
l'intervention, en France du moins, des banques pour amener
certains opérateurs à acheter pour revendre immédiatement
en vente publique, ce qui ne pouvait manquer de créer des risques
d'effondrement en chaîne en cas de retournement du
marché
.
(1) L'affaire des Iris de Van Gogh
L'affaire des
Iris
de Van Gogh témoigne du
dérapage auquel peuvent donner lieu les pratiques, normales dans une
optique commerciale, mais qui aboutissent à faire douter de la
sincérité des prix de vente publique.
En novembre 1987, Sotheby's adjugeait un tableau de Van Gogh
Les Iris
pour la somme fabuleuse de 53,9 millions de dollars à M. Alan Bond, sous
enchérisseur sur
Les Tournesols
du même artiste, vendus par
Christie's, en mars 1987, pour 39, 9 milliards de dollars.
En fait, deux ans après on apprit que Sotheby's avait avancé la
moitié du prix d'achat des Iris contre la garantie du tableau
lui-même et d'autres tableaux déjà détenus par
l'homme d'affaire australien. Il semble que des propositions de conditions de
paiement ait été faites avant la vente. Certains purent en
conclure que cela avait encouragé l'inflation des prix et notamment
facilité la vente des tableaux récupérés en
contrepartie. Mais, ce qui apparaît avéré, c'est que les 49
millions de dollars ont bien été versés et que Sotheby's,
outre le " buyer's premium " de 10 %, récupéra ce qui
lui était dû, intérêt et principal.
Enfin, et de façon très anglo-saxonne,
Sotheby's ne tarda pas
à réagir en annonçant qu'il n'accepterait plus de prendre
l'objet acheté en garantie et ne prêterait plus sur aucun objet
d'art à moins de douze mois après son achat
. La maison de
vente récupéra les Iris
34(
*
)
qu'elle réussit à vendre au musée Getty.
(2) La spéculation alimentée en France par les crédits bancaires
L'autre
dérive plus spécifiquement française, s'est traduite par
la
mise en place de circuit de financement spécifiques permettant
à des marchands d'acheter
, en vente ou chez des particuliers,
de
la marchandise destinée à être remise en vente publique
dans des délais très bref
.
Le système devint d'autant plus instable qu'il reposait sur un
équilibre dynamique, où il était indispensable de vendre
pour pouvoir payer que ce que l'on avait mis aux enchères. A partir du
moment où le marché se renversa, la mécanique se grippa et
le marchand se retrouva plombé avec des stocks qu'il n'était pas
en mesure de payer.
Nul doute que pendant cette période de folie, les marchands ont
été invités à passer leur stock en vente publique
découvrant avec étonnement et ravissement que ce qu'il mettait
des mois à vendre s'enlevait pour beaucoup plus cher en ventes
publiques...De là à acheter pour revendre, la tentation
était forte, surtout si on y était incité par les
commissaires-priseurs désireux de profiter de cette euphorie et si des
banques vous multiplient les moyens d'acheter.
Des banques ont avancé imprudemment de l'argent à un certain
nombre de personnes incitées à spéculer à
découvert
, tandis que la marchandise était
déposée chez les commissaires-priseurs, qui pouvaient à la
fois garantir la valeur des oeuvres, tout en permettant aux banques de
s'assurer des sûretés qu'elles demandaient. Mais à ce jeu,
en cas de retournement du marché, le piège se referme sur les
marchands qui ont spéculé à découvert et sur les
banques qui se retrouvent propriétaires d'oeuvres brutalement
dépréciées.
(3) L'échec des opérations de placement bancaires à moyen terme
Il faut
donc bien distinguer dans ces interventions, même si la frontière
n'est pas évidente, les opérations de placement comme BNP arts ou
British Rail Pension Fund, de ces opérations de spéculation.
En 1974, en association avec Sotheby's, la caisse de retraite des chemins de
fer britannique, le
British Rail Pension Fund
décida d'investir
l'équivalent de 400 millions de francs en oeuvres d'art, ce qui ne
représentait que moins de 1 % de leurs investissements. Certains achats
spectaculaires comme celui de
La promenade
de Renoir, soit
l'équivalent de 16,2 millions de francs de 1991,
défrayèrent la chronique.
Revendues à partir de 1987, ces achats se sont
révélés, dans l'ensemble, judicieux et ont
dégagé pour les premières ventes une forte
rentabilité 6,9 % en monnaie constante, 15,3 % en monnaie courante.
D'une part, il faut comparer ces résultats à l'évolution
de la bourse de Londres au cours de la même période, soit 16 %.
D'autre part, ce qui n'a pas été vendu au début des
années 90 a dû l'être dans de moins bonnes conditions dans
la période de recul des prix que l'on a connu depuis 1990. Il n'a
d'ailleurs pas été possible d'obtenir de Sotheby's un bilan 1999
de l'opération British Rail, alors même, qu'une vente vient encore
d'intervenir en 1998.
De toute façon, Il semble que cette opération soit l'exception
qui confirme la règle : Les opérations d'investissement en
oeuvres d'art institutionnalisées et dissociée du plaisir de la
consommation esthétique ont peu de chances de déboucher sur une
rentabilité importante.
C'est méconnaître les caractéristiques des oeuvres d'art et
les motivations des acheteurs que de croire que, sauf lorsque l'on
achète aux creux du cycle pour revendre à son sommet ou que l'on
a la chance d'acheter des oeuvres d'artistes destinés à
être découverts ou redécouverts, ce genre d'investissement
soit rentable :
•
Des oeuvres d'art constituent des actifs
, qui, surtout
lorsqu'ils sont simplement stockés, présentent des frais
d'entretien supérieurs à ceux des actifs financiers ; il
faut les garder longtemps pour amortir les coûts de transaction,
même si on les achète en vente publique et, a fortiori, si on les
acquiert auprès de marchands ;
•
Les acheteurs
, sauf dans les périodes exceptionnelles
1987, 1988 et 1989,
se méfient toujours des oeuvres qui reviennent
trop vite sur le marché
, comme si le " déjà
vu " était un handicap. Or, une dizaine d'années est
à la fois un minimum pour le marché et un maximum pour des
investisseurs.
A ce facteur, s'ajoute le
manque d'attrait pour des ensembles d'oeuvres qui
ne reflètent pas une personnalité
: une collection se
vend, en général, bien, parce qu'elle témoigne d'un
goût, dont on s'arrache volontiers les exemples comme autant de
trophées, même s'il s'agit de marchands promus collectionneurs
pour les besoins de la cause.
Les achats d'un fonds d'investissement ne constituent pas une collection ;
ils n'ont pas d'âme et, en période d'attentisme, comme
aujourd'hui, les acheteurs en sont de plus en plus conscients et sont donc de
plus en plus méfiants.
C'est ce qui explique
l'échec de l'opération BNP
- dont la
presse a fait état
35(
*
)
. D'excellents
experts, des choix classiques " tradition française ",
censés éviter les valeurs spéculatives, mais un achat
à contretemps au moment du boom, une vente intervenant trop tôt
et, de surcroît, les défauts structurels des achats collectifs,
particulièrement handicapants lorsque, dans un marché encore
hésitant, les collectionneurs recherchent surtout de la marchandise
" fraîche ". Au total, la collection a été vendue
pour près de 12 millions de dollars. Il en aurait fallu plus de 20
pour que l'opération soit profitable. Il y a de bonnes raisons de penser
que ceux qui ont acheté les oeuvres vendues par BNP arts ont fait, eux,
de bonnes affaires....
En revanche, l'intervention des banques comme conseil à
l'achat
36(
*
)
qui tend à se
développer n'encourt pas les mêmes critiques dans la mesure
où a démarche s'inscrit en général dans le long
terme et où, a priori, l'oeuvre étant détenue par son
propriétaire, celui-ci en retire toujours une satisfaction
esthétique, à défaut d'en retirer un profit
monétaire, appliquant ainsi de façon concrète les
principes de bon sens qui découlaient de l'étude
précitée de W. J. Baumol.
c) Les réactions face à la crise : quand les uns se replient, les autres se restructurent
La
crise de 1990 a joué le rôle de révélateur des
rapports de force entre Commissaires-priseurs et maisons de vente
anglo-saxonnes
. Elle a montré que les performances accomplies par
les commissaires-priseurs français dans les périodes fastes
étaient fragiles : des " coups " comme la vente des
" noces de Pierrette " de Picasso ou celle de la collection Roberto
Polo, ne se rééditent pas facilement.
Elle tend à prouver aussi que le recul plus net des ventes des grandes
maisons de vente aux enchères depuis 1990, loin de marquer une
faiblesse, était au contraire le signe d'une capacité
d'adaptation supérieure à un marché désormais
mondial.
Déjà, en 1975, la crise pétrolière avait conduit
les deux " majors " à s'entendre de facto pour instaurer une
commission de 10 % sur les acheteurs à l'image de ce qui se faisait
déjà sur le continent.
En 1990, le volume d'affaires baissa de moitié dans les deux grandes
maisons de vente . La réaction fut aussi rapide et même brutale
pour restaurer la rentabilité : à la fin de l'année
Christie's licencia 140 personnes, Sotheby's 119.
Mais même au
creux de la vague alors que les ventes avaient diminué des 2/3 par
rapport au sommet de 1989, Sotheby's était encore
légèrement bénéficiaire.
En 1994, toujours pour restaurer la rentabilité, les deux soeurs
ennemies mais unies dans les moments difficiles décidèrent comme
en 1974 de modifier leurs tarifs en passant à 15 % le taux des frais
acheteur en dessous de 30 000 livres
.
En fait, en dépit d'une concurrence acharnée, les deux firmes ont
su s'unir et faire, opportunément, des mouvements dans le même
sens, dès lors qu'il s'agissait de rétablir leur
rentabilité ; de même, fut mis un peu d'ordre dans les
commissions dues par le vendeur, au moins en principe, car, de ce point vue, la
concurrence pour attirer les vendeurs - et notamment pour s'attacher des
marchands, est toujours aussi vive.
Les maisons de vente sont des sociétés introduites en bourse
évoluant dans un contexte libéral. Cela change tout
.
Les actions de Christie's avait été offertes au public
37(
*
)
depuis 1973 ; de son côté Sotheby's
fut introduit en 1977
38(
*
)
. Il en est
résulté le changement des règles du jeu. Le pouvoir allait
passer des amateurs ambitieux aux hommes d'affaires soucieux avant tout de
rentabilité.
Comme le note Robert Lacey, l'introduction de la commission à l'achat
constitua un tournant : elle "
marqua le moment où
Sotheby's et Christie's abandonnèrent ensemble la conception du monde de
l'art comme une chaleureuse fraternité où les maisons de vente et
les marchands se serraient les coudes pour résister à tous les
autres. En entrant en bourse, Christie's s'était soumis à
d'autres maîtres, ces étrangers dont les commissaires-priseurs et
les marchands avaient jadis profité de concert et Sotheby's allait lui
emboîter le pas. Dans le document annonçant la cotation en bourse
que le Sotheby's Parke-Bernet group Ltd présenta au marché en
juin 1977, la commission d'achat était citée comme le facteur
principal des récents bénéfices de la maison de
vente. "
L'arrivée des financiers notamment américains - son
propriétaire actuel M. Alfred Taubmann, qui fit fortune dans les centres
commerciaux du Middle West - au pouvoir achevait de faire de Sotheby's une
entreprise multinationale comme les autres, vulnérable aux raids
extérieurs et donc très attentive à l'évolution de
ses profits.
De façon moins spectaculaire et sans doute plus tardive, au moins
jusqu'à l'entrée dans son capital de M. François Pinault,
à hauteur de 29,1 %
39(
*
)
, Christie's
connut une évolution analogue. L'opposition, un temps colportée
par une plaisanterie qui faisait sourire le microcosme, selon laquelle
Sotheby's était géré par des hommes d'affaires qui se
prenaient pour des gentlemen, et Christie's était dirigé par des
gentlemen qui se prenaient pour des hommes d'affaires, n'est plus de mise.
Désormais, la préoccupation de rentabilité est, à
l'évidence, omniprésente - comme on a pu le voir avec les
tentatives de reprise en main des frais acheteur et vendeurs. Et ce n'est pas
sans provoquer des tensions internes entre gestionnaires et experts, notamment
dans certains départements, importants pour le prestige et la tradition,
mais sans doute peu rentables compte tenu d'un relativement faible - au regard
de celle de la peinture impressionniste et moderne - niveau de prix.
4. La marche vers la globalisation
La
supériorité des anglo-saxons est évidente : aux
avantages techniques - expertise, publicité et relations publiques -
liés à l'esprit d'entreprise, à ceux résultant
d'une implantation intercontinentale, s'ajoute désormais la force du
capitalisme : capacité à mobiliser des capitaux, à
procéder sans états d'âme aux restructurations
nécessaires.
Pour autant
, l'accès, pour les commissaires-priseurs, au statut
commercial prévu par le projet de loi portant réglementation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est une condition
nécessaire mais pas suffisante de leur compétitivité
.
Celle-ci repose non seulement sur des capitaux et un environnement juridique et
fiscal national adapté mais aussi sur la mise en place de réseaux
internationaux, auxquels tient l'efficacité des maisons de vente
anglo-saxonnes.
Le processus d'intégration auquel on assiste, n'est pas propre au
marché de l'art mais il s'appuie peut-être de façon plus
étroite sur celui résultant au niveau des supports et des
vecteurs sur des nouvelles technologies de l'information et, au niveau des
contenus, sur la tendance à une mondialisation de la culture :
concurrence entre les grands musées, dont les
réaménagements sont autant d'événements
médiatiques à l'échelle mondiale, grandes expositions,
dont la plupart désormais circulent ; répercussion
instantanée des résultats des ventes qui sont rapportées
dans les journaux voire à la télévision.
Face à un espace culturel mondial de plus en plus intégré,
les deux majors anglo-saxonnes développent des
stratégies de
diversification
dans les moyens d'atteindre leur public :
poussée vers l'art contemporain, tant au niveau des ventes aux
enchères que des ventes privées ; développement
d'Internet qui, sous couvert de modernité et
d'instantanéité, aboutit à renforcer les liens avec les
marchands.
Reste le défi de la demande que l'élévation du niveau
d'information des acheteurs - collectionneurs, la multiplication des banques de
données informatiques qui vont permettre de suivre à la trace le
mouvement des oeuvres, va sans doute modifier dans le sens d'une exigence
accrue.
a) La position dominante des maisons de vente confortée par la maîtrise des réseaux
Comme
pour beaucoup d'empires, ceux des grandes maisons de vente aux enchères
anglo-saxonnes reposent en grande partie sur leur capacité à
maîtriser des réseaux de communication et à organiser
à leur profit des relations de dépendance avec les autres
puissances qu'elles sont parvenues à dominer.
En l'occurrence, leur position dominante tient à la qualité et
surtout au caractère mondial de
trois types de
réseaux
:
• un
réseau de correspondants
appartenant à tous
les milieux, mais spécialement bien implanté dans ce qu'il est
convenu d'appeler la bonne société, qui tels des
détecteurs ont pour tâche de signaler aux propriétaires,
désireux de vendre la capacité de l'entreprise qu'ils
représentent à tirer un bon prix de leurs biens ;
• un
vivier de collectionneurs
ou tout simplement d'acheteurs,
approché ou entretenu grâce à des opérations de
relations publiques, qui sont, soit déjà des clients, soit des
enchérisseurs connus, on peut le rappeler, du fait qu'il n'est pas
possible dans le système anglo-saxon de placer une enchère sans
s'être fait préalablement identifier ;
• un
réseau de spécialistes
, notamment en art
ancien, conservateurs, professeurs d'université, chercheurs, avec
lesquels leurs spécialistes entretiennent de bonnes relations, et qui
acceptent de donner ou de confirmer des attributions.
C'est l'étendue de ces fichiers, qui permettent à ces maisons
d'attirer les vendeurs en leur promettant la clientèle la plus large et
surtout la plus adaptée au bien vendu.
La tendance à l'homogénéisation des échelles de
valeur à travers le monde, n'est pas incompatible avec la persistance de
différences nationales.
La connaissance des marchés nationaux,
des goûts propres à chaque pays, fait précisément
partie des services offerts par ces multinationales de la vente publique
.
Celles-ci savent - sans qu'il faille attribuer à cette connaissance une
rigueur absolue - s'il vaut mieux mettre l'objet en vente à Paris,
à Londres ou à New-York, voire ailleurs.
De ce point de vue, on assiste à un processus d'intégration du
marché de l'art à l'échelle mondiale autour des deux
grandes maisons de vente, sous l'effet de stratégies
délibérées, largement indépendantes de
considérations nationales. La spécialisation entre les
différentes places et la localisation des pôles principaux des
différentes spécialités seront dictées par des
considérations de profit.
L'autre manifestation de la puissance des maisons de vente est d'avoir non
seulement su renverser le rapport de force avec le commerce mais encore d'avoir
réussi à se constituer une " clientèle " de
marchands.
Les grandes maisons de vente anglo-saxonnes ont toujours attaché une
importance particulière à la clientèle des marchands, qui
bénéficient ouvertement de commissions réduites à
la vente
40(
*
)
. Elles entretiennent, de
notoriété publique, des relations étroites avec certains
marchands français, qui y portent une part importante de leurs
acquisitions.
Le fait nouveau est que semble-t-il ces relations couvrent des domaines
variés et se caractérisent par une dépendance
réciproque, certes mais fortement asymétrique à
l'échelle du marché dans son ensemble.
Bien qu'elle préserve la liberté du marchand, puisque ceux-ci
peuvent toujours aller voir un concurrent, cette dépendance
réciproque n'en traduit pas moins une certaine subordination des
marchands qui pourraient bien constituer de simples auxiliaires des grandes
maisons de vente.
" Dans ce petit milieu, chacun a besoin de l'autre et cela se passe
très bien ainsi " dit le directeur du directeur
général de Christie's à Paris.
Les marchands jouent alors un rôle de régulation du
marché
que ne peuvent pas assumer Sotheby's et Christie's, du moins
pour tout ce qui n'est pas le haut de gamme, qui à travers les ventes
privées, intéresse, pour des raisons de rentabilité mais
aussi de service après-vente, les grandes maisons de vente
anglo-saxonnes.
b) Les nouvelles frontières du marché : Internet et les " ventes privées "
La concurrence que se livrent les deux grandes maisons de vente aux enchères, les conduisent à explorer de nouveaux domaines pour élargir leur clientèle.
(1) L'OPA de Sotheby's sur Internet
Très logiquement pour des firmes organisées en
réseaux à l'échelle mondiale, les deux grandes maisons de
vente vont se lancer sur Internet, profitant de l'engouement pour cette
nouvelle forme de vente.
La vogue des enchères est déjà bien établie aux
États-Unis où on recense près de 150 sites en ligne.
L'entreprise leader sur ce marché émergent, eBay a vu sa valeur
en bourse grimper de 800 millions de dollars à 25 milliards en quelques
mois. Le site, qui peut faire état de 23 millions de ventes aux
enchères en ligne sur les trois premiers mois de l'année, vient
d'acquérir la troisième maison de vente américaine
Butterfield and Butterfield, opérant essentiellement sur la côte
Ouest.
Sotheby's a déjà dévoilé au début de
l'année 1999, son plan de campagne. La firme, qui a recruté un
ancien président de Sony Worldwide Networks pour gérer sa
nouvelle division, a prévu d'y consacrer 25 millions de dollars ainsi
que de recruter une soixantaine de personnes pour la faire fonctionner.
La première vente devrait intervenir en juillet 1999 et concernerait des
souvenirs relatifs au base-ball qui seraient vendus à la fois en salle
et sur le réseau.
Ce qui devrait caractériser le site Sothebys.com, c'est qu'à
côté de ventes classiques il permettra à des professionnels
de proposer leur marchandise.
Il s'agit d'un réel partenariat avec
les marchands affirment les responsables de Sotheby's ", qui, au moins
pour la période de démarrage, leur proposent des conditions
particulièrement attractives: une commission de 10 % à la charge
de l'acheteur, sans frais pour le marchand qui bénéficie d'autres
avantages annexes
41(
*
)
.
Le marché visé par Sotheby's concerne des objets dont le prix est
compris entre 2000 et 60 000 francs. L'idée est de diminuer les
coûts pour les lots de valeur unitaire modeste - 80 % des lots vendus
chez Sotheby's ne dépassent pas 30 000 francs - en profitant des
avantages d'Internet : qualité croissante des images - encore
insuffisante pour la peinture ancienne..- possibilité de notices
importantes sans contrainte de place, contrairement aux catalogues
" papier ".
Sotheby's
, qui compte sur sa notoriété pour attirer les
clients,
intervient comme intermédiaire
:
• d'une part,
la firme s'assure des paiements et vérifie que
les acheteurs sont en mesure de payer ce qu'ils doivent
;
• d'autre part, elle
garantit l'authenticité des
oeuvres
....dans les mêmes conditions que dans ses salles des ventes,
même si, semble-t-il, elle laisse la responsabilité de la
description de l'objet au vendeur.
Bien qu'il ait été annoncé que les investissement
pourraient, au début, peser sur les résultats de l'entreprise, le
projet, a été bien très bien accueilli par le Bourse
américaine, où le cours a augmenté de 25 %.
A la mi - février 1999, un mois après le lancement de
l'opération, Sotheby's pouvait faire état, après un
forcing consistant à imposer un délai de 8 jours pour
l'acceptation de leur offre, de l
'accord
de 1500 marchands
-
chiffre porté à 2000 depuis lors - pour participer à
l'opération et donner l'exclusivité de leur mises en vente sur
Internet à Sotheby's.
En tous cas, l'effet médiatique est réussi, car cette
opération a beaucoup plus fait parler d'elle que les projets de Bonhams
ou Phillips, qui annoncent leur intention de tenir des ventes
régulières sur Internet et d'accepter les enchères par le
net et pas seulement par téléphone
Quant à Christie's, il part de façon beaucoup plus prudente en
annonçant en mars 1999, qu'il commencerait en septembre à vendre
des oeuvres de moindre valeur, photos, gravures ou livres, tout en critiquant
les options les plus risquées de son concurrent comme le fait de faire
rédiger les notices par le vendeur ou celui de communiquer le nom des
enchérisseurs.
On note qu'en Europe, Bernard Arnault, le patron du groupe de luxe LVMH vient
de racheter 20% du site de vente aux enchères sur Internet.Collector.
Il est hasardeux, pour les oeuvres d'art comme pour d'autres biens,
d'évaluer les perspectives de développement du commerce sur
Internet. Effet de mode ou réel besoin ? Il est difficile de
trancher. Le développement dépendra de la capacité des
opérateurs à assurer la sécurité des transactions,
c'est-à-dire à la fois, la conformité et
l'authenticité de objets, d'une part, et le paiement, d'autre part.
Pour le très haut de gamme, il apparaît douteux que cela puisse
compter, en revanche, il semble que dans le milieu de gamme, Internet puisse
jouer un rôle - les enchères s'apparentent en fait à des
petites annonces -, surtout si les maisons de vente anglo-saxonnes mettent leur
nom dans la balance et profitent de leur image de marque mondiale..
(2) L'offensive en matière de ventes privées
L'autre
frontière à conquérir pour les grandes maisons de vente
est constituée par les ventes privées
.
On peut avoir l'impression qu'elles développent un type
d'opération aux antipodes de leur vocation, qui est théoriquement
de procéder à des ventes publiques.
En fait, comme on l'a vu, cette évolution se situe dans la droite ligne
de la stratégie de Peter Wilson, qui consiste à rendre service
aux clients. Or, ceux-ci peuvent avoir un besoin urgent d'argent ou ne pas
vouloir ébruiter, pour des raisons personnelles, la cession.
En juin 1996, Sotheby's a annoncé officiellement qu'elle rachetait la
galerie Emmerich de New York, qui allait devenir la tête de pont des
ventes privées pour l'art du XX
ème
siècle. A sa
tête, la société américaine plaça un
ex-responsable de l'art pour la City Bank et producteur de l'oeuvre de
l'artiste américain Jeff Koons. Le succès est d'ailleurs
très relatif. De nombreux artistes de la galerie Emmerich,
mécontents de se voir repris par une maison de ventes, sont partis,
tandis que les expositions organisées dans la galerie n'attirent
guère les foules.
Depuis mars 1999, Christie's a ouvert un département ventes
privées dites "pour l'art du XX
ème
siècle ", au niveau mondial. Auparavant, Christie's organisait
déjà des " private sales ", mais elles se faisaient toujours
par des canaux divers.
Cette offensive inquiète les galeries, qui soulignent
systématiquement que le coeur de leur métier n'est pas tant de
vendre l'art contemporain comme un produit comme les autres que de soutenir des
artistes.
De Paris à New York, tous les spécialistes en charge des ventes
publiques agissent de façon informelle pour organiser les " private
sales ". La chose est d'autant plus naturelle que ces firmes ont les meilleurs
fichiers de clients dans le domaine de l'art. Elles connaissent non seulement
le nom des acheteurs mais également celui des sous-enchérisseurs.
L'activité de " private sales " semble pour Christie's aussi intense en
Europe qu'aux États-Unis. A titre d'exemple en France, c'est Christie's
qui est intervenu comme intermédiaire pour l'achat par l'association des
Amis du Louvre du " Portrait de Juliette de Villeneuve " peint en 1824 par
David.
c) Les inconnues fonctionnelles : transparence croissante et rotation accélérée des oeuvres
Le marché de l'art est une terre de contrastes. Alors que l'on n'a pas dissimulé l'importance des transactions officieuses et le halo de mystère qui entoure parfois l'origine des oeuvres et la personnalité des propriétaires, anciens ou nouveaux, on est amené à souligner les incertitudes que font peser sur son développement la transparence, encore très imparfaite certes, mais croissante des transactions " publiques ".
(1) Vers un régime transparence imparfaite
Certes,
les deux maisons de vente anglo-saxonnes cessèrent au début des
années 1970 de publier les listes de prix assortis du nom des acheteurs
-, ce qui était une pratique peu discrète.
Mais, elles furent amenées pour des raisons commerciales ou de
probité professionnelle, dont elles mirent parfois du temps à
admettre la nécessité, à prendre toute une série de
décisions,
ou généraliser des pratiques favorables
à la transparence du marché et à la
sincérité des transactions
:
•
publication des estimations dans les catalogues
:
traditionnellement, il incombait à la personne intéressée
par l'objet de demander à l'expert des estimations ; le rôle
de l'expert était alors d'engager ladite personne sur le terrain de la
conversation pour essayer de voir si elle constituait un client potentiel
sérieux ; cette publication ne plut pas toujours aux marchands qui
perdaient d'une certaine façon leurs privilèges d'initiés
mais aboutit à donner confiance aux néophytes et à
élargir ainsi le marché ;
•
Publication des listes de prix faisant apparaître
- par
différence, les numéros des lots n'ayant pas trouvé
preneur étant simplement omis de la liste -
les
" invendus "
: au début, du temps notamment de Peter
Wilson, lorsqu'il était encore d'usage de publier le nom des acheteurs,
il n'était pas rare de voir utiliser des noms fictifs par la maison de
vente en cas de retrait ; progressivement, les maisons de vente prirent
l'habitude de publier pour certaines ventes des synthèses faisant
apparaître le pourcentage d'invendus en nombre de lots et en valeur ;
•
Publication dans le catalogue de l'historique connu des
oeuvres
, et de plus en plus souvent, des passages en vente publique,
même récents, avec, parfois, mention du prix ou de la
non-vente
42(
*
)
; les maisons de vente
commencent à réaliser qu'avec la multiplication des annuaires de
vente désormais en versions cédéroms ou sous forme de
banques de données en ligne, il est relativement facile pour des
personnes intéressées de vérifier par elles-mêmes
ces éléments d'information
Toutes ces pratiques, que l'ont trouve en usage chez certains
commissaires-priseurs, constituent des progrès considérables dans
le sens de la transparence du marché de nature à renforcer la
confiance de la clientèle
Mais on n'a pas encore perçu toutes leurs conséquences sur le
fonctionnement du marché de l'art dans son ensemble et pas seulement des
ventes publiques.
D'abord, et c'est un des facteurs de leurs difficultés à faire
face à la concurrence des maisons de vente, la transparence ne fait pas
l'affaire du négoce.
John Walsh, le directeur du Musée Getty, indiquait dans l'ouvrage
précité page que :"
Au bon vieux temps, il n'y a pas
si longtemps, quand les marchands achetaient l'essentiel de leur stock
directement auprès des propriétaires privés, ils avaient
de grandes facilités : personne ne savait combien ils avaient
payé et donc ne connaissait l'importance de leur marge ; on ne
savait pas qu'ils détenaient telle ou telle oeuvre, de telle sorte
qu'ils pouvaient les proposer à ses clients, les uns après les
autres ; ensuite, après un certain temps, ils pouvaient racheter
les oeuvres à leurs clients pour les revendre à d'autres, parfois
en faisant des profits plusieurs fois sur la même oeuvre, gérant
ainsi dans une confidentialité tranquille un ensemble d'oeuvres
détenues par des générations successives de
collectionneurs confiants. Aujourd'hui, les marchands sont de plus en plus
obligés d'acheter en vente. Le prix qu'ils ont payé est de
notoriété publique, ce qui limite leur marge
".
Ensuite, cette évolution ne se contente pas d'entraver le
développement des marchands ; elle pourrait poser à terme un
problème en ce qu'elle risque de retirer un peu de magie et de
mystère à un marché qui à certains égards
s'en nourrit.
Ainsi, le marché va-t-il avoir de plus en plus de
mémoire
....Or l'oubli est nécessaire. L'amateur a besoin de
rêves et donc d'oubli pour mieux se griser de redécouvertes. Bref,
on va pouvoir savoir qui a acheté quoi, quand et surtout
combien
43(
*
)
.
Parmi les composantes du prix d'une oeuvre ou d'un objet, il n'y a pas que la
qualité intrinsèque. Il faut aussi tenir compte
d'éléments de nature commerciale, comme l'origine ou la
personnalité du propriétaire, ce qui, lorsqu'il s'agit d'un
collectionneur notoire, peut être un facteur d'élévation du
prix.
(2) L'accélération de la vitesse de circulation des oeuvres et le problème de la " fraîcheur "
De
même, la " fraîcheur ", c'est-à-dire le fait de ne
pas avoir été vu depuis longtemps ajoute un " plus ",
qui pourrait devenir une qualité plus rare. Les oeuvres seront pour
ainsi dire suivies à la trace, fichées, comme si le " casier
commercial " des oeuvres était désormais ouvert à
tous.
Il sera de plus en plus difficile de repasser une oeuvre en vente en passant
sous silence qu'elle est restée invendue. Tôt ou tard, même
les néophytes prendront conscience des limites des ventes publiques et
du temps nécessaire pour effacer la marque infamante sur l'objet
retiré faute d'enchères.
Le nouvel amateur, souvent très au fait du fonctionnement des
marchés - percevra plus nettement le risque qu'il prend en mettant un
objet en vente avec un prix de réserve élevé et donc
la
liquidité incertaine de l'actif oeuvre d'art
.
Sur le plan du fonctionnement du marché de l'art dans son ensemble, cela
conduit d'abord à souligner l'importance du secteur marchand du point de
vue des grandes maisons de vente elles-mêmes.
C'est sur eux que comptent ces dernières pour assurer la
liquidité du marché en jouant le rôle de contrepartiste et
en recyclant une partie au moins des oeuvres ne trouvant pas preneur.
Ensuite, on peut se demander si cette transparence n'aura pas pour
conséquence de freiner la spéculation à court terme en
dissuadant d'investir tous ceux qui ne sont pas prêts à conserver
les oeuvres pendant quelques années, juste le temps nécessaire
pour les oeuvres de se refaire une " fraîcheur ".
C. DES ENJEUX RÉELS OU VIRTUELS POUR LA FRANCE ?
Peut-on
après cette première analyse du fonctionnement de marché
de l'art tenter de répondre de façon un peu plus
argumentée à la question posée en introduction : le
marché de l'art est-il vraiment une affaire d'importance, justifiant
l'attention de l'État ?
Les développements précédents ont montré
qu'à l'oeuvre d'art était attachée toute une mythologie.
La fascination qu'elle exerce empêchait de voir la réalité
des faits. Les attributs magiques de transmutation de la matière en or
qu'on lui prête, sont réels mais n'ont aucun caractère
général.
L'importance du marché de l'art est éminemment symbolique mais
cette
valeur symbolique
est ambiguë. Plus sans doute que dans
d'autre pays elle est
associée à la fois à
l'idée de privilège et à celle de démocratie
.
L'oeuvre d'art reste fondamentalement un bien marchand. Elle est un produit de
luxe individuel, qui entre dans la compétition aujourd'hui largement
médiatisée, parfois irrationnelle, que se livrent les grandes
fortunes et qui permet d'ennoblir l'argent gagné dans des
activités industrielles ou commerciales.
Mais, elle fait aussi l'objet d'une consommation collective. Elle est devenue
un bien public au sens de la théorie économique, justifiant une
appropriation par la collectivité ou à tout le moins que celle-ci
en favorise l'accès à tous.
La tentation est forte de considérer que ces deux faces de l'oeuvre
d'art, privilège des riches et droit du plus grand nombre, peuvent
être dissociées et que l'État n'a pas à intervenir
pour développer un marché qui n'intéresse qu'une petite
minorité.
Pourtant, au-delà des chiffres des personnes ou des métiers
connexes, le rapporteur a la conviction que le dynamisme du marché de
l'art n'est pas sans importance pour un pays qui dépense autant pour les
arts, dont la spécialisation, sur le plan international comporte
notamment des produits de luxe ou à fort contenu culturel.
a) Le marché de l'art et la sauvegarde de savoir-faire appartenant au patrimoine national
Pour des
raisons, il est vrai plus intuitives que véritablement
étayées sur des données mesurables, car on ne dispose
guère des statistiques sur l'importance du marché de l'art et des
activités connexes.
Liés pour certains à la restauration du patrimoine, pour d'autres
à la création, les métiers d'art s'exercent dans des
conditions très différentes : artisan ou profession
libérale, petite ou moyenne entreprise, industrie d'art.
Généralement, on considère qu'un " métier
d'art " réunit trois éléments : une technique
essentiellement manuelle, souvent traditionnelle, une entreprise dirigée
par un professionnel, une production d'objets uniques ou en petites
séries ou l'exécution de services non répétitifs.
Seule la qualité effective du travail réalisé constitue
une ligne de partage entre ce qui est métier d'art et ce qui ne l'est
pas (cf. rapport Dehaye 1976)
44(
*
)
.
Cette hétérogénéité rend difficile la
connaissance exacte de leur poids économique et social. Les inventaires
des entreprises " métiers d'art ", réalisés dans
certaines régions, permettent de recenser environ 15.000 entreprises
artisanales, occupant 33.000 emplois et réalisant 10 milliards de
chiffre d'affaires.
Le marché de l'art permet le maintien de savoir faire constitutifs de la
tradition artisanale française. L'antiquaire Didier Aaron a, lors de son
audition, évoqué l'importance des emplois, selon lui au moins
cinquante mille, et la diversité des spécialités
concernées. Pour illustrer cette diversité, il a fait parvenir la
liste suivante :
- Les restaurateurs de meubles en marqueterie
- Les restaurateurs de sièges
- Les sculpteurs sur bois
- Les peintres sur bois
- Les doreurs sur bois
- Restaurateurs spécialisés en meubles Boulle (écaille et
cuivre)
- Restaurateurs de bronzes, comprenant : fondeurs, ciseleurs et
doreurs,
- Restaurateurs de pendules comprenant : horlogers, émailleurs pour
les cadrants, fabricants de pièces d'horlogerie pour les mouvements
incomplets,
- Restaurateurs de baromètres et thermomètres anciens,
- Restaurateur de porcelaines comprenant : des restaurateurs de pâte
tendre, de faïences, de terre cuite, de marbres anciens
- Restaurateurs de laques chinoises ou japonaises,
- Restaurateurs de tableaux, comprenant : les rentoileurs,
transposeurs, restaurateurs de peintures
- Restaurateurs de dessins anciens,
- Fabricants de châssis
- Restaurateurs de cadres,
- Restaurateurs de livres, comprenant des restaurateurs de papier, et
restaurateurs de reliure XVIII
ème
et art-déco ainsi
que des gainiers
- Restaurateurs de tapis, tapisseries, tapissiers en siège, passementiers
- Restaurateurs de verre, lustres, bronziers, cristal, pierres
semi-précieuses
- Socleurs
- Restaurateurs d'argenterie
b) Les activités connexes
Une
étude commandée par la fédération britannique du
marché de l'art, déjà citée qui figure en annexe,
donne pour la Grande Bretagne, un intéressant aperçu de l'impact
global du marché de l'art sur toute une série de services,
qualifiés d'auxiliaires.
Considérant que la situation ne doit pas être fondamentalement
différente en France Le rapporteur souhaite qu'une étude analogue
soit entreprise dans notre pays.
En Grande-Bretagne, le marché des oeuvres d'art et des antiquités
a dépensé environ 2 milliards de francs en services de soutien.
Près du quart de cette somme concerne des dépenses de
restauration et de conservation, presqu'à égalité avec les
dépenses relatives aux foires et expositions. Le reste correspond
à des dépenses de transport, d'assurance, de publicité et
d'impression.
Structures des dépenses induites par le marché de l'art en Grande-Bretagne (pour une dépense totale d'environ 2 milliards de F.)
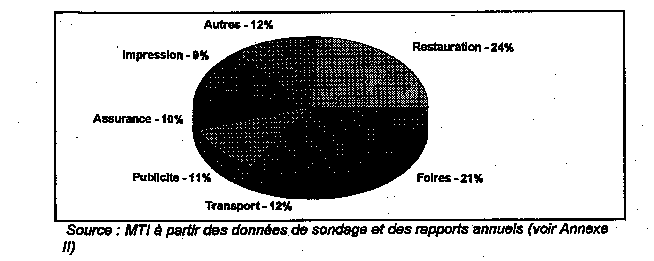
Ces dépenses induites correspondent à environ un dixième de la taille du marché estimé - commerce et grandes salles des ventes additionnées - à plus de 2,2 milliards de francs.
c) Un élément clé de la politique culturelle
La
France, terre des arts, pourrait, à l'instar de l'Italie, se contenter
de geler le stock existant et se désintéresser de son
marché vivant au risque d'encourager les transactions clandestines.
• la France a fait le choix en 1992 d'un régime de liberté
des échanges, sur lequel il semble difficile de revenir autrement
qu'à la marge ;
• il y a en Italie, une connaissance et un attachement au patrimoine
mobilier, qui n'a pas d'équivalent en France ; le nombre des
collectionneurs privés, l'existence de collections de banques au fort
enracinement local - mais l'Italie est un pays décentralisé -,
comme celle du Monte Paschi di Siena, tournées vers le patrimoine
régional, sont venues pallier l'action longtemps inexistante de
l'État dans le domaine et finalement limiter l'exode clandestin des
oeuvres d'art ;
• enfin, l'intérêt pour le marché de l'art est
cohérent avec une
politique culturelle sans équivalent par
ses objectifs et ses moyens financiers publics: la politique de grands
équipements culturels et notamment de grands musées, un budget
d'acquisition, qui n'a maintenant d'égal que celui de l'Angleterre, un
soutien aux grandes expositions, en dernier lieu la création d'un
institut national d'histoire de l'art, témoignent de ces ambitions.
On note toutefois que si sur le plan de la diversité la politique
française d'exposition reste sans doute l'une des plus riches, il n'en
est pas de même en termes de fréquentation, ainsi que permettent
de le constater les tableaux ci-après.
Il semble au rapporteur que ce choix n'est pas ou plus possible et ne
correspond pas aux ambitions affichées par notre pays en matière
culturelle, qui ne compte que trois expositions sur les trente premières
expositions les plus visitées dans le monde en 1997 et 1998, contre 19
et 21 aux Etats-Unis.
Fréquentation des expositions dans le monde en 1997
|
Nombre de visiteurs |
Exposition |
Lieu |
Ville |
|
630.000 |
Documenta |
En ville |
Cassel |
|
489.423 |
Portraits de Renoir |
Art Institute |
Chicago |
|
433.890 |
Picasso et le Portrait |
Grand Palais |
Paris |
|
530.911 |
Picasso : les premières années |
National Gallery of Art |
Washington |
|
534.613 |
Georges de La Tour |
Grand Palais |
Paris |
|
220.000 |
L'art du XXe siècle |
Martin-Gropius-Bau |
Berlin |
|
338.300 |
Monet et la Méditerranée |
Kimbell Art Museum |
Fort Worth |
|
255.000 |
Monet et la Méditerranée |
Brooklyn Museum of Art |
New York |
|
165.220 |
Art et Anatomie |
Museum of Art |
Philadelphie |
|
270.303 |
L'art à Vienne |
Van Gogh Museum |
Amsterdam |
|
358.770 |
Van Gogh : dessins |
Musée Van Gogh |
Amsterdam |
|
199.756 |
250 ans de style |
Museum of Art |
Philadelphie |
|
170.000 |
Biennale |
Giardini di Castello |
Venise |
|
460.864 |
La Gloire de Byzance |
Metropolitan Museum |
New York |
|
355.000 |
Jan Steen |
Rijksmuseum |
Amsterdam |
|
236.407 |
Robert Capa |
Museum of Art |
Philadelphie |
|
320.867 |
Angkor : l'art khmer |
Grand Palais |
Paris |
|
228.277 |
Rodin et Michel-Ange |
Museum of Art |
Philadelphie |
|
172.600 |
Fabergé en Amérique |
Museum of Art |
Cleveland |
|
239.427 |
Peintures victoriennes |
National Gallery of Art |
Washington |
|
140.097 |
David Alfaro Siqueiros |
Museum of Fine Arts |
Houston |
|
294.734 |
Sensation |
Royal Academy |
Londres |
|
420.686 |
Cartier |
Metropolitan Museum |
New York |
|
221.870 |
Egon Schiele |
Museum of Modern Art |
New York |
|
248.837 |
Jasper Johns |
Museum of Modern Art |
New York |
|
159.794 |
La collection Rothschild |
Museum of Art |
Philadelphie |
|
486.100 |
Trésors du Mont Athos |
M. de la culture byzantine |
Thessalonique |
|
100.000 |
Expressionnisme allemand |
Palazzo Grassi |
Venise |
|
152.219 |
Matisse, Picasso et leurs amis |
Museum of Fine Arts |
Houston |
Fréquentation des expositions dans le monde en 1998
|
Nombre de visiteurs |
Exposition |
Lieu |
Ville |
||
|
480.496 |
Les Van Gogh de Van Gogh |
National Gallery |
Washington |
||
|
565.992 |
Monet au XXe siècle |
Musée des beaux-arts |
Boston |
||
|
528.267 |
La collection d'Edgar Degas |
Metropolitan |
New York |
||
|
400.000 |
Millet-Van Gogh |
Orsay |
Paris |
||
|
301.037 |
L'art de la moto |
Guggenheim |
New-York |
||
|
410.357 |
Gianni Versace |
Metropolitan |
New-York |
||
|
250.810 |
La gloire d'Alexandrie |
Petit Palais |
Paris |
||
|
300.000 |
Alexander Calder 1898-1976 |
Musée d'art moderne |
San Francisco |
||
|
305.883 |
Delacroix : les dernières années |
Museum of Art |
Philadelphie |
||
|
299.950 |
5.000 ans d'art chinois |
Guggenheim |
New York |
||
|
302.204 |
René Magritte |
M. royaux des B.-Arts |
Bruxelles |
||
|
152.794 |
Van Eyck |
Museum of Art |
Philadelphie |
||
|
236.217 |
Le Codex Leicester et la postérité de Léonard de Vinci |
Art Museum |
Seattle |
||
|
276.202 |
Bonnard |
Tate Gallery |
Londres |
||
|
243.336 |
Picasso : chefs-d'oeuvre du MoMA |
High Museum of Art |
Atlanta |
||
|
284.064 |
Tapis indiens de l'époque moghole |
Metropolitan |
New York |
||
|
288.709 |
Alexander Calder 1898-1976 |
National Gallery |
Washington |
||
|
230.680 |
Sculpture in situ |
Walker Art Center |
Minneapolis |
||
|
154.443 |
Autodidactes du XXe siècle |
Museum of Art |
Philadelphie |
||
|
81.000 |
Vinci, la Dame à l'hermine |
Quirinale |
Rome |
||
|
160.000 |
Van Eyck |
National Gallery |
Londres |
||
|
236.702 |
Manet-Monet et la Gare Saint Lazare |
National Gallery |
Washington |
||
|
100.000 |
Les Grecs anciens en Espagne |
Musée nat. d'archéologie |
Athènes |
||
|
230.921 |
Degas aux courses |
National Gallery |
Washington |
||
|
253.170 |
Picasso : chefs d'oeuvre du MoMA |
National Gallery of Canada |
Ottawa |
||
|
210.753 |
Visions du Nord |
Musée d'art moderne de la Ville de Paris |
Paris |
||
|
176.893 |
La conception des parcs Disney |
Walker Art Center |
Minneapolis |
||
|
225.000 |
Monet et la Méditerranée |
Brooklyn Museum |
New York |
||
|
205.704 |
Les anges du Vatican |
Art Museum |
Saint-Louis |
||
|
Pays |
Nombre d'expositions mentionnées dans le palmarès des 200 expositions les plus fréquentées en 1998 |
||||
|
France |
38 |
||||
|
États-Unis |
41 |
||||
|
Grande-Bretagne |
21 |
||||
|
Italie |
13 |
||||
|
Allemagne |
5 |
||||
Il est
intéressant de constater que
si l'on prend en compte le
palmarès des 200 expositions les plus fréquentées dans le
monde en 1998, la France avec 38 citations fait presque jeu égal avec
les États-Unis, 41, indépendamment de la différence de
population
.
On est donc loin de la domination écrasante des Américains
constatée lorsque l'on ne considère que le palmarès des
trente premières expositions. La différence est encore plus
notable avec la Grande-Bretagne, qui n'arrive qu'en troisième position
avec un nombre de citations de moitié inférieur à celui de
la France. Il faut également remarquer une
présence notable
d'expositions en province ce qui dénote de la vitalité des
régions
: Lyon, Nantes, Antibes, Rennes, Nice, Marseille,
Bordeaux, Metz et Dijon parviennent à placer souvent deux expositions
dans le palmarès.
d) Une composante de notre image de marque commerciale
La vente
aux enchères est devenue, en moins de 40 ans, si ce n'est une
" industrie ", du moins
une activité de service
développée à l'échelle mondiale
, qui a, du fait
de son
impact en terme d'image
, notamment auprès d'une certaine
élite des affaires, une importance certaine, en dépit de la
modicité des flux macro-économiques.
D'un point de vue économique, le marché de l'art n'est pas
négligeable pour la
France
, qui se veut la
patrie du luxe et
le pays de l'art de vivre
. Ce n'est pas un hasard si M. François
Pinault - qui s'intéresse depuis peu au secteur du luxe comme le montre
l'affaire Gucci - est devenu le principal actionnaire de Christie's et si l'on
prête à LVMH des vues sur Sotheby's.
Paris, et la France en général, sont-ils condamnés
à rester ce
marché local,
- volontiers
présenté comme folklorique par la presse anglo-saxonne - Tel est
bien l'objet de la réflexion entreprise par le rapporteur sur les
perspectives de relance du marché de l'art en France
II. LES VOIES DE LA RENAISSANCE
Comment
restaurer la compétitivité du marché
français ? Une succession de rapports remarquablement convergents,
quelle que soit la couleur politique des gouvernements qui les ont
commandés, fournissent des analyses et des propositions que l'on
trouvera largement reprises dans le présent rapport.
Pourtant, en dépit de leurs recommandations convergentes, les
gouvernements successifs, faute de temps et sans doute de volonté
politique, n'ont pas agi à temps. Cette " douce insouciance ",
ce " benign neglect " a pour conséquence que pour les dossiers
européens il est bien tard pour réagir et arrêter la
mécanique européenne quand elle est lancée.
A. LA PROBLÉMATIQUE DE LA COMPÉTITIVITÉ
Le
présent rapport reprend et s'appuie largement sur les analyses des
rapports Chandernagor et Aicardi.
Il s'en distingue toutefois par une approche peut-être moins
volontariste, qui résulte de l'analyse de la question de la
réforme des ventes publiques, que l'auteur du présent rapport a
été amené à faire en qualité de rapporteur
pour avis
45(
*
)
du projet de loi portant
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Instruit par l'expérience, le rapporteur est à la fois conscient
d'une part, des pesanteurs réglementaires notamment européennes,
d'autant plus paralysantes qu'il a pu mesurer le manque de mobilisation
politique du présent gouvernement, et d'autre part, de la
nécessité de s'adapter à des règles du jeu
définies par les opérateurs dominants jouant le jeu
libéral anglo-saxon.
En d'autres termes, dans un marché mondial, complètement
dominé par deux grandes entreprises, il n'a pas paru réaliste,
dès lors que l'on faisait le choix de l'ouverture, de vouloir jouer avec
des règles du jeu, très différentes de celles
" agrées par la fédération internationale ",
même si les nôtres sont objectivement meilleures.
1. Les analyses des rapports de MM. Chandernagor et Aicardi
La
personnalité des auteurs des rapports, leur expérience, la
qualité et le nombre des avis dont ils ont pu entourer leur travaux, la
compétence technique des équipes mises à leur disposition,
font de leur travail des ouvrages de référence.
Il a paru utile, lorsqu'ils n'avaient pas été publiés, de
les placer en annexe du présent rapport et c'est ainsi que l'on a joint
le rapport de M. Aicardi et le deuxième rapport de
M. Chandernagor ; que leurs auteurs soient remerciés d'avoir
accepté de venir compléter la masse d'informations contenue dans
le présent rapport.
a) Les rapports Chandernagor
En août 1992, M. André Chandernagor a reçu, en sa qualité de président de l'Observatoire des mouvements internationaux d'oeuvres d'art, mission du ministre de l'Éducation nationale et de la culture d'analyser les possibilités de développement du marché de l'art en France dans le contexte européen d'ouverture des frontières, en vue de faire " connaître toutes propositions de nature à améliorer la compétitivité de ce marché ".
(1) Le constat
Au-delà des indications chiffrées sur l'ampleur
du
marché de l'art et des échanges extérieurs, le rapport
comporte une analyse des mécanismes du marché de l'art : les
objets d'art d'un montant supérieur à 500 000 francs, qui sont
ceux qui intéressent une clientèle internationale, constituent
une " masse flottante à la recherche des meilleurs lieux de
valorisation ". Les pôles dominants du marché sont Londres,
New-York et Paris, mais fréquemment, ni le vendeur ni l'acheteur ne sont
des résidents.
Le rapport constate également que "
la France se situe loin en
arrière de ses principaux concurrents, en matière de dynamisme
commercial et de concentration financière ".
Les atouts de notre pays sont considérés comme importants :
le prestige de la France, le nombre des amateurs, la richesse de notre
patrimoine, la diversité et la multiplicité des
opérateurs, qu'il s'agisse des marchands, des commissaires-priseurs ou
artisans, sont autant d'atouts dans la concurrence internationale. Le
marché est présenté comme très favorable à
l'acheteur par la grande sécurité et les tarifs attractifs qu'il
offre à l'acheteur : "
le marché est fiable,
très contrôlé par l'État, les objets y sont sains.
Le régime de ventes publiques et la responsabilité trentenaire de
droit commun des professionnels donnent à l'acheteur une
sécurité infiniment plus grande que celle qu'il peut trouver en
Grande-Bretagne ou ailleurs
. "
Les handicaps évoqués par le rapport sont un différentiel
de charges (TVA à l'importation et droit de suite) et des contraintes
réglementaires (tarif acheteur dégressif, restrictions à
l'appel à des capitaux extérieurs).
(2) Les propositions
Les
propositions de M. André Chandernagor pouvaient être
regroupées autour de trois objectifs généraux :
•
réduire le différentiel de charge :
- TVA :
A défaut de taux zéro, le rapport
préconise un taux intermédiaire de l'ordre de 2,5 %, du
même ordre que celui appliqué par l'Angleterre ;
- Droit de suite :
transfert de la charge du vendeur à
l'acheteur, diminution du taux du droit à 1 % au moins pour les oeuvres
de plus de 500 000 Francs, élargissement de l'assiette à toutes
les oeuvres d'art, y compris celles tombées dans le domaine public ;
- Impôts sur les plus values et sur la fortune :
il a paru
"
plus important de maintenir [l'exonération de l'impôts
sur la fortune ] que de supprimer l'impôt sur les plus-values
".
•
Donner aux commissaires-priseurs les moyens financiers de lutter
contre leurs concurrents :
- Capacités d'investissements :
autoriser les
sociétés d'exercice libéral à s'ouvrir aux capitaux
extérieurs dans la limite de 49 % voire sans limite, mais à
condition que la société continue de ne pouvoir exercer son objet
social que par l'intermédiaire obligatoire d'un commissaire-priseur et
que, si le dirigeant désigné par les actionnaires majoritaires ne
soit pas commissaire-priseur, celui-ci doive être agréé par
le ministère de la justice
- Rendre le tarif acheteur linéaire :
le rapport
annonçait la réforme tendant à remplacer le tarif
dégressif par un taux linéaire de 9 %.
•
Mettre l'accent sur la fiabilité du marché
français :
- Lutter contre le marché illicite :
rappelant le rôle du
livre de Police dans la garantie de l'origine des objets vendus, le rapport
évoque l'importance du paracommercialisme évalué à
45 000 personnes ;
- Protéger le patrimoine :
le rapport souligne que la mise
en oeuvre de la loi du 31 décembre 1992, qui suppose une bonne
collaboration avec les professionnels va accroître la fiabilité du
marché français ;
- Doter les experts d'un statut :
considérant que, si
les professionnels du marché sont informés de la qualité
des experts auxquels ils s'adressent, il n'en est pas toujours de même
des particuliers et qu'en conséquence, il est souhaitable que soit mise
en place une liste des experts auxquels ils pourraient s'adresser ;
à défaut de liste nationale établie par une commission
constituée à partir des trois organismes représentatifs
actuels, le rapport envisage des listes régionales par chambre
régionale choisie par une commission comprenant des conservateurs ;
- Préciser la responsabilité des experts :
considérant que la responsabilité effective des experts est
difficile à mettre en oeuvre, ceux-ci étant tenus à une
obligation de moyens et pas de résultats, le rapport estime que la
responsabilité trentenaire de droit commun, non seulement n'est pas une
entrave sérieuse au développement du marché
français mais constitue au contraire un des ses atouts.
(3) Le nouveau rapport d'avril 1998
En mars
1998, la ministre de la culture et de la communication, a confié
à M. André Chandernagor, une mission d'analyse de la situation et
des problèmes actuels et de propositions permettant de développer
le marché de l'art dans notre pays.
Rappelant d'abord les grandes lignes de l'analyse faite du fonctionnement du
marché effectuée dans son premier rapport, M. André
Chandernagor propose une série de mesures, articulées autour de
trois objectifs :
Permettre aux professionnels des ventes publiques de se doter des moyens
nécessaires pour affronter leurs principaux concurrents
:
après avoir évoqué les effets bénéfiques de
la libération annoncée des tarifs acheteurs, l'auteur du rapport
a souligné le temps perdu pour la mise en place d'un nouveau
régime, en regrettant que le projet de loi oblige les
commissaires-priseurs à renoncer à l'exercice libéral de
leur profession.
Réduire le différentiel de charge qui pénalise le
marché français :
TVA sur les ventes :
il n'y a pas de déséquilibre majeur
en Europe, mais une distorsion ponctuelle pour l'art contemporain pour lequel
la TVA peut atteindre dans certains cas 9 % non déductible, ce qui est
d'autant plus pénalisant que l'Allemagne, de son côté, a
obtenu la possibilité de conserver son taux réduit
déductible de 7 % jusqu'au 30 juin 1999.
Taxe sur les plus values
: cette taxe n'est pas
considérée comme " pénalisante pour le marché
de l'art. Son maintien paraît même justifié, puisque les
oeuvres d'art bénéficient comme dans le reste de la
Communauté, de l'exemption de l'impôt sur le capital et il ne
semble pas que les raisons qui dès l'origine de cet impôt, ont
conduit à exonérer les oeuvres aient perdu de leur valeur :
difficulté d'évaluation de l'oeuvre d'art, facilité de
dissimulation, accroissement de la fraude et de l'évasion vers
l'étranger, refus de participation de participation des
propriétaires privés à la politique culturelle de
l'État et des collectivités territoriales (exposition
mécénat).
"
De surcroît, l'extension aux ventes privées de
l'exemption de la taxe dont bénéficient les vendeurs
étrangers en vente publique serait un adjuvant important pour nos
importations qui en ont besoin ; Et si l'on se place du point de vue des
résidents français assujettis à la taxe, rien, si ce n'est
la moindre transparence des transactions privées par rapport aux ventes
publiques, ne peut expliquer la différence de traitement fiscal qu'ils
subissent, selon qu'ils vendent le même objet à un
négociant ou en vente publique ".
TVA à l'importation
: après avoir souligné
l'exode massif de certains marchés - bijoux manuscrits, meubles de moins
de cent ans d'âge -, M. André Chandernagor souligne qu'il suffit
de constater la stagnation du chiffre hors CEE, de nos importations pour
être convaincu de la nocivité de cette taxe, qui, agissant comme
un droit de douane dissuasif à l'entrée de notre marché, a
pour résultat la fermeture de celui-ci sur lui-même "...Il
poursuit : "
actuellement cette taxe ne rapporte au Trésor
que 40 millions environ par an. Pour un aussi faible rapport est-il bien
nécessaire de maintenir un impôt aussi
paralysant...
? "
Droit de suite
: l'auteur du rapport reprend l'essentiel des
analyses du premier rapport en préconisant que l'assujetti soit
l'acheteur et non pas le vendeur et que le taux soit dégressif pour
n'être que de 1 % pour les oeuvres d'une valeur supérieure
à 500 000 francs ; il ajoute qu'on pourrait si possible aller plus
loin et assujettir au droit de suite toutes les oeuvres même
tombées dans le domaine public. Il souligne également les
difficultés des galeries, si le projet de directive venait à leur
être appliqué.
Droit de reproduction
: L'auteur du rapport pose le problème
de l'adaptation du texte de la loi du 27 mars 1997 exonérant les ventes
publiques pour tenir compte du nouveau régime des ventes publiques et de
l'extension de l'exonération aux catalogues des galeries
Renforcer la fiabilité de notre marché :
Expertise
: M. André Chandernagor se félicite de ce que
les organisations représentatives de ces professions se soient
efforcées de se doter d'un code de déontologie, tout en
soulignant les limites d'un système dans lequel son application est
laissée à la discrétion des instances
professionnelles : pour lui, "
seule une autorité
indépendante dans sa composition et pluraliste dans sa composition
serait à même d'offrir des garanties suffisantes
d'objectivité et de rigueur
. " Préconisant l'extension
de la compétence du Conseil des ventes volontaires prévu par le
projet de loi à l'agrément de tous les experts, qu'ils exercent
ou non pour les ventes publiques, il suggère d'appeler cette instance,
" Conseil des ventes volontaires et de l'expertise "
Veiller à ce que les mesures de protection du patrimoine soient aussi
compatibles qu'il est possible avec la libre circulation des oeuvres
d'art
: M. André Chandernagor, après avoir fait le
bilan de l'application de la loi du 31 décembre 1992 en notant la grave
lacune que constitue le fait qu'il suffit à un propriétaire
d'attendre trois ans pour être assuré d'obtenir le certificat,
insiste, compte tenu de l'effet dissuasif de la jurisprudence Walter en
matière de classement d'office, sur l'urgence de donner une suite
favorable au projet de réforme de la loi de 1992 en cours
d'élaboration.
Il se déclare favorable, notamment, à deux dispositions contenues
dans cet avant-projet : une procédure inspirée du
système anglais prévoyant la possibilité pour
l'État d'acheter des oeuvres qualifiées de " trésors
nationaux " à dires d'expert ; des exonérations de
droits de mutation et de taxe forfaitaire pour les propriétaires
d'objets classés.
Après s'être déclaré favorable à
l'affectation aux "trésors nationaux" d'une part préfixée
des recettes de la Française des jeux, suivant l'exemple britannique, M.
André Chandernagor a souligné l'urgence de ces mesures et la
nécessité d'une alliance avec l'Angleterre, qui tout en
étant notre concurrent partage avec nous le souci de préserver un
marché de l'art important sur notre continent.
b) Le rapport Aicardi
Par une
lettre en date du 2 décembre 1994, le Premier Ministre,
M. Édouard Balladur a confié à M. Maurice
Aicardi une mission d'étude et de propositions consacrée aux
problèmes liés à la circulation des oeuvres d'art et au
maintien sur le territoire national des oeuvres majeures de notre patrimoine
culturel, avec pour objectif de formuler des propositions autour de deux
thèmes principaux :
• "
comment organiser la défense et l'enrichissement du
patrimoine national, comment mieux associer les entreprises et les particuliers
à sa conservation et au maintien des trésors nationaux sur notre
territoire
? "
• "
quelles sont les conditions d'un fonctionnement optimal du
marché de l'art en France ? En effet l'existence d'un marché
de l'art français puissant et bien structuré est l'essentiel, non
seulement parce qu'il peut favoriser le maintien en France des oeuvres
majeures, mais aussi en raison de l'atout économique qu'il
constitue.
"
En ce qui concerne les "trésors nationaux", le rapport souligne les
défauts du régime institué par la loi du 31
décembre 1992 : blocage de l'oeuvre pour laquelle a
été refusé le certificat pendant trois ans ; pas de
possibilité d'achat de l'oeuvre par l'État sur la base d'une
valeur prédéterminée ; nécessité d'une
indemnisation en application de la loi de 1913 par suite de la suppression de
la loi de la loi du 23 juin 1941 ; détournement de procédure
faisant utiliser le classement comme moyen d'interdire la sortie ; enfin,
il n'est prévu aucun moyen pour l'État d'acheter les
"trésors nationaux". Face à une situation où s'accumulent
les cas pendants d'oeuvres, le
rapport suggère soit de créer
un fonds de concours alimenté par une dotation de la Française
des jeux, soit d'inciter les personnes privées à acheter des
"trésors nationaux" en leur permettant de bénéficier d'un
crédit d'impôt sur la fortune, sur les sociétés ou
de droits de mutation, pour tout ou partie de la valeur du bien, selon que les
personnes se réservent ou non un usufruit limité dans le
temps.
En outre, le rapport propose une procédure d'acquisition calquée
sur celle en vigueur en Grande-Bretagne. Enfin, le rapport propose de revoir
certains aspects de la réglementation : garantir que les biens
régulièrement importés depuis moins de cinquante ans ne
peuvent être classés, raccourcir les seuils d'ancienneté
pour le contrôle des archives qui pourraient être ramenées
de 50 à 20 ou 30 ans.
"
La commission souligne avec force la singularité de la
position de la France qui, anticipant sur l'évolution de ses partenaires
européens a renoncé pour de purs motifs douaniers au droit
régalien de retenir ses trésors nationaux, tandis que ses
prudents voisins se gardant bien d'abroger leur législation protectrice,
se bornaient à mettre en oeuvre la nouvelle réglementation
douanière ".
Pour renforcer
la protection du patrimoine, le rapport affirme la
nécessité d'un "
volet préventif
" car
"
sans attendre d'être placé devant le fait accompli, il
faut s'attacher à en réduire les causes
".Il
préconise la recherche d'un " effet de levier, par lequel une
incitation initiale de l'État pousse les propriétaires à
diriger une plus grande part de leur ressources vers la sauvegarde de leur
patrimoine.
Le rapport prévoit, à ce titre, d'aménager le
régime de l'article 795 A du code général des impôts
qui exonère d'impôt sur les successions les biens mobiliers
constituant le complément artistique ou historique d'un monument
historique. Il s'agit d'éviter la double facturation du temps, en cas de
rupture de la convention, à la fois avec l'actualisation de la valeur du
bien et l'application d'intérêts de retard. A cette mesure,
s'ajouteraient d'autres aménagements plus techniques, comme la prise en
compte de la fraction des biens exonérés dans les parts des
sociétés civiles ou la possibilité de déduire les
frais d'assurance des monuments historiques pour leur montant réel.
Par ailleurs, il est souhaitable d'encourager le propriétaire à
vendre un musée national plutôt qu'à un acheteur
étranger comme cela est le cas en Grande Bretagne où lorsqu'un
bien pour lequel les droits de succession étaient suspendus, est vendu
à un musée national, le vendeur ne paye que 75 % de ce droit.
Dans le même perspective, il est proposé d'étendre la
faculté de dation à d'autres impôts que les droits de
mutation.
Toujours dans un souci de sauvegarde du patrimoine, le rapport propose
d'accorder un abattement de 50 % sur la valeur des oeuvres d'art retenue pour
la calcul des droits de succession pour les propriétaires s'engageant
à ne pas céder leurs oeuvres et à les prêter pour
des périodes délimitées aux musées nationaux pour
expositions, selon des clauses à prévoir dans une convention type.
Abordant, dans un second temps, la question du marché de l'art, le
rapport de la commission présidée par M. Aicardi développe
une problématique assez proche de celle élaborée par M.
Chandernagor.
Partant du constat que pour les oeuvres d'une valeur unitaire supérieure
à 500 000 francs, les vendeurs choisissent les places les plus
attractives et donc cherchent à minimiser la taxation, "
une
importance particulière s'attache pour le développement de la
place de Paris, à ce que la transaction ne soit pas plus taxée
qu'ailleurs. "
Sur les cinq taxes qu'une vente publique est susceptible de supporter (TVA
à l'importation, TVA à la vente, droit de suite, taxe forfaitaire
et droit de reproduction) deux ne posent pas de problème, mais trois
sont à l'origine de distorsions graves.
La TVA à l'importation ne pose pas de problème car la taxe est
supportée par l'acheteur et celui-ci ne la paie pas lorsqu'il est
extra-européen et qu'une taxe similaire existe à New-York
La taxe forfaitaire ne pose pas non plus de problèmes car elle ne
pèse pas sur les non résidents et qu'elle n'influe pas non plus
sur le choix du résident, que la vente ait lieu à Paris ou hors
de France.
La TVA à l'importation ne devrait pas soulever de difficultés
à ceci près que :
• le vendeur, qui ne connaît l'acheteur qu'une fois la vente
faite, ne peut être assuré d'avance de ce que le bien sera
acheté par un résident extra-européen et doit donc prendre
en compte dans son choix le risque de subir une TVA à l'importation,
"
la TVA ayant ainsi toujours un effet dissuasif, même si elle
n'est pas perçue dans tous les cas "
;
• la possibilité laissée à la Grande-Bretagne de
n'appliquer la taxe au taux de 2,5 % pénalise la France et crée
des risques de détournement de trafic : il suffit à un
vendeur extra-européen de faire transiter son bien par l'Angleterre pour
échapper à la TVA française.
Le rapport souligne un point sur lequel le rapporteur de la commission des
finances reviendra, en soulignant que l'application de la TVA procède
d'une mauvaise compréhension du marché de l'art :
"ce
n'est pas, comme pour les marchés de biens et services, l'exportation
qui est favorable - elle appauvrit le patrimoine national - mais l'importation
qui l'accroît ".
Pour la commission présidée par M. Aicardi, seule la voie
européenne est envisageable tant pour l'aménagement de la
définition des oeuvres d'art que pour la constitution avec les
britanniques d'un
" front hostile à la TVA à
l'importation des oeuvres d'art ."
En ce qui concerne le droit de suite, qu'il considère comme
" difficilement contestable dans son principe ", le rapport
préconise de le mettre à la charge de l'acheteur et de le rendre
dégressif, en observant que cette modification ne léserait pas
les bénéficiaires du droit de suite, puisque le seul effet du
droit de suite est d'en déplacer le vente sur les places qui ne le
reconnaissent pas.
Au sujet du droit de reproduction, la commission, considérant que
l'extension du droit de reproduction aboutit la plupart du temps à
mettre en place une " double rémunération " qui n'est
pas justifiée, estime nécessaire que le législateur
exonère les catalogues de ventes publiques de droit de reproduction.
Les développements du rapport consacrés aux ventes publiques,
sont aujourd'hui datée du fait des choix effectués par le projet
de loi portant réforme du régime de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, mais restent intéressants dans leur
approche.
Au-delà de la nécessité juridique d'obtempérer
à l'injonction des autorités de Bruxelles, la commission fait un
constat : "
l'interdiction faite aux opérateurs
internationaux d'organiser des ventes publiques sur le sol français..[
aboutit à faire] vendre hors de France les beaux objets de notre
patrimoine ", soulignant au passage que " le loi du 31 décembre
1992 en abrogeant la loi douanière de 1941 a grandement facilité
les échanges de France vers l'extérieur, c'est-à-dire les
transferts d'objets français destinés à être vendus
à Monaco, Londres ou New-York... ".
Le rapport attire l'attention sur les conséquences dommageables d'une
telle situation : une perte de chiffre d'affaires qui se compte en
centaines de millions de francs ; des objets achetés hors de France
sans espoir de retour ; une masse d'objets réduite sur laquelle
l'État peut exercer son droit de péremption.
Il affirme également que " le monopole d'officiers
ministériels est de surcroît radicalement inefficace à
l'extérieur de nos frontières... Si certains professionnels s'y
sont taillés un rang et un rôle, ils le doivent à leur
compétence et à leur dynamisme, nullement à leur statut de
commissaires-priseurs, qui par sa nature même les prive des capitaux
nécessaires à l'activité internationale ".
En ce qui concerne les adaptations juridiques, la commission a émis des
doutes sur le caractère " réaliste " de la proposition
d'action de concert suggéré par la Chancellerie et
considéré que la liberté de prestation de services qui
était le complément de la possibilité ainsi offerte,
était une " impasse " et que la réponse à la
question posée par Bruxelles restait l'aménagement de la
liberté d'établissement.
Sur le plan juridique, la commission a, d'une part, considéré que
l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral
dans la limite de 49 % restait un " faux semblant " et qu'un tel
dispositif conduit inéluctablement à une forme de fraude. En
revanche, elle s'est déclarée favorable à l'extension du
système de la société auxiliaire déjà
pratiquée par certains offices par lequel le commissaire-priseur qui
dirige la vente, s'adosse par convention à une société
commerciale, responsable de l'organisation et du suivi de la vente.
Dans sa conclusion, le rapport affirme son attachement à " la
conservation de l'essentiel de la spécificité française,
c'est-à-dire la responsabilité vis à vis des
acheteurs " et souligne
" avec force que l'ouverture aux
sociétés commerciales des ventes aux enchères publiques
volontaires d'objets d'art n'aurait aucun sens, si elle n'était
précédée ou a tout le moins accompagnée d'une
élimination des distorsions fiscales et parafiscales, dont souffre
aujourd'hui le marché français des ventes aux enchères
d'oeuvres d'art. "
2. Une analyse stratégique de la spécialisation internationale
Le
rapporteur adhère tout à fait à la logique de ces deux
documents qui mettent l'accent sur le rôle tout à fait
déterminant du vendeur dans le choix des lieux de vente.
Mais, il tend à ne pas isoler cette observation du mode de
fonctionnement d'un marché marqué par des comportements de
duopole - à la fois compétitifs et coopératifs .
Ce
sont bien les vendeurs qui disposent mais ce sont les grandes maisons de vente
qui proposent
, et qui sauront orienter la demande dans le sens de leurs
intérêts à long terme. Cela n'est pas contradictoire avec
les analyses précédentes dans la mesure où les
considérations de coûts et de charges pour le vendeur seront
effectivement dans la plupart des cas déterminantes.
a) L'analyse de la spécialisation
Comme cela a été souligné dans les deux rapports les oeuvres de niveau international sont très mobiles car le vendeur n'hésitera pas à tenir compte de différences de charge, fussent-elles minimes. Mais il ne faut pas pour autant sous-estimer les facteurs tenant à la localisation de l'offre ou de la demande.
(1) La notion de marché international
Le
marché international peut se définir en fonction d'une certaine
valeur ; le seuil de 500 000 francs proposé par les rapports
Aicardi et Chandernagor apparaît raisonnable, même s'il ne s'agit
là que d'une approximation variable selon les types d'oeuvres : 500
000 francs c'est probablement peu pour un tableau de l'école
impressionniste ; c'est beaucoup pour un dessin de maître ancien,
dont on peut penser qu'il atteint le niveau international à un niveau de
prix situé aux alentours de 200 à 250 000 francs.
Mais on peut aussi chercher
à définir le marché
international de façon fonctionnelle, comme celui où
s'échangent les oeuvres dont les prix justifient le déplacement
des oeuvres et des acheteurs entre les pays et plus certainement encore entre
les continents.
Dans les segments élevés du marché le nombre
d'opérateurs importants ne dépasse pas le millier. Selon un
initié, la clientèle importante en matière de peinture du
XIX
ème
et du XX
ème
siècle -
c'est-à-dire celle susceptible d'acheter plusieurs fois par an des
oeuvres d'un prix supérieur au seuil du niveau international - se
répartirait de la façon indiquée dans le tableau
ci-dessous. Ces chiffres sont donnés comme des indications des rapports
d'importance entre les marchés européens et américains.
Opérateurs segment supérieur du marché (XIX e etXX e )
|
|
USA |
Europe |
Asie |
Total |
|
Personnes privées |
100 |
40 |
20 |
160 |
|
Professionnels |
50 |
50 |
10 |
160 |
|
Musées |
10 |
10 |
10 |
30 |
|
Total |
160 |
100 |
40 |
300 |
On voit que, selon ces informations relatives au marché du XIX ème XX ème siècles, qui représentaient en 1997 chez les deux grandes maisons de vente anglo-saxonnes, 1,28 milliards de francs, soit environ le tiers de leur chiffre d'affaires total, le centre de gravité du marché se trouve nettement aux États-Unis, pour ce qui est de la grosse clientèle 46( * ) .
(2) Les facteurs déterminants de la spécialisation
Comment
se répartit le marché des oeuvres de niveau international entre
les places ? Certes, on peut sans risque affirmer que ce sont
effectivement les vendeurs qui font la loi. Mais, quels sont les facteurs qui
déterminent leur choix ? Quel rôle jouent les maisons de
vente dans ce choix ?.
Pour simplifier, on peut dire que
les vendeurs tiendront compte des charges
mais aussi de la taille et du dynamisme du marché
. Le niveau des
charges est sans doute déterminant mais, il faut aussi faire entrer en
ligne de compte d'autres facteurs liés à l'offre, à la
demande ou à l'efficacité de l'intermédiation.
Pour qu'un marché soit dynamique et attire par un
phénomène de boule de neige des produits de l'extérieur,
il faut :
•
une demande intérieure soutenue
, c'est le cas des
États-Unis, depuis longtemps mais ce n'est pas suffisant ou en tous cas
ce ne l'a pas longtemps été dans la mesure où ce n'est que
récemment que New-York s'est imposé comme la place dominante du
marché mondial de l'art ;
•
une offre abondante
: de ce point de vue, tel est le cas
de la France et, pour l'art du XIX
ème
et
XX
ème
siècles, des États-Unis, qui ont non
seulement été parmi les premiers à découvrir
l'impressionnisme et toutes les avant garde qui lui ont succédé,
mais encore ont fini par accumuler des stocks considérables dans
beaucoup de compartiments du marché ;
• enfin, quand on a ni une offre abondante, ni une demande
particulièrement soutenue, on peut néanmoins développer un
marché " off shore ", tel est le cas de Londres, qui a pu
faire valoir
longtemps de coûts d'intermédiation faibles et une
efficacité commerciale forte
et donc un bon rapport qualité
du service/prix, même si ce ratio tend aujourd'hui à se
détériorer.
Toute l'histoire de ces trente dernières années est
marquée par un accroissement de l'efficacité commerciale et
technique des deux grandes maisons de vente anglo-saxonnes mais aussi par une
croissance encore plus rapide de leurs coûts d'intermédiation.
Londres est ainsi passé de 10 % à la charge du vendeur et aucun
frais acheteur au milieu des années soixante à l'instauration
d'un " buyer's premium " de 10 % en 1975 porté à 15 %
pour les lots d'une valeur inférieure à 300 000 francs en 1991,
tandis que les commissions vendeurs étaient dans la foulée en
1994 rendues plus rigides pour éviter le laminage des marges.
(3) Les chances de la place de Paris
Les
chances de Paris doivent s'apprécier en fonction de ces critères,
avec l'idée que, s'agissant de multinationales, l'efficacité de
l'intermédiation est équivalente quel que soit la place choisie
et que les frais doivent être mis en rapport avec l'état du
marché, tant du point de vue de l'offre que de la demande.
De ce point de vue, il faut sans doute distinguer les marchés pour
lesquels il y a une offre et une demande comme le mobilier Art déco ou
le livre, ou à certains égards comme le dessin ancien bien que la
tradition très forte à Londres et la croissance du marché
à New-York rende l'ascension de la place de Paris plus difficile.
Deux points en conclusion de ces analyses prospectives :
• le marché de la peinture impressionniste et de la
première moitié du XX
e
siècle reste largement
hors de portée, compte tenu du fait que la demande et sans doute une
bonne part de l'offre se trouve maintenant localisées aux
États-Unis ; cela signifie qu'en la matière, les ambitions
françaises ne peuvent se limiter qu'à des opérations
ponctuelles, des " coups " toujours possibles, mais qui sur le moyen
terme ne devraient pas peser en termes de chiffres d'affaires dans le partage
du marché global ;
• mais, mis à part ces très grosses ventes, rien n'est a
priori hors d'atteinte pour Paris : on a bien vu que la foire de
Maastricht s'est imposée dans un autre registre certes, mais qui prouve
que l'on peut encore développer des activités complètement
" off shore ", indépendamment de l'agrément du
séjour à Paris que tous les opérateurs se plaisent
à reconnaître.
Mais, la grande inconnue reste l'évolution de la concurrence et la
question de savoir si la montée des coûts de structures des deux
grandes maisons de vente laissera la place à des structures de ventes
légères aussi efficaces commercialement mais moins chères
que les deux majors du marché de l'art.

b) La logique mondiale des multinationales anglo-saxonnes et la place faite à Paris
Les
maîtres du jeu seront
, au-delà des vendeurs,
les
" majors " anglo-saxons qui arbitreront entre les places en fonction
d'une logique mondiale,
quoiqu'aient pu en dire les représentants
des deux grandes maisons de vente
.
Le représentant de la maison Christie's peut affirmer
:" La
stratégie de vente des maisons anglo-saxonnes est effectivement de
vendre à Paris. Nous essayons à la fois de convaincre les
interlocuteurs français et les maisons anglo-saxonnes que Paris et la
France ont un rôle important à jouer dans le domaine du
marché de l'art
. " ; mais il n'en reste pas moins que la
stratégie des maisons de vente est parfaitement internationale comme le
montre la tableau ci-joint sur la répartition géographique du
chiffre d'affaires de Christie's et comme en témoigne l'interview
donnée dans le Journal des arts d'avril 1999 par le nouveau co-directeur
de Sotheby's Europe, ancien directeur du London Commodity Exchange :
En réponse à la question, " Londres et New York sont
traditionnellement considérés comme les deux grands centres du
marché de l'art ; Cela va-t-il changer ? ", celui-ci affiche la
démarche de la grande maison de vente : "
Sotheby's est une
société internationale, et l'Europe est une partie
intégrante du marché de l'art mondial. Ce continent est à
la fois une mine d'objets et la source de nouvelles collections. La
stratégie de Sotheby's est d'étendre sa base d'activités
à travers l'Europe pour tenir compte des spécificité
régionales, comme elle le fait aux États-Unis et en
Grande-Bretagne. Nous sommes en train d'ouvrir de nouvelles salles de vente
à Paris, Amsterdam et Zurich. Toutes participeront à
l'activité internationale de Sotheby's, mais chacune devra être
légitimée par sa propre rentabilité.
"
A la question, " Aimeriez-vous voir la part européenne du
marché s'accroître aux dépens des États-Unis
? ", la réponse est nette :
" Non, mon
intérêt stratégique est un intérêt mondial. La
réussite de Sotheby's s'opère à l'échelle
internationale et dépend de l'essor de nos activités, à la
fois en Europe et aux États-Unis, et de nos investissements dans le
développement de notre réseau sur Internet..
. "
La réponse fournie à la question, " le marché de
Zurich tiendra-t-il compte des marchés suisse et allemand ? ", est
également sans ambiguïté : "
L'Allemagne compte
de nombreuses maisons de vente régionales. Sotheby's opère sur le
marché intermédiaire et supérieur ; notre salle de Zurich
suivra donc la même ligne, en laissant aux maisons locales l'organisation
des ventes d'oeuvres de moindre valeur. Zurich s'adressera au marché
local, suisse et allemand, mais sera également tourné vers
l'étranger, notamment si l'harmonisation de la TVA et l'introduction du
droit de suite sont conduites à leur terme au Royaume-Uni
. "
Enfin, la réponse à la question, "
Quand Paris ouvrira,
qu'y vendrez-vous ? " est non moins éclairante sur la
démarche de Sotheby's : " Nous ne sommes pas encore tout à
faire décidés. Naturellement, nous vendrons des biens
français. Pour nous, Londres et New York resteront les principaux
centres internationaux, les autres dépendront du dynamisme du
marché local
".
On ne peut être plus clair sur la logique mondiale qui présidera
à la spécialisation entre les différentes places du
marché de l'art. Toute la question est de savoir si la logique des
États peut encore s'imposer face à celles des multinationales.
*
* *
La
démarche du rapporteur consiste, pour apprécier les chances d'une
relance du marché de l'art en France, à se demander quel est dans
les évolutions le poids des facteurs structurels par rapport à
ceux relevant du cadre juridique et fiscal.
Il ne faut pas exagérer l'importance des facteurs fiscaux par rapport
aux évolutions économiques générales ; il ne
faut pas aussi se complaire dans l'évocation nostalgique d'une
suprématie, réelle certes mais dont nous sommes efforcés
de montrer les limites, ne serait-ce que, comme on l'a vu, les milliardaires
américains de la fin du siècle dernier et du début de ce
siècle n'achetaient pas ou peu en ventes publiques.
Mais cette démarche se veut aussi critique. Analysant un marché
mondial qui nous dépasse, le rapporteur a souhaité prendre un peu
de recul et ne pas considérer qu'en ce domaine comme dans d'autres, nous
avions le meilleur système, même si de façon
complètement incompréhensible pour nous, les autres s'obstinaient
à ne pas en reconnaître les mérites.
A cet égard, il faut admettre que la formule de M. Jacques Tajan, selon
laquelle " le système anglais a fait ses preuves mêmes pour
les aveugles " n'est guère contestable, indépendamment d'une
attitude générale ayant trop tendance à justifier une
absence de réglementation, qui ne serait en France qu'une loi de la
jungle inacceptable.
Si le présent rapport reprend nombre d'analyses et de propositions des
deux rapports précités, il s'en distingue par un zeste de
scepticisme sur la capacité à créer la
compétitivité et à offrir des garanties uniquement par des
règles de droit.
En particulier, si les deux grandes maisons de vente sont parvenues à
dominer le marché de l'art mondial sans offrir de garanties juridiques
explicites, c'est bien parce que les garanties de compétences
réelles qu'elles soient commerciales ou scientifiques, sont plus
importantes que toutes les assurances juridiques ou financières.
S'agissant du marché des oeuvres de niveau international, il est
optimiste voire illusoire, de croire qu'on va le rapatrier, même
partiellement, par des garanties juridiques ; les vendeurs - qui sont bien
conseillés ne serait-ce que par les experts des deux grandes maisons de
vente répugneront à proposer leurs biens sur un marché
trop contraignant, tandis que les acheteurs, à partir d'un certain
niveau de prix, sont non moins bien conseillés et savent que
l'acquisition d'une oeuvre d'art ancienne, notamment, comporte bien souvent une
part de risque.
Bref, un peu plus de pragmatisme à l'anglo-saxonne et un peu moins de
juridisme à la française dût notre fierté nationale
en souffrir quelque peu.
B. DES ATOUTS DIFFUS MAIS RÉELS
Les analyses les plus récentes des ressorts de l'investissement international soulignent le rôle des facteurs diffus dans ce qu'il est convenu d'appeler " l'attractivité " du territoire national. Le commerce de l'art ne fait pas exception à la règle.
1. Une tradition de curiosité, un pays "grenier de l'Europe"
Si la France est la patrie des chineurs, et des " petits " collectionneurs, c'est pour des raisons historiques bien précises qui trouvent leur origine dans les brassages résultant de la tourmente révolutionnaire et une division des patrimoines, qui, avec le temps, ont fait perdre leur " identité " à un grand nombre d'oeuvres. La France est plus que les autres pays une terre de découvertes qui en font le marché le plus excitant pour les amateurs.
a) Le trop petit monde des amateurs
L'importance de la France dans le microcosme des collectionneurs internationaux n'est pas proportionnelle au pouvoir d'achat de ses collectionneurs.
(1) Plus d'amateurs que de gros collectionneurs
Les
grands collectionneurs qui font l'activité des deux grandes maisons
anglo-saxonnes sont couramment évalués à moins de mille
personnes, tous secteurs confondus ; selon d'autres sources et avec toutes
les approximations que comporte ce genre d'évaluation, il n'y en aurait
en France qu'une cinquantaine, qui soient en mesure d'acheter plusieurs oeuvres
par an de niveau international.
En revanche, les amateurs y sont, semble-t-il, nombreux, bien que les avis
divergent sur ce point : tandis que les uns déplorent comme l'a
fait devant le rapporteur, M. Pierre Rosenberg, président directeur du
Musée du Louvre, que le " vice " de la collection soit peu
répandu en France, d'autres sont plus optimistes.
L'exposition
" Passions privées "
organisée en
1995 au Musée d'art moderne de la ville de Paris témoigne de la
vitalité du collectionnisme. Les organisateurs de l'exposition ont
visité 300 "
vraies collections à Paris surtout mais
aussi en province pour n'en retenir presqu'une centaine. Il est vrai que la
France ne " possède pas de ces collectionneurs leaders d'art
contemporain du type Panza (Italie) ou encore Ludwig (Allemagne)....Elle
possède par contre - et cette exposition en témoigne - beaucoup
de collectionneurs avisés, exigeants et intrépides, y compris
dans les expressions contemporaines les plus chaudes, symptôme d'une
attitude neuve de dynamisme et d'ouverture qui va dans le sens d'une
internationalisation affirmée
. "
Plus que dans tout autre pays, plus encore que l'Angleterre même, la
France est un pays de collectionneurs, comme le signalaient, non sans une
certaine raillerie, les frères Goncourt dans leur journal, à la
date du 7 décembre 1958 : "
la collection est entrée
complètement dans les habitudes et les distractions du peuple
français. C'est une vulgarisation de la propriété de
l'oeuvre d'art ou d'industrie réservée dans les siècles
précédents aux Musées aux grands seigneurs, aux
artistes
". Les deux frères, qui se disaient eux-mêmes
atteints de " collectionnite " aiguë et de
" bricabracomanie ", représentent l'archétype des ces
collectionneurs pas toujours fortunés qui font la richesse et
l'intérêt de beaucoup de collections publiques françaises.
La collection n'est pas dans notre pays toujours le fait de l'argent.
L'histoire de l'art regorge d'exemple de ces collectionneurs balzaciens
à la manière du cousin Pons, écumant les brocanteurs pour
y dénicher le chef d'oeuvre : Magnin - conseiller à la cour
des comptes à la pingrerie légendaire - ou plus lointainement le
docteur Lacaze qui pouvait aussi bien dépenser 16 000 francs or pour le
Gilles de Watteau que quelques louis pour la bohémienne de Franz Hals.
La tradition est conservée, notamment en matière de dessins
anciens ; elle montre que la notoriété de certains
collectionneurs français dépasse largement la valeur
monétaire de leur collection ; de même, le goût des
amateurs français est bien souvent à l'avant-garde comme le
montre l'exemple de certaines écoles du début du XIX
e
siècle, dont on vient de voir brutalement la cote exploser
à New-York, alors qu'elles sont depuis longtemps recherchées en
France.
(2) Les sociétés d'amis entre la loi des grands et des petits nombres
Il n'en
reste pas moins que par rapport à d'autres pays, la France ne
bénéficie pas pour ses musées d'un soutien de riches
" trustees ", analogue à celui dont bénéficient
les musées étrangers. Il suffit pour s'en rendre compte de
regarder la composition des conseils d'administration des associations d'amis
des musées pour constater que les hommes d'affaires n'y sont pas
légions par rapport aux " capacités ".
Beaucoup d'efforts ont été déployés par les
associations pour attirer du mécénat d'entreprises et des hommes
d'affaires. Mais leurs résultats limités traduisent, à
quelques exceptions tout à fait remarquables, un intérêt
plus faible qu'ailleurs des milieux d'affaires pour les Beaux-arts.
A côté des associations à caractère presque
confidentiel comme l'association des Amis du Musée national d'art
moderne - 1 millions de francs de budget et moins de 400 membres - ou celle des
amis d'Orsay, il faut faire une place à art au succès
exceptionnel de la société des amis du Louvre qui a su
bénéficier à plein de l'effet " Grand Louvre "
et qui compte aujourd'hui plus de 30 000 membres .
Si ce succès témoigne d'un réel intérêt pour
l'art dans une fraction croissante de la population, s'il permet de mobiliser
des ressources croissantes en faveur du budget d'acquisition, il ne faut pas se
faire trop d'illusion. Il y a là le résultat d'une conjonction
d'intérêts :
- de celui des adhérents qui bénéficient à la fois
de l'entrée gratuite ainsi que de divers autres avantages selon le
niveau de la cotisation, et d'avantages fiscaux ;
- de celui des musées qui trouvent le moyen de commercialiser ce qui
peut s'analyser comme des abonnements, tout en gardant le produit des ventes
pour des acquisitions qui peuvent être faites dans des conditions
avantageuses pour le musée.
Les conservateurs ne peuvent que trouver commode un système qui leur
permet de faire choisir les oeuvres dans des conditions de souplesse
particulièrement utiles, notamment quand il faut se décider
rapidement pour acheter en ventes, et qui les fait échapper pour ces
recettes indirectes aux prélèvement de la Réunion des
musées nationaux.
Ainsi même si le rapporteur reconnaît le rôle essentiel de
ces associations auprès des musées, il doit bien
reconnaître que, à bien des égards, elles fonctionnent
comme des démembrements de l'État, menant une action
d'intérêt public grâce aux privilèges que celui-ci
leur confère. On note que la puissance des amis du Louvre par rapport
à celle des amis d'Orsay vient en bonne partie de ce que
l'administration du musée n'a pas cherché à commercialiser
une carte " blanche " donnant l'accès gratuit illimité
comme celle du Musée d'Orsay.
Par ailleurs, il faut souligner en ce qui concerne la société des
amis du Louvre qu'elle joue également le rôle d'associations
d'usager, en relayant auprès des autorités des musées les
observations des adhérents sur le fonctionnement de l'institution,
même si dans la pratique ces derniers influent peu ou pas sur la
composition des instances dirigeantes - par l'effet notamment de l'absence de
limitation du nombre de pouvoirs pouvant être détenus par la
même personne.
Bref, on est assez loin d'un système anglo-saxon fondé à
la fois sur la place éminente des " trustees " et où le
rôle des associations d'amis est avant tout de mobiliser des
" volonteers " qui viennent suppléer le manque de personnel
permanent.
b) Un gisement convoité
La
France ne serait pas ce pays de chineurs, si le marché de l'art n'y
était pas plus propice que partout ailleurs à ce type
d'activité. Le patrimoine privé français est riche,
certes ; mais ce qui le distingue de celui de l'Angleterre ou de l'Italie,
à certains égards aussi abondant, c'est qu'il n'est pas
concentré dans un petit nombre de collections aristocratiques. De cette
dilution, de cet éparpillement, il résulte que les objets sont le
plus souvent perdus de vue et qu'ils peuvent réapparaître à
tout moment. C'est un
marché " imprévisible
",
comme l'a qualifié le président directeur du Louvre.
Il suffit pour s'en convaincre de lire ou d'entendre des experts marchands
raconter leur surprise, quand, dans les endroits les plus improbables, ils
découvrent des chefs d'oeuvres, tel un carton de tapisserie de Jules
Romain placé au plafond à la manière d'un plafond
peint ; quand les fonctionnaires en charge de la commission des
"trésors nationaux" voient surgir des Greuze sortis de nulle part,
absolument inconnus des conservateurs ; quand les amateurs et les
professionnels voient apparaître dans des ventes sans catalogues à
l'Hôtel Drouot des Poussin ou des Georges de la Tour. L'Hôtel
Drouot, il peut s'y passer tous les jours quelque chose, c'est un peu les puces
au coeur de Paris.
Effectivement, l'Hôtel Drouot, au-delà de son désordre
légendaire, est une sorte de caverne d'Alibaba, où chacun amateur
ou marchand espère trouver l'occasion unique. Ceux-ci échappent
parfois à l'oeil fatigué des experts mais extrêmement
rarement à ceux des marchands, " brocs " ou amateurs, qui
arpentent la salle des ventes : il est fréquent que des lots partis
à quelques milliers voire quelques centaines de francs finissent leur
course à des montants qui se comptent en centaines de milliers de
francs : ainsi, en 1997, a-ton vu un tableau catalogué être
mis à prix 20 000 francs - pour une estimation de 40 à 50 000
francs,- et finir à plus d'1,2 million de francs. L'oeuvre, d'un artiste
italien absent des collections françaises, est aujourd'hui à
Kansas City - . Ainsi, le marché rectifie-t-il presque toujours les
erreurs des experts. Ce qui est le signe que, la compétence tendant
à devenir de plus en plus répandue, la chasse aux objets est de
plus en plus difficile...
Les avis divergent sur l'importance des réserves
. Tandis que
certains pensent que celles-ci s'épuisent, d'autres estiment qu'elles
restent considérables.
Les deux grandes maisons de vente anglo-saxonnes alimentent largement leurs
ventes avec des oeuvres en provenance de France : une bonne partie - sans
doute
autour du tiers
, d'après les informations
communiquées au rapporteur -
des lots de la dernière vente de
tableaux anciens de Sotheby's New-York en janvier dernier proviendrait de
France
.
On comprend que les deux entreprises anglo-saxonnes, qui, non sans raison se
présentent parfois comme " les premières études de
France ", souhaitent s'installer en France tout autant pour trouver des
objets et pour entrer en contact avec de nouveaux clients que d'être
présent sur
un marché précurseur en matière
d'évolution du goût
.
2. Les atouts commerciaux
Comme dans d'autres domaines, un retard n'est jamais uniquement un handicap ; il est parfois un atout quand il permet aux talents de s'exprimer ou quand il permet d'éviter certaines impasses structurelles.
a) Les marchands
Au cours
de l'entrevue qu'il a eue avec le rapporteur, M. Pierre Rosenberg de
l'Académie française a souligné la part prise par une
dizaine de jeunes marchands de tableaux anciens dans le dynamisme du
marché de l'art à Paris.
Ce groupe témoigne
d'une conception ambitieuse du métier de
marchand
qui est à la fois
d'explorer de nouvelles
frontières du goût
et donc de faire découvrir et
apprécier aux amateurs de nouvelles écoles ou de nouveaux
artistes, et de
redonner
, grâce à l'acuité de leur
oeil,
leur identité à des oeuvres ayant perdu leurs
papiers
.
Une place à part doit être réservée à des
marchands dont la politique consiste à acheter et revendre en ventes
publiques
: ils achètent le plus souvent, dans des ventes sans
catalogues ou dans des ventes de province, des tableaux sans attribution ou mal
attribués, pour les revendre après avoir par tous moyens,
recherches d'archives ou comparaisons stylistiques, retrouvé leur
état civil véritable. Le plus important d'entre eux est connu sur
la place de Paris pour être un des grands pourvoyeurs de marchandises de
la maison Sotheby's dont il alimente les ventes de New-York.
Ces marchands, le plus souvent parisiens disposent d'un
réseau de
correspondants
en province
qui leur signalent les occasions
intéressantes, ce qui témoigne une diffusion très large si
ce n'est de compétences techniques du moins d'un certain sens de la
qualité, qui leur permet de jouer le rôle de guetteur.
b) L'Hôtel Drouot :une plate-forme commerciale sans équivalent
L'unicité de lieu de vente à Paris est une
pratique
coutumière très ancienne consacrée par un arrêt de
la Cour de cassation du 3 novembre 1982. Elle entraîne pour les
commissaires-priseurs l'obligation d'exercer leur ministère à
l'Hôtel Drouot ou dans un certain nombre de lieux
déterminés, sauf à en faire agréer d'autres par la
chambre de discipline
.
.
La suppression du monopole des commissaires-priseurs en matière de
ventes volontaires comme l'arrivée de Sotheby's et Christie's risquent
d'être fatale à l'Hôtel Drouot.
(1) Une institution désuète ?
C'est ce
qu'a fait savoir au rapporteur, en le regrettant, le président directeur
général du Louvre, tout en soulignant le " désuet "
de cette institution. Il a également souligné que le
système anglais
de ventes aux enchères était plus
rationnel et efficace que le système français :
95 %
des oeuvres ou objets importants sont concentrés sur deux expositions
par an et la vente a lieu effectivement 6 mois après
, alors qu'en
France, elle a lieu le lendemain, ce qui laisse très peu de temps pour
s'organiser, et que l'Hôtel Drouot requiert une fréquentation
quasi-quotidienne.
L'organisation de l'Hôtel Drouot est souvent critiquée, tant par
les utilisateurs que par certains commissaires-priseurs.
Ainsi, lors d'un colloque, intitulé quel avenir pour le marché de
l'art
47(
*
)
, un conservateur du patrimoine s'est
fait l'écho de l'insatisfaction, voire de la frustration des usagers,
qu'il s'agisse des conservateurs ou de ses " messieurs ", qui
défilent entre 12 heures et 13 heures 30 à l'heure dite des
banquiers :
"
A Drouot, vous arrivez à 11 heures, Drouot ouvre à 11
heures. Vous avez la journée pour voir les oeuvres. Je
m'intéresse particulièrement à la peinture. Vous avez des
tableaux accrochés à 3 mètres de haut que l'on ne voit
jamais. Vous avez des dessins qui sont encadrés que l'on n'arrive pas
à apercevoir. Vous avez des experts, des commissaires-priseurs qui sont
là -ou pas là. La journée se passe : à 18
heures, tout le monde s'en va. Le lendemain, vous pouvez voir les oeuvres dans
un capharnaüm épouvantable entre 11 heures et 12 heures. Puis
la vente se déroule aux alentours de 14 heures et vous achetez si
vous le désirez.
Comment cela se passe-t-il à Londres ? Vous avez eu 4 ou 5 jours
d'exposition. Vous avez le loisir lorsqu'il s'agit de dessins, par exemple, de
les consulter. Pour les tableaux, vous avez, à la disposition des
acheteurs éventuels, des escabeaux. Des experts vous indiquent
l'état de conservation. Il existe également un service
après-vente dans les maisons anglo-saxonnes. On n'en trouve pas dans les
maisons françaises. Aussi, deux ou trois jours après, vous pouvez
avoir le résultat de la vente avec la liste des oeuvres vendues et le
prix qu'elles ont atteint. En France, il faut attendre des semaines pour avoir
communication des résultats des ventes
48(
*
)
.
En conclusion, je constate simplement, en tant que conservateur du patrimoine,
qu'il y a, d'une manière générale, un plus grand
professionnalisme des maisons anglo-saxonnes. "
D'un autre point de vue, le plus important commissaire-priseur de la place,
Maître Jacques Tajan, plutôt sceptique sur l'avenir de
l'Hôtel Drouot, dénonce devant le rapporteur les modalités
de facturation des salles à l'hôtel Drouot, qui, parce qu'elles
dépendent du chiffre d'affaires réalisé, pénalisent
les commissaires-priseurs les plus dynamiques.
(2) Une restructuration indispensable
Face
à la concurrence des grandes maisons de vente anglo-saxonnes et à
leurs méthodes de ventes spécialisées, relativement peu
nombreuses et faisant l'objet d'une publicité préalable
adéquate, il y a place, à Paris, pour une structure comme
l'Hôtel Drouot mais à condition que celui-ci sache se
réformer.
Celui-ci constitue
une plate-forme idéale pour des ventes à
rotation rapide
, organisées sur un rythme régulier. Le rythme
actuel d'un jour d'exposition et d'un jour de vente, dès lors qu'il est
respecté, permet un chiffre d'affaires au mètre carré
appréciable, -les objets vendus sont moins chers mais les ventes plus
nombreuses - ; il assure une unité de lieu et une
régularité de rythme, très appréciées des
" habitués ",.
Il est essentiel de maintenir une plate-forme qui, si elle disparaissait,
aboutirait à une
dispersion des lieux de vente préjudiciable
aux vendeurs ;
c'est la présence d'amateurs des mondes voisins
de la Bourse et des banques qui assure la concurrence stimulante sans laquelle
le marché résisterait plus difficilement aux tentations des
ententes entre professionnels, soit qu'ils pratiquent la révision, soit
qu'ils achètent en commun.
Il est non moins certain que l'outil devra être adapté et les
salles réaménagées ; les rythmes devront, au moins
pendant les périodes consacrées à des ventes de prestige,
être ralentis de façon à permettre aux amateurs
occupés de voir les objets mis en vente, et le mode de facturation des
salles réformé.
Il est non moins évident que la survie de l'Hôtel Drouot est la
condition indispensable à la compétitivité des
sociétés de ventes volontaires, qui prendront la suite des
commissaires-priseurs actuels.
Faute d'un régime fiscal adapté, l'outil que constitue
l'Hôtel Drouot pourrait bien disparaître, entraînant avec lui
celle des études moyennes qui font la richesse et le dynamisme du
marché de l'art parisien.
C'est ce qu'a voulu éviter la commission des finances par les
amendements qu'elle a proposés, lors de la discussion du projet de loi
sur les ventes volontaires, pour aménager le régime fiscal des
offices obligés de se transformer en sociétés
commerciales
49(
*
)
.
Au moment où les maisons de vente anglo-saxonnes concentrent leurs
installations à New-York dans des complexes lourds de nature à
offrir des services diversifiés à leurs clients
50(
*
)
, il serait dommage de laisser disparaître un
outil qui peut encore être compétitif.
c) Enchères : des créneaux de compétitivité encore tenables
A côté des deux grandes maisons de vente aux enchères, il y a place pour d'autres types d'opérateurs, ne serait-ce que parce que les deux soeurs ennemies ne veulent et ne peuvent absorber l'ensemble du marché.
(1) la contre-offensive des structures légères
On a vu
que Sotheby's et Christie's formaient un
duopole très
compétitif en matière de services et de produits mais
fondamentalement coopératif sur les prix.
La montée en puissance et la conquête du marché mondial de
l'art par les deux grandes maisons de vente anglo-saxonnes a eu pour
contrepartie une baisse de leur rentabilité.
Cette
baisse tendancielle de leur rentabilité
est due à la
fois à des
coûts de structure croissants
- les deux firmes
doivent entretenir un nombre accru de représentations à travers
le monde, ainsi qu'un réseau toujours plus dense de correspondants, et
organiser des opérations de promotion toujours plus onéreuses -
et à une
concurrence acharnée pour attirer les vendeurs
.
Pour enrayer cette tendance
51(
*
)
et, à
chaque fois, pour faire face aux conséquences sur leur marché du
ralentissement de l'activité économique mondial, les deux grandes
entreprises ont été
amenées à augmenter, avec un
parallélisme remarqué, leurs commissions acheteur puis en 1994
à mettre simultanément un terme à la surenchère des
rabais sur les commissions vendeur en édictant des tarifs non
négociables
.
Au total, pour les oeuvres et objets d'art d'une valeur inférieure
à un seuil correspondant à 300 000 francs - qui constituent,
rappelons le, 80 % en nombre de lots des ventes de Sotheby's en 1997 -,
le
coût d'intermédiation est élevé, de l'ordre de 30
%,
si l'on additionne des frais acheteur et vendeur de base de 15 %.
Il y a donc effectivement des marges élevées qui pourrait
susciter l'apparition d'une concurrence par les prix
.
Les anciens commissaires-priseurs pourront-ils avec les nouvelles
sociétés de ventes volontaires venir concurrencer le
duopole ?
Cette éventualité doit être prise en considération
dans la mesure où les nouvelles structures seront conçues
dès leur création comme internationales - et associeront des
compétences de toutes nationalités - et qu'elles chercheront
à écrémer le segment le plus intéressant du
marché, en l'occurrence essentiellement la peinture du XIX
e
et du XX
e
siècles, sur les places les plus importantes,
Paris, New-York et Londres.
Le succès de ce type de structures légères
dépendra de l'importance des capitaux qu'ils sauront mobiliser mais
aussi de facteurs faisant entrer l'équation personnelle des
professionnels associés à l'entreprise
. Nul doute que des
structures, combinant le réseau de relations d'anciens
commissaires-priseurs avec ceux d'anciens experts des deux grandes maisons de
vente, ont des chances de réussir, à condition qu'elles
parviennent à obtenir une certaine
crédibilité et
visibilité internationales
.
Dans d'autres domaines comme les opérations de fusion acquisition, on
voit de petites structures cohabiter avec de grosses banques d'affaires,
dès lors que leur responsables ont le réseau de relations
suffisant pour trouver un courant d'affaires suffisant. Il n'est donc pas
impossible que l'on voie apparaître une concurrence de nature à
entamer la position dominante de Sotheby's et Christie's.
(2) Des positions fortes à certains niveaux de marché
Toutes
les analyses qui précèdent, permettent d'esquisser une
certaine
typologie des opérateurs
susceptibles de se partager le
marché avec
les deux majors anglo-saxonnes
.
Il y aura toujours
des
maisons de vente locales
dans tous les
pays et notamment en France, qui, par leur enracinement et la faiblesse de
leurs coûts, devraient rester compétitives moyennant quelques
regroupements.
Des
maisons de vente nationales
, en nombre beaucoup plus
limité qu'aujourd'hui, peuvent également prospérer,
notamment en France dès lors qu'elles bénéficient de bon
réseau et qu'elle sauront nouer
des alliances internationales
efficaces.
Les commissaires-priseurs, ont déjà pour affirmer leur
présence mondiale, très logiquement cherché à
développer des accords : M. Jacques Tajan est devenu en 1996 membre
de l'Association internationale des auctioneers aux côtés
notamment, de maisons de vente comme le Dorotheum de Vienne et Swann
Galleries de New-York ; PIASA a signé un partenariat avec la maison
anglaise Phillips ; tout récemment, l'étude Binoche a joint
ses forces à celles de Finarte Milan et Finarte Espagne pour organiser
conjointement deux fois par an des ventes d'artistes contemporains espagnols
français et italiens.
On pourrait ainsi voir s'affronter deux logiques d'organisation : les
réseaux intégrés des deux grandes compagnies
anglo-saxonnes
aux
réseaux partenaires des maisons de vente
nationales
.
Enfin, pourrait s'ajouter un troisième niveau
avec des petites
structures internationales
, dont le succès n'est pas évident
compte tenu des échecs qu'ont connu certaines tentatives comme celle
Habsburg-Feldman et dépendra en définitive de la capacité
des associés à convaincre les vendeurs qu'ils ont les
réseaux suffisants pour mobiliser la même clientèle que
Sotheby's et Christie's tout en leur offrant des conditions plus
avantageuses.
3. L'attrait de Paris
Bien
qu'il ne puisse plus prétendre être le pôle culturel
dominant, Paris conserve un attrait évident, au moins pour les acteurs
des marchés de l'art ancien et moderne.
Pour l'art contemporain, en dépit du succès de la FIAC, la
capitale est sans doute trop loin de New-York et trop concurrencée au
niveau régional par les autres manifestations européennes, comme
celles de Bâle et de Madrid, pour que l'attrait spécifique de
Paris puisse constituer un atout significatif.
a) Un pôle culturel majeur
Il
n'appartient pas à ce rapport de développer ce point. Celui-ci
est plus mentionné à titre de " pour mémoire "
et qui ne prétend pas se livrer à un recensement des atouts
culturels de la capitale française.
Notons simplement que, par une sorte de masochisme dont les Français ont
le secret, on a tendance à en sous-estimer les attraits. On oublie que,
si Paris n'est certes plus ce qu'il était, il reste
dans
l'ensemble
une concentration unique de qualité de vie et
d'activité créatives, même si dans certains domaines nous
sommes désormais concurrencés comme dans la mode ou
relégué au statut de zone périphérique
comme
en matière d'art contemporain.
Paris est une ville musée ; mais c'est aussi un lieu de vie, de
création et d'affaires. Là est toute la
différence.
b) Un haut lieu du tourisme international
L'étude menée par la fédération
britannique du marché de l'art fait état des dépenses de
28 milliards de francs émanant de touristes pour qui le marché de
l'art est une " raison très importante " de leur venue.
Le chiffre paraît considérable mais il tend à souligner que
les personnes attirées par le marché de l'art apportent des
revenus aux hôtels, restaurants et taxis dans des proportions importantes
pour Londres et sans doute non négligeables pour Paris.
Le rapporteur a rassemblé quelque chiffres relatifs à
l'importance économique du tourisme de luxe et au tourisme d'affaires en
ce qui concerne les foires et salons professionnels pour lesquels tient encore
la première place.
Paris, et la France en général, possède une
hôtellerie de luxe très puissante. Ainsi, a-t-on constaté
à Paris, en 1997, que les hôtels 4 étoiles et luxe ont
vendu plus de 5 millions de nuitées, soit une augmentation de plus
de 25 % par rapport à 1996.
52(
*
)
Les achats et la visite des musées correspondent aux motivations
principales des séjours dans ce qu'il est convenu d'appeler "l'espace
urbain" et plus encore pour Paris et l'Île-de-France.
Dans la capitale, certains grands magasins font près de 35 % de
leur chiffre d'affaires grâce aux achats des touristes étrangers.
On estime que les touristes en provenance des marchés lointains
consacrent près de 30 % de leur budget dans le seul secteur du
"shopping". Ces clientèles recherchent tout particulièrement des
activités culturelles, puisque les études de marché
montrent que pour les deux tiers d'entre eux, ils souhaitent visiter des sites
historiques et vouloir visiter des musées.
Il s'agit-là de chiffres très généraux mais qui
montrent l'importance du tourisme et que la vitalité du commerce de luxe
à Paris tient pour beaucoup aux dépenses des visiteurs
étrangers.
Paris et la Région parisienne c'est aussi, en 1997, 7,8millions de
visiteurs pour 350 salons dont 113 professionnels. Si certaines manifestations
sont de nature très techniques, d'autres, notamment en matière de
mode, apparaissent non dépourvues de liens avec la création et le
marché de l'art et sont donc de nature à créer des
synergies, qu'il faut exploiter.
C. L'ACCUMULATION DE HANDICAPS PONCTUELS
L'importance des facteurs structurels dans le déclin du marché de l'art conduit le rapporteur à considérer que, si des aménagements fiscaux sont nécessaires, compte tenu du différentiel de charge dont pâtissent les opérateurs français, diverses contraintes en limitent la portée. Elles risquent, à défaut d'une volonté politique affirmée, d'amoindrir les chances de la France de redevenir un pôle majeur du marché de l'art mondial.
1. La fiscalité et les charges
La
question n'est pas fondamentalement différente pour les oeuvres d'art et
pour les produits d'épargne : face à des consommateurs, bien
informés, bien conseillés, et donc très mobiles, il faut
être très attentif aux charges.
Sans nécessairement s'aligner sur le moins disant fiscal ou social, il
convient donc d'examiner les effets des prélèvements
effectués sur les oeuvres d'art sans a priori, même s'il est
difficile de mettre de côté les considérations
idéologiques.
L'oeuvre d'art est un bien de luxe ; c'est un
bien symbole,
qui est
le privilège des riches et qui ne peut dans un État comme la
France imprégné d'idéaux égalitaires, être
exonéré d'impôt. Et pourtant dans un marché mondial
l'oeuvre d'art se déplace vers le marché où la demande est
la plus forte et/ou la fiscalité la moins pénalisante.
Il y a un
différentiel de charge entre la France et les
marchés concurrents anglais américain et suisse. Mais,
objectivement, s'agissant d'estimer son effet du point de vue de
l'attractivité du marché français, ce différentiel
ne joue qu'à la marge
et est pour une part,
plus psychologique
que réel.
a) La taxe sur les plus-values : un régime comparativement favorable
Les
ventes d'objets d'art - comme celles de métaux précieux, de
bijoux, - sont soumises à une taxe forfaitaire proportionnelle au prix
de vente, tenant lieu d'imposition sur les plus-values, dont le régime
est fixé aux articles 150 V bis et suivants du CGI.
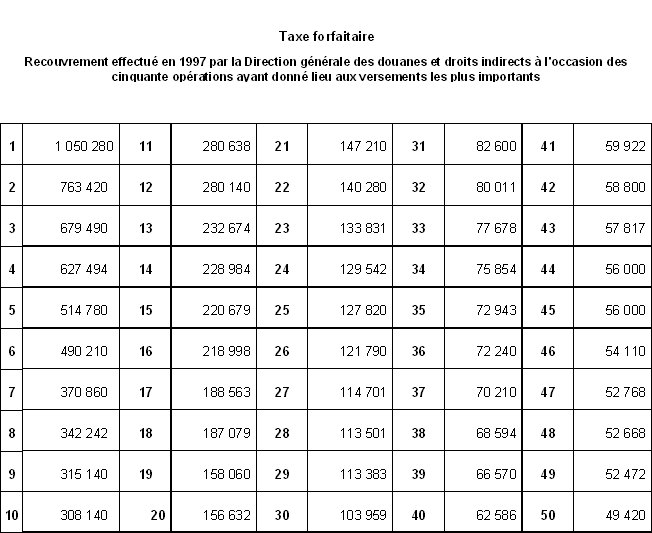 francs
francs
La taxe s'applique aux objets d'art et de collection
53(
*
)
- ainsi que les bijoux - d'une valeur
supérieure à 20 000 F (assorti d'un mécanisme de
décote jusqu'à 30 000 F),. Lorsque l'objet est exporté ou
non vendu aux enchères la taxe est de 7 contre 4,5 %, pour les ventes
publiques Il s'y ajoute, depuis le 1er février 1996, 0,5 point au titre
de la Contribution au remboursement de la dette sociale, CRDS, lorsque le
vendeur est domicilié en France.


La taxe est supportée par le vendeur particulier - y échappent
les professionnels et les non résidents - mais la responsabilité
du versement incombe à l'intermédiaire (marchand,
commissaire-priseur), ainsi qu'à l'exportateur en cas d'exportation.
Les personnes physiques ou sociétés de personnes qui
résident en France peuvent opter pour le régime de droit commun
des plus-values sur biens meubles lorsqu'elles cèdent ou exportent des
bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité et qu'elles sont en
mesure d'établir de manière certaine les dates et prix
d'acquisition (CGI, art. 150 V sexies).
La plus-value est alors déterminée suivant les règles
prévues aux articles 150 A et suivants du CGI. Elle est calculée
par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Pour
les biens cédés au-delà d'un an de détention, il
est tenu compte de l'érosion monétaire et de la durée de
détention (abattement de 5 % par année de détention
au-delà de la première). La plus-value est ainsi
exonérée à l'expiration d'un délai de
détention de 21 ans.
En ce qui concerne les oeuvres cédées par des artistes vivants,
il faut rappeler que la vente en France ou dans un autre État membre de
la Communauté européenne ou l'exportation des oeuvres
créées par l'artiste et faisant l'objet d'une
propriété continue
54(
*
)
depuis la
création est hors du champ d'application de la taxe. Le profit
réalisé constitue un bénéfice professionnel
imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Il faut souligner que ce régime est relativement favorable par rapport
à celui applicable tant en Grande-Bretagne qu'aux
États-Unis :
•
En Grande-Bretagne
, la plus-value est imposée au taux
marginal auquel est taxé le revenu annuel du vendeur. Le plus souvent,
ce taux s'élève à 40%. Elle est due par le vendeur sur la
vente de la plupart des oeuvres d'art vendues aux enchères, sauf celles
dont le prix est inférieur à 6.000 livres sterling, ou dont
l'espérance de vie ne dépasse pas 50 ans. Elle est
calculée sur la différence entre, d'une part, le produit de la
vente diminué des frais, et d'autre part, le prix d'achat originel
réactualisé pour tenir compte de l'inflation. Si l'oeuvre a
été acquise avant le 31 mars 1982, le prix d'achat pris en compte
consiste en la valeur de marché de l'oeuvre à cette date
réactualisée. L'impôt est dû par tout résident
sous réserve d'une franchise annuelle de 6800 livres
• Aux États-Unis , il y a deux types d'impôt sur les plus-values :
Au
Niveau Fédéral, pour les particuliers le taux de l'impôt
fédéral sur les plus values s'élève à 28%,
si le bien a été détenu pendant plus de 12 mois.
L'assiette est calculée en faisant la différence entre le prix de
vente et le prix d'achat actualisé ; pour les marchands, la
plus-value est traitée comme un élément de leur
bénéfice et est taxée au taux fédéral de
39% ; enfin, pour les sociétés, le taux de la taxe est de
35%,sauf si le bien fait partie de leur stock auquel cas il est taxé au
taux standard de l'impôt fédéral des sociétés.
Au niveau local, les plus-values sont taxées dans l'État de
résidence du vendeur à des taux variant entre 0 et 18 %.
On peut donc dire que la France est à cet égard - et pour une
fois dans une situation relativement favorable.
b) La TVA
La mécanique de la TVA joue à la fois contre le marché de l'art français et contre le patrimoine. Le phénomène est largement dénoncé par les professionnels en ce qui concerne la TVA à l'importation ; il est moins visible mais non moins réel en matière de TVA sur les marges.
(1) La TVA à l'importation
Jusqu'en
1991, l'importation des biens d'art en vue d'une vente publique aux
enchères était exonérée de TVA. La loi du 26
juillet 1991 a mis fin à cette exonération. La 7ème
directive européenne, adoptée à Bruxelles le 14
février 1994, a été transposée en droit
français par la loi du 29 décembre 1994, qui a confirmé
l'application de la TVA aux oeuvres d'art, des objets de collection ou
d'antiquité importés en France pour être vendus aux
enchères.
Le taux est de 5,5 % . Cette TVA n'est pas répercutée sur
l'acheteur. Elle est réglée à l'administration
douanière par le Commissaire-priseur. Quant à l'assiette de cette
taxe, elle est égale à la somme reçue par le vendeur,
augmentée de certains frais supportés à l'occasion de
l'importation.
La Grande-Bretagne a obtenu une dérogation lui permettant d'appliquer,
jusqu'au 30 juin 1999, aux importations des biens créés avant
1973, une TVA à taux réduit de 2,5%.
Il en résulte deux conséquences :
• Une nouvelle incitation, pour les vendeurs étrangers, à
choisir Londres plutôt que Paris et, plus généralement, les
États-Unis plutôt que l'Europe : à New-York,
s'applique une " sales tax ", très facile à esquiver,
puisqu'il suffit de faire livrer la marchandise dans les états voisins
qui ne la pratiquent pas ;
• Des risques de détournements de trafic entre Londres et Paris,
les objets ayant tendance pour bénéficier d'un
différentiel de 3 % de TVA à transiter par Londres avant,
éventuellement, d'arriver en France.
Il faut cependant nuancer ce handicap par le fait que, le plus souvent, les
biens destinés à être vendus aux enchères sont
introduits en France sous le régime de l'admission temporaire, d'une
durée maximale de deux ans, en suspension de taxes. En cas de
réexportation après la vente, aucune taxe n'est due.
Les commissaires-priseurs peuvent obtenir de l'administration douanière
des facilités pour n'avoir à verser dans ces cas qu'une fraction
de la somme qui serait due si l'acheteur se révélait être
un ressortissant communautaire.
La 7
ème
directive européenne autorise l'application
d'un taux réduit de TVA à l'importation sur les oeuvres d'art est
à l'origine d'une autre distorsion tenant au fait que certains objets
couramment vendus aux enchères ne font pas partie du marché de
l'art au sens de la directive
55(
*
)
. Les bijoux,
mais aussi les manuscrits et les meubles de moins de 100 ans d'âge, sont
soumis au taux normal de 20,6 %. Il en est résulté la
migration du marché des bijoux à Genève, ou le taux de TVA
applicable en la matière est de 6,5 %. ; autre exemple, le mobilier
Art déco sorti de France n'y reviendra pas avant longtemps, car
l'importation serait prohibitive !
Apparemment, la Grande-Bretagne est très déterminée
à éviter un alignement de son taux de TVA, dont la
première étape expliquerait, selon la Fédération
britannique du marché de l'art, une diminution de près de 40 % du
montant des importations britanniques d'oeuvres d'art.
(2) La TVA interne
La
septième directive qui règle notamment l'imposition à la
TVA des ventes et des importations d'oeuvres d'art, d'objets d'antiquité
ou de collection a été transposée par la loi
susmentionnée du 29 décembre 1994. Cette loi :
• consacre le régime de la marge comme le régime de droit
commun de ces transactions ;
• instaure, pour les échanges intra-communautaires un
système spécifique qui déroge aux règles
habituelles de taxation dans la mesure où il prévoit que les
ventes effectuées par les marchands - dits assujettis revendeurs, par
opposition aux autres entreprises assujetties mais dont le métier n'est
pas de faire le commerce de l'art - sont imposées dans les pays
d'origine et non dans le pays destinataire, quelle que soit la qualité
de l'acheteur (professionnel ou particulier) ;
• réserve à certaines opérations - et notamment aux
importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité,
ainsi qu'aux ventes d'oeuvres d'art par l'artiste ou ses ayants-droit -
l'application d'un taux réduit de TVA égal à 5,5%. Ce qui
revient à dire, à contrario, que les transactions
effectuées dans notre pays par des professionnels sont imposées
au taux normal (20,6%) sans qu'il soit fait de différence entre celles
qui portent sur des oeuvres d'art et celles qui s'appliquent à des
objets de collection ou d'antiquité.
Le principe général est que la base d'imposition est
constituée par la marge bénéficiaire. En effet, sont
soumises de plein droit au régime de la marge :
• d'une part, "les livraisons de biens achetés auprès d'un
non redevable", c'est-à-dire notamment les ventes effectuées par
un professionnel des oeuvres, des objets qu'il a acquis auprès d'un
particulier ;
• d'autre part, "les livraisons de biens achetés auprès
d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA au titre
de cette livraison". Il s'agit des ventes d'oeuvres d'art ou d'objets que les
marchands ont achetés auprès des artistes
bénéficiant de la franchise en matière de TVA
56(
*
)
ou auprès d'autres professionnels qui, eux
aussi, appliquent le système de l'imposition sur la marge.
Par ailleurs, les professionnels peuvent demander à
bénéficier du régime de la marge lorsque les oeuvres, les
objets qu'ils vendent ont été importés en provenance d'un
pays extérieur à la Communauté.
Dans la plupart des cas, les professionnels usent de la possibilité qui
leur est ainsi offerte d'acquitter la TVA sur la marge, même s'ils ont
toujours la possibilité d'adopter le régime
général, c'est-à-dire acquitter la TVA sur le prix de
vente total et à déduire la taxe supportée lors de l'achat.
Ils peuvent calculer cette marge de trois façons : soit "au coup par
coup"; soit globalement pour une période donnée; soit
forfaitairement, en appliquant un taux de marge
déterminé.
(a) Le calcul de la marge "au coup par coup"
L'expression "au coup par coup" signifie que la marge est
calculée opération par opération. La base d'imposition est
alors constituée de la différence entre le prix de vente
demandé par le marchand et le prix d'achat du bien en question.
Seules les opérations bénéficiaires supportent la taxe.
Mais ce système a l'inconvénient de ne pas permettre de compenser
la marge positive obtenue sur une bonne opération par la moins-value
réalisée sur une opération déficitaire.
(b) La globalisation des achats et des ventes
Jusqu'alors, cette possibilité de globalisation n'était pas prévue par la loi. Mais l'administration admettait qu'elle soit pratiquée par les marchands. Elle consiste à retenir, pour déterminer la base de l'imposition, l'ensemble des achats et des ventes réalisés au cours d'une période déterminée (qui est normalement d'un mois). La marge globale est alors égale à la différence entre le montant total des ventes et le montant total des achats effectués au cours de la période considérée. Lorsque le chiffre des achats dépasse celui des ventes, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Desrégularisations sont effectuées en fin d'année en fonction des variations du stock.
(c) La marge forfaitaire
La
possibilité d'adopter une marge forfaitaire égale à 30% du
prix de vente est offerte aux marchands dans deux cas :
• lorsque le prix d'achat n'est pas significatif : l'administration admet
que tel est le cas lorsque l'oeuvre d'art a été acquise depuis
plus de six ans;
• lorsqu'il s'agit de galeries effectuant des actions de promotion,
c'est-à-dire, pour reprendre les termes de l'administration, lorsque ces
actions se traduisent notamment par l'organisation de foires, manifestations,
expositions temporaires ou permanentes effectuées en France ou à
l'étranger. Elles peuvent concerner des oeuvres d'un même artiste
(mort ou vivant), des oeuvres appartenant à un courant (par exemple,
impressionnisme), ou des oeuvres regroupées autour d'un même
thème".
Ces critères sont donc assez larges. La plupart des marchands d'art
moderne, ainsi que nombre d'antiquaires,peuvent bénéficier du
système de la marge forfaitaire pour l'ensemble de leurs ventes
d'oeuvres d'art
57(
*
)
. Les assujettis qui
appliquent ce régime d'imposition ne peuvent pas déduire la TVA
en amont et ne doivent pas facturer la TVA au titre des ventes
concernées.
c) Le droit de suite
Ces droits perçus au profit des artistes, sont ressentis par les opérateurs du marché de l'art comme des taxes, bien qu'il faille dans leur finalité les rattacher à la famille des droits d'auteurs.
(1) Historique
Le
droit de suite
, apparu en France en 1920 dans un but de
solidarité et de justice à un moment où les artistes ne
bénéficiaient pas de la sécurité sociale, s'est
étendu progressivement à la plupart des pays d'Europe, puisqu'on
le trouve
dans 8 des 15 pays de l'Union Européenne
.
On peut rappeler la genèse de ce droit : en 1893, l'avocat Albert
VAUNOIS publia un article dans la "Chronique de Paris" défendant la
cause des artistes en soulignant que les écrivains, les musiciens
touchaient des droits d'auteur lorsque leurs oeuvres étaient
éditées, représentées, jouées, tandis que
les artistes n'avaient guère l'occasion d'en percevoir lorsque leurs
peintures, leurs sculptures étaient reproduites.
A l'époque, la jurisprudence considérait, en effet, que le droit
de reproduction était "attaché" aux oeuvres d'art et que, de ce
fait, il était cédé en même temps que celles-ci.
Un célèbre dessin de FORAIN, exécuté dans les
premières années du XX
ème
siècle,
illustre bien la vision très romantique de l'artiste et de la
création qui a conduit à l'instauration de ce droit : La
scène se passe à l'Hôtel des Ventes. Des messieurs, en
chapeaux hauts-de-forme, regardent une peinture. Au premier plan, deux enfants
en haillons dont l'un dit à l'autre : "Un tableau de papa".
Le message de ce dessin était parfaitement clair : les artistes sont
amenés à céder leur production à bas prix,
lorsqu'ils ne sont pas encore connus, sans que, lorsque leur jour de gloire est
arrivé, ils puissent bénéficier - directement ou par
l'intermédiaire de leurs héritiers - des prix
élevés que leurs oeuvres atteignent.
Ces préoccupations sociales aboutirent au vote de deux lois :
• la première en date du 9 avril 1910 précisait que, sauf
clause contraire, la vente d'une oeuvre n'entraînait pas cession du droit
de reproduction ;
• la seconde en date 20 mai 1920 créait le droit de suite, qui a
été repris dans la loi de 1957 et qui se trouve dans le code de
la propriété intellectuelle.
La loi de 1920 instituait pour une durée de cinquante ans après
la mort de l'artiste, un droit qui comportait un taux progressif allant de 1
à 3% .
On note que ce droit, qui ne concernait que les oeuvres originales et
représentant une création personnelle de l'auteur
58(
*
)
ne s'appliquait qu'aux oeuvres qui passaient en vente
publique.
Il était en outre transmissible par l'artiste, à ses
héritiers et ayants-cause, y compris les légataires.
Le régime actuel, tel qu'il résulte de la loi du 11 mars 1957,
comporte une série de différences importantes avec le texte de la
loi de 1920.
D'abord, le droit est applicable aussi bien aux ventes en galerie qu'aux ventes
aux enchères ; ensuite, le taux est porté au montant uniforme de
3% ; enfin, les légataires sont expressément exclus du
bénéfice du droit de suite.
Mais, l'extension aux ventes en galerie n'a jamais été
appliquée. Le décret, qui aurait dû préciser les
conditions dans lesquelles les galeries s'acquitteraient du droit de suite,
n'est toujours pas paru, ce qui a fait que les galeries n'ont jamais
versé ce droit.
Une des sociétés de recouvrement du droit se suite, la SPADEM,
aujourd'hui disparue
59(
*
)
, et en
difficultés financières s'est émue de cette situation.
En juillet 1990, elle a adressé une demande au gouvernement, lui
demandant de faire paraître le décret prévu par la loi de
1957. Face au silence du Gouvernement, la SPADEM a saisi le Conseil
d'État pour obtenir l'annulation de la décision implicite de
rejet . Celui-ci condamna effectivement l'État en avril 1993. Mais le
décret n'est toujours pas sorti...
(2) Le problème des galeries
Les
galeries d'art ont toujours protesté contre l'extension du droit de
suite au commerce privé d'oeuvres d'art. Elle font en effet valoir
que :
• elles ont accepté de participer au financement du régime
de la sécurité sociale des artistes pour ce qu'il est convenu
d'appeler la "part patronale" ;
• elles font un travail de promotion des oeuvres des artistes, qui se
traduit par la constitution des stocks lourds, qui devraient les dispenser
d'une telle charge.
A l'appui de leur position, les galeries soulignent également que le
système allemand, qui comporte effectivement un droit de suite, se
révèle plus favorable.
Le régime applicable en Allemagne aux galeries est le suivant : en
principe, ils ont 5% de droit de suite et 7% de cotisation à
sécurité sociale. Mais ils ont conclu un accord avec une
société, la "Bilkunst", qui représente les artistes.
Dans ce cadre, les galeries allemandes versent à cette
société un montant égal à 0,8 de leur chiffre
d'affaires. Ce versement tient lieu à la fois du droit de suite et de
cotisation à la sécurité sociale.
(3) Les ventes publiques et le problème de compétitivité internationale
Dans la
perspective de ce rapport, il convient seulement de souligner qu'il n'est
perçu ni à Londres, ni à New-York.
Il en résulte une nette tendance à la concentration des ventes
d'art contemporain vers ces deux places, qui vient, au moins pour la seconde,
accentuer l'attraction d'un marché américain déjà
dominant du fait de l'importance de ses artistes et du nombre et de la richesse
de ses collectionneurs.
(4) Les chiffres du droit de suite
Comme le
montre le tableau ci-dessous, les sommes perçues au titre du droit de
suite sont variables avec la situation du marché.
L
a Société des Auteurs Arts Graphiques et Plastiques - ADAGP -
assure, sauf pour quelques grandes familles d'artistes, la perception du
droit de suite.
Ses coûts de gestion sont d'environ 20 %,des sommes
récoltées, comme l'a indiqué devant le rapporteur M.
Jean-Marc Gutton, son directeur général.
PERCEPTIONS DROIT DE SUITE 1988-1998
FRANCE ET ÉTRANGER
|
|
France |
Étranger |
Total |
|
1988 |
22.000.000 F |
|
|
|
1989 |
47.000.000 F |
|
|
|
1990 |
79.000.000 F |
|
|
|
1991 |
26.000.000 F |
|
|
|
1992 |
12.000.000 F |
1.800.000 F |
13.800.000 F |
|
1993 |
13.000.000 F |
2.000.000 F |
15.000.000 F |
|
1994 |
14.000.000 F |
3.500.000 F |
17.500.000 F |
|
1995 |
10.000.000 F |
3.000.000 F |
13.000.000 F |
|
1996 |
11.000.000 F |
2.200.000 F |
13.200.000 F |
|
1997 |
11.200.000 F |
2.700.000 F |
13.900.000 F |
|
1998 * |
14.500.000 F |
3.000.000 F |
17.500.000 F |
* dont 3
millions vente Dora Maar/Picasso
En ce qui concerne, la répartition du droit de suite, il est difficile
d'avoir des chiffres très précis ; selon les informations
qui ont été fournies au rapporteur, les produits moyens
perçus par les bénéficiaires se répartissent de la
façon suivante :
Pour l'année 1996, sur 2490 bénéficiaires
:
• 38 auteurs (1,5 % des bénéficiaires) ont reçu
3.300.000 F (soit 30% du droit de suite) ;
• 250 auteurs (10 % des bénéficiaires) ont reçu
3.300.000 F (soit 30% du droit de suite) ;
• 2200 auteurs (88% des bénéficiaires) ont reçu
4.400.000 F (soit 40% du droit de suite).
Pour 1'année 1997, sur 2650 bénéficiaires :
• 39 auteurs (1,5 % des bénéficiaires) ont reçu
3.360.000 F (soit 30% du droit de suite) ;
• 270 auteurs (10,2 % des bénéficiaires) ont reçu
3.360.000 F (soit 30% du droit de suite) ;
• 2341 auteurs (88,34 % des bénéficiaires) ont reçu
4.480.000 F (soit 40% du droit de suite).
De tels chiffres ne permettent guère, faute d'informations
complémentaires, de se faire une idée sur le bien fondé de
tous ceux qui comme beaucoup de galeries, estiment que les personnes qui
perçoivent le droit de suite sont par définition des personnes
d'une certaine notoriété, qui en général n'en n'ont
pas besoin. En revanche, ils suffisent à démontrer l'inexactitude
de l'idée selon laquelle l'essentiel de ce prélèvement
irait à une dizaine de familles d'artistes.
d) Le droit de reproduction
Le droit
de reproduction résulte de l'article L122-3 du code de la
propriété intellectuelle, qui prévoit que l'auteur
perçoit une rémunération à l'occasion de la
reproduction autorisée de son oeuvre.
Le problème des reproductions d'oeuvres d'art dans les catalogues de
ventes s'est posé il y a quelques années quand le titulaire du
droit de reproduction de l'oeuvre d'Utrillo, a intenté une action en
justice contre Maître Loudmer, pour avoir reproduit sans son autorisation
deux peintures de l'artiste.
Dans un premier temps, le Tribunal de Grande Instance de Paris a admis dans un
jugement en date du 8 avril 1997 que la reproduction d'un tableau dans un
catalogue de vente devait être tenue pour une " courte
citation ",au sens de l'article 47.3 de la loi du 11 mars 1957, n'exigeant
pas l'autorisation de son auteur, dès lors que l'oeuvre en cause
était " reproduite à seule fin d'information des
acquéreurs éventuels et dans une présentation exclusive de
tout autre usage " ......
En appel, la première Chambre de la cour d'appel de Paris confirma le 20
mars 1989, le jugement du tribunal. Or concurremment, la 4ème Chambre de
la même cour adopta, en juillet 1989, toujours sur une plainte du
titulaire des droits d'Utrillo, une position inverse, condamnant les grandes
maisons de vente anglo-saxonnes, Sotheby's et Christie's, pour
contrefaçon.
En cassation, dans deux arrêts rendus le même jour le 22 janvier
1991, la juridiction suprême a décidé que "la reproduction
intégrale" d'une oeuvre d'art dans un catalogue de vente "ne pouvait en
aucun cas s'analyser comme une courte citation". Elle a donc confirmé la
décision rendue contre les maisons anglo-saxonnes et cassé
l'arrêt prononcé en faveur de Me Loudmer.
Mais le feuilleton judiciaire continuait, car la cour de Versailles devant
laquelle a été renvoyée l'affaire Loudmer, refusa de
s'incliner devant la cour de cassation. Elle a persisté à
considérer dans un jugement en date du 20 novembre 1991, qu'une
reproduction dans un catalogue de vente pouvait être assimilée
à une courte citation, dans la mesure où cette reproduction
"adopte notamment quant aux dimensions un format assez réduit pour la
ravaler au rang de la simple allusion ou, à tout le moins, de partie
d'un tout de référence qui est l'oeuvre elle-même".
Cet arrêt a été cassé par l'assemblée
plénière de la Cour de cassation (5 novembre 1993).
L'affaire n'aurait eu qu'une portée limitée si les
sociétés de perception ne s'étaient cru obligées de
demander aux maisons de vente anglo-saxonnes des droits de reproduction pour
ceux de leurs adhérents, dont les oeuvres avaient été
publiées dans différents catalogues de vente (diffusés en
France).
L'ADAGP a trouvé un terrain d'entente avec Sotheby's mais pas avec
Christie's, dont le refus d'obtempérer s'appuie sur des
considérations de droit communautaire
60(
*
)
.
Il faut toutefois souligner que la société des auteurs dans les
arts graphiques et plastiques - ADAGP- qui revendique un droit de reproduction
sur les oeuvres reproduites dans les catalogues des maisons de vente
anglo-saxonnes a clairement fait savoir qu'elle ne revendiquait pas le paiement
de ce droit pour les publications des opérateurs payant le droit de
suite en France
61(
*
)
.
On note que, pour l'instant,
il n'est pas prévu de maintenir en
faveur des sociétés de ventes volontaires l`exception
prévue par l'article 17 de la loi du 27 juin 1997 en faveur des
commissaires-priseurs pour leur catalogue mis à la disposition du public
" dans le seul but de décrire les oeuvres mises en
vente ".
Ainsi, devrait prendre fin " par le haut " la
discrimination dont pâtissaient les galeries d'art, tout en laissant
subsister un problème de charge pour l'ensemble du marché
français.
e) L'ISF, l'éternelle menace
Tel le
phénix, la menace de l'inclusion des oeuvres d'art dans l'assiette de
l'impôt sur la fortune ne cesse de renaître.
Les députés socialistes de la commission des finances de
l'Assemblée nationale ont proposé, lors de l'examen de la
dernière loi de finances, d'assujettir les oeuvres d'art à
l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Les partisans de la mesure en font d'abord une question de principe : " un
bon impôt, c'est-à-dire un impôt bien accueilli par
l'opinion, ne peut souffrir que très peu d'exonérations ou
d'abattements particuliers. Pour qu'un prélèvement ne suscite pas
une réaction légitime de rejet, il faut qu'il soit juste,
c'est-à-dire qu'il s'applique également à tous les
contribuables concernés "... Il s'agirait de pallier un " vice
congénital " de l'ISF qui est une " assiette très
étroite, pesant quasi exclusivement sur l'immobilier, et par contrecoup
ses taux d'imposition sont trop élevés "
62(
*
)
.
En fait cette proposition reprenait une suggestion du rapport du Conseil
national des impôts de juin 1998.
Sur le fondement d'une argumentation mettant en avant l'étroitesse de
l'assiette, le Conseil note que l'exonération des oeuvres d'art peut
" apparaître comme favorisant les détenteurs de patrimoine
important ".
Considérant, toutefois que l'imposition de ces biens poserait aux
services fiscaux des problèmes pratiquement insolubles
d'évaluation et de contrôle et que la suppression de
l'exonération risquerait aussi de perturber la "nécessaire
modernisation du marché de l'art français", le Conseil des
impôts suggérait d'inclure les oeuvres d'art et les objets de
collection dans l'assiette de l'ISF, tout en simplifiant et en forfaitisant
leur imposition, en proposant d'inclure les oeuvres d'art et les objets de
collection dans le forfait mobilier fixé à 5% de la valeur du
patrimoine.
L'argumentation se retrouve encore dans les propositions du
député apparenté communiste, Jean-Pierre Brard qui dans le
cadre de sa mission sur " La fraude et l'évasion fiscale "
envisage de rouvrir le débat sur l'impôt sur la fortune, qui
présente selon lui
" une assiette trop étroite, des taux
relativement élevés, un niveau parfois confiscatoire et cependant
un rendement modeste "
en préconisant en contrepartie un
élargissement de la base, notamment aux oeuvres d'art.
La commission des finances de l'Assemblée nationale, peut par rapport
à ce projet faire état d'un certain nombre
d'assouplissements : D'abord, elle a abaissé le plafond de 5 %
à 3 %. Ensuite, elle a suggéré d'exonérer les
contribuables exposant leurs oeuvres au public pendant six semaines par an,
ainsi que les oeuvres dont le créateur est encore vivant.
En dépit des interventions de Mme Catherine Trautmann
63(
*
)
et de M. Jack Lang
64(
*
)
, l'Assemblée nationale avait voté en
première lecture la suppression de l'exonération avant de
s'incliner devant le Gouvernement en seconde délibération. Le
Premier Ministre ayant tranché en faveur du maintien de
l'exonération des oeuvres d'art, dont la taxation n'aurait
rapporté que 280 millions pour un ISF censé rapporter 15
milliards l'an prochain, une mission parlementaire devant toutefois
réexaminer la fiscalité du marché de l'art.
2. L'instabilité liée aux interventions de l'administration
S'agissant du patrimoine national, il est normal que l'État dispose de prérogatives régaliennes. La France n'a pas bonne réputation ; mais aujourd'hui, elle est sans doute moins protectionniste que la Grande-Bretagne et c'est avec cette dernière que les grands collectionneurs du moment comme le Musée Getty, ont eu le plus de difficultés pour faire aboutir leurs achats, comme l'a montré l'affaire des Trois Grâces de Canova 65( * ) .
a) Le contrôle des "trésors nationaux"
De 1941 à 1992, la France a efficacement et à moindres frais, protégé son patrimoine artistique vis-à-vis de l'extérieur grâce à la réglementation douanière, issue de la loi du 23 juin 1941.
(1) L'ancien régime
Les
caractéristiques de ce régime étaient les suivantes :
• un champ d'application extrêmement large incluant tous les
objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art,
antérieurs à 1900 (tableaux) ou à 1830 (ameublement) ;
• une procédure articulée sur la déclaration
fournie à la douane par l'exportateur -, d'une part, cette
déclaration déclenchait la procédure conduisant
l'administration de la culture à délivrer ou à refuser
l'autorisation d'exportation; d'autre part, elle fixait une valeur sur la base
de laquelle l'État, pendant un délai de 6 mois, pouvait retenir
l'objet. Dans le cas où l'autorisation était
délivrée, cette valeur servait d'assiette à un droit de
douane de 5%.
Concrètement, l'administration avait dans ces conditions trois
possibilités
:
•
soit refuser
purement et simplement
la sortie
d'une
oeuvre,
en se fondant essentiellement sur la loi du 23 juin 1941 - et
accessoirement sur le décret du 30 novembre 1944 -, à condition
que l'oeuvre en question n'ait pas été importée
régulièrement ;
•
soit
"retenir" l'oeuvre
, c'est-à-dire
l'acquérir au prix déclaré par l'exportateur, en
s'appuyant également sur la loi du 23 juin 1941, c'était le droit
dit "de rétention" ;
•
soit
la
classer "monument historique
" - ce qui, par le
fait même, en interdisait l'exportation définitive - en vertu de
la loi du 31 décembre 1913.
(2) Les nouvelles règles du jeu
La mise
en place par l'Union européenne d'un marché unique à
compter du ler janvier 1993 a rendu nécessaire la révision d'un
mécanisme efficace et peu coûteux.
Premièrement, parce qu'en ce qui concerne les échanges intra-
communautaires, il n'y avait plus matière à déclaration ni
par conséquent à un quelconque droit de douane ;
Deuxièmement, parce qu'en ce qui concerne les échanges extra-
communautaires, puisque l'union européenne constituait désormais
un territoire douanier unique et qu'une procédure douanière
harmonisée s'imposait en conséquence. Tel fut l'objet du
règlement (C.E.E) n°3911/92 du Conseil des communautés
européennes en date du 9 décembre 1992 concernant l'exportation
de biens culturels.
C'est la loi du 31 décembre 1992 qui en a tiré les
conséquences en modifiant le régime de circulation des oeuvres
d'art.
Les nouvelles dispositions s'appuient sur deux principes posés par les
textes communautaires : d'une part, l'exception admise par l'article 36 du
Traité de Rome à la libre circulation des marchandises à
l'intérieur de l'espace européen, exception qui trouve sa
justification dans la "protection des trésors nationaux" ayant une
valeur artistique, historique ou archéologique" ; d'autre part, le fait
que la Communauté constitue une union douanière et que, partant,
elle applique un régime commun aux exportations vers les pays tiers.
Pour définir les" trésors nationaux" -la Commission
Européenne avait eu quelques velléités de préciser
cette notion - les pouvoirs publics se sont montrés très
pragmatiques, en estimant que trois catégories de biens culturels
devaient être obligatoirement rangés parmi les "trésors
nationaux".
• ceux qui font partie des collections nationales ;
• ceux qui sont ou qui seront classés monuments historiques ;
• ceux pour lesquels on a refusé la licence d'exportation ou pour
lesquels on refuse le certificat.
Le certificat constitue, la pierre angulaire du nouveau dispositif. Il s'agit
d'une sorte de "passeport" - qui n'est exigé qu'au dessus de certains
seuils de valeur - garantissant que l'oeuvre en question n'est pas
considérée comme un trésor national et qu'elle peut donc
quitter librement le territoire français.
Il remplace la licence d'exportation - du moins lorsque l'oeuvre d'art quitte
la France à destination d'un des pays de la Communauté ; en
revanche, lorsqu'elle est exportée vers un pays tiers, elle doit
être également munie d'une autorisation d'exportation étant
entendu que, dès l'instant où elles ont reçu le
certificat, elles obtiennent automatiquement l'autorisation.
Pour résumer, les différences entre le certificat et l'ancienne
licence sont les suivantes :
1. la licence était exigée, quelles que soient la nature et la
valeur du bien ; le certificat n'est obligatoire que pour les oeuvres
appartenant à des catégories déterminées et, dans
la plupart des cas, ayant une valeur supérieure à certains seuils
de valeur : 1 million de francs pour les tableaux, 350 000 francs
pour les sculptures, objets de collection, meubles anciens...,100 000
francs pour les dessins, estampes, photographies aucun seuil de valeur pour les
archives et les objets archéologiques.
2.
la licence devait être demandée au moment de l'exportation
; le certificat peut l'être à tout moment Ainsi un
commissaire-priseur est-il en mesure de savoir, avant une vente, si une oeuvre
peut quitter la France
.
3. la licence était valable pendant six mois tandis que le certificat
l'est pendant cinq ans.
4. Le nouveau système institue une commission, actuellement
présidée par M. André Chandernagor, composée de
représentants de l'État, et comportant deux professionnels du
marché de l'art, qui doit donner son avis lorsqu'un refus est
envisagé, ce qui permet un débat contradictoire.
5.
La licence pouvait être refusée autant de fois qu'elle
était demandée. Il n'en va pas de même s'agissant du
certificat. Le propriétaire de l'oeuvre d'art qui s'est vu refuser une
première fois le certificat peut, après trois ans, adresser une
nouvelle demande à l'administration. Celle-ci n'a alors d'autre choix,
si elle considère que l'oeuvre en question ne doit pas quitter la
France, que de l'acquérir ou de la classer monument historique, avec le
risque de devoir verser une indemnité au propriétaire
.



En
effet, l'application depuis le 31 décembre 1992 de la nouvelle
législation relative aux "trésors nationaux" fait l'objet d'un
bilan contrasté.
D'une part, le marché n'a pas été affecté par le
changement de législation - ce que confirment les éléments
statistiques fournis par la direction générale des douanes
à l'Observatoire des mouvements internationaux d'oeuvres d'art.
Mais, d'autre part, la nouvelle procédure de contrôle,
initialement prévue pour protéger le patrimoine national, ne
permet que difficilement à l'État des maintenir sur le territoire
français les oeuvres les plus importantes de notre culture.
(3) Un bilan contrasté
Les
principaux problèmes posées par la législation de 1992
sont les suivants :
1) Le refus de certificat n'est valable que trois ans. A l'issue de ces trois
ans, si le trésor national, interdit de sortie n'a pas fait l'objet,
soit d'une acquisition, soit d'un classement au titre des Monuments
Historiques, le refus de certificat ne peut être renouvelé. Le
trésor national devient paradoxalement exportable.
2) Il n'existe aucune obligation pour le propriétaire de vendre à
l'État le trésor national qu'il détient.
3) La loi ne prévoit aucun dispositif permettant d'évaluer au
juste prix les oeuvres que l'État souhaiterait acquérir.
Le système devient ainsi largement inopérant, faute pour
l'État de disposer de moyens d'acquisition proportionnés à
la valeur des oeuvres déclarées "trésors nationaux".
En effet, depuis l'arrêt Walter, qui a contraint l'État à
payer une indemnité excessivement lourde pour un tableau de Van Gogh
classé Monument historique, le classement au titre de la loi de 1913
devient en pratique difficile à envisager dans la plupart des cas. Dans
ce contexte, l'unique moyen de retenir définitivement un trésor
national est donc de l'acquérir.
(4) Le régime britannique de contrôle des oeuvres d'art à l'exportation
L'exportation d'oeuvres d'art de Grande-Bretagne fait l'objet
d'une
réglementation nationale et d'une réglementation
européenne.
Une oeuvre d'art ayant plus de 50 ans d'âge et d'une valeur
supérieure à certains seuils financiers ne peut être
exportée de Grande-Bretagne que moyennant l'obtention soit d'une licence
britannique soit d'une licence européenne.
Une licence britannique est nécessaire pour l'exportation d'une oeuvre
dont la valeur est supérieure au seuil financier applicable selon la
législation nationale dans les deux cas suivants:
• l'oeuvre est exportée vers un autre pays de l'Union, ou,
• l'oeuvre est destinée à un pays en dehors de l'Union et
le seuil financier national pour le type d'oeuvre concerné est
inférieur au seuil financier européen.
Une licence européenne est nécessaire pour l'exportation en
dehors de l'Union d'une oeuvre dont la valeur est supérieure au seuil
financier européen applicable. Une licence d'exportation est
octroyée automatiquement pour toute oeuvre importée en
Grande-Bretagne il y a moins de 50 ans.
Lorsqu'une licence britannique ou européenne est
nécessaire
66(
*
)
, la demande est
adressée au Ministère de la Culture, de la Communication et des
Sports. Un expert est invité à donner son avis sur
l'opportunité de l'exportation. Il émet un jugement sur base d'un
certain nombre de critères.
Ces
critères
dits
" Waverley
" sont les suivants
• L'oeuvre est-elle associée de si près à
l'histoire de la Grande-Bretagne et à sa vie nationale que son absence
serait considérée comme un malheur?
• L'oeuvre est-elle d'une importance esthétique exceptionnelle?
• L'objet est-il d'une signification exceptionnelle pour l'étude
de certaines formes spéciales d'art, de savoir ou d'histoire?
L'expert doit se prononcer dans un bref délai généralement
15 jours. S'il conclut que l'oeuvre ne remplit pas les critères
"Waverley", la licence est émise sans délai. S'il conclut que
l'oeuvre remplit un ou plusieurs critères "Waverley", il soumet la
demande de licence au Comité de Révision.
Si le Comité considère que l'oeuvre est d'importance nationale,
il recommande au Ministre de retarder l'octroi de la licence.
Les institutions britanniques et les particuliers sont alors invités
à faire une offre d'achat à un prix au moins égal à
la valeur du marché fixée par le Comité
. Si l'oeuvre a
été acquise récemment aux enchères, cette valeur
sera généralement fixée au prix marteau augmenté de
la commission d'achat. Les amateurs ont généralement une
période de 2 à 6 mois afin de présenter leur offre et de
réunir les fonds.
Si une offre d'achat est faite pendant la période fixée, et si
cette offre est acceptée par le demandeur de licence, l'oeuvre est alors
cédée avec engagement de l'acquéreur de la conserver en
Grande-Bretagne. Le demandeur est libre de refuser l'offre. Dans ce cas, il
devra conserver l'oeuvre en Grande-Bretagne. Si aucune offre n'est faite
pendant la période fixée, la licence d'exportation est
octroyée.
Ce système a l'avantage d'établir un équilibre entre les
intérêts de l'État et ceux du propriétaire. L'oeuvre
n'est grevée d'aucune charge tant qu'elle demeure en Grande-Bretagne. Si
l'exportation de l'oeuvre est déclarée d'intérêt
national, son propriétaire a le choix entre la vente en Angleterre au
prix du marché, ou la conservation de l'oeuvre en Grande-Bretagne. S'il
s'avère que personne n'est intéressé, ou n'a les moyens
d'acquérir l'oeuvre, l'exportation est autorisée.
Un nouveau projet de loi, modifiant la loi de 1992, est en cours
d'élaboration afin de rendre plus efficace le dispositif de protection
du patrimoine. Il devrait s'inspire comme le proposait la commission
présidée par M. Aicardi du système britannique.
b) Le droit de préemption
Le droit
de préemption a été institué par les articles 36 et
37 de la loi du 31 décembre 1921, en contrepartie de l'abrogation du
contrôle de l'exportation des oeuvres d'art, institué un an plus
tôt et finalement rétabli en 1941.
Il s'agissait de mettre en oeuvre une autre conception de la défense du
patrimoine national : d'une part, les exportations d'oeuvres d'art
étaient soumises à une taxe de 1 % destinée à
permettre à la Caisse des monuments historiques d'acheter les oeuvres
importantes ; d'autre part, on dote l'État, d'une
prérogative nouvelle, qui devait faciliter ces interventions : la
préemption en vente publique.
La préemption peut être définie comme la faculté
légale pour l'État de se substituer, au prix d'adjudication, au
dernier enchérisseur, que celui-ci soit français ou
étranger.
La loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 soumet au droit de préemption
de l'État - étendu sous certaines conditions de procédures
aux collectivités locales
67(
*
)
- " les
curiosités, les antiquités, les livres anciens et tous les objets
de collection (peintures, aquarelles, pastels, dessins, sculptures et
tapisseries originales) ".

Cette nouvelle définition a permis la préemption d'objets
variés, dont certains relèvent plus du patrimoine historique
comme la machine à calculer de Pascal, que de la stricte notion d'oeuvre
d'art.
On note
, également, que sa
définition
légale permet d'en faire usage pour acquérir des oeuvres
contemporaines
.
L'exercice du droit de préemption ne dispense pas de la consultation des
organes consultatifs chargés de se prononcer sur les acquisitions.
En pratique l'administration - ce sont en général les
musées ou les bibliothèques - a le choix : décider de
se comporter en enchérisseur ordinaire ; et donner pour instruction
à son agent de participer aux enchères dans la limite des
crédits qui lui ont été accordés ; elle peut
aussi exercer son droit de préemption de façon à
éviter de provoquer par son intervention de nouvelles enchères.
La décision de préemption est annoncée verbalement
à l'ensemble de la salle sitôt l'adjudication prononcée.
L'agent habilité, qui a donc prononcé à haute voix la
formule rituelle " sous réserve de l'exercice du droit de
préemption de l'État ", se fait connaître
auprès de l'officier ministériel, qui enregistre la
préemption mais aussi l'acquisition sous condition résolutoire de
l'adjudicataire évincé.
Un problème récurrent est celui de l'exercice du droit de
préemption, alors que le prix de réserve n'est pas atteint et que
le marteau s'abat, sans que le commissaire-priseur ait prononcé le mot
" adjugé ". Les tensions ne sont pas rares entre l'officier
ministériel et le conservateur chargé d'exercer les
prérogatives de l'État.
La validité de la préemption est soumise à sa confirmation
dans un délai de quinze jours. Ce laps de temps permet une nouvelle
consultation du Conseil artistique des musées nationaux et de prendre
une décision définitive d'achat. En cas de renonciation
explicite, ou faute de confirmation expresse, l'objet revient à
l'adjudicataire.
Les commissaires-priseurs n'aiment guère cette procédure, dont la
menace est de nature à décourager des acheteurs éventuels
et donc à peser sur les prix. Les acheteurs étrangers, souvent
venus spécialement pour l'oeuvre en question sont donc frustrés
de leur acquisition.
Effectivement, l'intention trop nettement affichée avant la vente,
d'exercer le droit de préemption perturbe le jeu normal des
enchères ; tandis que son exercice trop fréquent pendant la
vente mécontente les acheteurs, surtout lorsque les prix payés
sont modiques.
Ainsi, l'État s'est particulièrement fait remarquer, à la
fin de l'année dernière, en exerçant près de cent
fois son droit de préemption sur des papiers déchirés de
Picasso, des photographies de Dora Maar et des livres, manuscrits et documents
illustrés par l'artiste.
Le tableau ci-après, qui récapitule le nombre de
préemptions par an entre 1983 et 1997, montre que ce nombre a tendance
à croître. Il passe d'une quarantaine au cours des années
1983 et 1984, à un niveau compris entre 100 et 120 à partir des
années 1993 à 1996.
En revanche, le nombre de préemptions portant sur des oeuvres d'une
valeur supérieure à 500 000 francs, reste assez peu important
sauf pendant la période 1986 à 1991, où - sauf en 1989 ce
nombre était supérieur à 5. On remarque que l'année
1994 se caractérise par un petit nombre de préemptions mais un
montant global correspondant de près de 24 millions de francs.
Il n'en reste pas moins que, si l'on peut conclure que la préemption
intervient peu sur le marché des oeuvres de niveau international, cela
veut dire que le plus grand nombre de préemptions porte sur des objets
de relativement faible valeur unitaire. Le record est battu en 1996, avec 127
préemptions, dont 126 pour des objets d'une valeur inférieure
à 500 000 francs.
Il conviendrait d'éviter d'utiliser le droit de préemption pour
acheter des pièces de trop petite valeur unitaire, ce que
malheureusement les musées ou les bibliothèques sont bien
obligés de faire, compte tenu de l'insuffisance chronique de leurs
moyens.
Il est intéressant de noter à cet égard que les
musées nationaux achètent, pour les pièces importantes de
niveau international, relativement peu souvent en ventes publiques.
Le tableau précédent montre que les musées partagent, en
ce qui concerne les peintures valant plus de 500.000 francs, l'essentiel de
leur clientèle entre les particuliers et les galeries, les achats en
ventes publiques ne comptant que de façon marginale (7 %) comme mode
d'acquisition.
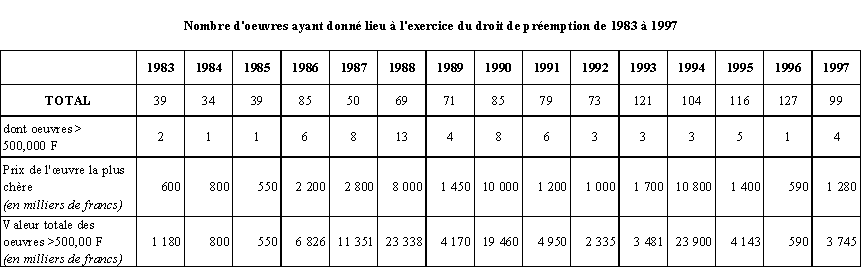
3. La stabilité juridique incertaine
Assurer
la sécurité des transactions commerciales est la condition d'un
bon fonctionnement du marché de l'art. Le système français
repose sur un ensemble de garanties législatives et jurisprudentielles,
qui sont dans les pays anglo-saxons de nature contractuelle.
Mais, à force de vouloir garantir la sécurité des uns, on
risque de déstabiliser le marché des oeuvres de niveau
international pour lesquelles acheteurs et vendeurs savent s'entourer des
conseils nécessaires et sont conscients de ce que l'authenticité
est souvent, pour les oeuvres anciennes, moins une question matérielle
qu'une affaire d'intime conviction des spécialistes du moment.
a) Un régime juridique en principe plus protecteur
Cette sécurité résulte de la combinaison des règles issues du code civil dans l'interprétation extensive que leur donne la jurisprudence, et d'une réglementation protectrice édictant une sorte de doctrine d'emploi des termes utilisés pour la description des oeuvres
(1) Les garanties juridiques
Pour conclure une réponse écrite adressée au rapporteur au sujet des problèmes posés par les garanties dont bénéficient acheteurs et vendeurs en ventes publiques, la chancellerie affirme que " le système français n'apparaît défavorable ni à l'acheteur ni à l'acquéreur. Il repose sur une relation équilibrée entre les différents acteurs Commissaires-priseurs, acquéreur et acheteur ".
(a) les actions en annulation de la vente
Les
actions tendant à l'annulation d'une vente reposent fondamentalement sur
le théorie des contrats. Le requérant cherche à fonder son
recours sur l'une des causes de validité des contrats, telles que les
définit l'article 1134 du code civil.
En pratique, il sera fait état d'un vice du consentement - erreur sur la
substance, dol ou violence - ou d'un vice caché, les actions
présentées sur ce dernier fondement étant plus difficile
à mettre en oeuvre.
L'action mettant en jeu la garantie pour vices cachés qui résulte
des dispositions de l'article 1631 du code civil, présente un certain
nombre de limites, à commencer par la difficulté de preuve du
caractère caché du vice. L'inconvénient majeur est que
l'action en garantie - ouverte uniquement à l'acheteur - doit être
exercée dans un " bref délai " à compter de la
vente, ce qui est souvent trop bref pour que l'acheteur prenne conscience du
défaut d'authenticité.
Le dol est une cause de nullité difficile à démontrer,
dans la mesure où la jurisprudence se montre exigeante en matière
de preuve.
D'où le rôle privilégié de l'erreur dans les actions
en nullité, erreur qui, aux termes de l'article 1110 du code civil, doit
porter sur " la substance même de la chose ". L'extension de la
notion d'erreur sur la substance à celle d'erreur sur les
qualités substantielles en a fait le moyen par excellence des actions
tendant à annuler des contrats portant sur des oeuvres d'art.
L'action, qui peut émaner de l'acheteur comme du vendeur, doit tendre
à prouver que l'authenticité était une qualité
substantielle et que cette authenticité n'était pas
établie.
L'acquéreur doit établir que l'authenticité était
pour lui une certitude, sans qu'il ait pu connaître et donc accepter un
aléa sur l'authenticité ; de même, le vendeur qui
accepte que sa propriété soit présentée comme
" attribuée à ", fait entrer l'aléa dans son
champ contractuel et ne peut donc exciper de son erreur,
lorsqu'ultérieurement, l'oeuvre se révèle un original. Il
est tenu compte dans certains cas de la qualité du requérant,
qui, lorsqu'il est professionnel, est mieux placé pour apprécier
certaines indications.
En outre, même établie, l'erreur doit avoir été un
élément déterminant dans la décision de contracter.
Le vendeur, qui fonde son recours sur l'erreur, doit être en mesure de
prouver qu'il a vendu une oeuvre dont il était sûr qu'elle
n'était pas authentique et que cette certitude était
erronée.
L'action en nullité doit aux termes de l'article 1304 du code civil
être engagée dans un délai de 5 suivant la
découverte de l'erreur. Bien que la question n'ait apparemment pas fait
l'objet de décisions judiciaires, l'opinion générale de la
doctrine est qu'elle doit être engagée dans les limites de la
prescription trentenaire.
Dans le cas particulier des ventes publiques, il faut distinguer le cas de
l'acheteur, vis-à-vis duquel la responsabilité du
commissaire-priseur est délictuelle sur le fondement de l'article 1382
du code civil et se prescrit par dix à compter de la manifestation du
dommage en application de l'article 2270-1 du même code, du cas du
vendeur, vis-à-vis duquel la responsabilité du
commissaire-priseur est contractuelle dans la mesure où ce dernier agit
en tant que mandataire du vendeur. L'action du vendeur est soumise à la
prescription trentenaire de droit commun.
Le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques tend à réduire cette
responsabilité à dix ans à compter du fait
générateur du dommage.
Certains contestent le caractère effectif de la garantie. Ainsi, comme a
pu le déclarer, devant la commission composée par MM. Cailleteau,
Favart et Renard, un des plus importants commissaires-priseurs de la place de
Paris : "
la garantie trentenaire est une hypocrisie. Elle est
censée protéger l'acheteur, mais elle repose sur le vendeur
à qui on ne le dit pas, car c'en serait fini de vouloir vendre en
France "
...
Effectivement, le vendeur de bonne foi peut se voir retourner son objet -
désormais invendable - et obligé de rétrocéder les
fonds perçus et doit donc pouvoir se retourner contre le
commissaire-priseur; c'est la raison pour laquelle l'initiative de la
commission des lois du Sénat tendant à aligner les délais
de prescription de l'action fondée sur l'erreur sur les actions en
responsabilité qui doit être réduite à dix ans.
Il n'en reste pas moins que, même réduite à dix ans, la
garantie d'authenticité repose sur les épaules du vendeur
particulier, ce qui fait contraste avec le régime appliqué par
les maisons de vente anglo-saxonnes, dont on peut montrer qu'elles ne
garantissent - et encore dans un bref délai de cinq ans et uniquement
pour l'acquéreur direct excluant même ses héritiers - que
l'authenticité des oeuvres postérieures à 1870, se
contentant pour les oeuvres antérieures de couvrir le cas de
contrefaçon faite pour tromper intentionnellement.
La garantie de Sotheby's New-York est tout à fait explicite à cet
égard : "
Sotheby's warrants the Authorship (as defined
above) of a lot for a
period of five years
from the date of sale of such
lot
and only to the original purchaser of record at the auction
. If it
is determined to Sotheby's satisfaction that the BOLD TYPE HEADING is
incorrect, the sale will be rescinded as set forth in 3 and 4 below, provided
the lot is returned to Sotheby's at the original selling location in the same
condition in which it was at the time of sale. It is Sotheby's general policy,
and Sotheby's shall have the right to have the purchaser obtain, at the
purchaser's expense, the opinion of two recognized experts in the field,
mutually acceptable to Sotheby's and the purchaser, before Sotheby's determines
whether to rescind a sale under the above warranty. If the purchaser requests,
Sotheby's will provide the purchaser with the names of experts acceptable to it.
Non-Assignability. The benefits of this warranty are not assignable and shall
be applicable only to the original purchaser of record and not to any
subsequent owners (including, without limitation, heirs, successors,
beneficiaries or assigns) who have, or may acquire, an interest in any
purchased property
Sole Remedy. It is specifically understood and agreed that the rescission of a
sale and the refund of the original purchase price paid (the successful bid
price, plus the buyer's premium) is exclusive and in lieu of any other remedy
which might otherwise be available as a matter of law, or in equity. Sotheby's
and the Consignor shall not be liable for any incidental or consequential
damages incurred or claimed.
Exclusions.
This warranty does not apply to: (i) Authorship of any
paintings, drawings or sculpture created prior to 187o
,
unless the lot
is determined to be a counterfeit (a modem forgery intended to deceive)
which has a value at the date of the claim for rescission which is materially
less thaii the purchase price paid for the lot; or (ii) any catalogue
description where it was specifically mentioned that there is a conflict of
specialist opinion on the Authorship of a lot; or (iii) Authorship which on the
date of sale was in accordance with the then generally accepted opinion of
scholars and specialists; or (iv) the identification of periods or dates of
execution which may be proven inaccurate by means of scientific processes not
generally accepted for use until after publication
of the catalogue, or
which were unreasonably expensive or impractical to use. "
Ces pratiques, qui peuvent paraître minimales et qui seraient
considérées comme non conformes à notre droit,
correspondent pourtant à une situation qui ne semble pas poser de
problèmes outre-Atlantique où l'on est plus conscient et
où on tire les conséquences du risque inhérent à
l'achat d'oeuvres d'art.
Maintenant, une jurisprudence récente montre que les maisons de vente
anglaises ne peuvent, sous prétexte de vente sans garantie ou en
l'état, se dispenser d'examiner l'oeuvre
68(
*
)
.
(b) La mise en jeu de la responsabilité de l'expert et du commissaire-priseur
Pour
obtenir la condamnation du commissaire-priseur et de l'expert, l'acheteur doit
démontrer que ceux-ci ont commis une faute et que, du fait de cette
faute, lui-même a subi un dommage.
Le décret du 21 novembre 1956, qui précisait, d'une part, que les
indications portées au catalogue engageaient la responsabilité
solidaire du commissaire-priseur et de l'expert et, d'autre part, que le
premier était responsable des fautes commises par le second, a
été abrogé en mars 1985.
Le projet de loi soumis au Parlement revient sur cette suppression, qui avait
pour conséquence qu'on ne disposait plus alors que de l'article 1382 du
code civil en vertu duquel quiconque, par sa faute a commis un dommage à
autrui est tenu de le réparer.
Le commissaire-priseur est responsable de ses fautes et non de celles des
autres... Or, lorsqu'on confie à un commissaire-priseur un objet, il
assure généralement du concours d'un expert
spécialisé. C'est ce dernier qui est responsable de la
description du catalogue. S'il commet une faute, c'est lui qui devra en
supporter les conséquences, sauf à démontrer que le
commissaire-priseur a choisi l'expert avec une légèreté
fautive .
On note qu'une des forces du système ancien était le
régime de solidarité des commissaires-priseurs, qui devait
garantir que les clients pourraient obtenir le paiement de leurs
créances. Il va être remplacé par un système
d'assurance, qui dans la logique du nouveau système ne devrait pas
être forcément mutuel, et donc pourrait se révéler
onéreux pour les nouvelles sociétés de vente.
En application des articles 8-11 de l'ordonnance n°45-2593 du
2 novembre 1945 et de l'alinéa 2 de l'article 18 du décret
n° 45-120 du 19 décembre 1945, "
la bourse commune de
la compagnie garantit la responsabilité professionnelle de tous les
membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux créanciers le
bénéfice de la discussion et sur la seule justification de
l'exigibilité de la créance et de la défaillance du
commissaire-priseur. "
La bourse commune est financée par les cotisations de tous les
commissaires-priseurs de la compagnie fixée en assemblée
générale. En pratique, la compagnie contracte une assurance
responsabilité civile avec les cotisations prélevées pour
la bourse commune. Lorsque le montant du sinistre est supérieur au
plafond garanti par l'assurance, ou lorsque les faits reprochés aux
commissaires-priseurs ne rentrent pas dans le champ d'application de la police,
une cotisation complémentaire est prélevée sur chaque
professionnel, quitte à ce que la compagnie se retourne contre le
débiteur défaillant.
C'est ainsi que la bourse commune de la compagnie de Paris devrait être
amenée à garantir le passif de la société Loudmer
et la dette de l'étude Briest résultant de sa condamnation
à payer une indemnité à l'Union de Banques à
Paris.
(2) Le décret du 3 mars 1981
Le
décret du 3 mars 1981 n'est, en ce qui concerne la terminologie en
usage, pas très éloigné de ce qui se trouve dans les
conditions de vente figurant dans les catalogues des deux grandes maisons de
vente. C'est d'ailleurs par préférence à ces pratiques en
usage en Angleterre qu'ont été établies les conventions de
langage que le décret édicte.
On peut résumer les dispositions du décret du 3 mars 1981 comme
suit :
•
oeuvre par .... oeuvre de
.. : il est garanti que l'auteur
mentionné est effectivement l'auteur de l'oeuvre;
•
signé .... estampillé
: même sens que les
expressions précédentes, sauf réserves expresses;
• attribué à
... : il existe seulement des
présomptions sérieuses que l'oeuvre est de l'auteur
mentionné;
•
atelier de
... : oeuvre exécutée dans l'atelier
du maître cité ou sous sa direction; école de... : l'auteur
est un élève du maître cité, et l'oeuvre a
été réalisée du vivant de l'artiste ou moins de
cinquante ans après sa mort;
•
époque..., siècle
... : ces conditions
garantissent que l'oeuvre a été produite au cours de la
période citée, exemple " bronze renaissance "
• dans le goût de, style.... manière de. ... genre de....
d'après.... façon de.
.. : aucune garantie particulière
exemple " style Empire ",
Par ailleurs, les indications figurant sur le certificat de vente remis
à l'acheteur, seront capitales, notamment, lorsqu'il ne s'agit pas d'une
vente publiques. C'est la raison pour laquelle le décret du 3 mars 1981
a rendu le certificat de vente obligatoire.
Aux termes de l'article ler du décret du 3 mars 1981, les vendeurs
habituels ou occasionnels d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs
mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels
procédant à une vente publique aux enchères doivent, si
l'acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance,
bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique.
contenant les spécifications qu'ils auront avancées quant
à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la
chose vendue.
Ce texte offre l'avantage d'étendre à toutes les transactions
portant sur des objets d'art, qu'elles soient entre particuliers dans une foire
ou dans une brocante, la pratique du certificat de vente qui, jusque-là,
était loin d'être générale.
b) De quelques effets de la jurisprudence sur l'erreur
Si respectueux qu'il soit des décisions de justice, le rapporteur ne peut pas ne pas faire remarquer les conséquences de certaines décisions pour le marché de l'art, les musées et l'Etat. La chronique judiciaire ne manque pas d'affaires ayant trait aux oeuvres d'art, mais il en est une tout à fait emblématique, par sa chronologie - c'était la première d'une longue série - et sa portée pour ne pas être relatée de façon détaillée.
(1) Les affaires Poussin
Un peu
d'histoire : les époux Saint-Arroman ont fait vendre aux
enchères publiques un tableau attribué par tradition familiale
à Nicolas Poussin mais inscrit, après avis d'un expert
missionné par le commissaire-priseur, au catalogue de la vente comme
attribué à l'École des Carrache avec leur assentiment.
Adjugée pour 2200 F, en février 1968, cette oeuvre qui
représentait
Apollon et
Marsyas,
avait été
adjugée à un marchand - le même qui fut au centre de
l'affaire du Verrou - mais a été préemptée par
l'État, pour le musée du Louvre. Celui-ci l'a exposée
ensuite comme une oeuvre de Poussin.
Par jugement du 13 décembre 1972, le tribunal de grande instance de
Paris a prononcé la nullité de la vente pour vice de consentement
des vendeurs en raison de l'erreur sur la substance.
Ce jugement a été infirmé par l'arrêt de la cour
d'appel de Paris du 2 février 1976, puis cassé par
arrêt du 22 février 1978 par la cour de cassation, au motif que la
cour d'appel n'avait pas recherché si, au moment de la vente, le
consentement des vendeurs avait été vicié par leur
conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une oeuvre
de Poussin.
La cour d'appel d'Amiens, devant laquelle les parties avaient été
renvoyées, a débouté les époux Saint-Arroman de
leur demande en annulation de la vente par son arrêt du ler
février 1982, lui-même cassé par la cour de cassation
(arrêt du 13 décembre 1983) : en déniant aux époux
Saint-Arroman le droit de se servir d'éléments
d'appréciation postérieurs à la vente pour prouver
l'existence d'une erreur de leur part au moment de la vente la cour d'appel
avait violé l'article 1110 du code civil.
Enfin, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 7 janvier 1987, a
confirmé le jugement de première instance en ordonnant la
restitution du tableau et du prix de vente reçu : elle a
considéré que les époux Saint-Arroman avaient fait une
erreur portant sur la qualité substantielle et déterminante de
leur consentement.
Le tableau a été restitué aux époux Saint-Arroman
qui ont remboursé la somme de 2200 F réglée au moment de
la vente
69(
*
)
.Le tableau a été
remis en vente et adjugé en décembre 1998 pour 7 400 000 francs.
Cette affaire a eu en effet de nombreuses répercussions dans la mesure
où elle a ouvert la voie à plusieurs autres contentieux de ce
type en matière d'acquisitions. Or si les achats d'oeuvres et objets
d'art ou de collection par les musées sont précédés
de procédures internes qui les mettent en principe à l'abri de
décisions hâtives ou mal fondées, ils sont conclus dans les
mêmes conditions que les achats pratiqués par des collectionneurs
privés. Et le contentieux le plus caractéristique du
marché de l'art porte sur les contestations relatives à
l'authenticité des pièces, qui constitue une qualité
substantielle dont la contestation peut amener à l'annulation de la
vente pour " erreur sur la substance " (article 1110 du code civil). Sur le
plan juridique, l'affaire a apporté des éléments
importants à la théorie générale des contrats et
à l'interprétation de l'erreur sur les qualités
substantielles pouvant entraîner la nullité de la vente dans le
cadre de l'application de l'article 1110 du code civil.
D'une part elle consacre définitivement la possibilité,
jusque-là contestée ou du moins admise avec réticences,
donnée au vendeur aussi bien qu'à l'acheteur, d'invoquer l'erreur
sur la substance dont il aurait été victime ; d'autre part,
elle admet que la preuve de l'erreur peut résulter de l'analyse des
consentements échangés (et non seulement des qualités
objectives de l'objet concerné), ce qui conduit donc à accepter
une théorie subjective de l'erreur sur la substance.
Par ailleurs, elle a confirmé une position constante de la jurisprudence
en matière de ventes aux enchères publiques, selon laquelle les
contestations en matière d'erreur sur la substance doivent être
considérées comme nées directement entre le vendeur et
l'acheteur.
En effet, si le décret du 21 novembre 1956 avait paru susceptible
d'accentuer la responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert en
disposant que les indications portées au catalogue, engageaient leur
responsabilité solidaire et que le commissaire-priseur était tenu
responsable des fautes commises par les experts qui l'assistent. (articles 23
et 29), cette possibilité n'a pas été retenue.
Depuis cette affaire, un décret du 29 mars 1985 a, comme on l'a vu,
abrogé et modifié certaines dispositions du décret de
1956, pour retenir la seule responsabilité de l'expert sur ses erreurs
d'appréciation comme le commissaire-priseur est responsable des fautes
qu'il peut commettre lui-même dans l'organisation de la vente.
En outre, le décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la
répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art
et d'objets de collection - cité en annexe, a fixé les
obligations pesant sur le vendeur habituel ou occasionnel d'oeuvres d'art et
d'objets de collection, ce texte a apporté, notamment, des
définitions précises à un vocabulaire
régulièrement utilisé par les professionnels, et permis
ainsi une meilleure sécurité des transactions en la
matière.
En ce qui concerne les contentieux ouverts après cette affaire, on peut
noter que les tribunaux ont montré une certaine
sévérité à l'égard des musées, en
partant de cette présomption que ces derniers disposent de tels moyens
d'étude et d'analyse qu'il leur est possible d'acheter à coup
sûr.
A titre d'exemple, on peut rappeler l'annulation d'une promesse de vente au
musée de Strasbourg d'un tableau que le propriétaire croyait
simplement attribué à Simon Vouet au motif que le musée
acquéreur aurait eu la certitude, en raison d'informations
données par le laboratoire des musées de France que le tableau
était de Simon Vouet lui-même (TGI février 1988).
(2) Une jurisprudence paralysante pour les musées et le marché fondée sur une conception erronée de l'authenticité
La
jurisprudence Saint-Arroman repose fondamentalement sur un malentendu sur la
notion d'authenticité.
Avec son esprit rationnel, sa confiance dans les vertus de la science, le
Français a du mal à admettre que l'histoire de l'art ne soit pas
une science exacte, permettant de distinguer le vrai du faux, de tracer une
ligne de démarcation claire et, surtout, stable entre la
vérité et l'erreur.
(a) Les musées sont-ils suspects de délit d'initié ?
Or, si
les techniques de plus en plus affinées peuvent permettre dans certains
cas d'assurer que telle oeuvre ne peut être attribuée à tel
artiste, il est par contre beaucoup moins évident d'attribuer l'oeuvre
à un artiste sans restriction : le fait qu'une oeuvre ait toutes les
caractéristiques techniques de celles réalisées par un
artiste peut résulter également du fait qu'il s'agit du travail
d'un élève qui l'entourait et utilisait les mêmes
techniques et moyens.
De plus, dans toutes les affaires mettant en cause les musées, on a en
filigrane l'idée que les musées sont en position de force et
qu'il abusent de leur position dominante, qu'ils ont accès à des
moyens d'investigation techniques hors de la portée du Français
moyen
En fait, avant la vente, les musées sont dans la même situation
que tous les autres amateurs, en n'ayant que leurs yeux et leur mémoire
pour tout instrument d'analyse.
Le rapport entre vendeur et musée n'est pas aussi
déséquilibré qu'on peut le penser. Le musée, s'il
est notoirement plus savant, reste susceptible d'erreur, comme le prouvent les
changements d'attributions d'oeuvres même importantes ; le particulier
vendeur peut s'entourer de conseils et d'expertises éclairés.
Jacques Thuillier, professeur au Collège de France, expose un point de
vue tout à fait opposé en se demandant si les musées ne
sont pas victimes, au contraire, d'une espèce de préjugé
défavorable, qui les oblige désormais à s'interdire de
profiter de la compétence de ses conservateurs.
" Que s'est-il passé ? écrit-il Est-ce par ce que l'art
est un domaine particulièrement médiatique ? Désormais les
affaires vont s'y multipliant. Commencé vers 1970 et prolongé
durant quelque douze années, le fameux procès en restitution de
l'Olvmpos et Marsvas de Poussin. acquis par le Louvre aux enchères
publiques, avait montré la faiblesse insigne des institutions prises
entre une législation floue et l'ignorance du public. Le plaisir d'avoir
fait plier un grand musée, l'arrêt final. contraire à la
fois à la coutume et à la vérité, entrouvraient la
porte à des procédures neuves. On n'y prit pas assez garde.
Depuis, les " affaires " sont devenues si fréquentes qu'on ne saurait
rappeler même les plus importantes........
(b) Les paradoxes d'une nouvelle affaire Poussin
Le
professeur au collège de France tire alors les leçons d'une
seconde affaire Poussin.
"
Une autre " affaire " concerne Poussin, et depuis plusieurs
années ne semble faire aucun pas. Nous venons d'évoquer son
Olympos et Marsyas : presqu'insoluble. Ou le tribunal français admet que
les deux frères ont raison, que leur toile est l'original de Poussin. et
en vertu de la jurisprudence établie par l'Olympos et Marsyas, il les
oblige à restituer le tableau ou verser 40 millions ; ce qui, du
même coup, les frustre de leur intuition géniale, du fruit de
leurs recherches et des intérêts de la somme immobilisée,
au profit d'une personne qui n'avait jamais prêté la moindre
attention à l'oeuvre. Mais ce faisant, les juges ne peuvent faire
abstraction des hauts cris poussés par l'érudit anglais. Le
possesseur américain est fort riche, bien muni d'avocats, et de
caractère peu porté aux accommodements. Il risque de se retourner
vers le tribunal, de le sommer de justifier son choix et d'exiger lui aussi une
indemnité considérable... Ou au contraire les juges estiment plus
simple de se mettre sous la haute protection du verdict de Mahon. En ce cas, le
tableau de Versailles vaut bien moins qu'il n'a été payé
aux enchères, et la plainte tombe. Mais s'il apparaît un beau jour
que le tableau français est sûrement l'original ? N'y
aura-t-il pas recours pour erreur judiciaire, et demande de
dédommagement pour les intérêts de la somme perdue du fait
du tribunal (des pourparlers de vente étaient en cours), selon la
jurisprudence établie par l'affaire Walter" ?
Or ce tribunal n'a aucun moyen de trancher. Les études historiques et
les examens de laboratoire, qui exigent toujours une interprétation
complexe, ont été exploités aussi bien en faveur de
l'exemplaire américain que de l'exemplaire français. Le jugement
esthétique est fait d'une conviction fondée sur
l'expérience, et non sur des preuves positives et définitives. Il
peut toujours être renversé par un ensemble de découvertes.
Pourquoi diable la justice va-t-elle s'engluer dans ces problèmes
d'attribution, dont certains ne sont toujours pas tranchés... depuis le
règne de Louis XIV ? Qui ne voit ici que le principe de l'" erreur sur
la marchandise,, au nom duquel les avocats ont fini par faire rendre l'01ympos
et Marsyas, vaut peut-être pour les produits commerciaux, mais ne peut
s'appliquer en pareil cas ? Si le tribunal recevait la plainte -et fallait-il
vraiment l'accepter ? -, il
convenait de mettre entre parenthèse la
question d'authenticité,
et se contenter d'examiner les droits
respectifs, légaux et moraux, de la plaignante, que personne n'a
forcée à mettre en vente son tableau...
Un fil tirant l'autre, et le fameux verdict concernant l'Olympos et Marsyas
faisant jurisprudence, M. Walter. après avoir vu les tribunaux
reconnaître officiellement à son tableau une valeur de 400
millions, puis de 200 millions, se retrouvera-t-il enjoint de restituer ces 200
millions contre un tableau de toute façon " brûlé "
et, pratiquement sans valeur marchande ? De pareilles contradictions sont-elles
propres à entretenir le prestige des tribunaux ? Nous avons dit qu'il
leur est dangereux de vouloir trancher de l'authenticité d'une oeuvre.
N'est-ce pas une erreur pire, que d'y vouloir ajouter une estimation
financière ? Valeur esthétique et valeur financière sont
des terrains mouvants, où les vétérans peuvent se risquer
- à leurs propres dépens - mais où le néophyte est
sûr de perdre la face. Au niveau de 145 millions, l'erreur est tout de
même difficilement acceptable
.
Encore une fois, il conviendrait que l'on se tourne avec un peu plus
d'humilité devant les faits pour voir ce qui se fait à
l'étranger.
Dans les pays anglo-saxons - et les conditions de vente jointes en annexe
à titre de matière à réflexion critique en
témoignent - on a compris qu'acheter une peinture ancienne
c'était, bien souvent, faire un pari.
L'acheteur prend un risque - et pour beaucoup, cela fait partie du jeu - sur le
fondement, non d'analyses de laboratoire - qui, de toute façon, ne
donnent que des certitudes négatives - mais d'un oeil ou d'une intuition.
Il ne faudrait pas que par une sorte de conception absolue de
l'authenticité, considérée comme à la fois
objective et immuable, alors qu'elle est une affaire d'opinion - de celles des
autorités du moment -, on en vienne à frustrer les musées
des fruits de leur compétence.
Ne désespérerons pas les chercheurs d'or en leur faisant rendre
leurs pépites, tout en leur laissant les cailloux qui les avaient fait
rêver...
En vente publique, dès lors que l'objet est catalogué - et
même, d'ailleurs, lorsqu'il ne l'est pas..- il est rare qu'un chef
d'oeuvre - grand ou petit - ne soit pas démasqué; et lorsque cela
arrive, c'est qu'il a fallu beaucoup d'intuition et d'audace à celui qui
l'a reconnu.
4. Les structures
Le principal handicap de la France, c'est d'avoir sur un marché prospecté de fait par les maisons de vente anglo-saxonnes, des structures éclatées, tant pour les commissaires que pour les experts.
a) Ventes publiques : un secteur atomisé
Le
secteur des ventes publiques en France est resté longtemps figé
dans l'attente d'une réforme, qui n'en finissait pas d'être sans
cesse annoncée et toujours reportée.
Une évolution des structures n'est perceptible que pour trois
régions : Paris, l'Île-de-France et la région
Rhône-Alpes.
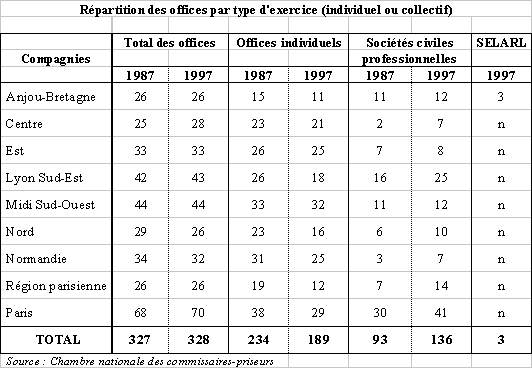
Sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée de la loi du 31 décembre 1990
Bien
que, très tôt, le statut d'officier ministériel ait
été perçu, par nombre d'observateurs, comme un carcan, on
a longtemps cru que l'on pouvait se contenter d'aménagements
limités des règles d'exercice de la profession, et, notamment,
qu'il suffisait de trouver des statuts permettant de lever des capitaux.
La profession apparaît victime, en définitive, de la confortable
protection que lui assurait un monopole légal, que, dans l'ensemble,
elle a plus cherché à prolonger qu'à faire évoluer.
Une fois de plus, un privilège s'est progressivement transformé
en handicap.
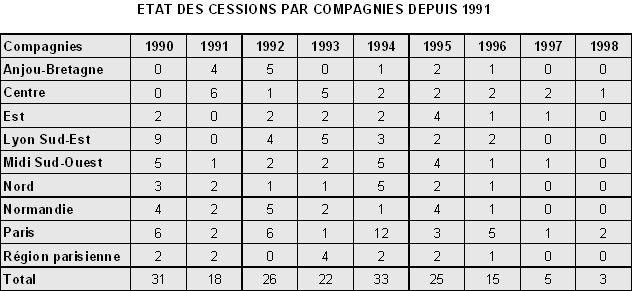
b) Les difficultés inhérentes à l'expertise indépendante
Le
système français d'expertise est à l'image de celui des
ventes aux enchères particulièrement éclaté.
L'expertise en ventes publiques est, avant tout, conçue comme une
activité libérale que les nécessités
matérielles conduisent à conjuguer avec des opérations de
commerce ou de courtage
70(
*
)
.
L'expertise a longtemps été un des handicaps des ventes publiques
françaises, même si aujourd'hui on trouve à Paris, nombre
d'experts de classe internationale.
En revanche, c'est le point fort des grandes maisons de vente aux
enchères qui font appel à des experts salariés.
On a vu lorsque l'on a évoqué les raisons de l'ascension des
grandes maisons de vente anglo-saxonnes, qu'une des innovations introduites par
les britanniques, avant même la seconde guerre mondiale, est d'avoir eu
recours à des experts, historiens d'art.
Les compétences de ces experts salariés ne reposent pas seulement
sur une vaste documentation - qui aujourd'hui s'est
généralisée -, mais surtout peuvent s'appuyer sur tout un
réseau de correspondants, universitaires ou conservateurs de
musées - à l'étranger du moins.
Dans un régime de marché atomisé comme celui du
marché français des ventes aux enchères, il est logique,
compte tenu de la faible taille des études, que se soit mis en place un
système d'expertise indépendante.
On peut même considérer qu'un tel système pourrait
s'inscrire dans la logique d'externalisation des activités que l'on
constate dans beaucoup de domaines.
Il est, de surcroît, tout à fait défendable de
considérer avec M. Claude Blaizot, président du syndicat
national des antiquaires et de la compagnie nationale des experts, qu'un expert
indépendant est naturellement plus libre qu'un expert salarié qui
peut être soumis aux pressions de son employeur.
Mais, force est de constater qu'on se trouve confronté à deux
contradictions :
• la dispersion du marché de l'expertise entre de nombreux
opérateurs et, partant, l'insuffisante rémunération des
experts, qui n'ont d'autre choix pour que leur entreprise soit viable, que
d'avoir des activités de compléments : la plupart sont aussi
marchands, ce qui peut créer des conflits d'intérêts, sinon
dans les faits, du moins dans l'esprit de leurs clients ; mais les autres
peuvent se livrer à des opérations de courtage ou être
rémunérés en tant qu'apporteurs d'affaires ;
• la nécessité de garantir une certaine fiabilité
pour le consommateur, a conduit la profession à se regrouper dans des
conditions qui ne sont pas exemptes de reproches du point de vue du respect des
règles de concurrence.
Les experts sont regroupés autour de quatre chambres principales :
• la Compagnie nationale des experts spécialisés en livres,
antiquités, tableaux et curiosités ; fondée en 1972,
elle regroupait 147 adhérents en 1992 et 141 en 1996, pour la
plupart implantés à Paris, exerçant les métiers de
libraires et d'antiquaires.
• la chambre nationale des experts spécialisés en objets
d'art et de collection ; fondée en 1967, elle regroupait en 1992
111 experts et 80 stagiaires, contre 115 et 85 en 1996, principalement des
antiquaires, répartis dans toute la France ;
• le Syndicat français des experts professionnels en oeuvres
d'art et objets de collection ; fondé en 1945, il regroupait en
1992, environ 120 membres actifs et, en 1996, 125 implantés
essentiellement en région parisienne, qui exerceraient leur
activité, " notamment dans les ventes publiques et dans les
expertises judiciaires " mais qui pourraient également
" être commerçants "
• l'Union française des experts spécialisés en
antiquités et objets d'art ; fondée à la fin des
années 1970, cette instance comptait en 1992 150 membres
implantés dans toute la France et en 1996, 95, qui seraient de
profession très variées : commerçants,
commissaires-priseurs et même des collectionneurs et amateurs d'art ;
Les deux premiers groupements cités sont habilités à
proposer des candidatures aux fonctions d'assesseurs à la commission de
conciliation et d'expertise douanière. Par ailleurs, les trois
premières organisations se sont regroupées dans une organisation
ouverte à des organisations étrangères
dénommée Confédération européenne des
experts d'art.
La décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-81 du
21 décembre 1998 démontre les contradictions entre le souci
d'assurer le respect des règles de concurrence et celui de
protéger le consommateur
.
Sur une saisine en date du 24 juin 1993, la décision a abouti à
condamner les quatre organisations précitées à une amende
dont le montant est égal pour l'ensemble à 286 000 francs.
Sans rentrer dans le détail de cette décision, on peut faire
remarquer que, si la cooptation n'a pas été jugée en
elle-même anticoncurrentielle, elle peut "
lorsqu'elle est
associée à d'autres dispositions telles que le parrainage et la
dispense de motivation des refus avoir pour effet de limiter le jeu de la
concurrence entre les experts
. ". De même, la diffusion de
barèmes d'honoraires qui pourrait paraître une façon de
protéger le consommateur contre certains abus - dès lors que les
quatre organisations n'appliquent pas les mêmes tarifs -, a
été considérée comme allant à l'encontre
d'un fonctionnement normal du marché dans la mesure où cela
pourrait avoir pour effet de " détourner les entreprises d'une
appréhension directe de leurs coûts ". En définitive,
le conseil de la concurrence n'a pas jugé que les dispositions
incriminées - qui, outre celles déjà citées,
comprenaient notamment l'échange d'informations relatives aux refus de
candidatures ou d'admission - contribuaient suffisamment à la
qualité des prestations offertes au consommateur pour que " les
restrictions à l'exercice et donc à l'offre d'expertise "
soient justifiées.
Mais, fondamentalement, la profession d'experts est libre. Le titre n'est pas
protégé, n'importe qui peut se prétendre expert. Il est en
conséquence extrêmement délicat d'évaluer leur
nombre. Par ailleurs, leurs spécialités sont multiples et
variées.
Même si cette situation n'est pas pleinement satisfaisante, le projet de
loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles
n'établit aucun monopole des experts agréés
. Comme
c'est le cas aujourd'hui, les sociétés de vente pourront toujours
recourir à des experts qui ne sont pas agréés par le
conseil des ventes.
Le conseil des ventes se contente d'établir la liste des experts
agréés auxquels peuvent avoir recours les sociétés
de vente, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs
judiciaires. Il veille à la régularité de
l'activité de ces professionnels et réprime les manquements
constatés.
En fait, et l'approche semble raisonnable dans son principe, le projet de loi
met en place un régime de liberté surveillée, assorti d'un
système de " labellisation " destiné à
protéger le consommateur : l'établissement de cette liste
sera, pour le vendeur comme pour l'adjudicataire, une garantie de
compétence de l'expert dans la spécialité dans laquelle il
est inscrit.
Enfin, on peut se demander si l'obligation d'assurance imposée pour des
raisons a priori légitimes pour garantir la sécurité des
transactions ne risque pas d'être difficile à mettre en
oeuvre ? Cette question est d'autant plus importante que l'on assiste en
France à la
multiplication des affaires mettant en cause la
responsabilité des experts.
Or, le problème est que la rémunération des experts -
3 % pour les ventes publiques/ 1 % pour les estimations privées
- est
bien modeste au regard de la responsabilité encourue.
Les auteurs du projet ne contestent pas que l'obligation d'assurance -
responsabilité civile - pour les experts est une contrainte. En effet,
si l'expert ne peut justifier d'une police d'assurance, sa demande
d'agrément sera rejetée, mais ils ont jugé cette
contrainte nécessaire pour des raisons de protection du consommateur.
Pour eux, le projet de loi ne fait que généraliser une pratique
largement répandue dans ce secteur d'activité.
On doit souligner que la responsabilité de l'expert est encore accrue
dans la mesure où la solidarité avec l'organisateur de la vente,
supprimée en 1985 serait rétablie. Dès lors, quand
l'expert a commis une faute, la responsabilité de l'organisateur de la
vente est engagée, sans qu'il y ait besoin de prouver sa faute.
Tandis que nous imposons une obligation d'assurance - qui va peser sur les
coûts et donc sur la compétitivité -, les anglo-saxons font
confiance au droit commun et au soin apporté par les grandes entreprises
à la préservation de leur image qui les conduira à couvrir
les fautes de leurs experts.
On voit, ici, une nouvelle manifestation de cette volonté de trouver une
solution " à la française ", où l'on cherche
à substituer des garanties institutionnelles à des garanties
offertes par le marché.
D. LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
A
l'origine des propositions du rapporteur, il y a d'abord un diagnostic :
aussi irritants soient-ils, les handicaps qui s'accumulent au détriment
de la compétitivité du marché français,
pèsent moins lourds que des facteurs structurels, qu'ils soient
économiques ou culturels :
• la France est moins riche, son économie moins dynamique que
celle des États-Unis, son système juridique et fiscal moins
favorable à l'initiative que celui des pays anglo-saxon - et partant ses
grandes fortunes moins fréquentes et en général trop
anciennes, pour que le marché français développe une
demande interne, suffisamment forte pour garder notre patrimoine et même
en attirer en provenance de l'extérieur ;
• la France n'est plus le pays phare de la culture mondiale ; elle
ne peut plus prétendre avoir le monde à ses pieds, comme cela
était le cas jusqu'au début des années cinquante.
Il y a dans le déclin de la France sur le marché de l'art, un
ensemble de raisons structurelles que la fiscalité et des
réglementations figées sur le passé ont renforcées.
Les aurait-on modifiées, que la face du monde de l'art n'en aurait pas
été changée pour autant.
Indépendamment même des facteurs culturels et des rapports de
puissance économique, les tendances lourdes comme la
préférence pour la réglementation et la méfiance
vis-à-vis de l'initiative, constituent des handicaps pour les
opérateurs français, au moins aussi lourds que la
fiscalité ou une réglementation par trop tatillonne.
Le rapporteur
tire les conséquences de cette conception dans
l'articulation de ses réflexions où
il distingue nettement ce
qui dépend de l'État français, de ce qui doit être
négocié
notamment
avec Bruxelles, où la marge de
manoeuvre est naturellement plus étroite.
Reprendre le refrain que l'on entend de toutes parts, sur le thème
" vous étiez les meilleurs ", il ne tient qu'à vous de
le redevenir, au prix de quelques impôts en moins, c'est oublier que
l'histoire a un sens et que certaines lésions sont largement
irréversibles, surtout s'il n'y a, on peut le regretter, ni mobilisation
des citoyens ni volonté politique fortes pour une cause pourtant
d'intérêt national.
1. Tenir compte de la marge de manoeuvre restreinte en matière de charges
L'un et l'autre de ces dossiers, particulièrement irritants pour les professionnels du marché de l'art sont difficiles à résoudre, en dépit de la faiblesse des enjeux financiers. L'un et l'autre se heurtent à l'inertie des positions de principe et à la vitesse acquise de la machine communautaire.
a) Le blocage communautaire sur la TVA
L'affaire s'insère dans une négociation globale au niveau communautaire où chaque modification se négocie avec tout les états membres, ce qui accroît l'inertie du système.
(1) La TVA entrave-t-elle la vente de biens importés ?
On peut
rappeler que la 7
ème
directive concernant les oeuvres d'art
et les biens d'occasion - aujourd'hui intégrée à la 6
ème
directive - est entrée en vigueur au 1
er
janvier 1995. Le régime communautaire prévoit que le taux
réduit de TVA est applicable aux importations d'oeuvres d'art,
d'antiquités et d'objets de collection. En pratique les taux applicables
vont de 5,5 % en France à 25 % au Danemark.
La Grande-Bretagne a obtenu de pouvoir utiliser un taux réduit de 2,5%
jusqu'au 30 juin 1999.
En fait, en dépit de la pression britannique, la commission paraît
déterminée à ne pas prolonger ce régime
dérogatoire.
Se fondant sur la possibilité pour le commerce d'utiliser le
régime de l'importation temporaire la Commission estime que la TVA
à l'importation ne constitue pas une gêne pour le
développement du marché communautaire en général et
britannique en particulier.
Le régime de l'importation temporaire est un système
particulièrement commode pour les maisons de vente aux enchères.
Ce régime autorise l'importation temporaire d'objet d'art en vue de leur
vente éventuelle pendant une durée de deux ans sans que la TVA
soit exigée le paiement de la TVA au moment de l'importation. L'avantage
de ce régime tient à ce que si les biens sont destinés
à être réexportés par la suite hors de la
communauté, la TVA ne sera pas due, sauf sur les honoraires du
commissaire-priseur qui sont soumis au taux normal
71(
*
)
.
En Grande-Bretagne, le valeur totale des biens importés sous ce
régime entre 1995 et 1998, a été multiplié par 13
entre 1995 et 1998, au point qu'à peu près tous les objets d'art
mis en vente en relèvent. La commission estime que plus de 50 % des
objets d'art ainsi importés restent ensuite dans la Communauté.
Et c'est cette observation d'ailleurs ambivalente, qui a permis à la
Commission d'estimer que la TVA à l'importation n'était pas une
gêne pour la Grande-Bretagne.
Les importations d'objets d'art au Royaume-Uni, exception faite des
importations temporaires, sont tombées de 992 millions d'euros en 1994
(lorsqu'elles étaient exonérées de la TVA) à 776
millions d'euros en 1995, lorsque la TVA a été introduite, et
à 624 millions d'euros en 1997. Ce passage de l'importation
définitive à l'importation temporaire est dû à
l'avantage en matière de trésorerie que présente le
régime temporaire, et qui provient du report de l'exigibilité de
la taxe, qui serait normalement due à l'introduction des biens sur le
territoire communautaire.
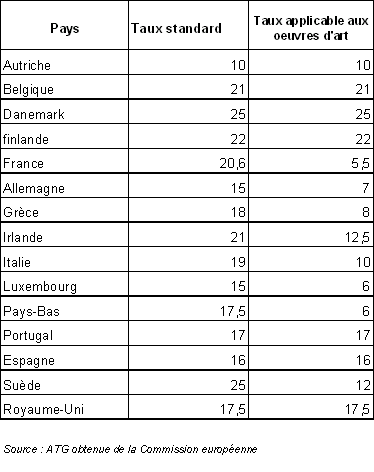
 Source Fédération britannique du
marché de l'art
Source Fédération britannique du
marché de l'art
Bref, la commission n'a relevé "
aucun indice laissant supposer
que la TVA avait une incidence importante sur la compétitivité du
marché communautaire de l'art par rapport aux marchés de l'art
des pays tiers. La Commission considère, par conséquent, que
l'adoption de la directive 94/5/CE n'a pas eu d'incidence déterminante
sur le marché communautaire de l'art et que toute proposition
législative en la matière est superflue.
"
La Commission estime que le cadre législatif en vigueur est suffisant
pour garantir la prospérité future du marché communautaire
de l'art et que les distorsions actuelles entre les États membres seront
considérablement atténuées après le 30juin 1999.
Par conséquent, la Commission n'envisage pas de proposer une
modification des dispositions relatives à l'application de la TVA aux
objets d'art
Le rapporteur ne peut, comme l'ont fait MM. Aicardi et Chandernagor, que
constater que le mécanisme même de
la
TVA "procède
d'une mauvaise compréhension du marché de l'art
": à la
différence des marchés de biens et de services, c'est
l'exportation qui appauvrit et l'importation qui enrichit.
Il ne peut que constater également que, malgré la modicité
des sommes en cause, le Gouvernement semble, sinon attaché au principe
même de l'imposition des oeuvres d'art à la TVA, du moins peu
désireux de se battre pour ce qui ne lui semble que des produits de luxe
et non des produits de première nécessité.
Pourtant, comme l'avait souligné M. André Chandernagor, la France
a tout intérêt à faire alliance avec la Grande-Bretagne sur
ce sujet car ce sont les deux seuls pays de l'Union Européenne à
avoir un marché ouvert sur l'extérieur.
De toute façon, le navire communautaire est lancé et il faudrait
une volonté politique affirmée pour espérer
l'arrêter, surtout si la commission refuse de prolonger le régime
dérogatoire dont bénéficie la Grande-Bretagne jusqu'au 30
juin 1999.
Telle est la raison pour laquelle le rapporteur préfère ne pas
placer trop d'espoir dans une suppression d'une taxe qui, si elle était
décidée, constituerait un nouvel exemple de course au
moins-disant fiscal, dont le ministère des finances, qui est
maître de la négociation, ne veut pas relancer.
b) L'incontestable droit de suite
Pour
l'instant, le droit de suite constitue un handicap pour la France dans sa
compétition avec Londres.
La situation pourrait évoluer avec l'adoption d'une
directive
européenne en cours d'élaboration
. En dépit du
caractère dégressif des droits prévu dans l'état
actuel du projet, la Grande-Bretagne continue de s'y opposer avec la
dernière énergie dans la mesure où elle y voit une cause
d'accélération du déplacement du marché de l'art du
XX
ème
siècle vers les Etats-Unis et peut-être,
en Europe, vers la Suisse.
Les Anglais ont ainsi refusé le projet présenté au
Conseil " marché intérieur " du 25 février
dernier
, qui prévoyait un taux de droit de suite variable selon le
prix de vente des oeuvres: 4% jusqu'à 50.000 euros, 3% de 50.000
à 200.000 euros et 1% au-dessus de 200.000 euros. Le délai de
mise en oeuvre serait de 2 ans. Ils ont également refusé le
compromis proposé par l'Allemagne prévoyant une extension du
délai de mise en oeuvre à 4 ans et surtout un taux réduit
à 0,5% pour les oeuvres d'un prix supérieur à
500.000 euros.
Le sentiment du rapporteur est que le compromis en cours d'élaboration
à Bruxelles entre la Commission et le Conseil, est un moindre mal,
surtout si l'on adopte la proposition de la présidence allemande d'un
taux à 0,5 % pour la tranche la plus élevée au-delà
de 500 000 euros .
A ce niveau, les effets de délocalisation vers les États-Unis
seraient restreints, notamment parce que le surcoût de la taxe, qui est
due par le vendeur, pourrait même être prise en charge par la
maison de vente aux enchères.
L'effet de délocalisation vers New-York pourrait ainsi rester
relativement limité du moins au regard des facteurs structurels
économiques et culturels, qui tendent à déplacer le
marché de l'art contemporain vers les États-Unis.
En outre, s'il se confirme, l'exonération des premières
transactions assorti d'un seuil relativement élevé, est de nature
à soulager les galeries, qui actuellement ne le payent pas
.
En outre, le rapporteur ne serait pas hostile
, compte tenu notamment des
éléments d'information qu'il a rassemblés sur la situation
sociale précaire des artistes,
à ce que les produits du droit
de suite viennent,
pour une petite part
, alimenter la
sécurité sociale des artistes et retrouve en partie la vocation
sociale
qui fut la sienne à l'origine
.
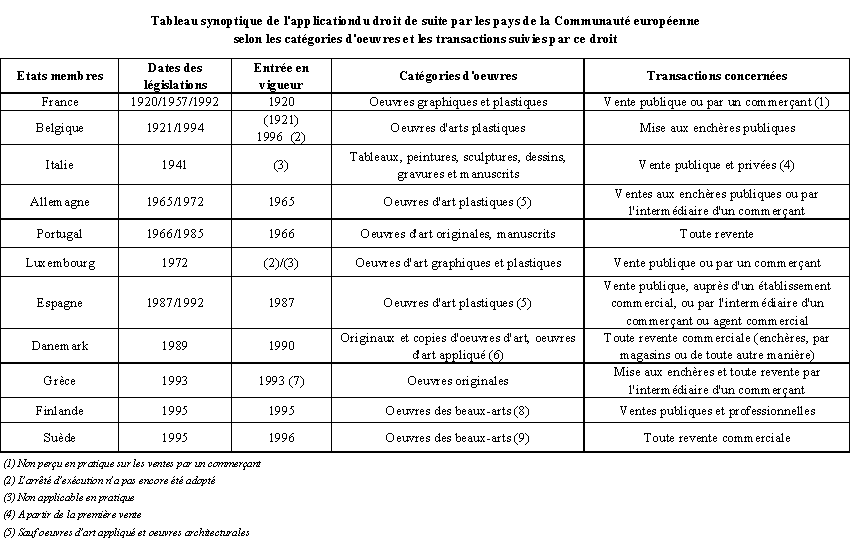

2. Dynamiser les structures
Dans notre pays, on ne fait vraiment confiance ni au marché qui doit être encadré, ni au consommateur qui, estimé incapable de se défendre, doit être protégé par l'État.
a) La réforme des ventes publiques : trop tard et trop peu ?
On ne
manque pas de remarquer, en France, la permanence de la volonté de fixer
dans la loi ce qui se trouve ailleurs, en particulier, dans le monde
anglo-saxon, dans les contrats ou la jurisprudence.
Bref, on préfère la réglementation à
l'autorégulation.
Question de culture.
(1) Un libéralisme bien tempéré
On
permet, enfin, à ce qui avait cessé d'être une
activité libérale, de devenir une activité commerciale
dans ses moyens d'actions - liberté de tarification, accès
à la publicité - comme dans son mode de financement.
Mais, en n'osant pas faire de la vente aux enchères une activité
comme les autres, on continue d'imposer aux commissaires-priseurs
français des contraintes, au nom de la protection des consommateurs,
notamment, qui ne favorisent pas leur compétitivité dans un
marché désormais mondial.
Le processus de libéralisation ainsi entrepris, reste bien
tempéré par la volonté, très française, de
normaliser les pratiques des entreprises afin de prévenir
d'éventuels abus, dont leurs clients pourraient être les victimes.
Cette tentation de vouloir faire mieux que le modèle libéral
anglo-saxon est d'autant plus forte, que les commissaires-priseurs
français se sont longtemps prévalus et se prévalent encore
des garanties supérieures qu'ils apportent tant à l'acheteur
qu'au vendeur.
(2) La nécessité d'une autorité de marché
La
multiplicité des opérateurs rend nécessaire une
réglementation plus stricte que dans un régime d'oligopole.
De ce point de vue, l'intervention de l'État n'est pas simplement une
nouvelle manifestation de l'exception française mais
une
nécessité qui correspond à la structure d'un
marché, qui restera moins concentré
, en dépit de
l'arrivée des grandes maisons des ventes anglo-saxonnes. C'est bien le
cas de l'expertise pour lequel le régime de liberté à
l'anglo-saxonne n'est pas adapté à la structure du marché
français.
Le marché a besoin de règles ; il suppose parfois, lorsqu'il
s'applique à des biens ou des services très spécifiques,
une autorité de régulation. Mais, dès lors que l'on met
précisément en place ce type de structure, il semble inutile,
même si cette instance n'a pas le statut d'autorité
indépendante, de prévoir une réglementation trop
tatillonne.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères a des
compétences en matière d'accès au marché et de
discipline ; lui confier une mission de surveillance
générale - des conditions et pratiques commerciales - en ferait
une autorité de marché,
comme il en existe dans d'autres
domaines, dont le pouvoir se fonderait moins sur la coercition que sur la
persuasion.
De simples observations, éventuellement rassemblées dans un
rapport annuel, suffiraient à entretenir la vigilance des acteurs, dans
des domaines où ce n'est bien souvent qu'a posteriori, en fonction des
circonstances, qu'il est possible de déceler des pratiques contestables.
S'il convient donc de
ne pas céder à la tentation
réglementaire
et de
faire confiance aux opérateurs
, ce
qui constitue le meilleur moyen de stimuler les initiatives et donc la
compétitivité du marché français, il faut aussi
stimuler leurs réflexes d'autodiscipline
, au moyen d'une instance
de régulation adaptée dans ses moyens comme dans ses missions.
A cet égard, il est important de souligner le rôle que pourrait
jouer le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, comme support de concertation avec les professionnels du
marché de l'art, qu'il s'agisse des vendeurs aux enchères, des
experts ou des marchands.
Bien qu'aucun chiffre ne soit disponible, on a toutes les raisons de croire
qu'entre un tiers et la moitié de la clientèle des ventes
publiques, est constitué de professionnels, à l'achat comme
à la vente.
(3) Le besoin d'une instance de concertation
La
fonction de régulation
au sens économique des ventes aux
enchères d'oeuvres d'art
est assurée par les marchands
,
petits ou grands. Ceux-ci doivent donc être associés au
fonctionnement et à la régulation, juridique cette fois, des
ventes aux enchères.
Il est important, à cet égard, que la composition et le mode
dedésignation des membres du conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques soient adaptés à cette
fonction
de concertation
et fasse en conséquence toute leur place aux
professionnels. Il ne semble d'ailleurs pas nécessaire que l'on se sente
lié par un principe de paritarisme, dès lors que la
présence d'un commissaire du gouvernement et la mise en place d'une
procédure d'appel assure la prise en compte de l'intérêt
public.
Bien qu'elle soit actuellement assurée
de facto
par
l'Observatoire des mouvements internationaux d'oeuvres d'art, par delà
les compétences d'analyse statistique, dont il est officiellement
investi, la concertation gagnerait sans doute à être
organisée dans un cadre plus institutionnel.
Garder nos atouts, tout en prenant ce qu'il y a de meilleur à
l'étranger, tel est manifestement le principe de la réforme.
La question est de savoir si cette ambition est réaliste et si les
nouvelles règles du jeu sont de nature à restaurer la
compétitivité des opérateurs et du marché de l'art
français en général.
b) L'accompagnement de la modernisation et la préservation de l'Hôtel Drouot
Les commissaires-priseurs doivent, en effet, non seulement être dédommagés de la perte d'un monopole, mais encore encouragés à faire face au choc d'une concurrence annoncée.
(1) Les mesures fiscales de neutralisation des effets fiscaux du passage au statut commercial
Or, de
ce point de vue, le projet de loi soumis au Parlement, par son silence sur le
statut fiscal des nouvelles sociétés, laisse le code des
impôts s'appliquer dans toute sa rigueur, alors même que
le
changement de statut est contraint et non choisi
.
La restructuration à laquelle vont être contraints les
commissaires-priseurs, devrait pouvoir être mise en oeuvre dans un
cadre fiscal neutre
, quelles que soient les structures d'exercice.
Il n'est pas normal
, alors même que l'on entend par ailleurs -
à en juger par certains propos tenus par le ministre de la culture -
favoriser le développement du marché de l'art,
que l'on puisse
faire supporter à des agents économiques le coût fiscal des
transformations juridiques qu'on leur impose.
Que l'on envisage un apport de l'activité de vente volontaire de ces
sociétés à des sociétés commerciales
nouvelles ou une scission des sociétés existantes, le coût,
tant en matière d'imposition des plus-values qu'en matière de
droits d'enregistrement, pourrait s'avérer particulièrement
lourd, et ceci alors qu'il ne sera dégagé aucune liquidité
pour s'acquitter des impositions exigibles.
Il est donc indispensable que des régimes équivalents soient mis
en place à ceux dont bénéficient les entreprises
individuelles pour permettre la restructuration des SCP et des
sociétés d'exercice libéral qui ne seraient pas soumises
à l'impôt sur les sociétés, au sein desquelles sont
exercées conjointement une activité volontaire et judiciaire.
Tel est l'objet d'une série d'amendements que l'auteur du présent
rapport a présenté et défendu au nom de la commission des
finances pour le passage en première lecture au Sénat.
(2) Le cas de l'Hôtel Drouot
L'unicité de lieu de vente à Paris est une
pratique
coutumière très ancienne consacrée par un arrêt de
la Cour de cassation du 3 novembre 1982. Elle entraîne pour les
commissaires-priseurs l'obligation d'exercer leur ministère à
l'Hôtel Drouot ou dans un certain nombre de lieux
déterminés, sauf à en faire agréer d'autres par la
chambre de discipline
72(
*
)
.
Les ventes à Paris sont organisées au coeur d'un dispositif
comprenant une société civile immobilière (SCI), une
société anonyme et les offices de commissaires-priseurs.
- La SCI, propriété des seuls commissaires-priseurs en exercice
possède les lieux de vente suivants : Hôtel des ventes
(Drouot-Richelieu), Drouot-Nord, Drouot-Véhicules (deux sites)
loués à Drouot SA. Pour les ventes de prestige, la SCI loue
à Drouot SA, les locaux correspondant à l'appellation
"Drouot-Montaigne", dont la Caisse des dépôts et consignations est
propriétaire.
Chaque office parisien est titulaire d'une part de la SCI.
La société anonyme, Drouot SA, propriété de la
seule Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, assure la logistique des
ventes. Les recettes d'exploitation proviennent de la location des salles,
calculée d'une part, forfaitairement en fonction de la surface
louée et d'autre part, proportionnellement en fonction du montant des
ventes. Outre la gestion de la salle des ventes, Drouot SA regroupe SA Drouot -
Estimation, qui procède à des estimations gratuites, SEPSVEP, qui
assure la distribution des catalogues des ventes ; la gazette de
l'Hôtel Drouot, hebdomadaire des ventes publiques tiré à 65
000 exemplaires, le moniteur des ventes, bi-hebdomadaire d'annonces des ventes
aux enchères tiré à 20 000 exemplaires, dispositif
complété par la création d'un site Internet
73(
*
)
.
C'est donc à ce niveau que se situe une des sources les plus importantes
de plus-values pour les commissaires-priseurs parisiens, qui devraient y
trouver les moyens de financer leur transformation en sociétés
commerciale, si l'État ne prélève pas l'essentiel des
sommes qu'ils pourraient récupérer au titre de l'impôt sur
les plus-values.
Les mécanismes fiscaux proposés par le rapporteur en
qualité de rapporteur pour avis de la commission des finances du
Sénat, tendent à favoriser le réemploi de leur
indemnité et de mettre en place un mécanisme de report
d'imposition des plus-values en cas comme il en existe d'autres exemples dans
le code général des impôts.
Le dispositif est non seulement juste, car on n'a pas à faire subir
les conséquences fiscales de restructuration imposée par la loi,
mais encore efficaces sur le plan économique dans la mesure où il
s'agit d'une aide au réinvestissement.
L'hôtel Drouot est un outil sans équivalent par le brassage
d'objets et de personnes. Sa richesse tient, pour une bonne part, à ce
mélange des genres, ce joyeux désordre, aux antipodes des
vacations aseptisées à l'anglo-saxonne. Un certain nombre de
professionnels en font une structure dépassée ; d'autres y
voient encore une formidable " machine à vendre ", des
" puces " en plein coeur de Paris, où il se passe toujours
quelque chose ...Le marché tranchera ; mais il ne faudrait pas que
l'outil soit condamné du fait de l'application d'une fiscalité
inadaptée à un cas unique.
(3) La suppression de la taxe
Le
rapporteur a, dans un souci de cohérence, aussi proposé de
supprimer la taxe prévue dans le projet de loi portant
réglementation des ventes volontaires de meubles.
Effectivement, la taxe est apparue juridiquement contestable,
financièrement inutile et économiquement nuisible à la
relance du marché de l'art dans notre pays :
•
Juridiquement contestable
, en ce sens que si on comprend bien
que la modernisation d'un secteur soit financée par les clients dans une
logique qui sous-tend beaucoup de taxes parafiscales, il ne s'agit plus pour
l'État dans le dispositif actuel que de racheter un droit qu'il a vendu
et c'est plutôt au budget général d'assumer une charge de
cette nature ;
•
financièrement inutile
, techniquement, parce que les
crédits ont déjà été inscrits et sont
soustraits à l'annualité budgétaire ;
budgétairement, on peut souligner que la hausse des tarifs qui va suivre
la mise en place du nouveau régime - les commissaires-priseurs allant
probablement s'aligner sur les tarifs des deux majors anglo-saxonnes, 15 %
jusqu'à 300 000 francs et 10 % au-delà, par rapport aux 9 %
du tarif réglementaire actuel -, va dégager des recettes
supplémentaires pour l'État
74(
*
)
•
économiquement inopportune
, si l'on souhaite relancer le
marché de l'art, soit que la taxe vienne en plus des frais "acheteur",
soit que, et c'est le plus probable, la taxe soit prise sur les marges des
commissaires-priseurs et ne compromette leur rentabilité et donc
n'obère les moyens dont ils ont besoin pour mener une politique
concurrentielle notamment du point de vue des frais vendeurs...
Enfin, pour le rapporteur, cette taxe d'un faible rendement - et qui viendrait
grossir les rangs de ces petites taxes récemment dénoncées
par un rapport de l'inspection des finances sur le coût de perception de
l'impôt.
3. Assurer le bon fonctionnement du marché
Le rapport Aicardi notait incidemment - au regard de la signification des soldes extérieurs - les similitudes entre le marché de l'art et celui des capitaux; il en est une autre que l'on peut signaler et qui n'est pas sans importance : le marché de l'art a besoin du climat de confiance, qui naît d'un environnement stable et d'un allégement des contraintes administratives. Le rapporteur a rassemblé sous cette préoccupation une série de mesures d'inégales importances.
a) Écarter une fois pour toutes l'application de l'impôt sur la fortune
La
" haine de l'art ", titre d'un article polémique à
propos de la controverse sur l'art contemporain, correspond bien à la
motivation qui semble animer les partisans de l'inclusion des oeuvres d'art
dans l'assiette de l'impôt sur la fortune.
On a déjà largement démontré qu'un tel impôt,
difficile à établir compte tenu de la volatilité des prix,
ne rapporterait rien et ferait fuir les oeuvres, qui n'ont que trop tendance
à rester dans les résidences extérieures des grands
collectionneurs. M. Jacques Thuillier, professeur au Collège de France
dans un article de la Revue administrative (N°306) intitulé
" L'art et l'ISF, bêtise pas morte ", dénonce avec un
beau talent de polémiste cet acharnement contre "
tout ce
secteur, doublement odieux, comme symbole d'une aristocratie de l'esprit et de
l'argent, et comme type même d'investissement improductif
".
En fait, l'imposition des oeuvres d'art apparaît économiquement,
techniquement et budgétairement injustifiée, bref aussi
inefficace que dangereuse :
• Sur le plan économique, on rappellera que les oeuvres d'art ne
rapportent pas de revenus et qu'à ce titre, l'imposition pourrait au
sens que lui donne le Conseil constitutionnel se révéler
confiscatoire
75(
*
)
; à cela s'ajoute
également l'argument de fait que la hausse du prix des objets d'art est
loin d'être prouvée comme l'a montré de façon
spectaculaire les résultats obtenus par les fonds d'investissement comme
le Fonds BNP Arts, pourtant bien conseillé ;
• sur le plan technique et matériel, on voit qu'une mesure de
cette nature risque de susciter des comportements d'évasion, car il
faudra bien être bien vertueux pour ne pas chercher à
échapper à la taxe, soit par simple dissimulation, soit par
délocalisation, et en tous cas bien naïf pour continuer à
prêter pour les expositions. Par ailleurs, on ne peut que rester perplexe
devant toutes les contestations auxquelles peut donner lieu l'évaluation
des oeuvres d'art dont on sait que la valeur est particulièrement
volatile et que la frontière avec des objets simplement fonctionnels ou
décoratifs est particulièrement floue ;
• sur le plan budgétaire, enfin, on peut à la fois
rejoindre les services du ministère de Finances pour souligner le faible
rendement de la taxe et montrer que compte tenu des ventes que ce type de
mesure pourraient provoquer, l'État serait soit contraint d'assister
impuissant à l'exode des oeuvres, soit obligé de les acheter tout
se suite, alors que l'État aurait pu bénéficier de dons
s'il avait pu bénéficier de plus de temps.
M. Jacques Thuillier, souligne avec virulence, les difficultés qui
résulteraient des obligations prévues en contrepartie des
exonérations et en particulier de celle consistant à obliger les
contribuables à exposer leurs oeuvres au public pendant six semaines par
an :
"
On ne sait s'il faut rire ou pleurer. Que veut dire exposer leurs oeuvres
au public " ? S'agit-il d'exposition dans un musée ? L'idée
serait inepte. Tous les musées de France ne suffiraient pas à
exposer en un an, dans les petites salles dont ils disposent, la
centième partie des oeuvres de collection privée, et qui se
chargera du transport, de l'assurance? S'agit-il d'ouvrir son appartement au
public ? On voit d'ici la famille se relayant pendant six semaines pour " tenir
portes ouvertes -, et permettre aux cambrioleurs de repérer ce qui
mérite leur attention... Ou bien ces bons députés sont-ils
assez imbus des clichés les plus éculés pour croire que
tous les collectionneurs soumis à l'ISF sont gens à château
avec cohorte de valets de chambre ? Quelle confiance faire à des
personnes aussi expérimentées ?
Il y a plus grotesque. il paraît que dans leur souci de protéger
la création, les commissaires acceptaient que fussent
exonérées les oeuvres d'art dont l'auteur était encore
vivant. On se frotte les yeux. Le collectionneur devra-t-il s'enquérir,
avant d'acheter une oeuvre, de la date de naissance de l'artiste, et demander
communication de son bulletin de santé ? Devra-t-il, pour n'être
pas accusé de fraude, vérifier s'il n'est pas mort dans
l'année ? Lui faudra-t-il, sous peine de voir ses impôts
augmenter, revendre ses tableaux le jour même du décès de
l'artiste ? Et verra-t-on dans la semaine suivante déferler à
Drouot la moitié des oeuvres du malheureux disparu - et du coup
s'effondrer sa cote
? ".
En conclusion de son propos, M. Jacques Thuillier cite M. Deydier, pour bien
souligner la portée et les conséquences de la menace, en
indiquant que celui-ci a raison d'écrire
76(
*
)
"
L'attaque fiscale, qui vise de nouveau les
collectionneurs, touche et risque de détruire le chaînon le plus
frileux et sensible du milieu de l'art. La trilogie marchands collectionneurs
et musées est vitale pour notre patrimoine culturel. Si un
élément est détruit, l'ensemble disparaîtra, chaque
catégorie étant en réalité totalement
dépendante et solidaire des deux autres. " Et d'ajouter : " Mes
collègues anglo-saxons m'ont fait observer avec gentillesse que, quelle
que soit d'ailleurs l'issue du vote, ce retour constant du même et vain
débat idéologique au premier plan de l'actualité, en
faisant peser une épée de Damoclès permanente sur le
marché de l'art français, finira par entraîner les
mêmes effets [ ... 1. Voudrait-on que la France soit
reléguée à un rôle purement provincial dans le
marché mondial de l'art, avec un appauvrissement
irrémédiable de notre patrimoine culturel ? On n'agirait pas
autrement.
"
b) L'aménagement de la taxe forfaitaire et le relèvement de son seuil à 60 000 francs
Le
rapporteur n'a rencontré que peu d'opposition de principe à cet
impôt. Aussi se contente-t-il de préconiser deux
aménagements techniques :
• l'actualisation du seuil de la taxe de 20 000 F à 60 000
francs, niveau choisi parce qu'il correspond à environ 10 000 euros avec
un système de décote jusqu'à 15 000 euros. Ce seuil
n'avait jamais été actualisé depuis son instauration en
1976 ; son relèvement permettrait de ne pas entraver les petites
opérations et simplifierait le recouvrement ;
• alignement du taux payé par les galeries sur celui payable en
ventes publiques car il n'y a pas de raisons de conserver une discrimination
dès lors que la galerie exerce son activité dans des conditions
vérifiables par l'administration fiscale.
c) Ne pas appliquer le droit de reproduction aux catalogues de vente
Le
rapporteur a demandé au Gouvernement s'il entendait étendre
l'exception dont bénéficient actuellement les
commissaires-priseurs en matière de reproduction aux nouvelles
sociétés de ventes volontaires qui être crées en
application du projet de loi soumis au Parlement.
Le Gouvernement considère que l'article 17 de la loi du 27 juin 1997 n'a
pas pour effet de créer une mesure discriminatoire. Les personnes
bénéficiant de l'exemption sont des officiers
ministériels, qui n'ont pas la qualité de commerçant et
qui sont donc dans une situation différente des galeries notamment, qui
font commerce d'oeuvres d'art.
Il précise dans sa réponse, que les catalogues visés sont
uniquement ceux qui sont mis à la disposition du public " dans le seul
but de décrire les oeuvres mises en vente ", ce qui signifie que
ces catalogues ne sont pas des objets de commerce.
En conclusion, le ministère de la culture fait savoir que " le
Gouvernement estime que le maintien de cette exception ne profitera plus aux
commissaires-priseurs à terme puisque leur profession fait l'objet d'un
projet de loi déposé devant votre assemblée. "
On peut s'interroger sur le bien fondé d'une telle position qui aboutit
à
systématiser une double rémunération pour
l'auteur
et ses ayant droits, qui perçoivent le déjà
le droit de suite.
On ne voit pas nettement ce qui distingue, du point de vue de l'artiste, une
vente publique d'une vente judiciaire. Il serait incohérent que, selon
le statut juridique de la vente, le droit de reproduction soit ou non
applicable.
En outre, on pourrait assister, compte tenu de la tendance de la jurisprudence,
à l'utilisation par certains ayants-droit de cette position de force
juridique comme un moyen de pression sur les modalités d'organisation de
la vente.
Dans ces conditions, le rapporteur préconise le maintien du dispositif
de l'article 17 de la loi du 27 juin 1997 et son extension à l'ensemble
du commerce des oeuvres d'art, sous réserve que les catalogues ne soient
commercialisés qu'à titre accessoire à prix coûtant
et que l'exemption ne concerne que l'oeuvre effectivement proposée
à la vente.
d) Renforcer la fiabilité juridique, améliorer la transparence
Le souci
de protéger le consommateur des services offerts par les
sociétés de vente, conduit le projet de loi déposé
devant les chambres à encadrer étroitement les pratiques qui de
sont développées en dehors de tout cadre légal
spécifique dans les pays anglo-saxons.
L'intention est louable. Toutefois, certains ne manquent pas de souligner les
rigidités qui en découlent, et le frein que celles-ci constituent
pour le développement des sociétés de ventes aux
enchères.
Il est frappant de constater que
les deux " majors "
anglo-saxonnes sont parvenues à régner sans partage sur le
marché mondial
de l'art sans,
officiellement du moins
,
apporter la moindre garantie juridique aux acheteurs
et en accumulant
dans leurs conditions de ventes des clauses qui seraient sans doute
léonines au regard de la loi et de la jurisprudence française.
Car
les vraies garanties du système anglo-saxon sont de nature
commerciale.
Il n'est point besoin d'édicter de strictes obligations
juridiques pour les opérateurs. Ceux-ci sont conscients qu'ils ont plus
à perdre qu'à gagner dans des contentieux où ils n'ont,
nonobstant les clauses contraires imprimées dans leurs catalogues pas
agi d'une façon irréprochable, au regard d'une éthique
professionnelle qu'ils savent faire évoluer quand c'est
nécessaire.
Dans le système français,
en revanche, on fait reposer
la garantie apportée sur un dispositif réglementaire, ce qui
ne peut que se traduire par des contraintes de gestion et des coûts
accrus,
qui pèseront sur la compétitivité des
opérateurs exerçant leur activité en France
.
Les pratiques anglo-saxonnes de prix garantis, d'avances aux vendeurs, de vente
de gré à gré des lots invendus après la vente sont
codifiées, afin de les encadrer dans des procédures rigoureuses,
dont l'inspiration tient plus de la pratique d'un office ministériel que
d'une société commerciale.
Mais, sans doute peut-on faire des distinctions entre les principes que l'on
veut sauvegarder.
(1) Les exigences de transparence
La
transparence et la rigueur sont des impératifs catégoriques,
qui ne peuvent qu'impliquer un certain nombre de règles
déontologiques, dont certaines sont élémentaires comme
l'interdiction de fixer un prix de réserve à un niveau
supérieur à l'estimation, étant entendu qu'en cas de
variation du marché, il est toujours possible de relever l'estimation le
jour de la vente.
On peut noter que l'on pourrait aller encore plus loin dans le sens de la
transparence et d'une déontologie plus stricte :
transparence accrue
, d'abord, avec la publication rapide d'une liste
de prix faisant clairement apparaître les invendus et les retraits ;
transparence, encore, quand il faut demander que l'expert fasse part dans
les catalogues de toutes les informations dont il a connaissance sur l'oeuvre
comme les ventes antérieures, les autres exemplaires connus et surtout
les opinions d'experts divergentes ;
transparence, toujours, mais c'est sans doute peu commercial, en permettant
aux personnes qui assistent à la vente de savoir sans
ambiguïté si le lot est retiré ou s'il est effectivement
vendu
77(
*
)
;
Ø
déontologie plus stricte,
aussi, en obligeant la
société de ventes aux enchères à garantir que les
ordres d'achats seront toujours exécutés au niveau le plus bas -
comme le font les maisons de vente anglo-saxonnes - ou en poursuivant
effectivement les pratiques de " révision "
78(
*
)
-, en régression certes mais encore, trop
fréquentes à l'Hôtel Drouot.
(2) Les garanties financières
Les
garanties à caractère financier, lorsqu'elles sont a priori,
constituent des protections contraignantes pour l'opérateur sans
apporter de sécurité absolue pour les consommateurs.
Ainsi :
Les obligations en matières d'avances ou de garanties de prix
pourraient s`accompagner de beaucoup de contraintes pour les opérateurs
sans avantages évidents pour le client, dont la sécurité
repose plus sur le capital de la société que sur les garde-fous
que l'on va s'efforcer de mettre en place ;
Ø
Les assurances obligatoires
, tant pour les experts que pour
les sociétés de vente aux enchères vont sans doute
alourdir les charges et constituer, pour certains
des barrières
à l'entrée non négligeables
; en outre, on ne
voit pas pourquoi il faudrait instituer une obligation d'assurance
professionnelle, alors que c'est à la société de juger de
l'opportunité d'une assurance, compte tenu de ses possibilités
financières.
Ø On note d'ailleurs que l'on a préféré dans le
projet de loi renforcer les obligations d'assurance au lieu d'imposer un
capital minimal
, ce qui était une autre façon, plus
libérale, d'assurer la sécurité des clients; une telle
observation semble d'ailleurs encore plus pertinente, si l'on envisageait de
permettre aux sociétés de ventes de faire des avances ou de
donner des garanties de prix sans passer par un intermédiaire financier
indépendant.
(3) La sécurité juridique
Enfin les garanties juridiques résultant de la
responsabilité notamment en matière d`authenticité ou de
versement du prix, que la loi et la jurisprudence imposent aux organisateurs de
ventes aux enchères peuvent être diversement
appréciées.
En matière de garantie d'authenticité :
Ø Certains contestent le caractère effectif de la garantie.
Ainsi, comme le déclarait un des plus importants commissaires-priseurs
de la place de Paris déjà cité :
"
la garantie
trentenaire est une hypocrisie. Elle est censée protéger
l'acheteur, mais elle repose sur le vendeur à qui on ne le dit pas, car
c'en serait fini de vouloir vendre en France "
...
De même, on peut faire remarquer que dans les instances judiciaires
ayant abouti à des annulations au titre de l'erreur sur les
qualités substantielles, mais qui trouvent leur origine dans des erreurs
d'attribution, la responsabilité des experts et des
commissaires-priseurs est rarement mise en cause ;
Ø d'autres voient dans cette garantie, hier encore trentenaire, et
demain décennale, un avantage décisif du marché
français qui offrirait une sécurité maximale aux acheteurs
en garantissant l'authenticité des objets vendus, oubliant qu'en
matière d'attribution, il n'y a, en dépit de décisions
judiciaires réitérées, guère de certitudes pour les
oeuvres anciennes.
Les anglo-saxons ne s'y sont pas trompés en n'acceptant de ne
rembourser - dans un délai de cinq ans - que les faux
caractérisés
ou en ne donnant leur garantie que pour les lots
postérieurs à 1870 et encore sous certaines conditions
Réduire la responsabilité à 10 ans est
déjà un progrès considérable, qu'il conviendrait de
poursuivre, tout en notant que l'action en annulation de la vente pour erreur
sur les qualités substantielles de la chose, reste en ce qui concerne
l'action du vendeur, prescrite par cinq ans à compter de la
découverte de l'erreur.
En matière de paiement du prix, il faut rappeler que :
Ø ni le procès verbal d'adjudication, ni les bordereaux
subséquents, constatant la vente intervenue entre le vendeur et
l'adjudicataire, ne sauraient avoir pour effet de mettre une dette
contractuelle à la charge du
commissaire-priseur
(mais sa
responsabilité délictuelle est engagée), qui
n'est donc
pas tenu de verser le prix, en cas de défaillance de l'acheteur
, et
ce, quand bien même le vendeur ne pourrait plus récupérer
son bien ;
Ø le transfert de propriété a lieu au moment où
retombe le marteau ; d'où la procédure, d'utilisation assez
rare, selon les informations communiquées au rapporteur par la
chancellerie, de vente à la " folle enchère "
79(
*
)
, peu protectrice du propriétaire du bien.
Le système anglo-saxon, qui consiste à ne procéder au
transfert de propriété qu'après le paiement total du
prix
80(
*
)
, apparaît d'autant plus
protecteur qu'il s'accompagne de l'enregistrement préalable des
enchérisseurs - on ne peut mettre une enchère qu'au moyen un
panneau portant un numéro -, dont la solvabilité et la
notoriété sont systématiquement vérifiées.
Il ne faut donc pas perdre de vue que le fait que le système
français actuel n'assure pas une protection aussi étendue qu'on
l'affirme souvent et que la volonté légitime de garantir les
droits des vendeurs et des acheteurs plus explicitement que dans les pays
anglo-saxons, peut nuire à la sécurité des transactions et
donc au dynamisme du marché de l'art, sans pour autant apporter la
preuve d'une meilleure protection du consommateur.
e) Améliorer l'environnement des marchands et collectionneurs
A
certains égards le marché de l'art fonctionne comme d'autres
marchés. Pour attirer ou retenir marchands et collectionneurs
internationaux, il en va comme pour l'investissement international, il faut
créer un environnement favorable à l'implantation, qui ne
dépend pas seulement de mesures fiscales.
Le dynamisme du marché dépend en partie des liens qu'il
entretient avec la communauté des historiens d'arts et des
conservateurs.
(1) Reconnaître le rôle indispensable du marché
On n'a
que trop tendance à opposer marché et histoire de l'art : au
contraire, il est des synergies évidentes et à cet égard,
la création de
l'Institut national d'histoire de l'art ne peut que se
nourrir et réciproquement d'un marché de l'art dynamique.
Le marché a joué un rôle essentiel dans les
" progrès " de l'histoire de l'art et, notamment, dans la
multiplication des redécouvertes qui caractérise l'histoire de
l'art depuis deux siècles.
Ce qu'on sait pour l'art contemporain est également vrai en art
ancien : les marchands sont à l'avant-garde du goût, en
avance, bien souvent, sur les musées. Les exemples pourraient être
multipliés - on pense aux orientalistes ou aux écoles nordiques
du XIX
ème
pour montrer que le marché explore
systématiquement les filons délaissés par le goût
dominant.
La personnalité d'histoire de l'art éminents comme celle de
Bernard Berenson mais aussi de Roberto Longhi sont l'occasion d'évoquer
ces rapports fructueux. Ce n'est pas une tradition française pour
laquelle l'art ne fait pas bon ménage avec l'argent mais il faut
rappeler que l'efficacité des grandes maisons de vente anglaises tient
pour une bonne part à la qualité des historiens d'art avec
lesquels elles entretiennent des liens et à celle de la documentation
disponible à Londres pour ses experts.
Les services offerts par le nouvel institut et notamment l'existence d'un
centre de documentation et d'une " iconothèque " comme sa
localisation sont des éléments qui doivent être pris en
compte pour apprécier la compétitivité de la place de
Paris et, en particulier de l'Hôtel Drouot.
De son côté
,
M. Claude Blaizot a signalé lors de son
audition par le rapporteur qu'un marché n'était dynamique que si
ses règles étaient à la fois claires et définitives
et que leur changement perpétuel en France avait engendré la
frilosité des grands collectionneurs à l'égard de son
marché.
LES
CONSERVATEURS ET LE MARCHÉ
réponse de la Direction des musées de France
Les
conservateurs du patrimoine comme tous les fonctionnaires, sont soumis aux
obligations inscrites dans le statut général de la fonction
publique ou dans des réglementations particulières.
Ils doivent ainsi respecter l'interdiction de cumul de fonction et de
rémunération (décret-loi du 29 octobre 1936). L'article 25
de la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires précise que ceux-ci " ne
peuvent prendre par eux
mêmes ou par personnes interposées dans une entreprise en relation
avec l'administration à laquelle ils appartiennent, des
intérêts de nature à compromettre leur
indépendance".
Le délit d'ingérence est
également sanctionné par les articles 432-12 et 432-13 du nouveau
code pénal.
Par ailleurs, l'article 26 de la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 rappelle
l'obligation de secret et de discrétion professionnelle qui s'impose
à tout bon fonctionnaire pour tous les faits, informations ou documents
dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions.
Ces dispositions de la loi de 1983 figuraient déjà dans le texte
du statut général de 1946. Leur application constitue un premier
frein à la réalisation d'expertise par les conservateurs.
Dans le cas des conservateurs de musées, ces dispositions
générales ont été complétées et
précisées par des dispositions propres au statut de leur corps.
Ainsi, le décret n° 63-973 du 17 septembre 1963 relatif au statut
particulier des membres de la conservation des musées de France,
prévoyait à l'article 7 que
" ne peuvent occuper les
emplois régis par le présent décret, les personnes qui se
livrent directement ou indirectement ou dont le conjoint se livre au commerce
ou à l'expertise des oeuvres d'art et des objets de collection "
.
Dans le décret modifié n° 70-51 du 8 janvier 1970, qui
a abrogé et remplacé le décret de 1963, les dispositions
de l'article 7 précité sont intégralement reprises, terme
à terme.
Les décrets n° 90-404 et 405 du 16 mai 1990 portant statut
particulier des corps des conservateurs et conservateurs généraux
du patrimoine concernent non plus les seuls conservateurs des musées
mais aussi ceux relevant des spécialités suivantes :
archéologie, archives, inventaire général et monuments
historiques.
Les articles 8 et 4 de ces textes disposent que
"les membres de ces corps ne
peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à
l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collections",
Il faut souligner que ces dispositions se retrouvent, en termes identiques,
dans le statut des cadres d'emplois des conservateurs territoriaux du
patrimoine (décret n° 91-839 du 2 septembre 1981, article 29) et
des attachés territoriaux du patrimoine (décret n° 91-843 du
2 septembre 1991, article 26).
Depuis le décret de 1963, tous ces textes statutaires prévoient
toutefois, qu'après autorisation du ministre ou de l'autorité
territoriale, les conservateurs du patrimoine
"peuvent procéder
à des expertises ordonnées par un tribunal ou donner des
consultations à la demande d'une autorité administrative".
L'interdiction qui est faite aux conservateurs de musée de
procéder à des expertises d'oeuvres ou d'objets à la
demande de personnes privées apparaît comme une mesure
déjà ancienne et dont le rappel dans les différents textes
statutaires rappelés ci-dessus, renvoie aux tâches des
conservateurs et à l'exercice habituel de leurs missions. Les
conservateurs sont en effet chargés de " conserver,
entretenir,
enrichir les collections qui leur sont confiées par l'autorité
représentant la personne morale propriétaire " le
décret statutaire de 1970 ajoutant même qu'ils
"étaient chargés de proposer des moyens d'accroître les
collections".
L'interdiction de faire des expertises pour des tiers est indispensable pour
que les conservateurs préservent leur impartialité et leur
objectivité, et pour qu'ils n'apparaissent pas comme juge et partie lors
d'opérations d'enrichissement des collections publiques.
Beaucoup de ces opérations sont le résultat de dons ou d'achats
sur le marché (vente aux enchères ou de gré à
gré .... ) qui s'effectuent selon les règles relevant du droit
commun. Mais les conservateurs disposent également de
prérogatives de puissance publique. Les procédures d'acquisition
qui sont propres à l'administration sont :
- la préemption en vente publique dont l'exercice est toujours
réservé à l'État mais celui-ci peut l'exercer
à la demande et pour le compte des collectivités territoriales.
- le processus d'exportation des oeuvres d'art et en particulier la
délivrance d'un certificat pour permettre la sortie temporaire ou
définitive hors du territoire douanier de biens culturels autres que
ceux qui ont été définis comme trésors nationaux.
(qui s'est substitué depuis la loi n° 92-1477 du 31
décembre 1992 au droit de retenue en douane)
- la dation en paiement de droits de succession : les conservateurs
participent, dans ce cas, à la préparation des dossiers
Par l'interdiction des expertises, les agents publics n'interviennent sur le
marché de l'art que dans les cas rappelés ci-dessus qui sont
étroitement encadrés par la législation. Dans ces
conditions, le marché peut jouer parfaitement son rôle de mise en
relation de l'offre et de la demande. Sont ainsi préservés les
rôles et fonctions des différents intervenants privés sur
ce marché (commissaires-priseurs, marchands, critiques, etc ... ).
Faute d'étude comparative, il est délicat de donner des
précisions sur la situation à l'étranger.
Il faut toutefois signaler que le Conseil international des musées,
l'IC.O.M., organisation internationale non gouvernementale liée à
l'U.N.E.S.C.O., a adopté en 1986 un code de déontologie
professionnelle applicable par l'ensemble de ses adhérents dans le monde
entier qui vise lui aussi à interdire l'expertise par les conservateurs.
Selon ce code, il " ne
faut pas délivrer des certificats
d'authenticité ou estimations écrites (évaluations) et on
ne doit donner d'avis sur la valeur monétaire d'objets que sur demande
officielle d'un autre musée ou des autorités juridiques
gouvernementales, ou autres autorités responsables publiques
compétentes".
(2) Vers un assouplissement des relations entre les conservateurs et le marché?
M.
Jean-Pierre Changeux, président de la commission des dations, a
précisé lors de son audition, insisté sur la
nécessité de développer
une capacité d'expertise
de niveau international
, en s'interrogeant, à cet égard,
"
sur la légitimité des règles qui interdisent aux
conservateurs de faire état de leur opinion d'expert, soulignant que,
dans son domaine d'activité, on encourageait les chercheurs à
établir des liens avec les entreprises, et que, par ailleurs, il est
tout à fait admis que les professeurs de droit donnent des consultations
juridiques
".
D'autres personnalités entendues par le rapporteur ont pris des
positions inverses; M. André Chandernagor, notamment, a fait savoir
"qu'il n'était pas favorable à ce que les conservateurs des
musées nationaux soient autorisés à procéder
à des expertises à la demande de tiers. Le mélange des
genres aboutirait inévitablement à la mise en jeu de la
responsabilité de l'État".
Le rapporteur a joint pour illustrer le droit et la pratique une réponse
adressée au rapporteur sur le fondement de l'interdiction d'expertise,
qui fait l'objet de l'encadré ci-contre.
(3) Définir un code de bonne conduite
Longtemps, les marchands ont subi avec quelques irritations
rentrées, l'exercice par les conservateurs des pouvoirs
quasi-proconsulaires, dont les dotait la loi.
Le droit de rétention, aujourd'hui supprimé, était
perçu par de nombreux marchands comme la
manifestation de
l'arbitraire
du pouvoir,
car celui-ci leur faisait perdre un affaire
et surtout un client, qui ne pouvait manquer d'être déçu de
ne pas pouvoir prendre possession de son achat. Le ressentiment était
d'autant plus vif que les marchands avaient souvent l'oeuvre depuis longtemps
dans leur vitrine et que c'était précisément, au moment
où ils avaient enfin trouvé un client que l'administration qui
connaissait la chose de longue date, se décidait à l'acheter.
L'irritation n'était pas moins vive, lorsque la rétention
était opérée après une vente publique où
l'État aurait pu exercer son droit de préemption ce qui aurait
déçu moins d'espoirs.
Bref, les marchands avaient le sentiment que les conservateurs faisaient - une
fois par semaine aux douanes - systématiquement leur "marché",
sans aucun respect pour la clientèle des marchands.
Les conservateurs, de leur côté avaient la conviction de faire
leur devoir de gardien du patrimoine national et trouvaient logique, compte
tenu de la modicité de leurs crédits, d'attendre que l'oeuvre
soit présentée en douane pour l'acquérir, espérant
sans doute jusqu'au dernier moment qu'elle soit finalement achetée par
un Français.
Des relations de négociation sur le mode du "donnant donnant" avaient
parfois tendance à s'établir et l'on a souvent laissé
entendre que certains dons aux musées émanant de marchands
étaient la contrepartie des autorisations ou des possibilités de
sorties qui leur avaient été accordées.
Avec le nouveau régime de circulation des oeuvres, les relations entre
marchands ont pris un tour différent, qui peuvent laisser espérer
l'instauration de relations plus confiantes.
Le droit de préemption est, dans l'ensemble, bien accepté par les
opérateurs, à condition de ne pas en abuser. Peut-être,
pourrait-on envisager d'en codifier l'usage par une sorte de bonne conduite par
lequel l'État s'engagerait notamment à ne pas l'utiliser pour de
trop petits achats ou pour des oeuvres en importation temporaire ; de
même on peut se demander s'il est bien normal que l'État puisse -
sauf indisponibilité des crédits - ne pas exercer son option et
rendre à l'adjudicataire, qui se retrouve ainsi propriétaire d'un
bien refusé par l'État.
Un autre point pouvant faire l'objet d'un code de bonne conduite serait que
l'État n'exerce pas son droit de préemption sur les oeuvres en
importation temporaires ou qu'il ne renonce pas à l'objet
préempté, sauf nécessité réglementaire
(indisponibilité des crédits...).
Enfin, plus important encore, serait pour l'État de renoncer à
refuser de délivrer un certificat pour des oeuvres importées
régulièrement en France depuis moins de cinquante ans afin de ne
pas laisser craindre à certain collectionneurs qu'ils puissent
être "piègés", s'ils mettent leur collection en France.
Le dynamisme d'un marché repose sur la présence permanente de
grands collectionneurs comme en témoigne, à certains
égards, la position prééminente de la France au
début des années cinquante. Il est sans doute difficile de
regagner culturellement le terrain perdu, mais comme cela a été
un moment envisagé par le précédent Gouvernement, il
conviendrait de réfléchir à la possibilité
d'aménager un statut privilégié pour les grands
collectionneurs internationaux qui souhaiteraient avoir une résidence en
France.
4. Préserver le patrimoine national dans un marché ouvert
Ainsi
qu'on l`a déjà rappelé, la France a choisi de s'aligner
sur les dispositions libérales définie au niveau communautaire.
Elle a choisi une solution à l'anglaise plutôt qu'à
l'italienne, dans laquelle presque tout le patrimoine à caractère
mobilier est pour ainsi dire gelé par une politique de classement
systématique. Elle a préféré un régime de
liberté au système italien, très protecteur, certes, mais
débouchant sur un important commerce parallèle.
Mais si elle a choisi la liberté des échanges, elle ne s'est pas
donné les moyens financiers de sa politique.
Il en résulte une hémorragie, qui se traduit par des
"
excédents
"
records en matière
d'échanges d'oeuvres d'art
, qui culminent au niveau
désormais de 2 milliards de francs
par an.
M. Chandernagor, notamment, l'a clairement énoncé devant le
rapporteur : dans un régime ouvert, la protection du patrimoine
coûte cher ; il faut donc s'en donner les moyens ".
C'est ce que propose le rapporteur en reprenant notamment certaines des
propositions de M. Aicardi, qui sont toujours aussi actuelles, anticipant sur
le projet de loi envisagé par le les gouvernements successifs mais qui
n'en finit pas de rester dans les cartons.
Ces propositions devraient s'inscrire dans le cadre d'une évolution plus
générale de la politique d'enrichissement du patrimoine national
faisant plus de place au temps et moins à l'urgence, plus aux
collectionneurs privés et moins à l'Etat.
a) Un principe pour l'État : faire acheter plutôt qu'acheter
La
défense du patrimoine suscite naturellement dans les pays latins des
attitudes protectionnistes. Il faut empêcher les oeuvres de sortir, tel a
été longtemps le leitmotiv de tous ceux qui se voulaient les
défenseurs des arts.
Hier, il suffisait d'interdire, aujourd'hui, il faut acheter et c'est beaucoup
plus difficile voire impossible, vu l'ampleur de l'hémorragie .
D'où le cri d'alarme des conservateurs qui assistent, impuissants, au
vidage de la France de son patrimoine, dont on retrouve l'écho dans un
éditorial non signé de la Revue de l'art qui, témoigne de
ce que la France alimente les ventes d'art ancien à Londres comme
à New-York.
"
Les deux ventes de tableaux anciens de New York du mois de janvier, chez
Christie's (29 janvier 1998) et chez Sotheby's (30 janvier), ont fait
sensation. Les prix atteints ont confirmé la vigueur du marché.
On a pu lire que de nombreux acquéreurs estimaient que les tableaux
anciens demeuraient bon marché, à qualité égale
(l'expression mériterait un commentaire), par comparaison avec la
peinture postérieure à 1800, à plus forte raison avec les
Impressionnistes. D'où provenaient ces tableaux ?
Christie's, n° 118 : une Nature morte de Juan van der Hamen y
Leon (1596-1631), se vendit pour 662 500 dollars (environ 4 millions
de francs). Le 16 juin 1997, à Lille, le même tableau
avait été adjugé pour 600 000 francs (hors
catalogue dans cette vente).
Sotheby's, n° 43 : L'archange saint Michel était vendu
sous le nom de Carlo Dolci (1616-1686) pour 354 500 dollars (environ
2 200 000 francs). A Drouot, le 30 mai 1997, mais sous une
attribution à Cesare Dandini (n° 5 du catalogue reproduit), le
tableau avait été adjugé au prix de
240 000 francs. Le catalogue de New York précisait que le
tableau provenait de France.
Sotheby's, n° 54 : un Joueur de luth chantant de Hendrick Ter
Brugghen (1588-1629) se vendit pour 321 500 dollars (2 millions
de francs environ). Le commissaire-priseur en avait obtenu à Rouen,
moins d'un an auparavant, le 9 février, 810 000 francs
(n° 51, reproduit en couleurs).
Autre cas bien plus modeste, mais exemplaire. Il s'agit, cette fois-ci, d'un
dessin : vendue chez Christie's le 30 janvier 1998 (n° 59,
reproduit) comme de Turchi (1578-1649) pour 6 900 dollars, cette
Vierge à l'Enfant accompagnée d'une sainte avait
été adjugée à Drouot, le 14-16 mars 1994
(n° 298, reproduit au catalogue), pour 3 800 francs.
Dernier exemple, particulièrement frappant : Sotheby's,
n° 137, Rubens : la Tête de saint Jean-Baptiste
présentée à Salomé. Ce chef-d'oeuvre de la jeunesse
du grand maître flamand se vendit pour 5 500 000 dollars
(environ 33 millions de francs). En vente publique à Fontainebleau
le 14 juin 1987, le même tableau avait été
adjugé pour 1 558 000 francs avec les frais.
Et pour faire bonne mesure, interrogeons-nous sur le prix que le musée
de Kansas City aux Etats-Unis a pu offrir pour un Saint Jérôme du
rare Tanzio da Varallo (1575/80-vers 1635 ; l'artiste semble absent des
collections publiques françaises). L'oeuvre, reproduite au catalogue
(n° 20) s'était vendue à Drouot le
11 décembre 1996 pour 1 100 000 francs (hors
frais) comme " Ecole flamande du XVII
e
siècle ".
Il serait fastidieux de multiplier les exemples. Contentons-nous de quelques
remarques, brutales dans leur sécheresse.
Ces cas sont contrôlables. Nous ignorerons toujours le nombre exact de
tableaux des ventes de Sotheby's et de Christie's qui provenaient de France,
qu'ils aient été exportés légalement ou
frauduleusement, qu'ils soient passés en vente publique ou qu'ils
proviennent du commerce, de foires de toutes natures ou de collections
particulières. D'après les rumeurs du commerce parisien, ce
serait près de la moitié des 550 lots des deux ventes de New
York qui auraient une provenance française récente.
Nous avons insisté sur les ventes publiques car elles étaient
" vérifiables ". Mal attribués, mal catalogués
(ou non catalogués), vendus sans publicité, ces tableaux se sont,
en France, mal vendus. Au détriment de leurs propriétaires.
Comment, dès lors, s'étonner, que ceux-ci se tournent, de plus en
plus nombreux, vers les salles de ventes anglaises ?"
Face à cette situation critique, le rapporteur voudrait faire
évoluer les esprits en développant l'idée selon laquelle,
non seulement l'État ne peut mais surtout il ne doit pas tout acheter.
Il faut, en effet, faire plus de place aux collectionneurs privés et
à l'initiative privée, en général, dans la
protection et l'enrichissement et la protection du patrimoine mobilier de la
France.

(1) L'État ne peut et ne doit pas tout acheter
L'État ne peut pas tout acheter pour des raisons
financières évidentes. Les crédits d'acquisitions des
musées, tous secteurs confondus, atteignent à peine 130 millions
de francs en 1997 ; si l'on ajoute, la dépense fiscale
correspondant à la valeur des dations acceptées, la somme totale
atteint une somme de 300 millions de francs la même année, qui est
manifestement, une des années les plus fastes de la décennie.
L'année précédente, en 1997, le montant des oeuvres
acceptées en dation ne se montaient qu'à 28 millions contre 163
millions de francs en 1997, ce qui témoigne on peut le noter au passage
le bon fonctionnement de la dation qui consiste pas à dépenser
une somme déterminée mais à tenir compte des
opportunités. C'est ce non plafonnement de la dépenses fiscale
sur laquelle a insisté M. Jean-Pierre Changeux, lors de son audition et
qui fait toute la force et l'intelligence de la procédure.
Or, si l'on additionne les valeurs de toutes les oeuvres dont le certificat a
été refusé par la commission des "trésors
nationaux" et qui vont très certainement être
représentées et qui vont donc sortir avec les conséquences
que l'on sait pour les finances publiques - cf. encadré ci-contre sur
l'affaire Walter - on aboutit à
un montant total d'oeuvres
en
attente
de l'ordre
d'un milliard de francs
.
Au surplus, dans le régime actuel, l'État ne peut pas acheter
l'oeuvre si son propriétaire refuse de la lui vendre en spéculant
sur le fait qu'on n'engagera pas de procédure de classement pour
éviter que l'État soit amené à payer des sommes
importantes pour une oeuvre dont il n'est même pas propriétaire.
Le projet de loi en cours d'élaboration devrait mettre un terme à
cette anomalie en mettant en place un système inspiré de la
législation britannique.
Mais surtout l'État ne doit pas tout acheter :
•
il ne faut pas d'abord négliger l'impact sur le rayonnement
culturel de la France des oeuvres prestigieuses qui partent à
l'étranger
: il est particulièrement souhaitable que le
musée Getty expose et achète des oeuvres françaises, car
dans cette région des États-Unis, la France est presque
totalement absente sur le plan culturel. La France a perdu des oeuvres, voire
des collections entières qu'elle aurait pu acheter ou qui aurait pu lui
être données, mais force est bien d'admettre que les grandes
baigneuses de Cézanne ou la Madeleine de Georges de La Tour,
respectivement à Philadelphie et Washington, font, au-delà de
l'émotion initiale, beaucoup pour l'image de la France et le prestige de
la culture française ;
• on ne peut manquer de souligner
un biais important dans la
politique d'achat des musées qui ont tendance à retenir ce qui
est déjà sur le territoire français, alors même
qu'il serait parfois plus opportun de rapatrier des oeuvres essentielles ou de
faire rentrer des oeuvres qui nous font cruellement défaut
si l'on
veut que le musée du Louvre notamment puise présenter comme
devait le faire le Museum de Napoléon, le plus beau rassemblement de
chefs-d'oeuvre du monde entier. A cet égard, il faut sans doute faire
preuve d'esprit critique et considérer que certains exemples de
mobilisation au niveau national pour empêcher le départ d'une
oeuvre, au demeurant austère, d'un peintre dont les musées
français sont largement dotés est moins utile à
l'enrichissement du patrimoine national que l'achat d'un beau tableau figuratif
de tel ou tel peintre de la Sécession viennoise, ou .des beaux paysages
de l'école anglaise qui manquent aux collections nationales.
M. Neil Mac Gregor, Directeur de la National Gallery de Londres pose à
cet égard une question fondamentale :
"
Est-ce qu'on cherche principalement à protéger ou
à enrichir le patrimoine
? Le choix anglais reconnaît
que fort souvent, les oeuvres d'art qui se trouvent dans les collections
privées sont du même type que celles que possèdent
déjà les musées nationaux, pour la raison très
évidente que ceux-ci ont été en grande mesure
formés de celles-là. Si l'on veut que les collections publiques
se dotent d'oeuvres jusqu'ici peu appréciées ou peu
collectionnées par les amateurs dans notre pays, il faut réserver
une partie des fonds disponibles pour acheter au-delà des
frontières. C'est ce qu'a fait récemment The Heritage Lottery
Fund, permettant à la Tate Gallery d'acheter à l'étranger
un beau Mondrian, alors qu'il n'avait pas aidé un peu plus tôt
à empêcher le départ d'un portrait britannique, beau,
certes, mais infiniment moins rare dans les collections anglaises que Mondrian.
C'est-à-dire que le but principal n'est pas de retenir ce qui se
trouver, souvent par hasard, sur le sol national, mais de créer, avec le
fonds de la loterie, les meilleures collections possibles pour les
générations futures
".
De toute façon, pour avoir ce recul et cette
sérénité que suppose la stratégie exposée
ci-dessus, il convient de
mettre en place un système
qui
permette enfin aux Musées de France de cesser d'intervenir
très souvent dans l'urgence
et à mener une politique d'achat
constamment sous pression.
(2) La collectivité a tout intérêt à inciter les collectionneurs privés à se porter acquéreurs des " trésors nationaux "
Faire
faire plutôt que faire, tel est le principe qui devrait guider, chaque
fois que cela est possible, la politique de préservation du patrimoine
national.
L'intérêt est d'abord financier, puisque l'on soulage d'autant des
budgets d'acquisitions, dont on sait qu'ils sont toujours insuffisants.
A cet égard, le rapporteur tient à indiquer que s'il approuve
l'idée d'imiter les anglais en prélevant sur les ressources du
Loto
81(
*
)
, à l'instar de ce qui se fait
pour le sport les crédits nécessaires aux acquisitions, il reste
sceptique sur ses chances d'aboutissement et considère qu'il vaut mieux
fonder ses espoirs sur d'autres mécanismes pour protéger le
patrimoine national.
En particulier, il semble préférable d'accorder des avantages
fiscaux à toutes les personnes qui contribueront au maintien sur notre
sol de nos "trésors nationaux". Il y a là un effet de levier
d'autant plus important que le niveau d'imposition dans notre pays est -
malheureusement - élevé. On pourrait même y voir une
tactique consistant à faire d'une faiblesse - notre niveau
élevé de taxation - une force au service de
l'intérêt national.
Le rapport Aicardi rappelle à cet égard : "
c'est
une évidence que de la dire mais on peut la rappeler :
toute
grande oeuvre détenue par un résident français reste dans
le patrimoine national et son maintien ne nécessite pas de la part de
l'État une intervention toujours onéreuse pour les finances
publiques. On peut ajouter que la détention privée d'une oeuvre
plutôt que publique, décharge l'État du soin d'assurer son
entretien et sa surveillance et la transfère au propriétaire qui
participe ainsi à la politique de maintien du patrimoine.
"
Et, qui sait, peut-être réussira-t-on par l'octroi de ses
avantages fiscaux à créer une dynamique de la collection en
France et que les personnes qui rechercheront les oeuvres d'art "trésors
nationaux" pour les avantages fiscaux qui leur sont attachés, se
prendront au jeu et se transformeront en véritables
collectionneurs.
b) Un premier moyen : assortir le classement d'avantages fiscaux
Le classement emporte dans certains cas déjà l'octroi d'avantages fiscaux. Mais on peut aller sensiblement plus loin pour favoriser le maintien des oeuvres classées sur le territoire national.
(1) Les avantages accordés au mobilier de certains monuments historiques en matière de droits de mutation
La loi
du 5 janvier 1988 a prévu " l'exonération des droits de mutation
pour les immeubles classés ou inscrits ainsi que les meubles,
classés ou non, inclus dans le circuit de visite, qui en constituent le
complément artistique ou historique, ". Cette mesure a pour but
d'éviter que le mobilier et les collections rassemblées ne soient
dispersés par les héritiers pour payer les droits de succession.

Pour bénéficier de cette exonération, les héritiers
doivent souscrire une convention à durée
indéterminée, dans les conditions prévues par un
décret du 21 avril 1988, avec le ministre de la Culture et le ministre
des Finances qui décrit l'immeuble et énumère les biens
meubles et immeubles par destination complémentaire
82(
*
)
.
Cette convention entraîne des obligations à la charge des
héritiers, qui doivent maintenir sur place les décors et objets
énumérés et permettre au public d'accéder au moins
cent jours par an entre avril et octobre aux biens exonérés
faisant l'objet de la convention. Cette durée de visite peut
éventuellement être diminuée si les héritiers
permettent à des collectivités publiques ou à des
associations sans but lucratif de présenter gratuitement au public ces
objets mobiliers. Les héritiers doivent également s'engager
à entretenir les biens et assurer le contrôle des dispositions de
la convention par les services du Ministère de la Culture et du
Ministère de l'Économie et des Finances.
Entre 1990 et octobre 1998, 34 conventions ont été conclues au
titre de la procédure prévue à l'article 795 A du code
général des impôts. 16 d'entre elles comportent une
liste d'éléments de décor (meubles et immeubles par
destination
).
Il s'agit d'immeubles par destination comme les boiseries, cheminées,
vitraux, fresques murales, lambris, dessus de portes ou des meubles se
composant de tableaux, de statues, de mobilier (lit, table, ... ), de lustres,
de glaces et de vases.
Six conventions sur les seize ne mentionnent pas d'évaluation des
éléments de décor (généralement
constitués d'immeubles par destination). Sur les dix autres conventions,
la valeur des biens mobiliers va de 60 000 F à 2 489 750 F pour un
total de 8 Millions de francs environ.
Le rapport Aicardi a considéré, comme ont l'a déjà
indiqué succinctement, que le système est très
pénalisant pour le propriétaire, lorsqu'il rompt la convention
avec l'État
.

"
A l'heure actuelle, le système est très
pénalisant pour le propriétaire lorsqu'il décide de rompre
la convention avec l'État.
Les droits de succession sont alors rappelés après application
d'intérêts de retard qui courent à compter du jour de la
signature de la convention (et non du jour de sa dénonciation) et sur la
base de la valeur actualisée du bien en question (au jour où la
convention n'est pas respectée),
"
Trois éléments donnent un caractère dissuasif
à ce régime :
le prix du temps écoulé est pris en compte deux fois par le
biais des intérêts de retard et de la -valeur actualisée.
Le montant cumulé des intérêts de retard peut doubler la
valeur du bien ;
ce système équivaut à considérer que la
convention, en cas d'extinction., n'a jamais été respectée
alors que, pourtant, elle l'a été temporairement ;
enfin, les droits sont d'autant plus lourds que la convention a longtemps
été respectée. Celui qui a respecté sur une longue
période la convention qu'il a signée est moins bien traité
que tel qui a renoncé plus rapidement à ses engagements.
Pour "adoucir" la sortie du dispositif, il conviendrait d'abandonner
l'actualisation de la base, qui fait double emploi avec le calcul des
intérêts de retard. On mettrait ainsi fin à l'anomalie que
constitue la double facturation du temps.
Quant au paradoxe qui conduit à d'autant plus taxer le
propriétaire qui a longtemps respecté la convention, il pourrait
être levé en plafonnant le montant des intérêts de
retard. "
(2) L'exonération des biens classés des droits mutations et accessoirement de la taxe forfaitaire
La
différence de niveau entre le marché mondial et le marché
français est considérable :
le prix d'un objet peut
varier de 1 à 2 voire de 1 à 5, selon qu'il peut ou non
être négocié sur le marché international
.
L'affaire du tableau de Van Gogh, le Jardin à Auvers, qui fait l'objet
de l'encadré ci-contre - montre que le classement est une mesure
coûteuse, puisqu'en l'état actuel du droit, il faut donner au
propriétaire de l'oeuvre classée une indemnité
représentative de la différence de prix, soit en l'occurrence 140
millions de francs.
Au système actuel, qui place l'Etat dans une situation impossible
où il lui faut soit classer l'oeuvre avec toutes les conséquences
financières ou de laisser sortir l'oeuvre dans la cas où le
propriétaire se refuse.
AFFAIRE WALTER
" LE JARDIN À
AUVERS "
L'analyse de la direction des musées de France
M. Jacques Walter a acquis en 1955 un tableau de Vincent
Van
Gogh intitulé " Jardin à Auvers ". A la suite d'une
demande d'autorisation d'exportation en Juin 1982, refusée, le tableau a
été classé d'office parmi les monuments historiques
confirmé par décret du 28 juillet 1989, décret contre
lequel M. Walter a exercé un recours, rejeté par
l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 juillet 1992.
M. Walter a ensuite demandé à l'Etat l'indemnisation du
préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de la décision de
classement, à hauteur de 250 millions de francs. Il fondait sa
demande sur l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 relatif
à l'indemnisation du préjudice résultant de l'application
de la servitude de classement d'office.
L'Etat fut condamné à payer la somme de 422.187.693 francs
(jugement du TGI Paris 22 mars 1994), indemnisation réduite
à la somme de 145 millions de francs par arrêt de la cour
d'appel de Paris du 6 juillet 1994. La cour de cassation ayant rejeté le
pourvoi formé contre cette décision, le ministère de la
culture a versé une indemnité de 147.920.657,54 francs. Les
frais de procédure ont été pris en charge par l'agent
judiciaire du Trésor (ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie) qui a assuré la défense de l'Etat
dans le cadre de son mandat légal.
Par sa jurisprudence, le juge a donné la priorité au respect des
droits du propriétaire sur la protection du patrimoine. Pour la
première fois le juge se prononce en faveur de l'octroi d'une
indemnité du propriétaire en la matière. Cet arrêt
revêt une importance tout à fait particulière, à la
fois sur le plan juridique et par ses conséquences pratiques.
Sur le plan juridique, la cour de cassation a opéré un revirement
de jurisprudence et a confirmé la méthode des juges du fond quant
à l'évaluation de l'indemnité résultant d'un
classement d'office.
En effet la cour de cassation a rejeté le moyen avancé dans son
pourvoi par l'Etat, à savoir que le dommage subi par M. Walter avait un
caractère incertain dès lors qu'à défaut du
classement d'office, le ministre de la culture aurait pu, de manière
discrétionnaire, sur le fondement de la loi du 23 juin 1941 (en
vigueur à l'époque des faits), refuser l'autorisation d'exporter,
ce qui aurait provoqué un préjudice identique, non indemnisable.
Ce moyen rencontrait pleinement la jurisprudence de la cour de cassation qui
avant l'affaire en question avait cassé le 28 mai 1991 l'arrêt
rendu dans l'affaire Schlumpf, allouant une indemnité pour le classement
d'office d'une collection de voitures.
Dans son jugement la cour de cassation a relevé que la cour d'appel a
souverainement retenu que le refus d'autorisation d'exportation notifié
à M. Walter en octobre 1989 se fondait sur la seule mesure de
classement d'office du tableau et qu'elle en a justement déduit que le
préjudice avait pour seule origine cette mesure de classement d'office,
qui en vertu de l'article 16 de la loi de 1913 ouvrait au
propriétaire un droit à indemnisation et que dès lors le
préjudice étant né du seul fait que le bien ne peut
quitter le territoire national, sa cause n'est rien d'autre que la perte du
marché international et il s'évalue en comparant le prix de vente
du tableau en France avec ceux d'oeuvres comparables vendues sur le
marché international à la date du classement.
On peut regretter que le juge ne se soit pas interrogé plus avant sur
l'existence avérée du préjudice et le caractère
certain et direct de celui-ci, qui ne pouvait naître qu'avec la
volonté d'exporter (affirmée, il est vrai, par M. Walter), et
qu'il n'ait pas interprété l'existence de ce préjudice au
regard du contexte de l'affaire. En outre, l'appréciation de la
servitude due à un classement parmi les monuments historiques doit
prendre en considération les autres conséquences de cette mesure.
E n présence d'une interdiction d'exportation la décision de
classement en elle-même n'ajoutait aucun effet juridique
spécifique, hormis les autres conséquences plutôt positives
pour le propriétaire.
Sur le montant de l'indemnité, il est intéressant de rappeler
enfin que dans l'affaire en question il y a eu une seule expertise, produite
par M. Walter. Or, M. Walter avait, en 1981 lors d'une première
demande d'autorisation d'exportation, fixé le prix du tableau à
6 millions de francs, et par ailleurs il n'avait pas opposé un
quelconque prix de réserve lors de la vente aux enchères de 1992,
pratique pourtant très courante.
Enfin, la cour de cassation en 1996 a estimé que le classement
créait un préjudice intangible, à l'inverse du refus de
certificat d'exportation qui ne créerait qu'un préjudice
temporaire, alors que le tableau avait l'objet de refus de certificat et que
par ailleurs la loi de 1913 prévoit une procédure de
déclassement.
Cette jurisprudence a rendu de fait quasiment impossible la procédure du
classement pour protéger le patrimoine mobilier national. Il peut en
effet paraître dès lors déraisonnable de faire courir au
budget de l'État le risque d'avoir de lourdes indemnités à
supporter, alors que le bien demeure entre des mains privées et n'a pas
vocation à être exposé publiquement.
Cependant, il y aurait peut-être lieu de s'interroger sur la
pérennité de cette jurisprudence, dans la mesure où la loi
du 31 décembre 1992 et ses décrets d'application sont venus
changer radicalement le régime d'exportation des biens culturels, en
prévoyant que le certificat d'exportation ne peut être
refusé une seconde fois pour le même bien si l'administration n'a
pas procédé à son classement (cf. article 9).
En tout état de cause, le ministère de la culture et de la
communication a préparé un projet de loi modifiant les lois du
31 décembre 1992, relative à la circulation des biens
culturels, et du 31 décembre 1913 relative aux monuments
historiques, qui vise à tirer les conséquences de ce contexte et
à rechercher un meilleur équilibre entre protection de droit de
propriété et protection du patrimoine national.
Il faut éviter que ce différentiel de prix ne se traduise par un
courant de sortie des oeuvres attirées par les " hautes
pressions " des marchés extérieurs.
On pourrait ainsi pour retenir les oeuvres :
• sortir les oeuvres classées de celles ayant fait l'objet
d'un refus de certificat dans des conditions à définir par la
loi, de l'assiette de l'impôt sur les mutations à titre
gratuit : en totalité pour le propriétaire de l'oeuvre au
moment du classement, en partie pour les acquéreurs
ultérieurs ;
• alléger les frais de mutation pour ce type d'oeuvres qui
pourraient être exonérées de taxe forfaitaire de l'article
150V bis
Il convient en effet de distinguer dans les avantages dont on assortirait les
oeuvres classées ou n'ayant pas obtenu de certificat, le
propriétaire de l'oeuvre au moment de la mesure des propriétaires
ultérieurs : les uns subissent de plein fouet la diminution de la
valeur de l'oeuvre ; les autres ont acheté une oeuvre
déjà frappée d'une servitude de non exportation ce qui ne
justifie pas un régime fiscal aussi avantageux.
On note que favoriser les acquéreurs ultérieurs est une
façon d'aider les détenteurs qui subissent le classement de la
conséquence du refus de certificat puisque cela crée une demande
de nature à faire augmenter le prix de marché et donc diminuer
d'autant la pénalisation consécutive à l'interdiction de
sortie résultant de la mesure de classement.
Deux points peuvent encore être précisés.
D'une part, il pourrait être opportun comme cela avait été
fait pour d'autres actifs en leur temps sortis de l'assiette des droits de
mutation, d'exiger un minimum de durée de détention avant la
mutation pour éviter un détournement de procédure, bien
évidemment contraire aux objectifs recherchés par le
rapporteur ;
De même, et sans que cela soit indispensable, il ne serait pas
inconcevable d'assortir le bénéfice de l'avantage fiscal d'une
obligation de prêt pour des expositions publiques selon un régime
allégé qui ne crée pas de gêne pour les
propriétaires des oeuvres.

c) Un second moyen : assouplir et étendre le régime de la dation
(1) La procédure actuelle
La loi
du 31 décembre 1968 a institué la dation en paiement qui permet
à " tout héritier, donataire ou légataire d'acquitter les
droits de succession par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de
collection, ou de documents de haute valeur artistique ou historique ".
La définition des oeuvres est la même que celle applicable aux
donations
83(
*
)
, mais s'agissant d'un paiement et
non d'une libéralité, l'offre de dation doit être pure et
simple, et ne peut être assortie d'aucune réserve ni condition.
Le champ d'application de la dation a été étendu par la
loi de finances rectificative n° 82-540 du 28 juin 1982 qui accorde
désormais le bénéfice des dations au paiement des droits
de mutation ou de partage et au paiement de l'impôt de solidarité
sur la fortune. Le régime est fixé par l'article 1716 bis du code
général des impôts.
Les objets qui peuvent être offerts en dation, sont ceux
mentionnés ci- dessus à l'exclusion des oeuvres d'artistes
vivants dont la valeur est plus incertaine
84(
*
)
.
Selon une pratique aujourd'hui établie, l'acceptation d'une dation est
soumise à une série de conditions restrictives. L'oeuvre doit
présenter un intérêt culturel majeur et venir combler une
lacune au sein des collections nationales.
La procédure de dation en paiement précisée à
l'article 384 A de l'annexe II du code des impôts, comporte quatre phases
principales.
L'initiative d'une proposition de dation en paiement appartient au
débiteur des droits qui s'adresse avant le terme des délais de
règlement à la recette des impôts ou à la
conservation des hypothèques territorialement compétentes, une
offre dans laquelle il précise la valeur artistique ou historique de
l'objet, la valeur libératoire proposée et justifie de son titre
de propriété sur l'objet. La proposition a pour effet de reporter
le paiement jusqu'à une réponse de l'administration, mais en
l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an,
l'offre est réputée avoir été refusée.
L'offre de dation est ensuite transmise par l'intermédiaire du
Ministère des Finances à la Commission interministérielle
d'agrément
85(
*
)
pour la conservation du
patrimoine artistique, appelée couramment " Commission des dations " qui
comprend un représentant du Premier ministre, assisté de deux
représentants du ministre de la Culture ainsi que de deux
représentants du ministre des Finances.
La Commission vérifie la régularité formelle de l'offre -
et notamment l'origine de propriété - ; elle prend l'attache
pour les dations importantes le Comité consultatif des musées
nationaux et le Conseil artistique des musées nationaux.
La décision finale qui fixe la valeur libératoire de l'oeuvre
proposée en dation relève du ministre des Finances. Celui-ci a
toujours suivi dans les faits l'avis de la Commission. Cette décision
précise toujours l'affectataire des oeuvres acceptées en dation -
ce qui ne permet pas toujours de préciser la localisation effective de
l'oeuvre. Dans la réponse écrite fournie au rapporteur par le
ministère de l'Économie et des Finances, il est
précisé :
"
La dation est la remise à l'État d'un bien pour une
valeur libératoire de l'impôt. La valeur libératoire n'est
pas une valeur marchande. C'est l'estimation de la valeur objective d'une
oeuvre qui tient certes compte de la valeur de marché mais aussi
d'autres éléments comme :
•
l'appréciation du complément que le bien
constituerait pour les collections nationales;
• la commodité pour les héritiers demandeurs de ne pas
organiser une vente qui demande du temps et induit des frais
supplémentaires;
• l'intention libérale des offreurs de voir une oeuvre entrer dans
les collections nationales.
La référence à la valeur libératoire et non
à un prix de marché évite d'ailleurs que la valeur
fixée ne serve de référence ou de cote sur le
marché de l'art, l'État n'étant pas en l'espèce un
simple acheteur participant au mouvement spéculatif de ce
marché
".
La Commission des dations qui donne son avis sur la valeur libératoire
des oeuvres offertes en dation, s'entoure de plusieurs experts,
généralement des conservateurs de musées
spécialisés en fonction de la nature de l'oeuvre offerte.
Ces experts publics rédigent une fiche d'appréciation comportant
notamment les prix obtenus en ventes publiques. Ils portent cette
appréciation sur la valeur libératoire compte tenu notamment de
l'état de l'oeuvre, de son importance pour les collections nationales et
de son intérêt artistique.
La décision d'acceptation ou de refus d'agrément de l'offre de
dation est notifiée au demandeur. Lors de son audition par le rapporteur
M. Jean-Pierre Changeux, Président de la Commission des dations,
" a souligné le caractère fondamentalement volontaire de la
procédure, dans la
mesure où l'offre initiale, qui est
assortie d'une évaluation chiffrée de l'oeuvre et d'une
expertise, peut toujours être retirée, même après
l'acceptation du ministre
. "
La Cour des comptes avait formulé les observations suivantes sur le
fonctionnement de la procédure de dation :
• l'acceptation de la procédure de dation pour les
donations-partages en l'absence de disposition législative l'autorisant ;
• l'inobservation de certaines dispositions réglementaires,
telles que l'acceptation d'offres de dation déposées plus de 6
mois après le décès du " de cujus ", l'absence d'octroi
d'un délai de 30 jours à l'offreur pour qu'il accepte
définitivement la décision ou le dépassement d'un
délai d'un an à compter du dépôt de l'offre pour la
notification de la décision définitive;
• l'imprécision des décisions d'agrément sur
des points comme la désignation des oeuvres ou documents objets de la
dation, l'origine de propriétés des biens offerts ou la preuve du
transfert de propriété à l'État des oeuvres ou
documents acceptés en dation ;
• les modalités de détermination de la valeur
libératoire, trop souvent égale au montant des droits dus.
Après les observations de la Cour des comptes, la procédure a
fait l'objet d'une série d'aménagements :
• l'application des majorations de retard, lorsque l'offre est
déposée après le délai de 6 mois à compter
du décès, sur la période courant de la fin du délai
de 6 mois jusqu'au dépôt de l'offre ;

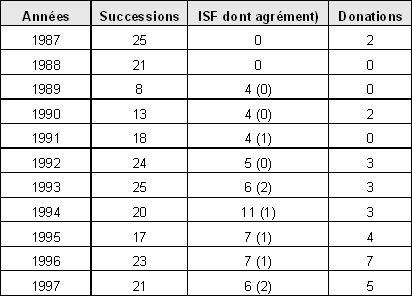
• l'intégration d'un délai de 30 jours d'acceptation
de la décision d'agrément par l'offreur de la dation ;
• la mention dans les décisions d'agrément de la
consistance de la dation en joignant une liste annexe si besoin est ;
• la recherche de l'origine de propriété des biens
offerts en dation ;
• la délivrance d'une décision d'agrément
seulement après prise en charge des oeuvres par leur
établissement affectataire ;
En ce qui concerne la valeur d'agrément, la commission prend bien garde
de distinguer, valeur libératoire et prix du marché, même
si en pratique, comme l'a indiqué M. Jean-Pierre Changeux devant le
rapporteur, la commission "
prenait toujours comme
référence le prix du marché international. La commission a
d'ailleurs constitué une banque de données lui permettant de
juger des propositions faites à la commission. Il a rappelé que
l'oeuvre faisait l'objet d'un double examen portant d'abord sur la valeur
artistique et, ensuite, sur la valeur de marché. Globalement, il a
indiqué que le bilan de la commission faisait apparaître que les
valeurs libératrices préparées par les offreurs
étaient, en général, raisonnables mais parfois
révisées à la baisse et que dans certains cas, même
révisées à la hausse par souci d'équité et
de façon à éviter toute contestation
.
Lorsque la valeur libératoire est inférieure à la dette
exigible, le débiteur s'engage à verser un complément de
droits mais dans le cas contraire l'État ne verse pas de soulte au
débiteur.
(2) Les propositions du rapporteur
On
trouve dans le rapport de la commission Aicardi exprimée l'idée
que le régime de la dation pourrait être assoupli et en quelque
sorte généralisé: les personnes privées seraient
incitées à acheter des trésors nationaux en vue de les
donner à une collectivité publique. Dans ce cas,
l'acquéreur devrait bénéficier d'un crédit
d'impôt (sur le revenu, sur le fortune, sur les sociétés,
droits de mutation) égal selon les cas à la totalité, si
la donation est pure et simple, ou à une fraction du prix d'acquisition,
s'il se réserve un usufruit limité dans le temps.
Si le crédit ne peut être épuisé dés la
première année, ce qui n'est pas improbable, ce surplus serait
reportable dans une limite à déterminer cinq à dix ans,
cette période coïncidant éventuellement avec celle de
l'usufruit). Si le crédit n'a pas été utilisé par
le donateur pour cause de décès, il serait donc transmissible aux
héritiers et dans ce cas pourrait, une fois actualisé, servir
à régler en tout ou en partie les droits de mutation.
L'idée avancée par le rapporteur est assez voisine dans son
principe mais moins ambitieuse dans la mesure où elle constitue non une
généralisation la dation à tous les impôts mais une
simple extension de la dation aux cas où la valeur des biens offerts et
acceptés en dation excéderaient - dans une proportion
raisonnable, fixée à 30 % - les droits dus.
Le régime prévoit également que pour une période de
temps limitée - fixée à 10 ans, le contribuable puisse
conserver l'
usufruit
de l'oeuvre acceptée pour laquelle il n'a
pas épuisé son crédit d'impôt.
Enfin, on pourrait songer, toujours en suivant la voie ouverte par le rapport
Aicardi à permettre à un contribuable qui ferait don à une
institution publique d'une oeuvre classée ou n'ayant pas obtenu le
certificat, de bénéficier d'un crédit d'impôt sur
les droits de mutation ou l'ISF - calculé par rapport à la valeur
de son usufruit. Une idée de ce type viendrait utilement compenser le
maigre bilan de l'exonération de l'article 1131
86(
*
)
d) Un problème grave: les mécanismes de la TVA interne jouent contre le patrimoine
La TVA
est un mécanisme qui, traditionnellement, taxe les importations et
subventionne les exportations ; en matière d'oeuvres d'art, cette
logique aboutit à des résultats particulièrement
désastreux du point de vue du patrimoine national : elle freine
l'entrée sur le territoire d'oeuvres, qui pourraient venir enrichir le
patrimoine national ; elle incite aussi les marchands à exporter.
Avant 1991, les antiquaires qui faisaient vendre aux enchères, en
France, des objets leur appartenant, ne devaient pas acquitter la TVA sur ces
ventes. Mais la loi du 26 juillet 1991 a supprimé cette
exonération. Les antiquaires doivent acquitter la taxe sur lesdites
ventes sauf si les objets en question sont exportés par les
adjudicataires.
Dans une profession où les consommations intermédiaires sont
faibles et où les possibilités de se faire rembourser la TVA sont
limitées, l'exportation présente, indépendamment des
questions de clientèle, un avantage décisif : on ne paie pas
de TVA (à 20,6 %) sur la marge.
Le tableau de Poussin vendu pour quelques centaines de milliers de francs
à l'Hôtel Drouot dans une vente sans catalogue ne sera jamais
remis en vente en France par le marchand qui l'a acheté en faisant le
pari de son authenticité ; son intérêt commercial de
marchand talentueux est bien de le remettre - directement ou indirectement - en
vente à New-York.
A supposer même que la personne qui l'a acquis, l'aurait fait au
même prix à Paris, le marchand, lui, aurait, pour un prix de vente
de près de 40 millions de francs dû payer plus de 6 millions de
francs de TVA !
Or c'est le vendeur qui, on le répète, décide de la
localisation des ventes. Même intégré dans le
bénéfice imposable, le gain est trop substantiel pour qu'un
professionnel y renonce.. Ceci pourrait même être un des facteurs
accessoires du déclin de la Grande-Bretagne par rapport aux
États-Unis dans les exportations françaises puisque depuis que le
premier pays applique la TVA quel qu'en soit le taux, les ventes à
Londres ne sont plus considérées comme des exportations.
A l'attraction naturelle du marché américain due au dynamisme de
la demande, s'ajoute une incitation fiscale. La TVA fonctionne donc, dans le
cas particulier des oeuvres de prix élevé mises en vente par les
marchands, et surtout s'il s'agit une oeuvre redécouverte, comme une
pompe qui viderait la France de son patrimoine.
Le rapporteur n'a pas de solution pour pallier les effets pervers
inhérents au mécanisme de bas de la TVA, mais il convenait
d'attirer l'attention sur un phénomène particulièrement
grave.
5. Encourager la création contemporaine
Le
secteur des galeries a paru déprimé au moins autant
économiquement que moralement. Il a manifestement traversé un
passage à vide, dont il ne se remet que lentement.
L'action de l'État mériterait une étude d'ensemble, qui ne
peut être entreprise dans un rapport dont l'axe central est le
patrimoine. Le rapporteur a bien noté que les galeries qu'il avait
rencontrées estimaient que l'art français était quelque
peu délaissé au profit des stars de la jet set de la
création internationale et qu'il manquait un lieu consacré
à la promotion des artistes français.
Néanmoins dans l'optique de ce rapport, il s'est contenté
d'examiner les pistes qui pourraient être explorées pour stimuler
la demande d'art contemporain et faciliter le développement des
galeries.
a) Faciliter le financement des galeries plutôt que stimuler artificiellement la demande
Il faut aider l'art contemporain à trouver son marché. Mais pour des raisons pratiques et de principes, le rapporteur croit plus dans des encouragement aux galeries à financer des artistes et à trouver des clients, que dans une incitation directe aux particuliers collectionneurs.
(1) La fausse piste des incitations fiscales aux particuliers
Une
simple lecture du code des impôts montre qu'il serait très
difficile de mettre en place un système de déduction des oeuvres
d'art qui soit acceptable au regard du respect de certains impératifs de
contrôle qui doit pouvoir caractériser ce type de mécanisme.
Il est clair qu'un mécanisme de réduction d'impôt
fonctionnant sur le modèle de celui dont bénéficient les
dépenses de grosses réparations afférentes à
l'habitation principale, serait impossible à transposer pour une
série de raisons : le montant des sommes en causes reste en tout
état de cause limité, alors qu'il ne serait pas légitime
de porter la réduction d'impôt au même montant que celles
relatives à l'habitation principale
87(
*
)
; de plus, surtout s'il fallait plafonner le
crédit d'impôt en pourcentage de la dépense totale à
l'image de ce qui est prévu pour les grosses réparations - ce
plafond est de 20% - il faudrait disposer de référence pour juger
si le prix payé par le contribuable est conforme au marché.
Bref, on mettrait, dans tous les cas de figure, en place un système qui
ne pourrait jamais porter sur des sommes suffisamment conséquentes pour
alimenter la demande du niveau de celles des galeries, tout en étant
d'une difficulté de gestion considérable, sans même parler
des risques de fraudes ou d'abus que pourrait engendrer le système.
Le rapporteur considère que s'il fallait chercher une piste dans la
direction des particuliers amateurs d'art contemporain, il serait sans doute
préférable de la rechercher en facilitant les dations d'art
contemporain.
(2) Créer de fonds d'investissements en art contemporain fonctionnant comme des sociétés de capital risque
Pourtant, le soutien du marché de l'art contemporain ne peut pas reposer entièrement sur l'État. Il paraît plus prudent de faciliter le financement des stocks des galeries, notamment pour les aider à acheter les oeuvres de jeunes artistes français.
b) Relancer le mécénat des entreprises
Le
rapporteur ne souhaite pas au moment où l'on est, semble-t-il sur le
point d'engager une réflexion d'ensemble sur le mécénat
d'entreprise aborder les questions générales touchant au
mécénat artistique comme aux autres formes de
mécénat culturel ou humanitaire, et, en particulier, les
questions de plafonnement en termes de chiffres d'affaires, des dépenses
de mécénat.
En revanche, de façon plus modeste et plus ciblée, il voudrait
évoquer et faire des propositions, d'ampleur d'ailleurs limitée,
tendant à encourager les entreprises à acheter des oeuvres d'art
à l'instar de ce qui se passe, notamment, aux États-Unis et en
Italie.
(1) L'échec des procédures existantes
La
procédure prévue à l'article 238 bis OA du code
général des impôts permettant est un échec flagrant.
Cet article permet à une entreprise d'acheter (ou de s'engager à
acheter) une oeuvre présentant une "haute valeur artistique ou
historique", dans le but, dix ans après au plus tard, de l'offrir
à l'État, si celui-ci en accepte la proposition ; pendant toute
cette période, l'entreprise est tenue d'exposer l'oeuvre au grand public
; en échange, elle peut déduire le coût d'achat du bien,
par annuités constantes (mais au plus égales à 3 pour 1000
du chiffre d'affaires).
En fait, seulement deux demandes ont été enregistrées :
l'une a été refusée et l'autre est en cours d'instruction.
L'article 238 bis AB du code général des impôts, issu de
l'article 7 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit que les entreprises qui
achètent des oeuvres originales d'artistes vivants, peuvent
déduire dans certaines conditions et limites, une somme égale au
prix d'acquisition des oeuvres concernées.
Dans le cas d'achat d'oeuvres d'artistes vivants, le système est presque
identique à ceci près que - l'objectif n'étant pas
d'enrichir les collections publiques, mais de favoriser la création
contemporaine - l'entreprise reste propriétaire de l'oeuvre ; en
revanche, on retrouve la même déduction sur dix ans du prix
d'achat (sous réserve du plafond), en contrepartie de la même
obligation d'exposer au grand public.
Cette déduction qui est pratiquée par fractions égales au
titre de l'exercice d'acquisition et des neuf années suivantes (20 ans
avant 1994 !) ne peut excéder au titre de chaque exercice la limite
de 3,25% du chiffre d'affaires, minorée du total des déductions
mentionnées à l'article 238 bis AA du code déjà
citée, et doit être affectée à un compte de
réserve spéciale figurant au passif du bilan.
Elle est subordonnée au respect par l'entreprise de son obligation
d'exposer l'oeuvre au public, dans des conditions similaires à celles
prévues pour les dons d'oeuvres d'art à l'État.
En cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de
prélèvement sur le compte de réserve, les
déductions pratiquées sont immédiatement
réintégrées.
La décision de pratiquer cette déduction relève d'une
décision de gestion de l'entreprise et n'est subordonnée à
aucune autorisation préalable de l'administration. L'entreprise qui
décide de pratiquer cette déduction doit joindre à sa
déclaration de résultats un document conforme au modèle
présenté par l'administration
En outre trois sociétés ont acquis des oeuvres d'art en
application de la loi du 27 juillet 1987 :
Il s'agit de :
- la société AXA qui a consenti le prêt pour une
durée de 12 ans renouvelable, par contrat en date du 26 mars 1990, d'un
portrait d'Alphonso d'Avalos par Le Titien pour le département des
peintures du musée du Louvre, acquis par elle en 1990 ;
- la société Mutuelles du Mans qui a consenti le prêt
pour une durée de 10 ans renouvelable par contrat en date du 25 juin
1990, d'un album de la famille des Saint-Aubin pour le département des
arts graphiques du musée du Louvre, acquis par elle en 1990 ;
- la société GAN qui a consenti le prêt pour une
durée de 10 ans renouvelable, par contrat en date du 30 juillet 1992,
d'un tableau par Monet,
Les Villas de Bordighera
pour le musée
d'Orsay, acquis par elle en 1992.
L'explication de l'échec du système actuel est simple : les
entreprises sont soumises à beaucoup de contraintes pour de bien maigres
avantages
.
L'obligation d'exposition
- qui peut durer dix ans - est
particulièrement contraignante
: elle peut certes être
satisfaite en confiant l'oeuvre en dépôt à un musée.
A défaut, " le bien doit être situé dans un lieu
effectivement accessible au public ". Ce lieu d'exposition ne doit pas
être " réservé aux seuls salariés ou aux seuls
clients de l'entreprise, ou à une partie d'entre eux.
" Quelle que soit la modalité d'exposition le public doit
être informé du lieu d'exposition et de sa possibilité
d'accès au lieu. L'entreprise devra donc organiser l'information
appropriée du public, par des indications attractives sur le lieu
même de l'exposition et par tous moyens promotionnels adaptés
à l'importance de l'oeuvre (campagne d'affiches, annonces dans la
presse, messages radiophoniques ou
télévisés) "
88(
*
)
Il
s'agit là d'obligations particulièrement lourdes. Mais surtout,
en contrepartie de ces sujétions, l'entreprise n'a n'en à
gagner...
Il lui faut pour bénéficier à plein des faibles avantages
offerts par ce régime de déduction
réunir toute une
série de conditions
:
•
les exercices fiscaux de la période doivent être tous
bénéficiaires
; chaque année,
• le bénéfice fiscal doit être au moins égal
à l'annuité ;
• cette annuité ne doit être écrêtée,
ni par le plafond de 3 pour 1000, ni par le cumul des deux plafonds de 2 ou 3
pour 1000.
Ce n'est que dans ces hypothèses que, au mieux, l'entreprise retrouvera"
la part d'impôt sur les sociétés correspondant au prix
d'achat de l'oeuvre.
Comme le note le rapport de M. Grangé-Cabannes
89(
*
)
, le système de provision pour
dépréciation des oeuvres d'art acquises, à quelque titre
que ce soit, par une entreprise, prévue par la loi de juillet 1987, ne
semble pas être appliqué. Jusqu'alors, en cas de
dépréciation d'une oeuvre d'art, l'entreprise qui la
possédait était autorisée à passer, dans les
conditions de droit commun, une provision égale à cette
dépréciation. Depuis 1987, cette dépréciation doit
en outre être "constatée par un expert agréé par le
ministère de la Culture lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre
est supérieur à 50 000francs".
Faute qu'ait, semble-t-il encore été publiée la liste des
experts agréés, le système n'est pas
opérationnel.
(2) Des aménagements limités
Le
rapporteur n'a pas souhaité changer radicalement de système en
dépit du peu de succès des procédures actuelles. Il lui a
semblé possible dans un esprit pragmatique de se contenter
d'assouplir les régimes existants
en proposant des
aménagements limités :
• pour
l'art ancien
, il a paru d'abord souhaitable de limiter le
bénéfice du régime aux seuls
biens classés, en
ayant fait l'objet d'un refus de certificat
, ce qui simplifie la
tâche des entreprises qui n'ont pas à demander un agrément
et
surtout de substituer au système de donation sous réserve
d'usufruit, un régime d'acquisition en pleine
propriété
; ensuite, on propose d'autoriser une certaine
souplesse dans l'amortissement qui ne serait pas forcément
effectué par fractions égales ; enfin, on allégerait
la contrainte d'exposition au public pour la remplacer par une obligation de
prêt limitée qui pourrait être d'un an par période de
dix ans.
• pour
l'art contemporain
, on se contenterait de conserver le
régime actuel en en assouplissant les modalités, comme pour
l'achat d'oeuvres anciennes en ce qui concerne les modalités de
l'amortissement qui serait assouplies, la possibilité d'un amortissement
non linéaire, et la contrainte d'exposition qui serait
allégée.
DIX PROPOSITIONS POUR RELANCER LE MARCHÉ DE L'ART ET SAUVEGARDER LE PATRIMOINE
Étant donné l'inertie du processus de
décision
communautaire, le rapporteur a préféré en conclusion de ce
travail se concentrer sur un ensemble de mesures concrètes, relativement
peu onéreuses eu égard à l'importance de l'enjeu,
dépendant de la seule volonté du législateur fiscal.
Fonctionnement du marché de l'art
1)
Actualisation du seuil de la taxe forfaitaire
sur les objets
d'art
, qui serait porté à 60 000 francs contre 20 000 F
actuellement ;
2)
Alignement du taux
de la taxe forfaitaire
sur les objets
d'art
,
applicable aux galeries et marchands
, sur celui de 4,5 %
(+0,5% de CRDS)
en vigueur pour les ventes publiques
;
2)
Exonération de droit de reproduction des catalogues des
sociétés de ventes comme des marchands
,
dès
lors que l'oeuvre en cause est " reproduite à seule fin
d'information des acquéreurs éventuels et dans une
présentation exclusive de tout autre usage ", ce qui n'est pas
prévu dans le texte actuel du projet de loi portant réforme des
ventes volontaires ;
Encouragement à l'art contemporain
4)
Assouplissement du régime d'amortissement
- il ne
serait plus nécessairement linéaire -
ainsi que des
obligations d'exposition des oeuvres
originales d'artistes
vivants
, qui sont excessivement contraignantes pour les entreprises
dans le régime actuellement prévu à l'article 238 bis AB
du code général des impôts ;
5) Création d'un nouveau cadre juridique, appelé "
Fonds
d'investissement en Art contemporain
", bénéficiant d'un
statut fiscal lui permettant sur le modèle des sociétés de
capital risque d'être exonéré d'impôt sur les
sociétés à raison des plus-values provenant de la vente
d'oeuvres présentant certaines caractéristiques. En l'occurrence
il s'agirait pour être admis à ce régime spécial que
les achats de la société soient constitués à plus
de 50 % par des oeuvres d'une valeur inférieure à 100 000F
d'artistes travaillant en France ;
Sauvegarde du patrimoine mobilier national
6)
Exonération de droits de mutation des oeuvres classées
à raison
de la
totalité de sa valeur
lorsqu'il
s'agit de la
première mutation
après le
classement
et des trois quarts pour les mutations suivantes ; ce
privilège se justifie par la nécessité de compenser la
dépréciation de la valeur de l'oeuvre consécutive à
l'interdiction de sortie du territoire résultant du classement ;
7)
Exonération de taxe forfaitaire sur les objets d'art des ventes
portant sur des oeuvres classées
;
8)
Assouplissement du régime de la dation en paiement
pour
permettre l'octroi d'un crédit d'impôt (pour les droits de
mutation et l'impôt sur la fortune) lorsque la valeur
agréée de l'oeuvre excède le montant de l'impôt
dû, avec possibilité - dans la limite de dix ans - d'usufruit tant
que le crédit d'impôt n'est pas épuisé ;
9)
Encouragement aux dons d'oeuvres classées
pour lesquelles le
donateur sous réserve d'usufruit bénéficierait d'un
crédit d'impôt (pour les droits de mutation et l'impôt sur
la fortune) égal à une fraction de la valeur agréée
de l'oeuvre, déterminée par application de la moitié du
pourcentage auquel est fixée la valeur fiscale forfaitaire de la nue
propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier ;
10)
Extension aux oeuvres anciennes classées du régime
applicable aux oeuvres d'artistes vivants
, c'est-à-dire
possibilité pour les entreprises d'acquérir des oeuvres anciennes
sans être obligées de les donner à l'État au bout de
dix ans comme dans l'actuel - et totalement inappliqué -
régime - de l'article 238 bis OA du code général
des impôts.
Ces propositions approuvées dans leurs grandes lignes par la
commission des finances feront l'objet de propositions de loi
déposée par l'auteur du présent rapport d'information qui
utilisera son droit d'initiative parlementaire
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le 28 avril 1999 sous la présidence de M.
Alain
Lambert, président, la commission à tout d'abord entendu la
communication
de
M. Yann Gaillard
, rapporteur spécial
des crédits de la culture, sur les
aspects fiscaux
et
budgétaires
d'une politique de relance du
marché de
l'art
en
France
.
Après avoir rappelé qu'il avait procédé à
l'audition de nombreuses personnalités du monde de l'art, conservateurs,
marchands, experts, commissaires-priseurs, artistes, ainsi que de
représentants des administrations compétentes, M. Yann Gaillard a
souhaité poser d'emblée une question fondamentale : quels
sont les enjeux pour la France d'une relance du marché de l'art ?
Indiquant que, pour lui, l'importance sans doute faible sur le plan quantitatif
-environ 20 milliards de francs de chiffres d'affaires pour l'ensemble du
secteur - ventes publiques et commerce - était néanmoins
significative au regard des ambitions de notre pays en matière de
culture ou dans le domaine des produits et des services de luxe, M. Yann
Gaillard a décrit, chiffres à l'appui, le déclin du
marché de l'art français : ainsi, en dépit de
chiffres globaux relativement rassurants - les commissaires-priseurs
représentant à peu près le même chiffre d'affaires
que chaque grande maison de vente aux enchères anglo-saxonne -, la
France ne représente que 5,6 % du marché mondial des
tableaux et dessins en 1998.
Il a souligné ensuite qu'une telle situation peut s'interpréter,
soit comme la conséquence d'un statut tellement protecteur qu'il en est
sclérosant, soit comme celle d'une infériorité
structurelle par rapport à des maisons de ventes anglo-saxonnes,
naturellement tournées vers l'international et qui ont fait preuve d'un
pragmatisme et d'un esprit d'innovation exceptionnels.
Il a ensuite attiré l'attention sur les facteurs structurels
macro-économiques à l'origine de cette situation, et qui
expliquent l'ascension de New-York et le déclin relatif de Londres comme
pôle majeur du marché de l'art, désormais mondial.
Enfin, il lui a paru important d'évoquer les transformations
structurelles en cours sur un marché en voie de globalisation :
extension des activités des grandes maisons de ventes à l'art
contemporain, investissements importants sur Internet, soulignant au passage
les liens toujours plus étroits entre marchands et vendeurs aux
enchères.
Abordant ensuite les aspects fiscaux d'une relance du marché de l'art et
renvoyant au rapport écrit pour les autres aspects de son analyse, M.
Yann Gaillard a mis l'accent sur l'étroitesse de la marge de manoeuvre
en la matière, compte tenu des contraintes communautaires et de
l'état d'esprit de l'administration fiscale, plus sensible à des
considérations de principe qu'aux exigences propres du marché de
l'art. Il a également estimé que beaucoup d'obstacles
étaient plus psychologiques que réels, même si cela pouvait
entraîner des conséquences non négligeables sur le
comportement des acteurs - acheteurs ou vendeurs - spontanément
allergiques aux contraintes administratives et fiscales.
En matière de TVA, il a souhaité que, à défaut de
pouvoir la supprimer à l'importation, on ne laisse pas se
perpétuer un différentiel de taux avec Londres, évoquant
à cet égard l'attention portée par les pouvoirs publics
britanniques à la question, comme il avait pu le mesurer lors de son
voyage à Londres. Il a aussi noté les effets pervers du
mécanisme de la TVA, qui freine les importations des collectionneurs et
pousse à l'exportation pour les marchands.
En ce qui concerne le droit de suite, M. Yann Gaillard a estimé qu'il
était difficile de revenir sur un droit d'auteur que la France avait
inventé, et qui était actuellement perçu dans huit pays de
l'Union européenne sur quinze, et qu'il fallait appuyer le projet de
directive en cours d'élaboration à Bruxelles, assorti de la
variante proposée par la présidence allemande comportant une
tranche à 0,5 % pour les oeuvres d'un prix de plus de 500.000 euros.
Puis il a examiné les perpectives d'adaptations ponctuelles tant de la
taxe forfaitaire sur les objets d'art (actualisation du seuil de
20.000 F ; alignement du taux applicable aux ventes en galeries et
aux enchères publiques) que des droits de mutation à titre
gratuit, pour s'efforcer de retenir sur le territoire national les
" trésors nationaux ", soulignant une fois de plus à ce
sujet l'efficacité du pragmatisme anglo-saxon.
En dernier lieu, il a évoqué la situation des galeries d'art
contemporain, aussi sinistrées économiquement que moralement
après l'euphorie des années 80, en souhaitant que l'on mette
en place, non des dispositifs fiscaux d'aide à l'achat des particuliers,
mais des dispositifs de financement de stocks fournissant des
débouchés aux jeunes artistes travaillant en France.
Un débat s'est ensuite engagé. M. Philippe Marini, rapporteur
général, a souhaité connaître les instruments
permettant de contrôler la sortie du territoire français des
oeuvres classées. S'agissant, par ailleurs, des acquisitions d'oeuvres
d'art par les musées publics, il s'est interrogé sur les mesures
qui permettraient de faciliter les apports de fonds de concours des entreprises
ou de personnes privées.
M. Jacques Chaumont et M. François Trucy ont tenu à souligner
qu'il existait un marché de l'art souterrain, dit " en
chambre ", dont il paraissait difficile de prendre la mesure.
M. Alain Lambert, président, a estimé que l'art devrait
constituer pour la France un des moyens de maintenir son rayonnement dans le
monde. Il s'est également demandé si l'aspect fiscal constituait
un outil efficace pour attirer un marché actif ou si la solution ne
résidait pas en une réelle volonté politique
vis-à-vis du marché de l'art.
M. Yann Gaillard a tout d'abord précisé qu'il existait des
mécanismes de protection des oeuvres classées et a
évoqué d'autres prérogatives régaliennes, comme la
retenue à l'exportation et l'exercice du droit de préemption par
l'Etat.
Il a ensuite indiqué que le système anglais de contrôle des
trésors nationaux, à la fois plus souple et plus efficace que le
système français, ferait l'objet d'un développement dans
le rapport d'information.
Il a reconnu que le marché de l'art, de gré à gré,
constituait un secteur important mais que la France se trouvait dans une
ignorance de la réalité et des chiffres de ce marché,
alors même que l'on trouvait des antiquaires dans toutes les villes de
France, phénomène qui n'existait, à cette échelle,
dans aucun autre pays d'Europe. Évoquant, par ailleurs, les secteurs
porteurs du marché qui expliquaient l'installation à Paris des
maisons de vente anglo-saxonnes, il a indiqué qu'il existait encore en
France des réserves d'oeuvres très importantes.
Enfin, s'agissant des obstacles fiscaux au développement du
marché de l'art français, il s'est déclaré
sceptique sur notre capacité à les lever, tout en rappelant qu'il
ne fallait pas en majorer l'importance.
Il a toutefois souligné que des mesures d'accompagnement pourraient
permettre aux pouvoirs publics de témoigner de l'importance du
marché de l'art en France. Il a regretté, à cet
égard, le retard pris dans l'examen du projet de loi sur le statut des
commissaires-priseurs.
La commission a alors donné acte au rapporteur spécial de sa
communication et décidé de publier, sous forme d'un rapport
d'information, le rapport qui en était l'objet.
COMPTES-RENDUS DES ENTRETIENS
DU
RAPPORTEUR
M.
Didier AARON,
antiquaire Vice-Président du Syndicat des
négociants d'objets
d'art
M. Maurice AICARDI,
Membre du Conseil Economique et Social
M. Guy AMSELLEM ,
Délégué aux arts plastiques
Mme Laure de BEAUVEAU CRAON,
Président Directeur
Général de Sotheby's
M. Claude BLAIZOT,
Président du Syndicat national des antiquaires
M. Marc BLONDEAU
, Expert en art moderne et contemporain
Mme Françoise CACHIN
, Directeur des musées de France
M. Alain CAZARRE,
Directeur régional des douanes au bureau des
procédures, régimes économiques et réglementations
techniques
M. Gérard CHAMPIN
, Président de la Chambre nationale des
commissaires-priseurs
M. André CHANDERNAGOR,
Ancien ministre, Président de
l'observatoire des mouvements internationaux d'oeuvre d'art
M. Jean-Pierre CHANGEUX
, Président de la commission des dations
et
Mme Suzanne STCHERBATCHEFF,
Commission des patrimoines
Mme Henriette CHAUBON
, sous-directeur de la direction des professions
judiciaires et juridiques à la Chancellerie
Mme Arlette CHOUMER,
Syndicat des personnels des commissaires-priseurs
M. Jean-Marc GUTTON
, Directeur de la Société des Auteurs
Arts Graphiques et Plastiques,
Mme Anne LAHUMIERE
, Président du Comité des galeries d'art
M. Eric LAUVAUX
, du Cabinet NOMOS
M. Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
, Directeur, Chef du service de la
législation fiscale
M. Joël MILLON
, président de la Chambre des
commissaires-priseurs de Paris
M. Pierre ROSENBERG,
Président-directeur du Musée du Louvre
M. Jean-Marie SCHMITT
,
Directeur de l'Institut d'étude
supérieur des arts
Maître Jacques TAJAN
, commissaire-priseur
M. Eric TURQUIN
et
M. Bruno de BAYSER,
experts
M. Bertrand du VIGNAUD
Président de Christie's Monaco et
Vice-Président de Christie's France et
M. Anthony BROWNE,
Président de la Fédération Britannique du
marché de l'art
*
* *
En outre, M. Yann GAILLARD a rencontré plusieurs artistes et a été visiter leurs ateliers situés à Paris, Nogent-sur-Marne et Fontenay-sous-Bois. Il s'agit de MM. Fabian CERREDO, Denis MONFLEUR, Michel PELLOILLE, Benoît TRANCHANT et Vincent VERDEGUER.
Entretien de M. Didier AARON,
Vice-Président du Syndicat des négociants d'objets d'art
le jeudi 7 janvier 1999
M.
Didier Aaron
a tout d'abord souligné l'importance du marché
de l'art en France. D'une part, les métiers engendrés par ce
marché en France perpétuent une main d'oeuvre d'une
qualité unique au monde au point de vue de la qualité et il est
essentiel de la sauvegarder. En second lieu, la clientèle des grands
antiquaires contribue à la vitalité du marché de luxe. La
Biennale des Antiquaires à Paris est, avec Maastricht, l'exposition la
plus importante du monde et elle draine un nombre considérable de
touristes.
Dans les années 50, le marché de l'art français
était le premier au monde, avant d'être supplanté par les
Anglais, grâce, notamment, au génie de Peter Wilson.
M. Didier
Aaron
a déclaré qu'il était depuis longtemps partisan
d'une réforme de la profession de commissaire-priseur et que
l'échec des diverses tentatives effectuées jusqu'à ce jour
était dû à une profonde méconnaissance de la
profession par les fonctionnaires du ministère de la Justice dont elle
relève. Aujourd'hui, il est indispensable de laisser les Anglais
s'installer en France afin de relancer le marché et d'intensifier les
échanges. Cela contribuera à faire de Paris un pôle
culturel mondial.
M. Didier Aaron
, à la demande de
M. Yann Gaillard
, a
ensuite identifié les mesures à prendre d'urgence pour
améliorer la situation actuelle : la TVA à l'importation qui
est totalement dissuasive et ne rapporte donc plus rien ; le droit de suite qui
ne profite qu'à quelques familles illustres et ne sert qu'à faire
vivre les sociétés chargées de la percevoir ; la
convention unidroit signée par la France et dont il s'est
déclaré opposé à la ratification par le Parlement.
Selon cette convention, tous les objets d'art sortis d'une manière
illégale de leur pays de création doivent être rendus
à leur pays d'origine. Ce serait, dans ce cas, la quasi-totalité
de ses départements d'art grec et égyptien que la France devrait
rendre.
M. Yann Gaillard
l'ayant interrogé sur l'importance des
antiquaires en France,
M. Didier Aaron
a estimé que leur
activité était au moins égale à celle des ventes
publiques. Il a déclaré que Paris était la seule ville au
monde où il restait des grands antiquaires et que ceux-ci contribuaient
au prestige de la capitale. Il a ajouté que les relations avec les
musées s'étaient améliorées et que les marchands et
les conservateurs avaient compris l'intérêt d'une bonne
collaboration. Il a déploré que les commissaires-priseurs
français, faute d'une politique adaptée, aient perdu leur place
et il a souligné l'extrême nécessité de
légiférer sur l'ouverture des ventes publiques avant fin 1999
afin d'être en mesure de faire face à la concurrence de New-York
qui devenait le centre mondial du commerce de l'art.
A
M. Yann Gaillard
, désireux de connaître son opinion sur
les procédures de protection du patrimoine,
M. Didier Aaron
a
répondu qu'il était favorable au principe, tout en reconnaissant
que les musées devaient éviter de constituer des réserves
trop importantes et que la circulation des objets d'art était
nécessaire. Il a souhaité que l'interdiction de sortie d'un objet
d'art soit assortie d'une obligation d'achat par l'Etat pour ne pas
léser le propriétaire. Il a conclu que la France disposait
d'atouts majeurs pour reconquérir la première place dans le
marché de l'art : Paris est une ville prestigieuse qui constitue un
puissant centre d'attraction ; les collectionneurs français sont en
nombre important ; il existe de nombreux marchands de qualité ; enfin,
les réserves d'objet d'art sont encore considérables sur le
territoire français.
Entretien de M. Maurice AICARDI,
Membre du Conseil économique et social
le mardi 26 janvier 1999
M.
Maurice Aicardi
a tout d'abord rappelé que Paris était le
centre du marché de l'art jusqu'à la seconde guerre mondiale. Le
marché avait connu ensuite une révolution à laquelle la
France avait été incapable de s'adapter, ce qui expliquait son
déclin. L'essor international des collections et la mondialisation des
échanges avaient transformé la nature des ventes et
s'étaient accompagnées d'expertises de plus en plus
poussées. Les grandes sociétés anglo-saxonnes de ventes
publiques avaient su intégrer ces nouvelles données alors que les
Français restaient attachés de façon archaïque
à un statut de la profession de commissaire-priseur remontant au XVIe
siècle.
M. Maurice Aicardi
a souligné que, dans son rapport, il
s'était déclaré favorable à ce que les
commissaires-priseurs aient un statut d'officier ministériel pour les
ventes judiciaires et d'agent commercial pour les autres ventes. Selon lui,
l'indemnisation, qui avait été la pierre d'achoppement des
précédentes tentatives de réforme, devait se limiter au
strict remboursement de la part du monopole acquittée par le
commissaire-priseur. Selon
M. Maurice Aicardi,
il était urgent de
légiférer sur cette question car le marché de l'art
représentait un enjeu économique important et les grandes
sociétés de vente anglo-saxonnes qui allaient s'installer
à Paris devaient trouver les Français prêts à
récupérer leurs parts de marché.
Les obstacles étaient, d'après
M. Maurice Aicardi
,
principalement d'ordre fiscal. Il a déploré l'impact
négatif du droit de suite sur les ventes d'art contemporain en France.
Il a fait remarquer également que la menace constante de l'inclusion des
oeuvres d'art pour le calcul de l'ISF avait découragé les
collectionneurs. Cette menace semblait désormais écartée,
notamment grâce à une jurisprudence du Conseil Constitutionnel qui
considérait que l'ISF ne devait en aucun cas être confiscatoire
(et qu'en conséquence on ne pouvait soumettre à l'ISF les biens
ne produisant pas de fruits), mais
M. Maurice Aicardi
a convenu
avec
M. Yann Gaillard
que les professionnels étaient encore
loin d'être pleinement rassurés à cet égard. Deux
conditions étaient, selon
M. Maurice Aicardi
, absolument
indispensables au développement des transactions : la
liberté et la discrétion.
En s'appuyant sur des exemples,
M. Maurice Aicardi
a expliqué que
l'expertise d'art n'était jamais absolue et que l'Etat ne devait jamais
en endosser la responsabilité sous peine de se voir obligé de
garantir des prix et il s'est déclaré opposé à la
création d'un ordre d'experts engageant la responsabilité de
l'Etat.
M. Yann Gaillard
l'ayant interrogé sur les réformes
fiscales qu'il souhaitait voir mettre en place,
M. Maurice Aicardi
a
réclamé une définition et un contrôle plus stricts
des bénéficiaires du droit de suite ainsi qu'une diminution de sa
durée d'application. Il a souhaité que la TVA à
l'importation soit limitée aux oeuvres de moins de 50 ans pour
faciliter le retour des oeuvres d'art en France. La construction de l'Europe
rendait, selon lui, de toute façon, inéluctable une
évolution vers une harmonisation fiscale européenne.
M. Maurice Aicardi
a ensuite fait valoir les avantages que la
réforme du statut des commissaires-priseurs allaient apporter à
la France. La redynamisation du marché de l'art entraînera des
retombées économiques importantes sur tout le marché de
luxe et l'industrie du tourisme et contribuer de façon
considérable au rayonnement culturel et au prestige international de la
France.
M. Maurice Aicardi
s'est dit persuadé que c'était
désormais entre Paris et New-York que tout se jouait, Londres ayant
perdu sa place prépondérante. Dans cette compétition,
Paris avait culturellement et historiquement un avantage certain et
représentait de plus l'Europe continentale.
M. Maurice Aicardi
a souhaité que l'intervention de l'Etat se
limite à deux domaines : d'une part, favoriser l'entrée des
oeuvres d'art en France en manifestant la même volonté politique
que celle qui avait présidé à la loi sur les
dations ; d'autre part, protéger le patrimoine. A cet égard,
il a fait référence à la loi de 1941 et s'est
déclaré favorable à ce que la France se dote d'un
dispositif plus efficace que la loi de 1992. Son recours devrait rester
exceptionnel et s'accompagner de la constitution d'une réserve
financière sur les produits de la Française des Jeux, permettant
à l'Etat d'intervenir immédiatement dans ces seuls cas.
Pour conclure,
M. Maurice Aicardi
s'est déclaré optimiste
quant aux chances qu'avait la France de reconquérir la première
place sur le marché de l'art.
Entretien de M. Guy AMSELLEM,
Délégué aux arts plastiques
le mardi 26 janvier 1999
M. Guy
Amsellem
a exprimé son souci de concourir à la promotion des
artistes français contemporains, non seulement en France, mais aussi sur
le plan international.
La première action à mener pour réaliser cet objectif est
de consolider les acteurs privés. Il faut également se demander
quel type d'action engager pour donner à l'art contemporain une
dimension populaire. A cet égard, il a cité le " Turner
price " qui est un prix décerné à un artiste
contemporain en Angleterre et qui donne lieu à des manifestations
populaires et très médiatisées pendant deux mois.
M. Guy Amsellem
a indiqué qu'il essayait de mobiliser des
entreprises et des figures emblématiques des médias pour tenter
de développer ce type d'initiative en France. Il a ensuite jugé
que les institutions françaises gagneraient à être moins
angéliques sur la scène internationale qui est devenue un
marché.
Il a également évoqué les interventions de l'AFAA
(Association française d'action artistique) qui devrait, selon lui,
travailler davantage en liaison avec les opérateurs professionnels de
l'art ; l'AFAA, qui est une émanation du Quai d'Orsay, et a eu
parfois tendance à se substituer aux acteurs du marché de l'art.
Il a ensuite fait part de suggestions, notamment la création d'antennes
de représentation permanente des galeries dans certains pays
ciblés au sens du marché de l'art. Il a rappelé que le
rayonnement international était devenu un enjeu fort de la
délégation aux arts plastiques et que la nécessaire
diversité des expressions dont elle est garante doit s'accompagner d'une
action garantissant la diversité des acteurs, notamment au regard de la
part trop importante prise par les acteurs publics d'Etat ou locaux.
M. Yann Gaillard
a voulu savoir comment dynamiser le marché de
l'art contemporain.
M. Guy Amsellem
a proposé une solution simple qui consisterait
à ouvrir un droit à réduction d'impôt
plafonnée à une somme relativement basse (20.000 ou
30.000 francs). Cette mesure constituerait un message fort d `une
volonté de sortir l'art contemporain de son ghetto actuel. Il a
cité, à titre d'exemple, la situation à New-York où
un nouveau quartier, Chelsea, regroupe de très nombreuses galeries et
où justement existe un mécanisme de déduction fiscale pour
l'achat d'oeuvres d'art très incitatif pour les jeunes couples. Toute
mesure fiscale devrait bien sûr éviter de mettre en oeuvre des
dispositifs d'évasion fiscale pour des achats financièrement
élevés.
Il a rappelé également qu'il était important d'annoncer
une stabilité de l'environnement législatif et
réglementaire, au moins sur une législature. A cet égard,
il a évoqué la menace récurrente de l'introduction des
oeuvres d'art dans l'assiette de l'ISF.
Il a estimé que l'outil fiscal était essentiel, Londres qui est
un marché relativement artificiel, ayant été
créé grâce au levier fiscal.
S'agissant ensuite de la TVA à l'importation,
M. Guy Amsellem
s'est déclaré hostile au fait de ramener son taux à
zéro mais au contraire favorable à l'idée de se battre
contre la dérogation accordée aux Anglais. Ramener la TVA
à un taux zéro serait catastrophique pour les artistes
français vivants qui, eux, sont soumis à la TVA.
Il a estimé que le rapport de M. Chandernagor ne prenait pas
suffisamment en compte la situation des galeries d'art. En effet, notre pays
n'a pas besoin de favoriser l'art ancien au détriment de l'art
contemporain.
S'agissant du droit de suite, il a indiqué que la position
française ne devrait plus varier sur le sujet. Il a rappelé qu'en
Allemagne, il existait un prélèvement unique de l'ordre de
5 % sur le produit de la vente qui contribuait au financement de la
protection sociale et à celui du droit de la propriété
intellectuelle. En France, les galeries contribuent au financement de la
protection sociale, soit environ 20 millions de francs par an, si on leur
appliquait le droit de suite, le coût total serait pour elles de
70 millions de francs. Cet alourdissement des charges ne paraît pas
opportun alors que les galeries sont aujourd'hui un secteur sinistré.
M. Guy Amsellem
a alors précisé qu'il avait plaidé
auprès du Ministère, d'une part pour que l'on ne dépasse
pas le taux des 3 %, y compris pour le segment du marché de l'art
portant sur les prix les plus bas, d'autre part, pour qu'un mécanisme de
compensation soit institué afin d'éviter que les galeries ne
paient à la fois la protection sociale et le droit de suite. Enfin, il a
également demandé d'exonérer du droit de suite, la
première vente à un particulier, qui est en fait la
deuxième vente après la vente aux galeries.
Il a tenu à rappeler que le produit du droit de suite était
très inégalement réparti, 40 % bénéficiant
à quelques familles, au sein desquelles l'essentiel des
bénéficiaires ne vivent pas en France.
Il a surtout insisté sur la nécessité d'éviter que
la protection des oeuvres, au titre du droit de suite, ne conduise à
surtaxer les segments de marché où les prix sont les moins
élevés, c'est-à-dire les oeuvres d'art contemporain.
Il a également rappelé qu'une autre dérogation au titre de
la TVA à l'importation était accordée aux Allemands, qui
leur permet de cumuler un taux réduit de TVA avec un système de
déductibilité. Plutôt que de demander à
bénéficier du système allemand, il vaudrait mieux le faire
disparaître, comme cela est d'ailleurs prévu au 30 juin 1999.
Il a enfin estimé qu'il fallait créer un espace de
stabilité et sans distorsion de concurrence au sein de l'Europe, puis
mettre en place un dispositif d'incitation fiscal pour relancer le
marché de l'art contemporain, en créant, par exemple, un statut
fiscal de collection d'entreprise, comme cela existe déjà en
Allemagne. Il s'est cependant montré sceptique sur la
réceptivité des services de Bercy à toutes propositions
concernant les déductions fiscales.
Entretien de Mme de BEAUVEAU CRAON,
Président directeur général de SOTHEBY'S France
le jeudi 28 janvier 1999
En
réponse à
M. Yann Gaillard
,
Mme Laure de Beauvau
Craon
a déclaré que la société Sotheby's
était installée en France depuis 1975 et qu'elle-même en
était devenue Président directeur général en 1991.
Elle a constaté que le monopole, loin d'avoir empêché la
concurrence internationale de s'installer en France, avait au contraire
empêché la France d'être au centre du marché de l'art
européen, ce qui était sa vocation géographique,
historique et culturelle. Comme l'avait constaté la Commission Aicardi
en 95, le marché de l'art en France n'est plus un marché
international, En effet, les lois régissant le monopole ne sont
absolument pas adaptées à la mondialisation du marché de
l'art et sont également contraires au Traité de Rome, ce pour
quoi la France a reçu une mise en demeure de la commission de Bruxelles
en 95 et un avis motivé en août 98.
Mme Laure de Beauvau Craon
a souligné l'urgente
nécessité de remédier à cette situation en
libéralisant le marché de l'art français afin d'endiguer
le flot alarmant des exportations et de faciliter le retour de ceux-ci sur le
territoire français. Le retard pris par la législation fait
perdre des parts de marché à Paris, Sothebys exportant vers
l'étranger les unes après les autres les grandes collections qui
lui sont confiées.
Tout en reconnaissant l'importance déterminante de la fiscalité
sur le marché de l'art,
Mme Laure de Beauvau Craon
considère que c'est un problème qui doit être traité
séparément. Elle rappelle que le taux de TVA à
l'importation ainsi que le droit de suite seront réglementés par
Bruxelles. Elle encourage la France de faire pression avec l'Angleterre sur
Bruxelles pour limiter, à défaut de pouvoir les supprimer, ces
taxes. Elle souligne que la plus-value libératoire telle qu'elle est
appliquée aujourd'hui en France, l'est au taux le plus favorable de tous
les pays concernés par le marché de l'art. Le taux
appliqué en France - qui est de 5 % pour les ventes à
l'intérieur de la CEE et de 7,5 % pour les ventes à
l'extérieur de la CEE - se compare à un taux de plus-value en
Angleterre et aux Etats-Unis excédant souvent 40 %. Elle
considère qu'un amalgame entre la fiscalité du marché de
l'art et la fin du monopole n'est pas souhaitable. Cela rendrait le
débat plus confus et retarderait l'ouverture.
A la demande de
M. Yann Gaillard
,
Mme Laure de
Beauvau Craon
, s'est ensuite prononcé en faveur du projet de
loi qu'elle a jugé globalement bon. Deux points en particulier lui
paraissaient excellents : d'une part, la possibilité de vendre de
gré à gré un bien déclaré non adjugé
dans un délai de 8 jours après la vente bien qu'elle regrette la
limitation dans le temps, d'autre part, l'interdiction de fixer un prix de
réserve à un montant supérieur à l'estimation tel
que cela se pratique en Angleterre et aux Etats-Unis dans le but d'une
information claire vis-à-vis de l'acheteur. Par contre, elle a
jugé que l'article 12 était inutilement contraignant et allait
à l'encontre du but recherché en ne laissant pas les
sociétés de ventes volontaires gérer elles-mêmes
leurs avances comme cela se pratiquait déjà dans les pays
anglo-saxons. Dans la nouvelle législation, elle souhaiterait que le
transfert de propriété intervienne, comme cela se fait
habituellement dans les transactions commerciales, au moment du paiement, et
non plus quand le marteau tombe ce qui est le cas à l'heure actuelle,
les commissaires-priseurs étant officiers ministériels. Elle
souhaiterait également qu'il soit possible d'interdire d'enchères
des mauvais payeurs notoires, comme cela se fait en Angleterre et aux
Etats-Unis.
Mme Laure de Beauvau Craon
a ensuite souligné les avantages que
les commissaires-priseurs allaient retirer de la libéralisation de leurs
tarifs qui leur permettrait d'augmenter leur taux de commission.
Pour conclure,
Mme Laure de Beauvau Craon
a déclaré que la
réforme était bonne et nécessaire et que son seul souhait
était de la voir mettre en oeuvre le plus vite possible dans
l'intérêt du marché de l'art en France.
Entretien de M. Claude BLAIZOT,
Président du Syndicat national des antiquaires
le jeudi 14 janvier 1999
Après avoir précisé que la contribution
de la
commission des finances à l'examen au fond, par la commission des lois
du projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques s'inscrivait dans la préoccupation
du soutien au marché de l'art français,
M. Yann
Gaillard
a interrogé
M. Claude Blaizot
sur les facteurs
qui expliquent ce déclin et notamment les aspects fiscaux. Il lui a
également demandé de préciser si des différences
étaient constatées selon les types de produits.
Ayant constaté que l'ensemble du marché était
concerné par cette régression,
M. Claude Blaizot
a
souligné que cette réflexion globale était
nécessaire pour éviter l'erreur consistant à prendre des
mesures ne tenant pas suffisamment compte des réalités et
inspirées par les seules apparences médiatiques de ce
marché.
S'il a estimé que la situation de la France n'était pas
désespérée, en raison de la qualité de ses
professionnels, de ses experts et des atouts que représentaient son
patrimoine mobilier et son tissu touristique et commercial, il a en revanche
constaté qu'elle était désormais reléguée
à la troisième place mondiale avec 8 % du marché,
dans le même temps où les Etats-Unis importent 50 % et le
Royaume-Uni 30 %. Il s'est également inquiété de la
sortie du territoire de pièces importantes, alors que leur retour
était beaucoup plus problématique
M. Claude Blaizot
a reconnu que la segmentation du marché
était réelle, que les moyens financiers de la clientèle de
nos concurrents étaient d'évidence plus importants, mais il a
également fait état de dispositions juridiques et fiscales
applicables en France ou en Europe, bien que différentes selon les
secteurs, qui dans leur ensemble fragilisaient notre activité.
Il a ainsi cité le " droit de suite ", qui influait surtout
sur le marché de la peinture " impressionniste ", les
dispositions contenues dans la convention " Unidroit ", qui si elle
était ratifiée par la France ne pourrait qu'inciter davantage les
acteurs à s'orienter vers les marchés des pays non signataires,
en priorité les Etats-Unis, et la " taxe de douane " que
constitue la TVA à l'importation qui, d'un faible rapport pour le
Trésor, est surtout dissuasive pour le retour des pièces
importantes.
M. Yann Gaillard
ayant fait remarquer que cette taxe n'était
aucunement à la charge du vendeur et que seuls les acquéreurs
nationaux étaient tenus de l'acquitter,
M. Claude Blaizot
a
justifié l'intérêt porté au cas des acheteurs
français par le souci de sauvegarde de notre patrimoine et
affirmé que le client américain se trouvait " de
facto " favorisé, dans le coût final de son enchère,
du montant de cette taxe, soit 5,5 %.
Il a également estimé que cette situation était de nature
à freiner l'attrait pour le marché français des vendeurs
dans la mesure où leur produit net ne pouvait qu'être
réduit par l'excès de taxes.
Il s'est aussi élevé en ce qui concerne la taxe forfaitaire,
contre la différence de traitement fiscal entre l'activité des
ventes publiques (4,5 %) et celle du commerce de détail
(7,5 %). Il a ajouté que d'autres discriminations étaient
injustifiées puisque les sociétés de vente auraient la
possibilité de négocier les invendus dans les huit jours qui
suivent les enchères et qu'elles bénéficieraient d'une
exonération des droits de reproduction de catalogues de vente, ce qui
n'était pas le cas des professionnels.
M. Claude Blaizot
a
jugé qu'un marché n'était dynamique que si ses
règles étaient à la fois claires et définitives et
que leur changement perpétuel en France avait engendré la
frilosité des grands collectionneurs à l'égard de son
marché.
M. Yann Gaillard
, après avoir évoqué la
qualité supposée des expertises étrangères, qui
disposent d'ailleurs d'experts français, a également fait
état de la responsabilité trentenaire et de ses
conséquences sur la pratique des experts français, volontiers
évasifs. Il a demandé si le système reposant sur le
salariat des experts pratiqué par Sotheby's et Christie's était
meilleur.
M. Claude Blaizot
, précisant qu'il était également
président de la compagnie nationale des experts, a estimé que le
travail d'expertise anglais n'était pas supérieur à celui
exercé en France et que cette activité dans notre pays reposait
uniquement sur le savoir et l'expérience, sans référence
à un diplôme, ce qui pouvait soulever quelques problèmes
quant aux garanties. Il a divisé la profession en deux catégories
les salariés et les indépendants, ces derniers ayant sa
préférence pour assurer une réelle liberté de
jugement et éviter le risque de favoritisme, à l'égard
d'un client, par une maison qui ferait pression sur son expert salarié.
Rappelant que l'expert avait obligation d'assurance et était
coresponsable de la vente avec le commissaire-priseur, il a jugé que le
projet, qui visait à instituer une catégorie d'experts
agréés par le conseil des ventes, était inadapté de
ce point de vue puisque le commissaire-priseur pourra continuer à
choisir un expert non agréé. Selon lui cette pratique qui a par
le passé permis l'apparition d'experts " feu d'artifice ", a
contribué à donner une mauvaise réputation à la
place de Paris.
M. Claude Blaizot
a ajouté que l'expert agréé ne
pourra plus enchérir pour protéger son client et qu'il lui
deviendra également difficile d'acheter pour sa clientèle, en
raison du risque de communication de son fichier de clients aux
commissaires-priseurs.
Selon lui, le projet devrait prévoir en premier lieu d'appliquer
à tous les experts, intervenant dans une vente, les mêmes
obligations avant d'envisager la création d'une liste d'experts
agréés.
Répondant à
M. Yann Gaillard
qui s'étonnait du
manque apparent de rigueur d'un système qui permettait à l'expert
d'intervenir dans les enchères,
M. Claude Blaizot
a
affirmé que ce système avait fait ses preuves et qu'il n'avait,
à sa connaissance, pas engendré d'abus. Il a ajouté qu'il
présentait le mérite de la transparence.
Rappelant qu'il avait participé à la première commission
Léonnet sur le problème du Conseil de ventes volontaires, il a
estimé que la tâche qui lui était dévolue
requérait une trop vaste compétence professionnelle. En effet, ce
Conseil paritaire de 14 membres serait chargé de l'agrément
et du contrôle d'experts européens compétents dans des
secteurs très pointus et ne pourra disposer des moyens
nécessaires pour juger de leur véritable compétence.
Il a précisé que les trois grandes compagnies d'experts
françaises représentaient déjà à elles
seules environ 500 membres et que bien que professionnels, ils
éprouvaient des difficultés à opérer une
sélection rigoureuse.
M. Yann Gaillard
ayant opposé que la difficulté
était inhérente à tout conseil et que ceux-ci avaient
recours à l'avis de spécialistes,
M. Claude Blaizot
a
rappelé que sa profession avait proposé que le Conseil des ventes
volontaires crée, sous son autorité, un Conseil de l'expertise.
Il a surtout contesté dans la rédaction de l'article 34 l'absence
d'obligation d'assurance pour les experts extérieurs à la liste
agréée. Il a reconnu toutefois que le cas des experts
salariés ne posait pas ce type de problème puisque la garantie
était alors assurée par la société,
s'inquiétant cependant du risque présenté par le recours
éventuel à des CDD.
En réponse à
M. Yann Gaillard
, qui évoquait la non
mise en cause de l'expert et du commissaire-priseur dans l'affaire d'un tableau
de Poussin,
M. Claude Blaizot
a indiqué que nombre de ventes
avaient fait l'objet de contestations et que dans ce cas l'assurance avait
été amenée à couvrir la perte. Il a toutefois
précisé que dans la plupart des contestations, la vente
était purement et simplement annulée, à l'instar de
l'affaire évoquée et que les grandes maisons de vente
étrangères pratiquait également de la sorte. Il a
également ajouté que les professionnels redoutaient le
dépôt d'une plainte pour perte de chance.
Évoquant le problème de la garantie exercée contre le
vendeur ou à défaut ses héritiers, il s'est
étonné qu'elle puisse être trentenaire pour les
indépendants (opération non commerciale) et décennale pour
les ventes publiques (qui seront assimilées à des
opérations commerciales).
En ce qui concerne la frilosité que l'on reproche souvent aux experts
français,
M. Claude Blaizot
l'a expliquée par une
certaine méfiance face à l'amélioration des moyens
techniques d'expertise qui entraîne la remise en cause d'attributions
antérieures, et à l'intervention des assureurs. Il a
considéré que si la prudence s'imposait, il convenait toutefois
de ne pas sombrer dans l'excès.
En réponse à
M. Yann Gaillard
qui évoquait la vente
d'un tableau seulement " attribué " à Fragonard dans un
premier temps et donnant lieu à procès, dès lors que sa
signature s'était trouvée confirmée,
M. Claude
Blaizot
a fait état de la quasi impossibilité de
légiférer dans ce domaine. Il a considéré que la
création de la liste d'experts agréés débouchera
sur une formule de cooptation, tout en rappelant qu'il avait été,
dans le passé, sur une telle liste à Drouot avant que ce
dispositif ne soit abrogé.
Les deux chambres de commissaires-priseurs, l'une nationale et l'autre
parisienne, qui disposent d'un conseil de discipline, n'ont, selon lui, jamais
réussi à réglementer et assainir cette activité et
un Conseil des ventes même sévère et contrôlant
suffisamment aura des difficultés à réglementer dans un
domaine aussi étendu.
M. Claude Blaizot
a répondu à
M. Yann Gaillard
,
qui s'inquiétait des conséquences, pour le marché
français, d'une nouvelle réglementation, que, s'il ne partageait
pas cette inquiétude, il était en revanche favorable à la
garantie du caractère définitif de la vente, en faisant reposer
le système sur la responsabilité de l'expert, du
commissaire-priseur et de l'assureur, afin de lever les incertitudes qui, en
définitive, ne pénalisent que le vendeur.
Par ailleurs, il a précisé que le taux de 5,5 % de la TVA
à l'importation était considéré comme dissuasif par
tous les acteurs du marché, à l'exception du Comité des
galeries d'art, arc-bouté sur le protectionnisme des artistes
français. Selon lui, la " sale tax ", applicable à
New-York, est contournée par une délocalisation dans les Etats
voisins et cette situation est si favorable que nombre d'artistes
français de qualité sont installés aux Etats-Unis,
malgré la perte du bénéfice du droit de suite. Il a
regretté que pour protéger un secteur extrêmement
fermé, les chances européennes de l'ensemble du marché
soient hypothéquées. Il a également reproché au
Comité des galeries d'art de faire des propositions irréalistes,
puisqu'elles reposent sur l'hypothèse d'une baisse de TVA de 20,6 %
à 5,5 % et sur la récupération de la TVA à
l'importation pour les seuls professionnels, ce qui ne manquerait pas de nuire
aux ventes publiques. Après avoir rappelé sa proposition de
supprimer la TVA à l'importation, pour les oeuvres dont les auteurs sont
décédés depuis 70 ans,
M. Claude Blaizot
a
jugé que l'assimilation par la 7
ème
directive des
oeuvres d'art aux autres produits de consommation était une erreur,
celles-ci étant déjà suffisamment
génératrices d'impôts et de taxes forfaitaires sur la
plus-value, ne serait-ce que par leur réévaluation permanente.
Il a relevé que bien que la taxe instituée en Grande-Bretagne
n'était que de 2,5 %, leurs importations avaient toutefois
baissé de 40 % depuis sa mise en oeuvre. Constatant la difficulté
d'établir un contre-projet de réforme, il l'a expliqué par
l'existence de 50.000 entreprises, concernées par ce secteur, dans notre
pays, avec de nombreuses activités induites et l'absence de
données chiffrées significatives, au point de ne pas trouver un
cabinet intéressé par une étude, similaire à celle
réalisée par un grand cabinet anglais. Il a également
souligné que la situation française était unique,
Sotheby's et Christie's ayant phagocyté le marché de l'art
à l'étranger.
Après avoir précisé qu'il était spécialiste
de la littérature du 19
ème
et du
20
ème
siècle,
M. Claude Blaizot
a
déclaré que certains de ses clients importants s'étaient
expatriés en raison du déplafonnement de l'ISF et de menace
d'imposabilité des objets d'art à l'ISF. Il a
considéré que l'incorporation des objets d'art à l'ISF
aurait pour conséquence la non déclaration de la possession, et
leurs exodes clandestins pour leurs ventes.
En conclusion,
M. Claude Blaizot
a recommandé de n'agir sur le
marché de l'art qu'avec prudence en raison de sa grande
volatilité.
Entretien de M. Marc BLONDEAU,
Expert en art moderne et contemporain et
de M. Etienne BRETON, Expert en tableaux anciens
le jeudi 7 janvier 1999
M. Marc
Blondeau
et
M. Etienne Bréton
ont tout d'abord fait
état de leur expérience professionnelle française et
anglo-saxonne qui leur a permis de comparer les deux systèmes. Selon
M. Blondeau
, il existe un réel potentiel pour le marché de
l'art en France mais des problèmes de compétence et
d'organisation en freinent le développement. Les Anglais disposent d'une
efficacité accrue grâce au système de l'expertise interne
qui évite le conflit marchand-expert. Beaucoup d'experts français
sont partis à l'étranger afin de pouvoir exercer leur profession
dans des conditions moins pénalisantes.
Au niveau des commissaires-priseurs, la France n'a pas su s'adapter face au
dynamisme des anglais et elle se doit d'avoir aujourd'hui une approche
économique de la profession.
M. Etienne Bréton
a
ajouté que le titre d'officier ministériel n'avait plus
guère de sens dans un marché mondial et qu'il fallait scinder la
profession en deux métiers : les commissaires-priseurs judiciaires et
les sociétés commerciales. En réponse à
M. Yann
Gaillard
,
M. Marc Blondeau
s'est montré partisan d'une
libéralisation totale pour les sociétés de ventes
volontaires prévues par le projet de loi. Selon lui, la plupart des
commissaires-priseurs vont disparaître pour laisser place à un
petit nombre de sociétés au sein desquelles on pourrait envisager
la création d'un département de ventes judiciaires. A la
différence de leurs homologues anglo-saxons, les commissaires-priseurs
français n'ont actuellement pas la possibilité de garantir des
prix à leurs clients et cela les prive du marché des successions
qui se font toutes par vente publique.
M. Marc Blondeau
s'est
montré tout à fait favorable à la mesure interdisant de
fixer le prix de réserve à un montant supérieur à
celui de l'estimation.
M. Marc Blondeau
a ensuite fait état du dynamisme des antiquaires
français dont la Biennale constitue un événement
exceptionnel dans le marché de l'art et contribue au rayonnement de la
France dans le domaine artistique. Il a déploré l'absence
d'impact des galeries d'art françaises et a souligné la
collaboration que les experts entretenaient avec les antiquaires et qui
n'existait pas avec les marchands de tableaux.
Puis
M. Marc Blondeau
a déclaré que la préemption
jointe à l'interdiction de sortie éliminait la France de toute
compétition internationale.
M. Etienne Bréton
a
ajouté que l'Etat ne devrait pas préempter un objet frappé
d'interdiction de sortie du territoire car cela constituait un abus de droit.
Tous deux ont déploré l'impact négatif de l'incertitude
que faisait peser sur les ventes publiques l'exercice par l'Etat de ces deux
prérogatives.
En réponse à une question de
M. Yann Gaillard
sur la
responsabilité des experts,
M. Marc Blondeau
a répondu que
dans son domaine, celui de l'art contemporain, l'expert était
plutôt un généraliste et que la responsabilité
était diluée par le spécialiste. Le problème de la
responsabilité était plus sensible dans le domaine des tableaux,
du mobilier et des objets d'art anciens. Il a ajouté qu'il faudrait
ramener la responsabilité des experts de 30 ans à 10 ans.
M. Etienne Bréton
a ajouté que l'expertise
n'était pas une science exacte et que, les spécialistes
eux-mêmes étant parfois en désaccord, c'était en
dernière analyse le marché qui tranchait.
M. Marc Blondeau
a ensuite fait état des atouts que la France
possédait dans le domaine du marché de l'art : notre pays est une
des plus belles sources d'objets d'art ; il existe dans l'hexagone un nombre
considérable de collectionneurs, même si c'est à petite
échelle ; on compte 120.000 professionnels du marché de
l'art alors qu'aux Etats-Unis, tout étant concentré à
New-York, on n'en trouve aucun dans une ville de l'importance de Los
Angeles ; Paris, enfin, est une capitale prestigieuse qui attire les
touristes du monde entier et constitue une place financière importante.
M. Marc Blondeau
a souhaité que la taxe d'importation soit
diminuée et que le droit de suite soit unifié au niveau
européen afin de revitaliser le marché français.
M. Yann Gaillard
s'étant interrogé sur la création
contemporaine française,
M. Marc Blondeau
a répondu que le
pôle créatif, après s'être situé en France
avec l'impressionnisme et l'Ecole de Paris, s'était
déplacé, après la seconde guerre mondiale, vers les
Etats-Unis où l'Ecole de New-York regroupait actuellement les principaux
peintres dont il a souligné qu'ils n'étaient pas exclusivement
américains. Il a expliqué cette situation par le fait que les
galeries françaises n'avaient pas su donner un rayonnement international
à leurs artistes, que certains peintres n'avaient pas fait le choix
d'une galerie, que l'Etat avait court-circuité les galeries en traitant
directement avec les artistes au détriment de la diffusion commerciale,
qu'il existait de fait peu de créateurs en France et enfin que les
musées français n'avaient pas su jouer le même rôle
moteur dans l'art contemporain que leurs homologues américains. C'est au
niveau de la fiscalité et du développement des ventes publiques
françaises que l'on doit agir aujourd'hui si l'on veut réveiller
le marché de l'art contemporain.
M. Marc Blondeau
et
M. Etienne Bréton
ont tous deux conclu
qu'il était possible de redonner à la France la première
place dans le domaine du marché de l'art et que c'était avant
tout une question de volonté politique.
Entretien de Mme Françoise CACHIN,
Directeur des musées de France,
Conservateur général du Patrimoine,
le jeudi 4 février 1999
M. Yann
Gaillard
a souhaité connaître la situation du Marché de
l'art en France et ses problèmes. Il a également interrogé
Mme Françoise Cachin sur les mécanismes de protection du
patrimoine et le fonctionnement de la loi de 1992.
Mme Françoise Cachin
a tout d'abord rappelé qu'il
était très important que le marché de l'art se revitalise
en France. Elle a estimé que la réforme du statut des
commissaires-priseurs apporterait une nécessaire clarification et que
l'arrivée de Sotheby's et Christie's en France serait positive pour
dynamiser le marché. En effet, un marché actif fera naître
des vocations de collectionneurs en France et, par conséquent, enrichira
le patrimoine public à long terme.
S'agissant de la protection du patrimoine en France, elle a
déploré la fuite constante de celui-ci depuis un
demi-siècle. La loi de 1941 avait mis en place un système
permettant de retenir ou d'acquérir, au prix déclaré, les
oeuvres présentées à la douane. Avec le nouveau
système mis en place par la loi de 1992, la France a trop vite
baissé la garde par rapport à d'autres pays d'Europe qui ont
continué à protéger leur patrimoine. Les anglo-saxons ont
notamment un système remarquable de protection du patrimoine. Les
collectionneurs ou les héritiers ne payent pas de droits de succession
si les oeuvres d'art restent sur le territoire national. Au moment de la vente,
deux solutions s'offrent à eux, soit il vendent sur le marché et
ils sont lourdement taxés, soit, ils vendent à une
collectivité locale ou à un musée et ils sont moins
taxés. De plus, le système anglais s'est donné les moyens
d'acquérir les oeuvres avec le pourcentage sur le loto.
Revenant au système français,
Mme Françoise Cachin
a estimé que la loi de 1992 présentait de graves
inconvénients : la première étant la retenue des oeuvres
pour trois ans seulement ; le second étant que les vendeurs ne sont pas
contraints de vendre à l'Etat si celui-ci leur fait une proposition
d'achat ; le troisième étant que le vendeur peut fixer n'importe
quel prix alors qu'il faudrait se référer au "fair price",
c'est-à-dire, au vrai prix du marché.
Dans le cadre d'une réforme de la loi de 1992, il faudrait proposer le
système d'expertise suivant : un expert pour le vendeur, un pour
l'Etat, avec en cas de litige, désignation d'un troisième expert.
Il s'agit là du système anglais. Le projet de réforme de
la loi de 1992 est prêt depuis un an, mais son inscription à
l'ordre du jour se heurte à l'encombrement du plan de charge des
Assemblées.
Mme Françoise Cachin
a indiqué que ce projet de
réforme avait fait l'objet d'une concertation avec les
représentants du marché de l'art. Ceux-ci sont très
favorables aux dispositions concernant le certificat de sortie des oeuvres qui
n'est actuellement valable que pour cinq ans. Dans le projet de réforme
de la loi de 1992, le certificat serait définitif pour les oeuvres qui
ont plus de cent ans et il serait valable vingt ans pour les oeuvres ayant
entre 100 et 50 ans.
Mme Françoise Cachin
a ensuite évoqué le
problème du taux de TVA à l'importation des oeuvres d'art
actuellement à 2,5 % en Grande-Bretagne, 5 % en France et 0 % aux
Etats-Unis. Elle a estimé urgent de trouver un système de
régulation à l'intérieur de l'Europe afin d'éviter
de continuer à pénaliser le marché de l'art en France. A
cet égard, elle a rappelé que 70 % de ce que vend Sotheby's et
Christie's à Londres et surtout à New-York provient de France. Le
patrimoine français est "razzié". Elle a précisé
que les collectionneurs vont à New-York car il n'y a pas de taxe et
qu'ils y gagnent beaucoup plus d'argent qu'à Paris.
Elle a enfin indiqué qu'il fallait bien faire la distinction entre les
oeuvres patrimoniales dont le départ de France est très
dommageable et le " terreau " du marché de l'art qui se
déplace.
Entretien de M. Alain CAZARRE,
Directeur régional des douanes au bureau des procédures,
régimes économiques et réglementations techniques
(accompagné de Mmes Nicole PIN et Claire GROUFALL
et de M. Guillaume ADELLE)
ainsi que de Mme Sylvie PERRIN, du bureau de la fiscalité et des
transports
le jeudi 28 janvier 1999
M. Alain
Cazarré
a introduit son propos en soulignant que la douane applique
une réglementation qu'elle ne définit pas, même si elle
parfois associée à l'élaboration des textes qu'elle doit
faire respecter.
Il a souligné la réduction du nombre des contrôles
douaniers induite par la création du marché unique, les
contrôles - ne concernant plus que les biens en provenance de pays tiers
-intervenant essentiellement dans les ports et les aéroports.
M. Alain Cazarré
a ensuite exposé les grandes lignes
de la réglementation relative à l'importation d'oeuvres d'art en
insistant sur la distinction majeure faite entre les importations simples et
les importations à titre temporaire. Il a indiqué qu'il
n'existait pas de droits de douane en matière d'importation d'oeuvres
d'art, de sorte que le rôle de la douane se limitait à la
perception de la TVA extra-communautaire. Il a également insisté
sur l'absence de procédure spécifique aux biens culturels,
considérés à l'importation comme n'importe quelle autre
marchandise.
M. Alain Cazarré
a expliqué la procédure qui
s'applique à l'occasion d'une importation simple : l'importateur
doit remplir une déclaration en douane, document administratif unique
commun à tous les Etats membres de l'Union. La TVA exigible est
calculée sur la valeur déclarée. La douane vérifie
toutefois la nature et la valeur des biens déclarés. Ces
vérifications ne posent pas de problème, dans la pratique, le
seul problème réel, qui est celui des faux, relevant de la
compétence des experts et non de celle des douaniers.
Ainsi, la TVA est due quelle que soit la qualité de l'importateur.
Toutefois une exception existe au profit du ministère de la culture, des
34 musées nationaux et des établissements agréés
par le ministère, ainsi qu'au profit des personnes
exonérées ressortissantes d'autres Etats membres lorsque le bien
est en transit. Le taux de TVA applicable est celui du pays d'importation,
c'est-à-dire le taux français.
A l'inverse, les importations temporaires sont soumises aux régimes
douaniers économiques qui permettent d'importer des biens en suspension
de TVA. Ces régimes, qui ont pour base légale le code des douanes
communautaires et le code général des impôts, autorisent
l'admission en suspension de droits, pour une durée donnée. Le
choix de l'un ou l'autre de ces régimes est conditionné par le
motif de l'opération : ainsi l'importation d'une oeuvre en vue
d'une vente, d'une exposition ou d'une expertise se fait dans le cadre du
régime dit " de l'admission temporaire " pour un délai
initial de 24 mois maximum, éventuellement prorogeable . L'importation
d'un bien en vue d'une restauration, d'un encadrement ou d'une autre
intervention se fait plutôt dans le cadre dit " du perfectionnement
actif ". La TVA n'est alors perçue que lors de la mise à la
consommation.
Les contrôles douaniers sont en revanche, plus approfondis en cas
d'importation temporaire car il faut s'assurer de l'identité de l'oeuvre
importée et de l'oeuvre ultérieurement réexportée.
En réponse à la question de M. Yann Gaillard concernant la
date d'exigibilité du paiement de la taxe et les mesures
éventuelles à envisager pour faciliter l'activité des
importateurs,
Mme Claire Grouffal
a indiqué que la douane
n'exigeait qu'une garantie à hauteur de 10% du montant de la TVA due. En
outre les commissaires-priseurs, les antiquaires ou galéristes
affiliés auprès d'un organisme reconnu par l'administration des
douanes (comité professionnel des galeries d'art et syndicat national
des antiquaires) bénéficient d'un régime simplifié
de garantie les dispensant de caution, sur production d'une police d'assurance.
M. Alain Cazarré
a donc conclu qu'il n'existait pas
d'obstacle fiscal à l'importation temporaire des biens culturels par des
professionnels, seuls les particuliers devant effectivement verser le montant
de garantie.
M. Alain Cazarré
a ensuite abordé la question de
l'exportation des biens culturels et de la protection des trésors
nationaux. Il a indiqué que ces biens faisaient l'objet d'une
réglementation nationale à laquelle s'ajoute la
réglementation communautaire harmonisant les règles d'exportation
des biens culturels vers les pays tiers. Il a indiqué que la Douane
n'était pas compétente pour autoriser la sortie d'un bien
culturel du territoire français -tant vers un autre Etat membre que vers
un pays tiers-, seul le ministère de la culture étant
habilité à délivrer le
certificat
. Il a
précisé, qu'au sein de l'administration des douanes, le SETICE
(Service des titres du commerce extérieur), était, en revanche,
compétent pour délivrer
l'autorisation d'exportation
à destination des pays tiers, sur présentation, par
l'opérateur, du certificat de sortie émis par le ministère
de la culture. Soulignant la faiblesse des moyens en personnel affectés,
dans ce service, au contrôle de l'exportation des biens
culturels -2 personnes -, il a indiqué que 2141 licences
d'exportation, temporaires ou définitives, avaient été
délivrées en 1998, en faisant remarquer que ce chiffre augmentait
régulièrement d'année en année, depuis 1993.
M. Alain Cazarré
a estimé que l'identité entre
les seuils de valeur des biens exportés retenus au niveau
français et les seuils européens était de nature à
faciliter les mouvements d'oeuvres d'art, et que la réglementation
actuelle ne posait pas - ou peu - de problèmes d'application aux douanes.
En réponse à une question relative à la fiabilité
des statistiques concernant les exportations de biens culturels,
M. Alain Cazarré
a fait valoir qu'elles étaient
établies par le SETICE mais qu'elles ne pouvaient être
complètes dès lors que les particuliers n'étaient pas
soumis à l'obligation d'établir une déclaration
d'échanges de biens en cas d'exportation intra-communautaire. Il a
précisé que les contrôles, en matière d'exportation
intra-communautaire, étaient limités à l'obligation de
produire à toute réquisition des services douaniers un document
permettant d'attester la régularité du transport.
MM. Alain Cazarré et Guillaume Adelle
ont conclu leur propos
en souhaitant que ne soit pas aggravée ou alourdie une
réglementation déjà fort complexe et en exprimant la
crainte de voir le marché de l'art se délocaliser encore
davantage vers la Belgique et les Pays-Bas en cas de rétablissement de
barrières ou d'entraves à la libre circulation
intra-communautaire.
Entretien de Maître Gérard
CHAMPIN,
Président de la Chambre nationale des Commissaires-priseurs
le jeudi 4 février 1999
Maître Gérard Champin
a tout d'abord
rappelé
que l'élément fondamental intervenu dans le domaine de l'art
depuis l'après-guerre était son internationalisation. Le
système français d'offices ministériels est un
système de proximité excellent dans un marché
fermé. Il s'est révélé totalement inadapté
à un développement international. La France avait pris des
années de retard et il était absolument nécessaire
d'opérer une mise à niveau en matière fiscale et
parafiscale.
Maître Gérard Champin
a ensuite passé en revue les
différentes causes de distorsions du marché français. Il a
tout d'abord cité la TVA à l'importation qui, selon lui, posait
un problème plus psychologique que réel car ses recettes, qui
s'élevaient à 40 millions de francs par an,
présentaient un caractère tout à fait marginal dans le
budget de l'Etat. Néanmoins les Anglais bénéficiaient
actuellement d'un taux réduit qui pénalisait les Français.
Maître Gérard Champin
a rappelé que la 7
e
directive européenne avait prévu la mise en place d'un taux
unique dans toute l'Union européenne au 1
er
juillet 1999
et que le Gouvernement français devrait se montrer très ferme
dans les discussions qui ne manqueraient pas de l'opposer à la
Grande-Bretagne.
Maître Gérard Champin
a ensuite fait état de la
liberté de tarif dont bénéficiaient les maisons de vente
britanniques. Il s'est félicité de ce que le projet de loi mette
fin au tarif encadré pour les ventes volontaires en France, ce qui
permettra aux Français de s'aligner sur le taux de 15 %
pratiqué par les Anglais pour les objets d'une valeur inférieure
à 300.000 francs.
A la demande de M. Yann Gaillard,
Maître Gérard Champin
a
ensuite abordé la question du droit de suite qu'il a jugé
généreux dans son principe et justifié à
l'époque de sa création, dans les années 20, mais
totalement inadapté au marché concurrentiel actuel. Des
discussions étaient actuellement en cours au niveau européen
où deux points de vue contraires s'affrontaient : celui des
Allemands, favorables à une extension du droit de suite, et celui des
Anglais, farouchement opposés à sa mise en application.
Maître Gérard Champin
s'est déclaré favorable
à l'instauration d'un taux dégressif et a souligné la
nécessité de trouver une solution pour le cas particulier des
galeries d'art.
Maître Gérard Champin
, en réponse à M. Yann
Gaillard, a ensuite évoqué le droit de reproduction comme autre
cause de distorsion avec la Grande-Bretagne où ce droit n'existait pas.
Ce droit, ancien mais d'application récente en France, avait fait surgir
des problèmes partiellement résolus par la loi du 27 mars 1997
exonérant " les reproductions intégrales ou partielles
d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans
le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en
France par un officier public ou ministériel ". Il était
important, selon lui, d'étendre le bénéfice de cette
exonération aux sociétés de vente étrangères
aussi bien qu'aux galeries d'art.
Maître Gérard Champin
a ensuite souhaité que la
modification de la loi de 1992 sur la circulation des biens intègre un
volet fiscal exonérant du droit d'enregistrement une oeuvre
frappée d'interdiction de sortie afin de compenser la perte de sa valeur
et a déploré que le ministère des Finances y soit
opposé.
Maître Gérard Champin
a ensuite abordé la seconde
partie de son exposé concernant l'indemnisation des
commissaires-priseurs prévue par le projet de loi. Il a rappelé
qu'une commission indépendante nommée pour évaluer le
préjudice subi avait rendu son rapport en janvier 1998. Le
préjudice avait alors été estimé à 900
millions de francs, somme qui avait été diminuée de
moitié par le gouvernement sans aucune justification.
Maître
Gérard Champin
a alors proposé que cette somme soit
considérée comme une provision sur indemnisation et que les
commissaires-priseurs qui pensaient avoir subi un préjudice
supérieur puissent le faire valoir. Sa proposition s'inspirait du
décret concernant l'indemnisation en cas de création de charge et
permettait à la fois de mettre la loi à l'abri de
l'inconstitutionnalité dont elle serait frappée si le
préjudice subi n'était pas intégralement remboursé
et, à l'inverse, de ne pas indemniser les intéressés
au-delà de celui-ci.
En réponse à M. Yann Gaillard, désireux de connaître
son interprétation de l'article 36 du projet de loi,
Maître
Gérard Champin
a expliqué qu'il s'agissait effectivement
d'établir une moyenne entre deux modes d'évaluation et non
d'opérer une division ainsi qu'une mauvaise interprétation
l'avait laissé penser.
Enfin,
Maître Gérard Champin
a déclaré que le
débat autour de l'indemnisation n'avait pas donné lieu à
des fluctuations sur le prix des études et qu'il n'y avait pas lieu
d'être inquiet de voir l'indemnisation engloutie par le règlement
des affaires récemment soulevées par les médias.
Pour conclure,
Maître Gérard Champin
s'est
déclaré favorable à une limitation de la
responsabilité des commissaires-priseurs ramenée à 10 ans,
ce qui favoriserait l'attractivité du marché français. Il
était important, selon lui, de perpétuer la tradition du droit
romain qui visait à protéger l'utilisateur, contrairement au
droit anglo-saxon qui tendait à rendre les gens responsables de leurs
actes. Une seconde raison présidait au choix de cette durée de 10
ans : la solidarité collective disparaissant lors de la mise en
application du projet de loi, les commissaires-priseurs devaient s'assurer pour
le passé et les compagnies d'assurance ne prenaient en compte que les
dix dernières années.
Entretien de M. André CHANDERNAGOR,
Président de l'Observatoire des mouvements d'oeuvres d'art
le mardi 12 janvier 1999
En
réponse à
M. Yann Gaillard
qui lui demandait son analyse
de la situation du marché de l'art en France,
M. André
Chandernagor
lui a fait remarquer que les statistiques en la matière
n'étaient pas toujours fiables : en particulier, il a
indiqué qu'il avait des doutes sur la réalité d'une
tendance qui se traduisait par la baisse des exportations à destination
des pays de l'Union européenne, qui avec une part de 17 % se situe
à un niveau nettement inférieur aux quelques 25 à
30 % que l'on connaissait au début des années 1990.
Il a avancé l'explication selon laquelle les mouvements d'oeuvre, dans
un contexte d'ouverture des frontières intra-européennes,
étaient sans doute mal retracés, les particuliers étant
dispensés de " déclaration d'échanges de
biens ", ainsi que dans certains cas, les opérateurs
professionnels. En revanche, les mouvements extérieurs à l'Union
européenne demeurent fiables. Nos deux principaux clients sont, à
part sensiblement égale, les Etats-Unis et la Suisse.
Evoquant ensuite la question de la position concurrentielle du marché de
l'art français,
M. André Chandernagor
a souligné
les raisons du déclin relatif de ce marché : tandis que
Londres bénéficiait d'une fiscalité attractive, et de
maisons de vente très organisées et très actives :
les commissaires-priseurs français se sont trouvés bridés
par leur statut, leur tarif et une fiscalité peu attractive. Ils se sont
limités au marché intérieur, sans effort suffisant de
présence sur le marché mondial.. Au contraire, les Anglais ont su
attirer de la marchandise et des clients en provenance de l'extérieur et
c'est cet objectif que l'on doit se fixer si l'on veut que Paris redevienne la
plaque tournante du marché de l'art qu'il était encore
après la deuxième guerre mondiale. Il a noté qu'il y avait
une large domination des anglo-saxons sur ce marché, qu'il s'agisse
des maisons de vente, de la publicité et de l'exploitation des
moyens modernes de communication.
En ce qui concerne le droit de suite,
M. André Chandernagor
a
observé que ce droit, qui aurait pu prendre la forme d'un droit social a
été conçu à l'origine comme un droit de nature
patrimoniale, ce qui en rend la suppression pratiquement impossible. D'une
façon générale, il a insisté sur le fait que si
Français et Anglais étaient concurrents, ils avaient des
intérêts communs et que la stratégie française, sans
doute la plus efficace, serait de se rapprocher de nos partenaires britanniques
pour trouver, à l'harmonisation européenne du droit de suite, une
solution acceptable qui n'obère pas trop le marché
européen -essentiellement Londres et Paris- par rapport à
New-York et Genève.
En ce qui concerne l'ISF,
M. André Chandernagor
a
estimé qu'il était en tout état de cause mauvais d'en
laisser planer la menace.
Au sujet des experts, il a insisté sur les problèmes posés
par la multiplicité des syndicats et sur la nécessité de
les convaincre d'adopter et de faire respecter des codes de déontologie,
comme il l'avait toujours préconisé. Il a indiqué par
ailleurs qu'il n'était pas favorable à ce que les conservateurs
des musées nationaux soient autorisés à procéder
à des expertises à la demande de tiers. Le mélange des
genres aboutirait inévitablement à la mise en jeu de la
responsabilité de l'Etat.
Abordant ensuite la question de l'exercice par l'Etat de ses
prérogatives régalienne en matière d'oeuvres d'art,
M. Chandernagor
a tout d'abord souligné la croissance du
nombre de demandes de certificats, qui sont passés de plus de 2.300 par
an à près de 3.800 aujourd'hui, tout en attirant l'attention sur
le petit nombre de refus de certificats qui n'ont concerné qu'une
soixantaine d'objets sur plus de 20.000 demandes depuis 1993.
Il a considéré que le régime actuel de protection des
" trésors nationaux " fonctionnait convenablement, même
si des efforts restaient à accomplir, à la Direction du Livre,
pour réduire la durée de délivrance des certificats. Il a
estimé en outre que ce régime doit être adapté pour
permettre à l'Etat d'acquérir dans certains cas les oeuvres sur
la base d'un prix fixé à dire d'experts. La procédure
actuelle de classement est en effet devenu inopérante depuis l'affaire
du tableau de Van Gogh, le " jardin à Auvers ", où
l'Etat a dû payer une indemnité équivalente à une
année de crédits d'acquisition, sans devenir propriétaire
du tableau.
En conclusion,
M. Chandernagor
a souligné que si l'on voulait
protéger notre patrimoine, il fallait dans l'environnement ouvert qui et
le nôtre, accepter d'y mettre le prix. Il a rappelé que les
Anglais, confrontés au même problème, l'ont résolu
par l'affectation d'une partie des recettes de leur loterie nationale à
l'acquisition d'oeuvres d'art.
E
ntretien de M. Jean-Pierre CHANGEUX,
Professeur au Collège de France,
Président de la commission des dations
le mardi 12 janvier 1999
M.
Jean-Pierre Changeux
a tout d'abord souligné, en réponse
à
M. Yann Gaillard
qui a souhaité connaître son
sentiment sur la
situation et les perspectives du marché de l'art
en France, qu'un marché de l'art florissant dans notre pays ne pouvait
que multiplier le nombre d'amateurs, ce qui permettait d'espérer
à terme des dons ou des dations venant enrichir les collections
publiques.
A l'appui de cette affirmation, il a indiqué que l'on pouvait raisonner
par analogie avec l'activité scientifique : faute d'organes de diffusion
nationaux, les chercheurs français sont soumis au jugement et à
l'expertise de leurs collègues anglo-saxons. Aujourd'hui, ils doivent
obligatoirement publier en anglais, alors que longtemps, le français a
été la langue de référence pour les publications
scientifiques.
Pour lui, une évolution analogue s'est produite pour le marché de
l'art qui s'est déplacé progressivement, hier de Paris à
Londres, et aujourd'hui de Londres à New-York. Les raisons de cette
évolution tiennent largement au fait, d'une part, que Paris n'est plus
comme autrefois un lieu où se manifestent une offre et une demande
importante d'oeuvres, et, d'autre part, que les anglo-saxons ont une
capacité d'expertise incontestée sur le plan international.
Reprenant son argumentation,
M. Jean-Pierre Changeux
a
précisé les conditions qui lui paraissaient de nature à
revitaliser le marché de l'art en France :
1. Développer une capacité d'expertise de niveau
international
: il a souligné que la crédibilité
supérieure des anglo-saxons était un facteur déterminant,
à côté de l'existence d'une population d'amateurs capables
de payer des prix élevés, qui explique l'essor des places de
Londres et de New-York. Il s'est interrogé, à cet égard,
sur la légitimité des règles qui interdisent aux
conservateurs de faire état de leur opinion d'expert, soulignant que,
dans son domaine d'activité, on encourageait les chercheurs à
établir des liens avec les entreprises, et que, par ailleurs, il est
tout à fait admis que les professeurs de droit donnent des consultations
juridiques.
2. Susciter l'apparition d'amateurs d'art :
il faut faire en sorte
que les personnes qui en ont les moyens s'intéressent à l'art.
3. Définir un statut fiscal privilégié :
il
s'agit selon lui d'un aspect important dans la mesure où il est
établi que beaucoup d'oeuvres quittent le territoire national sans
être déclarées. Telle est la raison pour laquelle il est
non seulement dangereux de soumettre les oeuvres d'art à l'impôt
sur la fortune, mais encore souhaitable de définir un statut
privilégié pour celles achetées à l'étranger.
Pour conclure sur ce point
M. Jean-Pierre Changeux
a indiqué
qu'il n'était pas pessimiste et que Paris était par ailleurs une
ville suffisamment attractive pour faire venir les collectionneurs
internationaux.
En réponse à
M. Yann Gaillard
qui lui demandait ce qu'il
pensait de l'exercice par l'administration de ses prérogatives
régaliennes, (préemption et interdiction de sortie)
M.
Jean-Pierre Changeux
a indiqué qu'il ne s'agissait pas, selon lui,
d'un frein important, d'autant plus que dans d'autres pays, et notamment au
Japon et aux Etats-Unis, il existait des mécanismes très
rigoureux de protection des trésors nationaux. Le problème vient
parfois du caractère tardif de l'autorisation de sortie, ce qui peut
créer un handicap pour les oeuvres très chères.
Abordant, dans un deuxième temps, les problèmes
spécifiques de la
procédure de dation
en paiement,
M.
Jean-Pierre Changeux
a tout d'abord souligné qu'elle avait permis de
conserver des éléments importants du patrimoine national dans les
domaines les plus variés, rappelant à ce sujet qu'elle concernait
non seulement les oeuvres de haute valeur artistique mais aussi celles ayant
une importance historique.
Evoquant les opérations récentes les plus marquantes,
M.
Jean-Pierre Changeux
a souligné la diversité des oeuvres
acquises (qui vont des oeuvres d'art aux hélicoptères en passant
par des bibliothèques ou des collections scientifiques) tout en
indiquant néanmoins, qu'en valeur, l'art moderne était le plus
important.
En ce qui concerne le bilan de la procédure, il a fait savoir que de
plus en plus d'oeuvres étaient déposées en régions
et que l'on s'efforçait même, s'agissant d'une procédure de
dation et non d'une donation, de tenir compte des souhaits des
intéressés quant à l'affectation de l'oeuvre.
Puis
M. Jean-Pierre Changeux
a attiré l'attention sur le
déroulement pratique de la procédure, signalant la
modicité des moyens administratifs dont dispose la commission des
dations : celle-ci n'a pas de budget, tous les frais étant
théoriquement pris en charge par les administrations auxquelles
appartiennent les membres de la commission ou les experts consultés.
Il a souligné le caractère fondamentalement volontaire de la
procédure, dans la mesure où l'offre initiale, qui est assortie
d'une évaluation chiffrée de l'oeuvre et d'une expertise, peut
toujours être retirée, même après l'acceptation du
ministre. Il a précisé sur ce point que le ministre avait
toujours suivi l'avis de la commission des dations et que cette dernière
fonctionnait suivant le principe du consensus.
En ce qui concerne la valeur libératoire,
M. Jean-Pierre Changeux
a insisté sur le fait qu'il prenait toujours comme
référence le prix du marché international. La commission a
d'ailleurs constitué une banque de données lui permettant de
juger des propositions faites à la commission. Il a rappelé que
l'oeuvre faisait l'objet d'un double examen portant d'abord sur la valeur
artistique et, ensuite, sur la valeur de marché. Globalement, il a
indiqué que le bilan de la commission faisait apparaître que les
valeurs libératrices préparées par les offreurs
étaient, en général, raisonnables mais parfois
révisées à la baisse et que dans certains cas, même
révisées à la hausse par souci d'équité et
de façon à éviter toute contestation.
Pour conclure,
M. Jean-Pierre Changeux
a indiqué que si la
procédure actuelle était satisfaisante, on pouvait songer
à l'étendre au paiement d'autres impôts ou dettes
vis-à-vis de l'Etat. L'essentiel, selon lui, est de ne pas introduire de
plafond dans le montant annuel des dations compte tenu des fluctuations
conjoncturelles inhérentes aux offres de dations (décès,
partages, héritages).
Entretien de Mme Henriette CHAUBON,
Sous-directeur de la direction des professions
judiciaires et juridiques
à la Chancellerie
et M. Mathias Emmerich, conseiller technique
le mercredi 10 février 1999
M. Yann
Gaillard
a souhaité avoir des précisions, tout d'abord, sur
le mode de calcul de l'indemnisation des commissaires-priseurs, ensuite sur le
taux et la durée de la taxe prévue à l'article 40 du
projet de loi pour son financement et enfin sur la clause de sauvegarde.
M. Mathias Emmerich
a tout d'abord indiqué que le calcul de la
valeur d'une charge était le résultat de la moyenne entre les
deux critères d'évaluation suivants : le chiffre d'affaires et le
résultat. La somme ainsi dégagée est affectée d'un
coefficient différent pour Paris et la province traduisant la
différence des transactions entre ces deux pôles.
Mme Henriette Chaubon
a précisé que le produit demi-net
est un critère qui sert à évaluer le montant des prix de
cession qui est librement fixé entre les parties. Il est obtenu en
déduisant des produits bruts les loyers des locaux professionnels, les
salaires, les charges sociales et la taxe professionnelle. Dès 1976, une
circulaire ministérielle indiquait que la produit demi-net ne
correspondait plus tout à fait à la réalité
économique. Ce critère avait été retenu dans le
premier projet de loi. Il était affecté d'un coefficient
élevé, ce qui pouvait s'analyser en une aide. Le total de
l'indemnisation s'élevait à 2,3 milliards de francs. Dans le
projet de loi actuel, l'aide a disparu, il ne s'agit plus que d'une juste
indemnisation du préjudice subi pour laquelle le nouveau Gouvernement
s'est appuyé sur le rapport de MM. Cailleteau, Favart et Renard.
S'agissant de la clause de sauvegarde,
M. Mathias Emmerich
a
estimé qu'elle serait difficile à mettre en oeuvre et risquait de
générer des contentieux judiciaires à venir. Il a
indiqué , en réponse à M. Yann Gaillard, s'agissant de la
taxe de 1 % prévue à l'article 40 qu'il ne serait pas
inconcevable d'envisager sa suppression qui serait, par ailleurs, bien
perçue par les commissaires-priseurs et constituerait un argument de
meilleure compétitivité sur le marché de l'art.
Evoquant le système de garantie prévu aux article 11 et 12 du
projet de loi,
M. Mathias Emmerich
a souligné que l'objectif
était de protéger des sociétés fragiles ou peu
capitalisées en évitant tout lien capitalistique direct entre la
société de ventes aux enchères et l'établissement
de garantie.
M. Yann Gaillard
a alors rappelé qu'un certain
nombre de commissaires-priseurs souhaitait l'application, en la matière,
du droit commercial ordinaire.
M. Mathias Emmerich
a indiqué
qu'il s'agissait d'un dispositif de transition.
Concernant la responsabilité des commissaires-priseurs.
Mme Henriette Chaubon
a rappelé que le code civil
prévoyait une responsabilité de 30 ans à l'égard du
vendeur (art. 2262) et de 10 ans à l'égard de l'acheteur (art.
2270-1), alors que le projet de loi (article 27) fixe la responsabilité
des commissaires-priseurs à dix ans à partir du fait
générateur du dommage.
Enfin, en réponse à M. Yann Gaillard, qu'il interrogeait sur le
sort réservé à l'Hôtel Drouot et à la
Gazette,
M. Mathias Emmerich
a répondu que leur sort ne relevait
pas seulement de décisions des pouvoirs publics. En tout état de
cause, il a estimé que l'arrivée de Sotheby's et Christie's
à Paris allait transformer le marché et générer une
augmentation des ventes et, par conséquent, faire de Paris le
troisième marché mondial de l'art.
Entretien de Mme Arlette CHOUMER
et de M. Claude PAQUET
Syndicat des personnels des commissaires-priseurs
le mercredi 7 avril 1999
M.
Claude Paquet
a tout d'abord indiqué que l'avant projet de loi sur
les ventes aux enchères publiques prévoyait que les
indemnités de licenciement pour motif économique étaient
calculées à raison d'un mois de salaire par année
d'ancienneté. Le projet définitif, après arbitrage
auprès du Premier ministre, a abandonné ce système pour en
revenir à l'application de la convention collective de la profession.
Or, celle-ci est très peu protectrice en cas de licenciements puisque
cette situation ne se produisait pratiquement jamais dans la profession. Dans
le système retenu, une personne ayant 30 ans de maison et gagnant 10.000
francs par mois percevrait 30.000 francs d'indemnité.
A cet égard,
Mme Arlette Choumer
a observé que les
regroupements de commissaires-priseurs allaient générer de
nombreux licenciements. En effet, sur les 1.500 salariés actuellement
employés, 400 licenciements sont prévus.
M. Claude Paquet
a estimé que le personnel faisait partie des
oubliés de la réforme du statut des commissaires-priseurs. Selon
lui, le Gouvernement n'a pas voulu créer un précédent en
prévoyant une indemnisation des salariés, dérogatoire
à la convention collective, dans un projet de loi.
En conclusion,
M. Yann Gaillard
a déclaré que le
Sénat ne manquerait pas de rappeler que l'avant projet de loi
était plus favorable au personnel et de déposer un amendement
tendant à améliorer les conditions de leur indemnisation.
Entretien de M. Jean-Marc GUTTON,
Directeur de la Société des Auteurs
Arts Graphiques et Plastiques,
le jeudi 28 janvier 1999
M.
Jean-Marc Gutton
a d'abord replacé la société qu'il
dirige dans le contexte des sociétés d'auteurs. Il a
souligné qu'une des particularités françaises était
la multiplicité des sociétés d'auteurs. Pour lui, la SACEM
est forte car elle est seule, à la différence des arts plastiques
où longtemps il y a eu deux sociétés.
M. Jean-Marc Gutton
a également commenté les raisons de la
crise qui a emporté la SPADEM, en soulignant les responsabilités
de la tutelle dans les dérives qui ont provoqué la disparition de
cette société.
Puis, il a indiqué que sa société, l'ADAGP, regroupait la
presque totalité des artistes, à l'exception de quelques grands
noms comme Picasso, Matisse ou Delaunay.
En ce qui concerne la question des droits d'auteur, il s'est
élevé contre la présentation qu'avait faite le rapport de
M. Chandernagor du droit de suite qui n'est pas une taxe mais un droit d'auteur
pur au coeur même de la Propriété Intellectuelle.
Il a souligné que la charge représentée par le droit de
suite était modérée : le volume des ventes
protégées était inférieur à 5 % du
total, et le droit de suite correspondrait 0,2 % du chiffre d'affaires
global des opérateurs. Pour lui, ces pourcentages seraient identiques
entre la France et la Grande-Bretagne si le droit de suite était
appliqué dans ce dernier pays.
Enfin, après avoir rappelé que les Américains avaient
annoncé qu'ils se pencheraient sur le problème de l'introduction
du droit de suite aux Etats-Unis lorsque l'Europe l'aura
généralisé,
M. Jean-Marc Gutton
a fait savoir qu'il
était favorable à une dégressivité des taux qui
pourraient ainsi passer de 4 à 3, puis 2 %, voire 1 %
seulement pour la tranche la plus élevée.
Il a ajouté, en ce qui concerne le droit de reproduction, qu'il ne
voulait pas que les opérateurs paient deux fois et donc que ce droit ne
serait pas exigé des opérateurs qui, comme les
commissaires-priseurs français, paient déjà le droit de
suite.
Enfin,
M. Jean-Marc Gutton
a souligné que les frais de perception
de l'ADAGP étaient réellement modérés, par rapport
aux 11 millions de francs collectés au titre du droit de suite.
Entretien de Mme Anne LAHUMIERE,
Présidente du Comité des Galeries d'art,
de Mme Marie-Claire MARSAN, Déléguée
générale,
et de M. Patrick BONGERS, Galériste
le mardi 5 janvier 1999
Mme Anne
Lahumière
, a débuté son exposé en indiquant que
l'appartenance au Comité des galeries d'art était
subordonnée à un double parrainage et à la signature d'un
code de déontologie. Le Comité compte actuellement
160 galeries sur un total compris entre 400 et 500 en France. Le
galériste, à la différence du commissaire-priseur,
effectue un travail de promotion permanent de ses artistes. Ce travail prend la
forme d'invitations, de catalogues, d'affiches, d'expositions montées en
France et à l'étranger ainsi que de participations à des
foires d'art internationales.
Mme Marie-Claire Marsan
a fait observer qu'aujourd'hui n'importe
qui pouvait s'intituler galerie d'art en se contentant de prendre des oeuvres
en dépôt. Elle a souligné qu'une vraie galerie se
distinguait par le travail qu'elle opérait en profondeur et dans la
durée pour la promotion de l'oeuvre de l'artiste qu'elle avait choisi.
Une autre caractéristique essentielle résidait dans le fait que
c'était la galerie qui rémunérait l'artiste et non
l'inverse.
Mme Anne Lahumière
, en réponse à une question de
M. Yann Gaillard
sur la situation actuelle de la profession, a
déclaré que le marché intérieur subissait le
contrecoup de la crise de 1990 et était toujours déprimé.
Les galeries ne subsistent que parce qu'elles participent à des foires
à l'étranger et que 90 % des ventes sont
réalisées à l'exportation. Elle a toutefois reconnu que,
en dehors de toute conjoncture économique, l'art contemporain
n'intéressait pas les collectionneurs français.
M. Patrick Bongers
a fait observer que la création
française se vendait mal à l'étranger également.
Mme Anne Lahumière
a précisé que l'Angleterre,
entièrement tournée vers les Etats-Unis, ne représentait
pas un marché intéressant dans le domaine de l'art contemporain
pour la France. Parmi les pays de la communauté, l'Allemagne
était le seul concurrent sérieux et représentait un
marché dynamique que la France devait s'efforcer de conquérir. La
Suisse représentait également un débouché valable
pour la création française.
Mme Marie-Claire Marsan
a expliqué la vitalité du
marché allemand par la structure fédérale du pays :
chaque région développe en effet une politique culturelle intense.
Mme Anne Lahumière
a ajouté qu'il existait de
véritables incitations pour les collectionneurs à travers les
fondations et que la vitalité du marché interne était la
cause directe de la reconnaissance des artistes allemands à
l'étranger.
Patrick Bongers
a fait remarquer que la création allait là
où était le marché. La France ayant perdu sa place
prépondérante dans le domaine du marché de l'art au cours
des années 60, ne représentait plus un centre de création
artistique. Il a déploré le manque de moyens mis à la
disposition des créateurs et des galeries ainsi que le manque
d'intérêt des médias à leur égard et mis en
cause l'éducation scolaire, tournée vers la littérature,
qui ne donnait aucune culture artistique aux enfants. Tout cela contribuait
à décourager le public.
Mme Anne Lahumière
a fait valoir que la menace constante
d'imposition des oeuvres d'art qui pesait sur le contribuable dissuadait les
acheteurs potentiels.
M. Yann Gaillard
ayant désiré
connaître les mesures qu'elle préconisait,
Mme Anne
Lahumière
a proposé que soit mise en place, sous forme de
déductions fiscales, une politique d'incitation pour les petites
entreprises qui achetaient des oeuvres d'art. Elle a également
demandé que la taxe forfaitaire et le droit de reproduction qui
pénalisent les galeries d'art soient alignés sur le même
taux que celui pratiqué dans les ventes publiques. En ce qui concerne la
taxation à la marge au taux nominal de TVA instaurée par la
7
ème
directive européenne, elle a souhaité
que soit mis en place un système permettant l'application d'un taux
réduit lorsqu'il existe une TVA en amont (artistes assujettis,
importations) à l'image de ce qui se fait en Allemagne.
Mme Marie-Claude Marsan
s'est déclarée opposée
au droit de suite, dans la mesure où, en France, les galeries cotisaient
déjà pour la sécurité sociale des artistes.
Mme
Anne Lahumière
a souligné l'iniquité du droit de suite
qui ne profitait qu'à quelques familles célèbres.
Mme Anne Lahumière
a suggéré, pour redynamiser
le marché français, d'ouvrir un espace réservé
à la création d'artistes français ou résidents
français à partir des années 20.
M. Yann
Gaillard
ayant déploré le manque de diversité dans les
expositions ou les musées consacrés à l'art contemporain,
Mme Marie-Claire Marsan
pense que, malgré des efforts, un
système de pensée unique persiste malheureusement dans les achats
pour les collections publiques.
Mme Anne Lahumière
a
ajouté que, de plus, lorsque les institutions s'adressent directement
à l'artiste, cela fausse le marché en fixant de façon
arbitraire des prix qui ne sont pas nécessairement le reflet de la
réalité et empêche l'artiste d'avoir un rayonnement
international faute d'un marché privé. Elle a conclu qu'il
était important de garder à l'esprit que le circuit commercial
était le seul à même d'offrir la plus grande
diversité et d'assurer la plus large diffusion.
.
Entretien de M. Eric LAUVAUX,
du Cabinet NOMOS (commissaires-priseurs)
accompagné de Maîtres DUHAMEL et de CORNEILLAN
le mardi 12 janvier 1999
M. Eric
Lauvaux
a tout d'abord présenté l'organisme
représenté par son cabinet : CPR (commissaires priseurs
réunis) est un groupement constitué sous forme d'une
société civile de moyens rassemblant un certain nombre de
commissaires-priseurs de province. En terme de chiffre d'affaires, ceux-ci
représentent 13 % du marché français et 22 % du
chiffre d'affaires des commissaires-priseurs de province. Il s'agit, a-t-il
souligné, d'un groupement stable puisque 5 ans après sa
constitution, ce groupement n'a enregistré aucune défection.
Ensuite,
M. Eric Lauvaux
a précisé le sens de la
démarche des commissaires-priseurs de CPR : leur but est d'avoir les
moyens de s'adapter aux nouvelles conditions de marché
créées par la nouvelle loi et en tout état de cause de
faire lever le plus vite possible les incertitudes qui pèsent
actuellement sur les futures conditions d'exercice de leur profession.
Plus précisément, il a, avec les deux commissaires
présents, évoqué un certain nombre de sujets de
préoccupation :
1.
L'absence de prise en compte des problèmes posés par les
nécessaires restructurations qui vont découler du nouveau
régime des ventes aux enchères
. Selon eux, on ne tient pas
compte du coût fiscal des réorganisations, alors que celui-ci sera
immédiatement exigible sans avoir pour contre-partie aucun
dégagement de trésorerie. Dans la mesure où actuellement
aucun des participants n'est soumis à l'impôt des
sociétés, ils ne peuvent bénéficier du
régime de l 'article 151 octies du CGI.
M. Eric Lauvaux
a
indiqué qu'il fournirait à
M. Yann Gaillard
une note
technique précisant les difficultés engendrées par
l'inadaptation du régime fiscal des plus-values à la situation
des commissaires-priseurs.
2.
Les conditions d'exercice de l'activité de commissaire-priseur
judiciaire.
Il a été souligné que le projet de loi
était muet sur cette question, or, pour les membres de CPR, une
évolution et des regroupements sont inévitables et il faut donc
les prévoir et les accompagner.
M. Yann Gaillard
a pris note du
problème posé tout en considérant qu'il relevait de la
compétence exclusive de la commission des lois.
3.
La conception trop restrictive de la notion de vente publique
: Les
représentants de CPR ont souligné que le projet de loi ne
concernait ni les ventes fermées (fréquentes en matière
automobile), ni d'une façon générale les ventes qui
pourraient intervenir par Internet. Il y a là une lacune importante
notamment du point de vue de l'assiette de la taxe destinée à
financer l'indemnisation.
4.
L'indemnisation
: Les représentants de CPR ont d'abord
critiqué le principe même de la taxe qui va conduire à
faire financer l'indemnisation par les études les plus dynamiques. Ils
ont en effet estimé que compte-tenu de l'état très
concurrentiel du marché, la taxe serait en fait supportée par les
commissaires-priseurs. En conclusion, ils se sont même demandés
s'il n'aurait pas été préférable de ne
prévoir ni taxe ni indemnisation. Outre le problème d'assiette
déjà mentionné, ils ont insisté sur les
modalités critiquables du calcul de l'indemnité (non prise en
compte de la dernière année connue, 1997, et traitement
discriminatoire entre les études parisiennes et les études de
province) et sur les incertitudes juridiques qui pèsent sur le statut
fiscal de l'indemnité : s'agit-il d'un revenu ou d'une plus-value ?
5.
Questions diverses :
Enfin, les représentants de CPR ont
souligné la situation relativement favorable faite aux notaires et aux
huissiers qui pourront continuer à effectuer des ventes aux
enchères volontaires sans avoir à changer de statut.
Entretien de M. Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN,
Directeur, Chef du service de la législation fiscale
et de M.
Jean-Louis JOURNET,
Sous-directeur au service de la législation
fiscale
le mardi 9 février 1999
M. Yann Gaillard
s'étant tout d'abord
interrogé sur la possibilité d'une réforme, voire d'une
suppression de la TVA à l'importation,
M. Hervé Le
Floch-Louboutin
a déclaré qu'on était là
domaine contraint sur le plan juridique et que la 7
e
directive ayant
posé le principe de la taxation à l'importation, il
n'était pas envisageable de revenir en arrière. Par ailleurs,
fondamentalement le marché de l'art s'inscrivait tout naturellement dans
le champ d'application de la TVA. Cette TVA n'étant due que par les
ressortissants de la communauté européenne, elle ne lui
paraissait pas nuire au rôle de Paris en tant que plaque tournante du
marché de l'art.
M Yann Gaillard
lui ayant fait observer
que, dans l'incertitude de la destination finale de l'oeuvre, le vendeur
donnerait toujours priorité au pays le plus fiscalement favorable,
M. Hervé Le Floc'h-Louboutin
a convenu qu'il s'agissait
là d'un vrai débat de principe qui rejoignait la
problématique des discussions actuelles sur les activités
délocalisables et la manière de les taxer. La position de la
France était très claire : sur tous les sujets de
compétition fiscale elle défendait l'idée d'une taxation
minimum.
M. Yann Gaillard
ayant fait valoir que le marché de l'art
était un marché étroit, ne présentant pas les
mêmes enjeux que les grands débats économiques,
M. Hervé Le Floc'h-Louboutin
s'est élevé
contre la logique du moins-disant fiscal qui conduisait à ne pas taxer
les riches.
M. Jean-Louis Journet
a ajouté que le
marché allait tout naturellement là où se trouvaient les
nouvelles fortunes, à savoir les Etats-Unis. Par ailleurs il lui
paraissait que c'était moins la fiscalité que la libre
disposition de ses biens qui préoccupait le collectionneur et à
cet égard la protection du patrimoine jouait un rôle dissuasif
dans le retour des oeuvres sur le territoire français.
M. Yann Gaillard
ayant soulevé la question de la
dérogation obtenue par les Anglais pour l'application d'un taux
réduit de TVA à l'importation,
M. Hervé
Le Floc'h-Louboutin
a répondu que si cette dérogation
devait être prorogée, alors la France demanderait un alignement
afin de ne pas être pénalisée.
M. Jean-Louis
Journet
a rappelé que la règle de l'unanimité
s'appliquerait lors des débats au sein de la Commission
européenne sur cette question. Une autre dérogation a alors
été évoquée : la possibilité pour les
Allemands d'appliquer un régime de taxation à la marge au taux
réduit.
M. Hervé Le Floc'h-Louboutin
a
précisé que cette dérogation devait prendre fin en juillet.
En réponse à une question de M. Gaillard,
M. Jean-Louis
Journet
a indiqué que les Anglais pratiquaient la vente de biens
sous régime suspensif, ce qui les plaçaient en infraction avec la
législation européenne et qu'une action était actuellement
en cours à Bruxelles contre eux.
M. Yann Gaillard
s'est ensuite fait l'écho de diverses
revendications émanant des commissaires-priseurs installés en
province quant à la restructuration de leurs études en
sociétés de ventes volontaires.
Pour conclure,
M. Hervé Le Floc'h-Louboutin
a indiqué
qu'une réflexion était en cours sur le problème fiscal que
risquait de poser la cession des parts de la société Drouot SA
appartenant à la Compagnie des commissaires-priseurs lors de la
disparition de cette dernière.
Entretien de Maître Joël MILLON,
Président de la Chambre des commissaires-priseurs de Paris
et Maître William STUDER, commissaire-priseur,
le jeudi 4 février 1999
M. Yann
Gaillard
a demandé à
M. Joël Millon
d'exposer sa
position sur deux points : la situation et les perspectives du
marché de l'art français en général et le projet de
loi sur les ventes volontaires.
M. Joël Millon
a rappelé que si la définition d'un
statut des commissaires-priseurs était une urgence, la réforme
attendait déjà depuis quatre années ce qui, dans une
activité devenue un marché de capitaux, les plaçait en
situation difficile par rapport aux maisons commerciales
étrangères Sotheby's et Christie's.
Il a estimé que dans ce contexte de mondialisation, la réforme ne
pouvait apporter de solution, notamment au problème de la défense
du patrimoine, que complétée par des mesures rendant plus
attrayantes fiscalement, tarifairement et juridiquement le marché
parisien. Il a ajouté que le manque de visibilité, qui
résultait de l'attente d'un nouveau statut, entraînait un blocage
des ventes d'études comme des ouvertures de capital qui handicapait la
profession.
Si
M. Joël Millon
a rappelé que le projet actuel par rapport
au projet Léonnet, établi en concertation et soutenu par M.
Toubon, divisait déjà par deux l'indemnisation, il a
regretté que le nouveau gouvernement l'ait réduite à
nouveau de moitié en supprimant de surcroît le volet social. Il a
ainsi déclaré que même si l'expropriation n'était
que partielle selon l'avis rendu par la Cour de cassation, l'indemnisation
devait rester préalable, totale et juste, ce qui, selon lui,
n'était pas le cas dans le projet de loi.
Abordant le calendrier de la réforme, il a considéré que
ses délais d'adoption et de mise en place, de une à deux
années, notamment pour l'indemnisation, constituaient un handicap pour
les opérateurs français, dans une période ou les
concurrents étrangers commencent à se positionner
.
M. Joël Millon
a évoqué, à ce propos, la
tenue d'une vente par Sotheby's au Château de Groussay, hors de la
circonscription de la Chambre de Paris, et la demande présentée
par des commissaires-priseurs parisiens de vendre pour Sotheby's au
siège du futur hôtel des ventes de cette société
à Paris. Il a cependant estimé que même si un recours
était déposé, cet aspect juridique était
peut-être dépassé.
M. Joël Millon
a également considéré que
l'incertitude, tant sur les partenaires futurs que sur les moyens financiers,
hypothéquait l'avenir de Drouot dont l'activité, essentielle pour
le quartier, représentait surtout 6.000 à 8.000 visiteurs
quotidiens, un million d'objets vendus chaque année et
2.000 emplois.
Évoquant le Livre blanc qu'il avait initié en 1987-1988 et qui
n'avait permis d'obtenir que quelques aménagements, il a rappelé
les difficultés pour obtenir la possibilité de créer des
sociétés anonymes pour les officiers ministériels. Il a
donc plaidé pour une harmonisation totale de règles qui
deviendraient applicables à l'échelon international.
M. Joël Millon
s'est déclaré partisan, plutôt
que de revenir au projet initial de la commission Léonnet s'appuyant sur
le produit demi-net, de revenir au projet soutenu par Mme Guigou et
élaboré par les trois sages.
Concernant les aspects financiers du projet, il a rappelé ses quatre
critiques majeures :
l'incohérence et l'inadaptation du montant de l'indemnisation ;
le renvoi des dispositions financières, telle que celle concernant
le fonds de garantie, à une loi de finances ultérieure ;
la durée du délai de traitement des dossiers
d'indemnisation qu'il a proposé de ramener de 1 an à 6 mois ;
les risques d'insuffisance de la période de 5 ans pour la
perception de la taxe d'indemnisation, et de pérennisation de cette taxe
une fois son objet rempli.
Après avoir précisé que la latitude financière du
Parlement était délimitée par l'ordonnance de 1959,
M.
Yann Gaillard
a proposé que les deux Chambres de
commissaires-priseurs lui présente des exemples concrets
d'indemnisation, établis d'une seule voix, afin qu'il puisse se livrer
à une comparaison avec les simulations du ministère. Il a
remarqué que dans son étude juridique sur le sujet, M. Vedel
avait considéré qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation,
ce qui était également le point de vue initial de l'inspection
générale des finances.
M. Joël Millon
a affirmé que si le projet n'était pas
modifié, en ce qui concerne les règles d'indemnisation, la
profession utiliserait tous les recours disponibles pour combattre cette
disposition.
Il a tracé un parallèle avec les mesures dont avaient
bénéficié les avoués, les greffiers et les agents
de change, lors des réformes de leurs professions et
considéré que l'indemnisation demandée était
raisonnable au regard des rentrées fiscales qu'avait assuré la
profession à l'Etat. Il s'est également interrogé sur
l'éventualité du rachat d'une étude, dans la mesure ou le
projet permettrait de créer une SARL pour 50.000 F.
Après avoir fait remarquer que le système des
bénéfices non commerciaux, auquel ils étaient assujettis,
ne leur permettait de constituer ni fonds propres, ni réserves,
M.
Joël Millon
a fait observer que la valeur de l'office était
validée par la Chancellerie et représentait bien une valeur
pécuniaire, prise en compte par l'administration fiscale. Il a
rappelé que c'était le ministère de l'Économie et
des finances qui avait imposé la réduction du coefficient
d'indemnisation à l'article 37 et demandé le retour à
l'indemnisation préalable à l'ouverture du marché à
l'article 35. Il a précisé que la nouvelle estimation,
réduisant de moitié le produit demi-net de 1,8 milliard de
francs, qui servait de référence initiale, avait
été acceptée en contrepartie de la poursuite
d'activité, mais qu'il ne pouvait accepter une nouvelle division
aboutissant à une indemnisation globale de 450 millions de francs
seulement. Il a fait état de la comparaison avec la maison Christie's
dont le volume d'affaires, soit 10 milliards de francs, était du
même niveau que le marché français, et de la proposition de
M. Pinault de la racheter pour 8 milliards de francs : ce rapport peut
inciter, selon lui, à la réflexion sur l'estimation du montant de
l'indemnisation par le Gouvernement même s'il ne peut pas être
considéré comme applicable en l'état au cas de la
réforme.
Après s'être interrogé sur le risque d'application de
l'article 40 aux amendements proposés,
M. Yann Gaillard
s'est
inquiété des perspectives de Drouot après cette
réforme.
M. Joël Millon
a précisé que la grande
stabilité de Drouot SA reposait sur l'unicité du lieu de vente et
la solidarité collective et qu'elle se trouvera fragilisée par la
réforme. Il a estimé que le flou tant juridique que fiscal actuel
entravait toutes les initiatives de regroupement ou de revente de parts pour
les 110 actionnaires de la société, alors que celles-ci seront un
préalable à la constitution de la nouvelle société,
d'autant que les deux activités, judiciaires et commerciales, seront
dissociées. Drouot SA subissait selon lui les séquelles d'un
passage de la personnalité morale de droit public, statut actuel de la
compagnie des commissaires-priseurs, à celle de droit privé. Il a
jugé que la charge de l'impôt sur les sociétés et
des dividendes, applicable à la compagnie au titre des actions de Drouot
SA, était difficile à supporter dans le contexte de la
réforme. Il a donc souhaité un report du paiement de la
plus-value.
Il a enfin regretté la disparition de tout volet social du projet.
Maître William Studer
a présenté une proposition de
création de société de cautionnement mutuel pour
satisfaire aux garanties d'assurance, prévues par le projet de loi, et
dont les assureurs et établissements de crédits étaient
demandeurs. Son capital, apporté par les adhérents, devrait
atteindre environ 20 millions de francs, pourrait bénéficier
d'actions libérées de Drouot SA et constituerait un fonds de
garantie, pour tout sinistre éventuel, permettant de recourir à
l'assurance, tant pour les avances que pour les garanties d'adjudications, et
aux financements bancaires.
Entretien de M. Pierre ROSENBERG,
Président-directeur du Musée du Louvre
le mardi 9 février 1999
M.
Pierre Rosenberg
a tout d'abord déclaré qu'il était
temps que le Gouvernement autorise Sotheby's et Christie's à faire des
ventes aux enchères publiques à Paris, sinon le marché
risquait de s'installer définitivement à Londres. Il a
noté qu'une des raisons du succès de la place de Londres tenait
à la qualité de ses experts qui font largement défaut
auprès des commissaires-priseurs français.
Il a ensuite estimé que l'installation de Sotheby's et Christie's
risquait d'entraîner la disparition de l'Hôtel Drouot, situation
qu'il regretterait personnellement tout en soulignant le caractère
désuet de cette institution. A cet égard, il a rappelé que
Sotheby's et Christie's s'étaient substitué au marché
parisien au profit de Londres en s'appuyant sur une conception très
mondialiste du marché de l'art.
M. Pierre Rosenberg
a encore observé que le vrai débat
relevait des taxes dans l'Europe communautaire qui incitaient les marchands
à vendre à New-York, qu'il s'agisse de la TVA ou d'autres charges
qui font qu'un marchand à plus intérêt à vendre
à New-York qu'à Londres.
Il a ensuite indiqué que le système anglais de ventes aux
enchères était plus rationnel et efficace que le système
français. En effet, 95 % des oeuvres ou objets importants sont
concentrés sur deux expositions par an et la vente a lieu effectivement
6 mois après, alors qu'en France, elle a lieu le lendemain, ce qui
laisse très peu de temps pour s'organiser, et que l'Hôtel Drouot
requiert une fréquentation quasi-quotidienne. Il a encore comparé
les systèmes français et anglais concernant les experts et
regretté qu'en France ces derniers soient en même temps marchands,
cette confusion des genres étant préjudiciable au marché
de l'art.
S'agissant de la protection du patrimoine national et de la réforme de
la loi de 1992, il a indiqué qu'il y avait deux solutions possibles, le
système italien de " notification " très
protectionniste et le système anglais très libéral. La
France n'a jamais su choisir entre les deux. Elle passe sans arrêt de
l'un à l'autre. Il a estimé que la loi de 1992 avait pour
principal défaut de ne pas donner à ceux qui ont la
responsabilité de cette loi les moyens de l'appliquer, notamment les
moyens financiers pour l'acquisition des oeuvres.
Il a cité, à cet égard, l'exemple anglais de la loterie et
estimé qu'une loterie dont une fraction du produit serait clairement
affectée à la défense du patrimoine pourrait constituer
une solution en France.
Il a en outre indiqué que les musées nationaux ne pouvaient
à eux seuls assurer la défense du patrimoine et que,
malheureusement, le " vice " de la collection était peu
répandu en France.
M. Pierre Rosenberg
a ensuite évoqué les problèmes
posés par des décisions judiciaires qu'il s'agisse de l'affaire
du " Jardin à Auvers " " ou, plus anciennement, de celle
du " Poussin ". A ce titre, il a indiqué que si Le Louvre
achète en vente publique un tableau qu'il a identifié, alors que
ni les experts ni le commissaire-priseur ne l'ont fait, il sera contraint de le
rendre à son propriétaire ; les anglais, de leur
côté, défendent avant tout leur réputation, et si
une erreur est commise, font tout pour que cela ne se sache pas.
Enfin, il a souligné que le dynamisme du marché de l'art en
France tenait pour beaucoup à celui d'une douzaine de jeunes marchands
d'une compétence sans équivalent à Londres et New-York.
Entretien de M. Jean-Marie SCHMITT,
Directeur de l'Institut d'étude supérieur des arts
le mardi 22 décembre 1998
M. Yann Gaillard
a tout d'abord souhaité
savoir s'il
était important, pour le développement d'une culture vivante,
d'avoir un marché de l'art.
M. Jean-Marie Schmitt
a
répondu par l'affirmative en rappelant que la création actuelle
dépendait d'une logique de marché. A cet égard, il a
cité l'exemple américain et rappelé qu'après la
seconde guerre mondiale le poids économique de ce pays, son dynamisme et
le mode de vie américain s'étaient conjugués pour faire
basculer quasiment tout le marché de l'art vers les Etats-Unis.
Il a également indiqué que la France avait perdu pied dans l'art
contemporain parce qu'elle n'avait pas de marché secondaire et donc pas
de recyclage possible pour les acheteurs. Telle est la raison pour laquelle la
création française actuelle n'a plus passé les
frontières depuis les années 60, à quelques exceptions
près.
M. Jean-Marie Schmitt
a ensuite indiqué qu'une bonne approche du
marché de l'art français nécessitait de le fragmenter en
trois parties : le marché de l'art actuel qui ne dispose pas de
deuxième marché, le marché de l'art ancien, lui-même
divisé entre les oeuvres de niveau international et les oeuvres de
niveau national et le marché de l'art moderne.
Il a, enfin, estimé que le problème premier de ce marché
était avant tout symbolique. En effet, l'oeuvre d'art n'a pas simplement
une valeur vénale ou scientifique mais une valeur symbolique qu'il est
très difficile de rattacher à des données
concrètes, précises et quantifiables. A cet égard, il a
estimé que le marché de l'art français se situait dans une
problématique proche de la francophonie, la France se vivant comme une
puissance à vocation culturelle universelle. Il a estimé
nécessaire de maintenir ce passé de la plus grande Nation sur le
plan culturel pour des raisons de rentabilité économique, le
tourisme, les produits dérivés ayant pour socle l'exploitation de
ce patrimoine.
M. Yann Gaillard
a ensuite souhaité connaître l'état
actuel du marché de l'art français.
M. Jean-Marie Schmitt
a indiqué que Paris se situait en
troisième position après New-York et Londres. En terme de ventes
publiques, New-York détient 50 % du marché, Londres
35 % et Paris entre 6 et 7 % alors que 60 % des oeuvres vendues
sont françaises ou ont été créées en France
pour la période située entre 1870 et 1930. Il a estimé que
l'objectif de 10 à 15 % de part de marché pourrait
être atteint par Paris, les ventes publiques se déplaçant
facilement. Il faudrait évidemment que les professionnels se montrent
capables d'inverser la tendance actuelle. Il a ensuite précisé
que, contrairement aux données chiffrées, Londres restait la
capitale où était réellement enraciné le
marché de l'art, les différents acteurs -consommateurs,
marchands, galéristes, experts- étant extrêmement bien
structurés.
Il a estimé que la France disposait également des atouts
nécessaires pour constituer le socle qui permettrait de
développer le marché des ventes publiques pour la partie la plus
volatile et la plus spéculative que représente l'art
impressionniste et l'art moderne.
Il a cependant estimé que trop d'incertitudes pesaient sur le
marché de l'art français, qu'il s'agisse de la position des
professionnels, qui gèrent les stocks, mais ne veulent pas investir, ou
de la création, sans cesse reportée, de l'Institut national
d'Histoire de l'art français qui constitue pourtant un réel enjeu.
M. Yann Gaillard
a souhaité connaître les quelques mesures
à envisager pour faire évoluer la situation du marché de
l'art.
M. Jean-Marie Schmitt
a estimé qu'il fallait lever
l'hypothèque " ventes publiques " en réformant
très rapidement la profession de commissaire-priseur. L'absence de
décision, qui perdure depuis trois ans, neutralise le marché. La
situation s'est figée parce que les commissaires-priseurs ont voulu
traiter de façon monolithique leur sortie de profession alors qu'il
aurait fallu dissocier l'indemnisation de la modernisation de la profession. On
ne peut mesurer les conséquences précises de cette attente, mais
les ventes publiques sont en " stand-by " et les études qui
avaient des velléités d'investir attendent. Cet état de
glaciation a des effets sur le marché lui-même. Après avoir
espéré 3 milliards de francs, puis être passés
à une indemnisation de 850 millions de francs et enfin à
450 millions de francs, les commissaires-priseurs ont désormais un
intérêt à faire traîner la situation.
Concernant l'intégration des objets d'art dans l'impôt sur la
fortune,
M. Jean-Marie Schmitt
a estimé qu'il aurait presque
être préférable de prendre la mesure proposée en la
verrouillant plutôt que de subir cette menace permanente.
S'agissant de la TVA à l'importation, il a estimé que le
problème venait du différentiel avec Londres. Il a rappelé
que le marché de l'art était très défendu au niveau
politique en Grande-Bretagne. Les Anglais, jusqu'à l'intégration
dans la communauté européenne, avaient un système
permettant l'entrée en franchise de TVA de toutes les oeuvres
antérieures à 1973. Ils ont admis, lors de la négociation
sur la 7
ème
directive sur la TVA de payer un taux
réduit dérogatoire de 2,5 %. Cette dérogation vient
à échéance en juin 1999 et il devrait passer à un
taux réduit " normal ", soit 5 %. Cependant il a
indiqué que l'effet de la taxation à l'import était
très faible, en effet, on importe environ 1 milliard de francs
d'oeuvres d'art en France. Dans ce contexte, il a indiqué que les
problèmes fiscaux servaient parfois d'alibi pour justifier l'inaction
des professionnels car pour l'acheteur français, payer 5 % de plus
une oeuvre d'art n'était pas vraiment rédhibitoire. Toutefois, si
un blocage se faisait du côté des anglais, il serait peut
être justifié d'aligner le taux français de TVA à
l'import sur celui de l'Angleterre. Le coût budgétaire serait peu
élevé et permettrait de vérifier si le différentiel
de TVA à l'import pénalise effectivement le marché
français.
Il a ensuite abordé le droit de suite et estimé que même si
les Anglais utilisaient des moyens dilatoires, celui-ci serait étendu
à toute l'Europe puisque 11 Etats de la communauté sur 15
l'appliquent déjà.
Le système mis en place à Bruxelles prévoit un taux
dégressif de 4 % à 1 % pour les tranches
supérieures. Cette taxe pèse sur le vendeur et la durée du
droit de suite a été uniformisé à 70 ans.
Cependant, le droit de suite va poser un problème pour les galeries qui
en sont exonérées au motif qu'elles cotisent déjà
à la caisse de sécurité sociale des artistes, à
raison de 1 % de leur chiffre d'affaires. Pour cette raison, l'Etat ne
leur a pas appliqué la loi de 1957 sur le droit de suite en ne prenant
pas les décrets d'application.
M. Yann Gaillard
a enfin interrogé
M. Jean-Marie Schmitt
sur la loi de 1992 relative à l'interdiction de sortie des oeuvres du
territoire.
Il a indiqué que le système actuel qui semblait
équilibré prévoyait un certificat de libre circulation qui
pourrait être refusé par l'Etat pendant une durée
provisoire. A l'issue de cette période, soit l'Etat achète
l'oeuvre, soit il la classe. Ce système a trouvé récemment
ces limites avec la regrettable affaire du tableau de Van Gogh -le jardin
à Auvers- où l'Etat a été condamné à
payer 145 millions de francs au propriétaire du tableau, notamment
du fait de l'arrogance de certains conservateurs. Un projet de loi est
actuellement à l'étude à la direction des Musées de
France qui vise à modifier la loi de 1992 et qui s'inspirerait du
système anglais. Il a jugé primordial que toutes les mesures
concernant l'interdiction de sortie ne soient pas applicables aux oeuvres
rentrées en France depuis moins de 50 ans. Cela créerait une
sécurité patrimoniale pour les collectionneurs qui viennent
s'installer en France. En tout état de cause, il a estimé qu'il
fallait sortir du système français actuel qui est enfermé
dans l'antagonisme collectionneur public-collectionneur privé et
examiner toutes les mesures fiscales ou de protection du patrimoine en ayant
pour objectif principal de faire émerger la notion de collection et
d'encourager les collectionneurs.
Entretien de Maître Jacques TAJAN,
Commissaire-priseur
le mardi 5 janvier 1999
Maître Jacques Tajan
a tout d'abord rappelé
que
jusqu'en 1952 le marché de l'art français était le premier
au monde. Désormais, les Anglais avaient conquis ce marché
grâce à leurs atouts : statut libéral des
commissaires-priseurs, moyens financiers importants, liberté d'action
totale.
Les commissaires-priseurs français, étroitement conservateurs
dans leur ensemble, prisonniers d'un carcan de réglementation qui
remonte jusqu'à Henri II, ont été dans l'incapacité
de réagir à cette concurrence.
L'État français a laissé les Anglais se rendre
acquéreurs du patrimoine français tout en leur interdisant la
revente en France.
Maître Jacques Tajan
estime qu'au total ce
préjudice représente aujourd'hui 50 % du patrimoine privé,
ce qui est considérable.
Il a déclaré que le statut d'officier ministériel
était inadapté aujourd'hui à une profession qui devait
évoluer dans un marché international et qu'une réforme
était nécessaire.
Maître Jacques Tajan
a rappelé l'importance de la
profession de commissaire-priseur. D'une part, ceux-ci jouent un rôle sur
le plan culturel car ils consolident le patrimoine en le maintenant en France.
D'autre part, ils représentent un poids économique
considérable. Les 450 commissaires-priseurs existant en France
emploient entre 30 000 et 40 000 personnes dans leurs études,
et, si l'on prend en compte les activités périphériques
induites, ce sont au total 70.000 personnes qui dépendent d'eux. De
plus, les commissaires priseurs sont aussi des auxiliaires de justice et des
collecteurs d'impôt.
Maître Jacques Tajan
a indiqué qu'il était favorable
à un renforcement de la législation en ce qui concerne les ventes
judiciaires et, à l'inverse, partisan d'une totale libéralisation
pour les ventes volontaires.
Evoquant ensuite le projet de loi portant réglementation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques,
Maître Jacques
Tajan
l'a accusé d'être une réforme en "trompe-l'oeil".
En effet, ce texte, selon lui, feint de libéraliser et de moderniser
alors qu'en fait il impose une réglementation excessive et
inadaptée qui montre une totale méconnaissance de la profession.
A titre d'exemple,
Maître Jacques Tajan
a cité : la
garantie de prix minimum qu'on restreint à la fourchette basse de
l'estimation, l'obligation de passer par un organisme d'assurance ou un
établissement de crédit pour la garantie des prix au vendeur, la
fixation du prix de réserve inutilement contraignante, la
possibilité de revente de gré à gré dans un
délai de 8 jours mais à des conditions absurdes, puisque le
prix ne doit pas être inférieur à l'enchère atteinte
lors du retrait de l'objet.
Selon lui, notamment en matière d'avances aux vendeurs des
sociétés de ventes volontaires devraient ne relever que du droit
commercial commun. Par contre, dans le domaine des ventes judiciaires,
Maître Jacques Tajan
a souligné la nécessité
de protéger le citoyen et de renforcer la législation.
Le marché de l'art français est pénalisé par une
fiscalité à l'importation des objets d'art de 5,5 % et par
le droit de suite de 3 %. Les Etats-Unis, la Suisse et le Japon, qui
représentent les plus grandes réserves d'objets d'art que du
monde, sont ainsi empêchés de vendre ceux-ci dans le pays dont ils
sont issus.
Pour conclure,
Maître Jacques Tajan
a évoqué
l'indemnisation prévue par le projet de loi qu'il a
préféré appeler "avance de trésorerie". Le
système envisagé est, selon lui, usuraire car il revient
finalement à rembourser deux fois ce qui a été
avancé.
Maître Jacques Tajan
a évoqué les
effets pervers de cet esprit "bourse commune" qui pénalise les plus
entreprenants et que l'on retrouve également aussi bien dans la
règlement de l'affaire Loudmer que dans le financement de l'hôtel
Drouot.
De façon générale,
Maître Jacques Tajan
a
dénoncé le " trompe l'oeil " et l'hypocrisie de cette
réforme qui consiste à affirmer haut et fort que l'on va donner
les moyens de la concurrence aux Commissaires-priseurs français
notamment, en rapprochant notre système de celui des autres pays de la
communauté.
On affirme ensuite sur divers points : garantie de prix, avance de fonds,
vente de gré à gré, que cela va être possible comme
dans les autres pays, mais aussitôt on s'empresse d'assortir ces
soi-disant possibilités de telles conditions irréalistes qu'en
fait, rien ne sera possible à mettre en pratique.
Maître Jacques Tajan
a rappelé qu'on assistait par ailleurs
à une main mise de l'Etat sur la profession à travers la
création d'un conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, constitué majoritairement par des
personnalités désignées par les pouvoirs publics.
On est loin du système anglais qui s'inscrit purement et simplement dans
le droit des entreprises de service et de commerce quelles qu'elles soient.
Le comble qui résume l'état d'esprit du pouvoir qui veut tout
régenter dans cette affaire est atteint notamment, à l'article 10
où on peut lire :
-1
er
paragraphe : " Chaque vente volontaire de meuble aux
enchères publiques donne lieu à une publicité
sous
toute forme appropriée
".
Cela ressemble un peu à Monsieur de LAPALISSE, mais enfin...
Hélas, aussitôt après :
-2
ème
paragraphe : " Les mentions devant figurer
sur la publicité seront fixées par décret ".
Comment et qui, dans un monde qui évolue chaque jour, peut figer
définitivement ce qu'il est opportun de faire figurer dans des
publicités destinées à tous les pays du monde, avec leur
sensibilité et leurs usages, en compétition avec tous les pays
où les règles générales qui régissent la
publicité sont appliquées un point c'est tout.
Entretien de M. Eric TURQUIN, Expert en tableaux anciens
et de M. Bruno de BAYSER, Expert en dessins anciens
le jeudi 7 janvier 1999
M. Bruno de Bayser
a débuté son
exposé
en attirant l'attention sur le problème majeur de la
responsabilité trentenaire dans l'exercice de la profession d'expert en
France. Les experts anglais, qui n'ont pas à subir cette contrainte,
sont plus brillants que leurs homologues français, condamnés
à une vision craintive et timorée dans leurs expertises sous
peine de se voir infliger des procès.
Puis
M. Eric Turquin
a dressé un bref historique du
marché de l'art en soulignant que les objets d'art étaient pour
un très grand nombre d'origine française ou étaient
passés par la France plus tard. Jusque dans les années 60, les
Français ont dominé le marché. Ensuite, les Anglais,
grâce à une fiscalité plus favorable notamment au niveau
des importations, les ont supplantés. C'est désormais vers New
York que se déplace le marché, toujours pour des raisons d'ordre
fiscal.
Réagissant aux réactions de scepticisme de
M. Yann
Gaillard
,
M. Eric Turquin
a souligné l'importance du
préjudice que la taxe à l'importation faisait subir au vendeur et
l'impact direct que celle-ci avait sur le choix du lieu de vente. Les
procédures compliquées et les tracasseries administratives que
doivent subir à la douane les personnes qui veulent faire expertiser un
objet en France constituent un obstacle supplémentaire à la
vitalité et au dynamisme de la profession.
M. Eric Turquin
a ensuite déploré l'existence du
droit de préemption, spécificité française, qui
décourage les acheteurs potentiels. Il a souhaité que l'Etat se
comporte comme un acquéreur normal et fasse des enchères lors des
ventes publiques.
M. Eric Turquin
s'est également
prononcé contre le droit de suite qui ne favorise que quelques grandes
familles et ne trouve sa justification qu'aux yeux des sociétés
chargés de le percevoir.
M. Bruno de Bayser
ayant souligné qu'en France les
transactions étaient pénalisées par une fiscalité
défavorable et une bureaucratie trop lourde,
M. Yann
Gaillard
a souhaité pouvoir disposer d'un tableau comparatif prenant
en compte les différents cas de figure suivant la nature de l'objet, le
lieu de vente et la nationalité du vendeur et de l'acheteur.
M. Eric Turquin
a fait valoir qu'il était aussi essentiel de
favoriser la création artistique que les transactions. Le marché
des objets d'art constitue, en effet, une vitrine prestigieuse pour le pays et
induit des effets économiques non négligeables. En réponse
à
M. Yann Gaillard
, il a précisé que le
Syndicat national des antiquaires allait sous peu publier une étude sur
la réalité de ce marché en France. L'exemple du
marché du dessin, entièrement recentré sur Paris, prouve
qu'il est possible que la France retrouve sa place prépondérante.
Revenant sur le problème de la responsabilité des experts,
M. Eric Turquin
a déploré qu'en France on ait
l'habitude de considérer qu'une vente pouvait être cassée.
Il a regretté que le principe relevant du droit commercial commun de
sécurité des transactions soit ainsi bafoué.
M. Bruno de Bayser
a fait valoir que les experts devaient
statuer sur 15.000 artistes répartis sur trois siècles. Il
était absolument évident que dans ces conditions, les avis ne
pouvaient pas être toujours d'une totale certitude.
M. EricTurquin
a ajouté que l'histoire de l'art était
une science humaine et comportait en tant que telle une marge d'erreur et que
l'aspect subjectif était essentiel dans l'appréciation d'un objet
d'art. Tous deux ont plaidé pour une limitation de la
responsabilité des experts.
En réponse à
M. Yann Gaillard
,
M. Eric
Turquin
et
M. Bruno de Bayser
se sont
déclarés favorables aux propositions de l'Observatoire concernant
les listes d'experts agréés et le code de déontologie,
mais réservés sur la composition du Conseil des ventes
volontaires qui ne devait pas, selon eux, être une émanation de la
puissance publique.
M. Yann Gaillard
s'interrogeant sur la nécessité de
la protection du patrimoine,
M. Eric Turquin
et
M. Bruno de
Bayser
ont répondu que l'Etat était le plus actif des
collectionneurs et que les conservateurs étaient tentés
d'utiliser les procédures de protection du patrimoine pour
" enrichir " les collections publiques à meilleur compte, ce
qui en effrayant les détenteurs d'oeuvres d'art, contribue, en fait,
à favoriser les exportations "invisibles". Ils ont conclu que la
meilleure façon de protéger le patrimoine était de
faciliter sa circulation.
Entretien de M. Bertrand du VIGNAUD, Président de
Christie's Monaco et Vice-Président de Christie's France
et de M. Anthony BROWNE, Président de la Fédération
Britannique
du marché de l'art
le jeudi 14 janvier 1999
M. Yann
Gaillard
a tout d'abord rappelé que l'intérêt de la
commission des finances pour la situation du marché de l'art
français était justifiée par la volonté de
comprendre le déclin de la France sur le marché mondial depuis le
début des années 1950.
M. Anthony Browne
est intervenu en premier pour exposer quelles
étaient les raisons pour lesquelles Paris a décliné par
rapport à Londres.
Il a souligné que ces deux villes étaient désormais
menacées par la montée en puissance de New-York et
considéré que la France et l'Angleterre devaient avoir une
position commune vis à vis de la Commission de Bruxelles, qui ne voyait
pas que l'Europe était désavantagée par des charges
élevées dans sa compétition avec les Etats-Unis.
Revenant sur les raisons pour lesquelles Londres a considérablement
développé ses affaires dans les années 70 et 80,
M.
Anthony Browne
a rappelé que ce succès était dû
à la capacité de Londres à attirer, du fait de la
faiblesse de ses coûts, de la marchandise en provenance du monde entier.
Il a indiqué que la Fédération britannique du
marché de l'art avait commandé une étude démontrant
l'importance du marché de l'art pour l'économie britannique dans
des domaines aussi divers que le tourisme, le fret ou l'artisanat, tout en
précisant que 40.000 emplois étaient concernés.
En dernier lieu, il a déclaré qu'il est essentiel de comprendre
que le marché de l'art à une dimension essentiellement
internationale et qu'il était important qu'il puisse se
développer dans un environnement fiscal favorable.
Puis
M. Bertrand du Vignaud
a indiqué les raisons pour lesquelles
la société Christie's entendait organiser des ventes à
Paris et précisé les raisons pour lesquelles la France avait
perdu du terrain par rapport à l'Angleterre.
Tandis que la France a eu tendance à rester dans le cadre d'un
système très réglementé, l'Angleterre et le monde
anglo-saxon en général s'adaptaient de façon pragmatique
et avaient mis en place un mode de fonctionnement faisant une large place
à l'autorégulation.
A cet égard, il s'est déclaré satisfait de ce projet de
loi portant réforme des ventes volontaires à quelques
détails techniques prêts sur lequel il a transmis une note
écrite au rapporteur.
Il a néanmoins évoqué un point particulier, celui des
ventes après la vente, en soulignant qu'il s'agissait d'une pratique de
dernier recours et qu'il préférait, bien entendu, que les lots
soient adjugés au cours de la vente.
Répondant à une question du rapporteur sur les garanties
apportées par Christie's en matière d'authenticité,
M.
Bertrand du Vignaud
a insisté sur le fait que, par-delà les
termes mêmes de leurs conditions contractuelles, les maisons anglaises
étaient très attentives à la satisfaction de leurs clients
et à leur bonne réputation.
Puis, après que M. Yann Gaillard ait évoqué les obstacles
techniques et politiques qui pouvaient s'opposer à l'aménagement
du régime des charges et notamment de la TVA,
M. Bertrand du
Vignaud
a abordé les questions fiscales.
Il a attiré notamment l'attention sur le différentiel de taxe
entre l'Europe et les Etats-Unis et insisté sur les conséquences
néfastes sur le commerce de la " paperasserie " qui
résultait de l'introduction de la TVA à l'importation,
indépendamment même de la charge supplémentaire qu'elle
pouvait constituer.
1
Raymonde Moulin L'artiste,
l'institution et
le marché.
2
Les intéressés sont obligés de se faire
inscrire soit à la préfecture du département où ils
exercent leur activité soit à la préfecture de police s'il
sont établis dans le ressort de celle-ci.
3 A Paris, le produit " art " a évolué de la
façon suivante depuis 1995 : 2,344 milliards de francs en 1995,
2,421 milliards de francs en 1996, 2,475 milliards de francs en 1997 et 2,720
milliards de francs en 1998.
4
Il faudrait tenir compte aussi de l'existence en Grande-Bretagne
de maisons de vente telles Phillips ou Bonham, qui si elles sont petites
comparées aux deux majors n'en sont pas moins au niveau des plus grandes
études parisiennes. Ainsi la maison Phillips peut-elle faire état
d'un chiffre d'affaire de l'ordre de 1 200 millions de francs en 1998, dont 180
millions aux États-Unis.
5
Quel avenir pour le marché de l'art. F. Duret-Robert. H
Léna 1996.
6
Le Commerce de l'art de la Renaissance à nos jours
Éditions de la Manufacture 1992
7
Les caractères gras ne sont pas dans le texte original.
8
Les caractères gras ne sont pas dans le texte original.
9
Antoine Schnapper : Le géant la licorne la tulipe
Flammarion 1988.
10
1767 : Julienne ; 1764 : Lalive de Jully ;
1772 : duc de Choiseul ; 1775/76 : Mariette ; 1777 Randon
de Boisset, Prince de Conti etc....
11
Le Commerce de l'art de la Renaissance à nos jours
Éditions de la Manufacture
12
Ainsi en 1770, la vente du duc de Guiche, qui comportait
seulement quarante numéros dura trois jours ; celle du prince de
Conti en nécessita quarante cinq !
13
La norme et le caprice Flammarion 1986
14
De 1789 à 1820, le marché anglais fut
alimenté par les ventes des émigrés, puis en 1830 par les
contrecoup de la révolution de juillet: le nombre de ventes passe
brutalement du niveau de 2000 avant 1829 à près de 4000 en 1830.
C'est ainsi qu'ont été vendues à Londres, chez Christie's,
les collections du Chevalier d'Éon, de Mme du Barry, puis après
1830, celles de Casimir Perier, de Louis-Philippe et du prince
Jérôme Napoléon.
15
Il fonda en 1869 la revue
internationale
de l'art et de la
curiosité et fait paraître entre 1890 et 1891 un journal
hebdomadaire au nom lui aussi significatif : l'Art dans les
deux mondes
16
En 1972, le sociologue Jean Baudrillard avance une analyse
analogue dans son ouvrage " Pour une critique de l'économie
politique du signe " paru chez Gallimard : " il est
intéressant de confronter, toujours dans le domaine de la peinture, la
fonction réciproque de l'institution du marché et de
l'enchère, et de l'institution du musée. On pourrait croire que
les musées, ôtant les oeuvres à ce marché
privé parallèle pour les " nationaliser ", les
restituent à une sorte de propriété collective et par
là à leur fonction esthétique " authentique ".
En fait, le musée joue comme caution de l'échange
aristocratique.....de même qu'il faut un fonds-or, la couverture publique
de la Banque de France pour que s'organise la circulation du capital et la
spéculation privée, il faut la réserve fixe du
musée pour que puisse fonctionner l'échange signe des tableaux.
Les musées jouent le rôle des banques dans l'économie
politique de la peinture. "
17
Pour la petite histoire, on note que son matricule était
007 et qu'il y avait parmi ses collaborateurs un certain Ian Fleming.
18
Robert Lacey Sotheby's Éditions JC Lattès 1998.
19
Martin Feldstein The Economics of Art Museums The University of
Chicago Press 1991 NBER
20
Sotheby's est installé depuis 1998 dans les locaux de
l'ancienne galerie Charpentier en face de l'Elysée ; Christie's
aménage les anciens locaux d'Artcurial avenue Matignon qui devraient
être achevés pour l'an 2000.
21
Les 400 coups du marteau d'ivoire Robert Laffont 1964.
22
" Unique, insubstituable, et néanmoins
aliénable, bien de jouissance quasi indestructible car le regard qui le
contemple ne l'altère pas, stérile comme l'or et se situant comme
lui dans la catégorie des placements de refuge et de spéculation,
l'oeuvre d'art est le type idéal de bien rare à offre rigide dont
la valeur est déterminée par la demande " Raymonde Moulin,
La genèse de la rareté artistique.
23
Raymonde Moulin ibidem
24
Il est important de noter que l'échantillon de transaction
constitué par W.J. Baumol à partir des relevés de
Reitlinger (presqu'uniquement chez Christie's) ne retient que les remises en
vente couvrant un intervalle supérieur à cinquante ans. Or on
pourrait considérer au contraire que, si tant est que l'achat d'une
oeuvre d'art soit un investissement, la décision et donc l'arbitrage
entre le placement en oeuvre d `art et le placement en titre n'a pas de sens au
delà de l'horizon du siècle voire d'une
génération : peut-on vraiment considérer que
même inconsciemment l'acheteur d'une oeuvre d'art investit à un
horizon supérieur au siècle ?
25
La valeur antinaturelle ou l'art considéré comme un
coup de poker in Économie et culture- Tome I La documentation
française 1987
26
Gerald Reitlinger The Economics of Taste Hacker art Book
New-York 1982.
27
Phiippe Simonnot Doll'Art Gallimard 1990
28
Risques n°13 janvier-mars 1993
29
IS art such a bad investment Document de travail GREQE n°
90B03 juin 1990 : le taux - réel - avancé dans ce papier
préparatoire était sensiblement plus important, 12%, sans que
cette diminution par deux du rendement calculé soit expliquée.
Mais, entre temps, le marché s'était effondré et les
calculs se sont adaptés aux faits.
30
De 1968 à 1969, fut publié un Times Sotheby's index
fondé sur l'évolution d'oeuvres types à partir des dires
des experts sur une base 100 en 1951,année qui avait été
délibérément choisie parce qu'elle constituait un point
historiquement bas des prix du marché. L'expérience fut
arrêtée compte tenu des critiques des marchands et du fait que
l'administration anglaise des impôts commençait à l'opposer
aux propriétaires.
31
Journal des arts ? ? ?
32
Ainsi, sur les 18 oeuvres acquises en 1998 par le Musée
d'Orsay, 10 l'ont été pour moins de 50 000 francs, étant
entendu que ces bas prix s'expliquent parce qu'il s'agit de dessins ou d'objets
beaucoup moins chers que les peintures... Au département des peintures
du Musée du Louvre, le niveau de prix est sensiblement plus
élevé, puisqu'aucune peinture n'était d'une valeur
inférieure à 100 000 francs et seulement 4 sur un total de 7
acquisitions étaient inférieures à 250 000 francs. Pour
les musées de province le nombre d'acquisitions d'un prix relativement
bas sont beaucoup plus nombreuses.
33
Raymonde Moulin opus cité
34
On note que, si l'on ajoute aux Iris, le portrait du docteur
Gachet adjugé par Christie's pour 82,5 millions de dollars et le
Moulin de la galette
adjugé chez Sotheby's pour 78,1 millions de
dollars, tous deux acheté par Saito Ryoei, un magnat de la presse
japonais qui fit banqueroute, les trois peintures les plus chères du
monde firent l'objet de saisies.
35
En 1989, la BNP a fait appel à la société
Finacor pour constituer une collection de tableaux et de dessins. Il s'agissait
de réunir deux fonds communs d'investissement d'une valeur de
75 millions de francs et de 50 millions de francs en dix-huit mois. Cette
offre avait notamment comme avantage, pour les investisseurs, d'éviter
le paiement de l'impôt sur la fortune. Dans le climat spéculatif
de l'époque, cette opération remporta donc un franc succès
et 400 personnes environ participèrent à ce fonds d'un genre
nouveau. Il était prévu que les oeuvres mises en portefeuille
seraient conservées pendant une durée maximale de 10 ans.
En novembre 1998, Christie's a mis en vente les tableaux et dessins du XIXe et
du début du XXe siècle. Le résultat a été
plus que mitigé : une des toiles les plus importantes de
l'ensemble, un Courbet " Vue d'Ornans et son clocher ", estimé 800.000
dollars, a été adjugée pour seulement 607.500 dollars.
L'oeuvre avait été acquise en juin 1990 pour 1,3 million de
dollars.
Fin janvier 1999, c'était au tour des oeuvres anciennes de la
collection BNP d'être mise aux enchères. L'ensemble comportait
notamment une série de 20 dessins du XVIe siècle de l'Italien
Federico Zuccaro. Achetée en 1990 chez Sotheby's pour 2,3 millions de
dollars, elle a étté acquise par le Getty Museum pour seulement
1,7 million de dollars. On note aussi que le " Portrait de jeune
garçon en costume hongrois ", par Pierre Subleyras a atteint 700.000
dollars, alors que la toile avait été cédée
à Londres pour 580.000 dollars à un marchand anglais, Colnaghi,
qui l'avait sans doute revendue sensiblement plus cher au fonds de la BNP.
36
Depuis 1975, Paribas a créé dans le cadre de son
département gestion privée, un service chargé de
conseiller et de guider les clients de la banque désireux de diversifier
leurs placements.
37
37 % des actions d'une valeur nominale de 10 pence avait
été proposées à 70 pence, le reste étant
conservé par les directeurs pour permettre de faire face à des
raids hostiles.
38
A l'été 1977, la maison de vente mis sur le
marché 12 millions d'actions à 25 pence. La souscription fut
couverte 28 fois
39
M. François Pinault reprend, par l'intermédiaire de
sa holding personnelle Artemis, les parts du milliardaire britannique Joe Lewis
pour devenir le premier actionnaire de Christie's'. Le reste du capital est
détenu par de grands fonds d'investissement anglo-saxons : So
Partners (9%), Mercury Assets, Management et Shroeder (environ 6 % chacun) le
reste par les anciens propriétaires la famille Floyd.
40
, avec le risque de dérapage comme c'était apparu
clairement avec l'affaire Higgons, qui avait causé quelques soucis
à Peter Wilson en 1970, en mettant à jour un système
d'avance.
41
Les marchands auxquels Sotheby's propose de consacrer
gratuitement une page de présentation sur le Web, reçoivent le
droit de proposer des oeuvres ou des objets en dépôt et se
voient offrir diverses facilités pour compléter la liste de leurs
clients : communication du nom de l'acheteur - et éventuellement du
sous - enchérisseur -
42
Il y a bien sûr encore des progrès à faire,
notamment, dans la sincérité des indications d'origine, dont on
peut se demander si elle ne cherchent pas quelquefois à masquer de la
marchandise en provenance du négoce.
43
En outre, la mention du marchand chez qui l'oeuvre a
été achetée, dans la description du lot mise en vente est
ambivalente : elle est une garantie de qualité de l'oeuvre ;
mais elle peut porter atteinte à la réputation du marchand si le
lot reste invendu ou si le prix obtenu est faible...
44
Les conditions dans lesquelles il sera possible de se
prévaloir de la qualité d'artisan d'art ont été
fixées par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif
à la qualification artisanale et au répertoire des
métiers. Son article 2 dispose que : " la qualité
d'artisan d'art est reconnue de droit par le Président de la chambre de
métiers compétente du département, aux personnes physiques
y compris les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent les
métiers de l'artisanat d'art dont la liste est fixée par
arrêté du Ministre chargé de l'Artisanat, et sont
titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou
d'un titre du niveau équivalent ou supérieur
délivré pour le métier considéré. La
qualité d'artisan d'art peut également être reconnue dans
les mêmes conditions, aux personnes physiques y compris les dirigeants
sociaux de personnes morales qui justifient d'une durée
d'immatriculation au répertoire des métiers de six ans dans le
métier d'artisanat d'art considéré ".
45
Avis n° 324 (1998-1999)
46
C'est aussi aux États-Unis que se trouve la plus grande
puissance financière culturelle du monde, la Fondation Getty. Beaucoup
de choses ont été dites sur ce " grand
prédateur " dont le tableau de chasse comporte notamment les Iris
de Van Gogh, le portait de Hallebardier par Pontormo, le tableau ancien le plus
cher du monde, une adoration des mages de Mantegna ; Il faut
préciser que son budget, qui dépasse un milliard de francs par an
n'est que pour une relativement faible partie consacré à des
achats d'oeuvres d'art - le montant de ses achats est tenu secret - c'est parce
que la fondation met désormais plus l'accent sur les activités en
profondeur de son institut de recherche que sur le musée lui-même
en dépit de la construction de son nouveau centre de Brentwood.
47
Quel avenir pour le marché de l'art. F. Duret-Robert. H
Léna. Éditions l'Harmattan 1996.
48
La Gazette de l`Hôtel Drouot serait en dépit de sa
présentation il est vrai confuse, évaluée à
près de 200 millions de francs ( cf. l'avis n° 324 de la commission
des finances sur le projet de loi portant réglementation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques). Il y aurait beaucoup de
progrès à faire pour mettre sur Internet, si ce n'est les
catalogues - mais on y viendra - du moins les résultats.
49
Avis N°324 1998-1999
50
Christie's vient de quitter ses locaux de Park avenue pour
s'installer au Rockefeller Center en plein coeur de New-York ; Sotheby's,
de son côté, prévoit de développer son emplacement
actuel, ce qui ferait passer son espace de bureau, stockage et vente de 16.000
à 40.000 mètres carrés.
51
En 1997, la rentabilité de Sotheby's et Christie's sur
fonds propres aurait atteint respectivement 18 % et 16 %.
52
Il est d'ailleurs tout à fait remarquable que cette
catégorie d'hôtellerie attire, pour plus du tiers, les visiteurs
en provenance du Japon (34 %), du Proche et Moyen Orient (41 %), de
l'Amérique du Nord (34 %) ; l'Europe de l'Est et la région
Asie-Pacifique apportent leur clientèle, pour 25 %, à cette
même catégorie.
53
D'une manière générale, le point de savoir
si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui est
appréciée par l'administration au cas par cas, sous le
contrôle du juge de l'impôt.
A cet égard, divers éléments peuvent être pris en
considération, à savoir
- l'ancienneté,
- la rareté,
- l'importance de son prix qui doit excéder sensiblement la valeur du
même bien destiné à un usage courant,
- l'arrêt de la fabrication du bien,
- la provenance ou la destination,
- l'intérêt historique qu'il présente,
- le fait qu'il ait appartenu à un personnage célèbre.
La qualification d'objet de collection découle de l'application d'un ou
plusieurs des critères ainsi définis.
54
En revanche, en cas de vente ou d'exportation par l'artiste d'une
oeuvre qu'il avait au préalable cédée puis
rachetée, la vente ou l'exportation entre dans le champ d'application de
la taxe et éventuellement des exonérations (exportations
temporaires, artiste n'ayant pas en France son domicile fiscal, entreprises
industrielles et commerciales ... ).
55
En quoi se distinguent les oeuvres d'art des objets de collection
ou d'antiquité ? En fait, la directive - et la loi - désignent
par le terme d'oeuvres d'art les biens que l'on qualifiait auparavant d'oeuvres
originales : tableaux, peintures, et des dessins "entièrement
exécutés à la main par l'artiste", des sculptures (tirages
limités à huit exemplaires), des estampes à tirage
limité, des tapisseries qui n'ont pas été tissées
à plus de huit exemplaires, etc.
Par objets de collection, il faut entendre les timbres, les monnaies
recherchées par les numismates, les pièces "présentant un
intérêt historique, archéologique, paléontologique
ou ethnographique", etc.
Et par objets d'antiquité, "les biens meubles autres que les oeuvres
d'art et les objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge"
En fait, cette distinction ne présente de réel
intérêt que pour l'application de la marge forfaitaire de 30% qui
ne s'applique que lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des oeuvres
d'art.
.
56
Cette franchise est égale à 245 000 F.
Les artistes ayant réalisé, l'année
précédente, un chiffre d'affaires inférieur à ce
montant sont exonérés de TVA. Européenne ou lorsqu'ils ont
été acquis auprès d'artistes assujettis que ceux-ci soient
établis en France ou dans un autre pays de la Communauté
Européenne
57
Les ventes d'objets de collection ou d'antiquité ne
peuvent bénéficier de ce régime favorable: aussi bien dans
l'hypothèse où le prix n'est pas significatif que dans celle
où la galerie effectue des actions de promotion. Sont toutefois
assimilées aux oeuvres d'art "les pièces
d'ébénisterie de plus de cent ans d'âge dont la
rareté et l'estampille ou l'attribution attestent de
l'originalité du travail de l'artiste ......
58
le rapporteur de la loi, Abel FERRY, avait pour souligner ce
dernier point, pris l'exemple des verres de Gallé : ceux qui
étaient des oeuvres personnelles du maître seraient soumis au
droit de suite, ceux qui avaient été exécutés en
série, notamment après la mort de l'artiste, ne devaient pas
donner lieu au versement.
59
En mai 1996, le tribunal de grande instance de Paris a
prononcé, la liquidation judiciaire de la Spadem (société
de la propriété artistique des dessins et modèles),
gérante des droits de quelque 3.500 auteurs d'arts visuels. Le bilan de
la spadem faisait apparaître un déficit de 4,4 millions de
francs pour l'exercice 1994 et des pertes cumulées d'un montant de 15,4
millions de francs depuis 1991.
60
Afin de concilier les principes posés par le traité
de Rome, en matière de libre circulation avec la protection des droits
d'auteurs, la Cour de Justice des Communautés Européennes a
notamment élaboré la notion d'objet spécifique du droit,
qui constitue le noyau dur de ce droit, c'est-à-dire ce minimum auquel,
en aucun cas, on ne saurait toucher sauf à léser l'auteur dans
l'exploitation légitime de son monopole".
Or pour Christie's, tel est le cas d'espèce car la raison d'être
de ces illustrations consiste essentiellement à renseigner les acheteurs
potentiels sur les oeuvres qui doivent être vendues. Elles constituent un
élément d'appréciation au même titre que
l'indication du format ou celle du prix d'estimation. A l'inverse,
l'application de la loi française serait susceptible d'entraver la
circulation des catalogues entre la Grande-Bretagne et la France.
En effet, si certains artistes ne donnaient pas leur accord pour la
reproduction de leurs oeuvres, ou réclamaient des redevances
prohibitives, les auctioneers anglo-saxons se verraient dans l'obligation de ne
plus expédier leurs catalogues dans notre pays.".
61 Après consultation de ses mandants, l'ADAGP, en est arrivée
à la conclusion que l'exercice d'un tel droit, en France, serait
nuisible à tous : dès lors que le droit de suite est
payé sur les ventes, on n'avait pas à faire valoir, à un
double niveau, le droit d'auteur : droit de reproduction pour les oeuvres dans
les catalogues assurant l'information de la vente, et droit de suite, lequel
constitue le droit d'auteur par excellence. Par contre, la plupart de nos
membres se sont prononcés en faveur du droit de reproduction sur les
catalogues de ventes anglo-saxons car Sotheby's et Christie's n'appliquent pas
le droit de suite.
62
L'ISF, l'art et l'impôt. Le Monde du 20 octobre 1998.
64"
C'est un combat politique contre une mesure cosmétique qui fragilisera
le marché de l'art. Et pour rapporter quoi ? Des roupies de sansonnet
! " aurait dit l'ancien ministre de la culture. Le Monde 16 octobre 1998.
65
En quelques années, Les britanniques se sont
opposés à une série d'achats du Getty : Temps calme,
un tableau de Poussin, que les Anglais auraient en vain essayé de
retenir. Mais a fait remarqué la presse la National gallery expose
déjà 13 tableaux de ce maître, un tableau du peintre
florentin Fra Bartolomeo, "la Sainte Famille daté de 1508 ; les
"Trois Grâces" du scupteur italien Canova qu'ils ont réussi
à retenir par une association entre la National gallery de Londres et
celle d'Edimbourg
66
En principe, chaque oeuvre d'art doit faire l'objet d'une demande
de licence individuelle. Cependant, certaines catégories de personnes se
sont vues attribuer un permis global d'exportation individuel qui leur permet
d'émettre des licences d'exportation britanniques pour certains types
d'oeuvres sans devoir passer par le Ministère de la Culture. Ce permis
global est particulièrement utile en ce qui concerne les oeuvres qui
sont demeurées en GrandeBretagne pendant moins de 50 ans.
67
l'article 24 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 relative au
mécénat, prévoyant que les collectivités locales
peuvent demander à l'État de préempter pour leur compte
68
En janvier 1995, la Haute Cour de Londres a accordé
100.000 livres de dédommagement en sus du remboursement des 500 000
livres (plus 57.500 livres de commission, lors d'une vente aux enchères
en 1987) payées pour un tableau du peintre autrichien Egon Schiele
(1890-1918)
Le tableau "Jeune agenouillé devant Dieu le Père", signé,
était bien d'Egon Schiele mais avait été en grande partie
retouché après le décés du peintre, à tel
point que 6% seulement de la peinture originale était visible. Le juge,
pour lequel cela constitue une "contrefaçon" aux sens des
critères généralement appliqués par Christie's. Le
juge n'a pas eu à se prononcer juridiquement sur une éventuelle
"négligence" de Christie's. Mais il a débouté la maison de
vente, qui se défendait en avançant que le tableau est bel et
bien de Schiele, et que les retouches ultérieures ne sont liées
qu'à l'état du tableau. Christie's rappelait en outre que les
tableaux sont vendus "en l'état" et "au risque de l'acheteur" lors de
ses enchères. Mais le juge a estimé qu'"étant parti du
principe que le tableau était de Schiele", la maison de vente n'a "pas
accordé la moindre attention à la question des retouches".
69
Les frais de procédure engagés par l'Etat
s'élèvent à la somme de 165 067,50 F.
70
Selon les renseignements fournis par la Chambre nationale des
commissaires-priseurs, parmi les 280 experts auxquels les commissaires-priseurs
ont le plus souvent recours, une quarantaine d'entre eux exerce
parallèlement la profession de marchand.
71
La commission a engagé une
procédure
d'infraction contre la Grande-Bretagne
en contestant la façon dont
les maisons de vente appliquent la TVA aux biens vendus sous le régime
de l'importation temporaire. Ces dernières appliquent à ces biens
la TVA au taux de 2,5 % sur l'ensemble du prix de vente - prix d'adjudication
et prime de l'acheteur - alors que pour la commission la commission doit
être taxée au taux normal.
72
On note que les nouvelles sociétés commerciales
continueront de devoir désigner " les locaux où auront
lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à
la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères
publiques " et de devoir informer l'instance de surveillance,
désormais le Conseil des ventes aux enchères, lorsque
l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local.
73
S'y ajoute, Drouot - Mécénat qui organise des
colloques, des expositions, Drouot - Formation et les Jeudis de Drouot, deux
organismes qui dispensent des cours et des conférences
74
: Il devrait en résulter une hausse de la TVA - 6 points
de plus de marge s'analysant en 5 % de marge en plus hors taxes et 1 % du
chiffre d'affaires en recettes supplémentaires pour l'État. A
raison d'une hypothèse de 8 milliards de chiffre d'affaires à 15
% de frais "acheteur" et de deux milliards à 10 %, mécaniquement
les recettes supplémentaires de TVA seraient de l'ordre de 85 millions
de francs par an. On est donc très exactement dans l'hypothèse de
rendement de la taxe de 1 % .
75 La loi de finances pour 1999 comportait effectivement un article conduisant,
dans certains cas, à soumettre à l'ISF pour lutter contre une
forme d'évasion fiscale consistant pour le propriétaire d'un bien
à en donner l'usufruit, Le Conseil constitutionnel a censuré
cette mesure pour la raison qu'elle revenait à taxer le seul possesseur
de nue-propriété sur la valeur en pleine propriété
alors que le bien ne permet pas de dégager des revenus
nécessaires au paiement de l'impôt. donner l'usufruit revient
à donner des revenus.
76 ( le Figaro du 21 octobre 1998 " ISF : veut-on tuer le marché de
l'art ? ".):
77
En principe, la formule " adjugé " suit le bruit
du marteau, quand le lot est vendu.
78
La révision est une pratique consistant pour un groupe de
marchands intéressés par un objet à ne pas se faire
concurrence pendant la vente pour laisse l'un d'entre eux acheter l'objet
à bon compte à charge pour lui de remettre l'objet aux
enchères à l'intérieur du groupe, la différence
entre le prix d'adjudication officiel et le prix payé par
l'acquéreur étant réparti entre les marchands participant
au groupe. Cette pratique est sévèrement réprimée
par l'article 313-6 du code pénal issu de la loi du 22 juillet 1992.
Selon les informations communiquées par la Chancellerie, les poursuites
pénales exercées sur ce fondement sont peu fréquentes.
79
Cette procédure consiste à remettre en vente l'objet
aux risques de l'adjudicataire défaillant, qui se voit ainsi tenu de la
différence entre son enchère et le prix payé par
l'acheteur final. Compte tenu de l'insolvabilité de l'adjudicataire, le
vendeur risque d'être dépossédé de son bien sans
être sûr d'en retirer le prix normal.
80
Il ne serait d'ailleurs pas inconcevable d'autoriser les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques de prévoir une condition suspensive pour le transfert de
propriété.
81
Depuis 1995, l'Heritage Lottery Fund, a accordé pour
près de 5 milliards de francs à divers musées et
collection, ce qui représente 45 % des dépenses totales du fonds;
Mais ce taux a tendance à baisser pour s'établit aux alentours de
24 % pour l'exercice en cours. Tels sont les données mises en
évidences par un rapport d'une commission d'enquête parlementaire,
qui prend acte de la baisse "du degré d'engagement du Loto dans le
patrimoine.
Par ailleurs, celle-ci souligne le non respect du principe de
complémentarité dans la mesure où il était convenu
au départ que les fonds de la loterie seraient utilisés pour
financer des projets qui n'auraient pas bénéficier d'une soutien
public; or, la tendance est plutôt inverse, puisque les fonds du Loto
viennent désormais souvent utilisés en fait pour compenser la
diminution des crédits publics.
82
Les héritiers doivent remettre à la recette des
impôts du domicile du défunt dans les 6 mois à compter du
jour du décès, une copie de la demande de convention
certifiée par le service régional des affaires culturelles du
lieu de situation des biens. La perception des droits sur les biens en cause
est différée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la
demande.
Les décisions de refus ou d'accord sont notifiées aux demandeurs.
En cas d'accord le ministère des finances notifie son acceptation par
lettre recommandée avec accusé de réception. Le demandeur
dispose ensuite d'un mois pour déposer une copie certifiée
conforme de cette convention à la recette des impôts
compétente.
83
Son régime est précisé à l'article
1131 du Code général des impôts, qui prévoit
l'exonération des droits de mutation en cas de don d'une oeuvre d'art,
de livre, d'objet de collection ou de documents de haute valeur artistique ou
historique.
84
Par ailleurs la dation concerne aussi les immeubles lorsqu'ils
sont situés dans des zones d'intervention du Conservatoire de l'espace
littoral
85
La commission dispose d'un secrétariat de deux personnes,
à plein temps, mises à disposition l'une par la Réunion
des Musées Nationaux, l'autre par le ministère de
l'Économie et des Finances.
86 De 1990 à 1998, 5 demandes d'exonération de droits de mutation
au titre de l'article 1131 du code général des impôts ont
été reçues, 2 agréments ont été
délivrés sans réserve d'usufruit et 3 sont en cours
d'instruction.
Les dispositions issues de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1991
visant à étendre aux musées des collectivités
territoriales les règles applicables aux musées nationaux n'ont
pas accru le nombre d'opérations exonérées dès lors
qu'elles ne peuvent être mises en oeuvre faute de disposition
particulière applicable aux dons et legs aux musées nationaux.
Cela dit, l'objectif poursuivi peut en principe être atteint puisqu'il
est admis qu'une offre de donation d'oeuvres d'art à l'État en
vertu de l'article 1131 du code général des impôts peut
être assortie par le demandeur, de la condition que le bien donné
soit affecté par l'État à un musée
départemental communal. Cette faculté est toutefois rarement
utilisée.
87
L'article 199 sexies D ouvre une possibilité de
réduction d'impôt plafonnée à 20 000 francs pour une
personnes isolée et 40 000 francs pour un couple sur une période
de 5 ans.
88
Instruction de 1988.
89
Septembre 1994 Rapport à M. le ministre de la culture et
de la Francophonie.







