ANNEXE
Croissance, inflation et emploi dans la zone euro
Réflexions sur le sentier de croissance
européenne
à moyen terme
par Ch.
de Boissieu
*(
*
)
et MC.
Marchesi
*(
*
)*
Contribution au XIVème colloque de réflexion économique
du Sénat :
Quelles perspectives de croissance dans la zone euro ?
le 16 juin 1999
L'introduction de l'euro a été, sans conteste,
une
réussite technique. Il reste maintenant à en faire un
succès économique, social et politique. L'ambition pourraît
paraître démesurée. Elle est en fait à la hauteur
des défis auxquels l'Europe est confrontée.
L'Europe connaît un chômage élevé, même s'il a
reculé depuis plusieurs trimestres. Les comparaisons Etats-Unis/zone
euro nous font rêver à un "nouvel âge" semblable à
celui des Etats-Unis depuis près de huit ans sans que d'ailleurs les
composantes de la nouvelle économie américaine aient
été elles-mêmes déterminées avec
précision.
L'objet de cet article n'est pas de fournir des prévisions
macroéconomiques à l'horizon de cinq ans pour la zone euro. Il
est d'éclairer les sentiers possibles de cheminement de l'inflation, de
la croissance et de l'emploi dans cette zone en combinant plusieurs
approches : l'interprétation des évolutions passées
et récentes, certains raisonnements analytiques, des comparaisons
internationales, enfin certains exercices de simulation effectués en
s'appuyant sur un modèle macro-économétrique
multinational, le modèle OEF (voir annexe 1).
Après avoir étudié la dynamique des prix et de la
croissance dans la zone euro (I
ère
partie), nous analyserons
les marges de manoeuvre disponibles à court et à moyen terme
(II
ème
partie).
I. La dynamique des prix et de la croissance dans la zone euro
La
désinflation est l'un des phénomènes marquants intervenus
en Europe depuis le début des années 1980. Même si
aujourd'hui elle fait l'objet d'un large consensus, elle doit être
analysée en elle-même mais aussi dans ses relations avec la
croissance et l'emploi. Le débat sur les avantages et les coûts de
la désinflation n'a donc pas été évacué par
l'expérience de ces dernières années. L'objet de cette
partie est de revenir sur certains aspects du phénomène de
désinflation et d'aborder dans une perspective dynamique le sentier de
croissance dans la zone euro.
1.1. La désinflation
1.1.1. Le processus
L'arrivée de l'euro en 1999 s'est produite dans un contexte de basse
inflation en Europe, cette dernière atteignant un niveau historiquement
faible.
Des chocs extérieurs à la zone euro et agissant sur les
conditions de l'offre ont favorisé et amplifié la
décélération des prix ; la baisse des prix du
pétrole et celle des matières premières constituent une
cause centrale. Plus globalement, la crise asiatique survenue deux ans
plus tôt en faisant émerger des surcapacités substantielles
a contribué à relâcher davantage les pressions sur les prix.
Dès lors, des facteurs externes sont également à l'origine
de ces records historiques.
Notre propos, sans écarter les événements récents
qui ont toute leur importance pour expliquer la dynamique
macroéconomique internationale et notamment une part des performances de
l'économie américaine, tend à se recentrer sur les
facteurs structurels à l'origine des performances européennes en
matière de désinflation et s'interroge sur la possibilité
et l'opportunité de parvenir à une stabilité des prix dans
la zone euro.
En agissant de la sorte, notre préoccupation est de nous greffer sur le
débat d'actualité portant sur le rôle et les objectifs de
la BCE.
Il y a encore quinze ans, les records obtenus sur le plan de l'inflation dans
les pays industrialisés étaient loin d'être
considérés comme aisés à atteindre. Or, la
décennie en cours a connu non seulement la disparition progressive des
processus d' "hyper inflation" dans un nombre important de pays
émergents mais aussi la poursuite du tassement des rythmes d'inflation
déjà faibles dans les pays industrialisés.
La stabilité des prix est-elle souhaitable ou celle de l'inflation
est-elle suffisante ? Son influence sur la croissance réelle est-elle
positive ? Modifie-t-elle les conditions de la croissance de l'emploi ?
Ces questions restent centrales si l'on souligne le contraste entre les
performances en matière de désinflation en Europe et les
évolutions, quant à elles, inquiétantes du chômage
dans la même zone. Les mutations du système financier qui ont
accompagné l'entrée dans ce régime d'inflation basse,
voire quasi nulle, ont simultanément développé les
structures indispensables pour garantir, si ce n'est la stabilité des
prix, au moins le contrôle de leur progression à des rythmes
modérés. Dans les pays développés, cette nouvelle
architecture monétaire et financière n'a fait que se consolider
avec les années (indépendance des banques centrales,
définition de nouvelles cibles en politique monétaire, etc...).
Si l'on se projette quinze ans en arrière, le monde industrialisé
sortait d'une longue phase durant laquelle l'inflation avait
prédominé. Ce qui contrastait fortement avec la période de
stabilité des prix et de croissance soutenue qui avait prévalu
après la seconde guerre mondiale. L'origine des chocs inflationnistes
majeurs a été externe aux économies
développées (chocs pétroliers) mais la réaction des
politiques économiques pour contrer la vague inflationniste puis les
poussées récessionnistes qui lui ont succédé, est
tenue en partie pour responsable de l'émergence de conséquences
graves et aujourd'hui bien connues en Europe : persistance de l'inflation,
phases de récession ou de croissance molle enfin (et surtout),
montée et persistance du chômage.
L'ampleur des impacts néfastes de ces chocs inflationnistes, pourtant
symétriques à tous les pays, a donc été variable en
fonction des économies. La capacité d'adaptation des conditions
de production, l'importance des rigidités nominales, enfin la
réactivité et les priorités de la politique
économique ont fait la différence.
Les enseignements tirés de ces différents épisodes ont
été nombreux.
Tout d'abord, l'inflation est apparue comme un phénomène qui
pouvait avoir un caractère "persistant". Lorsqu'un choc inflationniste
intervient et qu'il n'est pas corrigé par des politiques
adéquates, alors les risques de le voir se propager et persister dans le
temps sont importants.
Ensuite, la réaction de la politique monétaire est cruciale et la
crédibilité des autorités monétaires qui la
détermine l'est tout autant car les anticipations d'inflation
participent à la persistance de cette dernière (à la suite
du premier choc pétrolier, la politique monétaire allemande a
ainsi enrayé le processus inflationniste très rapidement par
opposition à la réaction de la politique économique
française).
Enfin, la formation des salaires et l'absorption du choc inflationniste et
récessionniste par le marché du travail (notamment, l'ajustement
de l'évolution des salaires réels à la chute des gains de
productivité) constituent des éléments d'ajustement
primordiaux. Les divergences qui se sont manifestées sur ce plan entre
les grandes économies ont été fortes. Aux Etats-Unis, le
coût réel du travail a augmenté de moins de 10% de 1970 au
milieu des années 1980 tandis que dans la zone euro, l'évolution
a approché un taux de 50%
.
La forte réaction des économies développées au
second choc pétrolier a ensuite inauguré leur entrée dans
une phase d'ajustement majeur marquée par des politiques
économiques dirigées prioritairement dans la lutte contre
l'inflation.
A cette phase d'ajustement a succédé une phase
d'approfondissement et de consolidation dans les années 1990 qui a
conduit à la situation actuelle dans laquelle les taux d'inflation sont
parvenus à des niveaux historiquement bas. Le contrôle de
l'inflation qui reste néanmoins prioritaire semble désormais
à la portée de la majorité des économies
industrialisées.
Le chemin pour parvenir en 1999 à l'avènement de l'euro a
été laborieux pour un grand nombre de pays européens.
Outre cette maîtrise de l'inflation, des efforts considérables ont
été déployés pour réaliser l'assainissement
budgétaire imposé par l'UEM sans lequel d'ailleurs les
performances sur le terrain de l'inflation n'auraient pas été
atteintes.
L'arrivée de l'euro se fait donc dans un contexte d'inflation quasi
nulle et de déficits publics en recul mais, en contrepartie, la
croissance atteint difficilement son potentiel et, corollaire
préoccupant, le taux de chômage se situe à un niveau trop
élevé pour ne pas risquer de générer de
l'instabilité. Les économies européennes, 11 d'entre elles
en tout cas, se sont engagées à maintenir ces conditions
monétaires et budgétaires (pacte de stabilité et de
croissance) avec des possibilités d'ajustements nominaux réduits
(taux d'intérêt commun, invariabilité des taux de change
nationaux...), pariant sur cette stabilité pour faire émerger une
croissance fructueuse, en particulier sur le plan de l'emploi.
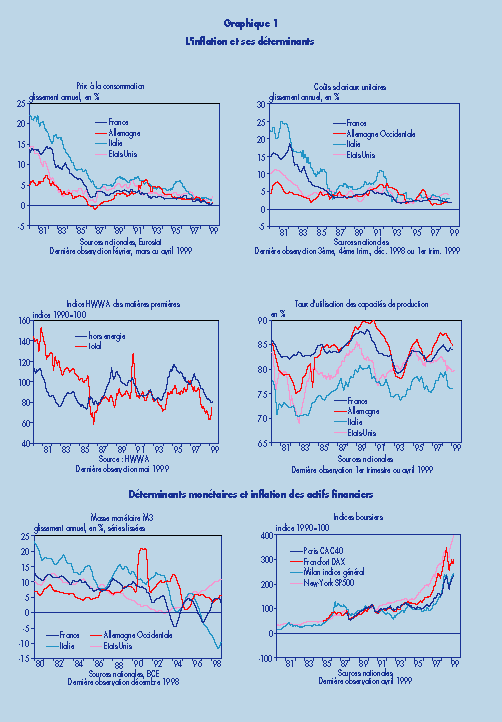
Malgré les records atteints sur le terrain de la
désinflation, le débat sur les coûts de l'inflation ne
s'est pas éteint. Faisant écho aux bilans et études sur
les coûts de la politique de désinflation et d'assainissement
monétaire et, allant parfois jusqu'à mettre en garde contre de
nouveaux risques inflationnistes, les études sur les effets
néfastes de l'inflation se sont encore largement
développées ces dernières années.
Deux raisons peuvent être avancées pour expliquer ce foisonnement :
- la première rappelle que si le monde industrialisé est
entré dans une phase d'inflation modérée et
maîtrisée, ce n'est pas le cas pour l'ensemble des pays
émergents ou en transition. Comme il l'a été
rappelé ci-dessus, bien que des efforts considérables aient
été réalisés dans de nombreuses zones, il semble
nécessaire à certaines organisations internationales de rappeler
les implications " contre-productives " du développement de
l'inflation. Ainsi, de nombreuses études mettent en évidence une
corrélation négative entre le taux d'inflation et le taux de
croissance dans ce type d'économies.
Les analyses ont été étendues dans certains cas aux pays
industrialisés mais la relation apparaît alors moins claire en
particulier lorsque les taux d'inflation tombent en dessous de 10 % (cf.
encadré ).
- la seconde, plus proche de notre propos, renvoie aux arguments selon lesquels
l'inflation, bien qu'à des niveaux modérés, n'est pas pour
autant dénuée d'effets pervers pour la croissance, en particulier
à moyen-long terme. Ainsi, il n'y aurait pas un seuil
en-deçà duquel les variations nominales ne seraient plus
responsables de distorsions amenant à faire des choix de comportements
non optimaux pour la croissance et le bien-être.
Cette position est défendue de façon fervente et appuyée
par les partisans de la pure stabilité des prix avec à leur
tête M. Feldstein. Ce dernier précise, cependant, que la
stabilité des prix doit être entendue au sens large puisqu'elle ne
correspond pas dans les faits à un taux d'inflation nul mais
plutôt proche de 2 %, compte tenu des erreurs de mesure qui
entourent l'évaluation de l'inflation. A l'opposé, certains
économistes (Akerlof, Dickens & Perry (1996)) prônent, de leur
côté, le maintien d'un espace de fluctuations nominales qui
permettrait de réguler les tensions sur le marché du travail sans
entraîner de conséquences néfastes en termes d'emploi. Pour
trancher en faveur de l'une ou l'autre position, il faut pouvoir confronter les
coûts et les gains générés par les deux options. Les
coûts de l'inflation, bien que cette dernière se situe à
des niveaux modérés, sont-ils supérieurs aux coûts
d'une politique de désinflation et à quel horizon ? Les analyses
sur les coûts de la désinflation se sont largement fondées
sur l'évaluation de " ratios de sacrifice ". Dans le cas
européen, elles mettent en évidence la part imputable à la
politique de désinflation et à la politique monétaire
restrictive, qui en a été la base, dans la montée du
chômage.
Parti des Etats-Unis, le débat s'implante naturellement en Europe avec
l'arrivée de l'euro, la création de la BCE et la
définition de ses objectifs.
Inflation basse et contrôlée ou pure stabilité des prix ?
Doit-on considérer que les taux d'inflation observés aujourd'hui
en Europe correspondent en fait à la stabilité des prix ?
Inflation et croissance : quels enseignements peut-on retenir des évaluations empiriques ?
La mise
en évidence empirique de la relation négative entre inflation et
croissance (ou bien-être) a récemment fait l'objet de nombreuses
études. Si les amplitudes sont variables d'une estimation à
l'autre La validité empirique d'une
corrélation
négative
semble assurée en présence
d'une inflation
à deux chiffres
(Briault C. (1995)).
La méthodologie la plus utilisée consiste à tester
l'existence de cette relation sur la base d'un panel intégrant des
séries temporelles pour un nombre important de pays ce qui permet de
valider la relation à la fois dans le temps et dans l'espace (les
modèles de croissance retenus peuvent varier d'une étude à
l'autre mais le modèle néo-classique standard est courant).
Le problème du sens de la causalité entre inflation et croissance
est souvent posé et oppose une réserve aux conclusions
tirées de ce type d'études. Il est, en effet, évident
qu'une inflation forte peut résulter d'une croissance située
au-dessus de son rythme tendanciel (ou potentiel). La relation négative
qui ressort, alors, dans une majorité d'estimations sur les
périodes récentes peut très bien refléter la
réaction des politiques monétaires à un dérapage
inflationniste. Une baisse simultanée de la croissance et de l'inflation
se produit sans que la dernière soit le déterminant, en soi, du
ralentissement de l'activité.
L'étude de R.J. Barro (1995) porte sur un panel de plus de 100 pays et
couvre la période 1960-1990 (la dernière décennie qui a
enregistré des records en matière de désinflation dans un
contexte de croissance modérée n'est malheureusement pas
analysée). La variation des prix est intégrée dans un
modèle de croissance défini par divers facteurs explicatifs
relatifs au capital humain, à la politique publique, à la
démographie et aux choix d'investissement dans le secteur privé.
Son estimation, réalisée en laissant constants les facteurs
autres que l'inflation, aboutit au résultat selon lequel une
augmentation de 10 points du taux d'inflation annuel provoque une chute de
0,24 point du taux de croissance annuel du PIB réel par tête
.
Constatant que cette relation est prédominée par les observations
correspondant aux pays où l'inflation est comprise entre 10% et 20%,
l'auteur procède à une estimation en trois temps en fonction des
niveaux d'inflation (supérieur à 40 %, compris entre
15 % et 40 % et en dessous de 15 %). Les coefficients
correspondant à une baisse du taux d'inflation de 1 point sont
respectivement égaux à
- 0,023 ; - 0,037 et
enfin, - 0,016. Cependant, pour les taux d'inflation les plus bas
(inférieurs à 10 %), la relation n'est plus significative.
Par ailleurs, les tests portant sur la relation entre la volatilité de
l'inflation et la croissance ne peuvent conclure sur l'existence d'une relation
négative ce qui pourrait provenir du fait que la volatilité ne
traduit pas correctement l'incertitude relative à l'inflation future.
S. Fischer (1993), en identifiant le rôle occupé par l'inflation
parmi les déterminants de la croissance constate également,
à partir d'un échantillon de 80 pays sur une période
couvrant les années qui ont précédé et suivi le
premier choc pétrolier, que l'inflation est corrélée
négativement avec le taux de croissance (- 0,04 pour 1 point d'inflation
supplémentaire) mais aussi, bien qu'à des niveaux moindres, avec
le taux d'accumulation du capital et la croissance de la productivité.
S. Fischer montre que lorsque le taux d'inflation est bas (entre 0 et
15 %) alors l'impact sur la production est plus élevé.
L'influence de l'inflation sur la productivité a aussi fait l'objet
d'évaluation, le sens de la causalité allant de l'inflation vers
la productivité et non l'inverse (test de causalité de Granger).
Ainsi, Rudebush et Wilcox (1994) ont estimé à 0,35 % le
supplément de croissance annuelle de la productivité
résultant d'une baisse de 1 % de l'inflation aux Etats-Unis. Les
tests pour la France et l'Allemagne ne produisent pas de résultats
significatifs. Ce résultat est intéressant à rapprocher
des situations observées actuellement aux Etats-Unis et en Europe,
notamment, le parallèle entre le choc
" présumé " positif de productivité et le
tassement de l'inflation
.
1.1.2. Les coûts de l'inflation
Les arguments retenus à l'encontre de l'existence de tensions
inflationnistes, si faibles soient-elles comme c'est le cas aujourd'hui dans le
monde industrialisé, se rapportent aux perturbations que les variations
nominales introduisent dans l'allocation des ressources et la redistribution
des revenus et de la richesse. L'inflation et l'incertitude sur l'inflation
(appréhendée par sa volatilité) peuvent réduire le
niveau de la production mais également le taux de croissance de cette
dernière en décourageant l'accumulation du capital et, par
conséquent, l'innovation et la productivité globale des facteurs.
Si l'inflation était correctement anticipée, les coûts
générés ne seraient que modérés voire
inexistants. Mais en réalité, il est extrêmement difficile
d'anticiper l'inflation car cela suppose d'évoluer dans un contexte
d'information parfaite avec une totale transparence sur les objectifs
déterminés par les autorités monétaires.
Supprimer les sources de distorsions suppose une bonne maîtrise des
différents niveaux de décisions économiques
concernés (élaboration de contrats indexés, adaptation des
systèmes comptables, etc...) et, en particulier, un système
fiscal parfaitement évolutif en fonction de l'inflation. Or, cette
contrainte est rarement remplie.
L'inflation non anticipée provoque, alors, des coûts d'ajustement
plus ou moins amples.
Du constat empirique selon lequel plus l'inflation est élevée,
plus sa variabilité est forte, on est amené à
déduire qu'une inflation élevée accroît
l'incertitude sur les évolutions futures de prix. Le comportement des
agents s'adapte alors à cet environnement risqué d'une
façon qui peut très bien ne pas être optimale. La
perturbation qui naît tout d'abord de la déformation des prix
relatifs générée par l'inflation est alors
aggravée. Les agents économiques sont ainsi incités
à se détourner des contrats de long terme à la
rentabilité aléatoire, défavorisant alors l'accumulation
de capital. La redistribution des richesses qui s'opère en faveur de
certaines catégories d'agents ou de facteurs peut donc s'avérer
contre-productive à long terme.
L'installation dans un régime d'inflation élevée et/ou
croissante favorise l'apparition de transferts en faveur de certains agents et,
par extension, de certains types de comportement. Ainsi, par exemple, la
constitution d'épargne n'est pas encouragée du fait de sa
dépréciation alors qu'en parallèle, l'endettement
réel est progressivement diminué par l'inflation (cela s'applique
aussi à la dette publique).
La position de M. Feldstein (1996) en faveur de la stabilité des prix
(telle qu'elle a été définie ci-dessus) plutôt que
de celle de l'inflation, suppose que les effets de cette dernière sur la
croissance sont linéaires, il n'y aurait donc pas un seuil
en-deçà duquel la variation des prix ne provoquerait plus de
distorsions. M. Feldstein ne s'étend pas sur la validité de cette
proposition lorsqu'un régime d'inflation stable émerge d'un
contexte de forte crédibilité des autorités
monétaires. Il souligne néanmoins l'avantage, qualifié de
"bonus de crédibilité", que détiennent les
économies ayant su maîtriser l'inflation lors de chocs
inflationnistes majeurs.
Dans ce cas, les agents peuvent intégrer en toute confiance les
objectifs d'inflation fixés par les autorités puisque les
incertitudes qui entourent l'évolution future des prix disparaît.
Ainsi, l'une des causes des effets néfastes sur l'activité est
supprimée mais d'autres demeurent tels que la déformation des
prix relatifs ou les distorsions liées à une indexation
imparfaite, en particulier du système fiscal.
C'est sur ces dernières que repose en grande partie l'évaluation
de M. Feldstein sur les coûts de l'inflation. Il se concentre sur deux
types de distorsions.
Le premier est relatif aux conséquences des interactions entre inflation
et pression fiscale sur l'accumulation de richesse par les ménages et
à leurs implications sur le rendement réel de l'épargne.
Ces effets provoquent une déformation des arbitrages
opérés entre consommation et épargne globales tout au long
du cycle de vie. L'effet sur l'investissement logement provenant des
distorsions liées aux déductions fiscales pour
intérêts d'emprunts est également traité. Le second
porte sur les implications pour les recettes de l'Etat d'une inflation
zéro.
Les gains estimés pour les Etats-Unis
sont compris entre 0,63 %
et 1 % du PIB par an pour une baisse de 2 points du taux d'inflation
.
Mais Feldstein défend l'idée que la politique monétaire ne
doit pas être uniquement animée par la crainte des
retombées négatives d'une hausse de l'inflation sur la croissance
mais, plus fondamentalement, préoccupée par la dégradation
des revenus réels qu'entraîne chaque augmentation des prix et qui
à long terme pèse significativement sur le niveau du PIB.
Enfin, il renforce sa position en soulignant que les gains de la
stabilité des prix sont permanents, bien qu'ils n'apparaissent
qu'à moyen terme (6 à 9 ans), tandis que les coûts
d'ajustement provoqués par la désinflation ne seraient que
transitoires. Cependant, le caractère transitoire de ces coûts
peut être discuté car il n'est pas assuré que ces
ajustements n'aient pas d'influence dans le long terme. La persistance du
chômage européen contrecarre, en effet, pour partie cette
hypothèse.
La démarche et la méthodologie de M. Feldstein ont
été reprises dans différentes analyses menées au
sein des banques centrales européennes pour éclairer le
débat sur l'opportunité d'un passage à une inflation
zéro en Europe (cf. tableau 1). Les disparités institutionnelles
et fiscales (régulations différentes des marchés du
travail ou des capitaux, mais aussi, variété des systèmes
de retraite impliquant des comportements d'épargne différents, le
système par capitalisation augmentant, par exemple, la durée de
l'épargne dans le cycle de vie) sont à l'origine d'impacts
différenciés en fonction des pays.
Tableau 1
Comparaison internationale des gains procurés par
le passage du
taux d'inflation de 2% à 0
en termes de surplus annuel (en %)
|
France |
Etats-Unis |
Allemagne |
Espagne |
Royaume-Uni |
|
0,34 |
1,06 |
1,42 |
1,71 |
0,21 |
Source :
Chatelain J.B., Sevestre P. (1999). Evaluation des auteurs pour la France et de
M. Feldstein (1996) pour les Etats-Unis ; K.H. Tödter G.Ziebarth (1997)
pour l'Allemagne, Dolado J.J et
alii
(1997) pour l'Espagne ; Bakhshi H.
et
alii
(1997) pour le Royaume-Uni.
1.1.3. Les coûts de la désinflation jusqu'à la
stabilité des prix
1) Les rigidités nominales à la baisse des salaires : une
raison importante de conserver une inflation modérée ?
La stabilité des prix suscitent encore de nombreuses réticences
parmi lesquelles les préoccupations concernant les répercussions
possibles sur l'emploi occupent une place primordiale. Dans la polémique
qui s'est récemment développée outre-atlantique les
travaux de Akerlof et
alii
(1996)
, côté opposition,
sont à souligner. Pour appuyer leur thèse selon laquelle
l'existence de fluctuations nominales permettraient de mieux gérer les
ajustements réels, notamment en termes d'emploi, les auteurs
mènent tout d'abord, une enquête démontrant l'existence de
rigidités nominales à la baisse des salaires nominaux. Car, selon
eux contrairement à une idée qui s'est répandue, les
baisses de salaires nominaux sont, en réalité, peu
pratiquées. Dès lors, qu'on accepte ce fait, on comprend que le
maintien d'une inflation modérée puisse permettre aux entreprises
rencontrant des difficultés, surtout si ces dernières sont
temporaires, d'opérer des ajustements sur les coûts réels
sans faire varier les salaires nominaux perçus auxquels les
salariés seraient particulièrement sensibles. En l'absence
d'inflation, la baisse des salaires, si elle était praticable, pourrait
provoquer une contraction de la productivité du fait d'une baisse de la
motivation des salariés. La flexibilité salariale réelle
qu'autorisent par conséquent les variations de prix est le moyen
d'éviter des ajustements sur l'emploi. Elle serait d'autant plus
appréciable que des disparités micro-économiques au stade
de l'entreprise mais aussi sectorielles existent.
Sur le plan théorique et méthodologique, Akerlof et
alii
estiment à partir d'un modèle intégrant cette
hypothèse de rigidité nominale des salaires, les coûts et
bénéfices de deux politiques monétaires, l'une ayant pour
cible une inflation à 3 %, l'autre une cible de 0 %. A long
terme (entre 6 et 10 années),
le taux de chômage est dans le
deuxième cas supérieur de 2,6 points
au niveau atteint dans
le premier scénario.
2) Des "ratios de sacrifice" plus élevés dans les
années 1990
Les coûts de la désinflation peuvent être estimés
à partir de "ratios de sacrifice" qui évaluent les pertes de PIB
observées lorsque la baisse de l'inflation a comme contrepartie le
passage du taux de chômage au-dessus de son taux naturel. Ces ratios
peuvent être définis de deux manières ; soit, par le
rapport entre l'écart de l'évolution observée de la
production à son évolution tendancielle et la variation de
l'inflation ; soit, en rapportant directement l'accroissement du taux de
chômage à la baisse de l'inflation.
Ces ratios estimés par L. Ball (1996) pour les années 1980 dans
le cas des Etats-Unis, du Royaume Uni, de l'Allemagne et de la France le sont
en identifiant dans chacun des cas les épisodes de désinflation
enregistrés sur la période (les écarts à l'output
tendanciel sont déterminés par les niveaux observés de
l'output en début de phase de désinflation et après la fin
de cette dernière).
Ils s'élèvent respectivement
à 1,83 dans le cas américain ; 0,87 pour le Royaume-Uni ; 3,56
pour l'Allemagne et, enfin, seulement 0,60 pour la France
1(
*
)
.
Le ratio particulièrement élevé pour l'Allemagne, qui
présentait le taux d'inflation le plus bas au début de la phase
de désinflation, renforce l'intuition selon laquelle les coûts de
la désinflation sont plus élevés lorsque l'inflation est
déjà basse.
Lorsque ces évaluations sont étendues aux années
1990
2(
*
)
pendant lesquelles la
poursuite du processus de désinflation s'est accompagnée d'une
croissance en moyenne relativement modérée,
le coût
d'une désinflation de l'ordre d'un point en France s'élève
à 3,5 % de PIB. Ainsi, la désinflation de deux points
observée entre 1990 et 1996 a eu un coût de l'ordre de 7% du
PIB
. Pour les Etats-Unis, le coût est estimé à 6 %
et pour l'Allemagne à 11 %. (Pour les Etats-Unis, le
résultat est conforme aux estimations de M. Feldstein ce qui le conduit
à dire qu'au-delà de six années, les gains dus à la
baisse de l'inflation (environ 1 % de PIB par an) deviennent plus
importants que le coût total et transitoire de la désinflation).
Ces résultats confortent à nouveau l'idée selon laquelle
la poursuite de la désinflation lorsque les taux d'inflation sont
déjà bas est relativement plus coûteuse.
1.1.4. Le régime de basse inflation : ses implications
1) Notre hypothèse : le régime de basse inflation va se
prolonger
L'inflation n'est pas uniforme dans la zone euro, et les situations
asymétriques du côté de la croissance et de l'inflation ne
vont pas disparaître du jour au lendemain. A s'en tenir aux pays du
"noyau dur", le taux d'inflation devrait, à l'horizon des trois-quatre
prochaines années, demeurer modique (en rythme annuel, compris entre 0
et 2 %, plus probablement entre 0 et 1,5 %). Cette hypothèse ne
tient pas compte du débat, par ailleurs justifié, sur la "bonne"
mesure de l'inflation, mais les premiers travaux effectués par l'INSEE
sur ce sujet suggèrent qu'en France la correction à apporter
serait de l'ordre de 0,3-0,4 % en rythme annuel (en moins), contre
1 % à 2 % aux Etats-Unis. Notre vue prospective résulte
elle-même de la conjugaison de plusieurs éléments :
a) La remontée récente des prix du pétrole et de quelques
autres matières premières ne peut être extrapolée.
Fondamentalement, et malgré une démonstration inverse de temps
à autre, l'OPEP est et va rester un cartel faible, traversé par
des dissensions sans oublier le poids des producteurs à
l'extérieur du cartel. Par delà d'inévitables fluctuations
à court terme, les prix du pétrole et des grandes matières
premières vont être plus influencés par le sentier
d'évolution de la demande, donc par la croissance à moyen terme
de l'économie mondiale, que par l'incertaine organisation de l'offre.
b) Le chômage va rester élevé dans la zone euro,
spécialement dans certains pays du "noyau dur" (France, Allemagne...).
Raisonnons pour la France avec un NAIRU de 8 à 9 % (donc
proche de sa valeur actuelle, une estimation légèrement
inférieure à celle habituellement retenue, par exemple celle du
FMI comprise entre 9 et 10 %). En partant d'un taux de chômage
effectif de 11 % (pour simplifier) il faudrait, avec une croissance
annuelle de 3 %, de cinq à huit années pour retomber au
NAIRU ! Et le taux de chômage naturel lui-même devrait
progressivement s'abaisser en Europe, comme il l'a fait aux Etats-Unis, sous
l'effet de la croissance, des nouvelles technologies, de l'essor des services,
etc. Conclusion : il existe encore en Europe continentale une marge
significative avant que la courbe de Phillips joue à plein et que la
réduction du chômage ne provoque des tensions sur les coûts
salariaux unitaires et sur les prix.
c) Même si la "nouvelle économie" américaine comporte des
spécificités évidentes, certaines de ses composantes vont
concerner l'Europe pour les dix prochaines années. On pense bien
sûr aux effets, déjà présents, de la concurrence et
de la globalisation sur la formation des prix (où sont, aujourd'hui en
France, les secteurs abrités de la concurrence internationale et
spécialement de la concurrence européenne ? Même si les
services publics les plus traditionnels sont désormais exposés),
mais aussi aux nouvelles technologies, aux gains de productivité
à en attendre et donc au sentier d'évolution des coûts
salariaux unitaires. Pour les nouvelles technologies, le
phénomène de "rattrapage" devrait jouer à tous les niveaux
: la France va combler une partie de son retard vis-à-vis des
Etats-Unis, et l'Allemagne va elle-même dans les années qui
viennent rattraper la France, se créant ainsi de nouvelles marges de
croissance et de productivité. Avec des taux de chômage qui,
même en baisse, vont rester à l'horizon des cinq prochaines
années au dessus du NAIRU et des réserves de nouvelles
technologies qui engendrent des réserves de gains de
productivité, on voit mal d'où pourrait venir, à l'horizon
de l'analyse, l'inflation salariale.
d) Nous attachons un poids modéré à la thèse de la
relance de l'inflation dans les cinq prochaines années du fait de
certains débordements monétaires et financiers. Certes
l'inflation financière ("asset inflation") ne saurait être
négligée. Elle est a priori plus forte aux Etats-Unis que dans la
plupart des pays européens, même s'il est en pratique difficile de
définir des PER d'équilibre et de déterminer avec
précision l'ampleur de la surévaluation des cours boursiers et de
la bulle financière. Des corrections probables sur les marchés
d'actions vont-elles transférer l'inflation des actifs financiers vers
les marchés de biens et services ? Nous pensons que des corrections vont
intervenir en 1999-2000, plus probablement en plusieurs étapes que par
le biais d'un krach boursier. Mais il n'y aura pas, compte tenu de la
concurrence et du nouveau mode de formation des prix, nécessairement de
remontée mécanique du prix des biens et services à la
suite des corrections boursières. Il va falloir suivre avec attention
l'évolution des marchés immobiliers en Europe. Car la reprise de
ces marchés pourrait, elle, déboucher non pas à court
terme mais à moyen-long terme sur des phénomènes de
surévaluation et de bulle immobilière à surveiller de
près. Un autre aspect du débat monétaire et financier
touche au "découplage" éventuel entre d'un côté la
progression des agrégats de monnaie et de crédit, de l'autre
celle du PIB nominal. Certes l'agrégat M3 croît plus vite dans la
zone euro que le PIB nominal, mais ce phénomène de ralentissement
de la vitesse de circulation de M3 reste modique. Le découplage entre la
progression du crédit et celle du PIB est plus marquée. Mais il
faut se rappeler que l'inverse a prévalu, avec pendant plusieurs
années des croissances de M3 et du crédit en retrait par rapport
à l'activité en valeur (à cause du processus de
désendettement de la part des entreprises et des particuliers, d'effets
de substitution entre les composantes de M3 et les titres du marché
financier, etc.). Il y a donc, dans le phénomène
évoqué, pour partie un phénomène de "rattrapage"
(ou de compensation). En outre, le monétarisme n'est plus ce qu'il
était dans les années 1960 ou 1970, et la liaison entre la
croissance monétaire et les prix est encore moins mécanique
qu'avant.
2) Le régime d'inflation basse : des effets persistants
Nous insistons sur quatre aspects du régime d'inflation basse, qui se
sont déjà manifestés et vont rester au centre de la
régulation économique et financière dans la zone euro
comme d'ailleurs, pour certains d'entre eux, dans d'autres pays du G7.
a) Les mouvements des prix relatifs
La baisse des prix relatifs de l'industrie -par rapport à l'indice
général des prix et aux prix des services- est nette en France et
dans le reste de la zone euro depuis la fin de 1997. Aux Etats-Unis le
décrochage est intervenu depuis la fin de 1996. Et une
légère correction s'est amorcée depuis le début de
1999 en liaison avec le rebond du pétrole et de certaines
matières premières.
Un certain nombre d'éléments structurels pourraient prolonger la
chute des prix relatifs de l'industrie : la concurrence encore plus aiguë
dans le secteur industriel que dans les autres secteurs ; l'existence de
surcapacités au plan mondial pour des produits stratégiques
(automobile, électronique...) ; dans la zone euro, les pressions
concurrentielles supplémentaires introduites par la monnaie unique ; la
persistance de certains écarts de productivité entre l'industrie
et les services. Mais, en fait, quand il est question de surcapacités ou
de performances de productivité, la question de la porosité de la
frontière entre l'industrie et les services devient centrale. L'essor
des services aux entreprises-catégorie hétérogène
qui regroupe le travail intérimaire, certaines composantes de
l'informatique et des transports, etc.- nécessite d'affiner l'analyse.
Les mouvements déjà constatés du côté des
prix relatifs et ceux qui vont les prolonger conduisent à deux
observations : 1/ Le retour de la confiance des industriels viendra
plutôt du rebond de la demande et de l'effet-volume associé, que
de l'amélioration de leurs prix relatifs. 2/ Le calcul des taux
d'intérêt réels doit continuer à faire
référence aux situations sectorielles. Un même taux nominal
signifie des écarts dans les taux réels à la production
pouvant aller jusqu'à 500 ou 600 points de base.
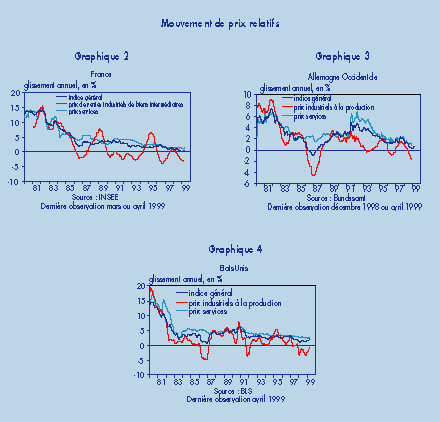
b) Le
moral des industriels et la confiance des consommateurs
Depuis 1998, c'est-à-dire depuis que la crise financière
internationale dans les pays émergents (Asie du sud-est...) ou en
transition a commencé à faire sentir ses effets sur les pays
occidentaux, est apparu un décalage entre la baisse du moral des
industriels et la confiance persistante des consommateurs, elle-même
nourrie par le recul du chômage. Ce découplage s'est
révélé spécialement marqué dans des pays
comme la France ou l'Allemagne, même si, dans la période la plus
récente il s'est un peu atténué. Le régime de basse
inflation joue ici un rôle, même s'il n'est pas le seul
élément à considérer : la chute des prix absolus et
relatifs dans l'industrie assombrit les perspectives d'un certain nombre
d'industriels et les rend attentistes dans leur politique de stockage, alors
qu'avec une inflation plus modérée que prévu, les
ménages réalisent des gains de pouvoir d'achat inattendus. Ce
dernier effet ne peut pas durer très longtemps car les ménages
tiennent compte de l'expérience et des erreurs de prévision
constatées ; ils s'adaptent au régime de basse inflation pour
revoir à la baisse leurs anticipations d'inflation.
Pour l'avenir, le découplage entre la déprime des industriels et
la confiance des consommateurs ne pourra pas se prolonger trop longtemps. On
peut raisonnablement espérer que le scénario de "sortie vers le
haut" (redressement du moral des industriels, en liaison avec le retour de la
croissance dans certains pays émergents, etc.) va prévaloir. Il
ne faudra pas trop compter sur l'improbable rebond des prix absolus et relatifs
de l'industrie, mais plutôt escompter l'atténuation graduelle de
certaines surcapacités.
c) Le comportement de la BCE
"L'objectif principal" de la BCE est de maintenir la stabilité des prix
(article 105 du traité de Maastricht). Principal ne veut pas dire
exclusif, et ceci est encore plus important lorsque la stabilité des
prix n'est pas vraiment menacée. On peut, pour cadrer le raisonnement,
représenter la fonction de réaction de la BCE par la règle
de Taylor, en la simplifiant de la façon suivante :
i = ( - *) + (y - y*)
* cible d'inflation, y* cible de croissance, i, taux directeur de la BCE.
L'objectif affiché par la BCE pour 1999 -une inflation inférieure
à 2 % pour la zone euro- ne sera pas nécessairement
reconduit tel quel pour 2000 et a fortiori les années
ultérieures. Car on peut s'attendre à ce que la BCE, par souci
d'une meilleure communication avec son environnement, affiche plus de
symétrie dans son ciblage de l'inflation (fixant donc, à la fois,
une valeur-plafond et une valeur-plancher). Quoi qu'il en soit, tant que
l'inflation effective demeure significativement en deçà du
plafond d'inflation, la BCE va être en mesure de s'intéresser
à l'écart de croissance et donc de conférer au poids () de
cet écart une valeur différente de zéro.
d) Les ajustements fiscaux en régime de basse inflation
C'est déjà le cas depuis deux-trois ans et cela va se prolonger :
avec une inflation durablement proche de zéro, les fluctuations à
court terme des rentrées fiscales, par exemple de la TVA,
dépendent de celles du PIB en volume. La volatilité du taux
d'inflation, très réduite, ne joue plus alors qu'un rôle
résiduel. Par rapport aux années d'inflation instable, ceci
change le mécanisme des stabilisateurs automatiques et le contexte
général de la politique budgétaire.
1.2. Croissance potentielle et taux de chômage d'équilibre
Le début de cette étude s'est concentré sur le
débat concernant les avantages et les coûts que peut induire un
régime d'inflation basse. Nous nous interrogeons dans un second temps
sur l'articulation qui peut émerger, dans un tel contexte, entre
inflation et croissance à moyen terme et d'autre part, entre inflation
basse et chômage. La question du taux de chômage d'équilibre
apparaît dès lors primordiale et nous avons choisi de la mettre en
perspective en confrontant les faits stylisés des années 1990 en
Europe, spécialement en France, et aux Etats-Unis.
Au début de la décennie, tandis que l'économie
européenne connaît une récession accusée d'où
elle sort avec un taux de chômage fort dégradé,
l'économie américaine, quant à elle, débute une
phase de croissance aux caractéristiques singulières. Les
années 1990 se sont écoulées et l'Europe enregistre des
records sur le front de la désinflation mais atteint difficilement un
rythme de croissance de 2,5 % tandis que son taux de chômage
approche 12 %. Aux Etats-Unis, la croissance se poursuit faisant baisser
le taux chômage sous la barre des 5 % considérée comme
le seuil en-dessous duquel les risques d'inflation apparaissent. Or,
jusqu'à présent, ces tensions sont inexistantes.
Ce cercle vertueux apparu outre-atlantique suscite bien entendu l'admiration
mais aussi beaucoup d'interrogations.
Est-on entré dans un nouveau régime de croissance dans lequel les
régulations standards sont obsolètes ? La "nouvelle
économie" prendrait racine dans la montée en puissance du "High
Tech". Avec des taux de croissance élevés de la production et des
prix qui ne cessent de chuter, le développement de ce secteur
permettrait une croissance globale soutenue sans inflation. En
parallèle, la globalisation répand sur un nombre de
marchés croissant des produits à faibles intensité
technologique mais également à faibles prix. Accroissant la
production globale par une part grandissante dans la valeur ajoutée mais
aussi bousculant la productivité globale dans un grand nombre de
secteurs du fait d'une diffusion massive, "les nouvelles technologies"
imposeraient à leur tour une nouvelle ère de croissance.
Les tenants de cette thèse sont cependant affaiblis par l'absence de
données confirmant la progression de la productivité globale qui
accompagnerait cette révolution. Ce défaut de constat empirique
contribue à affaiblir la thèse du "nouvel âge" au profit
d'explications plus conformes au cadre d'analyse standard. Cependant ce dernier
échoue à expliquer à la fois l'absence d'inflation et les
nouvelles relations qui s'établissent entre celle-ci et les autres
composantes telles que les salaires ou les taux d'utilisation des
capacités (Gordon R.J. (1998))
3(
*
)
.
En particulier, la relation inflation-chômage qui s'est imposée
aux Etats-Unis à partir de 1994 peut-elle encore être
fondée sur les concepts usuels tels que le NAIRU ? Le dilemme
inflation-chômage est-il toujours pertinent dans le cas américain ?
Certains profitent de cette situation " inattendue " pour rejeter
radicalement les outils d'analyse qui s'étaient imposés
progressivement mais dont la pertinence a toujours été
discutée (Galbraith J. K. (1997)). D'autres préfèrent
confirmer leur utilité tout en reconnaissant la nécessité
de les faire évoluer et de les améliorer pour leur permettre
d'appréhender les événements récents. C'est le cas
de nombreuses contributions portant sur l'évaluation du NAIRU qui
mettent en avant sa variabilité dans le temps. Ainsi, en dix ans, du
milieu des années 1980 au milieu des années 1990, le NAIRU aurait
baissé d'un point ce qui expliquerait la moindre pression
opérée sur les prix et donc la moindre inflation.
Qu'en est-il de l'Europe, et de la France en particulier, pour lesquelles les
performances en termes d'inflation s'accompagnent d'une
détérioration de l'emploi avec un taux de chômage
" d'équilibre " particulièrement élevé?
Aborder une réflexion sur le régime de croissance qui peut
prévaloir dans les années à venir nécessite que des
éclaircissements soient faits sur la notion de chômage
d' "équilibre" qui conditionne à la fois la croissance
potentielle et les anticipations d'inflation. De la sorte, c'est aussi
l'analyse des différentes composantes de la politique économique,
monétaire ou de l'emploi, qui est en jeu.
1.2.1. La montée en puissance du concept de NAIRU dans les
années 1980 et son utilisation en politique économique
La référence au NAIRU comme indicateur de pressions
inflationnistes existantes ou à venir s'est accrue et imposée
dans les années 1980, années pendant lesquelles la politique de
désinflation a constitué un axe majeur de la politique
macro-économique.
Ainsi, l'utilisation du NAIRU est courante dans la conduite de la politique
monétaire, du moins aux Etats-Unis. Sa référence lors de
la présentation des prévisions officielles comme indicateur des
pressions inflationnistes ou de leur anticipation semble entériner
l'idée que le NAIRU est un outil utile et pertinent. Cela
présuppose, bien entendu, qu'il soit admis que l'inflation
résulte, au moins en partie, des tensions existantes sur le
marché du travail. Ainsi, J. Stiglitz (1997) évalue à 20%
la part des variations de l'inflation expliquée par le taux de
chômage et estime que le maintien, pendant un an, du taux de
chômage à un niveau inférieur d'environ un point au NAIRU,
entraînerait un supplément d'inflation de l'ordre de 0,3 à
0,6 point.
Le dilemme inflation-chômage resterait, par conséquent,
d'actualité alors que l'évolution récente de
l'économie américaine pourrait en faire douter tant la
décélération de l'inflation a été inattendue
au vu des performances enregistrées sur la croissance et l'emploi.
Outre la proposition selon laquelle on assisterait à l'émergence
d'un nouveau paradigme de croissance aux Etats-Unis, des erreurs
d'évaluation du chômage d'équilibre peuvent être
à l'origine de ce qui apparaîtrait faussement comme une
singularité. Dès lors, le cadre d'analyse utilisé
jusqu'à aujourd'hui retrouverait une partie de son
intégrité. Dans ce cas, les économistes doivent être
capables d'expliquer la variation du NAIRU dans le temps (Gordon R.
(1997)) (le concept de taux de chômage naturel immuable est donc
largement dépassé). Divers facteurs sont évoqués
parmi lesquels le facteur démographique, si l'on suppose qu'à
chaque catégorie de la population correspond un taux de chômage
naturel (un pour le jeunes, un pour les hommes, un autre pour les femmes, par
exemple) alors les changements démographiques peuvent modifier le taux
de chômage global. L'adaptation des salaires réels à la
tendance de la productivité dès la fin des années 1980,
après que le choc négatif de productivité des
années 1970 ait introduit des pressions inflationnistes et tirer le
niveau de chômage d'équilibre vers le haut, ramène
aujourd'hui à l'inverse le NAIRU vers le bas. Enfin, la montée de
la concurrence et donc une compétitivité accrue aussi bien sur le
marché des biens que sur celui du travail, est souvent
évoquée comme explication. La mondialisation exerce une pression
à la baisse sur les prix tandis que sur le marché du travail, des
forces structurelles telles que la perte progressive du pouvoir des syndicats
sont susceptibles d'agir dans le même sens.
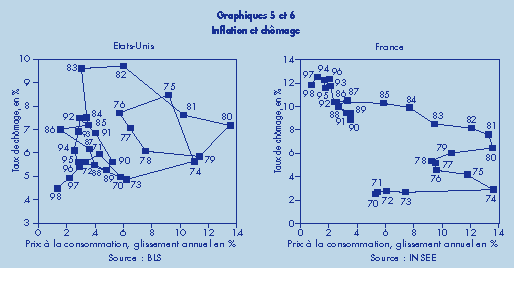
Malgré toutes les incertitudes qui entourent son évaluation, le
NAIRU est-il utile à la politique économique ? Est-il assez
robuste pour soutenir des décisions visant à contrôler
l'inflation parfois au détriment, à court terme, de la croissance
?
Les incertitudes sur le NAIRU, dans sa version la plus empirique ont, en effet,
soulevé beaucoup de scepticisme et d'insatisfaction. De plus, en Europe
le dilemme inflation- chômage ne peut-être abordé sous le
même angle de vue qu'aux Etats-Unis. La concomitance d'une basse
inflation et d'un chômage élevé et persistant a ouvert de
nouveaux axes d'analyse (la stationnarité du taux de chômage
américain étant souvent opposée à la croissance
continue du taux européen). Outre les développements importants
réalisés sur les causes de la persistance du chômage en
Europe, les analyses intégrant les fondements micro-économiques
du marché du travail ont été en pleine expansion dans les
années 1990 (théorie des négociations, du salaire
d'efficience, "insiders-outsiders") et ont conduit à redéfinir un
taux de chômage d'équilibre dans lequel les facteurs structurels
du marché du travail ont un rôle à jouer. Ainsi, cette
approche est pertinente pour analyser les chocs structurels (ou chocs d'offre)
ce qui n'est pas le cas des méthodes empiriques basées
essentiellement sur les fluctuations des salaires ou des prix (telles que la
courbe de Phillips traditionnelle qui lie les variations nominales de salaires
ou de prix au taux de chômage).
Partant des modèles de négociations anglo-saxons (Layard R.,
Nickell S., Jackman R. (1991)), ces approches cherchent à définir
le niveau d'équilibre du chômage en croisant deux relations
structurelles se rapportant l'une à la formation des prix (position de
la firme), l'autre à celle des salaires (position des salariés).
Le salaire, ainsi défini, l'est en niveau et non plus en variation comme
dans la courbe de Phillips. La détermination des salaires est
dépendante d'un ensemble de facteurs structurels et institutionnels
parmi lesquels la fiscalité et toutes sortes de
prélèvements pesant sur le travail ont une place
indéniable (en France, notamment, les cotisations sociales). Un
" coin social ou salarial " est alors déterminé comme
l'écart entre le coût du travail pesant sur l'entreprise et le
salaire net perçu par le salarié. Son augmentation provoque celle
du taux de chômage d'équilibre. Mais d'autres variables peuvent
également intervenir telles que le salaire minimum, les revenus de
remplacement (prestations chômage) ou encore les termes de
l'échange sur le marché intérieur et les taux
d'intérêt réels.
Des estimations réalisées sur données françaises
(L'Horty Y. et Sobczak N. (1997)) conduisaient en 1996 à estimer le taux
de chômage d'équilibre à plus de 10% ce qui le situait
au-dessus des estimations faites couramment sur le NAIRU aux alentours de 8%.
Divers enseignements peuvent être tirés de ces évaluations :
- Le coin salarial a un rôle déterminant dans l'accroissement du
taux de chômage d'équilibre, leur corrélation étant
positive. Mais, par ailleurs, le ralentissement des gains de
productivité contribue aussi à la montée du chômage
d'équilibre.
- Si, dans une perspective de moyen-long terme dépassant
l'équilibre partiel sur le seul marché du travail, le
comportement d'accumulation du capital par les entreprises est pris en
considération, alors les taux d'intérêt réels qui
pèsent sur le coût du capital contribuent, en s'accroissant,
à la hausse du taux de chômage d'équilibre (ce qui est en
adéquation avec les faits stylisés des années 1980 mais
qui le sera moins à l'avenir avec des taux d'intérêt
nominaux et une inflation stabilisés).
Ces résultats sont importants car ils suggèrent que l'état
actuel du marché du travail en France n'est pas si éloigné
de ce seuil. Par conséquent, bien qu'il existe une marge de baisse du
chômage qui pourraît provenir d'une relance de la demande
4(
*
)
, il serait inévitable
d'améliorer les conditions de l'offre pour voir se résorber plus
radicalement le chômage. Les politiques visant à réduire le
coût du travail à travers une baisse des cotisations sociales
patronales, en diminuant le coin fiscal, agiraient donc dans ce sens. A ce
niveau, il devient indispensable de raisonner en fonction de la structure du
marché du travail. Il est clair qu'en France et dans d'autres pays
européens (Belgique, Pays-Bas...) le taux de chômage des non
qualifiés est particulièrement important ce qui justifie d'autant
plus des politiques agissant sur le coût du travail de cette
catégorie de la population active, laquelle présente un "coin
salarial" relativement plus élevé que la moyenne. Ces
caractéristiques font partie des fortes divergences entre les situations
des marchés du travail américain et européen. La politique
de baisse de la durée du travail, si elle provoque un choc de
productivité positif, peut aussi avoir une contribution du même
type.
1.2.2. Croissance potentielle et perspectives de croissance à
moyen terme
La croissance potentielle constitue une référence dans toute
analyse portant sur le moyen-long terme puisqu'elle correspondrait à
l'utilisation des facteurs de production compatible avec une inflation stable.
Seules les contraintes d'offre sur l'emploi et le capital subsisteraient par
opposition aux contraintes de demande.
Avant d'aborder les évaluations empiriques de la croissance potentielle
dans la zone euro, il faut rappeler l'importance de son utilisation en
politique économique. En effet, la croissance potentielle guide
l'analyse de moyen terme en fournissant une référence
quantitative sur la tendance, le "sentier de croissance" qu'emprunte
l'économie mais, elle est aussi très présente dans les
analyses des fluctuations cycliques qui sont supposées se faire autour
de cette croissance potentielle (ou tendancielle). Ce sont alors les
écarts à ce " sentier de croissance " qui fondent les
appréciations sur les risques de " surchauffe " de
l'économie et ce qu'ils impliquent en matière d'inflation.
L'utilisation de cette référence en politique monétaire a
été vulgarisée par la " Règle de Taylor "
qui, outre l'écart à une cible d'inflation
déterminée par les autorités monétaires,
intègre clairement l'écart à la croissance potentielle
(output gap).
Cette distinction entre composante structurelle et composante conjoncturelle
constitue le coeur des analyses visant à évaluer les niveaux
"potentiels" de l'économie. Ainsi, elle s'applique plus largement
qu'à la seule croissance. Il devient courant de l'utiliser pour
distinguer au sein du taux de chômage celui qui peut-être
résorbé par un choc positif de demande (chômage
conjoncturel) et celui qui ne peut l'être que par un relâchement
des contraintes d'offre (chômage structurel). Elle est, aussi, à
la base de l'évaluation des déficits " structurels " et
de leurs compléments, les déficits " conjoncturels " et
a, ainsi, alimenté les débats sur l'assainissement
budgétaire en Europe et sur son acheminement vers l'UEM.
De nombreuses limites théoriques fragilisent néanmoins le concept
de croissance potentielle et les diverses approches méthodologiques
permettant de l'évaluer ont des performances très
discutées (CEPII (1997)). Ces méthodes peuvent être
sommairement classées en deux catégories ; celles faisant
référence à une fonction de production; celles plus
empiriques qui permettent d'extraire la tendance de moyen-long terme (ici, les
techniques sont variées mais la plus répandue est l'application
du filtre de Hodrick-Prescott (H-P)).
Nous proposons ici des évaluations réalisées à
partir des deux méthodes :
- d'une part, une application du filtre H-P aux PIB des principaux pays
européens et à celui des Etats-Unis de même qu'une
estimation pour la zone euro dans son ensemble. La période couverte
débute en 1980 et s'achève en 1997 ;
- d'autre part, des évaluations obtenues à partir de fonctions
de production relatives aux différentes économies nationales
détaillées ci-dessus, se rapportant à la même
période. Dans ce cas, l'estimation pour la zone euro est beaucoup plus
délicate car la pertinence d'une fonction de production et d'un NAIRU
communs à la zone est très discutable.
Fonction de production et emploi potentiel
La
fonction de production considérée est du type Cobb-Douglas
à deux facteurs, capital et travail, à rendements constants et
progrès technique neutre :
Log Y= a x Log(E) +(1-a) x log(K)+ trend avec
- Y : la production
- E : l'emploi
- K : le stock de capital
Le
stock
de capital K
est déterminé à partir des flux
d'investissement matériel (I) et d'un taux de dépréciation
du stock existant (d). Il s'écrit par conséquent:
K= (1-d) x K(t-1) + I(t)
Le coefficient
a
représente la part du travail dans le PIB et par
déduction (1-a), la part du capital. Ces coefficients correspondent aux
valeurs comptables des parts occupées par le capital et le travail dans
le PIB ( cette approche comptable est critiquable mais pragmatique).
Le
trend
introduit dans l'équation est un proxy du progrès
technique.
A partir
de cette spécification, le niveau potentiel de la production
Y
*
est défini en considérant le niveau d'emploi potentiel E* et en
supposant que, sur un sentier de croissance équilibrée, la
croissance du capital suive celle de la production potentielle.
L'emploi potentiel E*
est défini au niveau du NAIRU tel que :
E*= ((1-NAIRU)/100) x L
où L est l'offre de travail résultant de l'application du taux de
participation à la population active totale.
Ainsi, la croissance de l'emploi potentiel dépend de l'évolution
de ces trois déterminants, le NAIRU, la population active et le taux de
participation.
L'approche par une fonction de production est, d'un point de vue
théorique, plus satisfaisante, mais elle n'est pas exempte de
contraintes lesquelles, in fine, peuvent affaiblir sa pertinence. Ainsi,
l'évaluation du stock de capital et de sa dépréciation
sont délicates. De même, l'estimation de l'évolution de la
productivité soulève différents problèmes. Dans ce
cas, le caractère exogène du progrès technique est
entériné par la théorie standard de la croissance et la
tendance de la productivité des facteurs se trouve résumée
dans un terme n'intégrant aucun facteur structurel (le
" résidu de Solow "). Ce cadre standard échoue,
cependant, à expliquer la rupture de la productivité
observée au cours des années 1970 dans la plupart des pays de
l'OCDE. Il pourrait s'avérer être encore insuffisant pour analyser
les performances susceptibles d'émerger de la diffusion des nouvelles
technologies de l'information.
La croissance potentielle estimée à partir de cette structure
théorique est alors fortement dépendante des évaluations
portant sur l'emploi potentiel et, tout particulièrement, sur le taux de
chômage non inflationniste (NAIRU). Or, le concept et le calcul du NAIRU
sont, on l'a noté ci-dessus, sujets à débat et font encore
l'objet aujourd'hui de nombreuses recherches. Par ailleurs, plus la part de la
masse salariale est importante, plus les erreurs commises sur le NAIRU
engendrent des défauts d'estimation sur la croissance potentielle.
Les
évaluations du NAIRU : Courbe de Phillips traditionnelle
et
introduction des effets de persistance
D'un
point de vue empirique, il est cependant courant d'évaluer ce ratio
à partir de l'acception courante de base selon laquelle une
accélération des prix (ou des salaires) se produit dès
lors que le taux de chômage dépasse son niveau d'équilibre
ce qui peut se résumer par :
p = L (p) - A x (U-NAIRU)
avec p : taux d'inflation et L (p), valeurs retardées de p
Cette formulation peut être complétée pour tenir compte des
effets de " persistance " laquelle est largement admise comme une
caractéristique du chômage européen. On introduit alors un
terme qui résume les niveaux de chômage passés (LU) dans
l'équation précédente. C'est l'écart entre cette
variable LU et le taux observé qui intervient dans la
détermination des variations de prix. Le NAIRU est alors une combinaison
linéaire de cette variable traduisant les niveaux de chômage
passés et du taux de chômage d'équilibre issu de
l'estimation d'une courbe de Phillips traditionnelle (noté UP).
Dès lors, le seuil de déclenchement de tensions inflationnistes
se situe à un niveau supérieur à celui qui serait
défini sans l'intégration d'effets de persistance. Soit :
p = L (p) - A
x (U-UP) - B
x (U-LU)
et NAIRU = (A/(A+B)) x UP + (B/(A+B)) x LU
Tableau 2
Evaluations de la croissance potentielle et du NAIRU dans la zone euro et aux
Etats Unis
Croissance tendancielle (1), Croissance potentielle (2)
et NAIRU
associés
variations annuelles (en %)
|
|
FRANCE |
ALLEMAGNE |
ITALIE |
USA |
ZONE EURO |
||||||||||
|
|
1 |
2 |
NAIRU |
1 |
2 |
NAIRU |
1 |
2 |
NAIRU |
1 |
2 |
NAIRU |
1 |
||
|
1980-1985 |
1,8 |
2,0 |
8,8 |
1,4 |
1,7 |
7,2 |
2,1 |
2,2 |
9,2 |
3,2 |
2,7 |
8,0 |
1,7 |
||
|
1986-1990 |
2,7 |
2,4 |
9,0 |
3,3 |
2,6 |
7,1 |
2,6 |
2,7 |
10,8 |
2,8 |
2,8 |
6,1 |
3,0 |
||
|
1991-1995 |
1,5 |
1,8 |
9,0 |
2,2 |
2,3 |
7,9 |
1,2 |
1,5 |
10,5 |
2,3 |
1,9 |
6,3 |
1,8 |
||
|
1996 |
1,9 |
1,8 |
9,0 |
1,6 |
1,4 |
8,0 |
1,4 |
2,4 |
10,2 |
3,2 |
2,5 |
5,7 |
1,8 |
||
|
1997 |
2,1 |
2,2 |
9,0 |
1,7 |
1,0 |
8,3 |
1,4 |
2,2 |
10,2 |
3,4 |
3,0 |
5,4 |
2,0 |
||







