QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DANS LA ZONE EURO ?
BOURDIN (Joël) ; LEPELTIER (Serge)
RAPPORT D'INFORMATION 466 (98-99) - Délégation du Sénat pour la planification
Table des matières
- I - OUVERTURE DU COLLOQUE
- II - Démographie, technologie et croissance en Europe : pistes de réflexion
- III - Croissance, inflation et emploi dans la zone euro : réflexions sur le sentier de croissance européenne à moyen terme
- IV - QUELLES POLITIQUES ÉCONOMIQUES EN EUROPE ? UNE MISE EN PERSPECTIVE DES POINTS DE VUE NATIONAUX
- V - DISCUSSION
- ANNEXE
- Sources : COE et OEF
N°
466
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation du Sénat pour la planification (1) sur le colloque organisé le 16 juin 1999, sur les perspectives de croissance dans la zone euro .
Par MM.
Joël BOURDIN et Serge LEPELTIER,
Sénateurs.
(1) Cette délégation est composée de : MM. Joël Bourdin, président ; Serge Lepeltier, Marcel Lesbros, Georges Mouly, Jean-Pierre Plancade, vice-présidents ; Roger Husson, Mme Odette Terrade, s ecrétaires ; M. Pierre André, Mme Janine Bardou, MM. Michel Charzat, Patrick Lassourd, Henri Le Breton, Daniel Percheron, Roger Rinchet, Alain Vasselle.
Union européenne.
PRÉSENTATION
Depuis
1984, la Délégation pour la planification propose chaque
année aux membres de la Haute Assemblée de consacrer quelques
heures à la présentation et la discussion de travaux
réalisés par les organismes d'analyse et de prévision avec
lesquels le Service des Etudes du Sénat collabore
régulièrement.
Cette réunion veut être un lieu d'information et de
réflexion. En prenant ainsi l'initiative d'une rencontre entre
experts
et
sénateurs
, la Délégation pour la
planification s'attache à remplir sa mission prospective dans le domaine
économique.
Traditionnellement, ce Colloque s'appuie sur la présentation d'une
projection de l'économie mondiale réalisée à l'aide
du modèle multinational MIMOSA. Les contraintes techniques d'adaptation
et de révision qui s'imposent périodiquement à ce type
d'outil ont rendu impossible, cette année, la présentation d'un
exercice de cette nature, dont la valeur prédictive est certes, par
nature, limitée, mais qui permet d'illustrer et de discuter les options
de politique économique à partir d'un cadre global
cohérent.
Néanmoins, dans le souci de continuer à alimenter la
réflexion sur les
perspectives à moyen terme de
l'économie européenne
, votre Délégation a
commandé, au Centre d'Observation Economique (COE) de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Paris, une étude sur
le sentier de
croissance à moyen terme dans la zone euro
. La
première
partie
du Colloque organisé le 16 juin 1999 a ainsi
été consacrée à la présentation de cette
étude, dont la version finale figure en
annexe
à ce
rapport.
Au cours de la
seconde partie
, les représentants des instituts
d'analyse et de prévision économiques des quatre plus grands pays
européens (le National Institute for Economic and Social Research
-NIESR- pour le Royaume-Uni, le Deutsche Institut Für Wirtschaftforschung
-DIW- pour l'Allemagne, le PROMETEIA pour l'Italie et l'Observatoire
français des conjonctures économiques -OFCE- pour la France) ont
présenté les conclusions de leurs réflexions sur
l'
orientation des politiques économiques en Europe
, à
partir d'une
mise en perspective des points de vue nationaux
.
I - OUVERTURE DU COLLOQUE
-
•
M. Serge LEPELTIER, Vice-Président de la
Délégation pour la Planification
Mesdames, Messieurs, Mes chers collègues,
Je suis heureux de saluer un certain nombre de Sénateurs, et notamment le Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense qui nous fait le plaisir d'être parmi nous.
Notre collègue Joël BOURDIN, Président de la Délégation pour la Planification, qui a préparé et organisé ce colloque, nous rejoindra dans le courant de cet après-midi. Il présente actuellement au ministère de l'Intérieur son rapport annuel au nom de l'Observatoire des Finances locales, rapport dont la présentation était prévue ce matin mais qui a dû être décalée. Je vous prie de bien vouloir l'excuser.
Il m'a demandé, en tant que Vice-président de la Délégation, d'ouvrir ce colloque sans l'attendre. C'est donc en son nom que je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue.
Avant que nous débutions nos travaux, je voudrais rappeler en quelques mots l'esprit de ce colloque annuel, dont la tradition est désormais bien établie. Pour ma part, appartenant à cette Assemblée depuis le mois de septembre, j'y participe pour la première fois.
Cette réunion se veut d'abord un lieu d'information et de réflexion. En prenant l'initiative d'une réunion entre parlementaires et experts, ceux assis autour de moi ou ceux présents dans la salle, la Délégation s'attache à tenir le rôle d'information qui lui est confié et à contribuer à animer le débat public.
Pour que le dialogue entre Sénateurs et économistes soit fructueux, il est souhaitable qu'une grande liberté d'expression soit garantie, mais aussi que les économistes prennent le soin de mettre leurs propos à la portée des non-spécialistes. Mais il me semble que vous vous y efforcez et que vous le faites bien. Il est vrai que les bonnes choses s'expriment le plus souvent clairement.
La visée de nos travaux d'aujourd'hui se passe dans un cadre européen, pas forcément lié aux élections européennes du week-end dernier, mais dont l'objectif est délibérément européen. En témoigne la présence à cette table de représentants de trois grands instituts d'analyse économique européens que je remercie très chaleureusement d'avoir bien voulu participer à cette manifestation et de nous aider ainsi à enrichir notre réflexion.
Le thème de notre après-midi, " Quelles perspectives de croissance dans la zone euro ? ", nous fera aborder des questions qui l'ont peu été au cours des dernières semaines, mais qui sont pourtant au coeur des questions économiques se posant à l'ensemble de nos pays et de l'Union Européenne.
L'euro est un fait, même si nous n'avons pas encore dans notre vie courante le papier qui nous en donnerait la démonstration. Le fonctionnement monétaire et économique est là, même si parfois la population ne s'en rend pas compte.
Quelqu'un, lors d'un voyage en Pologne il y a quelques semaines, me demandait : " L'euro monte ou descend par rapport au franc ? ". J'ai essayé d'expliquer que tout cela était fixé, que ça ne bougerait plus et que nous ne pouvions parler de l'évolution de l'euro que par rapport au dollar. Ce qui montre que tout n'est pas forcément complètement acté, et ce ne le sera pas dans les esprits tant que nous n'aurons pas ces fameux billets.
Peut-on d'ores et déjà mesurer l'impact de la mise en place de l'euro ? Si oui, la croissance en a-t-elle été favorisée ou pas depuis quelques mois ?
Une des grandes questions à se poser est la suivante : une politique économique nationale a-t-elle encore un sens ? N'est-elle pas un concept un peu hors du temps ?
Pouvons-nous encore, aujourd'hui, avoir une véritable politique économique dans le cadre européen ?
Voilà un certain nombre de questions auxquelles nous aurons à répondre et que les experts vont essayer d'éclairer.
Comme le prévoit l'ordre du jour, je vais donner la parole à Mme Michèle DEBONNEUIL, chef du Service Economique du Commissariat général du Plan, sur le thème " Démographie, technologie et croissance en Europe ". Non sans lui avoir exprimé notre reconnaissance pour avoir accepté de relever le défi consistant à aborder la question de la croissance européenne à moyen ou long terme par des chemins sur lesquels, à ma connaissance, peu d'économistes se sont engagés jusqu'à présent.
Merci à toutes et à tous d'être nombreux à cette réunion qui, j'en suis certain, sera fructueuse.
-
• Mme Michèle DEBONNEUIL , Chef du Service Economique du Commissariat général du Plan .
Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs, lorsque nous essayons de faire des prévisions au-delà de cinq ans et lorsque les modèles macro-économétriques ne nous donnent plus les résultats mécaniquement, les économistes ont l'habitude de se référer à une méthode simple. Celle-ci consiste à partir de la croissance de la population active et à y ajouter la croissance de la productivité apparente du travail. C'est ainsi que nous obtenons, de la façon la plus simple possible et la plus robuste sur le futur, la croissance de la production d'un pays.
Cette méthode simple pose quelques problèmes, particulièrement pour prévoir la croissance en Europe dans les prochaines décennies.
Le caractère simple de cette méthode est extrêmement critiquable dans la mesure où nous voyons que cette productivité apparente du travail est quelque chose que nous essayons de prendre comme tendancielle en fermant les yeux comme si nous pouvions supposer, comme par miracle, que les évolutions enregistrées dans le passé pourraient se prolonger dans le futur.
Il est clair que cette variable est endogène, qu'il faudrait ouvrir la boîte à la productivité apparente pour voir ce qu'il y a dedans. C'est un peu ce que nous allons essayer de faire maintenant.
Déjà, il y a deux termes dans cette prévision de la croissance : la croissance de la population active et la croissance de la productivité apparente du travail.
Prenons d'abord la croissance de la population active qui déjà, en elle-même, pose un problème alors qu'habituellement nous estimons que les démographes savent nous donner des prévisions, que c'est finalement ce que l'on sait le mieux prévoir. C'est d'ailleurs pour cela que nous partons de cette variable, avec l'idée que nous nous sommes débarrassés de la croissance du capital qui nous pose souvent des problèmes et que, nous concentrant uniquement sur la croissance démographique, nous allons pouvoir avoir quelque chose d'assez assuré.
En réalité, le choc démographique va en effet réduire la croissance de la population active, d'abord, puis la population active, ensuite. Nous savons que cette évolution va induire éventuellement des déplacements de l'âge des départs à la retraite de ce que nous appelons les actifs.
A ce niveau-là, nous avons une difficulté, à partir des prévisions des démographes, pour passer à une prévision de la population active.
En effet, nous savons bien qu'une partie de la population active, aujourd'hui, n'est pas au travail, et de loin malheureusement. Il va donc falloir intégrer l'évolution du chômage.
Nous savons également que les taux d'activité sont perturbés par ce chômage important. Si par hasard le taux de chômage venait à se réduire, le taux d'activité viendrait lui-même à bouger.
Cette prévision de la croissance de la population active soulève nombre de questions auxquelles il n'est pas si simple de répondre. Un premier ingrédient de la croissance potentielle que nous essayons d'estimer est déjà là, plein d'un certain nombre d'aléas.
Passons à la productivité apparente du travail, encore beaucoup plus compliquée, du moins conceptuellement. Si nous nous référons au vieillissement démographique, nous comprenons que l'on souhaite avoir une croissance plus forte de la productivité apparente du travail. Etant moins nombreux à travailler, nous souhaiterions que chaque actif soit plus productif pour nourrir une population qui, vivant plus longtemps, sera plus nombreuse à être en inactivité.
De ce côté-là, nous attendrions une accélération de la productivité apparente du travail. Il semblerait que cela soit plus intéressant pour tout le monde.
Par ailleurs, si nous regardons le modèle américain - ce qu'aujourd'hui nous savons faire de mieux -, c'est-à-dire une économie au plein emploi croissant vite, nous voyons une productivité apparente du travail qui croît beaucoup plus faiblement qu'en France.
Nous nous demandons : où allons-nous ? Quelle est cette contradiction entre une productivité apparente que nous voudrions voir monter pour des raisons démographiques mais qui semble devoir ralentir, puisque nous connaissons en France une évolution de la productivité apparente du travail plus forte qu'aux Etats-Unis ?
Nous allons essayer d'éclairer cette contradiction.
Si nous regardons ce qui se passe aux Etats-Unis par rapport à l'Europe, nous avons l'impression qu'il y a un arbitrage entre la croissance de l'emploi et la croissance de la productivité apparente du travail.
Prenons des chiffres : en France comme en Europe, notre productivité apparente du travail est d'environ 2 % par an. Cela signifie que, même si le nombre d'actifs ne croît pas, la production va croître au rythme de 2 % par an.
Avec cette croissance de la productivité apparente du travail relativement forte, nous avons des créations d'emploi faibles, de telle sorte que nous pouvons décomposer notre croissance tendancielle sur les années passées entre une croissance des emplois faible et une croissance de la productivité apparente du travail de 2 %.
En revanche, aux Etats-Unis, la productivité apparente du travail progresse plus lentement : de 1 % au lieu de 2 % en France, mais l'emploi progresse de 1,5 % au lieu de 0 %.
Il faut donc choisir : soit la croissance de la productivité apparente du travail est plus forte mais l'emploi plus faible, et donc la croissance plus faible et le sous-emploi plus important ; soit la productivité apparente du travail est plus faible et l'emploi plus élevé.
En réalité, il faut un peu ouvrir la boîte à la productivité du travail, qui est finalement un concept trop synthétique pour que l'on puisse en déduire un enseignement intéressant à ce stade.
Comment l'évolution de la productivité du travail se " fabrique-t-elle " à partir des différents secteurs ? On aboutit à un constat tout à fait satisfaisant du point de vue intellectuel : une croissance forte de la productivité apparente du travail dans un certain nombre de secteurs dans lesquels il y a du progrès technique.
A l'intérieur de ceux-ci, il y a deux sous-catégories :
- les nouveaux secteurs à fort potentiel de croissance : typiquement l'informatique ou d'autres secteurs de nouvelles technologies. Ces derniers ont la double caractéristique extrêmement intéressante d'avoir à la fois une forte productivité apparente du travail et de fortes créations d'emploi, mais ils sont peu nombreux ;
- les secteurs qui connaissent aussi une forte croissance de la productivité du travail, mais au prix d'une progression de l'emploi très faible, voire négative puisque c'est précisément une des façons d'améliorer cette productivité que d'ajuster les emplois en automatisant, fusionnant, rationalisant, etc.
Coexistent donc, d'un côté des secteurs à croissance de productivité forte et, de l'autre, un secteur difficile à cerner mais que nous pouvons qualifier de service à la personne. Il semble être une sorte de déversoir pour les autres secteurs dans lequel l'emploi très peu qualifié croît très vite, et qui sont des secteurs dont le niveau de productivité est extrêmement faible.
La dynamique est ainsi assez simple à comprendre, avec :
- des secteurs qui tirent la croissance grâce à une forte progression de la productivité du travail, et d'importantes créations d'emploi ;
- des secteurs matures maintenant une forte croissance de la productivité du travail, mais au prix d'ajustements de l'emploi.
Si les secteurs dynamiques pouvant accueillir les salariés éjectés des secteurs matures sont insuffisants, ceux-ci seront récupérés dans un secteur non organisé où les gens se retrouvent avec leurs mains pour travailler et où la productivité est extrêmement faible.
Lorsque ce secteur existe, il assure le plein emploi et, au niveau global, il pèse sur la croissance de la productivité apparente du travail, puisque ce sont des secteurs dont la productivité est très faible.
A regarder les choses de cette manière, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de " paradoxe de la productivité " aux Etats-Unis. Il est vrai que le progrès technique va de pair avec une croissance de la productivité apparente du travail et de fortes créations d'emploi, mais il n'y a pas que des secteurs à fort progrès technique. Il y a des secteurs matures et surtout ce secteur qui récupère tout ceux que les autres éjectent et qui n'est pas récupéré dans les secteurs très dynamiques.
Plus il y aura de secteurs à fort potentiel, plus le risque d'excès de travailleurs qui vont être renvoyés dans des secteurs à faible productivité sera faible et plus la probabilité - pour que globalement la croissance de la productivité apparente du travail soit forte - est grande.
Nous voyons que toute la difficulté va être, dans les économies européennes, d'avoir suffisamment de secteurs à fort potentiel par rapport à des secteurs matures, pour éviter d'évacuer trop de gens de ce secteur informel des services à la personne.
Je ne rappelle pas évidement qu'en France, où nous ne voulons pas laisser naître ce secteur dans les conditions de précarité où il s'est installé aux Etats-Unis, au lieu d'avoir le plein emploi et un secteur à faible productivité, nous n'avons ni l'un ni l'autre. La croissance de la productivité apparente du travail y est donc plus forte pour l'ensemble de l'économie, dans la mesure où elle n'est pas laminée par l'effet de structure de ce secteur à faible productivité des services à la personne.
Que risque-t-il de se passer en Europe ?
Actuellement, d'une certaine manière, l'Europe essaye de rattraper le modèle américain. Elle s'efforce d'enrichir le contenu en emplois de la croissance, de faire en sorte que ces salariés ne trouvant pas de travail puissent en trouver avec des salaires plus faibles dans des secteurs à productivité plus faible.
Du côté du vieillissement, de bonnes raisons nous font penser qu'il y a là des éléments favorables à l'augmentation de la croissance de la productivité.
D'une part, le vieillissement va ralentir la demande de travail, rétrécir le champ des personnes demandant à travailler. C'est un élément important pour réduire la croissance des emplois faiblement productifs.
Comme le vieillissement entraîne plus d'épargne et d'investissement pour préparer la période d'inactivité, ceci devrait faire monter l'intensité capitalistique et, de fait, avoir une contribution positive sur la croissance de la productivité apparente du travail.
Surtout, il est intéressant de se demander quels sont les secteurs à fort potentiel sur lesquels nous allons pouvoir compter.
L'informatique, c'est une évidence. Le Gouvernement a d'ailleurs fait des efforts pour essayer d'inciter la demande afin que l'investissement se dirige vers le secteur des nouvelles technologies.
Nous pouvons imaginer que dans quelques années nous allons imiter les Etats-Unis et avoir un investissement très productif et très porteur d'emplois dans ces secteurs à fort potentiel.
Une question semble intéressante : ce secteur des services à la personne, apparaissant aujourd'hui comme un secteur d'ajustement de l'emploi, ne pourrait-il pas être organisé de façon à être à la fois porteur de beaucoup plus de progrès de productivité et en même temps très créateur d'emplois ?
Si nous faisions des progrès techniques permettant d'abaisser le prix de ces services, comme à une époque nous avons pu abaisser le prix de l'automobile et déployer ainsi une forte demande et donc créer de nombreux emplois, ce secteur des services ne pourrait-il pas constituer un gisement d'emplois important, tout en n'ayant pas cet inconvénient décisif d'avoir une productivité qui n'augmente que faiblement ?
Si cela était possible, il serait très intéressant que ce secteur puisse avoir une croissance de la productivité organisée, des progrès technologiques permettant de bénéficier non seulement de fortes créations d'emploi mais aussi d'un peu plus de croissance de la productivité.
Quel peut être le rôle de l'Etat dans la croissance future ?
Tout le monde est d'accord pour dire que l'Etat doit se désengager, qu'il ne doit plus avoir le même rôle en matière de politique industrielle. Il ne s'agit plus que l'Etat soit actionnaire des grandes entreprises, il faut qu'il organise la réglementation de manière que la flexibilité soit adaptée. Tout cela est assez partagé.
Il me semble qu'un rôle important de l'Etat consiste à vérifier, à essayer d'accompagner l'émergence suffisante de secteurs à fort potentiel, de façon à ne pas être obligé d'accepter qu'un certain nombre de salariés n'arrivant pas à s'insérer dans ces secteurs productifs soient relégués dans des secteurs à trop faible productivité.
Effectivement, la question qui se pose est : saurons-nous retrouver le plein emploi sans trop ralentir la productivité apparente du travail ?
Aujourd'hui, les Etats-Unis, ayant le plein emploi mais une croissance de la productivité du travail très faible, marient des secteurs dans lesquels des salariés bénéficient de gains de productivité - et donc de salaires - extrêmement forts, et d'autres, au contraire, où ne progressent que faiblement productivité et salaires.
Le défi, c'est d'arriver à obtenir le plein emploi avec une plus forte croissance de la productivité. Parvenir à une situation dans laquelle nous arriverions en Europe à avoir un secteur des services à la personne où la productivité apparente du travail serait un peu plus élevée, serait peut-être une solution optimale.
Pour conclure, j'insisterai sur la complexité de cette notion de productivité. Nous n'avons pas une situation homogène d'un secteur à l'autre, mais au contraire une mosaïque de secteurs dans des états de maturité différents. Certains sont très dynamiques en début de cycle de produits, d'autres dans des situations archaïques de production.
Tout va dépendre de la façon dont nous allons savoir tirer l'offre et la demande vers une situation dans laquelle nous aurons le plus possible de secteurs à forte croissance de la productivité et à forte croissance de l'emploi, et minimiser le poids des secteurs dans lesquels nous avons de fortes créations d'emploi et des gains de productivité faibles.
Ceci est très difficile puisque, jusqu'à présent, la seule chose que savent faire les pays en situation de plein emploi, est de laisser le reliquat se porter sur des secteurs à faible productivité.
Plus que jamais, l'avenir n'est pas dans les modèles, la croissance de l'Europe sera ce que nous la ferons.
M. Serge LEPELTIER, Président.- Merci beaucoup surtout sur cette conclusion. Les éléments que vous avez fournis sont très importants. Pour essayer de comprendre cette différence entre les Etats-Unis et l'Europe, pour parler largement, les élus se posent quelquefois la question de savoir comment faire en sorte que toutes les personnes sans aucune qualification ni moindre diplôme puissent trouver, sinon un emploi, du moins une activité.
Il vaudrait mieux que cela soit un emploi, mais il faut que cet emploi ait une justification économique. C'est également une des questions.
Je constate souvent que nous sommes capables de mettre en place ces services à la personne, mais encore faut-il que les personnes qui souhaitent y recourir veuillent ou puissent les payer ou que le système se mette en place pour les payer. Il faut bien à un moment donné une justification économique. Cela serait trop simple et ramènerait un trop grand nombre de charges potentielles à terme pour le système social.
-
•
M. Christian de BOISSIEU, Directeur scientifique au Centre
d'Observation Economique (COE) de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Paris.
Messieurs les Présidents, Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs, merci de votre accueil. Nous allons nous partager le travail avec Mme MARCHESI.
En quelques mots, je vais introduire la présentation. Ensuite Mme MARCHESI reprendra le flambeau et je le reprendrai dans la seconde partie.
Sans transition, je vais m'inscrire dans le prolongement de ce que vient de dire Mme DEBONNEUIL. Il faudra que nous en parlions ensemble autour de cette table : l'avenir n'est pas aux modèles.
C'est une expression un peu ambiguë, c'est-à-dire que dans le travail qui vous est présenté, nous sommes partis de l'idée que, quand nous abordons les problèmes de croissance à moyen terme dans la zone euro et en particulier en France, il est un peu facile et peu satisfaisant de prolonger de façon mécanique des modèles construits sur des données passées dans un monde où les comportements sont très instables.
Par exemple, l'événement sur lequel je reviendrai tout à l'heure, l'arrivée de l'euro, est en soi un changement qui a pu provoquer une certaine instabilité des comportements des agents économiques. Ainsi, quand vous faites de la prévision à moyen ou long terme en prolongeant des modèles économétriques testés sur le passé, vous pouvez aboutir à des résultats précis.
Vous pouvez alors dire : à partir d'un certain modèle, la croissance en France sera de 2,8 % mais, d'une certaine façon, vous n'aurez rien dit de plus. L'estimation que vous aurez sera conditionnée par beaucoup d'hypothèses plus ou moins explicites.
Nous nous rejoignons sur la démarche que nous avons adoptée dans la présentation que nous allons faire. Nous n'avons pas voulu faire tourner un modèle de façon mécanique mais présenter une prévision raisonnée sur les perspectives de croissance dans la zone euro à l'horizon de cinq ans.
Pour ce faire, nous avons distingué deux étapes.
La première, qui va être présentée par Mme MARCHESI, consiste à essayer de se projeter sur un certain nombre de variables fondamentales conditionnant la croissance dans la zone euro et en France. Qu'il s'agisse de l'évolution de la croissance potentielle ou de l'évolution du chômage dans ses relations avec ce que l'on appelle le " chômage de plein emploi ". Tout un ensemble d'éléments fondamentaux quand nous cherchons à étudier le régime de croissance et d'inflation, ou plutôt de désinflation.
Quel régime de croissance et de désinflation pour la zone euro et en particulier pour la France dans les cinq ans qui viennent ?
Voila les points sur lesquels nous allons dans un premier temps chercher à apporter des éléments de réponse.
La seconde partie, que je présenterai, sera consacrée aux marges de manoeuvre. Cela rejoint le débat sur ce que peuvent ou doivent faire les politiques économiques dans le contexte que nous allons évoquer.
C'est dans celle-ci que je répondrai à la question que vous avez posée au début, Monsieur le Président. A savoir dans quelle mesure l'arrivée de l'euro a-t-elle déjà ou va-t-elle modifier le sentier de croissance et par-là même les perspectives d'emploi dans la zone euro et en particulier chez nous en France ?
Voilà le menu que nous vous proposons.
• Mme Marie-Claire MARCHESI, responsable de la modélisation au Centre d'Observation Economique (COE) de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris -
Comme M. de BOISSIEU vient de le dire, je vais me concentrer sur la première partie.
Nous avons choisi d'aborder cette réflexion sur les conditions de la croissance future dans la zone euro par un éclaircissement sur les implications que peut avoir l'entrée dans un régime d'inflation basse, qui nous paraît être un fait marquant de cette dernière décennie.
Nous pouvons dire que les performances en matière d'inflation dans les pays industrialisés ont des origines conjoncturelles. Depuis deux ans, nous avons des facteurs conjoncturels évidents tels que la crise asiatique qui a provoqué la baisse des prix importés, une chute importante du prix du pétrole, etc..
Néanmoins, il nous a paru fondamental de ne pas reléguer au second plan les facteurs structurels, en particulier le rôle des politiques économiques dans le cheminement vers cette inflation basse ou quasiment nulle aujourd'hui. Christian de BOISSIEU s'étendra sur les questions de politique économique et de marge de manoeuvre de politique économique. Quant à moi, je me concentrerai sur deux points.
Le premier tentera de préciser le débat qui existe aujourd'hui encore concernant les coûts de l'inflation, malgré les performances atteintes dans le monde industrialisé.
L'inflation a-t-elle encore un coût y compris lorsqu'elle est à des niveaux extrêmement bas ? Ces coûts sont-ils supérieurs au coût d'une politique de désinflation ? Est-on arrivé à la stabilité des prix en Europe ? Est-il possible de poursuivre cette désinflation et de passer d'un taux d'environ 2 % à une inflation strictement nulle, donc à une stabilité des prix ?
Ce débat, amorcé aux Etats-Unis, est arrivé en Europe avec l'arrivée de l'euro et le débat sur le rôle et les objectifs de la Banque Centrale Européenne.
Dans un deuxième temps, j'aborderai les questions de croissance à proprement parler, en me greffant toujours sur la relation entre l'inflation et la croissance et entre l'inflation et le chômage. Il faudra aborder la question du taux de chômage d'équilibre, du " taux de chômage de plein emploi " et relever le fait que l'on a bien atteint des performances en matière de désinflation, maîtrisé le déficit public en Europe mais sans avoir été performants dans la lutte contre le chômage (12 % de taux de chômage actuellement et une croissance trop modérée pour pouvoir résorber le chômage spontanément).
Comme le disait à l'instant Mme DEBONNEUIL, nous sommes tentés, face à cette description un peu sommaire, de dire : " Cela fonctionne bien aux Etats-Unis, ils ont une croissance continue, un taux de chômage extrêmement bas, aucune tension inflationniste n'apparaît ". En rebondissant sur l'exposé de Mme DEBONNEUIL, j'essaierai de fournir quelques éléments de comparaison entre la zone euro et les Etats-Unis.
1. Les coûts de l'inflation et de la désinflation : certains tenants de la thèse de la stabilité des prix défendent à tout prix l'idée qu'une inflation, aussi modérée soit-elle, entraîne toujours des distorsions de prix et dans le comportement des agents. Les comportements ne sont pas optimaux, l'accumulation de la richesse et du capital est finalement défavorisée par rapport à des comportements d'endettement ou autres. Quoiqu'il arrive, une inflation entraîne toujours des pertes de production et donc une distribution entre agents non optimale et peu équitable.
Selon les tenants de cette thèse, ces arguments sont suffisants pour dire : " Nous arrivons à une stabilité des prix. Il vaut mieux en arriver là plutôt que de se contenter d'une stabilité de l'inflation aussi maîtrisée soit-elle . "
Il est clair que la relation entre l'inflation et la croissance est négative, d'autant plus que l'inflation est élevée. Toutefois, dans les études disponibles actuellement, il n'est pas évident de trouver une relation négative entre une inflation basse à un chiffre (en dessous de 10 %), le taux de croissance et le niveau du PIB.
De nombreuses études, concentrées sur les coûts d'une politique de désinflation en termes de croissance et d'emploi, montrent qu'il y a un sacrifice à conduire cette politique de la désinflation en matière de croissance et d'emploi. Ce sacrifice est d'autant plus fort que l'on serait déjà à des niveaux d'inflation basse. Nous pouvons citer à l'appui l'exemple de l'Allemagne dans les années 80 dont le coût de sa politique de désinflation a été plus élevé que pour les autres pays européens en raison d'une inflation déjà basse.
Nous pouvons également citer une étude faite à la Banque de France sur le coût de la politique de désinflation en France dans les années 90, qui nous conduit à dire que ce coût a été plus élevé en France dans les années 90, pour baisser de 2 points le taux d'inflation, que la politique de désinflation conduite dans les années 80.
Pour conclure, je dirais que notre intuition est que lorsque l'on arrive à des niveaux modérés d'inflation, les coûts de poursuite de cette désinflation peuvent être élevés.
En effet, les politiques successives de désinflation laissent des effets sur le taux de chômage. Après un choc négatif de croissance, on ne revient pas au niveau de chômage que l'on avait avant ce choc. Finalement, les coûts de désinflation ne seraient pas seulement transitoires mais pourraient avoir des effets permanents.
Précisément, la persistance du chômage en Europe et le dilemme inflation-chômage qui y persiste est un contraste important par rapport à la situation américaine. Ce dilemme semble avoir disparu aux Etats-Unis où il y a une inflation et un taux de chômage extrêmement bas.
Ce constat sur la croissance américaine a développé un débat outre-Atlantique sur l'apparition éventuelle d'un nouvel âge de l'économie américaine. Deux thèses s'opposent sur l'analyse de la situation américaine aujourd'hui. D'un côté les tenants de la nouvelle économie, du New Age , avancent que le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication serait tel, qu'il tirerait la croissance vers le haut. Nous aurions donc des taux de croissance rapides, avec des productivités élevées comme le disait Mme DEBONNEUIL, et en même temps des prix ne cessant de chuter. Les prix des ordinateurs aux Etats-Unis continuent de baisser à un rythme très élevé.
Cette thèse pourrait expliquer des choses mais elle manque un peu de constat empirique. Elle est un peu affaiblie par le fait que nous ne constatons pas empiriquement tous les progrès de productivité.
A l'opposé de ces tenants de la nouvelle économie, un autre groupe d'économistes dit que la croissance américaine peut être expliquée par les schémas traditionnels. Le bas niveau atteint aujourd'hui par l'inflation aux Etats-Unis s'expliquerait en partie par des chocs ponctuels (baisse des prix de la santé, des ordinateurs...). Mais des choses peu claires demeurent : le taux de chômage est bas, les salaires ont commencé d'accélérer.
Nous avons du mal à nous y retrouver dans les relations que nous avons l'habitude de manipuler et les économistes américains sont revenus sur leurs outils d'analyse traditionnels, parmi lesquels le NAIRU, que l'on peut définir comme le taux de chômage d'équilibre en dessous duquel on ne pourrait pas aller sans tension inflationniste.
Un courant de pensée avance que nous nous sommes un peu trompés sur le niveau de ce taux de chômage, que nous aurions surestimé les risques de surchauffe aux Etats-Unis et les risques inflationnistes. En même temps, nous aurions sous-estimé la croissance potentielle américaine puisque ce taux de chômage d'équilibre est un élément clé pour évaluer la croissance potentielle.
2. J'en viens à la deuxième partie concernant l'évaluation de la croissance potentielle en Europe et aux Etats-Unis. Comme le disait Mme DEBONNEUIL, nous laissons souvent de côté ce qui nous embarrasse dans l'évaluation de la croissance potentielle (le progrès technique, l'évaluation du stock de capital, sa progression), en nous concentrant sur l'élément clé déterminant la croissance potentielle : l'emploi potentiel.
Ce dernier est déterminé par le taux de chômage d'équilibre ou le NAIRU, par la croissance de la population active et par le taux de participation ou, son symétrique, le taux de non-emploi sur le marché du travail.
La comparaison entre l'Europe et les Etats-Unis montre que ces derniers sont avantagés sur ces trois points. Leur taux de chômage d'équilibre est très faible : en dessous de 5 % actuellement alors que pour l'ensemble des pays européens, nous sommes sensiblement à 9 %, voire 10 % en France, en intégrant l'incidence de la fiscalité sur le travail.
La croissance potentielle américaine est avantagée par ce faible taux de chômage d'équilibre mais aussi par la dynamique démographique : aux Etats-Unis, la croissance de la population active est plus rapide qu'en Europe. Le taux de non-emploi est ainsi très faible aux Etats-Unis (environ 25 %), alors que dans la zone euro, nous sommes proches de 45 %.
Dans notre étude, nous avons tenté d'évaluer la croissance potentielle dans la zone euro et aux Etats-Unis. Nous avons utilisé les méthodes statistiques traditionnelles pour obtenir une croissance tendancielle à partir des évolutions passées. Nous arrivons à un contraste saisissant : la croissance potentielle serait d'environ 3 % pour les Etats-Unis et de seulement 2 % pour la zone euro, la France se situant de façon assez favorable avec un taux légèrement au-dessus de celui de la zone euro.
Notre estimation est un peu inférieure à celle proposée par l'Union Européenne qui est voisine de 2,5 %. Si nous faisons des estimations à partir d'une fonction de production, nous sommes dans une fourchette de 2 à 2,5 % pour la zone euro.
Je vais conclure sur d'autres facteurs pouvant nous différencier des Etats-Unis. Michèle DEBONNEUIL s'est étendue sur les questions de productivité de travail. Effectivement, les Etats-Unis ont une productivité apparente du travail très faible.
En s'intéressant à la productivité globale des facteurs et pas seulement à la productivité du travail, nous constatons que l'écart entre la situation américaine et européenne est un peu moins contrasté, les Etats-Unis connaissant en effet une croissance soutenue - par rapport à l'Europe - de la productivité du capital.
Il est vrai que les évaluations sur la productivité du capital sont fragiles. Mais il est clair que les Etats-Unis ont connu, dans une période récente, une croissance de la productivité du capital, une croissance du stock de capital et une croissance du ratio de l'investissement sur le capital. C'est vrai au niveau global, mais également au niveau des nouvelles technologies et du matériel informatique. C'est assez cohérent avec ce que nous observons sur le rythme d'investissement et sur le rapport entre l'investissement et le PIB. Tout cela a un effet favorable pour la croissance américaine.
M. Christian de BOISSIEU.- Si je résume un peu ce que vient de dire Mme MARCHESI, nous pouvons améliorer les choses du point de vue de la croissance mais il n'y a pas de miracle à attendre. Ceux qui en France parlent déjà de l'arrivée possible de ce que l'on appelle aux Etats-Unis la nouvelle économie, le nouvel âge - depuis huit ans, les Etats-Unis n'ont pas été très loin de 4 % de croissance annuelle en moyenne - sont en train de prendre leurs désirs pour des réalités.
En résumant l'esprit du message délivré par Mme Marie-Claire MARCHESI, nous pouvons améliorer les choses mais nous n'allons pas retrouver spontanément un sentier de croissance à 3,5 ou 4 % dans la zone euro et également en France.
Cela pose le problème des marges de manoeuvre du côté des politiques économiques. Puisqu'il n'y a pas de miracle à attendre, pouvons-nous essayer à la marge d'améliorer les choses, d'améliorer le sentier de croissance et donc d'accélérer le recul du chômage ?
Je vais concentrer la partie de ma présentation sur ce problème des marges de manoeuvre, en reliant cela à votre question de tout à l'heure, Monsieur le Président, c'est-à-dire les conséquences de l'euro sur le sentier de croissance, pour les pays de la zone euro et ceux qui viendront nous rejoindre dans les années qui viennent :
Tout d'abord, il faudrait étudier de près les canaux par lesquels l'arrivée de l'euro modifie, ou peut modifier, le sentier de croissance dans nos économies. Il faudrait vraiment distinguer les effets de moyen-long terme et les effets de court terme.
Sans être exhaustif, je donnerai deux exemples de ce que j'appelle les canaux par lesquels l'arrivée de l'euro modifie le sentier de croissance dans nos économies. Tout d'abord, l'euro modifie forcément la manière dont nous faisons de la politique économique et, par ce biais, modifie les marges de manoeuvre.
L'arrivée de l'euro est forcément un peu ambiguë concernant les marges de manoeuvre du côté de la politique économique. D'un côté, sa préparation et son arrivée créent certaines contraintes sur les politiques économiques, je pense aux règles du Pacte de stabilité. Règles indispensables sur le moyen-long terme mais vécues à court terme comme des contraintes par les Gouvernements.
Nous avons de nouveau le problème : nous pourrions essayer de desserrer un peu la contrainte à court terme et la reporter sur le long terme. C'est tout le débat sur la soutenabilité des déficits et de la dette publique.
D'un côté, l'euro donne l'impression de créer des contraintes. Mais, de l'autre, il crée des marges de manoeuvre. Même si le débat aujourd'hui est très vif - surtout depuis un mois entre la Banque Centrale Européenne et les Gouvernements à propos de la politique de change -, mon sentiment est que bon nombre d'arguments permettent de penser que, même si les Européens vont sans doute continuer à accorder plus d'importance au taux de change de l'euro que la réserve fédérale américaine en a accordée - c'est-à-dire pas beaucoup ou pas du tout - depuis des années, le mariage par l'euro fait que le statut du taux de change dans la conduite des politiques économiques est modifié par rapport à ce qu'il était quand chacun de nos pays avait à gérer de manière extrêmement sévère cette contrainte de change.
Vous voyez que la réponse est plus compliquée qu'elle n'en a l'air. J'ajoute que l'euro modifie le sentier de croissance dans nos zones et va le modifier à travers l'accélération des restructurations. Ce sujet me paraît à la fois très important et très difficile à modéliser.
Nous savons que l'accélération des restructurations dans tous les secteurs, et pas seulement dans la banque ou la finance, antérieure à l'euro, est due au phénomène de globalisation et déréglementation. Mais nous savons aussi que l'arrivée de l'euro a ajouté " une couche de peinture " par rapport à ce phénomène, que son anticipation et, maintenant, son existence font que cela a très certainement accéléré les restructurations dans tous les secteurs.
Il est très difficile de modéliser cela. Il faudrait voir dans quelle mesure l'accélération des restructurations, à travers ses effets sur l'innovation industrielle, pourrait avoir une incidence sur l'évolution de la productivité.
La concentration est-elle favorable à l'innovation ? Nous retrouvons le débat de Schumpeter au début du siècle, qui disait que les grandes entreprises innovaient le plus. Mais ce débat reste encore ouvert un siècle après, la liaison entre la taille des entreprises et le rythme des innovations étant assez complexe.
Dès que nous partons sur les pistes de ce que j'appelle les effets micro-économiques de l'euro et pas uniquement son impact macroéconomique, nous débouchons sur des questions peu traitées : les canaux de transmission vers les phénomènes de restructuration, l'impact sur les innovations et donc l'évolution des productivités. Productivité du capital, du travail, nous allons retrouver le début de nos discussions avec les deux exposés précédents.
Ayant dit cela, je voudrais expliquer ce que nous avons cherché à faire à propos du débat sur les marges de manoeuvre dans la zone euro. Pour ce faire, nous sommes revenus vers les modèles (il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. ..). Même s'il ne faut pas aujourd'hui chercher à faire des prévisions précises à cinq ou dix ans, ces modèles sont utiles pour cadrer le raisonnement et permettre des exercices de variantes.
Nous proposons dans notre présentation - et nous retrouvons vraiment le débat sur les marges de manoeuvre - plusieurs variantes que je vais citer dans l'ordre de présentation : une variante de politique monétaire et une de taux de change.
Ensuite, hors variantes, je dirai quelques mots sur le problème du policy mix (combinaison politique monétaire-politique budgétaire dans la zone euro), en terminant par notre dernière variante qui porte sur un aspect des politiques structurelles : en effet, la recherche des marges de manoeuvre n'est pas à trouver uniquement du côté de la monnaie ou du budget pour la plupart des pays européens et en particulier le nôtre, il faut les chercher aussi dans les réformes structurelles.
Quelles sont les marges de manoeuvre associées à la politique monétaire ? Nous avons fait un exercice montrant les conséquences pour les pays de la zone euro, y compris la France, d'une baisse des taux d'intérêt. Exercice fait à partir d'un scénario central : combien gagnons-nous, en variante, de PIB ? De combien pouvons-nous réduire le chômage en faisant baisser le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne de 1 point ?
Voilà le genre d'exercice assez classique que nous présentons à partir du modèle utilisé dans tous ces exercices, le modèle OEF (Oxford Economic Forecasting) qui, à nos yeux, a l'avantage d'être un modèle multinational. Il est clair qu'il nous faut aujourd'hui travailler avec des modèles multinationaux, si possible sectoriels, mais il est parfois difficile de combiner l'aspect international et l'aspect sectoriel.
Ce qui apparaît déjà, c'est quelque chose que nous savons, mais qui rejoint un débat qui me paraît avoir rebondi de manière paradoxale depuis le 1 er janvier. Nous avons beaucoup parlé des problèmes de convergence avant l'arrivée de l'euro et nous n'en avons jamais autant parlé depuis l'existence de l'euro.
Si nous prenons l'euro 11 tel qu'il existe, du point de vue des rythmes de croissance et parfois du point de vue du calendrier des points de retournement, de l'appartenance ou pas aux mêmes cycles ou à des cycles différents, nous nous rendons compte que le débat, que nous considérions comme un débat théorique pour économistes en chambre sur la gestion des " chocs asymétriques ", se pose déjà à nous.
Regardez la façon dont certains pays membres de la zone euro ont mal réagi face à la baisse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne le 8 avril dernier. L'Irlande, qui est en surchauffe, a dit : " Cela ne nous va pas du tout ! " L'Espagne, dont la croissance est encore supérieure à 3 %, essentiellement une croissance de rattrapage, a également contesté cette décision de la Banque Centrale Européenne.
Je pense personnellement que la Banque Centrale Européenne a eu raison de faire ce qu'elle a fait le 8 avril. Les situations asymétriques, spécifiques, comme celles que connaissent certains pays, en écart par rapport à la moyenne, doivent être clairement gérées par les politiques économiques non monétaires, par les politiques budgétaires, salariales, structurelles.
La Banque Centrale Européenne ne peut pas prendre en considération toute la dispersion des situations nationales. Elle est obligée de travailler pour la moyenne, surtout si dans celle-ci figurent les grands pays. Ce ne sera peut-être pas toujours ainsi, mais aujourd'hui c'est à peu près le cas, même si dans les grands pays, l'Allemagne et l'Italie sont un peu à la traîne par rapport à la France au niveau de la croissance.
C'est le débat sur lequel nous reviendrons grâce à Philippe MOUTOT et à d'autres, le débat sur les marges de manoeuvre monétaires.
Le deuxième exercice " variantiel " que nous avons fait, c'est un choc de taux de change. Nous l'avons pris sous l'angle négatif, nous aurions pu le prendre sous l'angle positif. Que se passe-t-il si l'euro s'apprécie de 10 % par rapport au dollar ?
Ce n'est pas ce qui se passe depuis janvier, c'est l'inverse. Mais justement, c'est parce qu'il a baissé depuis janvier que nous sommes aujourd'hui dans un scénario où il risque de remonter au deuxième semestre 1999 pour de nombreuses raisons. Essayer de voir quelles sont les conséquences d'une remontée de l'euro sur les variables macroéconomiques dans l'ensemble de la zone et dans les pays est donc également intéressant.
Quand nous faisons ce genre d'exercice, nous rencontrons très vite les questions d'hétérogénéité dans la zone. Le fait que les spécialisations internationales des onze pays membres ne soient pas les mêmes fait qu'à partir du même choc sur la parité euro-dollar, les conséquences sont différentes, même en ne prenant que la seule zone euro.
Le troisième axe à propos du débat sur les marges de manoeuvre porte sur le policy mix (combinaison de la politique monétaire et de la politique budgétaire). Nous n'avons pas utilisé le modèle OEF pour raisonner là-dessus, c'est plutôt un raisonnement hors modèle.
Je voudrais livrer la réflexion suivante développée dans le papier : la question du policy mix dans la zone euro sera importante. Elle va conditionner l'évolution des taux d'intérêt dans la zone, en particulier les taux d'intérêt à long terme, importants à côté des taux à court terme. La nature du policy mix va également conditionner la crédibilité de l'euro à l'intérieur et vis-à-vis de l'extérieur.
Comme vous le savez, le débat est rendu spécialement délicat du fait que nous avons à coordonner une politique monétaire unique et onze - quinze demain et peut-être vingt après-demain - politiques budgétaires et fiscales.
Derrière tout cela, il y a à la fois un débat économique et institutionnel qui, à mon avis, est ouvert pour les mois qui viennent sur les rôles respectifs du Conseil de l'euro, du Conseil ECOFIN, l'articulation entre ces deux étages de la fusée : qui décide de quoi et jusqu'où va-t-on en matière de surveillance multilatérale des politiques budgétaires dans la zone euro, donc de coordination de nos politiques budgétaires.
Avec, en toile de fond, parce que nous ne pouvons pas trop séparer le budget et la fiscalité, la discussion ouverte sur l'harmonisation fiscale.
Nous ne savons toujours pas, aujourd'hui, si l'on va s'harmoniser par un processus politique (propositions MONTI) ou si, à défaut d'accord politique, l'harmonisation fiscale va se faire par ce qui s'est déjà amorcé : une concurrence fiscale avec ajustement sur le " moins disant ".
Nous sommes là au coeur de l'articulation entre fonctionnel et institutionnel. Pour terminer sur le policy mix , je voudrais dire que j'ai eu le sentiment qu'à un moment donné, nous étions à ce propos dans des situations un peu conflictuelles entre la Banque Centrale Européenne qui existe officiellement depuis le 1er juillet 1998, avant même l'arrivée de l'euro, et les Gouvernements. Il y a eu des hauts et des bas par rapport à ce conflit et mon sentiment aujourd'hui, au mois de juin 1999, est que nous sommes encore dans une situation délicate. Il y a en quelque sorte un dialogue difficile entre l'autorité monétaire européenne et les autorités budgétaires nationales.
Depuis la baisse des taux d'intérêt du 8 avril, il me semble que la balle est clairement dans le camp des Gouvernements. C'est plutôt à ces derniers de montrer leur capacité à réduire les déficits publics. Ce qui s'est passé en Italie est assez inquiétant. C'est aussi aux Gouvernements de montrer leur capacité à engager des réformes structurelles. Il ne s'agit pas uniquement d'un problème franco-français, c'est aussi la question de l'Allemagne, parfois confrontée à des problèmes plus délicats que les nôtres.
Je termine par le dernier exercice de variante que nous avons proposé dans notre contribution. Cette variante porte sur un aspect important des réformes structurelles : la baisse des charges sociales patronales. Pour la zone euro et les principaux pays, nous avons cherché à avoir les conséquences d'une baisse coordonnée des charges sociales patronales dans trois grands pays de la zone euro : France, Allemagne, Italie.
Il est clair que cela a des effets importants et favorables sur la croissance et sur l'emploi. D'autant plus que dans nos schémas, nous avons fait l'hypothèse que la baisse des charges sociales patronales n'était pas financée. Dans ce cas, il faut à peu près quatre ans pour retrouver la situation de départ des finances publiques.
Cela n'est pas réaliste : avec le Pacte de stabilité et la surveillance des marchés financiers, un pays ou une zone ne peuvent pas se permettre d'avoir un dérapage important des finances publiques et sociales pendant un temps aussi long.
Si je fais la liaison entre cette variante réalisée à l'aide d'un modèle et le débat franco-français sur la baisse des charges sociales patronales récemment proposée par le Gouvernement, je fais partie des gens considérant qu'il faudrait financer ex ante cette baisse des charges sociales patronales par une baisse des dépenses publiques.
Si nous finançons la baisse des charges patronales en augmentant d'autres impôts, l'effet sur le PIB et sur l'emploi est limité. Je n'engage que moi en disant que je suis persuadé qu'il aurait été sympathique et sans doute positif que le Gouvernement annonce, par exemple, que 50 % de la réduction des charges sociales patronales allait être financée par une baisse des dépenses. Pas nécessairement des dépenses sociales. Nous sommes sous Maastricht et je ne fais plus de différence entre les dépenses sociales et budgétaires. En termes d'impact sur la croissance et sur l'emploi, un message de ce style eût sans doute été plus efficace.
M. Serge LEPELTIER, Président - Merci beaucoup, vous nous avez ouvert des perspectives de réflexion.
A deux ou trois reprises, vous avez été à la limite du jargon de l'expert. Je préfère l'expression de « combinaison monnaie-budget » à celle de policy mix ».
Sur tous ces sujets et notamment sur le coût de la désinflation, vos conclusions se rapprochaient de cette formule triviale que j'emploie parfois dans des réunions locales : un peu d'inflation met de l'huile dans les rouages, ce qui ne fait pas de mal ; mais quand il y a en trop, cela noie le moteur.
Nous le constatons, c'est presque du bon sens. Les ajustements dont vous parliez, pouvant avoir des conséquences très graves en matière économique lorsque l'on est à 15 % d'inflation, peuvent être nécessaires à un moment donné, et un peu d'inflation permet de les réaliser. C'est ce que nous pouvons constater les uns et les autres sans forcement recourir aux modèles. Il est important que cela soit confirmé par vos recherches.
• Questions et observations des Sénateurs
M. Xavier de VILLEPIN.- Je souhaiterais poser trois questions :
1. Le lien entre l'accélération des restructurations et de l'euro, est-il tout à fait certain ?
Je pense à la Grande-Bretagne qui n'est pas dans l'euro mais a restructuré et restructure en permanence, et au Japon, qui a beaucoup restructuré tout en ayant gardé la même monnaie.
2. Il a été dit que la France avait un potentiel de croissance supérieur aux autres pays européens. Je pense à nos voisins allemands et italiens. Qu'est ce qui explique cela puisque nous souffrons à peu près des mêmes maux ?
3. La réserve fédérale américaine a-t-elle des raisons de baisser les taux aux Etats-Unis actuellement ? Ce qui serait un événement lourd de conséquences pour le futur de l'économie, y compris européenne.
M. Christian de BOISSIEU.- Sur l'accélération des restructurations à cause de l'euro : il est clair que tous les secteurs (banque, automobile, pharmacie, etc.) sont en train de se concentrer peu ou prou. Vous avez raison de rappeler que ces restructurations sont antérieures à l'euro et tiennent à des phénomènes de globalisation, de déréglementation et de surcapacités dans certains secteurs.
Les surcapacités créent des pressions à la baisse sur les prix et sur les marges bénéficiaires. Dans un contexte où vous ne pouvez pas trop compter sur la reprise de la demande pour faire disparaître les surcapacités, comment le marché fait-il disparaître celle-ci ? Par une restructuration de l'offre.
A partir du moment où l'on ne compte pas trop sur la demande, il faut jouer sur l'offre. C'est ce qui se passe, c'est le phénomène de concentration qui apparaît dans tous les secteurs.
Quand j'ai dit que l'euro accélère les restructurations, il est difficile de refaire l'histoire mais je pense par exemple qu'une opération comme celle de la B.N.P., face à la Société Générale et Paribas, aurait eu lieu, mais sans doute à un moment différent, peut-être plus tard s'il n'y avait pas eu l'arrivée de l'euro.
L'euro renforce assez sensiblement les pressions concurrentielles qui existaient avant lui et, de fait, accélère dans certains cas des phénomènes de restructuration qui, de toute façon, seraient intervenus. Cela précipite un peu le calendrier. Voila la thèse que je défendrais.
Sur la croissance comparée à l'intérieur de la zone euro et les raisons pour lesquelles l'Allemagne et l'Italie, en 1999, sont décrochées par rapport à la France : en 1999, l'Allemagne va être à 1,5% ou 1,7%, nous serons en France autour de 2,3%, l'Italie, pour les optimistes, sera à 1 % et pour les pessimistes, entre 0 % et 1 %.
Ceci s'explique tout d'abord par leur spécialisation internationale qui a plus exposé ces deux pays aux conséquences de la crise internationale, au choc asiatique, au choc russe, pour prendre ces deux exemples et ne pas revenir sur le Brésil. Ces deux événements ont plus pesé sur les exportations allemandes et italiennes que sur les exportations françaises.
L'Italie, pour être au rendez-vous de l'euro, a dû faire une politique budgétaire très sévère, finissant par peser sur la consommation. La fameuse " Prodette ", mesure fiscale équivalente en Italie à la " Juppette ", a dopé la consommation pendant un certain temps. Mais une fois supprimée, des effets de compensation à travers le temps font que la consommation retombe. Surtout lorsqu'il a fallu lever des taxes pour être au rendez-vous de l'euro.
D'autres facteurs ont joué, sur lesquels je n'insiste pas. Nous arrivons a posteriori à comprendre cet écart qui pourrait peut-être se réduire l'année prochaine.
Prenez l'exemple de la Corée du Sud : le fait qu'elle reparte cette année à 5 % de croissance, donc plus vite que la plupart des économistes ne le prévoyaient, aura peut-être un effet plus favorable pour l'Allemagne que pour nous, même si le raisonnement ne peut être complètement symétrique.
Sur le dernier point : le hasard du débat que nous avons aujourd'hui fait que je viens de passer quelques jours à Washington, à la réserve fédérale américaine, où j'ai travaillé sur la politique monétaire américaine et la question de savoir ce qu'il peut se passer les 29 et 30 juin où aura lieu une réunion du comité de politique monétaire de la réserve fédérale.
Je suis revenu avec le sentiment que compte tenu des dernières nouvelles sur l'économie américaine montrant que celle-ci est encore très dynamique, il ne faut pas écarter l'hypothèse que la réserve fédérale monte ses taux les 29 et 30 juin prochains de 50 points de base et passe de 4,75 à 5,25 %.
La réserve fédérale va être tentée de le faire, mais je pense qu'elle aurait tort. Je reste persuadé que même aux Etats-Unis, il n'y a pas franchement risque d'inflation. Malgré le dernier chiffre de 0,7 %, la reprise limitée de l'inflation aux Etats-Unis est due essentiellement à la remontée des prix du pétrole et des matières premières.
Les Etats-Unis sont, comme les autres pays, dans un monde de forte concurrence et de globalisation. Les entreprises américaines ne peuvent pas faire n'importe quoi dans la fixation de leurs prix de vente. Il me semble qu'un certain nombre d'analystes et de décideurs américains ont tendance à exagérer le risque inflationniste.
Cela rejoint le débat sur le taux de chômage d'équilibre. Le taux de chômage effectif aux Etats-Unis est - dernier chiffre connu - de 4,2 %. Où se situe le taux de chômage d'équilibre américain ? Chaque fois que j'ai discuté avec des responsables ou des analystes, j'ai eu autant de réponses que de personnes.
Certains disent que le taux de chômage d'équilibre aux Etats-Unis est de 5,5 % et considèrent que s'il n'y a pas eu d'inflation malgré le taux de chômage très bas, c'est parce que des facteurs transitoires comme la baisse du prix du pétrole en 1998 font qu'il n'y a pas eu l'inflation que l'on pouvait attendre avec un taux de chômage aussi bas.
D'autres économistes ou décideurs publics, y compris au sein de la réserve fédérale, défendent la thèse que la nouvelle économie, l'informatique, les nouvelles technologies ont entraîné une baisse du taux de chômage naturel et que le taux de chômage d'équilibre américain ne serait pas à 5,5 % mais autour de 4,5 %.
Le débat est entier là-bas, donc a fortiori entier chez nous.
M. Jean CLOUET - Je voudrais parler de productivité car j'ai lu que M. GREENSPAN a dit il y a deux ou trois jours que nous ne pouvions pas toujours faire progresser la productivité. Compte tenu de ce que vous dites, cela parait relativement intéressant comme remarque et susceptible d'avoir des conséquences sur les taux d'intérêt.
Mme DEBONNEUIL a évoqué tantôt la productivité du travail et tantôt la productivité apparente, ce qui tendrait à vouloir dire qu'il y a plusieurs productivités du travail. De laquelle avez-vous voulu parler ?
Mme Michèle DEBONNEUIL.- Lorsque nous étudions la croissance de la production et que nous essayons de la décomposer en deux termes, croissance des actifs et croissance de la productivité, il s'agit de la productivité " apparente " du travail.
Nous supposons que l'on ne regarde que le facteur travail et quand nous divisons la croissance de la production par la croissance de la population employée, nous trouvons que la production a progressé plus vite que le facteur travail.
L'évolution de la productivité apparente du travail, c'est " apparemment " la différence entre la croissance de la production et celle du facteur travail. C'est un concept apparent. C'est pour cela que j'ai dit au départ que c'était une supercherie de dire que cette productivité apparente va évoluer de la même façon que par le passé.
Tout le problème est de prévoir cette productivité apparente. Lorsque nous la décomposons, pour répondre à votre deuxième question, cela peut se faire en deux termes :
- la productivité globale des facteurs : c'est-à-dire la progression de la production indépendante de la croissance des facteurs de production. Le travail et le capital n'augmentent pas. Mais parce que le progrès technique est là, la production croît indépendamment de la croissance des facteurs de production.
La productivité apparente du travail est égale à la somme de la productivité globale des facteurs et d'un terme qui dépend de l'intensité capitalistique, c'est-à-dire de la plus ou moins grande quantité de capital que vous mettez sur chaque travailleur.
Il existe deux façons de faire augmenter la productivité apparente du travail : soit en faisant croître la production sans faire croître les facteurs par la productivité globale des facteurs, soit en accumulant plus de capital sur chacun des individus.
Nous observons qu'au cours du temps, la productivité apparente du travail aux Etats-Unis progressait autrefois de 2 % par an, comme elle progresse aujourd'hui en France. Depuis 1974, la croissance de la productivité apparente du travail aux Etats-Unis a baissé. Elle n'est plus que de 1 % et, en France, nous sommes sur ce rythme de 2 %.
Le problème est de savoir si, en France, la croissance de la productivité apparente du travail va passer de 2 à 1 % ou se stabiliser sur un autre rythme.
Toute la question est là. Plus ce rythme est élevé, plus la capacité de croissance avec un nombre de personnes donné est élevée. A priori, il est très important d'avoir une croissance de la productivité apparente du travail plus forte.
Aujourd'hui, nous observons que les Etats-Unis parviennent au plein emploi avec une plus forte croissance qu'ailleurs, même si elle n'est pas formidable (2,5 %).
Ce pays parvient au plein emploi avec une faible croissance de la productivité apparente du travail. C'est ce qui pose problème. Ce n'est pas parce que les secteurs à fort progrès technique ne sont pas créateurs d'emploi mais parce qu'il y a trop peu de secteurs ayant une très forte croissance de la productivité du travail avec une très forte croissance de l'emploi, et qu'il y a trop de créations d'emploi dans des secteurs non productifs.
Pourquoi l'économie des Etats-Unis est-elle au plein emploi ? Parce qu'elle est duale. L'on a à la fois des secteurs très innovants avec de très fortes croissances de la productivité et de l'emploi et des secteurs très créateurs d'emploi, mais à faible productivité.
Aujourd'hui, la France est en train d'imiter les Etats-Unis. Il n'est pas difficile de faire croître l'emploi dans des secteurs à faible productivité. Il suffit d'abaisser le coût du travail. C'est ce que nous faisons.
Nous allons vers une économie qui aura cette dualité entre deux secteurs, dont l'un est très créateur d'emplois avec des gains de productivité importants et l'autre très créateur d'emplois mais avec un niveau de productivité très faible (et donc, avec des inégalités salariales très marquées entre les deux secteurs).
Soit l'on considère que cela ne pose pas de problème et le sujet est terminé, soit cela en pose et l'on se dit : la croissance à la française, n'est-ce pas d'essayer d'obtenir des créations d'emploi, mais avec davantage de dynamique de la productivité dans les secteurs de services à la personne ?
Ce qui me semble intéressant, c'est que nous nous sommes habitués à ce que l'on appelle services aux ménages, par opposition aux services aux collectivités locales et aux entreprises qui n'ont pas la même connotation que ces services à la personne, où l'on a l'impression qu'il s'agit d'un secteur social.
Il faudrait voir que ce qui a existé jusqu'à présent dans le secteur des services aux ménages : services sociaux pour les enfants ou les personnes âgées. Ce secteur social extrêmement important doit rester avec sa spécificité, ses aides, etc..
Mais il faut se dire que les services aux ménages, c'est tout à fait autre chose. Existe-t-il une " politique industrielle " permettant de " soulever " la productivité dans ces secteurs où elle est très faible, puisque les gens y travaillent simplement avec leurs mains ?
Selon la réponse, nous avons deux modes de développement très différents avec la possibilité d'avoir à la fois beaucoup d'emplois et une croissance de la productivité apparente du travail plus forte.
Le défi pour l'Europe est de parvenir à soulever ce secteur des services aux ménages en termes de productivité. Ce n'est pas un problème de légitimité de la politique économique parce que dans les secteurs à forte croissance de la productivité du travail, comme l'informatique, la politique industrielle aux Etats-Unis est extrêmement importante. Ce n'est donc pas une question de principe de légitimité de l'action de l'Etat. Cela signifie que les Etats ne veulent pas ou ne savent pas intervenir sur des secteurs à faible productivité. Ils y sont intervenus massivement, mais pour des causes différentes.
Le Gouvernement français intervient très massivement sur ce secteur des services aux personnes, mais sur un segment particulier, le secteur social.
N'y a-t-il pas moyen d'industrialiser un secteur de services à des personnes tout à fait capables, qui ne sont ni des enfants ni des personnes âgées, et qui veulent avoir en face d'elles un secteur organisé comme les secteurs de services aux collectivités locales ou aux entreprises ?
Cela permettrait de créer des emplois peu qualifiés, mais avec des croissances soutenues de la productivité et, donc des salaires qui pourront augmenter. Sinon, nous allons faire comme les Etats-Unis, en opérant des transferts financiers qui permettront de soutenir le revenu des personnes travaillant des secteurs mais à un coût très élevé pour la collectivité.
Saurons-nous faire mieux que les Etats-Unis et mettre en place une autre politique que ces transferts financiers ? Existe-t-il une politique industrielle intelligente de l'Etat qui ne soit pas cantonnée dans des secteurs à très forte croissance de la productivité comme cela est le cas en Europe et aux Etats-Unis pour les secteurs de l'informatique, des nouvelles technologies, etc., et qui pourrait s'exercer dans des secteurs à faible productivité mais où le potentiel de croissance de la productivité est très fort ?
M. Serge LEPELTIER, Président.- Merci beaucoup. Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est de rendre ces politiques solvables, que quelqu'un, derrière, ait la volonté de payer.
Mme Michèle DEBONNEUIL.- Le but est de faire en sorte que ce soit l'organisation productive qui la rende solvable. Au lieu de donner de l'argent à des gens pour acheter un produit trop cher parce que la productivité est insuffisante, il faut monter celle-ci pour que le prix baisse, que les gens puissent l'acheter et que nous puissions payer ceux qui auront produit de façon productive.
Ce que je dis n'est pas scandaleux, c'est le mode de développement classique de tous les secteurs matures comme l'automobile et autres.
Pourquoi ce secteur de services aux ménages ne relèverait-il pas de la même logique ? Parce que jusqu'à présent, étant un microsecteur, son développement s'est cantonné sur un aspect extrêmement important, son aspect social, et que l'on confond les deux. Il y a une espèce de trouble et l'action de l'Etat n'est pas claire sur ces sujets.
M. Xavier de VILLEPIN, Sénateur.- Il faudrait affiner la terminologie et déterminer les frontières.
Quand vous parlez de services aux ménages, je dis que fabriquer des voitures particulières est un service aux ménages. Dans ce domaine, vous avez eu un développement considérable de la productivité.
Où commencent et où finissent ces services aux ménages ? Je pense qu'il y a là un problème.
-
M. Joël BOURDIN, Président. - Mesdames et Messieurs, nous allons reprendre notre séance. J'ai été privé de la première partie, j'en suis désolé pour les animateurs et pour Serge LEPELTIER qui a accepté avec beaucoup de gentillesse de venir à cette place.
La deuxième partie de ces travaux est consacrée aux politiques économiques en Europe à partir d'une mise en perspective des points de vue nationaux. Pour faciliter et animer le débat, nous avons fait appel à quatre économistes représentant des instituts d'analyse économique des plus grands pays de l'Union européenne :
M. Philippe SIGOGNE, remplaçant M. FITOUSSI qui n'a pu venir aujourd'hui. Ce dernier parlera au nom de l'Observatoire français des conjonctures économiques, c'est un habitué de nos colloques. Je lui témoigne ma gratitude pour sa disponibilité et sa fidélité.
M. Joachim VOLZ, représentant le Deutsche Institut Für Wirtschaftforschung (DIW, Berlin), l'un des principaux organismes de prévision et d'analyse allemands.
M. Ray BARRELL, représentant le National Institute for Economic and Social Research (NIESR, Londres).
M. Paolo ONOFRI, représentant le PROMETEIA de Bologne, qui vient de réaliser un rapport sur la protection sociale, qui a fait l'objet d'importants débats en Italie.
MM. BARRELL et ONOFRI s'exprimeront en anglais et j'invite ceux qui le souhaitent à se munir des casques mis à leur disposition.
La parole est à M. SIGOGNE.
• M. Philippe SIGOGNE, Directeur du Département d'Analyse et de Prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).-
Merci Monsieur le Président. Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir toujours renouvelé de me trouver parmi vous et un honneur de représenter l'OFCE en cette séance de la Délégation du Sénat pour la planification.
Il était d'usage de présenter chaque année dans un exercice de printemps des exercices modélisés sur ce que pourrait être notre avenir à moyen terme. Il ne s'agissait pas à proprement parler des prévisions mais plutôt de projections avec des scénarios permettant d'éclairer les différentes voies du futur et de permettre ainsi au monde politique de prendre les décisions qu'il pouvait juger appropriées en fonction de ces différentes possibilités.
Aujourd'hui, le débat est un peu différent. Notre modèle a reçu la possibilité d'obtenir une année sabbatique. Nous en profitons donc pour traiter un sujet un peu différent, qu'il nous a paru utile d'aborder en cette année de l'euro.
En introduction au débat, puisque l'essentiel sera présenté par les trois intervenants étrangers qui viennent de vous être annoncés, je me permettrai simplement de citer le cadre de réflexion dans lequel ce travail a été réalisé.
Pendant les décennies glorieuses, les choix de société semblaient, à tort ou à raison, pouvoir s'exprimer librement à l'abri des frontières, l'autonomie monétaire et fiscale autorisant une répartition du revenu national conforme aux aspirations exprimées démocratiquement.
A partir des années 80 - ceci a été clairement exprimé dans la première partie du débat -, la lutte contre l'inflation engagée partout dans le monde a monopolisé l'instrument monétaire, lui ôtant toute capacité de soutien de l'activité. Elle a en même temps fortement amputé, voire par moment réduit à néant les marges de manoeuvre budgétaires des Etats par la menace qu'elle faisait porter sur la capacité de maîtrise des dettes publiques.
Voyant ainsi durablement amoindris les moyens d'intervention macro-économiques, les agents économiques publics et privés ont été progressivement conduits à rechercher d'autres voies de redressement de l'activité, la croissance s'avérant en elle-même impuissante à procurer des postes de travail à tous ceux qui en manifestaient la demande.
La confusion des esprits relevant de cette impuissance à agir a conduit à rechercher à l'extérieur de notre pays des modèles dans l'espoir de nous les approprier.
Hélas, l'analyse minutieuse des expériences réussies a le plus souvent montré que les conditions initiales de ces modèles en étaient le plus souvent exceptionnelles et non reproductibles. L'enthousiasme soulevé par des propositions extrêmes exaltant les vertus du tout libéral et poussant à faire table rase du passé, est retombé à mesure que les études de cas, notamment les études sur l'emploi de l'OCDE, relativisaient les résultats obtenus et en affichaient les coûts.
Le fondement d'un nouvel ordre économique et social ne peut se faire en traitant indépendamment l'économique et le social comme s'ils n'interagissaient pas l'un sur l'autre.
Une réflexion intégrée s'impose donc, faute de s'exposer tôt ou tard à un rejet brutal risquant de remettre en cause la dynamique européenne.
La mise en place de l'Union économique et monétaire succédant à celle du marché unique a profondément modifié les modes d'approche des questions de politique économique en France et chez nos partenaires européens. La disparition des monnaies nationales, l'adoption du Pacte de stabilité et de croissance, la suppression de plus en plus totale des entraves à la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes et l'application d'une politique active de la concurrence au niveau européen ont notablement réduit la viabilité de solutions locales aux problèmes posés par la globalisation économique et financière.
Les politiques macro-économiques, les réformes du marché du travail, les politiques sociales et fiscales ne peuvent faire l'impasse d'une réflexion européenne préalable sous peine d'aboutir à des décisions nationales incohérentes, non coopératives et donc contre-productives.
Il est important aujourd'hui de réaliser que les relations entre la construction européenne et la souveraineté nationale sont beaucoup plus complexes qu'on ne le croit et qu'on ne le dit. Il est nécessaire de rappeler que la mise en oeuvre de la monnaie européenne ne détermine pas de façon univoque la conduite des politiques économiques en Europe, que les figures de l'avenir sont multiples et, plus encore, que ce qui se joue au travers d'un débat apparemment technique sur les politiques économiques nationales est le choix d'un modèle de société.
De même que les politiciens sont parfois amenés à simplifier à l'extrême leurs positions de façon que leur message soit clairement identifié, de même les économistes insistent souvent à l'excès sur ce qui différencie leurs courants de pensée. Dans un cas comme dans l'autre, le corps commun de doctrines s'en trouve largement occulté.
Cette manière d'agir donne à penser que seule existe la solution du tout ou rien répondant à une logique quantique. Il n'y aurait ainsi aucune possibilité de mixer les propositions, donc pas de dialogue ni de débat fécond.
Se démarquant de cette position, il nous a semblé au contraire nécessaire de profiter de l'espace européen qui nous est aujourd'hui ouvert pour fonder notre recherche des solutions possibles sur un véritable échange des expériences accumulées nationalement.
Les instituts de recherche économique nationaux ont une expérience couvrant plusieurs décennies de communication sur leurs visions des déroulements économiques et de perspectives à court et moyen terme. Ils multiplient à présent les échanges d'information et d'évaluation des politiques économiques passées, en cours et en gestation. Ils clarifient ainsi leur point d'accord mais aussi de divergence sur les déterminants de la croissance.
Aujourd'hui, nous avons voulu vous faire part des points de vue exprimés dans les quatre pays les plus importants de l'Union Européenne : l'Allemagne l'Italie, le Royaume-Uni et la France. Des membres d'instituts de recherche prestigieux qui viennent de vous être présentés, Ray BARRELL du National Institute for Economic and Social Research de Londres, Paolo ONOFRI de Prometeia et Joachim VOLZ du Deutsche Institut für Wirtschaftforschung de Berlin vont successivement exposer la diversité et les points de convergence des options actuellement ouvertes en Europe dans les domaines respectifs des politiques macroéconomiques pour le premier, des politiques sociales et fiscales pour le deuxième et des réformes du marché du travail pour le dernier.
La gestion des politiques macro-économiques sera notre point de départ. Cette introduction ne vise qu'à soulever quelques questions permettant de lancer le débat. La détente monétaire suffit-elle à elle seule à garantir le meilleur environnement possible pour les décisions privées ? Des relances publiques sont-elles nécessaires ? Si oui, sous quelles formes ? Dans quelles conditions risquent-elles d'être contre-productives ? La monnaie unique donne-t-elle plus ou moins d'autonomie à chaque partenaire ? Quelles formes doit revêtir la coordination des politiques budgétaires pour garantir une réponse optimale aux déroulements cycliques prévisibles ou inattendus ? Ray BARRELL traitera de ce premier domaine.
La maîtrise des dettes publiques et la préservation d'un modèle social européen sont deux aspirations largement partagées par les opinions des pays sous revue. Le social et l'économique se rejoignent pour reconnaître l'extension des besoins exprimés, chercher à s'assurer de leur solvabilité et organiser leur financement d'une manière qui ne pénalise ni l'incitation à travailler ni à investir. Harmonisation et concurrence fiscales sont intimement liées à ces problèmes : la disparition des monnaies nationales renforce le rôle de la fiscalité, à la fois instrument d'incitation, de répartition et de financement dont le maniement sans précaution peut conduire à des comportements non coopératifs. Paolo ONOFRI développera ce deuxième domaine.
La recherche d'une plus grande flexibilité s'est renforcée partout en Europe, partant du constat que de multiples rigidités accumulées au fil des ans entravaient le retour au plein emploi. Des expériences diverses de déréglementation du travail ont été conduites en Europe. Elles ont pour objectif de combiner une plus grande souplesse de gestion de la main d'oeuvre, de conforter durablement la modération salariale et de permettre en retour de plus fortes créations d'emploi. Ces tentatives, complétées par la nouvelle insistance mise sur l'employabilité des personnes en marge de la population active sont-elles suffisantes, doivent-elles être accentuées ou se limitent-elles à une simple redistribution de l'offre de travail existante ? Joachim VOLZ tentera de répondre sur ces points en s'appuyant notamment sur les programmes d'action nationaux soumis par les pays membres.
Le point nodal du diagnostic économique, qui détermine les possibilités d'action macro-économique, est le diagnostic porté sur la nature du chômage que subissent nos économies. Pour certains, les rigidités sont l'explication majeure et le taux de chômage effectif est proche de son niveau d'équilibre. Toute stimulation publique de la demande ne ferait qu'évincer la demande privée, et tout spécialement l'investissement, dans le cas d'une hausse des dépenses publiques des biens et services. Toute baisse d'impôts aggraverait le déficit public sans profit pour la croissance ; les capitaux transférés au privé s'exporteraient sans profit pour l'emploi national. Pour d'autres, les taux de chômage restent dans plusieurs pays européens bien au-dessus de leur niveau d'équilibre ; selon les calculs de l'OFCE, ils les dépasseraient en moyenne de quatre points pour l'ensemble Allemagne, France et Italie. Dans un tel cas, les marges de manoeuvre des politiques publiques s'avéreraient plus amples qu'on ne le soutient le plus souvent en Europe. Ceci fait aussi partie de notre débat d'aujourd'hui.
Un dernier point que je mentionnerai, qui m'a été inspiré par ce qui a été dit sur la divergence des évolutions conjoncturelles en Europe. Il est extrêmement important aussi pour apprécier la capacité des politiques économiques d'avoir une influence sur le niveau d'activité économique, de savoir quel est l'état exact de la situation du secteur privé. Que ce soit les comptes d'exploitation des entreprises, les bilans des sociétés, l'expérience des années 90 nous a montré qu'après les efforts menés dans la phase de désinflation ayant conduit les entreprises à changer de comportement pour se désendetter, réduire leur dépendance vis-à-vis des marchés, de dettes et s'autofinancer largement, un freinage de l'investissement est apparu - et sans doute au-delà de ce qu'il aurait été souhaitable - au fil des années 90.
La situation de départ dans l'euro est très différente selon les économies, selon que les unes ou les autres ont été soumises à une épreuve de crédibilité plus ou moins grande pour rentrer dans la monnaie unique.
Comme il a été très justement souligné par les intervenants du Centre d'Observation Economique, les pays souffrant le plus sont ceux dont la désinflation était déjà la plus avancée.
Ces points-là me paraissent essentiels pour déterminer les moyens d'action et les marges de manoeuvre des politiques économiques, qu'elles soient macro-économiques, fiscales, sociales ou autres dans le contexte européen d'aujourd'hui.
Je vous remercie Monsieur le Président.
M. Joël BOURDIN, Président.- Merci Monsieur Philippe SIGOGNE. Comme vous l'avez annoncé, je vais maintenant donner la parole à M. Ray BARRELL, qui va nous parler de la gestion des politiques macroéconomiques.
• M. Ray BARRELL, National Institute for Economic and Social Research (NIESR, Londres) (Traduction) . -
Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé d'avoir à m'adresser à vous en anglais mais il me semble que je serai plus clair que si je m'exprimais en français.
Je voulais évoquer brièvement deux ou trois aspects des questions suivantes : les problèmes de politique économique de l'Europe risquent d'aboutir à des évolutions des institutions en charge de cette politique économique, et les problèmes de politique économique que l'Europe pourrait rencontrer à l'avenir.
Les institutions ont évolué et vont continuer d'évoluer.
Je voulais également aborder brièvement la question des changements structurels en Europe, ce qui les pose, ce qui les provoque et enfin, celle de la force et de la faiblesse de l'euro.
S'agissant de l'évolution des institutions, il faut savoir qu'il y a dix ans seulement que l'Europe a envisagé l'Union monétaire. Pour nous, économistes professionnels, avec les débats de 1989 et 1990, le Traité de Maastricht est parvenu très rapidement à la conclusion qu'il nous fallait une Union monétaire associée à des objectifs de 3% de déficit budgétaire, et de taux de change stables.
Il y avait à l'époque un grand enthousiasme pour la construction de l'Union monétaire et la Finlande et la Grande Bretagne se sont associées au mécanisme de stabilisation des taux de change.
Lors de l'effondrement de ce mécanisme en 1992-93, beaucoup ont pensé qu'il n'y aurait jamais d'union monétaire en Europe et pourtant, cet effondrement ne l'a nullement arrêtée. Les politiques et les institutions ont continué d'évoluer par rapport aux problèmes que nous avions à l'époque en Europe et nous avons assisté à de nouveaux accords, à un nouveau départ vers l'Union monétaire. Ces institutions sont confrontées au fait que les économies européennes sont très diverses et en même temps convergent pour beaucoup de raisons, mais il y a beaucoup d'éléments qui vont les empêcher de converger.
La convergence concerne non seulement l'inflation, mais aussi les taux de change.
Aucun pays ne semble avoir une monnaie surévaluée ou sous-évaluée : il y a donc convergence sur ce plan.
Il y a un domaine dans lequel il n'y a pas encore eu convergence : c'est celui du chômage.
Il est très difficile de savoir quel est le chômage d'équilibre en Europe ; la plupart des commentateurs s'entendent pour dire qu'il y a un certain nombre de pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Italie, qui ont un chômage supérieur à ce qu'ils peuvent soutenir à long terme. Voilà pourquoi ils souhaitent tous une baisse du chômage.
Il faudrait peut-être avoir des institutions capables de lutter contre le chômage. C'est donc un premier problème.
Il y a une raison pour laquelle nous savons que le chômage est au-dessus de son niveau d'équilibre : c'est le niveau de l'inflation, peut-être pas en Irlande, en Espagne, aux Pays-Bas, mais en tout cas au coeur de l'Europe. Dans les trois grands pays, l'inflation est en baisse.
Le chômage dans la zone euro est de 10% en moyenne, alors que le taux de chômage soutenable est d'environ 8%.
Nous allons parler des plans d'action nationaux tout à l'heure, mais j'aimerais redire qu'il est très important une fois qu'on a une union monétaire, de penser à un certain nombre d'éléments.
Dans un pays comme le Royaume-Uni, nous avons une banque centrale indépendante. Si les partenaires sociaux décidaient de réformer le système de négociation des salaires afin que les salaires réels progressent moins rapidement, le taux de production d'équilibre augmenterait. Si la banque centrale reconnaît cette évolution, elle peut décider de valider ces changements. En d'autres termes, si les partenaires sociaux sont d'accord, nous devrions avoir des salaires réels moins élevés et un emploi plus élevé ; la banque centrale pourra tout de suite répondre en réduisant les taux d'intérêt, en laissant l'inflation à son niveau et en validant ces politiques. C'est très utile, mais il ne faut pas oublier que la situation est très différente dans le reste de l'Europe. Si les partenaires français choisissent entre eux d'avoir des salaires réels plus bas, un chômage plus bas, une inflation plus basse, ils n'ont aucune garantie que la Banque Centrale Européenne va valider ce choix par une baisse des taux d'intérêt.
La seule manière de réussir, c'est de passer par l'augmentation de la compétitivité par rapport aux autres partenaires européens. Sans coordination au niveau européen, au niveau des politiques du marché du travail, nous risquons de voir des réformes du marché du travail menées dans le cadre national.
De même, on peut mener avec un certain succès, comme aux Pays-Bas, des politiques fiscales qui permettent de réduire le chômage.
Mais, face à ces politiques ponctuelles, nationales, il y a une Banque Centrale Européenne qui mène une politique monétaire unique, et chaque pays pris isolément ignore ainsi la réaction de la politique monétaire face aux initiatives de politique économique qu'il peut prendre.
Ce problème de Banque Centrale Européenne (BCE) unique nous amène à une deuxième question.
Nous avons maintenant un certain nombre d'institutions qui travaillent ensemble. Nous avons une Banque Centrale Européenne indépendante, ce qui est bien ; c'est probablement la Banque centrale la plus indépendante au monde. Elle se fixe ses propres objectifs, ses propres manières d'y parvenir. Pourtant, elle ne joue pas le même rôle que la Bundesbank en Allemagne. En fait, la Bundesbank joue une partie de poker avec un ou deux joueurs. La BCE a 11 opposants et on ne peut pas jouer au poker avec 11 partenaires. Il faut donc qu'elle fonctionne différemment et il faut vraiment penser à cela.
La BCE a son évolution ; nous avons déjà une amorce d'évolution. Nous devons tirer les enseignements de ce qui s'est produit et essayer de replacer l'évolution de ces institutions dans leur contexte. Un certain nombre de questions se posent concernant l'évolution des institutions pour favoriser la lutte contre le chômage et la croissance. La Banque centrale n'est pas la seule nouvelle institution ; il y a également d'autres options de politique économique. Y a-t-il encore des politiques économiques qui nous sont offertes ?
Il existe également un pacte de stabilité et de croissance, qui limite l'autonomie budgétaire de manière considérable.
Il est donc très possible que les Gouvernements aient moins de marge de manoeuvre au niveau budgétaire.
Il y a une nouvelle institution, la BCE, et on ne sait pas toujours comment elle va réagir si l'inflation baisse ou si quelque chose arrive à l'euro.
Une autre nouvelle " institution ", née du Pacte de stabilité, a pour but de réduire la dette publique, mais risque aussi d'avoir à limiter la marge de manoeuvre fiscale des autorités.
Ces deux institutions pourraient être dans dix ans parfaites pour l'Europe qui sera la nôtre.
Toutefois, elles ont été conçues pour une Europe qui n'est pas confrontée à des problèmes particulièrement graves et je crois que nous devons discuter avec les autorités monétaires et les autorités budgétaires de la question de savoir si nous vivrons dans une Europe libre de tout problème. Nous avons déjà mentionné le problème du chômage et celui des crises dans d'autres régions du monde qui réduisent la demande, surtout en Italie et en Allemagne. Il y a un choc asymétrique dans la mesure où ces pays réagissent différemment du fait de leur spécialisation.
Pour ce qui est de la BCE, elle ne doit pas réagir aux événements qui se produisent dans un seul pays. Il faut qu'elle prenne en compte l'ensemble de l'Europe. Les autorités budgétaires doivent donc avoir un certain nombre d'instruments. Pourtant, elles sont très limitées par le pacte de stabilité et de croissance, surtout en Allemagne et en Italie.
Je ne dis pas qu'il faille relâcher les politiques budgétaires dans ces deux pays, il faut simplement reconnaître que cette option n'est pas vraiment disponible dans ces pays compte tenu des traités qu'ils ont signés.
Nous avons maintenant une Europe qui n'est peut-être pas armée pour faire face à ces problèmes à court terme, une Europe où il faut réfléchir aux institutions, une Europe qui a évolué très rapidement.
Il faut se poser la question de savoir ce qui a provoqué ces changements avant de parler de la conception des nations.
Ces changements structurels en Europe et au Royaume-Uni ont-ils été causés par la faiblesse de l'inflation ? C'est possible.
Ces changements structurels en Europe ont-ils été provoqués par l'instabilité du taux de change ? Peut-être aussi.
Toutefois, je crois que les changements structurels en Europe sont, en fait, dus à l'effet concret des politiques, mais pas de nature macroéconomique. Ces changements structurels sont dus au marché unique et à ses effets énormes sur la manière dont les marchés des biens et les marchés financiers fonctionnent.
La combinaison du marché unique et la libéralisation des mouvements de capitaux a vraiment provoqué un choc, par exemple, pour l'industrie automobile.
Donc en tant que macroéconomistes, nous devons laisser un certain espace pour le marché unique et prendre en compte l'investissement direct étranger.
J'en viens maintenant au contrôle de l'inflation, qui relève de la BCE.
Il faut tout d'abord souligner que la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale allemande ont évolué, modifié régulièrement leurs objectifs, leurs instruments pour parvenir à ces objectifs.
Donc, au fur et à mesure que nous avançons, la BCE doit également évoluer au même titre que la Réserve fédérale et la banque allemande ont évolué.
La BCE a beaucoup d'options : elle pourrait viser, à moyen terme, un agrégat monétaire ; on ne sait pas très bien si c'est ce que faisait la Bundesbank. Elle mentionnait une valeur de référence comme la Banque centrale et je crois qu'une banque centrale doit toujours prendre en compte la stabilité des prix qui doit être liée à un niveau de prix ou à un niveau monétaire.
Toutefois, la BCE s'intéresse également à l'évolution à court terme de l'inflation. Elle a une stratégie duale.
J'en viens maintenant à la question de la valeur externe de l'euro. Que se passe-t-il quand on dévalue ? Cela dépend de la raison pour laquelle on dévalue. Voilà pourquoi les modèles ne sont pas toujours utiles ; il faut d'abord se demander pourquoi on a dévalué. Je crois qu'il y a un ensemble de facteurs extrêmement complexes tels que la crise en Asie du sud-est, la force du dollar, la force du marché boursier américain et la faiblesse de l'euro.
Si nous avons constaté un choc de productivité aux Etats-Unis, si la technologie de l'informatique dope la croissance des Etats-Unis, c'est peut-être qu'il y a deux ou trois ans, les investisseurs ont commencé à s'intéresser aux Etats-Unis plus qu'à toute autre région du monde, ce qui provoqué une fuite des capitaux en Asie du Sud-est et ce qui explique la force du marché boursier américain. S'il y a un choc de productivité aux Etats-Unis, le dollar américain en termes réels doit augmenter par rapport à l'euro. A ce moment-là, la Banque centrale doit surveiller l'inflation. Si l'inflation est basse, elle doit réduire les taux d'intérêt, mais ne doit pas trop se concentrer sur la valeur de l'euro parce qu'il s'agit peut-être d'un changement, d'une évolution structurelle de l'économie mondiale.
En fait, la Banque Centrale Européenne doit pouvoir réagir de manière appropriée. Il faut donc savoir ce qu'elle fera pour l'avenir. La BCE doit avoir un objectif très clair quant à sa politique.
Dans un jeu de poker entre 11 joueurs et la BCE, il faut vraiment connaître le taux d'inflation, il faut s'adapter rapidement et il faut que ce taux d'inflation soit très clairement défini, et récompenser les réformes du marché du travail. Cette nécessité de réforme du marché du travail devra donc en fait contribuer à une certaine clarté pour aider à régler les problèmes de l'inflation
Un deuxième problème institutionnel très important concerne le pacte de stabilité et de croissance qui a permis de créer l'Union européenne. Il aurait été politiquement impossible de créer l'Union monétaire sans ce pacte. C'est vraiment le plus grand accord budgétaire de la décennie. Peut-être que d'ici à un an, nous devrions penser au prochain accord budgétaire. La prudence budgétaire n'a pas le même sens dans tous les pays. Un Gouvernement prudent peut viser un déficit de 0 à 3% s'il investit beaucoup. Un Gouvernement prudent peut suivre la règle d'or et emprunter davantage.
Ce taux de 3% s'explique dans certains pays. Toutefois, les pays sont différents en Europe et il faut prendre en compte ces différences.
La production est plus volatile dans certains pays européens pour des raisons historiques. Les analyses conduites par la Commission européenne montrent que la Finlande et la Suède ont une volatilité bien supérieure à celle de la France par exemple. Par conséquent, leur déficit budgétaire est beaucoup plus variable que celui de la France ou de l'Autriche. Certains pays, notamment la Suède, ont un système de taxation tel que le déficit réagit plus à une évolution de la production, par rapport à ce qui se passe en Allemagne, par exemple.
Tenir compte de la volatilité budgétaire est ainsi décisif pour apprécier l'évolution du déficit budgétaire. Il suffit de faire un certain nombre de calculs sur les objectifs de déficit budgétaire et la probabilité de parvenir aux lignes directrices du pacte de stabilité. Compte tenu de la volatilité passée, nous pouvons penser que l'Espagne et les Pays Bas ont une chance d'y parvenir en 1999. La France et l'Allemagne auraient une probabilité plus faible, ce qui signifie que les politiques fiscales devront être assez restrictives dans ces pays, parce qu'ils devront resserrer leur politique budgétaire, ce qui n'est pas nécessairement approprié pour l'Allemagne.
Il y a peut-être aussi d'autres éléments quand on fixe un plafond de 3% de déficit budgétaire : certains pays très " volatiles " devraient être le plus longtemps possible en excédent budgétaire pour éviter, en cas de récession, de dépasser la barre des 3 % de déficit. Inversement, ce plancher de 3% permettrait à des pays comme la France d'avoir durablement un déficit de moins de 1% du PIB, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable. Il faut des politiques prudentes dans le cycle de l'endettement.
Dans certains pays, on pourrait avoir une marge de manoeuvre plus importante. Ce plancher des 3% qui limite les politiques budgétaires dans beaucoup de pays nous fait craindre une récession l'année prochaine. Nous devrons peut-être être plus souples sur ce point, revoir nos institutions par rapport au problème de l'Europe qui sera celle de demain et non pas celle d'hier.
Je pense donc qu'il faudrait une révision constante des institutions en charge de la politique économique. Nous ne pouvons pas copier la Constitution américaine, il faut vraiment bâtir quelque chose d'entièrement nouveau et nous apprenons au fur et à mesure.
M. Joël BOURDIN, Président.- Merci Monsieur Ray BARRELL. Je passe maintenant la parole à M. Paolo ONOFRI pour qu'il nous parle de la maîtrise des dettes publiques et de la préservation d'un modèle social européen.
• M. Paolo ONOFRI, PROMETEIA (Bologne) (Traduction) .-
Merci Monsieur le Président. Je suis moi aussi désolé de ne pas parler français. J'espère en fait faire passer plus rapidement mon message en m'exprimant en anglais.
J'aimerais insister sur la chose suivante : ce que ce que Ray BARRELL vient de nous dire, nous renvoie à des perspectives de moyen terme, qui concernent la conception des institutions chargées de la politique économique en Europe. Je crois que nous ne devons pas oublier que nous sommes confrontés simultanément à deux questions tout à fait inattendues au début de cette aventure européenne.
Premièrement, la nécessité d'avoir à réduire à zéro le déficit budgétaire pour les pays européens, à moyen terme.
Deuxièmement, la nécessité de prendre en compte la situation conjoncturelle qui est totalement différente de celle que nous attendions. Je n'entrerai pas dans les détails, mais j'aimerais simplement vous rappeler deux questions :
- Que va-t-il se passer si la Réserve fédérale décide d'augmenter les taux d'intérêt ?
- L'Europe est-elle en mesure de se préserver de l'évolution des taux d'intérêt aux Etats-Unis ?
Nous rencontrons en effet le risque d'une réaction due à l'intégration des marchés financiers, un problème à long terme, alors que l'Europe sera toujours dans une impasse du point de vue de la conjoncture, et cela provoquera d'autres problèmes qui ne sont pas en fait dus à la construction d'une politique économique fédérale, mais qui seront dus à l'intégration totale des marchés financiers.
La crédibilité de la politique économique dans la zone euro que nous avons à construire n'est pas simplement dépendante du niveau du déficit ou de l'excédent budgétaire, elle est également dépendante de l'évolution de la structure des finances publiques.
Quel est l'impact de la pression fiscale ? Quel est l'impact des dépenses publiques en général, des dépenses sociales en particulier ? Quel est l'impact des transferts sociaux ?
Il s'agit là de questions auxquelles les pays européens doivent répondre. En effet, nous sortons d'une période au cours de laquelle la classe moyenne a travaillé dans une position très sûre dans toute l'Europe, mais elle est maintenant confrontée à une incertitude de plus en plus importante et durable. Par conséquent, si nous devons vraiment envisager un échange politique entre les partenaires sociaux et les gouvernements, nous ne devons pas simplement l'envisager en termes macro-économiques, mais prendre en compte également l' " échange " possible entre d'un côté la déréglementation sur le marché du travail et, d'un autre côté, une solide défense du système actuel de protection sociale. Tout simplement en raison du fait que l'évolution du revenu de la classe moyenne constitue une question essentielle pour tous les gouvernements en Europe. Il faut effectivement être certain qu'un réseau social aidera les classes moyennes à faire face à une plus grande incertitude, une insécurité de l'emploi, etc.
Dans le même ordre d'idée, je pense que le rôle de l'Europe en tant que tel est un rôle tout à fait important compte tenu du fait que la Commission est plus éloignée de la base électorale que chaque Gouvernement des états membres et qu'il est ainsi beaucoup plus facile pour la Commission de soutenir un certain nombre d'évolutions, de prendre même un certain nombre de positions impopulaires en matière, par exemple, de réglementation du marché du travail, ou de réformes imposées par le vieillissement de la population.
Je crois qu'à l'avenir, une fois que nous aurons absorbé l'effet des critères de Maastricht et du pacte de stabilité, le rôle des gouvernements européens consistera à traiter au niveau européen des effets du vieillissement de la population et des effets possibles également de la déréglementation du marché du travail. Il faudra qu'il y ait à ce sujet un échange politique dans le cadre de la restructuration du système de protection sociale.
Ce type d'évolution présente déjà un certain nombre de caractéristiques communes dans les états membres. Dans la quasi-totalité des pays, il n'y a plus du tout de partage des fruits du progrès technique entre salariés et retraités. La première mesure prise au début des années 1990 dans plusieurs pays d'Europe a consisté à supprimer le mécanisme d'indexation des prestations sociales de retraite par rapport à l'évolution des salaires réels, de sorte que les retraités ne profitent plus du progrès technique. Je crois qu'on ne peut pas dire que le progrès technique actuel est dû simplement aux travailleurs actuels. Il est également le fait de ce qui a été fait par les travailleurs d'antan, ceux qui sont aujourd'hui à la retraite.
Cependant, le consensus social actuel est tel que l'on a introduit ce genre de mesures.
Une autre caractéristique consiste à passer d'un système dans lequel certaines prestations sociales sont assez mal assurées par l'Etat à un système où la fourniture de ces prestations par le secteur privé devient de plus en plus importante.
Il y a deux exemples de ce genre de tendance. Premièrement, au Royaume Uni et, deuxièmement, aux Pays Bas et, en fait, on atteint à peu près les mêmes résultats par deux approches assez différents.
La première, au Royaume Uni, par la destruction totale du rôle des syndicats et la deuxième, aux Pays-Bas, avec l'accord des syndicats. Mais dans tous les cas, il y a eu déréglementation des marchés du travail, pas de réduction des systèmes de protection sociale pour la classe moyenne, pas de réduction des niveaux des prestations sociales. Par exemple, aux Pays Bas, il y a eu, en revanche, une augmentation de l'offre de la part du secteur privé. Tout cela a été considéré comme un outil visant à améliorer l'efficience dans l'offre des prestations sociales.
D'une certaine manière, il s'agit d'un nouveau type de modèle pour l'Europe où la solidarité sociale ne peut pas être découplée, détachée de l'efficience. C'est uniquement en associant l'égalité de traitement et l'efficience que la solidarité sociale trouve sa légitimité au sein de l'électorat.
Voilà pourquoi je pense que nous n'avons pas énormément de différences au niveau du comportement et des attitudes politiques des différents gouvernements en Europe.
Ainsi, presque partout, les systèmes de retraite vont être réformés ; dans certains, ils l'ont déjà été. Par exemple, en Italie. En Europe continentale, d'une manière générale, je dirais que nous sommes toujours dans le cadre d'un système public de répartition avec différentes caractéristiques, mais toujours fondé sur le principe de la répartition. Dans d'autres pays, on assiste à une progression des régimes de capitalisation.
Je crois que le développement des systèmes de retraite, la progression des systèmes privés et la diminution des systèmes de répartition vont nécessiter une certaine harmonisation du traitement fiscal des fonds de pension, une harmonisation de tous les mécanismes de régulation qui permettent ce qu'on appelle la " portabilité " des systèmes de pension d'un pays à l'autre. L'objectif ultime étant, bien sûr, d'améliorer la mobilité du travail.
Il s'agit là des principales caractéristiques concernant le marché du travail.
Pour en revenir à mon propos initial, toutes ces caractéristiques des politiques économiques concernent la structure du budget d'une manière ou d'une autre. En fin de compte, c'est toujours lié à la structure du budget, la composition, la structuration des revenus, des dépenses, à l'impact de ces éléments sur l'offre de main d'oeuvre et sur les prix relatifs de la main d'oeuvre.
On pourrait en fin de compte ajouter une tendance plus générale concernant la possibilité d'une réduction générale des revenus et des dépenses.
Il s'agit évidement d'imiter ce qui s'est passé aux Etats-Unis dans les années 1980 où l'on a assisté à la fois à une réduction des impôts et des dépenses avec un impact favorable sur la croissance. Ceci n'est cependant pas très facile à reproduire en Europe, compte tenu de l'économie sociale de marché à laquelle nous sommes habitués.
M. Joël BOURDIN, Président.- Merci Monsieur Paolo ONOFRI. Je vais laisser la parole à M. Joachim VOLZ.
• M. Joachim VOLZ, Deutsche Institut Für Wirtschaftforschung (DIW, Berlin).-
Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs, si j'ose vous parler en français, c'est en signe de respect pour le lieu où nous avons l'honneur de présenter cette réflexion et aussi de l'initiative prise par le Gouvernement français pour faire figurer dans le traité d'Amsterdam les objectifs en matière d'emploi comme priorité de l'Europe.
Entre-temps et dernièrement, lors du Conseil européen de Cologne, la place centrale de l'emploi parmi les priorités de l'Union européenne a été réaffirmée mais les moyens proposés relèvent moins d'une politique macro-économique coordonnée que de la mise en oeuvre simultanée sur le plan national des politiques de l'emploi, dans l'esprit de la politique de l'employabilité ou de flexibilité britannique.
La France n'est parvenue ni à faire adopter la recherche d'une croissance autour de 3 % parmi les objectifs chiffrés du Pacte, ni à faire accepter l'idée d'une conférence européenne annuelle sur les questions de l'emploi. Conférence à laquelle participeraient aussi bien la Banque Centrale Européenne que les ministères de l'Economie et du Travail et les partenaires sociaux.
En principe, on ne peut créer d'emplois que si la croissance économique est supérieure à la croissance de la productivité. Autre possibilité, le partage du travail, qui peut prendre différentes formes (travail à temps partiel, réduction du temps de travail, préretraite...) : une stratégie ayant comme condition d'augmenter le nombre d'emplois en baissant la durée moyenne du temps de travail.
Toutes les autres mesures des politiques d'emploi visent, soit à une plus grande efficacité, donc une plus forte productivité du travail, soit à une baisse des coûts du travail et ne créent donc pas des emplois.
Il est vrai que la baisse des coûts salariaux unitaires peut augmenter la compétitivité par une dévaluation réelle, et donc les exportations d'un pays.
Comme le montre le cas de l'Allemagne, surtout à partir de 1995, cette stratégie d'augmentations salariales très modestes aboutit également à une croissance très faible de la consommation privée et donc de la croissance économique.
Si vous regardez la comparaison des pays européens, vous pouvez voir qu'après 1995, l'augmentation de la consommation en Allemagne se situait autour de 0,5 % par an, alors que les autres pays avaient une augmentation de la consommation privée de 2,5 à 3 %.
Quel rôle peuvent donc jouer les politiques, dites spécifiques, du marché du travail ?
Avant de répondre à cette question, regardons les plans d'action nationaux, dont les lignes directrices pour 1999 ont été fixées au Conseil européen de Vienne en décembre 1998.
Celles-ci comportent quatre piliers :
- Améliorer l'employabilité, stratégie visant surtout à éviter le glissement du chômeur vers le chômage de longue durée.
- Développer l'esprit de l'entreprise, surtout avec une réduction de la pression fiscale sur le travail.
- Encourager l'adaptabilité des entreprises et de leurs travailleurs, promouvoir la flexibilité.
- Egalité des chances, surtout entre hommes et femmes.
Tout se passe comme si les pays estimaient que la responsabilité essentielle du chômage résidait dans un fonctionnement défectueux du marché du travail et que cette responsabilité restait foncièrement séparée de celle de la politique macro-économique.
Une stratégie libérale pense surtout que le chômage est structurel et préconise la suppression des rigidités du marché du travail, la baisse des salaires, les prestations et les cotisations sociales, à la fois pour diminuer les coûts du travail et inciter les inactifs à travailler.
Les partis de gauche ne pouvaient pas se rallier à cette stratégie. Mais elle inspire fortement les plans d'action nationaux comme la contribution du Chancelier allemand SCHROEDER, présentée la semaine dernière, sur la politique envisagée par les partis sociaux-démocrates.
Une autre stratégie préconise d'enrichir la croissance en emploi par la baisse de la durée du travail et le développement d'emplois dits de proximité, publics et sociaux.
Mais aucun accord global ne permet une harmonisation de telles stratégies en Europe.
La plupart des mesures sont fondées sur une stratégie ciblée visant à accroître l'employabilité par des aides spécifiques à cette catégorie de travailleurs et des réductions des cotisations, surtout pour les plus bas salaires. Des politiques donc dites actives du marché du travail.
De plus, dans de nombreux pays, les plans d'action nationaux sont restés une opération purement administrative, sans négociation et sans réelle prise en charge par les partenaires sociaux.
Le degré d'ancrage et les modalités des politiques actives sont à l'origine assez disparates selon le pays. En général, les plans d'action nationaux se traduisent par le fait que les politiques passives sont peu à peu remplacées par les politiques actives.
Par exemple en Suède, une politique active est obligatoire et remplace la politique d'indemnisation du chômage. En Allemagne et en Autriche, les politiques destinées aux jeunes ont un ancrage, via l'apprentissage surtout.
Dans les pays où la mise en place des mesures actives est bien ancrée dans les politiques du marché du travail, comme en Suède et au Danemark, où elles ont commencé à jouer un rôle majeur dans un passé récent comme dans le Royaume Uni ou la Finlande, les plans d'action nationaux ont surtout confirmé les politiques existantes.
Plusieurs pays comme l'Espagne, la Finlande, la Grèce mais aussi les Pays-Bas procèdent à un réaménagement des politiques de placement. D'autres, comme l'Irlande, réorientent la politique active dans un sens plus préventif. Les politiques actives sont destinées à faciliter le retour des chômeurs sur la marché de l'emploi. La formation, la réinsertion professionnelle, le maintien des liens avec le marché du travail et l'établissement d'un lien entre recherche d'emploi et indemnisation du chômage sont les principaux moyens utilisés pour y arriver.
Nous pouvons cependant observer aussi des effets d'aubaine (l'employeur par exemple aurait recruté même en l'absence de ces aides) ou de pure substitution entre certains groupes de travailleurs.
Dans le cadre d'un chômage élevé, les politiques actives peuvent être justifiées surtout par le souci de maintenir le lien avec le marché du travail et d'améliorer l'employabilité.
Il me semble qu'il existe un problème central : individuellement, chaque chômeur peut augmenter sa chance de retrouver un emploi en améliorant sa formation. Globalement, le problème est avant tout le manque d'emploi et, souvent, les mesures ne peuvent que changer la place dans la file d'attente.
Par ailleurs, la politique de flexibilisation globale visant notamment à assouplir la législation sur la protection de l'emploi, politique fortement recommandée par l'OCDE en 1994, rencontre de plus en plus de réserves. Certains gouvernements opèrent même à l'occasion du plan d'action national même un rééquilibrage de cette stratégie vers moins de flexibilité et plus de sécurité, tels le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas.
Les études empiriques parviennent à établir un lien négatif entre les degrés de protection de l'emploi et la vitesse d'ajustement sur le marché du travail. Il est en revanche difficile de trouver un effet significatif sur le taux de chômage d'équilibre.
Une autre stratégie envisage la réduction des cotisations sociales financées par l'éco-taxe. Soit il s'agit d'augmenter le salaire disponible des travailleurs pour les inciter à ne pas rester oisifs et d'éviter la création de " trappes à la pauvreté ", soit il s'agit d'encourager les entreprises à embaucher plus de travailleurs non qualifiés.
Dans ce cas, la logique veut que la réduction des cotisations employeur soit compensée par une hausse des autres prélèvements sur les entreprises, que ce soit par l'éco-taxe ou bien par une taxation sur la valeur ajoutée. C'est le cas en Allemagne, en Italie et peut-être aussi en France.
En France, la taxe contribuerait à financer une réduction des charges sociales pour les bas salaires afin de faciliter le passage aux 35 heures.
Aux Pays-Bas, la réforme envisagée seulement en 2001 prévoit des crédits d'impôts pour les personnes dont le revenu est compris entre 70 et 100 % du salaire minimum, financés par un redéploiement sur l'imposition indirecte (éco-taxe et TVA).
L'objectif de la réforme est surtout d'inciter les travailleurs à temps partiel à accroître leur nombre d'heures travaillées.
Enfin, il y a encore des stratégies de partage du travail, comme le montre l'exemple unique de la France. Ce type de stratégie est difficile à réussir, en particulier parce que les salariés ne sont pas prêts à accepter des baisses de salaire mensuelles comme aux Pays-Bas où c'est un grand succès.
Quelques conclusions :
Il apparaît qu'une politique uniquement basée sur l'accroissement de la flexibilité et de l'efficacité dans l'ensemble des pays européens, préconisée par l'OCDE en 1994, n'est pas appropriée.
Concernant les politiques actives du marché du travail, nous pouvons conclure par trois propositions :
- La mise en oeuvre des politiques actives à destination des chômeurs de longue durée et des jeunes.
- Des actions plus précoces de prévention de l'exclusion du marché du travail.
- L'accentuation des programmes de formation.
Pour une approche institutionnelle dans le cadre européen, il y a des limites. Dans tous les cas, les mesures ne nécessitent guère de coordination à l'échelle européenne, même si elles sont intégrées dans les plans d'action nationaux.
Etant donné les limites des politiques actives du marché du travail, nous pouvons reprendre la question initiale, à savoir : quel rôle peuvent jouer ces politiques dans le cadre global d'une politique pour l'emploi ?
Les problèmes dits structurels seront d'autant mieux résolus que la croissance sera forte. Les entreprises, comme le montre l'exemple des Etats-Unis, n'hésitent pas à embaucher des travailleurs peu qualifiés, qu'elles forment elles-mêmes.
Malgré tout, après quelques années d'une croissance forte, on peut craindre que les tensions inflationnistes ne se renforcent. Aujourd'hui, les politiques actives du marché du travail sont surtout prévues dans une situation de conjoncture faible et d'un chômage élevé. Cependant, elles seront encore plus logiques et efficaces dans une période de reprise conjoncturelle pour éviter des tensions inflationnistes aussi longtemps que possible à l'aide d'un potentiel de travailleurs très flexible et hautement qualifié.
Les politiques pour l'emploi devraient donc être conçues pour affaiblir le lien entre croissance et inflation et pour baisser le taux de chômage d'équilibre.
Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques idées que je voulais développer devant vous.
-
M. Joël BOURDIN, Président.- Avant de lancer la discussion sur les sujets évoqués, je vais donner la parole à M. Philippe MOUTOT, directeur général adjoint du Service Economie de la Banque Centrale Européenne afin qu'il nous fasse part de ses commentaires et réactions aux propos tenus cet après-midi.
Je vous remercie Monsieur MOUTOT d'avoir accepté de participer à ce colloque, ce qui témoigne d'une véritable volonté de communication de votre grande institution. Mais vous vous exprimez ici à titre personnel, comme économiste, et non comme représentant de la Banque Centrale Européenne. Je vous laisse la parole.
• M. Philippe MOUTOT, Directeur Général adjoint du Service Economie de la Banque Centrale Européenne.-
Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs, Vous savez que l'euro est lancé depuis environ 165 jours. Son introduction sur le plan technique a sûrement été un succès et il a pris une place éminente au niveau mondial. Mais il est encore plus intéressant de remarquer qu'il a définitivement pris une place centrale dans le débat économique et politique et qu'il amène à situer de plus en plus les débats nationaux dans un contexte européen.
Le sujet de ce colloque est à mon avis tout à fait pertinent et la Banque Centrale Européenne, par mon intermédiaire, est heureuse de pouvoir s'y associer.
L'analyse des perspectives économiques, qui est un peu notre travail de tous les jours, est absolument essentielle pour conduire la politique monétaire. Je vais donc m'efforcer de commenter les très nombreux sujets traités, en tant que banquier central, en passant en revue les différents aspects de notre travail.
Je commencerai par ce que j'appelle la stratégie de politique monétaire, déjà largement débattue. J'essayerai de continuer en donnant des exemples concrets d'application dans la vie réelle - pourquoi ne pas prendre les décisions les plus récentes ? - et je finirai sur les questions de taux de change et de coordination des politiques économiques.
Concernant la stratégie de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, l'objectif de la stabilité des prix a été clairement affirmé par le traité de Maastricht mais sa mise en oeuvre n'a pas été décrite dans le traité. Celle-ci impose la transparence, nécessaire à toute institution indépendante dans un contexte démocratique, et une certaine efficacité pour laquelle il est essentiel de définir une stratégie qui ne figure pas dans le traité.
Cette définition de la stratégie doit être effectuée par la Banque Centrale Européenne, ce qu'elle a entrepris de faire dès sa création, en se disant qu'il fallait élaborer une procédure claire et connue de prise de décision et une procédure de communication avec le public.
Le premier élément est la définition de notre objectif ; la clarté commence là. La clarté, pour nous, consiste à définir la stabilité des prix comme une croissance de l'indice des prix à la consommation, harmonisé au niveau européen, entre 0 et 2 %. C'est dire que la stabilité des prix doit être maintenue à moyen terme.
Pourquoi ces éléments ? Tout d'abord, le taux de O à 2 % tient compte d'un certain biais statistique existant toujours dans le calcul de l'indice des prix. Nous ne pouvions pas être extrêmement précis étant donné que ce biais statistique est difficile à estimer en Europe, particulièrement en ce moment, mais nous espérons avoir une idée plus précise dans le futur.
Ce choix reflète l'idée simple selon laquelle l'inflation est à moyen et long terme nocive à la croissance. C'est clairement le cas lorsque l'inflation est importante mais, à notre avis, ça l'est également lorsque l'inflation est limitée. Nous y voyons pour preuve les démonstrations faites par FELDSTEIN, évoquées dans l'étude présentée par le COE, et montrant qu'au plan micro-économique, l'inflation crée des distorsions importantes.
Nous pouvons quelquefois dire qu'elle facilite la négociation des salaires. En revanche, elle ne facilite pas la négociation des investissements et les rend beaucoup plus incertains. Tant et si bien que lorsque nous regardons, dans la pratique, par exemple les dernières études faites aux Etats-Unis, pour essayer de mesurer cette inflation optimale, nous nous apercevons qu'elle est entre O et 2 %.
Nous sommes donc assez opposés à un seuil minimum d'inflation plus élevé parce que nous ne pensons pas qu'il y a d'étude vraiment convaincante pour la défendre. A notre avis, la mesure des ratios de sacrifice est certainement contestable, car cela repose sur l'idée que l'on pourrait très facilement calculer la production potentielle. Nous étudions cette question et nous avons suivi un peu tous les indices statistiques produits par de nombreux instituts ou organismes internationaux. Malheureusement leurs résultats ne sont pas tous concordants, loin s'en faut, de sorte qu'il demeure une énorme incertitude à cet égard.
Nous avons aussi une autre crainte : en donnant un taux d'inflation minimum trop important, on peut finalement obscurcir le débat. En " mettant de l'huile " dans l'économie, nous avons l'impression que l'on cache ou repousse le débat sur les structures économiques, leur flexibilité, leur efficacité, leur adéquation. Il est important, quand l'inflation est basse, d'être très clair sur ces éléments structurels.
Nous avons l'impression qu'il faut clairement poser les problèmes et ne pas faire supporter à la politique monétaire plus de responsabilité qu'elle ne le doit. Finalement, nous pensons que la désinflation dans certains cas peut être très positive. Regardez par exemple ce qui s'est passé ces dernières années en Espagne ou au Portugal : une désinflation assez rapide, malgré une croissance soutenue.
Il faut donc prendre un point de vue extrêmement général, sans ignorer un élément important : il faut un minimum nous garantissant contre un vrai risque, celui de la déflation. C'est pour cela que nous avons fait apparaître que notre définition de la stabilité des prix se situait entre 0 et 2 %. Nous avons bien l'intention d'éviter cette déflation à tout prix.
Au-delà de la définition, il faut expliquer comment les décisions sont prises. Nous avons proposé deux piliers : l'un monétaire et le second appelé évaluation des perspectives d'évolution des prix.
Le pilier monétaire, vous le connaissez, c'est une valeur de référence pour la croissance de l'agrégat monétaire M3. Pourquoi l'avons-nous choisi ? Nous pensons qu'à moyen terme, l'inflation est un phénomène monétaire et nous savons, d'après les études que nous possédons - et que nous allons bientôt publier - que pour l'instant, la demande de monnaie est relativement stable dans l'Europe considérée globalement. Et ce, à l'inverse de ce qui a pu être observé au niveau des différents pays.
Bien sûr, son évolution de court terme ne fournit qu'une référence, pas plus, et dans ce sens, nous ne voulons pas suivre mécaniquement un agrégat monétaire. Ceci est parfaitement reconnu et justifie que nous ayons un second pilier, celui correspondant à l'évaluation des perspectives d'évolution des prix.
Pour ce faire, nous avons recours à un ensemble d'indicateurs : indicateurs de l'économie réelle, indicateurs financiers, projections économiques. Nous procédons à un investissement important grâce à un système de projection économique permettant de voir l'évolution de la zone euro en elle-même comme celle de chacun de ses pays.
Nous ne nions pas la méthode de projection économique et nous espérons nous en servir. Cela dit, nous pensons que dans un monde où les modèles économiques ne traduisent qu'imparfaitement la réalité, nous ne devons pas faire confiance à une seule méthode. Nous devons utiliser de multiples approches, regarder ce que donnent les projections d'inflation et de croissance, mais ne pas rester complètement prisonniers de ces concepts et faire également appel à d'autres analyses.
Nous ne sommes pas en faveur de règles systématiques. Il faut que la Banque Centrale Européenne garde une certaine discrétion dans son approche pour pouvoir prendre en compte les nouvelles informations ne figurant pas dans les modèles.
La difficulté pour la Banque Centrale Européenne est de garder cette flexibilité, cette discrétion dans son appréciation, tout en étant transparente. C'est pour cela que le troisième élément de notre stratégie est une communication effective. Nous avons donc décidé de présenter de manière immédiate et détaillée l'ensemble de nos décisions à la presse quelques minutes après qu'elles ont été prises.
Le Président de la Banque Centrale Européenne fait une conférence de presse et répond à toutes les questions posées. Nous publions également un bulletin mensuel dans lequel nous donnons tous les raisonnements économiques détaillés pouvant justifier nos décisions, et organisons un certain nombre d'apparitions annuelles du Président de la Banque Centrale Européenne au Parlement.
Je vous invite, concernant ces apparitions, à consulter le compte-rendu des débats sur notre site Internet. Vous verrez que ceux-ci sont assez détaillés et j'espère qu'ils le deviendront de plus en plus.
Voilà pour la stratégie suivie.
Quelques mots sur l'application des décisions monétaires récentes, afin de donner un exemple : pourquoi avons-nous baissé les taux d'intérêt de nos opérations principales de refinancement en avril ? Pas parce que nous avions l'impression qu'il y avait une information extrêmement nette en provenance des agrégats monétaires ou des agrégats de crédit mais parce que nous pensions que des risques non négligeables apparaissaient.
Une potentialité de retournement de la croissance se manifestait, car un choc extérieur commençait à se produire directement en Europe avec une possibilité de chute des investissements et des stocks, et donc de diminution de la confiance des agents économiques.
Notre décision n'était pas basée sur le fait que nous avions l'impression que ceci se produirait nécessairement, mais sur l'idée qu'il y avait un risque que nous devions prendre en compte.
Depuis, nous n'avons pas modifié les taux d'intérêt et nous avons l'impression d'observer un rééquilibrage des risques en Europe. Certes, la remontée des prix du pétrole a tendance à faire remonter l'indice des prix à la consommation, tout en le maintenant sous la barre des 2 %, mais nous avons aussi l'impression que la confiance revient chez les industriels, comme un certain nombre d'indices le fait apparaître. Finalement, le premier trimestre 1999 a été plus favorable que prévu. Je peux vous assurer que nous prenons en compte l'ensemble des éléments économiques dans notre réflexion. Je fais part toutefois d'un certain scepticisme sur l'impact des modifications de taux d'intérêt tel qu'il est parfois retracé dans les modèles. Nous avons l'impression, en effet, que les taux d'intérêt peuvent avoir un impact à court terme, mais que celui-ci disparaît assez vite à moyen terme. Nous ne sommes donc pas persuadés que les projections présentées faisant apparaître un impact important sur le moyen long-terme sont vraiment crédibles.
Un certain nombre de questions ont été posées, telle l'évolution des salaires. Pour l'instant, nous n'avons pas trop d'inquiétude à ce sujet, mais c'est à surveiller car cette évolution est essentielle au maintien d'une stratégie d'emploi.
Nous avons aussi quelques incertitudes sur la productivité future. Nous aimerions être sûrs que nous passons dans une nouvelle économie, que le nouveau paradigme américain s'applique à l'Europe. C'est une chose que nous n'excluons pas. Mais avant de l'envisager sérieusement, il faut avoir des données le faisant apparaître et, pour le moment, nous restons encore sceptiques sur ce point.
J'en viens au problème du taux de change. Nous avons affirmé clairement que nous n'avions pas de cible de taux de change, car c'est incompatible avec une politique monétaire recherchant la stabilité des prix. Cela ne signifie pas que nous ignorons ceux-ci. Nous considérons qu'ils sont un indicateur très important, que nous prenons en compte dans notre analyse économique, mais ce n'est qu'un indicateur parmi d'autres.
Ceci nous amène à insister sur le fait que de toute manière, et en accord avec le traité de Maastricht, la politique de change doit toujours être compatible avec la stabilité des prix. La conséquence institutionnelle de cet élément est que le Conseil ECOFIN peut donner des orientations générales, qui ne peuvent prendre effet que dans des circonstances exceptionnelles.
Nous n'envisageons pas d'accords de zone cible, pensant qu'ils sont contre-productifs. Les déterminants des taux de change sont in fine les différentes politiques monétaires, budgétaires, structurelles. Parfois, la spéculation amplifie ces déterminants ; il faut en tenir compte.
Les déterminants fondamentaux sont les politiques économiques. Celles-ci doivent être orientées vers la stabilité. Il faut donc prêter une large attention aux politiques fiscales et structurelles ; c'est à notre avis la meilleure manière de stabiliser les marchés financiers.
Nous ne sommes pas inquiets quant à l'évolution de l'euro. Nous ne souhaitons pas le voir se déprécier au-delà de ce qui a été observé, mais nous reconnaissons que c'est partiellement dû à un décalage conjoncturel avec les Etats-Unis et une idée qui s'est répandue sur une différence de productivité et de croissance à long terme, qui va probablement se corriger à partir du moment où l'on verra repartir l'économie européenne. Sur le moyen terme, nous sommes certainement optimistes quant à l'euro.
Je voudrais conclure sur la relation entre la politique monétaire et les autres politiques économiques. A notre avis, il est très important que la répartition des responsabilités issues du traité de Maastricht soit respectée. Cela pose la question de l'interprétation du mandat ou des statuts de la Banque Centrale Européenne.
Cette dernière, comme l'ensemble des autres institutions européennes, soutient certainement l'ensemble des politiques économiques de l'Union, incluant la stabilité des prix mais également la croissance, le développement de l'emploi. Ce qui doit rester clair toutefois, c'est que l'euro système en tant que tel, comme institution, a une responsabilité primordiale qui lui est clairement affectée : celle de la stabilité des prix.
La meilleure contribution qu'un banquier central puisse faire à la croissance sur le moyen long terme, c'est certainement la stabilité des prix, absolument essentielle à cette croissance.
Je suis donc assez peu favorable à une idée qui voudrait que nous redessinions, reconstruisions sans arrêt le tissu institutionnel européen. Certes, il faut évoluer de temps en temps mais la crédibilité est indissolublement liée à la stabilité. Lorsque l'on a fait un choix, il faut savoir s'y tenir, aussi longtemps qu'il n'apparaît pas déraisonnable de le faire. Il est très important d'avoir cette stabilité, cette crédibilité, cet ancrage présents à l'esprit.
Cela m'amène à dire que le Pacte de croissance et de stabilité doit être respecté à la fois dans son esprit et dans sa lettre. Ce n'est pas un carcan, car des déficits budgétaires proches de l'équilibre permettent, avec une limite à 3 %, de retrouver des marges de manoeuvre significatives en cas de choc. Ce sont des marges de manoeuvre tout à fait suffisantes.
Il apparaît important à l'heure actuelle de créer ces marges de manoeuvre et non pas de se plaindre d'un éventuel système qui limiterait la liberté d'action des Gouvernements. Dans la situation actuelle, s'il y avait un problème majeur, un certain nombre d'éléments de flexibilité dans ce Pacte permettraient des accommodements. Mais l'important est surtout de créer la marge de manoeuvre qui, à terme, permet de répondre à ces chocs.
Il ne faut donc pas rater les occasions et prendre conscience d'un fait : nous sommes tous en Europe. Nous avons besoin de contraintes uniformes, compréhensibles et acceptables par chacun. Dans ce cadre, il est très difficile d'imaginer des contraintes différentes pour les uns et les autres, renégociées sans arrêt, discutées et qui, finalement, perdent leur légitimité.
Si nous voulons être ensemble, il faut accepter qu'un certain nombre d'institutions existent, de manière durable.
Cette répartition des responsabilités est à mon avis compatible avec une très large coopération, existant déjà dans le cadre du Conseil ECOFIN, du Comité économique et financier et de l'euro 11. Elle est renforcée par le Pacte pour l'emploi qui, comme cela a été expliqué, instaure un dialogue.
Il faut bien avoir à l'esprit qu'il faut différencier coopération et coordination. Une coopération permet d'échanger des idées, d'atteindre le meilleur résultat. Sur un plan théorique, une coordination ex ante peut, si elle est décidée par une entité supérieure, donner de bons résultats. Mais en pratique, une coordination se faisant entre onze Gouvernements plus une Banque Centrale ne peut arriver, si elle est basée sur des règles, qu'à un résultat sous-optimal.
Nous préférons continuer dans la voie d'une solution nous amenant à une clarté et à une transparence maximale dans le dialogue. C'est la meilleure réponse au problème du poker à onze évoqué par M. BARRELL. Si vous voulez avoir un poker à onze, c'est possible mais c'est sous-optimal et cela suppose bien sûr que vous cachiez vos cartes. Puisqu'il faut les montrer dans un souci de transparence, il ne faut pas de poker à onze, ni une coordination automatique se substituant au dialogue.
Il faut en tout cas faire face aux véritables décisions structurelles en matière de dépenses publiques, de retraite - et là je suis totalement d'accord avec ce qui a été indiqué par M. ONIFRI - et rechercher, par des politiques structurelles, l'émergence d'une forte productivité.
Là aussi, attention aux mythes. La productivité se crée au sein des différents acteurs économiques. L'Etat peut encadrer - c'est sûrement dans le domaine de l'éducation qu'il peut apporter sa meilleure contribution - mais j'ai du mal à imaginer qu'il puisse lui-même, dans le détail, trouver les manières d'augmenter très fortement et très rapidement cette productivité.
La Banque Centrale Européenne entend assumer toutes ses responsabilités tout comme elle souhaite que les Gouvernements assument les leurs entièrement.
M. Joël BOURDIN, Président.- Merci pour ces quelques commentaires. Je pense que vous allez encore être à contribution, Monsieur MOUTOT, comme l'ensemble des intervenants car le temps est venu des questions et commentaires.
Je demande à ceux voulant poser des questions ou avoir des informations complémentaires de se manifester.
• Discussion
L'une à M. de BOISSIEU qui disait tout à l'heure que parmi les marges de manoeuvre étudiées dans son étude, il y avait notamment la baisse des charges sociales patronales mise en oeuvre conjointement par plusieurs pays européens.
Je suis assez surpris de voir que l'on parle toujours de la baisse des charges patronales et jamais d'une baisse des charges salariales. Au cours des années 90, une baisse très importante des charges patronales a eu lieu notamment sur les bas salaires. Or, je suis toujours assez étonné de voir des chefs d'entreprise, artisans ou commerçants de PME, ne pas très bien savoir faire la différence entre charges salariales et patronales. L'idée étant que chaque trimestre, ils ont tout cela à payer.
Au niveau psychologique, il y a peu de différence mais, en termes économiques, il y en a beaucoup. Je me suis toujours demandé s'il n'aurait pas mieux valu faire porter la baisse et sur la part patronale et sur la part salariale. Cela aurait relancé la consommation et n'aurait pas eu de répercussion sur les recettes de l'Etat.
J'aimerais savoir si cette question a été étudiée par les modélisateurs.
Deuxième question concernant l'ensemble des économistes représentant les instituts d'analyse économique des pays étrangers. En France, un problème se pose en matière sociale : la quasi non-différence de revenus disponibles, y compris aides et prestations sociales, entre ceux qui travaillent et ceux ne travaillant pas. Je parle des personnes au niveau du SMIC. Entre un RMIste et un salarié payé au SMIC, la différence est de 200 à 300 F par mois à peine.
A votre avis, dans nos divers pays, la volonté de reprise de travail est-elle suffisamment importante ou une telle politique sociale aboutit-elle à une démotivation ?
Une dernière remarque : je suis assez surpris de ce que nous a dit M. MOUTOT sur les taux d'intérêt. J'ignore ce que l'on appelle le court, moyen et long terme mais en termes de consommation, quand on achète une voiture en payant des taux d'intérêt à 15 % ou à 5 %, même si, bien sûr, l'inflation peut compenser la différence mais cela n'a pas du tout la même connotation en termes de choix personnel.
Je ne parle pas du bâtiment. En termes d'habitat, je suis très étonné en France, aujourd'hui, de voir combien la relance du bâtiment est forte sur des ménages assez jeunes qui n'envisageaient absolument pas de construire il y a quatre ou cinq ans. Je ne pense pas qu'ils tiennent le raisonnement selon lequel " l'inflation peut nous faire rattraper nos taux d'intérêt ". Ils raisonnent aujourd'hui par rapport à leurs salaires en termes de remboursements mensuels. Le taux d'intérêt est inclus, pour eux, dans le coût. On raisonne en valeur absolue et pas toujours en valeur relative quand on consomme. Et là, je ne sais pas si ce n'est que sur le court terme.
C'est une remarque et non pas une question. J'imagine que les uns et les autres ont des avis tout à fait différents d'après ce que j'ai entendu cet après-midi.
M. Joël BOURDIN, Président.- M. de BOISSIEU souhaite répondre.
M. Christian de BOISSIEU, Directeur scientifique du Centre d'Observation Economique (COE) de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.- En ce qui concerne les charges sociales, dans les modèles, nous avons étudié les deux aspects, c'est-à-dire le côté salarié et le côté employeur.
Comme vous l'avez dit vous-même, il y a des phénomènes de vase communiquant dans la politique salariale. Dans la politique de négociation entre les entreprises et les salariés, il est clair qu'il n'est pas toujours évident de faire une distinction totale.
Même si ces phénomènes existent, la différenciation existe également. Au départ, l'analyse des économistes consiste à dire que dans un cas, la baisse des charges sociales du côté salarié, on s'intéresse à l'effet sur le niveau des salaires et sur la consommation. Dans l'autre, ce qui nous intéresse et c'est pour cela que nous avions privilégié ce travail, c'est l'effet sur le coût du travail et les problèmes d'élasticité, de sensibilité de la demande de travail des entreprises en fonction de la partie indirecte du coût du travail.
Cet après-midi, un aspect de cette question, concernant la sensibilité différentielle de la demande de travail des entreprises en fonction du niveau de rémunération, n'a pas été évoqué. Il est clair qu'il faut faire la distinction entre travail qualifié et non qualifié, même si les spécialistes du marché du travail nous disent que certains travaux qualifiés peuvent être moyennement rémunérés. Le clivage entre haute et basse rémunération ne recouvre pas à 100 % le clivage entre travail qualifié et non qualifié.
Par ailleurs, comme vous, j'ai été intéressé et en même temps étonné de ce qu'a dit Philippe MOUTOT à propos de l'impact limité des taux d'intérêt sur l'activité.
Dans la variante politique monétaire, nous testons les conséquences d'une baisse du taux d'intérêt. Il est clair que celles-ci ne sont pas les mêmes quand on passe de 10 à 9 % ou de 5 à 4 %. C'est un peu cela le problème. La Banque Centrale a baissé son taux directeur de 50 points de base le 8 avril, à partir d'un niveau déjà considéré comme relativement bas.
Je n'irais pas pour ma part, indépendamment des modèles, jusqu'à défendre la thèse que cela n'a aucune incidence. Ce n'est pas ce qu'a dit Philippe MOUTOT mais, en France, c'est quelque chose que l'on a entendu. Je le dis parce que parfois les mêmes, qui réclament depuis dix ans une baisse des taux, ont soutenu tout à coup la thèse que celle-ci n'avait aucune importance ni influence, ce qui est surprenant.
Nous ne sommes pas en situation de " trappe à liquidités " à la japonaise où la baisse des taux n'aurait aucune incidence sur l'économie réelle. En baissant le taux d'intérêt de 50 points de base, à partir d'un niveau déjà bas, il n'y a pas de miracle à attendre : nous sommes d'accord, mais nous le sommes aussi sur le fait que l'effet d'annonce peut être positif.
J'insiste sur ce point car nous avons entendu en France un certain nombre d'économistes dire que la Banque Centrale Européenne avait eu tort car cela ne servait à rien. Je ne participe pas du tout à ce courant ; je m'oppose à la thèse de l'indifférence ou même du côté pervers de la baisse des taux du 8 avril, considérant qu'il fallait utiliser toutes les marges possibles.
Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Philippe MOUTOT, bien que n'étant pas banquier central, sauf sur un point, sur lequel j'aimerais qu'il revienne, quand il nous dit que la Banque Centrale a symétrisé son objectif d'inflation : dans la pratique, oui. Pour l'instant, officiellement, l'objectif d'inflation de la Banque centrale est inférieur à 2 %.
La politique du 8 avril a bien montré que la Banque Centrale Européenne était préoccupée par le risque de ralentissement, voire de pression déflationniste. Mais comme je l'ai déjà dit devant Philippe MOUTOT à une autre occasion, je souhaite que la Banque Centrale soit transparente, et qu'elle clarifie sa politique. Et donc que pour l'an 2000 et après, celle-ci ait un objectif d'inflation officiellement symétrique. Qu'elle dise par exemple pour l'année 2000, pour la zone euro : « Le taux d'inflation devra être compris entre 0 et 2 %. » Qu'elle le dise, que ce ne soit pas a posteriori que l'on redécouvre cette symétrie dans le comportement de la Banque Centrale.
M. Philippe SIGOGNE, Directeur du Département d'Analyse et de Prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).-
J'ai bien écouté ce qui a été dit. Je souscris à la nécessité de la transparence qui était bien présentée. J'avais l'impression que le 0 - 2 % était déjà clairement explicité par certains messages de la Banque et même 0 plus quelque chose et 2 % à cause du biais statistique que l'on ne connaît pas exactement. Cela étant, indépendamment du débat sur les taux, de leur influence ou pas, deux choses me surprennent.
D'une part, même si dans le contexte actuel, les taux n'ont pas nécessairement une énorme influence, ils en ont habituellement au moment des retournements conjoncturels, mais pas nécessairement dans l'ensemble du cycle. Il y a donc peut-être 80 % du cycle où cela n'a pas d'influence et 20 % où cela peut en avoir une forte.
L'un des aspects actuels qui peut jouer un rôle, c'est la détermination du prix des actifs en résultant. Car il est certain que les décisions de la Banque Centrale ont une influence sur les taux à long terme à un moment donné et donc sur les actifs. Ce point n'a pas été abordé tout à l'heure dans les différents indicateurs que la Banque Centrale peut prendre en compte.
Deuxième question : j'ai été à la fois intéressé et inquiété par la remarque suivante : on a cru un moment à la Banque Centrale qu'il y avait un risque de chute des investissements et des stocks. C'est pour cette raison essentiellement, et pas pour d'autres liées aux agrégats monétaires, que l'on a baissé les taux d'intérêt.
Or aujourd'hui, vous nous dites que cette inquiétude a disparu. Dois-je en déduire que la semaine prochaine ou dans un mois, nous remettrons les taux d'intérêt au niveau qui était le leur avant cette baisse ?
M. Philippe MOUTOT.- Concernant l'impact des taux, je n'ai peut-être pas bien transmis mon message. Je n'ai certainement pas voulu dire que les taux n'avaient aucun effet. J'ai voulu dire que les taux avaient un effet à court terme mais que si l'on essayait de faire passer l'idée qu'un mouvement de taux avait un effet quatre, cinq ou six ans après, j'avais des doutes. Surtout si l'on me dit qu'il est très significatif à ce moment-là.
Je crois que ce n'est pas vrai, tout simplement parce qu'à un moment ou à un autre, les prix réagissent et l'impact de la baisse des taux d'intérêt va être compensé. Mon propos est de souligner qu'une mesure de taux d'intérêt a un impact de court terme, qui disparaît après un certain temps. Elle risque, si elle est maintenue, d'en avoir un très net sur l'inflation !
Si l'on enchaîne effectivement les baisses de court terme continûment, on aura peut-être pendant quelque temps un impact sur la production mais, très vite, on aura un envol de l'inflation et certainement une chute de la production. Pour nous, c'est une sorte de sagesse bien reconnue, sur laquelle nous n'avons pas vraiment de doute.
Cela dit, nous avons pris justement une décision le 8 avril parce que nous avions l'impression qu'il y avait certains risques.
Quelle est la situation actuelle ? Je ne dirai pas que ces risques ont disparu mais simplement qu'ils sont plus équilibrés. Je ne vous dirai pas quelle est la meilleure prévision de taux, sauf que le taux le plus récent est probablement le meilleur prédicateur, pour l'instant.
Je serais tout à fait d'accord pour considérer que le prix des actifs est quelque chose à retenir. C'est un élément que nous observons. Je crois ne trahir aucun secret en disant que dans les dossiers que nous donnons à notre conseil pour justifier ou argumenter ces décisions de politique monétaire, nous avons inclus l'analyse de tous les marchés boursiers européens.
Nous essayons de développer des indices synthétisés, ce qui n'est pas très facile, et de développer le suivi des marchés de l'immobilier, mais c'est encore très partiel. Cela pose des problèmes statistiques non négligeables. De toute façon, nous ne l'ignorons pas.
L'un des éléments nous amenant à regarder encore ce problème d'actifs plus précisément, c'est l'évolution du crédit que nous observons. Comme vous le savez, ce dernier progresse relativement rapidement et l'une des explications possibles - nous n'en sommes pas sûrs -, c'est effectivement le crédit à l'immobilier dans un certain nombre de pays.
Nous ne sommes pas pour le moment très inquiets. Nous savons qu'il y a de multiples facteurs, que ce crédit peut être adressé à l'étranger pour financer d'autres opérations sur d'autres places que les places européennes. Nous avons des doutes et ne savons pas encore comment l'interpréter. Mais nous regardons bien les prix d'actifs dans ce contexte.
M. Joël BOURDIN, Président.- Merci. Une question était adressée à nos autres intervenants.
M. Joachim VOLZ.- Concernant les incitations au travail, surtout pour les gens ayant de bas salaires : on peut baisser les prestations sociales et même les salaires minimum mais, à la fin, quand le cadre macro-économique reste toujours le même, cela signifie que la pression sur le marché du travail augmente et qu'il y a une pression sur le salaire. S'il y a une baisse de salaire avec une telle mesure, c'est aussi une baisse pour la consommation privée entraînant plusieurs conséquences. Certains disent que cela va augmenter notre compétitivité et même la productivité car s'il y a pression sur les chômeurs, chacun, individuellement, va essayer d'avoir une formation et d'être plus productif. Ce qui, en soi, ne crée pas plus d'emplois.
Mais cela doit s'accompagner d'un changement de la politique macroéconomique. Sinon on augmente, comme en Allemagne au milieu des années 95, la compétitivité vis-à-vis de l'étranger. On a plus d'exportations mais moins de consommation privée.
En Allemagne, en 1998 par exemple, la consommation privée commençait à augmenter un peu plus vite, mais durant les deux dernières années, la reprise allemande s'était basée surtout sur les exportations. L'Allemagne était ainsi plus touchée que la France par la crise asiatique parce que la consommation privée était encore plus faible. Il n'y avait pas de compensations. Cela explique un peu la différence du développement conjoncturel entre l'Allemagne et la France.
A un journaliste me demandant pourquoi les résultats des élections européennes étaient si différents, j'ai répondu qu'en France, la croissance était peut-être plus élevée grâce à la politique française. Cela signifie plus de créations d'emploi, même si le taux de chômage ne baisse pas tellement. Il y a toutefois beaucoup plus de créations d'emploi en France qu'en Italie, en Allemagne, etc. Cela peut être une explication.
Ce n'est pas si simple. On peut constater des abus au niveau des prestations sociales mais baisser celles-ci n'aide pas toujours à créer des emplois.
M. BOURDIN, Président.- D'autres observations ?
Je crois que le moment est venu de vous remercier de votre participation à ce colloque où se sont échangées bien des observations qui alimenteront notre réflexion pour les prochains mois.
Soyez certains que la Délégation pour la Planification et le Sénat tout entier s'enorgueillissent d'avoir pu organiser un débat de cette qualité.
ANNEXE
Croissance, inflation et emploi dans la zone euro
Réflexions sur le sentier de croissance
européenne
à moyen terme
par Ch.
de Boissieu
*(
*
)
et MC. Marchesi
*(
*
)*
Contribution au XIVème colloque de réflexion économique
du Sénat :
Quelles perspectives de croissance dans la zone euro ?
le 16 juin 1999
L'introduction de l'euro a été, sans conteste,
une
réussite technique. Il reste maintenant à en faire un
succès économique, social et politique. L'ambition pourraît
paraître démesurée. Elle est en fait à la hauteur
des défis auxquels l'Europe est confrontée.
L'Europe connaît un chômage élevé, même s'il a
reculé depuis plusieurs trimestres. Les comparaisons Etats-Unis/zone
euro nous font rêver à un "nouvel âge" semblable à
celui des Etats-Unis depuis près de huit ans sans que d'ailleurs les
composantes de la nouvelle économie américaine aient
été elles-mêmes déterminées avec
précision.
L'objet de cet article n'est pas de fournir des prévisions
macroéconomiques à l'horizon de cinq ans pour la zone euro. Il
est d'éclairer les sentiers possibles de cheminement de l'inflation, de
la croissance et de l'emploi dans cette zone en combinant plusieurs
approches : l'interprétation des évolutions passées
et récentes, certains raisonnements analytiques, des comparaisons
internationales, enfin certains exercices de simulation effectués en
s'appuyant sur un modèle macro-économétrique
multinational, le modèle OEF (voir annexe 1).
Après avoir étudié la dynamique des prix et de la
croissance dans la zone euro (I
ère
partie), nous analyserons
les marges de manoeuvre disponibles à court et à moyen terme
(II
ème
partie).
I. La dynamique des prix et de la croissance dans la zone euro
La
désinflation est l'un des phénomènes marquants intervenus
en Europe depuis le début des années 1980. Même si
aujourd'hui elle fait l'objet d'un large consensus, elle doit être
analysée en elle-même mais aussi dans ses relations avec la
croissance et l'emploi. Le débat sur les avantages et les coûts de
la désinflation n'a donc pas été évacué par
l'expérience de ces dernières années. L'objet de cette
partie est de revenir sur certains aspects du phénomène de
désinflation et d'aborder dans une perspective dynamique le sentier de
croissance dans la zone euro.
1.1. La désinflation
1.1.1. Le processus
L'arrivée de l'euro en 1999 s'est produite dans un contexte de basse
inflation en Europe, cette dernière atteignant un niveau historiquement
faible.
Des chocs extérieurs à la zone euro et agissant sur les
conditions de l'offre ont favorisé et amplifié la
décélération des prix ; la baisse des prix du
pétrole et celle des matières premières constituent une
cause centrale. Plus globalement, la crise asiatique survenue deux ans
plus tôt en faisant émerger des surcapacités substantielles
a contribué à relâcher davantage les pressions sur les prix.
Dès lors, des facteurs externes sont également à l'origine
de ces records historiques.
Notre propos, sans écarter les événements récents
qui ont toute leur importance pour expliquer la dynamique
macroéconomique internationale et notamment une part des performances de
l'économie américaine, tend à se recentrer sur les
facteurs structurels à l'origine des performances européennes en
matière de désinflation et s'interroge sur la possibilité
et l'opportunité de parvenir à une stabilité des prix dans
la zone euro.
En agissant de la sorte, notre préoccupation est de nous greffer sur le
débat d'actualité portant sur le rôle et les objectifs de
la BCE.
Il y a encore quinze ans, les records obtenus sur le plan de l'inflation dans
les pays industrialisés étaient loin d'être
considérés comme aisés à atteindre. Or, la
décennie en cours a connu non seulement la disparition progressive des
processus d' "hyper inflation" dans un nombre important de pays
émergents mais aussi la poursuite du tassement des rythmes d'inflation
déjà faibles dans les pays industrialisés.
La stabilité des prix est-elle souhaitable ou celle de l'inflation
est-elle suffisante ? Son influence sur la croissance réelle est-elle
positive ? Modifie-t-elle les conditions de la croissance de l'emploi ?
Ces questions restent centrales si l'on souligne le contraste entre les
performances en matière de désinflation en Europe et les
évolutions, quant à elles, inquiétantes du chômage
dans la même zone. Les mutations du système financier qui ont
accompagné l'entrée dans ce régime d'inflation basse,
voire quasi nulle, ont simultanément développé les
structures indispensables pour garantir, si ce n'est la stabilité des
prix, au moins le contrôle de leur progression à des rythmes
modérés. Dans les pays développés, cette nouvelle
architecture monétaire et financière n'a fait que se consolider
avec les années (indépendance des banques centrales,
définition de nouvelles cibles en politique monétaire, etc...).
Si l'on se projette quinze ans en arrière, le monde industrialisé
sortait d'une longue phase durant laquelle l'inflation avait
prédominé. Ce qui contrastait fortement avec la période de
stabilité des prix et de croissance soutenue qui avait prévalu
après la seconde guerre mondiale. L'origine des chocs inflationnistes
majeurs a été externe aux économies
développées (chocs pétroliers) mais la réaction des
politiques économiques pour contrer la vague inflationniste puis les
poussées récessionnistes qui lui ont succédé, est
tenue en partie pour responsable de l'émergence de conséquences
graves et aujourd'hui bien connues en Europe : persistance de l'inflation,
phases de récession ou de croissance molle enfin (et surtout),
montée et persistance du chômage.
L'ampleur des impacts néfastes de ces chocs inflationnistes, pourtant
symétriques à tous les pays, a donc été variable en
fonction des économies. La capacité d'adaptation des conditions
de production, l'importance des rigidités nominales, enfin la
réactivité et les priorités de la politique
économique ont fait la différence.
Les enseignements tirés de ces différents épisodes ont
été nombreux.
Tout d'abord, l'inflation est apparue comme un phénomène qui
pouvait avoir un caractère "persistant". Lorsqu'un choc inflationniste
intervient et qu'il n'est pas corrigé par des politiques
adéquates, alors les risques de le voir se propager et persister dans le
temps sont importants.
Ensuite, la réaction de la politique monétaire est cruciale et la
crédibilité des autorités monétaires qui la
détermine l'est tout autant car les anticipations d'inflation
participent à la persistance de cette dernière (à la suite
du premier choc pétrolier, la politique monétaire allemande a
ainsi enrayé le processus inflationniste très rapidement par
opposition à la réaction de la politique économique
française).
Enfin, la formation des salaires et l'absorption du choc inflationniste et
récessionniste par le marché du travail (notamment, l'ajustement
de l'évolution des salaires réels à la chute des gains de
productivité) constituent des éléments d'ajustement
primordiaux. Les divergences qui se sont manifestées sur ce plan entre
les grandes économies ont été fortes. Aux Etats-Unis, le
coût réel du travail a augmenté de moins de 10% de 1970 au
milieu des années 1980 tandis que dans la zone euro, l'évolution
a approché un taux de 50%
.
La forte réaction des économies développées au
second choc pétrolier a ensuite inauguré leur entrée dans
une phase d'ajustement majeur marquée par des politiques
économiques dirigées prioritairement dans la lutte contre
l'inflation.
A cette phase d'ajustement a succédé une phase
d'approfondissement et de consolidation dans les années 1990 qui a
conduit à la situation actuelle dans laquelle les taux d'inflation sont
parvenus à des niveaux historiquement bas. Le contrôle de
l'inflation qui reste néanmoins prioritaire semble désormais
à la portée de la majorité des économies
industrialisées.
Le chemin pour parvenir en 1999 à l'avènement de l'euro a
été laborieux pour un grand nombre de pays européens.
Outre cette maîtrise de l'inflation, des efforts considérables ont
été déployés pour réaliser l'assainissement
budgétaire imposé par l'UEM sans lequel d'ailleurs les
performances sur le terrain de l'inflation n'auraient pas été
atteintes.
L'arrivée de l'euro se fait donc dans un contexte d'inflation quasi
nulle et de déficits publics en recul mais, en contrepartie, la
croissance atteint difficilement son potentiel et, corollaire
préoccupant, le taux de chômage se situe à un niveau trop
élevé pour ne pas risquer de générer de
l'instabilité. Les économies européennes, 11 d'entre elles
en tout cas, se sont engagées à maintenir ces conditions
monétaires et budgétaires (pacte de stabilité et de
croissance) avec des possibilités d'ajustements nominaux réduits
(taux d'intérêt commun, invariabilité des taux de change
nationaux...), pariant sur cette stabilité pour faire émerger une
croissance fructueuse, en particulier sur le plan de l'emploi.
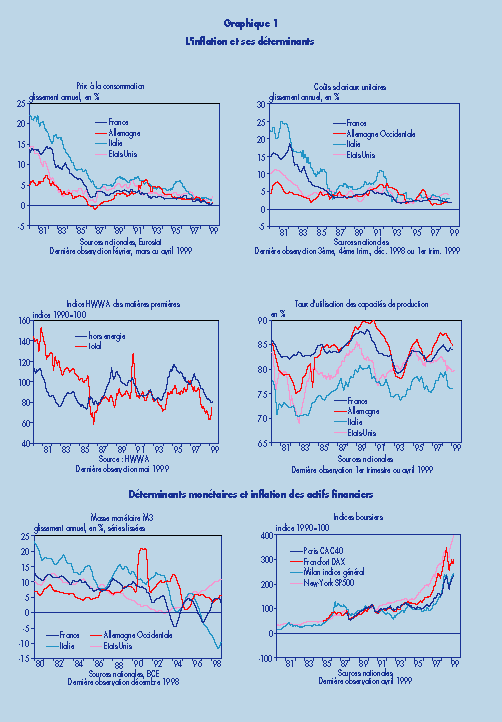
Malgré les records atteints sur le terrain de la
désinflation, le débat sur les coûts de l'inflation ne
s'est pas éteint. Faisant écho aux bilans et études sur
les coûts de la politique de désinflation et d'assainissement
monétaire et, allant parfois jusqu'à mettre en garde contre de
nouveaux risques inflationnistes, les études sur les effets
néfastes de l'inflation se sont encore largement
développées ces dernières années.
Deux raisons peuvent être avancées pour expliquer ce foisonnement :
- la première rappelle que si le monde industrialisé est
entré dans une phase d'inflation modérée et
maîtrisée, ce n'est pas le cas pour l'ensemble des pays
émergents ou en transition. Comme il l'a été
rappelé ci-dessus, bien que des efforts considérables aient
été réalisés dans de nombreuses zones, il semble
nécessaire à certaines organisations internationales de rappeler
les implications " contre-productives " du développement de
l'inflation. Ainsi, de nombreuses études mettent en évidence une
corrélation négative entre le taux d'inflation et le taux de
croissance dans ce type d'économies.
Les analyses ont été étendues dans certains cas aux pays
industrialisés mais la relation apparaît alors moins claire en
particulier lorsque les taux d'inflation tombent en dessous de 10 % (cf.
encadré ).
- la seconde, plus proche de notre propos, renvoie aux arguments selon lesquels
l'inflation, bien qu'à des niveaux modérés, n'est pas pour
autant dénuée d'effets pervers pour la croissance, en particulier
à moyen-long terme. Ainsi, il n'y aurait pas un seuil
en-deçà duquel les variations nominales ne seraient plus
responsables de distorsions amenant à faire des choix de comportements
non optimaux pour la croissance et le bien-être.
Cette position est défendue de façon fervente et appuyée
par les partisans de la pure stabilité des prix avec à leur
tête M. Feldstein. Ce dernier précise, cependant, que la
stabilité des prix doit être entendue au sens large puisqu'elle ne
correspond pas dans les faits à un taux d'inflation nul mais
plutôt proche de 2 %, compte tenu des erreurs de mesure qui
entourent l'évaluation de l'inflation. A l'opposé, certains
économistes (Akerlof, Dickens & Perry (1996)) prônent, de leur
côté, le maintien d'un espace de fluctuations nominales qui
permettrait de réguler les tensions sur le marché du travail sans
entraîner de conséquences néfastes en termes d'emploi. Pour
trancher en faveur de l'une ou l'autre position, il faut pouvoir confronter les
coûts et les gains générés par les deux options. Les
coûts de l'inflation, bien que cette dernière se situe à
des niveaux modérés, sont-ils supérieurs aux coûts
d'une politique de désinflation et à quel horizon ? Les analyses
sur les coûts de la désinflation se sont largement fondées
sur l'évaluation de " ratios de sacrifice ". Dans le cas
européen, elles mettent en évidence la part imputable à la
politique de désinflation et à la politique monétaire
restrictive, qui en a été la base, dans la montée du
chômage.
Parti des Etats-Unis, le débat s'implante naturellement en Europe avec
l'arrivée de l'euro, la création de la BCE et la
définition de ses objectifs.
Inflation basse et contrôlée ou pure stabilité des prix ?
Doit-on considérer que les taux d'inflation observés aujourd'hui
en Europe correspondent en fait à la stabilité des prix ?
Inflation et croissance : quels enseignements peut-on retenir des évaluations empiriques ?
La mise
en évidence empirique de la relation négative entre inflation et
croissance (ou bien-être) a récemment fait l'objet de nombreuses
études. Si les amplitudes sont variables d'une estimation à
l'autre La validité empirique d'une
corrélation
négative
semble assurée en présence
d'une inflation
à deux chiffres
(Briault C. (1995)).
La méthodologie la plus utilisée consiste à tester
l'existence de cette relation sur la base d'un panel intégrant des
séries temporelles pour un nombre important de pays ce qui permet de
valider la relation à la fois dans le temps et dans l'espace (les
modèles de croissance retenus peuvent varier d'une étude à
l'autre mais le modèle néo-classique standard est courant).
Le problème du sens de la causalité entre inflation et croissance
est souvent posé et oppose une réserve aux conclusions
tirées de ce type d'études. Il est, en effet, évident
qu'une inflation forte peut résulter d'une croissance située
au-dessus de son rythme tendanciel (ou potentiel). La relation négative
qui ressort, alors, dans une majorité d'estimations sur les
périodes récentes peut très bien refléter la
réaction des politiques monétaires à un dérapage
inflationniste. Une baisse simultanée de la croissance et de l'inflation
se produit sans que la dernière soit le déterminant, en soi, du
ralentissement de l'activité.
L'étude de R.J. Barro (1995) porte sur un panel de plus de 100 pays et
couvre la période 1960-1990 (la dernière décennie qui a
enregistré des records en matière de désinflation dans un
contexte de croissance modérée n'est malheureusement pas
analysée). La variation des prix est intégrée dans un
modèle de croissance défini par divers facteurs explicatifs
relatifs au capital humain, à la politique publique, à la
démographie et aux choix d'investissement dans le secteur privé.
Son estimation, réalisée en laissant constants les facteurs
autres que l'inflation, aboutit au résultat selon lequel une
augmentation de 10 points du taux d'inflation annuel provoque une chute de
0,24 point du taux de croissance annuel du PIB réel par tête
.
Constatant que cette relation est prédominée par les observations
correspondant aux pays où l'inflation est comprise entre 10% et 20%,
l'auteur procède à une estimation en trois temps en fonction des
niveaux d'inflation (supérieur à 40 %, compris entre
15 % et 40 % et en dessous de 15 %). Les coefficients
correspondant à une baisse du taux d'inflation de 1 point sont
respectivement égaux à
- 0,023 ; - 0,037 et
enfin, - 0,016. Cependant, pour les taux d'inflation les plus bas
(inférieurs à 10 %), la relation n'est plus significative.
Par ailleurs, les tests portant sur la relation entre la volatilité de
l'inflation et la croissance ne peuvent conclure sur l'existence d'une relation
négative ce qui pourrait provenir du fait que la volatilité ne
traduit pas correctement l'incertitude relative à l'inflation future.
S. Fischer (1993), en identifiant le rôle occupé par l'inflation
parmi les déterminants de la croissance constate également,
à partir d'un échantillon de 80 pays sur une période
couvrant les années qui ont précédé et suivi le
premier choc pétrolier, que l'inflation est corrélée
négativement avec le taux de croissance (- 0,04 pour 1 point d'inflation
supplémentaire) mais aussi, bien qu'à des niveaux moindres, avec
le taux d'accumulation du capital et la croissance de la productivité.
S. Fischer montre que lorsque le taux d'inflation est bas (entre 0 et
15 %) alors l'impact sur la production est plus élevé.
L'influence de l'inflation sur la productivité a aussi fait l'objet
d'évaluation, le sens de la causalité allant de l'inflation vers
la productivité et non l'inverse (test de causalité de Granger).
Ainsi, Rudebush et Wilcox (1994) ont estimé à 0,35 % le
supplément de croissance annuelle de la productivité
résultant d'une baisse de 1 % de l'inflation aux Etats-Unis. Les
tests pour la France et l'Allemagne ne produisent pas de résultats
significatifs. Ce résultat est intéressant à rapprocher
des situations observées actuellement aux Etats-Unis et en Europe,
notamment, le parallèle entre le choc
" présumé " positif de productivité et le
tassement de l'inflation
.
1.1.2. Les coûts de l'inflation
Les arguments retenus à l'encontre de l'existence de tensions
inflationnistes, si faibles soient-elles comme c'est le cas aujourd'hui dans le
monde industrialisé, se rapportent aux perturbations que les variations
nominales introduisent dans l'allocation des ressources et la redistribution
des revenus et de la richesse. L'inflation et l'incertitude sur l'inflation
(appréhendée par sa volatilité) peuvent réduire le
niveau de la production mais également le taux de croissance de cette
dernière en décourageant l'accumulation du capital et, par
conséquent, l'innovation et la productivité globale des facteurs.
Si l'inflation était correctement anticipée, les coûts
générés ne seraient que modérés voire
inexistants. Mais en réalité, il est extrêmement difficile
d'anticiper l'inflation car cela suppose d'évoluer dans un contexte
d'information parfaite avec une totale transparence sur les objectifs
déterminés par les autorités monétaires.
Supprimer les sources de distorsions suppose une bonne maîtrise des
différents niveaux de décisions économiques
concernés (élaboration de contrats indexés, adaptation des
systèmes comptables, etc...) et, en particulier, un système
fiscal parfaitement évolutif en fonction de l'inflation. Or, cette
contrainte est rarement remplie.
L'inflation non anticipée provoque, alors, des coûts d'ajustement
plus ou moins amples.
Du constat empirique selon lequel plus l'inflation est élevée,
plus sa variabilité est forte, on est amené à
déduire qu'une inflation élevée accroît
l'incertitude sur les évolutions futures de prix. Le comportement des
agents s'adapte alors à cet environnement risqué d'une
façon qui peut très bien ne pas être optimale. La
perturbation qui naît tout d'abord de la déformation des prix
relatifs générée par l'inflation est alors
aggravée. Les agents économiques sont ainsi incités
à se détourner des contrats de long terme à la
rentabilité aléatoire, défavorisant alors l'accumulation
de capital. La redistribution des richesses qui s'opère en faveur de
certaines catégories d'agents ou de facteurs peut donc s'avérer
contre-productive à long terme.
L'installation dans un régime d'inflation élevée et/ou
croissante favorise l'apparition de transferts en faveur de certains agents et,
par extension, de certains types de comportement. Ainsi, par exemple, la
constitution d'épargne n'est pas encouragée du fait de sa
dépréciation alors qu'en parallèle, l'endettement
réel est progressivement diminué par l'inflation (cela s'applique
aussi à la dette publique).
La position de M. Feldstein (1996) en faveur de la stabilité des prix
(telle qu'elle a été définie ci-dessus) plutôt que
de celle de l'inflation, suppose que les effets de cette dernière sur la
croissance sont linéaires, il n'y aurait donc pas un seuil
en-deçà duquel la variation des prix ne provoquerait plus de
distorsions. M. Feldstein ne s'étend pas sur la validité de cette
proposition lorsqu'un régime d'inflation stable émerge d'un
contexte de forte crédibilité des autorités
monétaires. Il souligne néanmoins l'avantage, qualifié de
"bonus de crédibilité", que détiennent les
économies ayant su maîtriser l'inflation lors de chocs
inflationnistes majeurs.
Dans ce cas, les agents peuvent intégrer en toute confiance les
objectifs d'inflation fixés par les autorités puisque les
incertitudes qui entourent l'évolution future des prix disparaît.
Ainsi, l'une des causes des effets néfastes sur l'activité est
supprimée mais d'autres demeurent tels que la déformation des
prix relatifs ou les distorsions liées à une indexation
imparfaite, en particulier du système fiscal.
C'est sur ces dernières que repose en grande partie l'évaluation
de M. Feldstein sur les coûts de l'inflation. Il se concentre sur deux
types de distorsions.
Le premier est relatif aux conséquences des interactions entre inflation
et pression fiscale sur l'accumulation de richesse par les ménages et
à leurs implications sur le rendement réel de l'épargne.
Ces effets provoquent une déformation des arbitrages
opérés entre consommation et épargne globales tout au long
du cycle de vie. L'effet sur l'investissement logement provenant des
distorsions liées aux déductions fiscales pour
intérêts d'emprunts est également traité. Le second
porte sur les implications pour les recettes de l'Etat d'une inflation
zéro.
Les gains estimés pour les Etats-Unis
sont compris entre 0,63 %
et 1 % du PIB par an pour une baisse de 2 points du taux d'inflation
.
Mais Feldstein défend l'idée que la politique monétaire ne
doit pas être uniquement animée par la crainte des
retombées négatives d'une hausse de l'inflation sur la croissance
mais, plus fondamentalement, préoccupée par la dégradation
des revenus réels qu'entraîne chaque augmentation des prix et qui
à long terme pèse significativement sur le niveau du PIB.
Enfin, il renforce sa position en soulignant que les gains de la
stabilité des prix sont permanents, bien qu'ils n'apparaissent
qu'à moyen terme (6 à 9 ans), tandis que les coûts
d'ajustement provoqués par la désinflation ne seraient que
transitoires. Cependant, le caractère transitoire de ces coûts
peut être discuté car il n'est pas assuré que ces
ajustements n'aient pas d'influence dans le long terme. La persistance du
chômage européen contrecarre, en effet, pour partie cette
hypothèse.
La démarche et la méthodologie de M. Feldstein ont
été reprises dans différentes analyses menées au
sein des banques centrales européennes pour éclairer le
débat sur l'opportunité d'un passage à une inflation
zéro en Europe (cf. tableau 1). Les disparités institutionnelles
et fiscales (régulations différentes des marchés du
travail ou des capitaux, mais aussi, variété des systèmes
de retraite impliquant des comportements d'épargne différents, le
système par capitalisation augmentant, par exemple, la durée de
l'épargne dans le cycle de vie) sont à l'origine d'impacts
différenciés en fonction des pays.
Tableau 1
Comparaison internationale des gains procurés par
le passage du
taux d'inflation de 2% à 0
en termes de surplus annuel (en %)
|
France |
Etats-Unis |
Allemagne |
Espagne |
Royaume-Uni |
|
0,34 |
1,06 |
1,42 |
1,71 |
0,21 |
Source :
Chatelain J.B., Sevestre P. (1999). Evaluation des auteurs pour la France et de
M. Feldstein (1996) pour les Etats-Unis ; K.H. Tödter G.Ziebarth (1997)
pour l'Allemagne, Dolado J.J et
alii
(1997) pour l'Espagne ; Bakhshi H.
et
alii
(1997) pour le Royaume-Uni.
1.1.3. Les coûts de la désinflation jusqu'à la
stabilité des prix
1) Les rigidités nominales à la baisse des salaires : une
raison importante de conserver une inflation modérée ?
La stabilité des prix suscitent encore de nombreuses réticences
parmi lesquelles les préoccupations concernant les répercussions
possibles sur l'emploi occupent une place primordiale. Dans la polémique
qui s'est récemment développée outre-atlantique les
travaux de Akerlof et
alii
(1996)
, côté opposition,
sont à souligner. Pour appuyer leur thèse selon laquelle
l'existence de fluctuations nominales permettraient de mieux gérer les
ajustements réels, notamment en termes d'emploi, les auteurs
mènent tout d'abord, une enquête démontrant l'existence de
rigidités nominales à la baisse des salaires nominaux. Car, selon
eux contrairement à une idée qui s'est répandue, les
baisses de salaires nominaux sont, en réalité, peu
pratiquées. Dès lors, qu'on accepte ce fait, on comprend que le
maintien d'une inflation modérée puisse permettre aux entreprises
rencontrant des difficultés, surtout si ces dernières sont
temporaires, d'opérer des ajustements sur les coûts réels
sans faire varier les salaires nominaux perçus auxquels les
salariés seraient particulièrement sensibles. En l'absence
d'inflation, la baisse des salaires, si elle était praticable, pourrait
provoquer une contraction de la productivité du fait d'une baisse de la
motivation des salariés. La flexibilité salariale réelle
qu'autorisent par conséquent les variations de prix est le moyen
d'éviter des ajustements sur l'emploi. Elle serait d'autant plus
appréciable que des disparités micro-économiques au stade
de l'entreprise mais aussi sectorielles existent.
Sur le plan théorique et méthodologique, Akerlof et
alii
estiment à partir d'un modèle intégrant cette
hypothèse de rigidité nominale des salaires, les coûts et
bénéfices de deux politiques monétaires, l'une ayant pour
cible une inflation à 3 %, l'autre une cible de 0 %. A long
terme (entre 6 et 10 années),
le taux de chômage est dans le
deuxième cas supérieur de 2,6 points
au niveau atteint dans
le premier scénario.
2) Des "ratios de sacrifice" plus élevés dans les
années 1990
Les coûts de la désinflation peuvent être estimés
à partir de "ratios de sacrifice" qui évaluent les pertes de PIB
observées lorsque la baisse de l'inflation a comme contrepartie le
passage du taux de chômage au-dessus de son taux naturel. Ces ratios
peuvent être définis de deux manières ; soit, par le
rapport entre l'écart de l'évolution observée de la
production à son évolution tendancielle et la variation de
l'inflation ; soit, en rapportant directement l'accroissement du taux de
chômage à la baisse de l'inflation.
Ces ratios estimés par L. Ball (1996) pour les années 1980 dans
le cas des Etats-Unis, du Royaume Uni, de l'Allemagne et de la France le sont
en identifiant dans chacun des cas les épisodes de désinflation
enregistrés sur la période (les écarts à l'output
tendanciel sont déterminés par les niveaux observés de
l'output en début de phase de désinflation et après la fin
de cette dernière).
Ils s'élèvent respectivement
à 1,83 dans le cas américain ; 0,87 pour le Royaume-Uni ; 3,56
pour l'Allemagne et, enfin, seulement 0,60 pour la France
1(
*
)
.
Le ratio particulièrement élevé pour l'Allemagne, qui
présentait le taux d'inflation le plus bas au début de la phase
de désinflation, renforce l'intuition selon laquelle les coûts de
la désinflation sont plus élevés lorsque l'inflation est
déjà basse.
Lorsque ces évaluations sont étendues aux années
1990
2(
*
)
pendant lesquelles la poursuite du
processus de désinflation s'est accompagnée d'une croissance en
moyenne relativement modérée,
le coût d'une
désinflation de l'ordre d'un point en France s'élève
à 3,5 % de PIB. Ainsi, la désinflation de deux points
observée entre 1990 et 1996 a eu un coût de l'ordre de 7% du
PIB
. Pour les Etats-Unis, le coût est estimé à 6 %
et pour l'Allemagne à 11 %. (Pour les Etats-Unis, le
résultat est conforme aux estimations de M. Feldstein ce qui le conduit
à dire qu'au-delà de six années, les gains dus à la
baisse de l'inflation (environ 1 % de PIB par an) deviennent plus
importants que le coût total et transitoire de la désinflation).
Ces résultats confortent à nouveau l'idée selon laquelle
la poursuite de la désinflation lorsque les taux d'inflation sont
déjà bas est relativement plus coûteuse.
1.1.4. Le régime de basse inflation : ses implications
1) Notre hypothèse : le régime de basse inflation va se
prolonger
L'inflation n'est pas uniforme dans la zone euro, et les situations
asymétriques du côté de la croissance et de l'inflation ne
vont pas disparaître du jour au lendemain. A s'en tenir aux pays du
"noyau dur", le taux d'inflation devrait, à l'horizon des trois-quatre
prochaines années, demeurer modique (en rythme annuel, compris entre 0
et 2 %, plus probablement entre 0 et 1,5 %). Cette hypothèse ne
tient pas compte du débat, par ailleurs justifié, sur la "bonne"
mesure de l'inflation, mais les premiers travaux effectués par l'INSEE
sur ce sujet suggèrent qu'en France la correction à apporter
serait de l'ordre de 0,3-0,4 % en rythme annuel (en moins), contre
1 % à 2 % aux Etats-Unis. Notre vue prospective résulte
elle-même de la conjugaison de plusieurs éléments :
a) La remontée récente des prix du pétrole et de quelques
autres matières premières ne peut être extrapolée.
Fondamentalement, et malgré une démonstration inverse de temps
à autre, l'OPEP est et va rester un cartel faible, traversé par
des dissensions sans oublier le poids des producteurs à
l'extérieur du cartel. Par delà d'inévitables fluctuations
à court terme, les prix du pétrole et des grandes matières
premières vont être plus influencés par le sentier
d'évolution de la demande, donc par la croissance à moyen terme
de l'économie mondiale, que par l'incertaine organisation de l'offre.
b) Le chômage va rester élevé dans la zone euro,
spécialement dans certains pays du "noyau dur" (France, Allemagne...).
Raisonnons pour la France avec un NAIRU de 8 à 9 % (donc
proche de sa valeur actuelle, une estimation légèrement
inférieure à celle habituellement retenue, par exemple celle du
FMI comprise entre 9 et 10 %). En partant d'un taux de chômage
effectif de 11 % (pour simplifier) il faudrait, avec une croissance
annuelle de 3 %, de cinq à huit années pour retomber au
NAIRU ! Et le taux de chômage naturel lui-même devrait
progressivement s'abaisser en Europe, comme il l'a fait aux Etats-Unis, sous
l'effet de la croissance, des nouvelles technologies, de l'essor des services,
etc. Conclusion : il existe encore en Europe continentale une marge
significative avant que la courbe de Phillips joue à plein et que la
réduction du chômage ne provoque des tensions sur les coûts
salariaux unitaires et sur les prix.
c) Même si la "nouvelle économie" américaine comporte des
spécificités évidentes, certaines de ses composantes vont
concerner l'Europe pour les dix prochaines années. On pense bien
sûr aux effets, déjà présents, de la concurrence et
de la globalisation sur la formation des prix (où sont, aujourd'hui en
France, les secteurs abrités de la concurrence internationale et
spécialement de la concurrence européenne ? Même si les
services publics les plus traditionnels sont désormais exposés),
mais aussi aux nouvelles technologies, aux gains de productivité
à en attendre et donc au sentier d'évolution des coûts
salariaux unitaires. Pour les nouvelles technologies, le
phénomène de "rattrapage" devrait jouer à tous les niveaux
: la France va combler une partie de son retard vis-à-vis des
Etats-Unis, et l'Allemagne va elle-même dans les années qui
viennent rattraper la France, se créant ainsi de nouvelles marges de
croissance et de productivité. Avec des taux de chômage qui,
même en baisse, vont rester à l'horizon des cinq prochaines
années au dessus du NAIRU et des réserves de nouvelles
technologies qui engendrent des réserves de gains de
productivité, on voit mal d'où pourrait venir, à l'horizon
de l'analyse, l'inflation salariale.
d) Nous attachons un poids modéré à la thèse de la
relance de l'inflation dans les cinq prochaines années du fait de
certains débordements monétaires et financiers. Certes
l'inflation financière ("asset inflation") ne saurait être
négligée. Elle est a priori plus forte aux Etats-Unis que dans la
plupart des pays européens, même s'il est en pratique difficile de
définir des PER d'équilibre et de déterminer avec
précision l'ampleur de la surévaluation des cours boursiers et de
la bulle financière. Des corrections probables sur les marchés
d'actions vont-elles transférer l'inflation des actifs financiers vers
les marchés de biens et services ? Nous pensons que des corrections vont
intervenir en 1999-2000, plus probablement en plusieurs étapes que par
le biais d'un krach boursier. Mais il n'y aura pas, compte tenu de la
concurrence et du nouveau mode de formation des prix, nécessairement de
remontée mécanique du prix des biens et services à la
suite des corrections boursières. Il va falloir suivre avec attention
l'évolution des marchés immobiliers en Europe. Car la reprise de
ces marchés pourrait, elle, déboucher non pas à court
terme mais à moyen-long terme sur des phénomènes de
surévaluation et de bulle immobilière à surveiller de
près. Un autre aspect du débat monétaire et financier
touche au "découplage" éventuel entre d'un côté la
progression des agrégats de monnaie et de crédit, de l'autre
celle du PIB nominal. Certes l'agrégat M3 croît plus vite dans la
zone euro que le PIB nominal, mais ce phénomène de ralentissement
de la vitesse de circulation de M3 reste modique. Le découplage entre la
progression du crédit et celle du PIB est plus marquée. Mais il
faut se rappeler que l'inverse a prévalu, avec pendant plusieurs
années des croissances de M3 et du crédit en retrait par rapport
à l'activité en valeur (à cause du processus de
désendettement de la part des entreprises et des particuliers, d'effets
de substitution entre les composantes de M3 et les titres du marché
financier, etc.). Il y a donc, dans le phénomène
évoqué, pour partie un phénomène de "rattrapage"
(ou de compensation). En outre, le monétarisme n'est plus ce qu'il
était dans les années 1960 ou 1970, et la liaison entre la
croissance monétaire et les prix est encore moins mécanique
qu'avant.
2) Le régime d'inflation basse : des effets persistants
Nous insistons sur quatre aspects du régime d'inflation basse, qui se
sont déjà manifestés et vont rester au centre de la
régulation économique et financière dans la zone euro
comme d'ailleurs, pour certains d'entre eux, dans d'autres pays du G7.
a) Les mouvements des prix relatifs
La baisse des prix relatifs de l'industrie -par rapport à l'indice
général des prix et aux prix des services- est nette en France et
dans le reste de la zone euro depuis la fin de 1997. Aux Etats-Unis le
décrochage est intervenu depuis la fin de 1996. Et une
légère correction s'est amorcée depuis le début de
1999 en liaison avec le rebond du pétrole et de certaines
matières premières.
Un certain nombre d'éléments structurels pourraient prolonger la
chute des prix relatifs de l'industrie : la concurrence encore plus aiguë
dans le secteur industriel que dans les autres secteurs ; l'existence de
surcapacités au plan mondial pour des produits stratégiques
(automobile, électronique...) ; dans la zone euro, les pressions
concurrentielles supplémentaires introduites par la monnaie unique ; la
persistance de certains écarts de productivité entre l'industrie
et les services. Mais, en fait, quand il est question de surcapacités ou
de performances de productivité, la question de la porosité de la
frontière entre l'industrie et les services devient centrale. L'essor
des services aux entreprises-catégorie hétérogène
qui regroupe le travail intérimaire, certaines composantes de
l'informatique et des transports, etc.- nécessite d'affiner l'analyse.
Les mouvements déjà constatés du côté des
prix relatifs et ceux qui vont les prolonger conduisent à deux
observations : 1/ Le retour de la confiance des industriels viendra
plutôt du rebond de la demande et de l'effet-volume associé, que
de l'amélioration de leurs prix relatifs. 2/ Le calcul des taux
d'intérêt réels doit continuer à faire
référence aux situations sectorielles. Un même taux nominal
signifie des écarts dans les taux réels à la production
pouvant aller jusqu'à 500 ou 600 points de base.
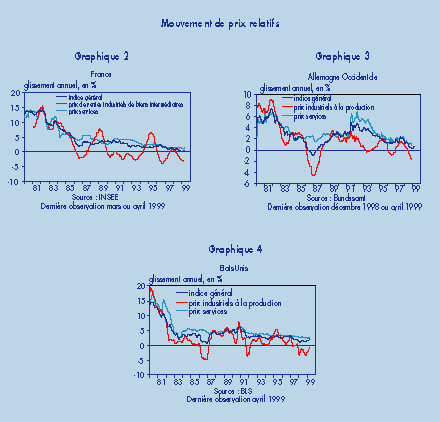
b) Le
moral des industriels et la confiance des consommateurs
Depuis 1998, c'est-à-dire depuis que la crise financière
internationale dans les pays émergents (Asie du sud-est...) ou en
transition a commencé à faire sentir ses effets sur les pays
occidentaux, est apparu un décalage entre la baisse du moral des
industriels et la confiance persistante des consommateurs, elle-même
nourrie par le recul du chômage. Ce découplage s'est
révélé spécialement marqué dans des pays
comme la France ou l'Allemagne, même si, dans la période la plus
récente il s'est un peu atténué. Le régime de basse
inflation joue ici un rôle, même s'il n'est pas le seul
élément à considérer : la chute des prix absolus et
relatifs dans l'industrie assombrit les perspectives d'un certain nombre
d'industriels et les rend attentistes dans leur politique de stockage, alors
qu'avec une inflation plus modérée que prévu, les
ménages réalisent des gains de pouvoir d'achat inattendus. Ce
dernier effet ne peut pas durer très longtemps car les ménages
tiennent compte de l'expérience et des erreurs de prévision
constatées ; ils s'adaptent au régime de basse inflation pour
revoir à la baisse leurs anticipations d'inflation.
Pour l'avenir, le découplage entre la déprime des industriels et
la confiance des consommateurs ne pourra pas se prolonger trop longtemps. On
peut raisonnablement espérer que le scénario de "sortie vers le
haut" (redressement du moral des industriels, en liaison avec le retour de la
croissance dans certains pays émergents, etc.) va prévaloir. Il
ne faudra pas trop compter sur l'improbable rebond des prix absolus et relatifs
de l'industrie, mais plutôt escompter l'atténuation graduelle de
certaines surcapacités.
c) Le comportement de la BCE
"L'objectif principal" de la BCE est de maintenir la stabilité des prix
(article 105 du traité de Maastricht). Principal ne veut pas dire
exclusif, et ceci est encore plus important lorsque la stabilité des
prix n'est pas vraiment menacée. On peut, pour cadrer le raisonnement,
représenter la fonction de réaction de la BCE par la règle
de Taylor, en la simplifiant de la façon suivante :
i = ( - *) + (y - y*)
* cible d'inflation, y* cible de croissance, i, taux directeur de la BCE.
L'objectif affiché par la BCE pour 1999 -une inflation inférieure
à 2 % pour la zone euro- ne sera pas nécessairement
reconduit tel quel pour 2000 et a fortiori les années
ultérieures. Car on peut s'attendre à ce que la BCE, par souci
d'une meilleure communication avec son environnement, affiche plus de
symétrie dans son ciblage de l'inflation (fixant donc, à la fois,
une valeur-plafond et une valeur-plancher). Quoi qu'il en soit, tant que
l'inflation effective demeure significativement en deçà du
plafond d'inflation, la BCE va être en mesure de s'intéresser
à l'écart de croissance et donc de conférer au poids () de
cet écart une valeur différente de zéro.
d) Les ajustements fiscaux en régime de basse inflation
C'est déjà le cas depuis deux-trois ans et cela va se prolonger :
avec une inflation durablement proche de zéro, les fluctuations à
court terme des rentrées fiscales, par exemple de la TVA,
dépendent de celles du PIB en volume. La volatilité du taux
d'inflation, très réduite, ne joue plus alors qu'un rôle
résiduel. Par rapport aux années d'inflation instable, ceci
change le mécanisme des stabilisateurs automatiques et le contexte
général de la politique budgétaire.
1.2. Croissance potentielle et taux de chômage d'équilibre
Le début de cette étude s'est concentré sur le
débat concernant les avantages et les coûts que peut induire un
régime d'inflation basse. Nous nous interrogeons dans un second temps
sur l'articulation qui peut émerger, dans un tel contexte, entre
inflation et croissance à moyen terme et d'autre part, entre inflation
basse et chômage. La question du taux de chômage d'équilibre
apparaît dès lors primordiale et nous avons choisi de la mettre en
perspective en confrontant les faits stylisés des années 1990 en
Europe, spécialement en France, et aux Etats-Unis.
Au début de la décennie, tandis que l'économie
européenne connaît une récession accusée d'où
elle sort avec un taux de chômage fort dégradé,
l'économie américaine, quant à elle, débute une
phase de croissance aux caractéristiques singulières. Les
années 1990 se sont écoulées et l'Europe enregistre des
records sur le front de la désinflation mais atteint difficilement un
rythme de croissance de 2,5 % tandis que son taux de chômage
approche 12 %. Aux Etats-Unis, la croissance se poursuit faisant baisser
le taux chômage sous la barre des 5 % considérée comme
le seuil en-dessous duquel les risques d'inflation apparaissent. Or,
jusqu'à présent, ces tensions sont inexistantes.
Ce cercle vertueux apparu outre-atlantique suscite bien entendu l'admiration
mais aussi beaucoup d'interrogations.
Est-on entré dans un nouveau régime de croissance dans lequel les
régulations standards sont obsolètes ? La "nouvelle
économie" prendrait racine dans la montée en puissance du "High
Tech". Avec des taux de croissance élevés de la production et des
prix qui ne cessent de chuter, le développement de ce secteur
permettrait une croissance globale soutenue sans inflation. En
parallèle, la globalisation répand sur un nombre de
marchés croissant des produits à faibles intensité
technologique mais également à faibles prix. Accroissant la
production globale par une part grandissante dans la valeur ajoutée mais
aussi bousculant la productivité globale dans un grand nombre de
secteurs du fait d'une diffusion massive, "les nouvelles technologies"
imposeraient à leur tour une nouvelle ère de croissance.
Les tenants de cette thèse sont cependant affaiblis par l'absence de
données confirmant la progression de la productivité globale qui
accompagnerait cette révolution. Ce défaut de constat empirique
contribue à affaiblir la thèse du "nouvel âge" au profit
d'explications plus conformes au cadre d'analyse standard. Cependant ce dernier
échoue à expliquer à la fois l'absence d'inflation et les
nouvelles relations qui s'établissent entre celle-ci et les autres
composantes telles que les salaires ou les taux d'utilisation des
capacités (Gordon R.J. (1998))
3(
*
)
.
En particulier, la relation inflation-chômage qui s'est imposée
aux Etats-Unis à partir de 1994 peut-elle encore être
fondée sur les concepts usuels tels que le NAIRU ? Le dilemme
inflation-chômage est-il toujours pertinent dans le cas américain ?
Certains profitent de cette situation " inattendue " pour rejeter
radicalement les outils d'analyse qui s'étaient imposés
progressivement mais dont la pertinence a toujours été
discutée (Galbraith J. K. (1997)). D'autres préfèrent
confirmer leur utilité tout en reconnaissant la nécessité
de les faire évoluer et de les améliorer pour leur permettre
d'appréhender les événements récents. C'est le cas
de nombreuses contributions portant sur l'évaluation du NAIRU qui
mettent en avant sa variabilité dans le temps. Ainsi, en dix ans, du
milieu des années 1980 au milieu des années 1990, le NAIRU aurait
baissé d'un point ce qui expliquerait la moindre pression
opérée sur les prix et donc la moindre inflation.
Qu'en est-il de l'Europe, et de la France en particulier, pour lesquelles les
performances en termes d'inflation s'accompagnent d'une
détérioration de l'emploi avec un taux de chômage
" d'équilibre " particulièrement élevé?
Aborder une réflexion sur le régime de croissance qui peut
prévaloir dans les années à venir nécessite que des
éclaircissements soient faits sur la notion de chômage
d' "équilibre" qui conditionne à la fois la croissance
potentielle et les anticipations d'inflation. De la sorte, c'est aussi
l'analyse des différentes composantes de la politique économique,
monétaire ou de l'emploi, qui est en jeu.
1.2.1. La montée en puissance du concept de NAIRU dans les
années 1980 et son utilisation en politique économique
La référence au NAIRU comme indicateur de pressions
inflationnistes existantes ou à venir s'est accrue et imposée
dans les années 1980, années pendant lesquelles la politique de
désinflation a constitué un axe majeur de la politique
macro-économique.
Ainsi, l'utilisation du NAIRU est courante dans la conduite de la politique
monétaire, du moins aux Etats-Unis. Sa référence lors de
la présentation des prévisions officielles comme indicateur des
pressions inflationnistes ou de leur anticipation semble entériner
l'idée que le NAIRU est un outil utile et pertinent. Cela
présuppose, bien entendu, qu'il soit admis que l'inflation
résulte, au moins en partie, des tensions existantes sur le
marché du travail. Ainsi, J. Stiglitz (1997) évalue à 20%
la part des variations de l'inflation expliquée par le taux de
chômage et estime que le maintien, pendant un an, du taux de
chômage à un niveau inférieur d'environ un point au NAIRU,
entraînerait un supplément d'inflation de l'ordre de 0,3 à
0,6 point.
Le dilemme inflation-chômage resterait, par conséquent,
d'actualité alors que l'évolution récente de
l'économie américaine pourrait en faire douter tant la
décélération de l'inflation a été inattendue
au vu des performances enregistrées sur la croissance et l'emploi.
Outre la proposition selon laquelle on assisterait à l'émergence
d'un nouveau paradigme de croissance aux Etats-Unis, des erreurs
d'évaluation du chômage d'équilibre peuvent être
à l'origine de ce qui apparaîtrait faussement comme une
singularité. Dès lors, le cadre d'analyse utilisé
jusqu'à aujourd'hui retrouverait une partie de son
intégrité. Dans ce cas, les économistes doivent être
capables d'expliquer la variation du NAIRU dans le temps (Gordon R.
(1997)) (le concept de taux de chômage naturel immuable est donc
largement dépassé). Divers facteurs sont évoqués
parmi lesquels le facteur démographique, si l'on suppose qu'à
chaque catégorie de la population correspond un taux de chômage
naturel (un pour le jeunes, un pour les hommes, un autre pour les femmes, par
exemple) alors les changements démographiques peuvent modifier le taux
de chômage global. L'adaptation des salaires réels à la
tendance de la productivité dès la fin des années 1980,
après que le choc négatif de productivité des
années 1970 ait introduit des pressions inflationnistes et tirer le
niveau de chômage d'équilibre vers le haut, ramène
aujourd'hui à l'inverse le NAIRU vers le bas. Enfin, la montée de
la concurrence et donc une compétitivité accrue aussi bien sur le
marché des biens que sur celui du travail, est souvent
évoquée comme explication. La mondialisation exerce une pression
à la baisse sur les prix tandis que sur le marché du travail, des
forces structurelles telles que la perte progressive du pouvoir des syndicats
sont susceptibles d'agir dans le même sens.
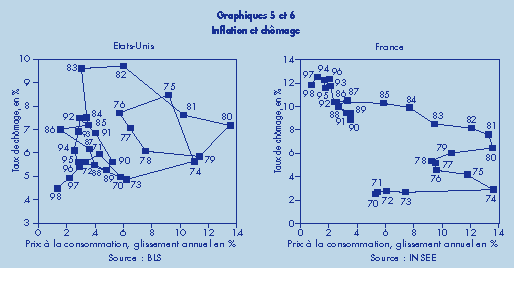
Malgré toutes les incertitudes qui entourent son évaluation, le
NAIRU est-il utile à la politique économique ? Est-il assez
robuste pour soutenir des décisions visant à contrôler
l'inflation parfois au détriment, à court terme, de la croissance
?
Les incertitudes sur le NAIRU, dans sa version la plus empirique ont, en effet,
soulevé beaucoup de scepticisme et d'insatisfaction. De plus, en Europe
le dilemme inflation- chômage ne peut-être abordé sous le
même angle de vue qu'aux Etats-Unis. La concomitance d'une basse
inflation et d'un chômage élevé et persistant a ouvert de
nouveaux axes d'analyse (la stationnarité du taux de chômage
américain étant souvent opposée à la croissance
continue du taux européen). Outre les développements importants
réalisés sur les causes de la persistance du chômage en
Europe, les analyses intégrant les fondements micro-économiques
du marché du travail ont été en pleine expansion dans les
années 1990 (théorie des négociations, du salaire
d'efficience, "insiders-outsiders") et ont conduit à redéfinir un
taux de chômage d'équilibre dans lequel les facteurs structurels
du marché du travail ont un rôle à jouer. Ainsi, cette
approche est pertinente pour analyser les chocs structurels (ou chocs d'offre)
ce qui n'est pas le cas des méthodes empiriques basées
essentiellement sur les fluctuations des salaires ou des prix (telles que la
courbe de Phillips traditionnelle qui lie les variations nominales de salaires
ou de prix au taux de chômage).
Partant des modèles de négociations anglo-saxons (Layard R.,
Nickell S., Jackman R. (1991)), ces approches cherchent à définir
le niveau d'équilibre du chômage en croisant deux relations
structurelles se rapportant l'une à la formation des prix (position de
la firme), l'autre à celle des salaires (position des salariés).
Le salaire, ainsi défini, l'est en niveau et non plus en variation comme
dans la courbe de Phillips. La détermination des salaires est
dépendante d'un ensemble de facteurs structurels et institutionnels
parmi lesquels la fiscalité et toutes sortes de
prélèvements pesant sur le travail ont une place
indéniable (en France, notamment, les cotisations sociales). Un
" coin social ou salarial " est alors déterminé comme
l'écart entre le coût du travail pesant sur l'entreprise et le
salaire net perçu par le salarié. Son augmentation provoque celle
du taux de chômage d'équilibre. Mais d'autres variables peuvent
également intervenir telles que le salaire minimum, les revenus de
remplacement (prestations chômage) ou encore les termes de
l'échange sur le marché intérieur et les taux
d'intérêt réels.
Des estimations réalisées sur données françaises
(L'Horty Y. et Sobczak N. (1997)) conduisaient en 1996 à estimer le taux
de chômage d'équilibre à plus de 10% ce qui le situait
au-dessus des estimations faites couramment sur le NAIRU aux alentours de 8%.
Divers enseignements peuvent être tirés de ces évaluations :
- Le coin salarial a un rôle déterminant dans l'accroissement du
taux de chômage d'équilibre, leur corrélation étant
positive. Mais, par ailleurs, le ralentissement des gains de
productivité contribue aussi à la montée du chômage
d'équilibre.
- Si, dans une perspective de moyen-long terme dépassant
l'équilibre partiel sur le seul marché du travail, le
comportement d'accumulation du capital par les entreprises est pris en
considération, alors les taux d'intérêt réels qui
pèsent sur le coût du capital contribuent, en s'accroissant,
à la hausse du taux de chômage d'équilibre (ce qui est en
adéquation avec les faits stylisés des années 1980 mais
qui le sera moins à l'avenir avec des taux d'intérêt
nominaux et une inflation stabilisés).
Ces résultats sont importants car ils suggèrent que l'état
actuel du marché du travail en France n'est pas si éloigné
de ce seuil. Par conséquent, bien qu'il existe une marge de baisse du
chômage qui pourraît provenir d'une relance de la demande
4(
*
)
, il serait inévitable d'améliorer les
conditions de l'offre pour voir se résorber plus radicalement le
chômage. Les politiques visant à réduire le coût du
travail à travers une baisse des cotisations sociales patronales, en
diminuant le coin fiscal, agiraient donc dans ce sens. A ce niveau, il devient
indispensable de raisonner en fonction de la structure du marché du
travail. Il est clair qu'en France et dans d'autres pays européens
(Belgique, Pays-Bas...) le taux de chômage des non qualifiés est
particulièrement important ce qui justifie d'autant plus des politiques
agissant sur le coût du travail de cette catégorie de la
population active, laquelle présente un "coin salarial" relativement
plus élevé que la moyenne. Ces caractéristiques font
partie des fortes divergences entre les situations des marchés du
travail américain et européen. La politique de baisse de la
durée du travail, si elle provoque un choc de productivité
positif, peut aussi avoir une contribution du même type.
1.2.2. Croissance potentielle et perspectives de croissance à
moyen terme
La croissance potentielle constitue une référence dans toute
analyse portant sur le moyen-long terme puisqu'elle correspondrait à
l'utilisation des facteurs de production compatible avec une inflation stable.
Seules les contraintes d'offre sur l'emploi et le capital subsisteraient par
opposition aux contraintes de demande.
Avant d'aborder les évaluations empiriques de la croissance potentielle
dans la zone euro, il faut rappeler l'importance de son utilisation en
politique économique. En effet, la croissance potentielle guide
l'analyse de moyen terme en fournissant une référence
quantitative sur la tendance, le "sentier de croissance" qu'emprunte
l'économie mais, elle est aussi très présente dans les
analyses des fluctuations cycliques qui sont supposées se faire autour
de cette croissance potentielle (ou tendancielle). Ce sont alors les
écarts à ce " sentier de croissance " qui fondent les
appréciations sur les risques de " surchauffe " de
l'économie et ce qu'ils impliquent en matière d'inflation.
L'utilisation de cette référence en politique monétaire a
été vulgarisée par la " Règle de Taylor "
qui, outre l'écart à une cible d'inflation
déterminée par les autorités monétaires,
intègre clairement l'écart à la croissance potentielle
(output gap).
Cette distinction entre composante structurelle et composante conjoncturelle
constitue le coeur des analyses visant à évaluer les niveaux
"potentiels" de l'économie. Ainsi, elle s'applique plus largement
qu'à la seule croissance. Il devient courant de l'utiliser pour
distinguer au sein du taux de chômage celui qui peut-être
résorbé par un choc positif de demande (chômage
conjoncturel) et celui qui ne peut l'être que par un relâchement
des contraintes d'offre (chômage structurel). Elle est, aussi, à
la base de l'évaluation des déficits " structurels " et
de leurs compléments, les déficits " conjoncturels " et
a, ainsi, alimenté les débats sur l'assainissement
budgétaire en Europe et sur son acheminement vers l'UEM.
De nombreuses limites théoriques fragilisent néanmoins le concept
de croissance potentielle et les diverses approches méthodologiques
permettant de l'évaluer ont des performances très
discutées (CEPII (1997)). Ces méthodes peuvent être
sommairement classées en deux catégories ; celles faisant
référence à une fonction de production; celles plus
empiriques qui permettent d'extraire la tendance de moyen-long terme (ici, les
techniques sont variées mais la plus répandue est l'application
du filtre de Hodrick-Prescott (H-P)).
Nous proposons ici des évaluations réalisées à
partir des deux méthodes :
- d'une part, une application du filtre H-P aux PIB des principaux pays
européens et à celui des Etats-Unis de même qu'une
estimation pour la zone euro dans son ensemble. La période couverte
débute en 1980 et s'achève en 1997 ;
- d'autre part, des évaluations obtenues à partir de fonctions
de production relatives aux différentes économies nationales
détaillées ci-dessus, se rapportant à la même
période. Dans ce cas, l'estimation pour la zone euro est beaucoup plus
délicate car la pertinence d'une fonction de production et d'un NAIRU
communs à la zone est très discutable.
Fonction de production et emploi potentiel
La
fonction de production considérée est du type Cobb-Douglas
à deux facteurs, capital et travail, à rendements constants et
progrès technique neutre :
Log Y= a x Log(E) +(1-a) x log(K)+ trend avec
- Y : la production
- E : l'emploi
- K : le stock de capital
Le
stock
de capital K
est déterminé à partir des flux
d'investissement matériel (I) et d'un taux de dépréciation
du stock existant (d). Il s'écrit par conséquent:
K= (1-d) x K(t-1) + I(t)
Le coefficient
a
représente la part du travail dans le PIB et par
déduction (1-a), la part du capital. Ces coefficients correspondent aux
valeurs comptables des parts occupées par le capital et le travail dans
le PIB ( cette approche comptable est critiquable mais pragmatique).
Le
trend
introduit dans l'équation est un proxy du progrès
technique.
A partir
de cette spécification, le niveau potentiel de la production
Y
*
est défini en considérant le niveau d'emploi potentiel E* et en
supposant que, sur un sentier de croissance équilibrée, la
croissance du capital suive celle de la production potentielle.
L'emploi potentiel E*
est défini au niveau du NAIRU tel que :
E*= ((1-NAIRU)/100) x L
où L est l'offre de travail résultant de l'application du taux de
participation à la population active totale.
Ainsi, la croissance de l'emploi potentiel dépend de l'évolution
de ces trois déterminants, le NAIRU, la population active et le taux de
participation.
L'approche par une fonction de production est, d'un point de vue
théorique, plus satisfaisante, mais elle n'est pas exempte de
contraintes lesquelles, in fine, peuvent affaiblir sa pertinence. Ainsi,
l'évaluation du stock de capital et de sa dépréciation
sont délicates. De même, l'estimation de l'évolution de la
productivité soulève différents problèmes. Dans ce
cas, le caractère exogène du progrès technique est
entériné par la théorie standard de la croissance et la
tendance de la productivité des facteurs se trouve résumée
dans un terme n'intégrant aucun facteur structurel (le
" résidu de Solow "). Ce cadre standard échoue,
cependant, à expliquer la rupture de la productivité
observée au cours des années 1970 dans la plupart des pays de
l'OCDE. Il pourrait s'avérer être encore insuffisant pour analyser
les performances susceptibles d'émerger de la diffusion des nouvelles
technologies de l'information.
La croissance potentielle estimée à partir de cette structure
théorique est alors fortement dépendante des évaluations
portant sur l'emploi potentiel et, tout particulièrement, sur le taux de
chômage non inflationniste (NAIRU). Or, le concept et le calcul du NAIRU
sont, on l'a noté ci-dessus, sujets à débat et font encore
l'objet aujourd'hui de nombreuses recherches. Par ailleurs, plus la part de la
masse salariale est importante, plus les erreurs commises sur le NAIRU
engendrent des défauts d'estimation sur la croissance potentielle.
Les
évaluations du NAIRU : Courbe de Phillips traditionnelle
et
introduction des effets de persistance
D'un
point de vue empirique, il est cependant courant d'évaluer ce ratio
à partir de l'acception courante de base selon laquelle une
accélération des prix (ou des salaires) se produit dès
lors que le taux de chômage dépasse son niveau d'équilibre
ce qui peut se résumer par :
p = L (p) - A x (U-NAIRU)
avec p : taux d'inflation et L (p), valeurs retardées de p
Cette formulation peut être complétée pour tenir compte des
effets de " persistance " laquelle est largement admise comme une
caractéristique du chômage européen. On introduit alors un
terme qui résume les niveaux de chômage passés (LU) dans
l'équation précédente. C'est l'écart entre cette
variable LU et le taux observé qui intervient dans la
détermination des variations de prix. Le NAIRU est alors une combinaison
linéaire de cette variable traduisant les niveaux de chômage
passés et du taux de chômage d'équilibre issu de
l'estimation d'une courbe de Phillips traditionnelle (noté UP).
Dès lors, le seuil de déclenchement de tensions inflationnistes
se situe à un niveau supérieur à celui qui serait
défini sans l'intégration d'effets de persistance. Soit :
p = L (p) - A
x (U-UP) - B
x (U-LU)
et NAIRU = (A/(A+B)) x UP + (B/(A+B)) x LU
Tableau 2
Evaluations de la croissance potentielle et du NAIRU dans la zone euro et aux
Etats Unis
Croissance tendancielle (1), Croissance potentielle (2)
et NAIRU
associés
variations annuelles (en %)
|
|
FRANCE |
ALLEMAGNE |
ITALIE |
USA |
ZONE EURO |
||||||||||
|
|
1 |
2 |
NAIRU |
1 |
2 |
NAIRU |
1 |
2 |
NAIRU |
1 |
2 |
NAIRU |
1 |
||
|
1980-1985 |
1,8 |
2,0 |
8,8 |
1,4 |
1,7 |
7,2 |
2,1 |
2,2 |
9,2 |
3,2 |
2,7 |
8,0 |
1,7 |
||
|
1986-1990 |
2,7 |
2,4 |
9,0 |
3,3 |
2,6 |
7,1 |
2,6 |
2,7 |
10,8 |
2,8 |
2,8 |
6,1 |
3,0 |
||
|
1991-1995 |
1,5 |
1,8 |
9,0 |
2,2 |
2,3 |
7,9 |
1,2 |
1,5 |
10,5 |
2,3 |
1,9 |
6,3 |
1,8 |
||
|
1996 |
1,9 |
1,8 |
9,0 |
1,6 |
1,4 |
8,0 |
1,4 |
2,4 |
10,2 |
3,2 |
2,5 |
5,7 |
1,8 |
||
|
1997 |
2,1 |
2,2 |
9,0 |
1,7 |
1,0 |
8,3 |
1,4 |
2,2 |
10,2 |
3,4 |
3,0 |
5,4 |
2,0 |
||
Sources : COE et OEF
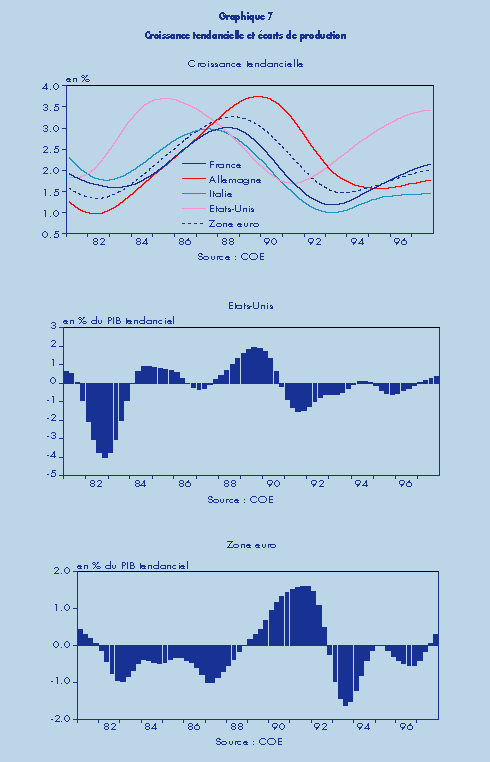
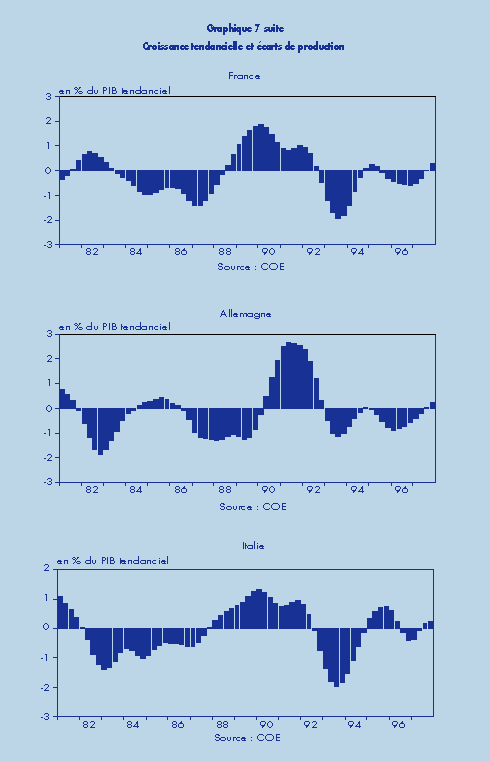
La
supériorité du potentiel de croissance américain par
rapport à la zone euro apparaît clairement quelle que soit
l'estimation. A l'intérieur de la zone euro, la France occupe une
position relativement plus favorable avec un taux de croissance tendancielle
légèrement supérieur à celui de la zone euro dans
son ensemble (soit de 2,1% en 1997). Suivant cette méthode, l'output gap
de la zone euro est en moyenne légèrement positif en 1998
(0,2 %).
Les estimations conduites par la Direction de la Prévision (1998) sur la
zone euro aboutissent à un taux de croissance potentielle comparable, de
l'ordre de 2,2-2,3% pour les principaux pays de la zone euro et à un
output gap pour l'année 1998 compris entre -0,3 et 0,1 en fonction de la
méthode retenue (H-P(0,1), combinaisons linéaires des
écarts de PIB (-0,3) ou écart de PIB obtenu par agrégation
des séries nationales (0,1), avec un taux de chômage
d'équilibre variable).
La Commission européenne estimait, quant à elle, le potentiel de
croissance réelle de l'Union à 2,6% en 1997 (ce qui est
supérieur à notre estimation proche de 2 %) et
prévoyait un accroissement de celui-ci sur les années suivantes.
Quelles que soient les estimations, il ressort que le niveau
élevé du NAIRU dans la zone euro contraste fortement d'avec celui
des Etats-Unis (le double). Par ailleurs, le caractère persistant du
chômage européen écarte encore davantage les trajectoires
des chômages dans les deux zones. A l'intérieur de la zone euro,
certains pays seront plus affectés que d'autres par cet effet
d'"hysteresis". Si l'on se réfère à l'étude de S.
Scarpetta (1996) qui propose une évaluation du degré de
persistance par pays (l'indice est d'autant plus élevé que le
degré de persistance est fort, il est égal à 1 pour les
Etats-Unis), alors l'Italie et la Belgique présenteraient des
rigidités fortes avec des indices de 16 et 17 et l'Allemagne serait
à un niveau légèrement supérieur à celui de
la France (13 contre 11).
Tableau 3
Taux de chômage, NAIRU et indicateurs de
sous-utilisation du travail
pour l'année 1997
(en %)
|
|
Taux de chômage |
|
|
Estimations du NAIRU |
||
|
|
Définition national |
Définition standard |
Sous utilisation du travail 1 |
Taux de non emploi |
OCDE |
FMI 2 |
|
Zone euro |
12,4 |
11,8 |
3,3 |
42,0 |
11,0 |
10,0 |
|
Belgique |
12,7 |
9,2 |
5,3 |
43,0 |
11,6 |
7,7 |
|
France |
12,4 |
12,4 |
5,0 |
41,2 |
10,2 |
9,7 |
|
Allemagne |
11,4 |
10,0 |
1,5 |
36,5 |
9,6 |
8,9 |
|
Italie |
12,3 |
12,1 |
4,9 |
49,5 |
10,6 |
9,7 |
|
Pays-Bas |
5,2 |
5,2 |
6,2 |
32,5 |
5,5 |
6,3 |
|
Espagne |
20,8 |
20,8 |
1,2 |
51,0 |
19,4 |
18,0 |
|
Royaume-Uni |
6,9 |
7,0 |
3,8 |
29,2 |
7,2 |
7,0 |
|
Etats-Unis |
4,9 |
4,9 |
5,9 |
26,5 |
5,6 |
5,0 |
Source:
World Economic Outlook, FMI, 1999
(1) taux de sous-utilisation du travail mesurant la proportion de personnes
" découragées " et les personnes ayant un emploi
à temps partiel alors qu'elles préféreraient travailler
à temps plein.
(2) intègrent un effet de persistance.
1.2.3.
En quoi les composantes de la croissance aux
Etats-Unis se distinguent-elles de celles de la zone euro ?
1)
Les déterminants de l'emploi potentiel : un avantage pour les
Etats-Unis
a) Le
niveau du NAIRU
Quelles que soient les méthodes d'estimation, il apparaît
clairement que le NAIRU américain a atteint son point le plus bas des
deux dernières décennies tandis qu'en Europe, les
phénomènes de persistance aidant, le taux de chômage
d'équilibre atteint dans de nombreux pays des niveaux proches de 9%(avec
des cas extrêmes comme l'Espagne où le NAIRU est estimé
à près de 18% pour un taux observé de 21%).
b) le
taux de participation
de la population active est nettement
plus élevé aux Etats-Unis. Le taux de non emploi -son
symétrique- signalé dans le tableau 3 s'élève en
moyenne à 26,5% contre 42% dans la zone euro.
c) enfin, le
dynamisme démographique
américain se
démarque par une croissance des populations totale et active toujours
supérieure à celle enregistrée en Europe. De plus,
la tendance
de la population active occupée est
nettement ascendante en fin de période.
La maturité de la génération " baby boomers "
qui a eu jusqu'ici un taux de chômage faible et qui aurait, en
parallèle, des revendications salariales moins fortes que les
générations plus jeunes est un argument évoqué pour
expliquer le bas niveau du NAIRU américain.
Cet argument devrait jouer également dans le cas européen. La
répartition du chômage par tranches d'âge est, par exemple,
comparable aux Etats-Unis et en France, le taux de chômage le plus
élevé étant celui des jeunes (près du double du
taux global dans les deux pays). Cependant, alors que l'évolution du
taux de chômage des 25-49 ans aux Etats-Unis suit celle du chômage
total, en France l'écart entre les deux taux a eu tendance à se
resserrer dans les années 1990. En parallèle, la part des moins
de 25 ans dans la population américaine évolue moins rapidement
qu'en France et le taux de chômage associé a une tendance
décroissante. Enfin, si l'on observe cette fois-ci le chômage en
fonction de la durée, le contraste entre pays est saisissant. En France,
la part de chômeurs de longue durée (plus d'un an) atteint
près de 40 % du nombre total de chômeurs alors qu'elle ne
dépasse pas 5 % aux Etats-Unis.
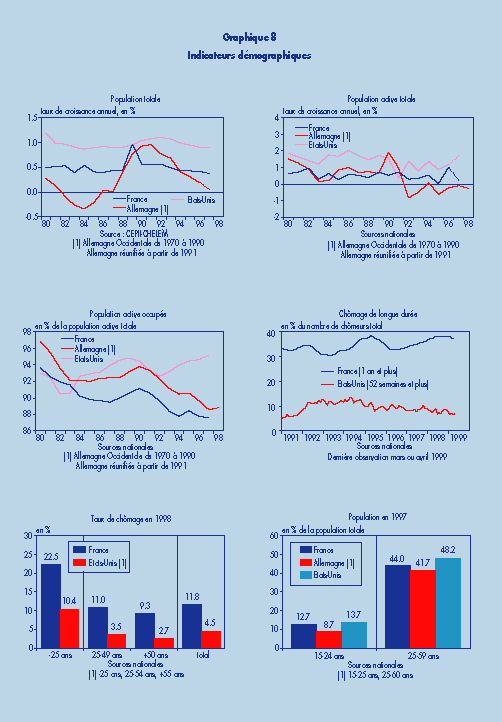
2)
La productivité des facteurs : où se situe l'effet
favorable aux Etats-Unis ?
En niveau, les Etats-Unis présentent un avantage comparatif
évident avec une productivité par heure travaillée ou par
emploi supérieures à celles de la France, elles-mêmes
au-dessus de celles de l'Allemagne. L'Italie se distingue par des indices
supérieurs mais que l'on est tenté d'expliquer par le faible taux
de participation observé sur le marché du travail italien et une
durée annuelle moyenne du travail plus faible.
Tableau 4
Revenus et niveaux de productivité du travail
dans les pays de
l'OCDE en 1994
|
|
PIB/tête
|
Emploi/population |
PIB/emploi |
Nombre d'heures travaillées/personne et par an |
PIB/Nombre d'heures travaillées
|
|
Etats-Unis |
136,8 |
47,2 |
123,4 |
1611 |
121,5 |
|
Japon |
111,3 |
51,6 |
91,8 |
1812 |
80,3 |
|
Allemagne |
105,5 |
42,9 |
104,6 |
1529 |
108,5 |
|
France |
103,0 |
38,5 |
113,9 |
1524 |
118,4 |
|
Italie |
100,2 |
35,2 |
121,3 |
1482 |
129,7 |
|
Royaume-Uni |
94,7 |
43,8 |
92,0 |
1498 |
97,4 |
|
Belgique |
108,2 |
36,4 |
126,5 |
1581 |
126,9 |
|
Espagne |
72,8 |
30,0 |
103,5 |
1903 |
86,3 |
Source :
Pilat D. (1996)
En revanche, si l'on s'intéresse cette fois aux variations de la
productivité du travail (définie par les mêmes concepts)
les Etats-Unis présentent de toute évidence une progression plus
contenue que celle des pays européens, la France occupant une situation
intermédiaire entre le cas américain et le cas allemand. Ce
constat doit être néanmoins nuancé par une vision plus fine
détaillant les évolutions par secteurs. On observe alors que la
variation de la productivité du secteur manufacturier américain
est restée proche de 3% durant les deux décennies passées
ce qui implique que celle du secteur des services a été nettement
plus faible voire négative. Bien que dans ce dernier cas,
l'évaluation soit plus difficile et donc davantage sujette à
l'imprécision, des éléments connus sur le marché du
travail américain (développements d'emplois précaires, de
qualification faible ou encore à temps partiel) vont dans le sens cette
observation.
Par ailleurs, les rémunérations des salariés connaissent
en Europe des variations inférieures aux gains de productivité du
travail alors qu'aux Etats-Unis les progressions sont très proches.
On peut illustrer cette caractéristique par les évolutions
comparées du partage de la valeur ajoutée en France et aux
Etats-Unis (cf. graphique 9) et remarquer, outre les évolutions en
ciseaux des deux indicateurs dans les années 1980, la forte correction
à la baisse qui s'est produite aux Etats-Unis au début des
années 1990 et la remontée récente qui correspond à
l'accélération des salaires américains en 1998. En
parallèle, la productivité du travail aurait aussi
progressé plus vivement (en 1996-1998, + 2,1% en moyenne annuelle). La
dernière estimation du BLS propose une progression en rythme
annualisé de 2,8% au premier trimestre 1999 (4% pour le secteur
manufacturier) après un rythme comparable au quatrième trimestre
1998. L'évolution plus vive des salaires sans tension inflationniste
pourrait s'expliquer aussi par ces faits.
Tableau 5
Evolution de la productivité du travail, de la
rémunération totale
et de la durée du travail
variation annuelle moyenne en %
|
|
|
Rémunération / travailleur
|
Heures
annuelles par travailleur
|
Rémunération relative au
PIB
|
|
France
|
3,7
|
4,0
|
-
0,9
|
1,2
|
|
Allemagne
|
4,0
|
3,6
|
-1,1
|
0,8
|
|
Allemagne entière
|
2,5 |
1,5 |
0 |
- 1,0 |
|
Italie
|
4,0
|
3,6
|
- 1,1
|
0,7
|
|
Etats-Unis
|
1,0
|
0,7
|
- 0,1
|
- 0,2
|
Source : Perspectives de l'emploi de l'OCDE (1998)
* la
variation de la productivité (1) est égale à la variation
de la rémunération par travailleur (2) - la variation
du nombre d'heures de travail (3) - la variation de la
rémunération par rapport au PIB réel (4).
La comparaison des productivités globales des facteurs confirme le
contraste entre l'Europe et les Etats-Unis, ces derniers enregistrant des
évolutions beaucoup plus faibles que les pays européens dans leur
ensemble. Outre les divergences constatées sur la tendance de la
productivité du travail, les écarts peuvent s'expliquer aussi par
les parts qu'occupe chacun des facteurs de production dans le PIB (cf.
graphique 9). En revanche, les Etats-Unis se singularisent par une progression
de la productivité du capital positive en moyenne sur les années
1980-1990 alors que les autres pays (hormis le Royaume-Uni) enregistrent encore
un ralentissement bien qu'à un rythme moins accusé.
Dans les années 1990, la progression de la productivité
potentielle (trend de la productivité globale des facteurs), qui est
celle qui contribue à la croissance potentielle, est estimée par
l'OCDE (Giorno C. et
alii
(1995)) à 0,8% pour les Etats-Unis ;
1,8% pour l'Allemagne ; 1,5% pour la France et enfin, entre 1,5% et 1,8% pour
l'Italie.
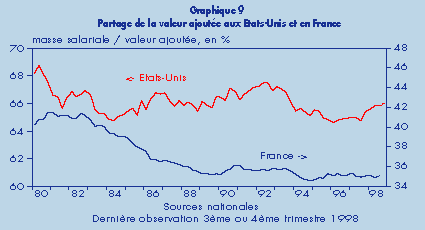
Tableau 6
Productivité dans le secteur des entreprises
variation en taux annuels en %
|
|
Productivité totale des facteurs (1) |
Productivité du travail |
Productivité du capital |
||||||
|
|
1960-73 |
73-79 |
79-97 |
60-73 |
73-79 |
79-97 |
60-73 |
73-79 |
79-97 (2) |
|
Etats-Unis |
1,9 |
0,1 |
0,7 |
2,6 |
0,3 |
0,9 |
0,4 |
- 0,5 |
0,1 |
|
Japon |
4,9 |
0,7 |
0,9 |
8,4 |
2,8 |
2,3 |
- 2,3 |
- 3,6 |
- 2,0 |
|
Allemagne (3) |
2,6 |
1,8 |
1,2 |
4,5 |
3,1 |
2,2 |
- 1,4 |
- 1,0 |
- 0,5 |
|
France |
3,7 |
1,6 |
1,3 |
5,3 |
2,9 |
2,2 |
0,6 |
- 1,0 |
- 0,5 |
|
Italie |
4,4 |
2,0 |
1,1 |
6,4 |
2,8 |
2,0 |
0,5 |
0,3 |
- 0,6 |
|
Royaume-Uni |
2,6 |
0,5 |
1,1 |
4,0 |
1,6 |
2,0 |
1,7 |
- 0,3 |
0,6 |
|
Total Union européenne |
3,4 |
1,2 |
1,2 |
5,4 |
2,5 |
2,2 |
- 0,2 |
- 1,3 |
- 0,5 |
|
Total OCDE |
2,9 |
0,6 |
0,9 |
4,6 |
1,7 |
1,7 |
- 0,4 |
- 1,5 |
- 0,7 |
Source : OCDE
(1) la
croissance de la productivité totale des facteurs (1) est égale
à la moyenne pondérée de la croissance de la
productivité du travail (col. 2) et de celle de la productivité
du capital (col. 3). La pondération est basée sur la part
qu'occupe, en moyenne sur la période, chacun des facteurs dans le PIB.
(2) dernière année disponible 1996 pour l'Allemagne, la France,
l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon.
(3) les deux premières moyennes concernent l'Allemagne occidentale, la
dernière, l'Allemagne entière à partir de 1991.
3)
La tendance de la durée du travail
Alors qu'aux Etats-Unis les gains de productivité récents se sont
répercutés essentiellement sur les salaires réels moyens ,
dans certains pays d'Europe comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, ces gains se
sont traduits par une réduction du temps de travail. La France va-t-elle
être dans le même cas avec l'entrée en vigueur des "35
heures" ?
Concernant la tendance lourde de la durée du travail, celle à
laquelle est sensible la croissance potentielle, la baisse se poursuit dans les
pays européens bien qu'elle se fasse à un rythme réduit
sur les décennies récentes. Mais ce tassement du rythme de
réduction de la durée du travail pourrait être remis en
cause par des mesures de politique économique. Les Etats-Unis ont connu
une tendance inverse puisque la durée de travail moyenne par travailleur
a augmenté au cours des années 1980 et à nouveau, bien
qu'à un rythme moindre, dans les années 1990.
4) Un stock de capital américain au contenu plus " High
Tech " qui poursuit sa croissance
La situation américaine se différencie sur trois points
importants :
- comme on l'a vu, la productivité du capital croît aux Etats-Unis
alors qu'elle baisse ailleurs ;
- la croissance très vive de l'investissement sur les années
récentes (à un rythme supérieur à celui
observé dans les grands pays européens) a fait croître la
part qu'occupe ce dernier dans le PIB
;
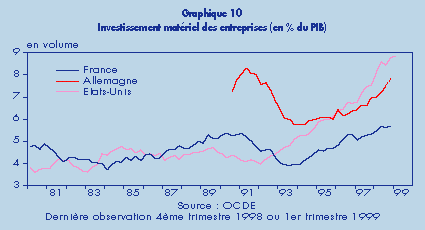
Cependant, la croissance du stock de capital ne dépend pas seulement de
l'importance des flux d'investissement. Elle est fonction de la part de
l'investissement dans le capital total (I/K) diminuée du taux de
dépréciation (d). Or, le rapport de l'investissement au capital
est lui-même fonction de deux ratios ; la part de l'investissement dans
le PIB (I/Y) et la productivité du capital (I/K= I/Y x Y/K).
Si l'on applique cette arithmétique au cas américain, on peut
comprendre que le seul fait d'avoir un accroissement significatif de
l'investissement dans le PIB n'est pas suffisant pour assurer une croissance du
capital aussi dynamique que par le passé, il faut pour cela que la
productivité du capital progresse elle aussi à des rythmes
comparables. Ainsi, sur les périodes où cette dernière a
connu des variations négatives (notamment, à la suite des chocs
pétroliers), la croissance du capital en a été
affectée négativement. En revanche, selon les estimations
disponibles (cf. tableau 6) pour la période récente, les deux
effets (productivité du capital et dynamisme de l'investissement dans la
croissance totale) seraient positifs et contribueraient à la tendance
ascendante du ratio investissement/capital. Ainsi, la croissance du capital,
dont le rythme se tassait, aurait connu sur la période récente un
changement de tendance plutôt favorable. Ce qui est vrai pour le stock de
capital total l'est aussi pour le stock de capital "informatique et nouvelles
technologies de communication" (Brender A. (1999), Lahidji R. (1999)) ;
- la croissance du stock de capital américain serait, en revanche,
désavantagée par un taux de dépréciation plus
élevé dû précisement à la part importante
qu'occupe la composante "informatique" (12% et 5% pour les seuls ordinateurs)
dans le stock total. L'innovation rapide dans ce domaine réduit, en
effet, la durée de vie de ce type de biens et une forte proportion de
l'investissement ne serait destinée qu'au remplacement de produits
obsolètes.
Cependant, cet effet négatif ne peut à lui seul remettre en
question le rôle moteur joué par les nouvelles technologies de
l'information (NTI) dans la croissance. Les estimations qui aboutissent
à une contribution modérée des NTI à la croissance
globale (Oliner S., Sichel D. (1994)) évaluent la seule contribution
directe du stock de capital "informatique et communication" et le font en
raisonnant à rendements d'échelle constants. De la sorte,
l'impact expansif de la diffusion de ces nouvelles technologies est
certainement sous-estimé. Par ailleurs, il est probable que les
interactions capital-travail et leurs implications sur la productivité
globale soient également mal appréhendées.
1.2.4. L'euro et les restructurations dans la zone
1) Les conséquences de l'euro pour les restructurations
La monnaie unique n'est pas la cause première ni unique des
restructurations (fusions, acquisitions, OPA...) touchant l'ensemble des
secteurs. Elles sont dues avant tout à la globalisation, à la
déréglementation et à l'existence, ici ou là, de
surcapacités.
Mais l'euro accélère dans la zone, mais aussi pour les pays "out"
qui la rejoindront à terme, la concentration et la consolidation. Car il
renforce et va continuer à renforcer les pressions à la baisse
sur les prix et les marges, chaque opérateur cherchant à
compenser par une part de marché accrue -ce qui est, par
définition, impossible pour tout le monde à la fois- le recul des
marges unitaires.
La concentration s'accompagne souvent d'un mouvement de diversification, ce qui
rend difficile la distinction entre l'effet-taille (et la question des
économies d'échelle) et l'effet-variété (et
l'argument des économies de gamme). Elle va également de pair
avec la multiplication d'opérations transfrontalières (par
exemple, mais pas seulement, dans la banque et la finance), ayant pour
conséquence de faire se rapprocher en Europe des systèmes de
"gouvernement d'entreprise" au départ très différents.
Dans une perspective prospective, nous insistons sur trois aspects des
restructurations :
a) Elles vont se poursuivre pendant au moins deux à trois ans dans la
plupart des secteurs, même si les économies d'échelle ne
sont pas toujours au rendez-vous. Au terme de cette phase de consolidation,
certains excès de la course à la taille seront corrigés
car une firme ne peut durablement fonctionner avec des rendements
décroissants. En sens inverse, dans les cas où les
économies d'échelle sont fortes (nous pensons par exemple aux
marchés de capitaux, et à la réduction des coûts de
transaction unitaires grâce à leur intégration et à
l'application des nouvelles technologies), le marché va tendre à
se rapprocher d'un monopole naturel.
b) Les restructurations dans la zone euro comme au plan mondial vont rester
dépendantes du respect d'une norme de rentabilité (ROE). On peut
discuter du niveau de cette norme (15 % ?), de ses éventuelles
modulations sectorielles et de sa probable évolution au cours du temps.
Il est cependant difficile de nier l'influence de la globalisation
financière et des comportements d'arbitrage de la part des investisseurs
(en particulier, mais pas seulement institutionnels) sur l'existence d'une
telle norme.
c) Face au mouvement de concentration, les autorités nationales et
européennes chargées de la politique anti-trust vont devoir
rester vigilantes. Les questions centrales vont être, de ce point de vue,
celle de la "contestabilité" des marchés -les marchés avec
un petit nombre d'opérateurs peuvent être parfaitement
contestables s'il n'y a pas de vraie barrière à l'entrée
et si la sortie du marché peut s'effectuer à coût faible ou
nul- et celle de la définition des aires de référence.
Prenons un exemple concret. Le Crédit Agricole a aujourd'hui une part de
marché de 20 % dans l'Hexagone, chiffre qui serait en gros celui de
l'ensemble BNP-Société Générale-Paribas s'il se
constitue. Mais ce chiffre moyen de 20 % camoufle des disparités
selon les métiers, et il doit être mise en comparaison avec une
part de marché du même Crédit Agricole de 3 % en
Europe, de 0,3 % au plan mondial (sans parler des parts de marché
dans telle ville ou telle région de France). La relation entre la
concentration et la concurrence effective pose de redoutables problèmes
d'appréciation. Face à ces défis, la Federal Trade
Commission (FTC) et le département de la justice aux Etats-Unis sont
devenus plus pragmatiques. La même tendance s'affirme -et devra se
renforcer- à la Commission européenne comme auprès des
autorités nationales concernées.
2) Les conséquences des restructurations pour l'emploi et la
croissance
Les restructurations ont des conséquences pour l'emploi et le sentier de
croissance. L'évaluation de ces conséquences n'est pas fournie
par les modèles économétriques disponibles, et c'est
pourquoi il faut se contenter d'analyses plutôt qualitatives.
a) L'impact sur l'emploi
Dans un certain nombre de secteurs, l'impact des restructurations et de la
concentration sur l'emploi peut être représenté par une
courbe en (J) : l'effet à court terme est susceptible d'être
négatif, à cause des économies d'échelle et de la
réduction des sureffectifs ; à moyen-long terme, l'incidence est
positive car l'amélioration de la compétitivité et de la
profitabilité des entreprises débouche sur des créations
d'emplois.
Cet effet des restructurations en Europe sur l'emploi et le chômage dans
la zone ne saurait être sous-estimé, surtout dans sa distribution
intertemporelle. Mais il nous paraît second en comparaison d'autres
déterminants "lourds" de l'emploi : la croissance bien sûr, mais
aussi le coût du travail, etc. A priori, le rythme, la forme et la
répartition intersectorielle des fusions, acquisitions, OPA, doivent
avoir une influence sur le contenu en emplois de la croissance. Une influence
que les modèles économétriques actuels ne permettent pas
de quantifier précisément.
b) L'incidence sur la croissance
La concentration est susceptible d'agir sur à la fois la croissance
potentielle et la croissance effective par plusieurs canaux : le rythme
d'innovation et la recherche-développement, la productivité,...
La liaison entre concentration et innovation reste ambiguë. D'un
côté, l'hypothèse d'une relation positive,
suggérée par Schumpeter, est illustrée par des travaux
empiriques montrant que l'effort de R & D est plus marqué chez les
grandes entreprises que dans les PME-PMI. De l'autre côté, est
développée l'idée qu'au delà d'un certain seuil la
concentration freine l'innovation.
L'analyse nuancée que présente pour les Etats-Unis
l'Economic
Report of the President
pour 1999 peut, grosso modo, s'appliquer à
l'espace européen. Ainsi la concurrence entre laboratoires
pharmaceutiques est sans doute favorable à la découverte de
nouvelles molécules (pour traiter le SIDA, l'obésité...).
En matière de télécommunications, il faut une certaine
taille critique, obtenue à la suite de restructurations, pour être
à la pointe de la R & D.
Quoi qu'il en soit, les restructurations pourraient, à terme, stimuler
la croissance dans la zone euro à condition de renforcer le rythme des
innovations.
II. Les marges de manoeuvre de la politique économique
A la
lumière des résultats précédents, il apparaît
que la croissance spontanément envisageable dans la zone euro va
dégager peu de marges de manoeuvre pour la lutte contre le chômage
et la résorption des déficits publics. Il est donc essentiel de
voir si et comment des marges de manoeuvre supplémentaires pourraient
être offertes par les politiques économiques. C'est pourquoi nous
allons successivement évoquer la politique monétaire, le
policy mix
et certaines réformes structurelles dans la zone euro.
2.1.
Le comportement de la BCE et les marges de manoeuvre
monétaires
2.1.1. La politique monétaire dans la zone euro
En peu de mois, la BCE aura su construire sa réputation et sa
crédibilité, sans que le processus soit aujourd'hui
achevé. Prenant pour la zone le relais de la Bundesbank, elle s'efforce
aussi d'établir sa spécificité. Ni Buba, ni
Fed
,
cela devrait valoir aussi bien pour la fonction de réaction de la banque
centrale que pour les aspects institutionnels (organisation de la transparence
et du système de responsabilité ("accountability")).
Notre analyse à l'horizon des cinq prochaines années repose sur
les hypothèses suivantes :
a) La BCE, comme elle l'a déjà fait depuis janvier 1999 (et en
particulier le 8 avril 1999 à l'occasion de la baisse de ses taux
directeurs de 3 à 2,5 %), va continuer à privilégier
l'inflation moyenne dans la zone euro (une moyenne pondérée en
fait, puisque les grands pays comptent plus que les autres...) en surveillant
un ou plusieurs agrégats de référence calculés pour
la zone (pour l'instant, il s'agit de M3 mais la situation n'est pas
figée). Les divergences d'inflation seront donc, pour l'essentiel,
prises en charge par les politiques économiques non monétaires
(politiques budgétaires, salariales, structurelles, etc.).
La BCE sera pragmatique, comme le suggère la décision du 8 avril.
Ce pragmatisme signifie concrètement qu'une fois la stabilité des
prix garantie, la banque centrale donnera plus de poids à la cible de
croissance. Cela veut dire, à partir d'une règle de Taylor
simplifiée du style
i = ( - *) + (y - y*)
que les pondérations et ne sont pas fixées, mais qu'elles
dépendent des variables explicatives elles-mêmes (ce qui complique
l'estimation économétrique). En particulier, la
pondération () accordée à la cible de croissance devrait
être proche de zéro (voire nulle) si la cible d'inflation est
dépassée ou juste réalisée (l'écart absolu
- * demeure en deçà d'un seuil critique retenu par la banque
centrale). Elle deviendrait significative lorsque le taux d'inflation effectif
serait significativement inférieur à la cible. Cette
hiérarchie entre l'objectif principal de stabilité des prix et
les autres objectifs, par définition non principaux, s'apparente en fait
à un ordre lexicographique.
b) La BCE, légitimement soucieuse de la qualité et de la
cohérence du
policy mix
dans la zone, va continuer à
surveiller de près l'évolution des déficits publics et des
dettes publiques. On peut penser qu'avant de faire évoluer à la
hausse ou à la baisse son taux directeur, elle tiendra compte, comme
elle l'a fait jusqu'à présent, des déficits publics
constatés et anticipés. Formellement, cela fait déboucher
sur une règle de Taylor "augmentée", qui se présente de la
façon suivante :
i = ( - *) + (y - y*) + (D - D*)
D* cible de déficits publics pour la zone (la répartition de ces
déficits entre les pays-membres n'est pas indifférente au regard
de l'application du pacte de stabilité ; elle ne sera pas non plus
indifférente à la BCE).
D, déficits publics effectifs
Notons que la cible D* utilisée comme référence par la BCE
n'est pas nécessairement celle qui résulte des cibles
gouvernementales agrégées (à certains moments, la banque
centrale peut être plus ambitieuse pour les déficits que les
gouvernements eux-mêmes). Là encore, le poids () accordé
par la BCE à la cible de déficits publics devrait dépendre
du sens et de l'ampleur de l'écart constaté. Cette
pondération devrait être nulle ou proche de zéro si (D) est
inférieur, et d'assez loin, à (D*), significative dans
l'hypothèse de dépassement.
c) La règle de Taylor même augmentée n'explicite pas le
rôle du taux de change, en particulier du taux de change euro/dollar,
dans le comportement de la BCE. On pourrait prétendre qu'il est
indirectement pris en compte à travers l'inflation et la croissance
effectives. Notre analyse insiste à nouveau sur le rôle des
seuils, même s'il est délicat de les fixer a priori. Tant que
l'euro restera compris dans une "zone cible" -par exemple tant que l'euro
variera entre 1 et 1,30-1,35 dollar- la BCE le surveillera mais elle ne devrait
pas avoir de raison majeure d'intervenir. Le
benign neglect
à
l'intérieur de cette zone découle d'arguments largement
partagés aujourd'hui : relative fermeture commerciale de la zone euro,
impact psychologique probable (pour l'instant, il s'agit seulement d'une
hypothèse) du seuil (1 euro = 1 dollar), etc. En dehors de l'intervalle
évoqué ci-dessus, le taux de change de l'euro deviendrait un
objectif ou une contrainte de la BCE, et il faudrait expliciter son rôle
dans une règle de Taylor augmentée.
2.1.2. Quelques conclusions à partir d'une variante de taux
d'intérêt
Cette variante analyse l'impact d'une baisse du taux d'intérêt
nominal de court terme de la zone euro. Le choc est d'un point par rapport au
niveau prévalant dans le compte central et cette différence est
maintenue sur les cinq années de la simulation.
Deux options sont proposées. Dans la première (cf. tableau 7), la
simulation est conduite à taux de change fixe. Le choix a donc
été fait de neutraliser les réactions du taux de change
euro/dollar afin d'identifier clairement les mécanismes de transmission
et l'intensité des effets dus aux variations de taux
d'intérêt seulement.
La seconde option (cf. tableau 8) correspond au bouclage "libre" du
modèle dans lequel le change étant influencé par la
variation du taux court et des différentiels de taux entre pays, une
dépréciation de la monnaie européenne peut intervenir.
Tableau 7
Baisse du taux d'intérêt nominal de court terme
dans la zone
euro (-1 point)
(à taux de change fixe)
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
PIB |
Zone euro
|
0,3
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
|
Inflation (1) |
Zone euro
|
0
|
0,2
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
|
|
Taux de chômage (1) |
Zone euro
|
-0,1
|
-0,2
|
-0,3
|
-0,3
|
-0,3
|
|
|
Taux d'intérêt nominal à court terme (1) |
Zone euro |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
|
|
Taux d'intérêt nominal à long terme (1) |
Zone euro |
-0,6 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|
|
Solde public (2) |
Zone euro
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
|
Balance courante (2) |
Zone euro
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,1
|
|
Source :
COE avec le modèle multinational OEF
Les taux de change sont exprimés au certain de sorte qu'un écart
variantiel positif correspond à une appréciation de la monnaie
(1) Ecarts en points
(2) Ecarts en points de PIB
Tableau 8
Baisse du taux d'intérêt nominal de court terme
dans la zone
euro (-1 point)
(à taux de change variable)
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
PIB |
Zone euro
|
0,4
|
0,4
|
0,7
|
0,8
|
0,9
|
|
Inflation (1) |
Zone euro
|
0,1
|
0,4
|
0,7
|
0,9
|
1,1
|
|
Taux de chômage (1) |
Zone euro
|
-0,1
|
-0,2
|
-0,4
|
-0,4
|
-0,5
|
|
Taux d'intérêt nominal à court terme (1) |
Zone euro |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
|
Taux d'intérêt nominal à long terme (1) |
Zone euro |
-0,6 |
-0,5 |
-0,6 |
-0,6 |
-0,6 |
|
Solde public (2) |
Zone euro
|
0,2
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
|
Balance courante (2) |
Zone euro
|
-0,1
|
0
|
0
|
-0,1
|
-0,1
|
Source :
COE avec le modèle multinational OEF
Les taux de change sont exprimés au certain de sorte qu'un écart
variantiel positif correspond à une appréciation de la monnaie
(1) Ecarts en points
(2) Ecarts en points de PIB
Si l'on
suppose que la crédibilité de la BCE est suffisante pour
permettre une baisse des taux d'intérêt sans fluctuation de
change, alors la référence à la première option
sera plus intéressante.
L'effet des variables financières sur la demande intérieure ne
transite pas uniquement par le taux de court terme. La transmission de la
baisse des taux courts aux taux de long terme est aussi un mécanisme qui
a toute son importance pour apprécier les répercussions sur la
consommation et l'investissement.
A court terme, les taux d'intérêt courts ont dans certains
modèles nationaux du modèle multinational OEF un impact direct
sur la consommation des ménages. Dans les autres cas européens
(France, Italie), ce sont les variations d'une variable "composite"
formée à partir des taux longs (à 95 %) et des taux
courts (à 5 %) et, par ailleurs, corrigée par le déflateur
de la consommation, qui sont liées aux fluctuations de la consommation.
La baisse des taux courts se répercute à près de 50 % sur
les taux nominaux de long terme (- 0,6 point la première année
puis - 0,5 point par la suite). En parallèle, le différentiel
d'inflation constaté par rapport au compte central reste
inférieur (en valeur absolue) à celui observé sur les
variables monétaires ce qui ne compromet donc pas les effets
bénéfiques de la baisse des taux d'intérêt sur la
demande. Ainsi, des suppléments de consommation significatifs et qui
s'amplifient dans le temps jusqu'à la troisième ou
quatrième année apparaissent. Dans le cas italien, il faut
préciser que l'effet des taux est plus ample et plus durable.
En revanche, cet impact expansif est contrecarré partiellement par les
pressions inflationnistes lorsqu'un effet d'encaisses réelles joue dans
l'équation de consommation. C'est le cas dans le modèle
français à court terme. Ainsi, par exemple, le surcroît de
consommation en fin de période n'atteint que la moitié de celui
enregistré en Italie. La diminution relative de la richesse
financière réelle nette qu'implique la hausse des prix renforce
ce contre-poids négatif à moyen terme.
La demande intérieure est ensuite entretenue par les surcroîts
d'activité qui en développant l'emploi assurent des revenus
supérieurs aux ménages. La baisse des intérêts
versés par ces derniers concoure également à
l'amélioration du revenu disponible et dissuade d'autant l'accumulation
d'épargne.
L'investissement des entreprises est très rapidement sensible aux
suppléments de croissance du PIB (effet accélérateur). De
plus, il réagit à une amélioration de la
profitabilité du capital qui résulte de la réduction du
niveau réel des taux d'intérêt. Comme pour la consommation,
l'impact des taux se fait par l'intermédiaire des taux longs et courts
mais ici dans des proportions équivalentes pour les deux
échéances.
La profitabilité influence la décision d'investir dans le long
terme. Le cas italien fait exception avec une intervention de cette variable
financière à la fois dans la dynamique de court terme et dans la
définition de l'équilibre de long terme. L'amplitude plus
prononcée des variations de l'investissement italien dès le
début de la période est ainsi justifiée. On trouve,
à l'opposé, l'investissement allemand nettement moins sensible
à cet effet financier.
Malgré le développement des capacités de production obtenu
grâce aux flux supplémentaires d'investissement, les importations
sont en nette croissance. Les exportations participent elles aussi à la
dynamique générale ce qui, au total, conduit à peu
d'effets sur la balance courante. L'effet est d'ailleurs neutre, en moyenne,
pour la zone euro.
Les avantages tirés de la baisse des taux s'étendent au secteur
public en allégeant le poids de son endettement. Cet effet
conjugué à celui qui résulte d'une progression relative
des recettes fiscales conduit à une amélioration du solde public
(en % PIB). Celle-ci s'élève à quelques dixièmes de
point allant dans le meilleur des cas (l'Allemagne) jusqu'à 0,5 point en
fin de période.
La transmission internationale des mouvements monétaires, bien que moins
active dans le sens Europe-Etats-Unis qu'à l'inverse, existe
néanmoins par l'intermédiaire de la présence des taux
européens dans l'explication du taux directeur de la FED. Cet effet
reste cependant symbolique. La propagation des variations de prix a plus
d'importance et ceci conduit, a contrario, à une légère
augmentation des taux d'intérêt américains.
La neutralité imposée, a priori, à la détermination
du taux de change supprime un canal international de transmission des chocs.
Spontanément le modèle provoque une dépréciation de
la monnaie nationale lorsque les taux d'intérêt fléchissent
(cf. tableau 8). Par ailleurs, si les politiques monétaires des deux
zones concernées, en l'occurence les Etats-Unis et la zone euro,
n'agissent pas dans le même sens, les différentiels de taux
d'intérêt et d'inflation se creusent pour accuser le mouvement de
dépréciation.
La dépréciation de l'euro par rapport au dollar agit, bien
entendu, au détriment du développement des exportations
américaines et en faveur de celles de la zone euro ce qui y amplifie les
effets expansifs sur le PIB.
Le rééquilibrage "automatique" des devises fait disparaître
totalement les mouvements de prix et de taux d'intérêt aux
Etats-Unis et accentue les pressions inflationnistes (salaires nominaux et
prix) dans la zone euro.
2.1.3. Retour sur la fonction de réaction de la BCE
Pour faire tourner le modèle OEF et décliner la variante de taux
d'intérêt précédente, nous avons retenu notre propre
estimation de la règle de Taylor pour la zone euro. L'estimation
adoptée est la suivante :
i = 4,5 + 0,5 (y - y*) + ( - *) + 0,5 (_
1
- *)
y* cible de croissance correspondant à la croissance potentielle dans la
zone euro et estimée à 2,5 % par an.
* cible d'inflation supposée égale à 2 %
et _
1
, inflation en glissement annuel pour le trimestre en cours et
pour le trimestre précédent.
Cette équation diffère également, mais pas drastiquement,
d'autres estimations (voir par exemple A. Verdelhan (1999)).
2.2. Taux de change de l'euro et marges de manoeuvre
2.2.1. La problématique générale
Nous avons déjà suggéré l'intervention probable de
seuils : la BCE se préoccupera vraiment du taux de change de l'euro
-spécialement du taux de change bilatéral vis-à-vis du
dollar, mais aussi, dans certains cas du taux de change effectif de l'euro-
lorsqu'il sortira d'une "zone cible". Cette "zone-cible" ne sera sans doute pas
rendue explicite par la BCE, mais on peut imaginer que, comme dans le
passé pour d'autres banques centrales, les marchés chercheront
à tester en certaines circonstances les bornes de cette "zone-cible". A
l'intérieur de cette zone, qui ne sera pas rigide mais au contraire
variera dans le temps selon les performances et les perspectives d'inflation et
de croissance en Europe, la BCE surveillera bien sûr l'évolution
du change, mais son attitude générale ne sera pas très
éloignée du
benign neglect
.
Le pragmatisme probable de la BCE en matière de change -une
hypothèse à articuler avec le débat institutionnel sur la
répartition exacte des compétences entre les instances politiques
européennes et la banque centrale à propos de la politique de
change -devrait se renforcer avec l'élargissement de l'UE et de l'UEM.
Alors que le coefficient d'ouverture commerciale de la zone euro à 11
est proche de 11 %, il tombe (en partant des chiffres les plus
récents, qui sont bien sûr appelés à se modifier)
à 8-9 % avec une zone euro à 15 ou 20. La dimension
commerciale n'est pas et ne sera pas la seule à considérer. Car
l'attractivité des marchés de capitaux de la zone est
également à prendre en compte, avec Londres aujourd'hui à
l'extérieur et demain à l'intérieur. Les autorités
politiques et monétaires ne pourront pas se désintéresser
d'éventuels arbitrages, comme celui esquissé au premier semestre
de 1999 avec la baisse de l'euro : l'amélioration de la
compétitivité-prix des entreprises de la zone est allée de
pair avec le ralentissement du redéploiement des portefeuilles
("portfolio shift") de la part de certains investisseurs internationaux en
faveur de l'euro.
2.2.2. Une simulation sur le taux de change de l'euro
Cette simulation porte sur les conséquences macro-économiques
d'une dépréciation de la monnaie américaine
vis-à-vis de l'euro. Le taux de change de l'euro contre dollar
(exprimé au certain) subit, sur l'ensemble de la période, une
hausse de 10 % par rapport au compte central.
L'analyse est conduite en deux étapes. Dans un premier temps, les effets
du choc sont évalués à taux d'intérêt de
court terme nominal européen inchangé (cf. tableau 9). La
fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne est donc
neutralisée afin d'identifier clairement l'impact isolé de la
dépréciation du dollar. Comme indiqué ci-dessus, la
fonction de réaction de la BCE suppose qu'elle réagisse à
des écarts aux cibles d'inflation (2 %) et de croissance
(2,5 %). Or, dans la première simulation, ces écarts
n'entraînent pas de modification (autres que celles imposées ex
ante) de la politique monétaire.
Les réactions de la BCE sont prises en compte dans la seconde variante
(cf. tableau 10). Aucune contrainte n'est alors imposée au modèle
et le taux d'intérêt nominal à court terme européen
peut varier à la suite du choc.
Dans le modèle OEF, la compétitivité-prix est prise en
compte à travers deux variables. Elle est représentée par
le coût relatif du travail sur le marché des biens et par les
termes de l'échange dans le secteur des services. Ces deux variables
sont des déterminants fondamentaux, à court terme comme à
long terme, du niveau des échanges extérieurs. Dès lors,
le choc proposé ici sur la parité euro/dollar entraîne une
perte de compétitivité importante pour les entreprises
européennes.
Deux types d'effets se conjuguent. D'une part, lorsque l'euro s'apprécie
par rapport au dollar. Le coût relatif du travail s'accroît en
Europe et pénalise les exportateurs de biens. D'autre part, la
dépréciation de la monnaie américaine conduit à une
augmentation de l'indice des prix du commerce mondial exprimés en
dollar. Or, les prix à l'exportation et à l'importation sont
indexés sur cet indice. Les premiers l'étant avec une
élasticité deux fois plus faible à court terme comme
à long terme, le choc modifie leur rapport et la
détérioration "des termes de l'échange" pénalise
les exportateurs de services.
Trois ans après le choc, la chute des exportations européennes
par rapport au compte central atteint son maximum (- 1,8 %) pour
s'établir à - 0,7 % lors de la dernière année. Aux
Etats-Unis par contre, l'écart variantiel atteint encore +1,1 % en
fin de simulation (cf. annexe 2)
Les importations des deux continents enregistrent des variations à la
baisse du fait de l'appréciation de l'euro. Cependant, ces modifications
ont lieu pour des raisons différentes : les importations
américaines diminuent sous l'effet de l'amélioration des termes
de l'échange tandis que la baisse des importations européennes
s'explique par une demande intérieure déprimée.
Le net recul de la demande extérieure adressée à l'Europe
(plus marqué que la baisse des importations) conduit à une
réduction de la production par rapport au compte central dans la zone
euro (- 0,6 % la cinquième année).
Cette baisse de l'activité réduit l'investissement des
entreprises européennes. En effet, celles-ci n'investissent que si elles
anticipent de futurs débouchés. Or, leurs anticipations sont
formalisées sur la base des évolutions passées de la
demande, la réduction de la production entretient par conséquent
une baisse de l'investissement privé non résidentiel.
La dépréciation du dollar a aussi pour effet de réduire
les coûts non salariaux supportés par les entreprises
européennes. Cela réduit les prix à la production et par
conséquent, les prix à la consommation et les prix du PIB. Les
salaires nominaux étant indexés sur ces prix, ils diminuent
à leur tour.
L'emploi s'ajuste à la demande finale et réagit aux
évolutions de salaires réels. Au total, le taux de chômage
européen est supérieur de 0,5 point à son niveau du compte
de référence la cinquième année après le
choc.
Cette hausse du chômage contribue à la constitution d'une
épargne de précaution et déprime davantage la demande
intérieure. Des différences importantes existent cependant au
sein de l'Europe. Ainsi, si la consommation diminue en France au cours des deux
premières années, elle augmente à partir de la
quatrième. La baisse des prix apprécie les encaisses
réelles et le pouvoir d'achat des ménages. L'effet
dépressif du choc est donc limité en France et, le taux de
chômage n'augmente, au bout de cinq ans, que de 0,1 point par rapport au
compte central. Ces différences entre les pays européens
s'expliquent par des vitesses d'ajustement différentes dans la boucle
prix-salaires, et par une réaction plus importante des prix à la
production aux coûts salariaux en France.
Dans la seconde simulation (cf. tableau 10), le mécanisme
endogène de formation des taux est actif. La réaction de la
politique monétaire européenne permet alors d'atténuer le
choc.
Le fléchissement de la croissance et la désinflation poussent les
autorités monétaires européennes à réduire
le taux directeur européen. Cette baisse conduit mécaniquement
à celle des taux long nominaux. Les taux d'intérêt
réels diminuent par rapport à la situation
précédente. Ils favorisent ainsi la consommation des
ménages et accroissent la rentabilité des projets
d'investissement.
En Europe, l'investissement total enregistre un retrait maximal de 0,3 %
la quatrième année contre - 1,7 % lorsque les taux
d'intérêt sont maintenus constants (cf. tableau 9). Alors que la
consommation fléchissait légèrement dans la variante
à taux d'intérêt fixes, elle est cette fois-ci en nette
hausse et l'écart par rapport au compte central atteint 0,7 % la
dernière année.
Les effets négatifs de la dépréciation du dollar sur la
croissance et l'emploi en Europe sont donc atténués. Le taux de
chômage croît de 0,2 point en fin de simulation contre
0,5 point précédemment.
Tableau 9
Dépréciation du dollar vis-à vis de l'euro de 10 %
(à taux d'intérêt nominal à court terme fixe)
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
PIB |
Zone euro
|
-0,3
|
-0,7
|
-0,9
|
-0,9
|
-0,6
|
|
Inflation (1) |
Zone euro
|
-0,5
|
-0,9
|
-1,0
|
-1,2
|
-1,1
|
|
Taux de chômage (1) |
Zone euro
|
0,1
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
|
Taux de change euro contre $ |
Zone euro |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Taux d'intérêt nominal à court terme (1) |
Zone euro |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Taux d'intérêt nominal à long terme (1) |
Zone euro |
0 |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
0,1 |
|
Solde public (2) |
Zone euro
|
-0,2
|
-0,4
|
-0,5
|
-0,5
|
-0,5
|
|
Balance courante (2) |
Zone euro
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0
|
-0,1
|
Source :
COE avec le modèle multinational OEF
Les taux de change sont exprimés au certain de sorte qu'un écart
variantiel positif correspond à une appréciation de la monnaie
(1) Ecarts en points
(2) Ecarts en points de PIB
Tableau 10
Dépréciation du dollar vis-à vis de l'euro de 10 %
(à taux d'intérêt nominal à court terme
variable)
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
PIB |
Zone euro
|
-0,2
|
-0,2
|
-0,3
|
-0,3
|
-0,1
|
|
Inflation (1) |
Zone euro
|
-0,5
|
-0,7
|
-0,7
|
-0,8
|
-0,7
|
|
Taux de chômage (1) |
Zone euro
|
0
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
|
Taux de change euro contre $ |
Zone euro |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Taux d'intérêt nominal à court terme (1) |
Zone euro |
-0,7 |
-0,2 |
-1,1 |
-1,1 |
-0,9 |
|
Taux d'intérêt nominal à long terme (1) |
Zone euro |
-0,4 |
-0,4 |
-0,1 |
-0,4 |
-0,4 |
|
Solde public (2) |
Zone euro
|
0
|
0
|
-0,1
|
-0,1
|
-0,1
|
|
Balance courante (2) |
Zone euro
|
0,1
|
0
|
0,1
|
-0,1
|
-0,1
|
Source :
COE avec le modèle multinational OEF
Les taux de change sont exprimés au certain de sorte qu'un écart
variantiel positif correspond à une appréciation de la monnaie
(1) Ecarts en points
(2)
Ecarts en points de PIB
2.3. La coordination entre la politique monétaire et les politiques
budgétaires et fiscales
Le policy mix
pose, dans la zone euro, des questions traditionnelles sur
la synergie et la cohérence de la politique monétaire et de la
politique budgétaire. En même temps, il soulève certains
aspects spécifiques, puisqu'il s'agit de coordonner
une
politique
monétaire et
n
politiques budgétaires (avec au
démarrage n = 11). Il y a là un défi qui suscite des
réponses aussi bien fonctionnelles qu'institutionnelles. Hors
modélisation, nous allons ici évoquer rapidement quatre
dimensions du débat.
Une première difficulté consiste à faire prévaloir
des solutions coopératives dans un contexte où des formules non
coopératives risquent spontanément de s'imposer. Ceci concerne
d'abord les relations entre la BCE et les gouvernements nationaux. A l'automne
1998 comme plus récemment, une problématique semblable à
un "dilemme du prisonnier" a caractérisé ces relations : chaque
partie attend de l'autre un geste (réduction des déficits
publics, baisse des taux de la banque centrale) avant de prendre
elle-même une initiative dans le sens d'un
policy mix
mieux
adapté aux difficultés du moment. A défaut, chacun campe
sur ses positions et le
policy mix
est sous-optimal. La baisse de son
taux directeur par la BCE le 8 avril 1999 représente, à ce
titre, une initiative intéressante, mais elle n'a pas été
suivie d'engagements suffisamment ambitieux et crédibles de la part des
autorités budgétaires nationales (en Allemagne, en France...). Il
faut, dans le respect de l'indépendance de la BCE, améliorer la
communication entre elle et les gouvernements de telle sorte que, face à
des configurations de "dilemme du prisonnier", les solutions
coopératives s'imposent. Il y va de la cohérence et de la
crédibilité du
policy mix
européen, donc aussi de
la crédibilité de l'euro et du niveau des taux nominaux et
réels dans la zone.
La question du
policy mix
pose aussi celle de l'effectivité et de
la crédibilité du pacte de stabilité. Celui-ci constitue
un garde-fou indispensable. Il devra cependant faire l'objet d'adaptations au
cours des prochaines années, à la lumière de
l'expérience. Il faudra, par exemple, expliciter dans le dispositif de
surveillance multilatérale le rôle indispensable de concepts comme
le solde primaire et le solde structurel (ce dernier solde n'intervient que de
façon indirecte et implicite, à travers l'exonération des
pénalités dans l'hypothèse d'une récession grave).
Il faudra aussi évaluer la crédibilité de l'ensemble du
dispositif. Le risque est en effet important qu'à l'occasion du
dérapage des finances publiques dans tel ou tel pays-membre, les
pénalités et la discipline prévues ne soient pas
parfaitement respectées.
Une autre ligne de force pour les cinq années à venir concerne le
rôle du Conseil de l'euro et son articulation avec le Conseil Ecofin.
Certes, avec l'entrée progressive des pays "out" dans la zone euro, les
deux instances auront de moins en moins de raison d'être
distinguées, mais d'ici là on peut s'attendre à ce que le
Conseil de l'euro, aux compétences largement définies mais aux
pouvoirs délibératifs aujourd'hui nuls (ou presque), s'affirme
dans le processus de coordination économique européen.
Last but not least
, les marges de manoeuvre budgétaires
dépendront non pas du principe de l'harmonisation fiscale -elle
interviendra de toute façon, provoquant non pas une convergence totale
des systèmes fiscaux, mais une réduction des écarts
actuellement constatés- mais de la façon dont elle se fera. Tant
que la règle de l'unanimité s'applique à Bruxelles pour
les questions fiscales, les chances de succès de la coordination
fiscale, par exemple du "code de conduite" proposé par M. Monti en
particulier pour l'impôt sur les sociétés et la
fiscalité de l'épargne, sont minces. C'est donc le
scénario de concurrence fiscale (et parafiscale) tous azimuts qui
prévaut et va continuer à prévaloir pendant un certain
temps, avec ses avantages et ses inconvénients. Seul le passage à
la majorité qualifiée permettrait de progresser dans la voie de
l'harmonisation par la coordination. En toile de fond du débat fiscal,
se profilent très vite deux autres débats liés, celui sur
la nécessaire réduction des dépenses publiques (en
Allemagne, en France...) et celui, déjà évoqué, sur
le pacte de stabilité.
2.4. Les réformes structurelles
Vu la croissance prévisible au cours des cinq années et les
contraintes pesant sur le
policy mix
européen, il faudra pouvoir
compter sur différentes réformes structurelles touchant aux
marchés du travail, à la protection sociale et au système
des retraites, à l'éducation, etc. Des réformes
structurelles toujours annoncées, souvent retardées. A cet
égard, l'Allemagne et la France paraissent en retard par rapport aux
Pays-Bas (même si l'idée de "modèle néerlandais" est
à relativiser...).
Nous présentons les résultats d'une simulation touchant à
un aspect de la politique structurelle, à savoir la réduction des
cotisations sociales employeurs. Il s'agit là d'un mouvement
amorcé depuis plusieurs années dans plusieurs pays-membres, mais
dont il est intéressant de préciser certains effets.
Cette simulation porte sur les conséquences macro-économiques
d'une réduction des cotisations sociales à la charge des
employeurs (cf. tableau 11). La baisse de la pression fiscale intervient
à travers une diminution d'un point de PIB du montant global de ces
cotisations. La mesure est appliquée simultanément en France, en
Allemagne et en Italie, et n'est pas financée ex ante.
Dans les trois pays concernés, la baisse des cotisations sociales
à la charge des employeurs conduit à un allégement des
coûts salariaux supportés par les entreprises. Ceci exerce un
effet restrictif direct sur les prix à l'exportation, sur le prix du PIB
et entraîne mécaniquement une baisse des prix à la
production. Dès lors, la désinflation se transmet aux prix
à la consommation et favorise à nouveau la baisse des prix
à la consommation, et favorise à nouveau la baisse des prix
à l'exportation.
La baisse du niveau général des prix se propage dans chacune de
ces économies et entretient une réduction des salaires nominaux.
Ceux-ci sont en effet indexés à court terme sur les prix à
la consommation, ou sur les prix du PIB selon le pays considéré.
Dans le cas français, par exemple, les salaires nominaux du secteur
privé sont indexés avec une élasticité de 1 sur le
prix du PIB à long terme, alors que leurs variations à court
terme s'expliquent par leurs propres variations trimestrielles passées
et par celles des prix à la consommation (avec une
élasticité de 0,5 à un an). Ces réductions de
salaires nominaux allègent à nouveau les coûts de
production et entretiennent ainsi les effets désinflationnistes.
Le choc implique des gains importants en termes de compétitivité.
Dans les trois pays concernés, les exportations de biens
dépendent directement des coûts salariaux unitaires relatifs. La
désinflation rend, par conséquent, les entreprises plus
compétitives vis-à-vis de leurs concurrents à
l'exportation.
Des effets bénéfiques apparaissent dans les trois pays
affectés par le choc mais on constate des différences
relativement importantes quant à leurs amplitudes. La spirale
désinflationniste "prix-salaires" apparaît beaucoup plus
accentuée dans le cas français ce qui provient de la
sensibilité plus forte des prix à la production aux coûts
salariaux et, de façon secondaire, des ajustements plus rapides des prix
et des salaires par rapport à l'Allemagne et l'Italie.
Les gains de compétitivité-prix se traduisent
immédiatement par une forte augmentation des exportations dans les trois
pays européens de sorte que la demande extérieure constitue un
moteur pour la croissance. La demande intérieure réagit alors aux
effets-prix et aux effets-volume découlant du choc. La baisse relative
des prix intérieurs soutient la consommation par un effet d'encaisses
réelles qui apparaît à deux niveaux. Certains
modèles, comme celui concernant l'économie française,
intègrent directement un effet de la variation des prix à la
consommation dans la dynamique de court terme. A moyen terme,
l'appréciation de la richesse financière réelle des
ménages dans les trois pays européens encourage la consommation.
Tableau 11
Baisse des cotisations sociales à la charge des employeurs
(1% du PIB
ex ante
maintenue sur 5 ans)
en France, en Allemagne et en Italie
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
PIB |
Zone euro
|
0,2
|
0,7
|
0,9
|
1,1
|
1,2
|
|
Inflation (1) |
Zone euro
|
-0,5
|
-1,2
|
-1,2
|
-1,3
|
-1,4
|
|
Taux de chômage (1) |
Zone euro
|
-0,3
|
-0,7
|
-0,9
|
-1,0
|
-1,1
|
|
Taux d'intérêt nominal à court terme (1) |
Zone euro |
-0,5 |
-1,5 |
-1,7 |
-1,9 |
-2,0 |
|
Taux d'intérêt nominal à long terme (1) |
Zone euro |
-0,3 |
-0,8 |
-0,9 |
-1,0 |
-1,1 |
|
Solde public (2) |
Zone euro
|
-0,4
|
-0,1
|
-0,1
|
0,1
|
0,2
|
|
Balance courante (2) |
Zone euro
|
0
|
-0,1
|
0
|
0
|
0
|
Source :
COE avec le modèle multinational OEF
Les taux de change sont exprimés au certain de sorte qu'un écart
variantiel positif correspond à une appréciation de la monnaie
(1) Ecarts en points
(2)
Ecarts en points de PIB
Le surplus de croissance enregistré conduit également les
entreprises à recruter davantage, accentuant ainsi les effets directs de
la baisse des coûts salariaux sur l'emploi. Cinq ans après le
choc, le taux de chômage européen a diminué de 1,1 point
par rapport au compte de référence. Réduisant
l'épargne de précaution des ménages et alimentant en
retour leur revenu disponible brut, cette baisse du chômage favorise
à nouveau la consommation.
Enfin, l'investissement des entreprises s'adapte à la croissance de la
demande finale et amplifie dès lors les effets expansifs (effet
accélérateur). En fin de simulation, les investissements
privés des entreprises françaises, allemandes et italiennes se
sont respectivement accrûs de 2,1 %, 2,9 % et 0,9 % par
rapport à la situation de référence.
Cinq années après le choc, l'écart variantiel du PIB
de la zone Euro est de 1,2 % et, respectivement, de 2,3 %, 1,9 %
et 0,9 % pour l'Allemagne, la France et l'Italie.
De plus la désinflation produite par la baisse relative du coût du
travail pousse les autorités monétaires à assouplir leur
politique. Par ailleurs, la baisse du taux d'intérêt à
court terme conduit mécaniquement à une diminution des
coûts de financement à long terme et donc à des taux
d'intérêt nominaux à long terme inférieurs à
ceux prévalant dans le compte de référence.
La baisse de l'inflation est cependant plus rapide que la baisse des taux
d'intérêt nominaux de long terme. Dès lors les taux
réels sont en hausse dans les pays concernés ce qui favorise
l'épargne, réduit la rentabilité des projets
d'investissement et, par conséquent, tempère le dynamisme de la
demande intérieure.
Le différentiel de taux courts nominaux entre l'Europe et les Etats-Unis
attire les capitaux outre-atlantique. A court terme, la monnaie
européenne se déprécie légèrement par
rapport au dollar, accentuant ainsi les gains de
compétitivité-prix mais, à moyen terme, l'effet du
différentiel d'inflation l'emporte. Alors que la baisse du taux
d'intérêt nominal à court terme s'estompe, la
désinflation rend l'euro plus attractif. A partir de la quatrième
année, la monnaie unique européenne s'apprécie par rapport
au compte de référence.
La baisse des charges sociales n'étant pas financée
ex
ante
, elle se traduit dans un premier temps par une baisse des recettes de
l'Etat. La détérioration des finances publiques n'est que
temporaire car la baisse du chômage réduit le montant des
prestations sociales versées par les administrations publiques et, en
parallèle, le surplus de croissance accroît les recettes fiscales.
Pour la zone euro dans son ensemble, le déficit public (en points de
PIB) retrouve dès la quatrième année un niveau semblable
à celui du compte de référence.
REFERENCES
Akerlof
G.A., Dickens W.T., Perry G.L., "The Macroeconomics of Low Inflation",
Brooking Papers on Economic Activity
, n° 1, 1996.
Ark, B. Van, "Manufacturing Prices, Productivity and Labor Costs in Five
Economies",
Monthly Labor Review
, Bureau of Labor Statistics, juillet
1995.
Ark, B. Van et Pilat D., "Productivity Levels in Germany, Japan and the United
States : Differences and Causes",
Brookings Papers on Economic Activity :
Microeconomics
, n° 2, décembre 1993.
Ark, B. Van, "Comparative Productivity in British and American Manufacturing",
National Institute Economic Review
, n° 142, novembre 1992.
Ball L., "Disinflation and the NAIRU",
National Bureau of Economic
Research
, Working Paper n° 5520, mars 1996.
Barro R.J., "Inflation and Economic Growth",
Bank of England, Quarterly
bulletin,
mai 1995.
Blanchard O.J. et Fitoussi J.P., "Croissance et chômage",
rapport du
Conseil d'analyse économique, la documentation française
,
1998.
Blanchard O.J. et Katz L.F., "What we Know and do not Know about the Natural
Rate of Unemployment",
The Journal of Economic Perspectives
, volume 11,
1997.
Brender A. et Pisani F., "Le nouvel âge de l'économie
américaine",
Economica
, 1999.
Briault C., "The Costs of Inflation",
Bank of England, Quarterly bulletin,
vol. 3, février 1995.
Chatelain J-B. et Sevestre P., "Coûts et bénéfices du
passage d'une faible inflation à la stabilité des prix. Une
comparaison internationale",
Banque de France
, Notes d'études et
de recherche, n° 62, février 1999.
Commission économique européenne, "Economic Survey of Europe",
n° 1, 1999.
Cotis J.P., Méary R. et Sobczak N., "Le taux de chômage
d'équilibre en France",
Direction de la Prévision
,
Document de travail,
décembre 1996.
Feldstein M., "The Costs and Benefits of Going from Low Inflation to Price
Stability",
National Bureau of Economic Research
, Working Paper
n° 5469, février 1996.
FMI, "The Rise and Fall of Inflation - Lessons from the Postwar Experience",
World Economic Outlook
, octobre 1996.
Direction de la prévision, "Que peut-on dire du cycle de l'UEM à
la veille de la création de l'euro ?",
Note de conjoncture
internationale,
décembre 1998.
Galbraith J.K., "Time to Ditch the NAIRU",
The Journal of Economic
Perspectives
, vol. 11, n° 1, 1997.
Giorno C., Richardson P., Roseveare D. et Noord Van Den P., "Estimating
Potential Output, Output Gaps and Structural Budget Balances",
Organisation
for Economic Co-operation and Development
, Working paper n° 152,
1995.
Gordon R.J., "The Time-Varying NAIRU and its Implications for Economic Policy",
The Journal of Economic Perspectives
, volume 11, n° 1, 1997.
Gordon R.J., "Foundation of the Goldilocks Economy : Supply Shocks and the
Time-Varying NAIRU, Brooking Papers on Economic Activity n° 2, 1998.
Lahidji R. "La nouvelle économie, entre mythe et réalité",
Commissariat Général du Plan, avril 1999.
La revue du CEPII, "Croissance potentielle et écart de production",
La documentation française
, 1997.
Layard R., Nickell S. et Jackman R. "Unemployment : Macroeconomic Performance
and the Labor Market",
University Press
, Oxford, 1991.
Lhorty Y. et N. Sobczak "Les déterminants du chômage
d'équilibre : estimation d'un modèle WS-PS",
Economie et
Prévision
n° 127, 1997.1.
OCDE, "Perspectives économiques de l'OCDE", décembre 1998
Oliner S. et Sichel D., "Computers and Output Growth Revisited : How Big Is the
Puzzle ?", Brooking Papers on Economic Activity, n° 2, 1994.
Pilat D., "Labour Productivity Levels in OECD countries : Estimates for
Manufacturing and Selected Service Sectors", OCDE,
Economics Department
,
Working Paper n° 169, 1996.
Pigott C. et Christiansen H., "Monetary Policy when Inflation is Low",
OCDE,
Economics Department
, Working Paper, n° 191, mars 1998.
Rudebush G.D. et Wilcox D.W., "Productivity and Inflation : evidence and
interpretations", Federal Reserve Board, Washington, mai 1995.
Scarpetta S. "Assesing the Role of Labour Market Policies and Institutional
Settings on Unemployment : A Cross-country Study",
OECD Economic Studies
,
n° 26, 1996.
Staiger D., Stock J. H., Watson M. W., "The NAIRU, Unemployment and Monetary
Policy",
The Journal of Economic Perspectives
, volume 11,
n° 1, 1997.
Stiglitz J., "Reflections on the Natural Rate Hypothesis",
The Journal of
Economic Perspectives
, volume 11, n° 1, 1997.
Svensson Lars E. O., "Price Stability as a Target for Monetary Policy: Defining
and Maintaining Price Stability",
Institute for International Economic
Studies, Stockholm University, CEPR and NBER,
mars 1999.
Tödter K.-H et Ziebarth G., "Price Stability versus Low Inflation in
Germany, An Analysis of Costs and Benefits",
Economic Research Group of the
Deutsche Bundesbank
, Discussion paper 3/97, juillet 1997.
Verdelhan A., "Taux de Taylor et taux de marché de la zone euro",
Banque de France
, Bulletin trimestriel, n°61, 1999.
ANNEXE
1
Le modèle multinational OEF
Le
modèle multinational macroéconométrique OEF, de
fréquence trimestrielle, comprend 22 modèles nationaux et 6
zones géographiques (couvrant 52 pays). Bien entendu, une
hiérarchie existe dans le traitement détaillé des pays.
Les principales économies industrialisées (Etats-Unis, Japon,
Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada) donnent lieu à des
modèles "volumineux" et plus performants (250 variables) que les petits
pays européens ou certains pays émergents (150 variables).
D'autre part, certaines régions du monde sont traitées en bloc et
avec une précision sommaire.
L'approche "globalisante" des modèles multinationaux se traduit par une
structure théorique similaire à la plupart des modèles
nationaux qui les composent. C'est le cas du modèle OEF. Les
spécificités nationales transparaissent alors essentiellement
à travers les valeurs des coefficients estimés dans chacune des
équations de comportement.
Sur le plan méthodologique, l'approche économétrique
correspond à la nouvelle génération de modèles
macro-économiques puisqu'elle est basée sur l'existence et la
mise en évidence de relations de cointégration entre les
principales composantes économiques dans le long terme. Techniquement,
cela se traduit par la présence de modèles à correction
d'erreur dans la majorité des équations du modèle.
Pour l'interprétation économique, cette architecture technique
n'est pas sans importance. Elle permet d'appréhender à la fois la
dynamique de court terme et le comportement de long terme des principales
variables analysées, la première étant corrigée
systématiquement afin d'assurer l'équilibre de moyen-long terme
du modèle. Le qualificatif "long" doit être nuancé car pour
un modèle trimestriel comme l'est OEF, l'ajustement au long terme peut
être réalisé en l'espace de quelques années (dont le
nombre est inférieur à 5 ans, notamment). Cette structure
technique répond ainsi doublement aux exigences du contenu
théorique puisque les expressions de long terme ont aussi la
propriété d'intégrer des déterminants
reflétant des comportements d'offre, souvent absents dans les
générations précédentes de modèles
macro-économiques néo-keynésiens.
Outre la globalisation géographique, la quasi-totalité des
variables économiques sont endogénéisées.
Le traitement des taux d'intérêt et des taux de change est, sur ce
plan, un exemple déterminant. La politique monétaire est
endogène dans le modèle multinational, conduire des variantes
à politique inchangée suppose donc que l'on neutralise un certain
nombre d'équations.
La formalisation des variables financières s'étend au-delà
des taux d'intérêt et de change. Elle couvre, en effet, mais de
façon plus sommaire, les déterminants directeurs de
marchés financiers. Ainsi, le marché des actions et leur prix ne
sont pas exogènes dans le modèle. La demande de monnaie est
également déterminée par le bouclage
macro-économique multinational.
Ces choix de développement ont des conséquences sur l'ensemble du
modèle car, ces variables financières sont présentes dans
les comportements économiques centraux : approche en Q de Tobin pour
l'investissement des entreprises ; influence de la richesse financière
dans le comportement de consommation et bien entendu, présence des taux
d'intérêt courts et/ou longs dans un grand nombre
d'équations pour expliquer à la fois l'équilibre de
moyen-long terme et la dynamique de court terme.
La transmission des chocs financiers internes et/ou externes conditionne donc,
de manière significative, à côté de la transmission
des chocs en volume, les résultats du modèle. Dans ces domaines,
la prédominance de l'économie américaine et allemande
(pour l'Europe) apparaît clairement.
La dernière version du modèle OEF (début 1999)
intègre la modélisation de la zone euro (11 pays). Cela se
traduit par l'existence de variables "zone euro" résultant simplement de
l'agrégation pondérée de variables calculées par
les différents modèles nationaux. Mais surtout, les
spécifications concernant la politique monétaire ont
été modifiées. Ainsi, le taux d'intérêt
à court terme pour la zone euro est déterminé dans le
modèle allemand par une fonction de réaction de la BCE
basée prioritairement sur une cible d'inflation (2 %) et, de
façon marginale, sur une cible de croissance potentielle (2,5 % pour
l'ensemble de la zone).
Un taux de change euro/dollar est formalisé à partir des
différentiels de taux d'intérêt et d'inflation par rapport
aux Etats-Unis et d'une prime de risque fonction de la balance courante. Il est
décliné à l'ensemble de la zone. Aucune autonomie
nationale n'est donc plus autorisée.
ANNEXE
2
Baisse du taux d'intérêt nominal de court terme dans la zone
euro
(- 1 point) (à taux de change fixe)
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
PIB |
Etats-Unis |
0 |
0,1 |
0 |
-0,1 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
|
Allemagne |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
|
France |
0,3 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
|
|
Italie |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
|
|
Royaume-Uni |
0,2 |
0,3 |
0 |
-0,2 |
-0,3 |
|
Consommation |
Etats-Unis |
0 |
0 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,1 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Zone euro |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
|
|
Allemagne |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
|
France |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
|
Italie |
0,3 |
0,5 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
|
|
Royaume-Uni |
0,4 |
0,9 |
0,7 |
0,4 |
0,3 |
|
Investissement privé non résidentiel (*) |
Etats-Unis |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0 |
0,2 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
-0,1 |
-0,2 |
|
|
Zone euro |
0,5 |
1,1 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
|
|
Allemagne |
0,3 |
1,0 |
1,1 |
1,0 |
0,8 |
|
|
France |
0,7 |
1,2 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
|
|
Italie |
0,8 |
1,5 |
1,6 |
1,3 |
1,1 |
|
|
Royaume-Uni |
0,2 |
0,9 |
0,5 |
-0,2 |
-0,3 |
|
Exportations |
Etats-Unis |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
|
|
Japon |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
|
|
Zone euro |
0,4 |
0,8 |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
|
|
Allemagne |
0,4 |
0,8 |
0,7 |
0,5 |
0,4 |
|
|
France |
0,5 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
|
|
Italie |
0,4 |
0,7 |
0,6 |
0,4 |
0,4 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,3 |
-0,1 |
|
Importations |
Etats-Unis |
-0,1 |
0 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,2 |
|
|
Japon |
0 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,3 |
|
|
Zone euro |
0,6 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
|
Allemagne |
0,7 |
0,9 |
0,8 |
0,6 |
0,6 |
|
|
France |
0,9 |
1,3 |
1,1 |
0,9 |
1,0 |
|
|
Italie |
0,5 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
|
|
Royaume-Uni |
0,5 |
1,2 |
1,2 |
0,9 |
0,8 |
|
Taux de chômage (1) |
Etats-Unis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
-0,1 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
|
|
Allemagne |
-0,1 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,4 |
-0,4 |
|
|
France |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Italie |
-0,1 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,4 |
-0,5 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
-0,1 |
0 |
0 |
0,1 |
(1) Ecarts
en points (*) investissement total pour la zone euro
Source : COE avec le modèle multinational OEF
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Inflation (1) |
Etats-Unis |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Japon |
0 |
0,1 |
0 |
0 |
0,1 |
|
|
Zone euro |
0 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
|
Allemagne |
0 |
0,2 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
|
|
France |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
|
|
Italie |
0 |
0,2 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,2 |
0,2 |
0,2 |
-0,2 |
0,4 |
|
Salaires nominaux |
Etats-Unis |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Allemagne |
0,1 |
0,4 |
0,8 |
1,4 |
2,1 |
|
|
France |
0,1 |
0,4 |
0,6 |
0,9 |
1,2 |
|
|
Italie |
0,1 |
0,4 |
0,9 |
1,4 |
2,0 |
|
|
Royaume-Uni |
0,1 |
0,3 |
0,5 |
0,2 |
-0,3 |
|
Taux de change contre $ |
Japon |
0,1 |
-0,1 |
0 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Zone euro |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Royaume-Uni |
1,4 |
1,9 |
1,9 |
2,1 |
2,8 |
|
Taux de change contre euro |
Japon |
0,1 |
-0,1 |
0 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Royaume-Uni |
1,4 |
1,9 |
1,9 |
2,1 |
2,8 |
|
Taux d'intérêt nominal à court terme (1) |
Etats-Unis |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
|
|
Zone euro |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,3 |
0 |
-0,1 |
-0,3 |
-0,5 |
|
Taux d'intérêt nominal à long terme (1) |
Etats-Unis |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Zone euro |
-0,6 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,5 |
-0,4 |
-0,4 |
-0,4 |
-0,5 |
|
Solde public (2) |
Etats-Unis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
|
Allemagne |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
|
|
France |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
|
|
Italie |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
0,1 |
0 |
-0,1 |
-0,3 |
|
Balance courante (2) |
Etats-Unis |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Zone euro |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
|
|
Allemagne |
-0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
France |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Italie |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,1 |
-0,3 |
-0,4 |
-0,3 |
-0,3 |
(2) Ecarts
en points de PIB
Les taux de change sont exprimés au certain de sorte qu'un écart
variantiel positif correspond à une appréciation de la monnaie.
Source : COE avec le modèle multinational OEF
Baisse
du taux d'intérêt nominal de court terme dans la zone euro
(-1
point) (à taux de change variable)
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
PIB |
Etats-Unis |
0 |
0 |
0 |
0 |
-0,1 |
|
|
Japon |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0 |
|
|
Zone euro |
0,4 |
0,4 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
|
|
Allemagne |
0,4 |
0,7 |
0,9 |
1 |
0,9 |
|
|
France |
0,4 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
|
|
Italie |
0,3 |
0,7 |
0,9 |
1 |
1,1 |
|
|
Royaume-Uni |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
-0,1 |
-0,2 |
|
Consommation |
Etats-Unis |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
|
|
Allemagne |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
|
France |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
|
|
Italie |
0,3 |
0,6 |
0,9 |
1,1 |
1,2 |
|
|
Royaume-Uni |
0,4 |
0,8 |
0,7 |
0,4 |
0,2 |
|
Investissement privé non résidentiel (*) |
Etats-Unis |
0 |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
|
|
Japon |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
|
|
Zone euro |
0,6 |
1,3 |
1,7 |
1,9 |
2,1 |
|
|
Allemagne |
0,3 |
1,2 |
1,5 |
1,5 |
1,3 |
|
|
France |
0,9 |
1,5 |
1,4 |
1,4 |
1,6 |
|
|
Italie |
1,0 |
2,0 |
2,3 |
2,2 |
2,0 |
|
|
Royaume-Uni |
0,3 |
1,0 |
0,8 |
0 |
-0,3 |
|
Exportations |
Etats-Unis |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
|
|
Japon |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Zone euro |
0,6 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
|
Allemagne |
0,6 |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
1,0 |
|
|
France |
0,6 |
1,2 |
1,3 |
1,5 |
1,7 |
|
|
Italie |
0,6 |
1,1 |
1,1 |
1,0 |
0,9 |
|
|
Royaume-Uni |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
|
Importations |
Etats-Unis |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|
|
Japon |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|
|
Zone euro |
0,7 |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
|
Allemagne |
0,7 |
1 |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
|
|
France |
1,0 |
1,6 |
1,5 |
1,3 |
1,4 |
|
|
Italie |
0,6 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
|
|
Royaume-Uni |
0,5 |
1,2 |
1,1 |
0,9 |
0,8 |
|
Taux de chômage (1) |
Etats-Unis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
-0,1 |
-0,2 |
-0,4 |
-0,4 |
-0,5 |
|
|
Allemagne |
-0,1 |
-0,3 |
-0,5 |
-0,6 |
-0,7 |
|
|
France |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
|
|
Italie |
-0,1 |
-0,3 |
-0,5 |
-0,6 |
-0,8 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
0 |
0,1 |
(1) Ecarts
en points (*) investissement total pour la zone euro
Source : COE avec le modèle multinational OEF
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Inflation (1) |
Etats-Unis |
0 |
-0,1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
0,1 |
0,4 |
0,7 |
0,9 |
1,1 |
|
|
Allemagne |
0,1 |
0,4 |
0,8 |
1,1 |
1,4 |
|
|
France |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
|
|
Italie |
0,1 |
0,5 |
0,8 |
1,0 |
1,2 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,1 |
0,4 |
0,4 |
0,1 |
-0,1 |
|
Salaires nominaux |
Etats-Unis |
0 |
0 |
0 |
0 |
-0,1 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
|
|
Allemagne |
0,1 |
0,5 |
1,3 |
2,3 |
3,6 |
|
|
France |
0,1 |
0,5 |
0,9 |
1,4 |
2,2 |
|
|
Italie |
0,1 |
0,5 |
1,3 |
2,2 |
3,3 |
|
|
Royaume-Uni |
0,1 |
0,6 |
0,9 |
0,9 |
0,6 |
|
Taux de change contre $ |
Japon |
0,1 |
0 |
0,1 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
-1,9 |
-2,3 |
-2,9 |
-3,8 |
-4,8 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,5 |
-0,1 |
-0,5 |
-0,9 |
-0,9 |
|
Taux de change contre euro |
Japon |
2,1 |
2,4 |
3 |
4 |
5,1 |
|
|
Royaume-Uni |
1,5 |
2,2 |
2,5 |
3 |
4,1 |
|
Taux d'intérêt nominal à court terme (1) |
Etats-Unis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,3 |
0,1 |
0,2 |
0 |
-0,2 |
|
Taux d'intérêt nominal à long terme (1) |
Etats-Unis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
-0,6 |
-0,5 |
-0,6 |
-0,6 |
-0,6 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,5 |
-0,4 |
-0,4 |
-0,5 |
-0,5 |
|
Solde public (2) |
Etats-Unis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
|
|
Allemagne |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
|
|
France |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
|
|
Italie |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0 |
|
Balance courante (2) |
Etats-Unis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
-0,1 |
0 |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Allemagne |
-0,1 |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
|
|
France |
-0,1 |
-0,2 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Italie |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,1 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,2 |
(2) Ecarts
en points de PIB
Les taux de change sont exprimés au certain de sorte qu'un écart
variantiel positif correspond à une appréciation de la monnaie.
Source : COE avec le modèle multinational OEF
Dépréciation du dollar vis-à-vis-de
l'euro
de 10
%
(à taux d'intérêt nominal de court terme
fixe)
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
PIB |
Etats-Unis |
0,1 |
0,3 |
-0,3 |
-0,5 |
0,3 |
|
|
Japon |
0 |
-0,2 |
-0,4 |
-0,4 |
-0,1 |
|
|
Zone euro |
-0,3 |
-0,7 |
-0,9 |
-0,9 |
-0,6 |
|
|
Allemagne |
-0,3 |
-0,8 |
-1,1 |
-1,1 |
-0,7 |
|
|
France |
-0,3 |
-0,6 |
-0,6 |
-0,6 |
-0,3 |
|
|
Italie |
-0,4 |
-0,8 |
-1,1 |
-1,1 |
-0,8 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,2 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,3 |
0,1 |
|
Consommation |
Etats-Unis |
-0,2 |
-0,6 |
-0,9 |
-0,8 |
0 |
|
|
Japon |
-0,1 |
-0,4 |
-0,7 |
-0,6 |
-0,4 |
|
|
Zone euro |
0 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,1 |
0,1 |
|
|
Allemagne |
0,1 |
0 |
-0,2 |
-0,2 |
0,2 |
|
|
France |
-0,1 |
-0,2 |
0 |
0,3 |
0,5 |
|
|
Italie |
-0,1 |
-0,3 |
-0,5 |
-0,6 |
-0,5 |
|
|
Royaume-Uni |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
|
Investissement privé non résidentiel (*) |
Etats-Unis |
0,7 |
1,8 |
0,7 |
-0,8 |
1,0 |
|
|
Japon |
-0,1 |
-0,6 |
-1,1 |
-1,3 |
-0,7 |
|
|
Zone euro |
-0,3 |
-1,1 |
-1,5 |
-1,7 |
-1,3 |
|
|
Allemagne |
-0,2 |
-1,1 |
-1,7 |
-1,8 |
-1,0 |
|
|
France |
-0,6 |
-1,3 |
-1,4 |
-1,2 |
-0,6 |
|
|
Italie |
-1,0 |
-2,1 |
-2,5 |
-2,1 |
-1,0 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,2 |
-0,9 |
-0,9 |
-0,4 |
0,7 |
|
Exportations |
Etats-Unis |
0,5 |
0,8 |
0,3 |
0,4 |
1,1 |
|
|
Japon |
-0,4 |
-0,3 |
-0,5 |
-0,3 |
0,6 |
|
|
Zone euro |
-0,9 |
-1,6 |
-1,8 |
-1,6 |
-0,7 |
|
|
Allemagne |
-1,0 |
-1,8 |
-2,1 |
-1,8 |
-0,8 |
|
|
France |
-0,9 |
-1,6 |
-2,1 |
-2,1 |
-1,5 |
|
|
Italie |
-0,9 |
-1,6 |
-1,9 |
-1,6 |
-0,7 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,9 |
-1,4 |
-1,4 |
-0,9 |
0,1 |
|
Importations |
Etats-Unis |
-1,1 |
-1,7 |
-2,7 |
-2,0 |
0,1 |
|
|
Japon |
-1,0 |
-1,8 |
-2,2 |
-1,7 |
-1,0 |
|
|
Zone euro |
-0,3 |
-0,7 |
-0,8 |
-0,5 |
0,2 |
|
|
Allemagne |
-0,2 |
-0,4 |
-0,4 |
0,1 |
1,0 |
|
|
France |
-0,7 |
-1,4 |
-1,4 |
-0,9 |
0 |
|
|
Italie |
-0,1 |
-0,3 |
-0,4 |
-0,1 |
0,5 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,4 |
|
Taux de chômage (1) |
Etats-Unis |
-0,1 |
-0,2 |
0,1 |
0,2 |
-0,1 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0 |
|
|
Zone euro |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
|
Allemagne |
0,1 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
0,8 |
|
|
France |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Italie |
0,1 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
0,9 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
0,1 |
0,1 |
0 |
-0,1 |
(1) Ecarts
en points (*) investissement total pour la zone euro
Source : COE avec le modèle multinational OEF
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Inflation (1) |
Etats-Unis |
0,7 |
0,6 |
0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Japon |
0,2 |
0,4 |
0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Zone euro |
-0,5 |
-0,9 |
-1,0 |
-1,2 |
-1,1 |
|
|
Allemagne |
-0,5 |
-0,9 |
-1,2 |
-1,4 |
-1,4 |
|
|
France |
-0,6 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
|
|
Italie |
-0,6 |
-1,0 |
-1,1 |
-1,2 |
-1,2 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,5 |
-0,7 |
-0,8 |
-0,7 |
-0,2 |
|
Salaires nominaux |
Etats-Unis |
0,1 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
1,3 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Allemagne |
-0,1 |
-0,8 |
-1,9 |
-3,1 |
-4,2 |
|
|
France |
-0,1 |
-0,8 |
-1,4 |
-2,1 |
-2,8 |
|
|
Italie |
-0,2 |
-0,8 |
-1,7 |
-2,7 |
-3,7 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,3 |
-1,1 |
-2,0 |
-2,7 |
-2,8 |
|
Taux de change contre $ |
Japon |
-0,1 |
-0,6 |
-0,4 |
0,7 |
0,8 |
|
|
Zone euro |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Royaume-Uni |
10,5 |
9,5 |
8,5 |
7,8 |
7,4 |
|
Taux de change contre euro |
Japon |
-10,1 |
-10,5 |
-10,4 |
-9,4 |
-9,3 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,6 |
-1,5 |
-2,3 |
-3,0 |
-3,3 |
|
Taux d'intérêt nominal à court terme (1) |
Etats-Unis |
0,1 |
0,6 |
0,6 |
0,1 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0,1 |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Zone euro |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,3 |
-0,8 |
-1,1 |
-1,0 |
-0,6 |
|
Taux d'intérêt nominal à long terme (1) |
Etats-Unis |
0,1 |
0,5 |
0,7 |
0,2 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0,2 |
0,4 |
0,1 |
-0,1 |
|
|
Zone euro |
0 |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
0,1 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
|
Solde public (2) |
Etats-Unis |
0 |
0,1 |
0 |
-0,1 |
0,2 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
-0,2 |
-0,2 |
0 |
|
|
Zone euro |
-0,2 |
-0,4 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|
|
Allemagne |
-0,2 |
-0,4 |
-0,6 |
-0,7 |
-0,6 |
|
|
France |
-0,3 |
-0,4 |
-0,4 |
-0,4 |
-0,4 |
|
|
Italie |
-0,1 |
-0,3 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,2 |
-0,4 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|
Balance courante (2) |
Etats-Unis |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
|
|
Japon |
0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Zone euro |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0 |
-0,1 |
|
|
Allemagne |
0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,4 |
|
|
France |
0,1 |
0,1 |
0 |
-0,1 |
-0,2 |
|
|
Italie |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,1 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,1 |
0 |
(2) Ecarts
en points de PIB
Les taux de change sont exprimés au certain de sorte qu'un écart
variantiel positif correspond à une appréciation de la monnaie.
Source : COE avec le modèle multinational OEF
Dépréciation du dollar vis-à-vis de
l'euro
de 10
%
(à taux d'intérêt nominal de court terme
variable)
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
PIB |
Etats-Unis |
0,1 |
0,3 |
-0,2 |
-0,5 |
0,3 |
|
|
Japon |
0 |
-0,1 |
-0,4 |
-0,4 |
-0,1 |
|
|
Zone euro |
-0,2 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,1 |
|
|
Allemagne |
-0,1 |
-0,2 |
-0,4 |
-0,4 |
-0,1 |
|
|
France |
-0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,1 |
0,1 |
|
|
Italie |
-0,2 |
-0,3 |
-0,4 |
-0,4 |
-0,2 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,2 |
-0,2 |
-0,4 |
-0,5 |
-0,2 |
|
Consommation |
Etats-Unis |
-0,2 |
-0,6 |
-1,0 |
-0,9 |
-0,2 |
|
|
Japon |
-0,1 |
-0,4 |
-0,8 |
-0,7 |
-0,5 |
|
|
Zone euro |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
|
|
Allemagne |
0,3 |
0,6 |
0,4 |
0,5 |
0,8 |
|
|
France |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
|
|
Italie |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
|
|
Royaume-Uni |
0,3 |
1,1 |
1,1 |
0,6 |
0,4 |
|
Investissement privé non résidentiel (*) |
Etats-Unis |
0,8 |
2,1 |
1,0 |
-0,8 |
1,1 |
|
|
Japon |
-0,1 |
-0,6 |
-1,1 |
-1,3 |
-0,8 |
|
|
Zone euro |
-0,1 |
0 |
-0,2 |
-0,3 |
0 |
|
|
Allemagne |
-0,1 |
-0,2 |
-0,5 |
-0,7 |
-0,2 |
|
|
France |
-0,2 |
-0,1 |
-0,4 |
-0,3 |
0,2 |
|
|
Italie |
-0,5 |
-0,5 |
-0,9 |
-0,7 |
0 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,4 |
0,3 |
|
Exportations |
Etats-Unis |
0,5 |
1,2 |
0,7 |
0,6 |
1,4 |
|
|
Japon |
-0,3 |
0 |
-0,2 |
-0,2 |
0,7 |
|
|
Zone euro |
-0,6 |
-0,7 |
-1,1 |
-1,0 |
-0,3 |
|
|
Allemagne |
-0,8 |
-0,9 |
-1,4 |
-1,2 |
-0,3 |
|
|
France |
-0,6 |
-0,8 |
-1,3 |
-1,3 |
-0,7 |
|
|
Italie |
-0,6 |
-0,8 |
-1,2 |
-1,1 |
-0,3 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,9 |
-1,5 |
-1,7 |
-1,2 |
-0,1 |
|
Importations |
Etats-Unis |
-1,0 |
-1,6 |
-2,9 |
-2,4 |
-0,1 |
|
|
Japon |
-1,0 |
-1,8 |
-2,4 |
-2 |
-1,3 |
|
|
Zone euro |
0 |
0,4 |
0,1 |
0,3 |
1,0 |
|
|
Allemagne |
0,2 |
0,7 |
0,4 |
0,7 |
1,5 |
|
|
France |
-0,2 |
0 |
-0,3 |
0 |
0,7 |
|
|
Italie |
0,2 |
0,6 |
0,3 |
0,6 |
1,1 |
|
|
Royaume-Uni |
0,2 |
1,4 |
1,4 |
1,1 |
1,2 |
|
Taux de chômage (1) |
Etats-Unis |
-0,1 |
-0,3 |
0 |
0,2 |
-0,1 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0 |
|
|
Zone euro |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Allemagne |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
|
|
France |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Italie |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0 |
(1) Ecarts
en points (*) investissement total pour la zone euro
Source : COE avec le modèle multinational OEF
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Inflation (1) |
Etats-Unis |
0,7 |
0,7 |
0,1 |
-0,1 |
0 |
|
|
Japon |
0,2 |
0,5 |
0,2 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Zone euro |
-0,5 |
-0,7 |
-0,7 |
-0,8 |
-0,7 |
|
|
Allemagne |
-0,5 |
-0,7 |
-0,8 |
-0,9 |
-0,8 |
|
|
France |
-0,6 |
-0,6 |
-0,6 |
-0,6 |
-0,5 |
|
|
Italie |
-0,6 |
-0,8 |
-0,7 |
-0,7 |
-0,7 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,6 |
-0,7 |
-0,6 |
-0,9 |
-0,6 |
|
Salaires nominaux |
Etats-Unis |
0,1 |
0,9 |
1,1 |
1,1 |
1,5 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Allemagne |
-0,1 |
-0,5 |
-1,2 |
-2,0 |
-2,7 |
|
|
France |
-0,1 |
-0,5 |
-0,8 |
-1,4 |
-1,8 |
|
|
Italie |
-0,1 |
-0,5 |
-1 |
-1,6 |
-2,1 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,3 |
-0,8 |
-1,6 |
-2,5 |
-3,0 |
|
Taux de change contre $ |
Japon |
0 |
-0,7 |
-0,5 |
0,7 |
0,9 |
|
|
Zone euro |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Royaume-Uni |
11,4 |
11,7 |
10,7 |
10,0 |
9,8 |
|
Taux de change contre euro |
Japon |
-10,1 |
-10,6 |
-10,4 |
-9,3 |
-9,2 |
|
|
Royaume-Uni |
0,3 |
0,6 |
-0,3 |
-0,9 |
-1,1 |
|
Taux d'intérêt nominal à court terme (1) |
Etats-Unis |
0,1 |
0,6 |
0,8 |
0,2 |
0,1 |
|
|
Japon |
0 |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
-0,7 |
-0,2 |
-1,1 |
-1,1 |
-0,9 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,6 |
-0,9 |
-1,1 |
-1,3 |
-1,0 |
|
Taux d'intérêt nominal à long terme (1) |
Etats-Unis |
0 |
0,5 |
0,8 |
0,2 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
-0,4 |
-0,4 |
-0,1 |
-0,4 |
-0,4 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,6 |
-0,9 |
-1,1 |
-1,3 |
-1,0 |
|
Solde public (2) |
Etats-Unis |
0 |
0,1 |
0 |
-0,1 |
0,2 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
-0,1 |
-0,2 |
0 |
|
|
Zone euro |
0 |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Allemagne |
-0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,1 |
|
|
France |
-0,2 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,1 |
|
|
Italie |
0,1 |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,3 |
-0,4 |
-0,5 |
-0,7 |
-0,7 |
|
Balance courante (2) |
Etats-Unis |
0,1 |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
|
|
Japon |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
|
Zone euro |
0,1 |
0 |
0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Allemagne |
0 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,3 |
|
|
France |
0 |
0 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,3 |
|
|
Italie |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,1 |
-0,5 |
-0,6 |
-0,5 |
-0,3 |
(2) Ecarts
en points de PIB
Les taux de change sont exprimés au certain de sorte qu'un écart
variantiel positif correspond à une appréciation de la monnaie.
Source : COE avec le modèle multinational OEF
Baisse
des cotisations sociales à la charge des employeurs
(1% du PIB
ex
ante
maintenue sur 5 ans)
en France, en Allemagne et en Italie
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
PIB |
Etats-Unis |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Japon |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Zone euro |
0,2 |
0,7 |
0,9 |
1,1 |
1,2 |
|
|
Allemagne |
0,4 |
1,1 |
1,5 |
2,0 |
2,3 |
|
|
France |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
1,5 |
1,9 |
|
|
Italie |
0,4 |
0,9 |
1,1 |
1,1 |
0,9 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
0,5 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
|
Consommation |
Etats-Unis |
0 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
|
|
Japon |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Zone euro |
0,3 |
0,8 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
|
|
Allemagne |
0,5 |
1,2 |
1,4 |
1,7 |
2,0 |
|
|
France |
0,3 |
0,6 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
|
|
Italie |
0,3 |
0,9 |
1,1 |
1,4 |
1,4 |
|
|
Royaume-Uni |
0,1 |
0,8 |
1,2 |
1,1 |
0,8 |
|
Investissement privé non résidentiel (*) |
Etats-Unis |
0 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,4 |
|
|
Japon |
0 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
|
Zone euro |
0,3 |
1 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
|
|
Allemagne |
0,2 |
1,5 |
2,1 |
2,3 |
2,5 |
|
|
France |
0,7 |
1,6 |
1,8 |
1,7 |
2,1 |
|
|
Italie |
0,9 |
2,1 |
2,2 |
1,8 |
0,9 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
0,8 |
1,7 |
1,2 |
0,4 |
|
Exportations |
Etats-Unis |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0 |
|
|
Japon |
0,1 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
|
|
Zone euro |
0,4 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
|
|
Allemagne |
0,6 |
1,6 |
2,1 |
2,5 |
2,6 |
|
|
France |
0,7 |
1,8 |
2,7 |
3,8 |
5,1 |
|
|
Italie |
0,5 |
1,4 |
1,3 |
1,0 |
0,6 |
|
|
Royaume-Uni |
0,1 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
Importations |
Etats-Unis |
0,1 |
0,6 |
0,6 |
0,8 |
0,6 |
|
|
Japon |
0,1 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
|
|
Zone euro |
0,5 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
|
Allemagne |
0,6 |
1,5 |
1,2 |
1,1 |
1,0 |
|
|
France |
0,8 |
1,9 |
2,3 |
2,5 |
2,9 |
|
|
Italie |
0,4 |
1,1 |
1,0 |
1,3 |
1,3 |
|
|
Royaume-Uni |
0,2 |
1,1 |
1,6 |
1,5 |
1,1 |
|
Taux de chômage (1) |
Etats-Unis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
-0,3 |
-0,7 |
-0,9 |
-1,0 |
-1,1 |
|
|
Allemagne |
-0,4 |
-1,0 |
-1,4 |
-1,8 |
-2,1 |
|
|
France |
-0,4 |
-0,9 |
-1,1 |
-1,2 |
-1,4 |
|
|
Italie |
-0,4 |
-0,9 |
-1,2 |
-1,3 |
-1,3 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
0 |
(1) Ecarts
en points (*) investissement total pour la zone euro
Source : COE avec le modèle multinational OEF
Ecarts variantiels en % sauf (1) et (2)
|
Années |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Inflation (1) |
Etats-Unis |
0 |
-0,2 |
-0,1 |
-0,1 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
-0,5 |
-1,2 |
-1,2 |
-1,3 |
-1,4 |
|
|
Allemagne |
-0,6 |
-1,6 |
-1,8 |
-1,6 |
-1,3 |
|
|
France |
-0,8 |
-1,7 |
-2,3 |
-2,9 |
-3,4 |
|
|
Italie |
-0,6 |
-1,4 |
-0,7 |
-0,5 |
-0,6 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,1 |
0,1 |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
|
Salaires nominaux |
Etats-Unis |
0 |
0 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,2 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Allemagne |
-0,1 |
-1,3 |
-3,1 |
-4,7 |
-6 |
|
|
France |
-0,3 |
-1,7 |
-4,1 |
-7,1 |
-10,5 |
|
|
Italie |
-0,1 |
-0,8 |
-1,5 |
-2,0 |
-2,6 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
0,4 |
1,2 |
1,9 |
2,3 |
|
Taux de change contre $ |
Japon |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0 |
|
|
Zone euro |
-0,4 |
-1,0 |
0 |
0,8 |
2,0 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,5 |
-1,0 |
-1,4 |
-2,5 |
-3,2 |
|
Taux de change contre euro |
Japon |
0,5 |
1,1 |
0,1 |
-0,8 |
-2,0 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,1 |
-0,1 |
-1,5 |
-3,3 |
-5,1 |
|
Taux d'intérêt nominal à court terme (1) |
Etats-Unis |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Zone euro |
-0,5 |
-1,5 |
-1,7 |
-1,9 |
-2,0 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,2 |
-0,1 |
0,3 |
0,4 |
-0,4 |
|
Taux d'intérêt nominal à long terme (1) |
Etats-Unis |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
-0,1 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
-0,3 |
-0,8 |
-0,9 |
-1,0 |
-1,1 |
|
|
Royaume-Uni |
-0,2 |
-0,7 |
-0,7 |
-0,8 |
-0,9 |
|
Solde public (2) |
Etats-Unis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Zone euro |
-0,4 |
-0,1 |
-0,1 |
0,1 |
0,2 |
|
|
Allemagne |
-0,6 |
-0,1 |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
|
|
France |
-0,6 |
-0,4 |
-0,3 |
-0,2 |
-0,2 |
|
|
Italie |
-0,5 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
0,1 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
Balance courante (2) |
Etats-Unis |
0 |
0 |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Japon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Zone euro |
0 |
-0,1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Allemagne |
0 |
-0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
|
|
France |
-0,1 |
-0,1 |
0 |
0,1 |
0,3 |
|
|
Italie |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|
|
Royaume-Uni |
0 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,4 |
-0,3 |
(2) Ecarts
en points de PIB
Les taux de change sont exprimés au certain de sorte qu'un écart
variantiel positif correspond à une appréciation de la monnaie.
Source : COE avec le modèle multinational OEF
Le
Sénat sur internet : http://www.senat.fr
minitel : 36-15 - code SENATEL
L'Espace Librairie du Sénat : tél. 01-42-34-21-21
*
Professeur à l'Université de Paris I
(Panthéon-Sorbonne), directeur scientifique du Centre d'Observation
Economique (COE), Chambre de Commerce et Industrie de Paris (CCIP)
**
Responsable de la modélisation au COE, CCIP
1
Ce qui signifie que chaque point d'inflation en moins a
coûté 0,6 % PIB, en France.
2
cf. les travaux de P. Sevestre et alii cités ci-dessus.
3
Ainsi, si l'on s'intéresse à
l'évolution de l'économie américaine de 1994 à
1998, il est logique que les salaires connaissent une
accélération compte tenu du bas niveau du taux de chômage
mais il est étonnant que cette accélération ne se
répercute pas dans les prix. De même, il est logique que le taux
d'inflation soit bas car le taux d'utilisation des capacités l'est
aussi. Mais il est surprenant, en revanche, d'avoir simultanément un
taux d'utilisation des capacités et un taux de chômage à
bas niveau.
4
Blanchard O., Fitoussi J.P. (1998) considèrent que la marge
de baisse du taux de chômage avant que la croissance ne se heurte
vraiment à l'inflation est importante. Par ailleurs, les auteurs
estiment que, pour atteindre un taux de chômage de 7,5 % en 5 ans en
France, la croissance annuelle effective doit s'élever à
3,6 % - 3,8 % (soit 1,5 point au-dessus de la croissance potentielle
estimée à 2,1 % - 2,3 %).







