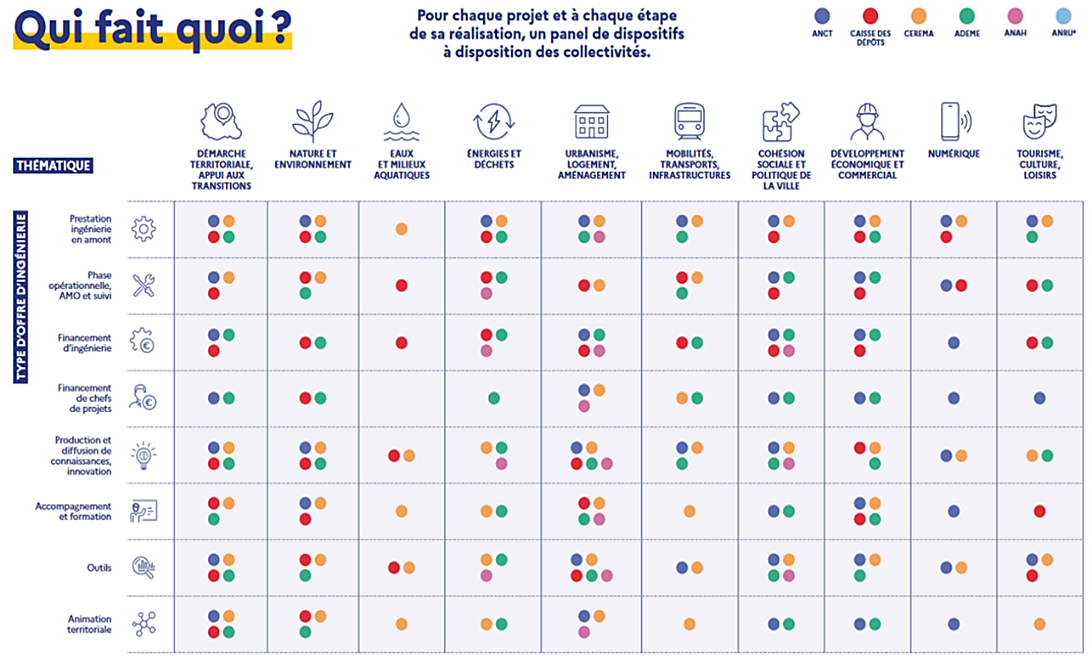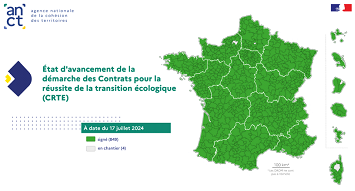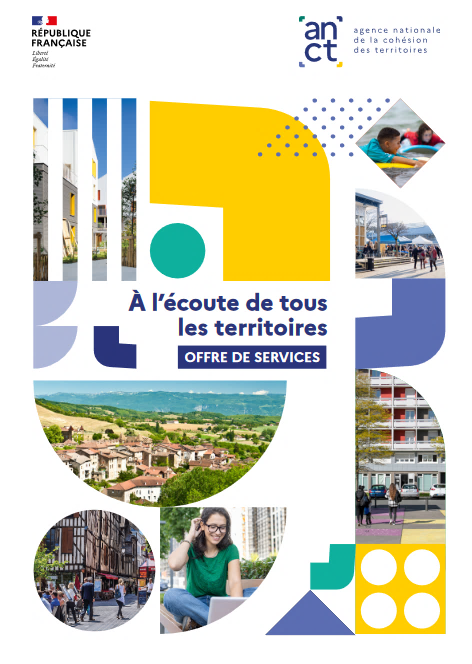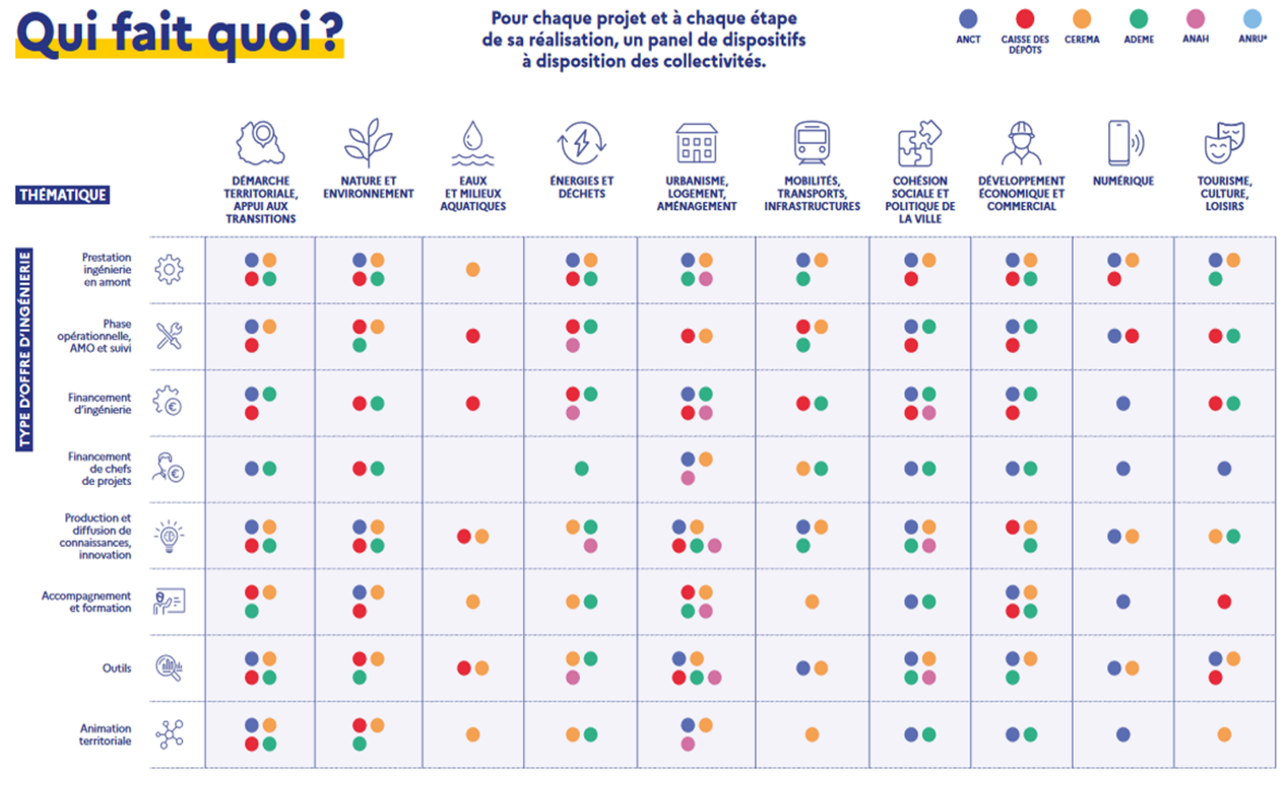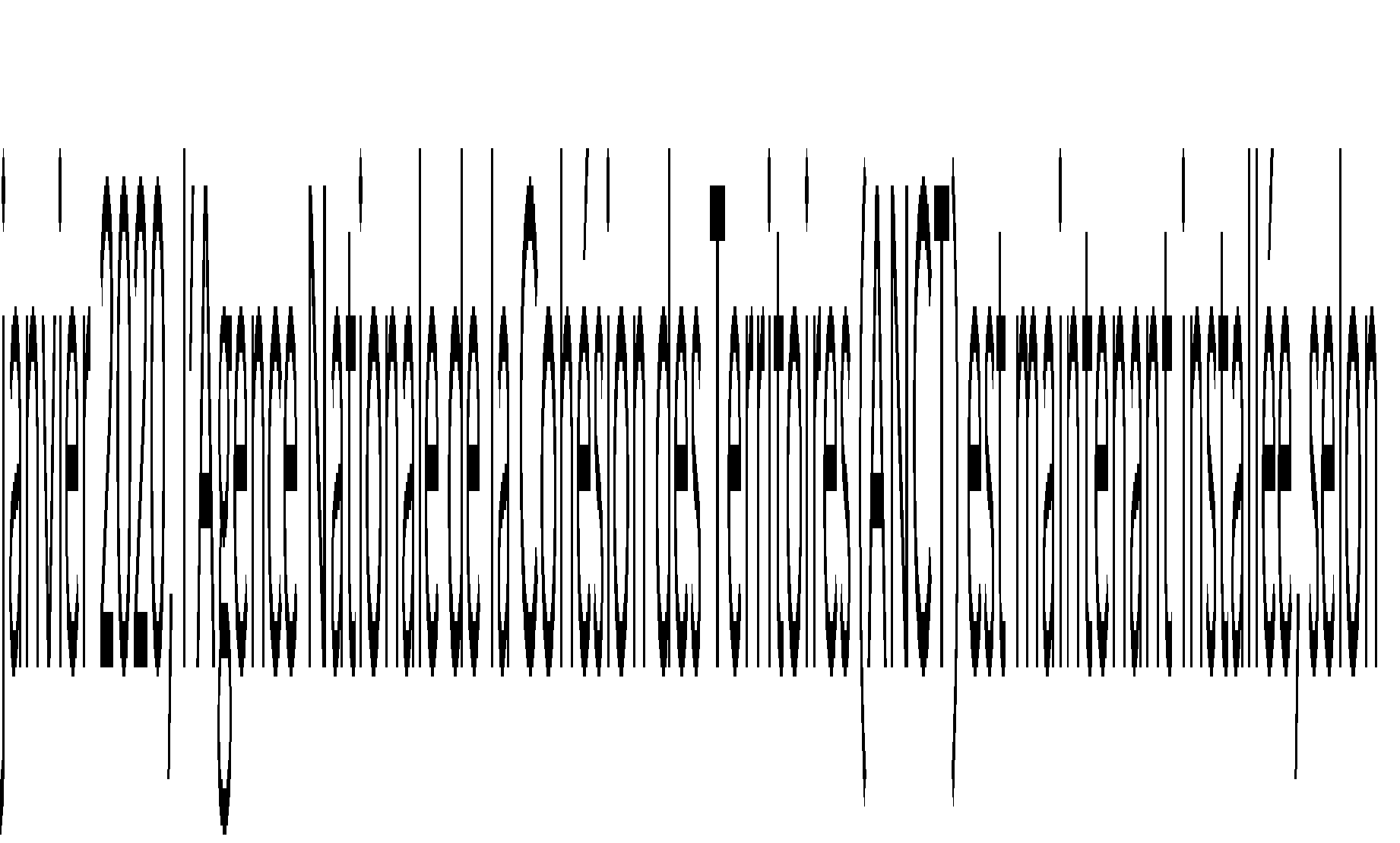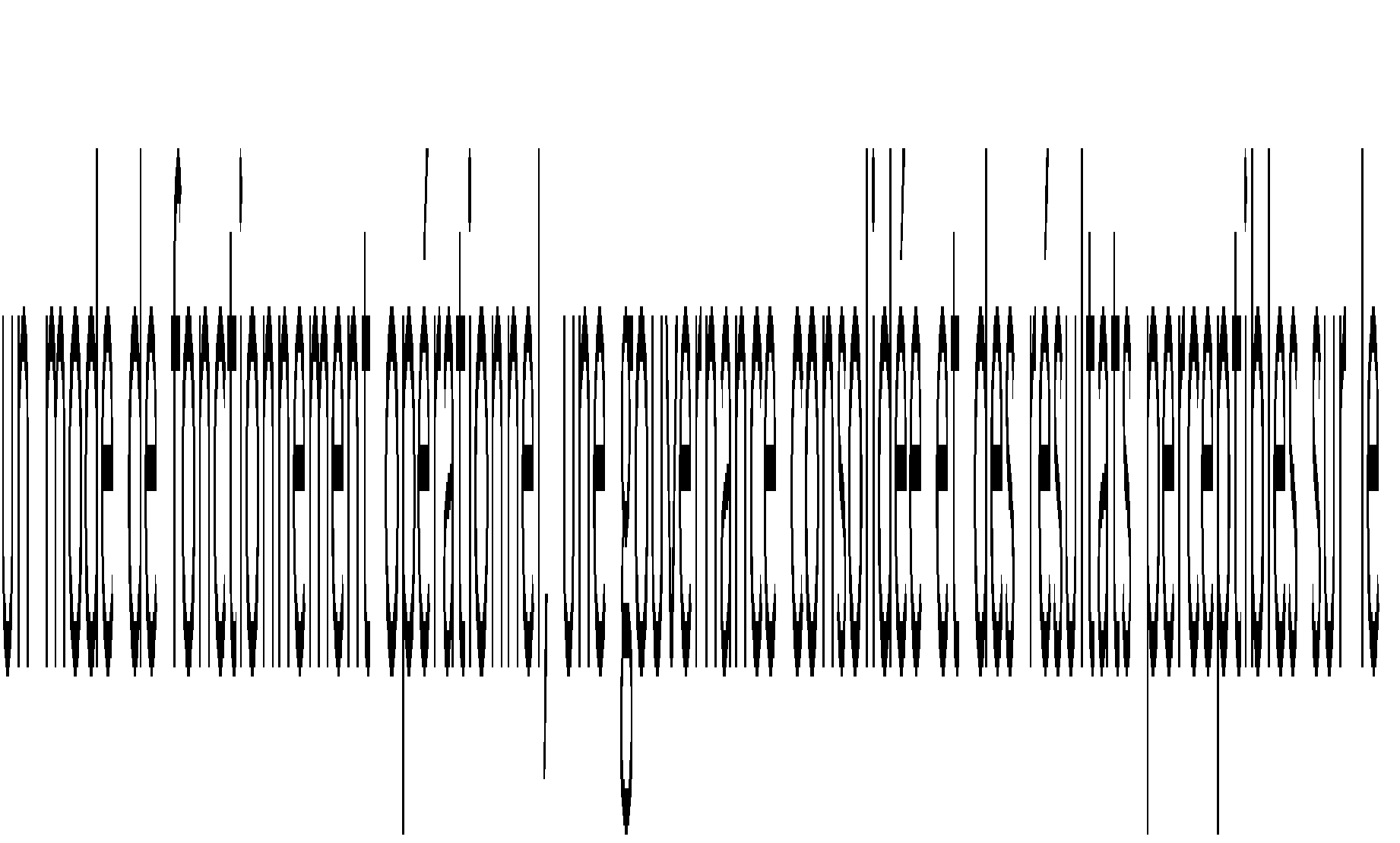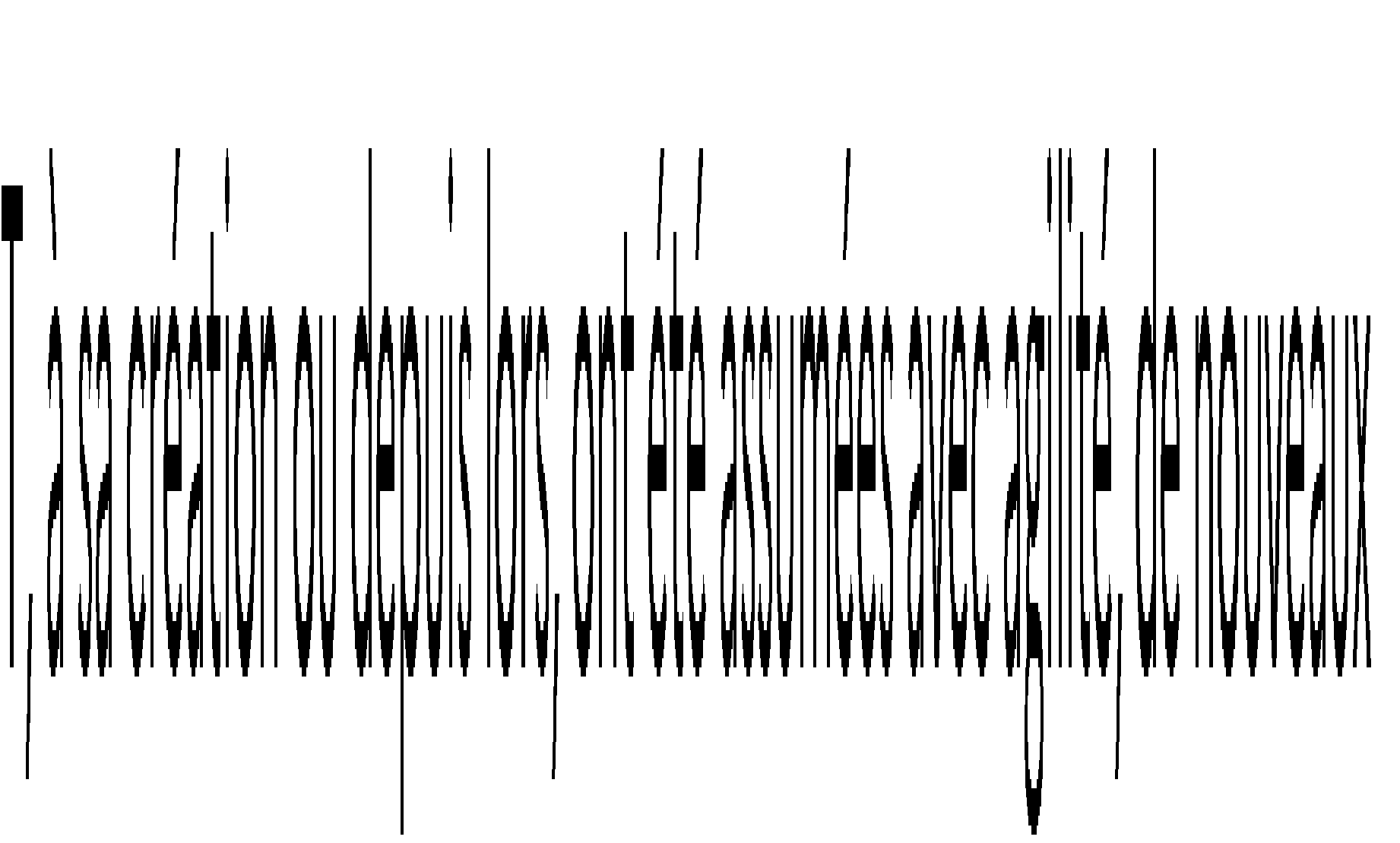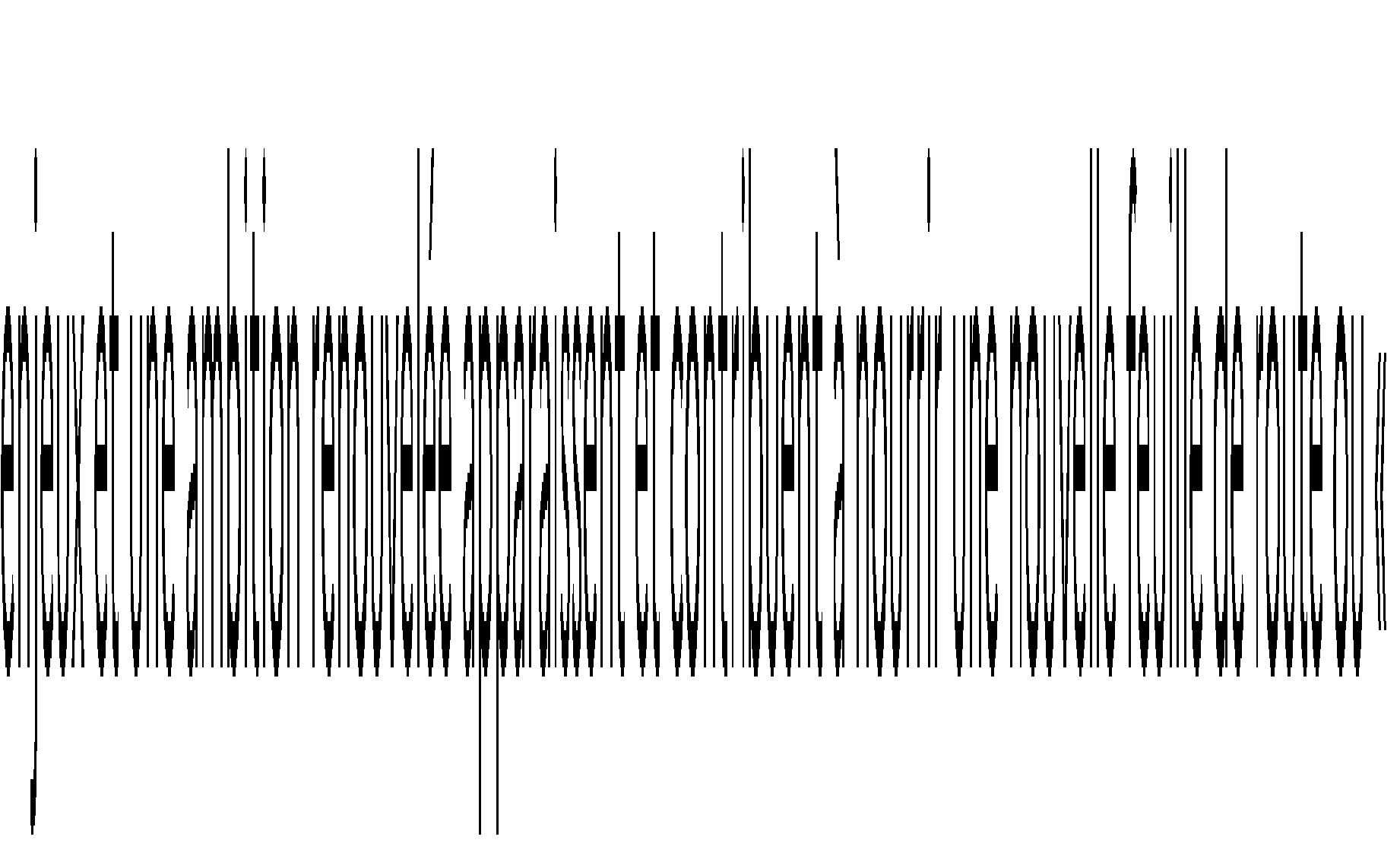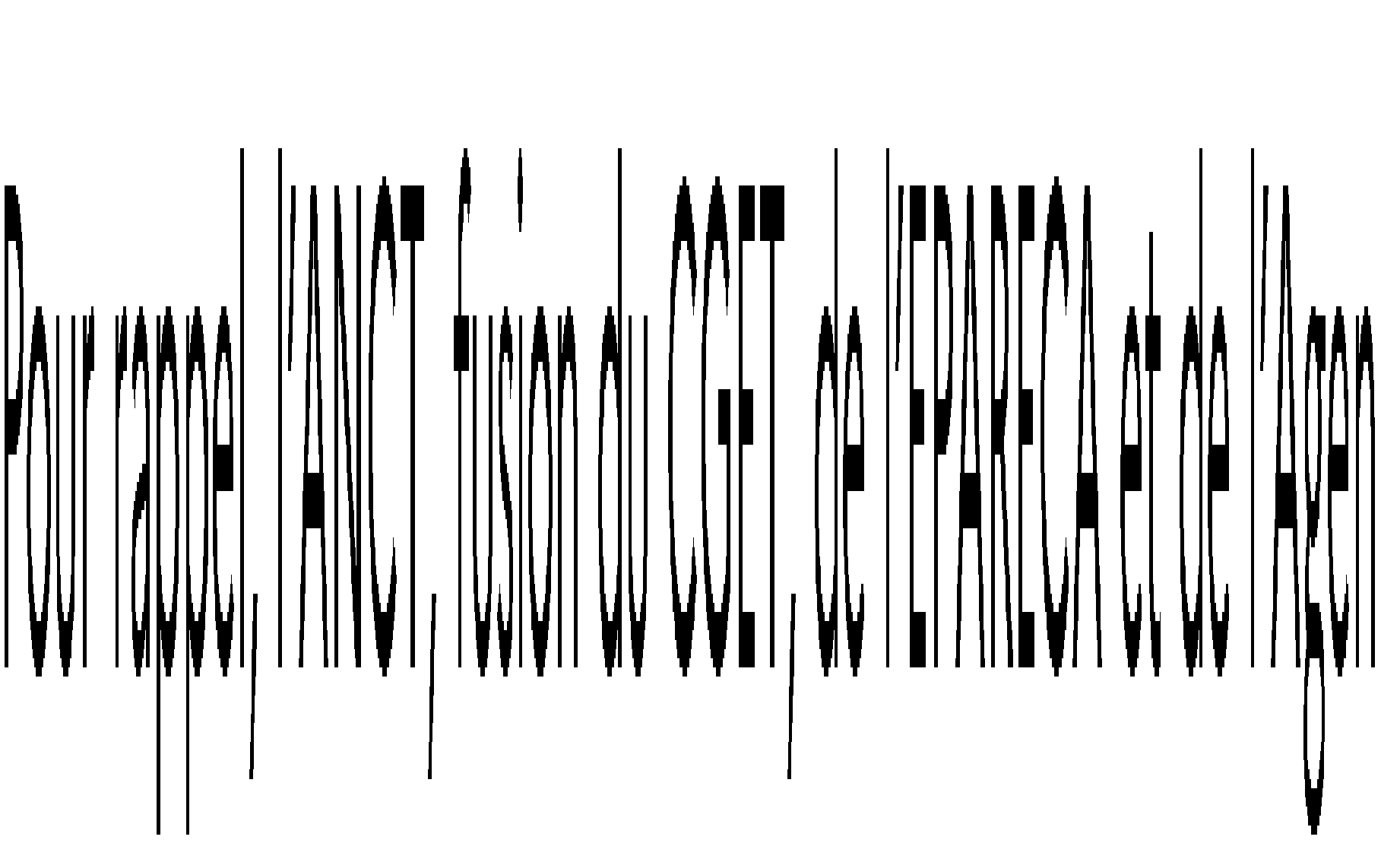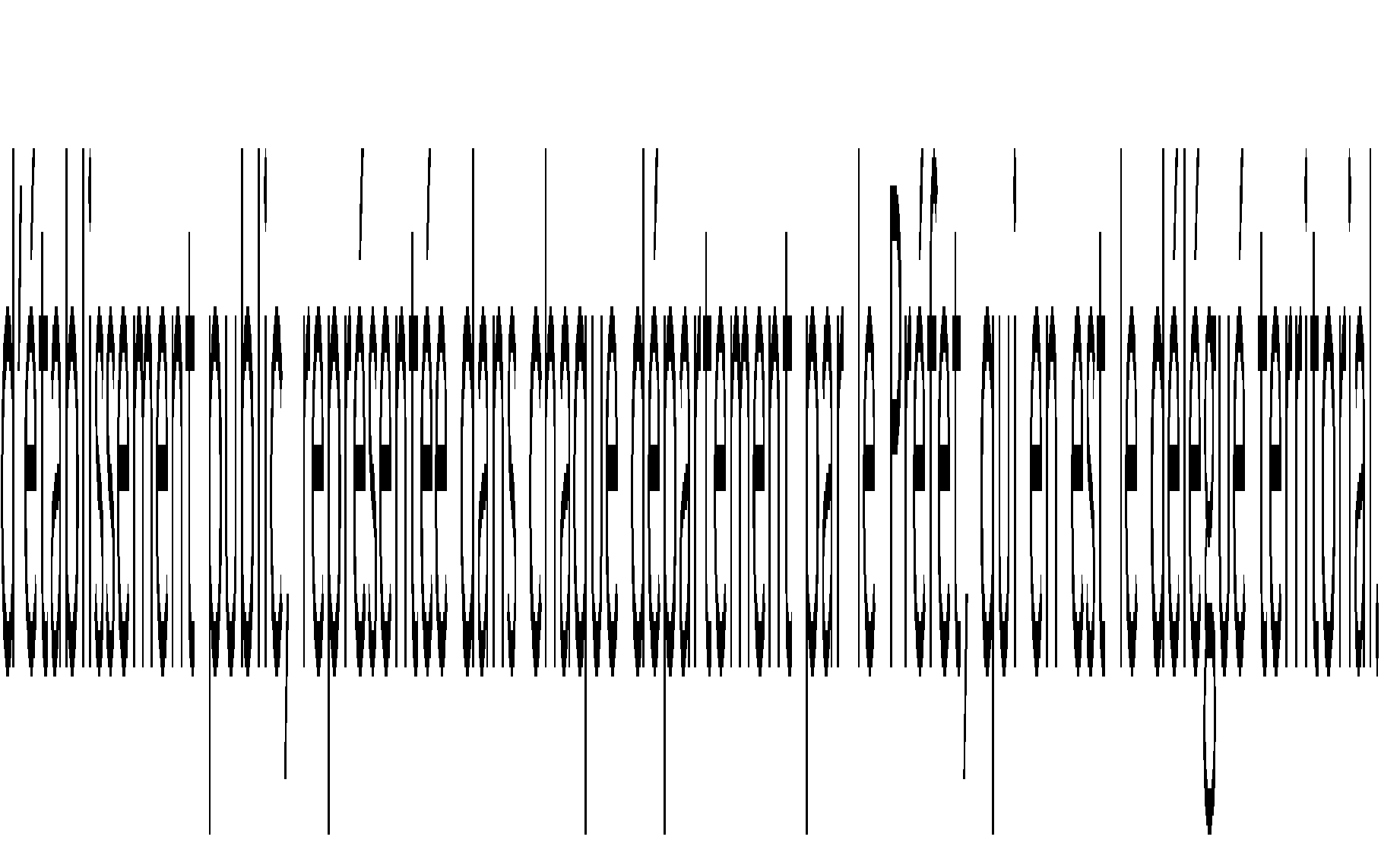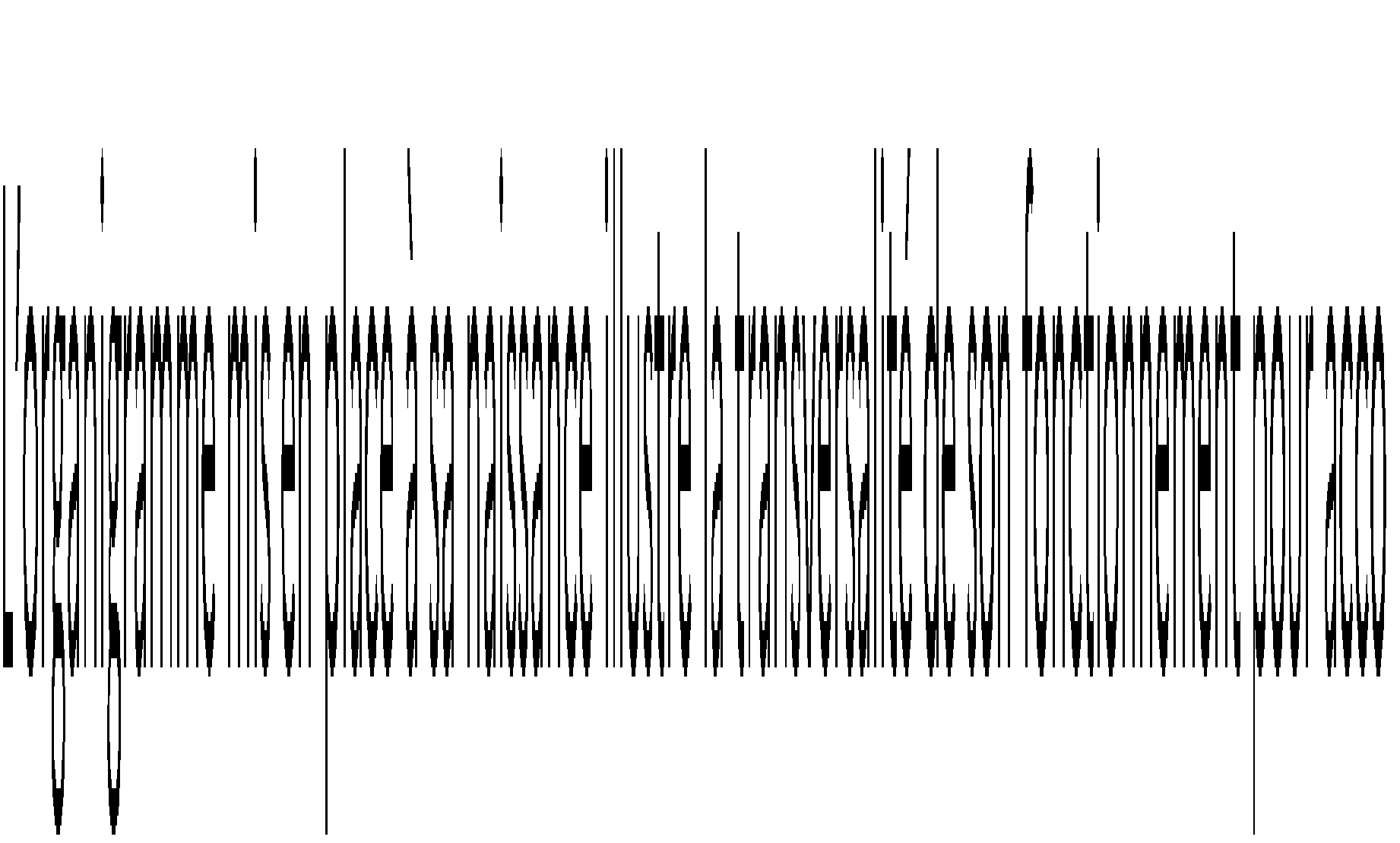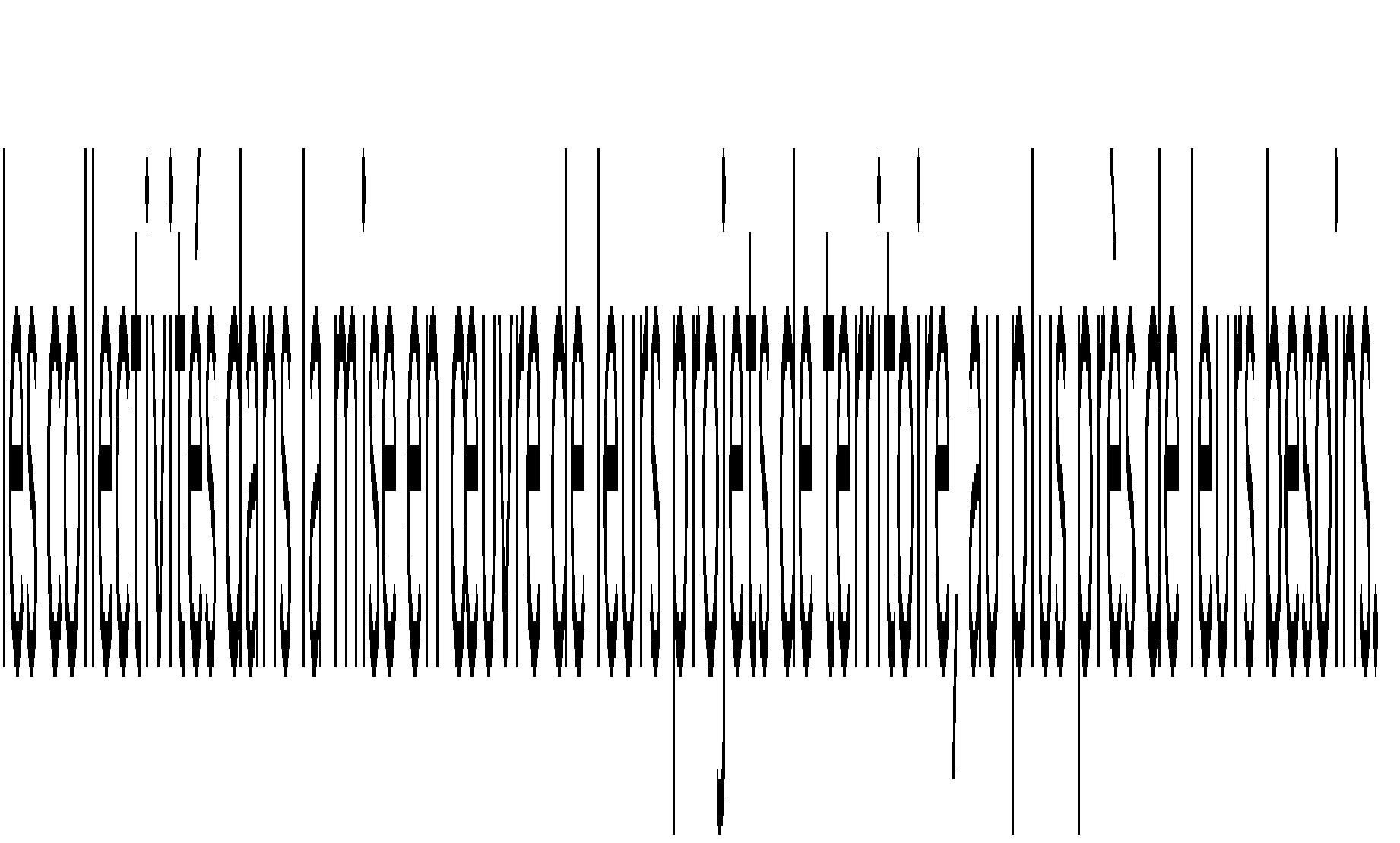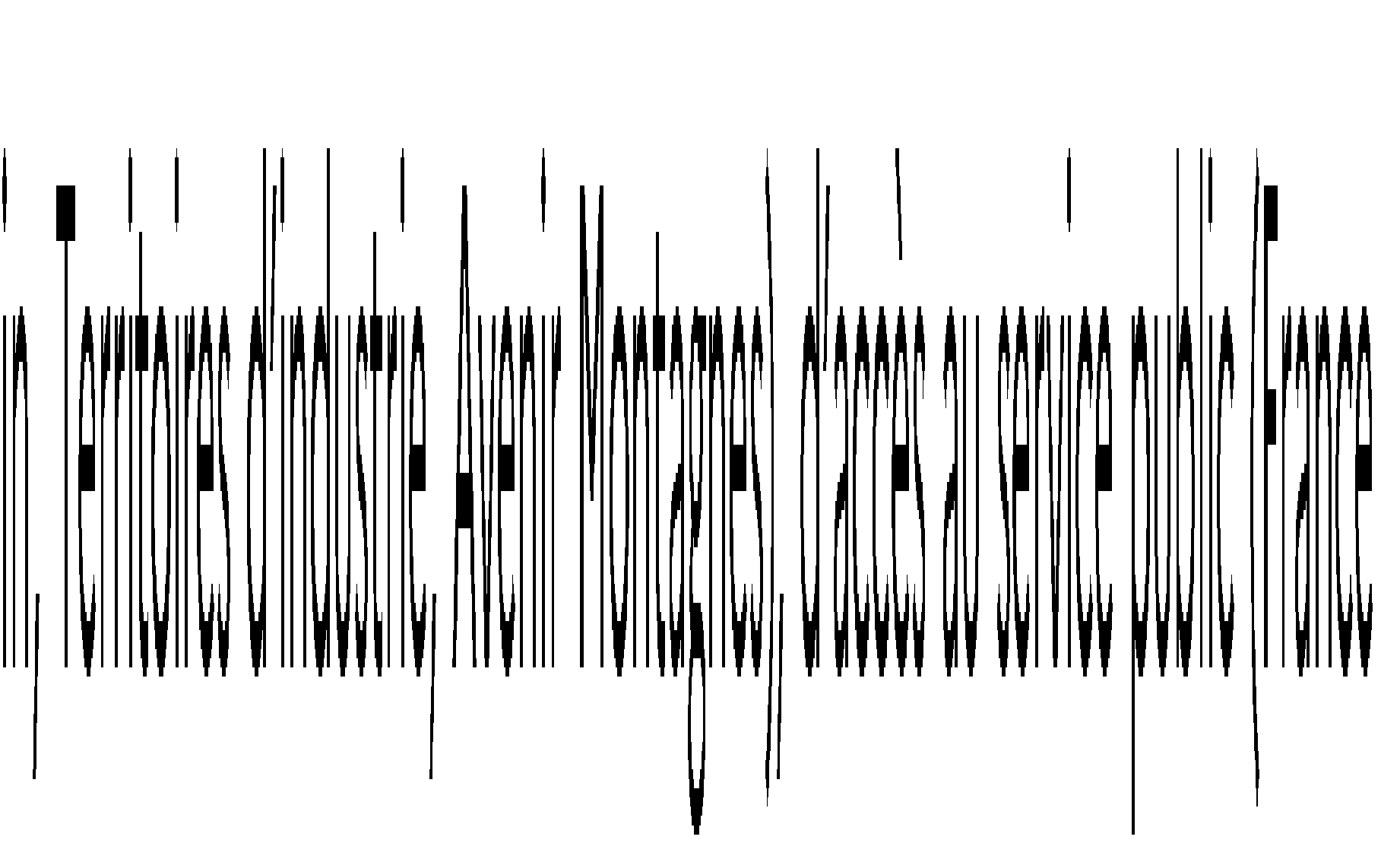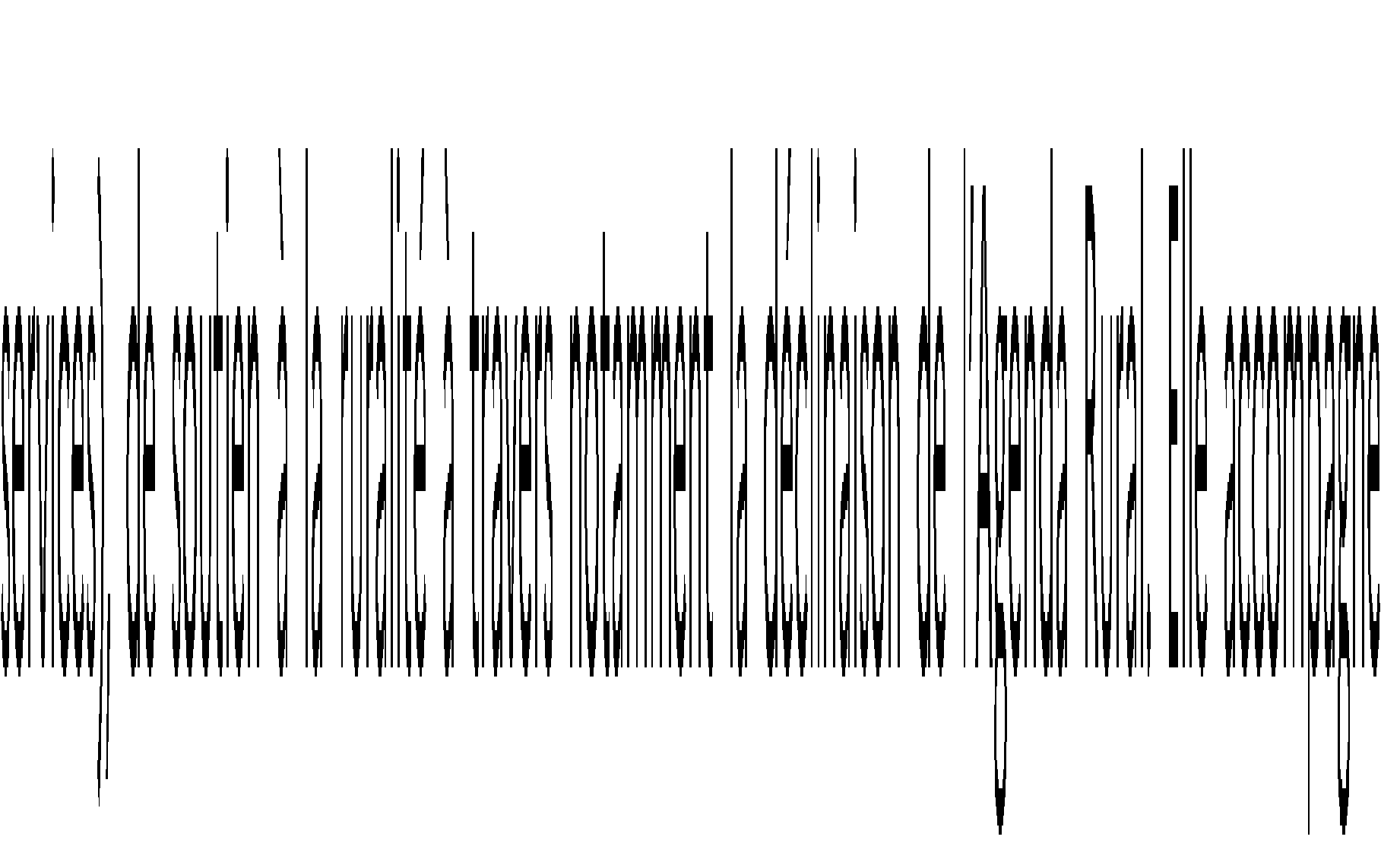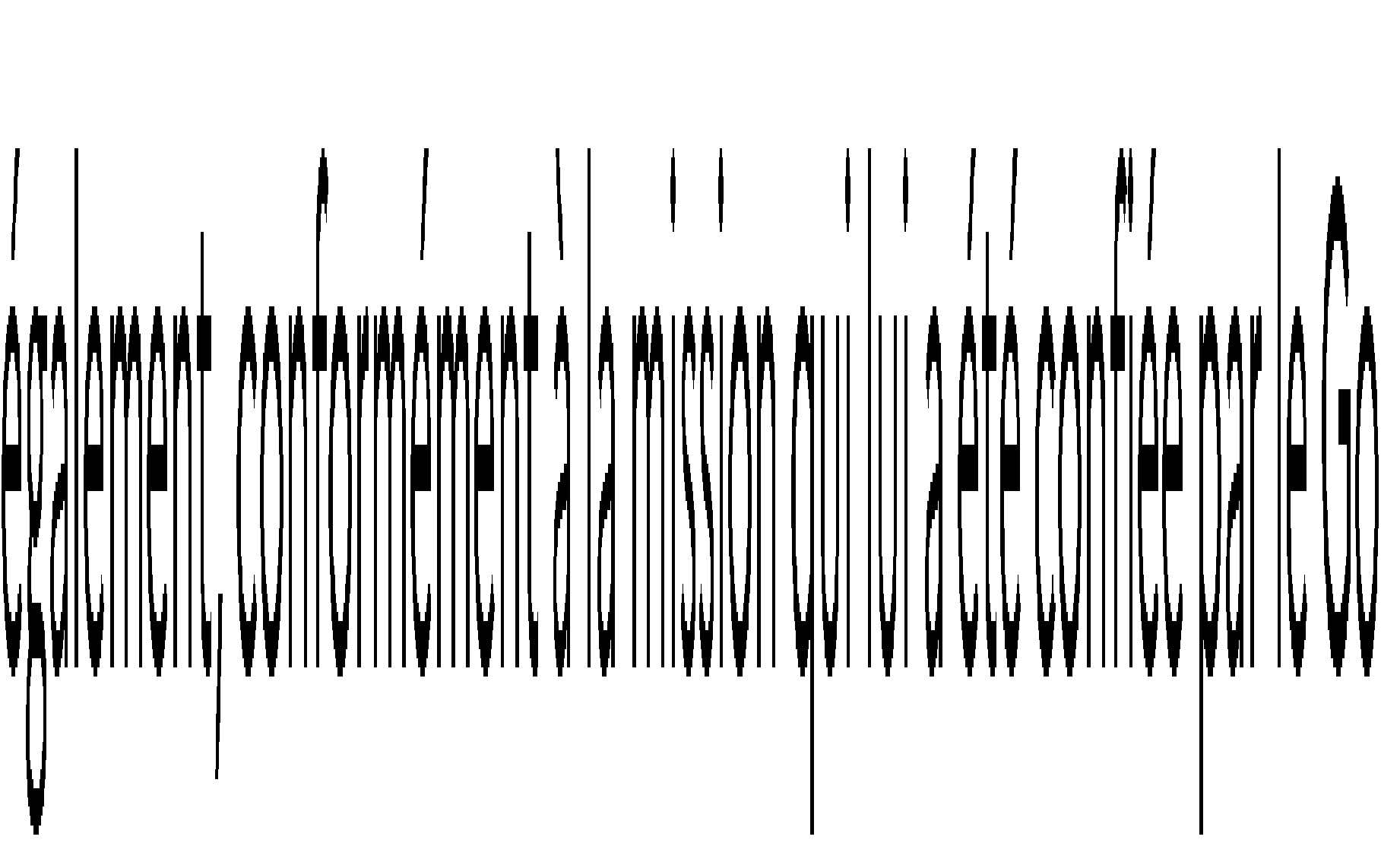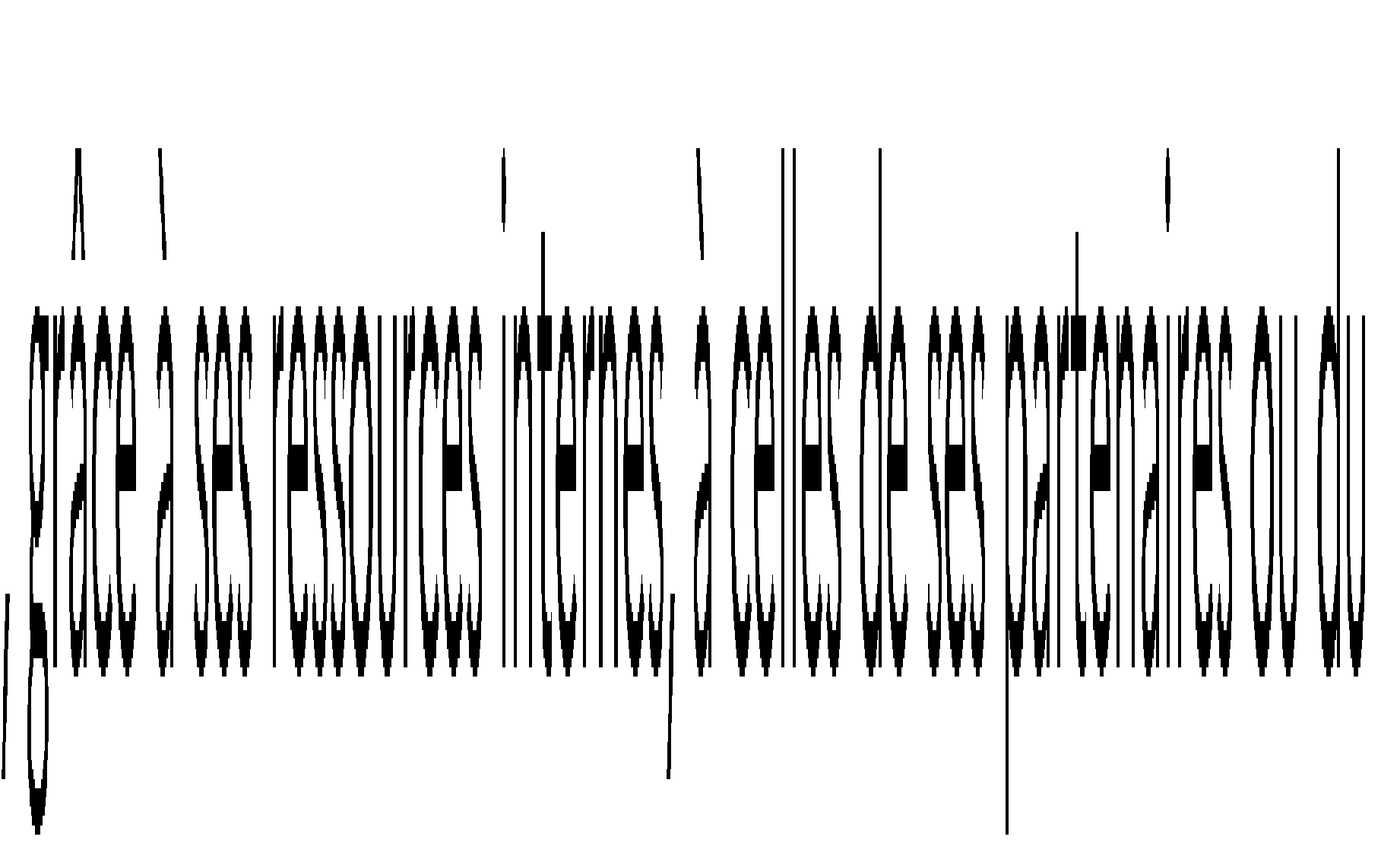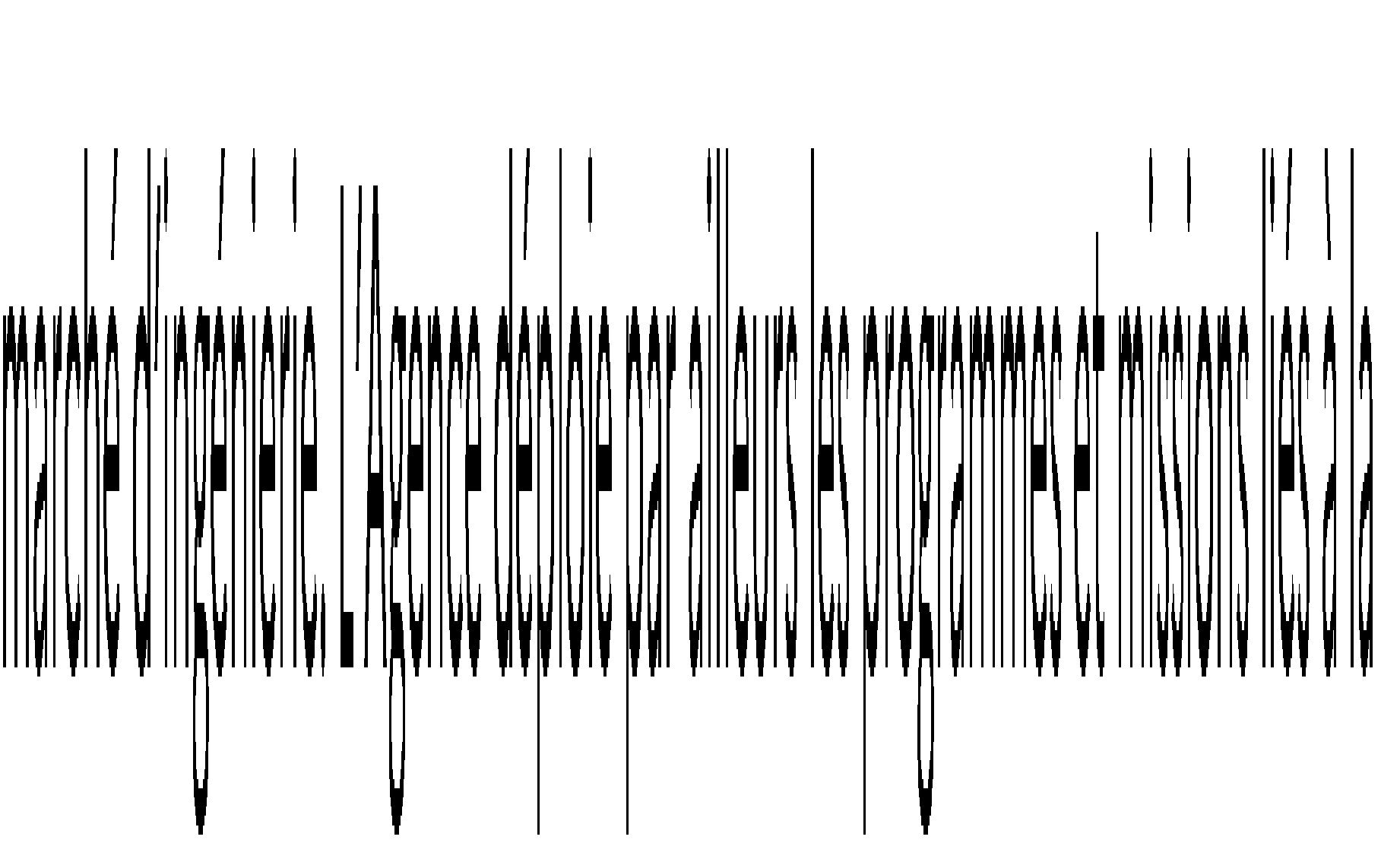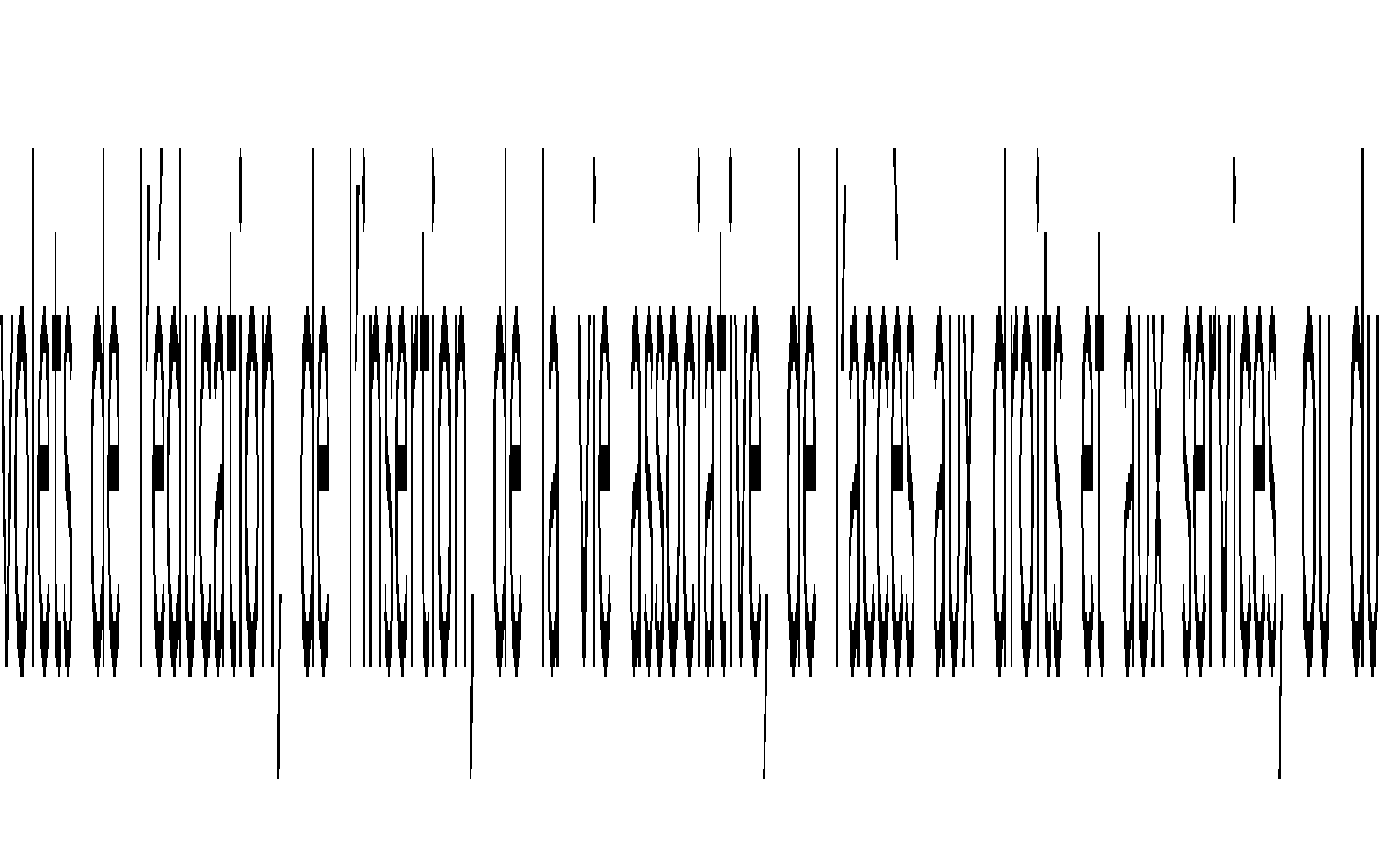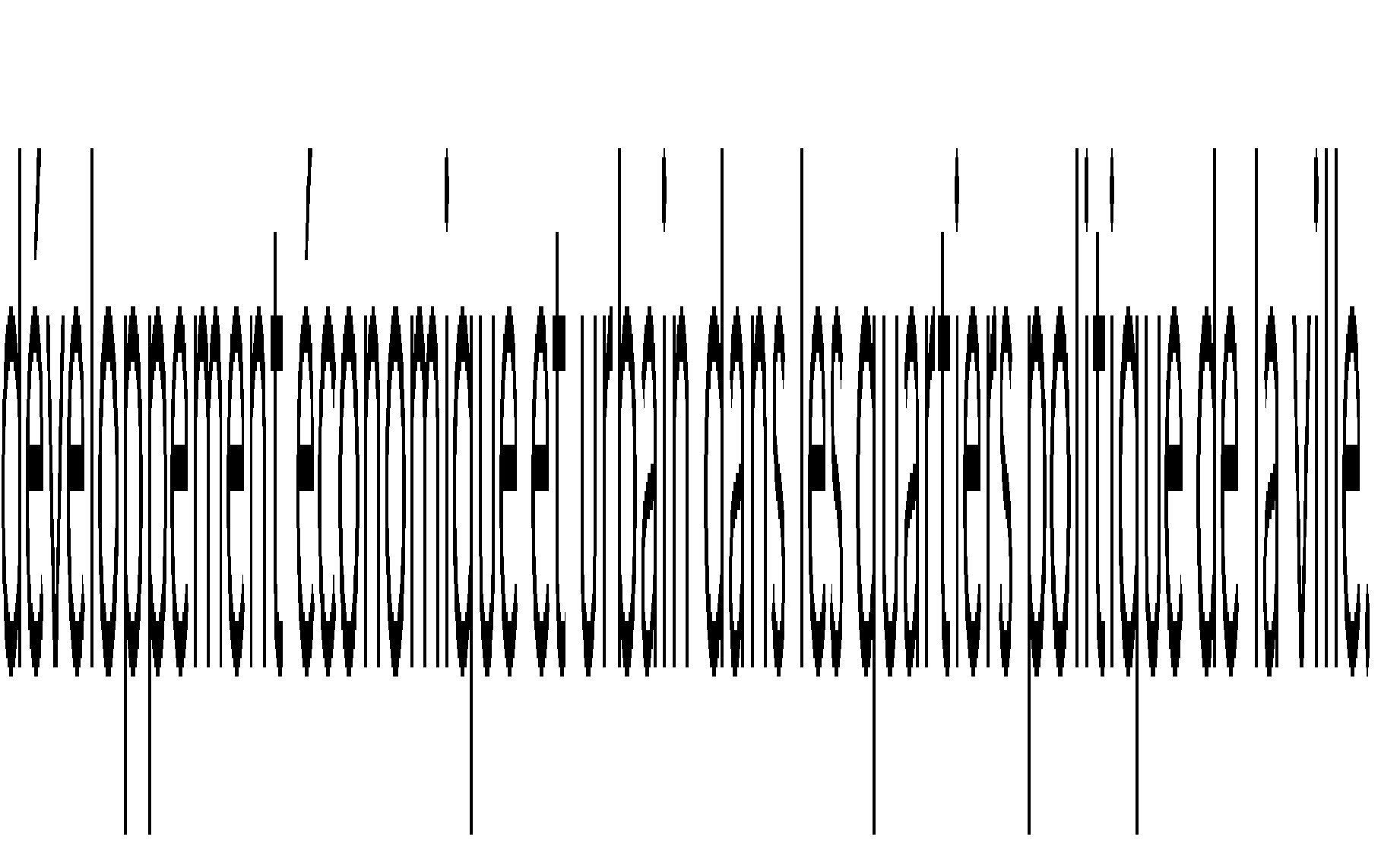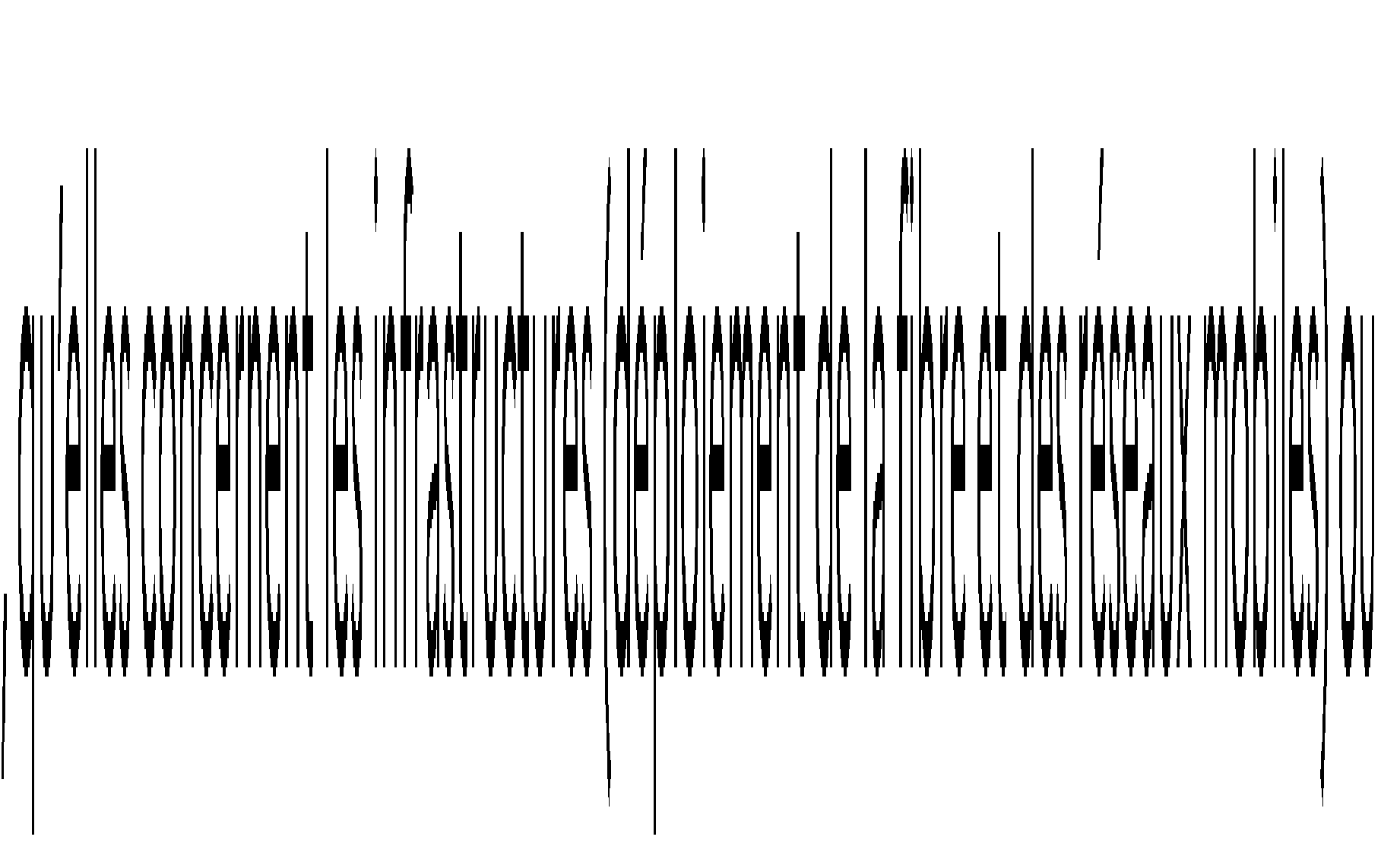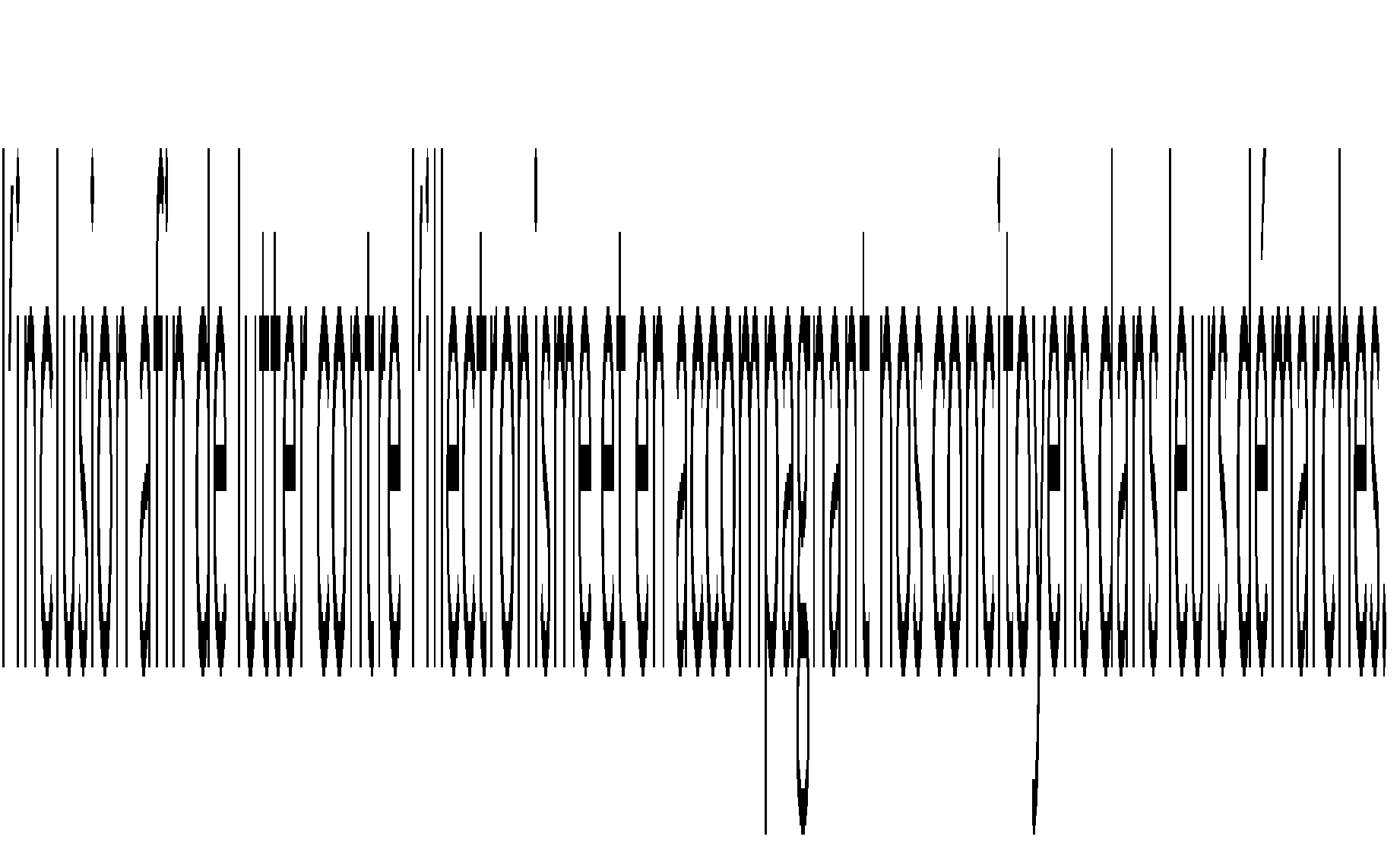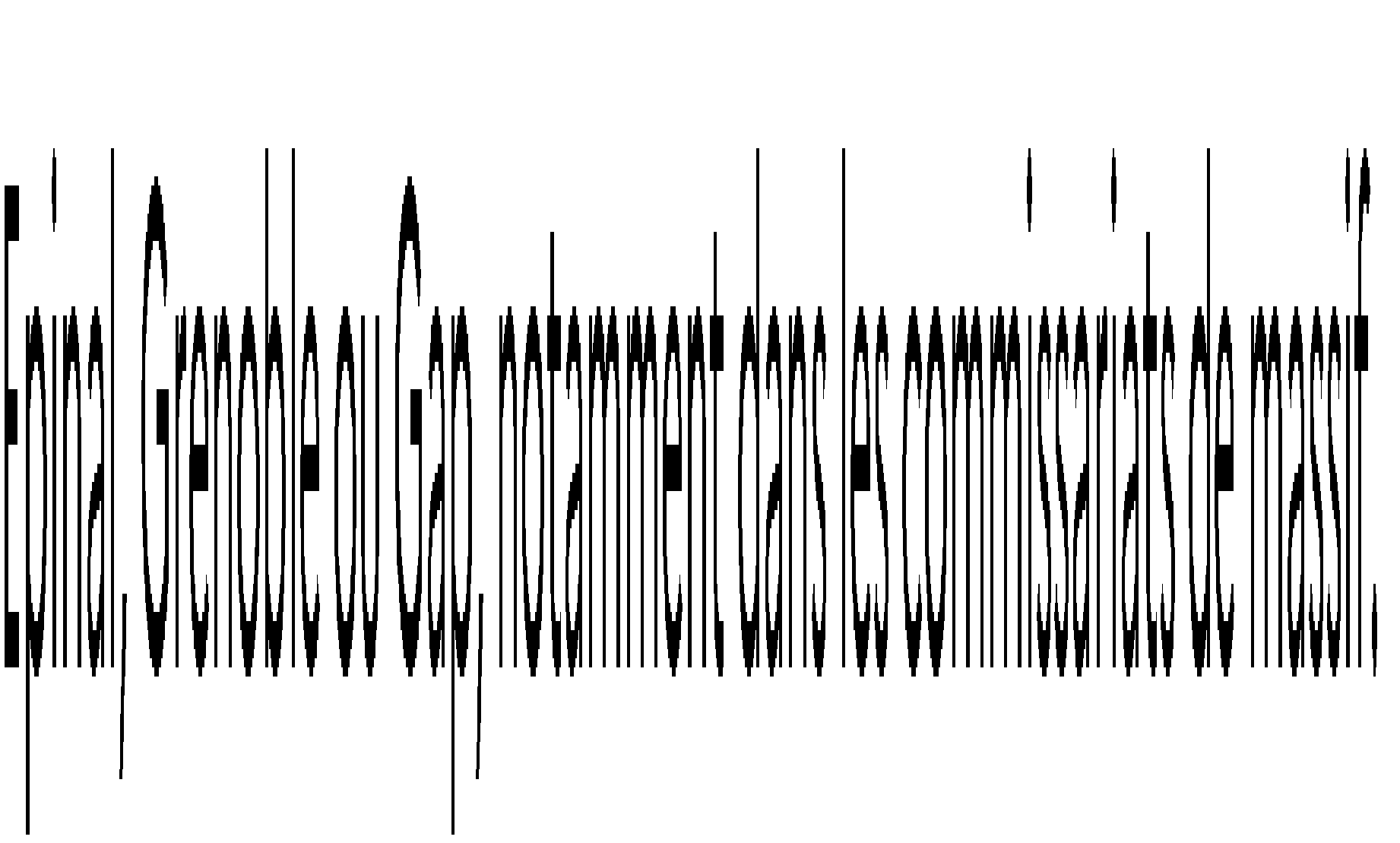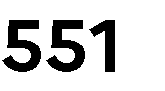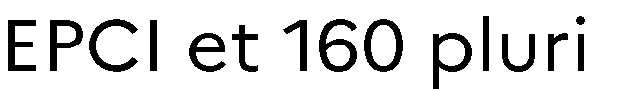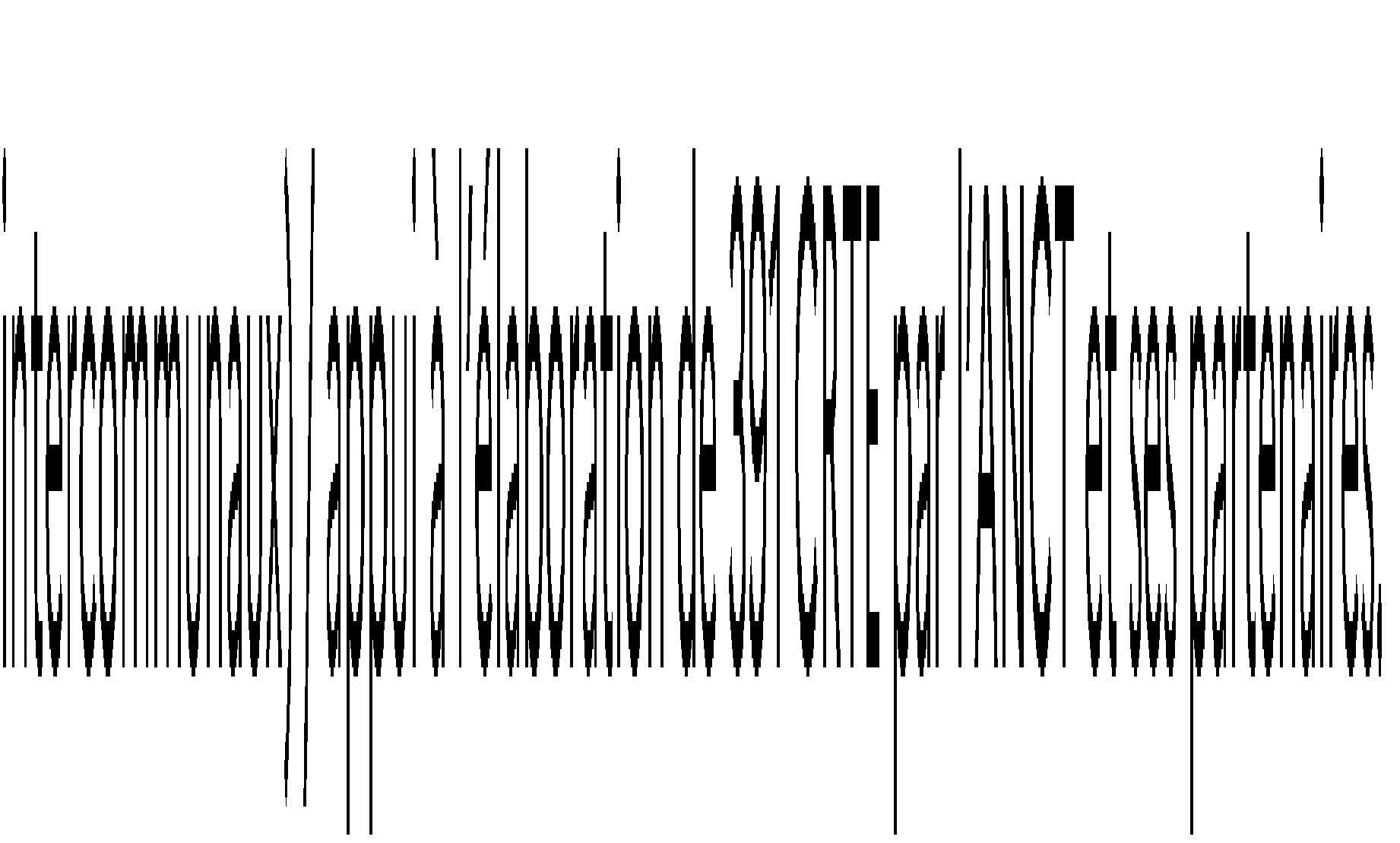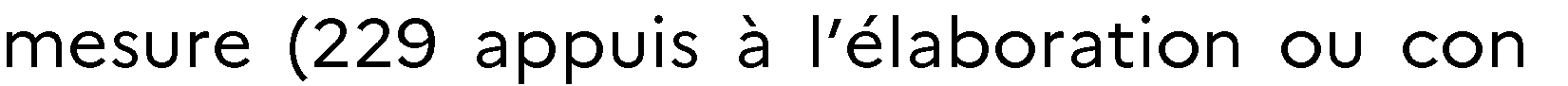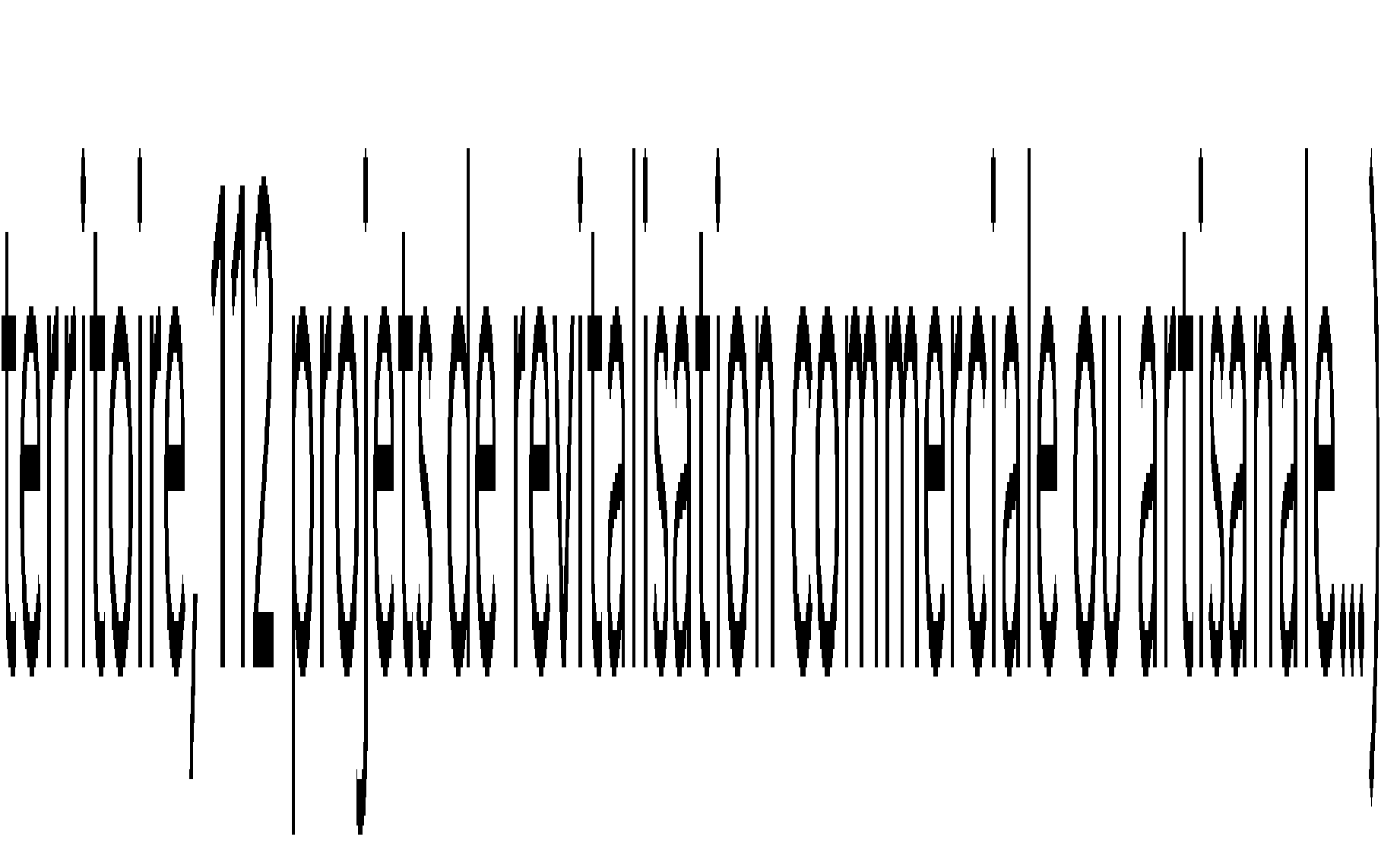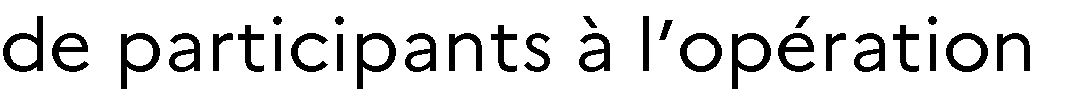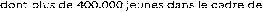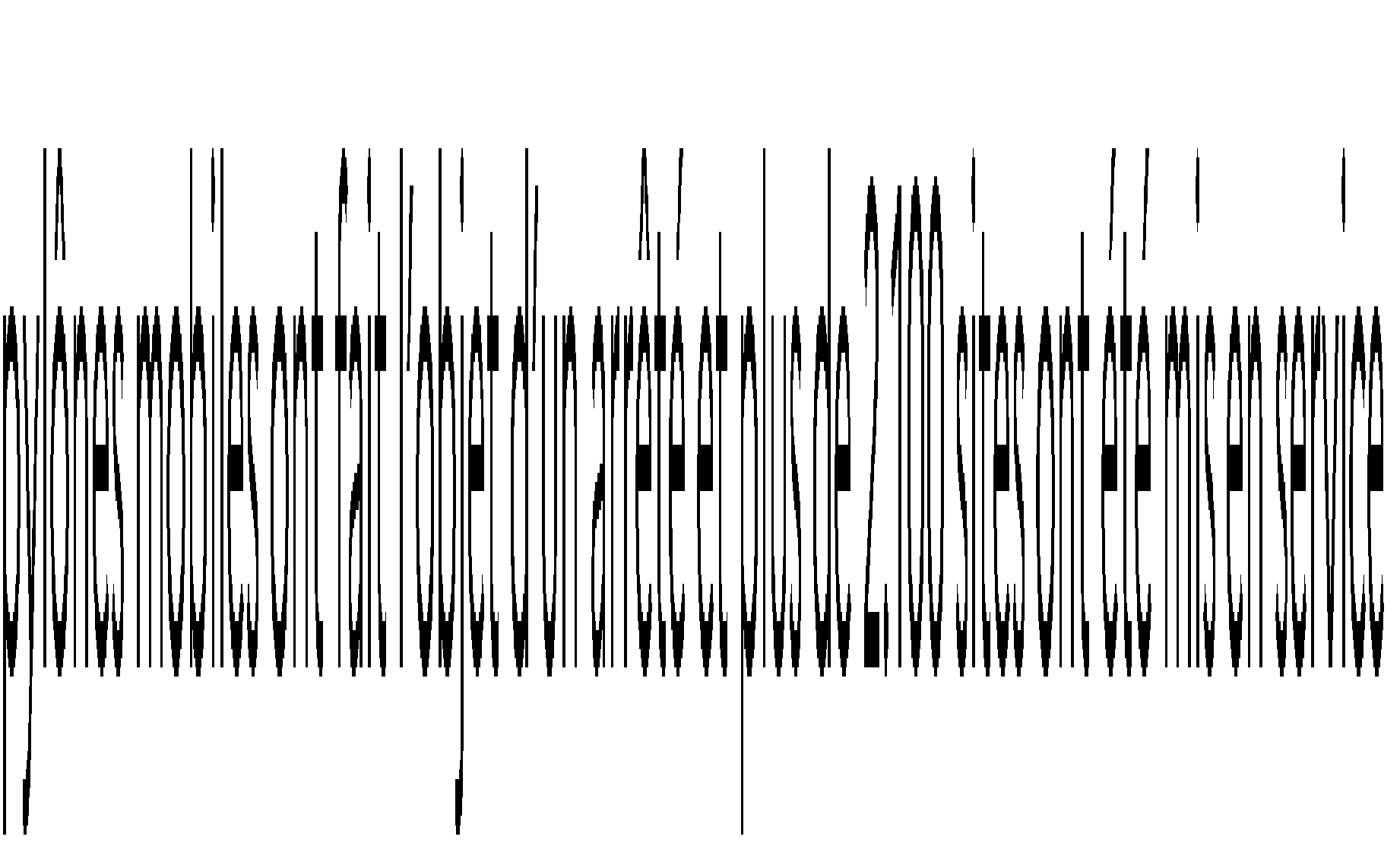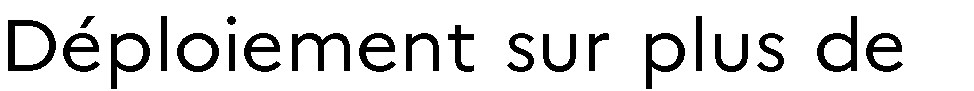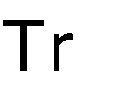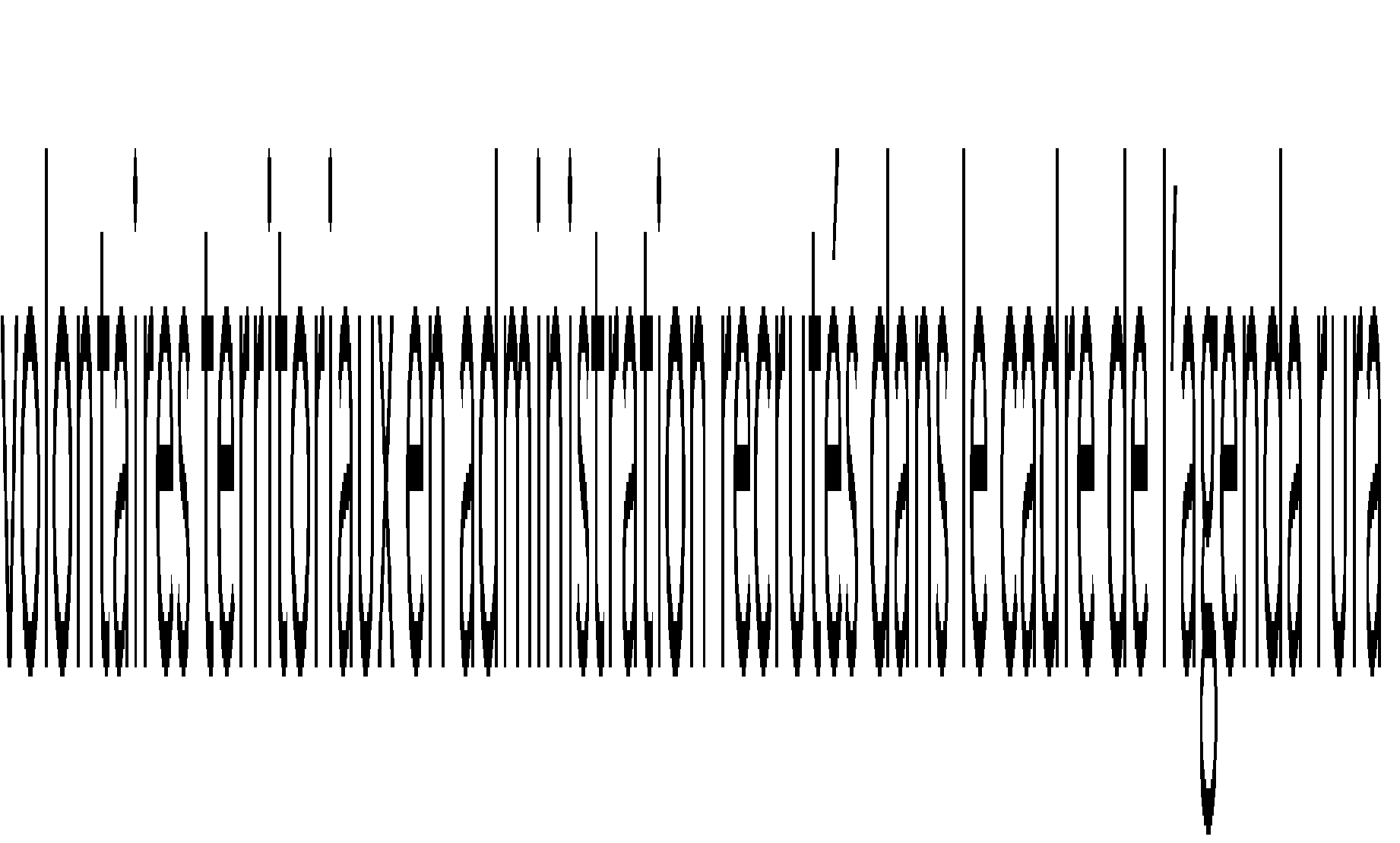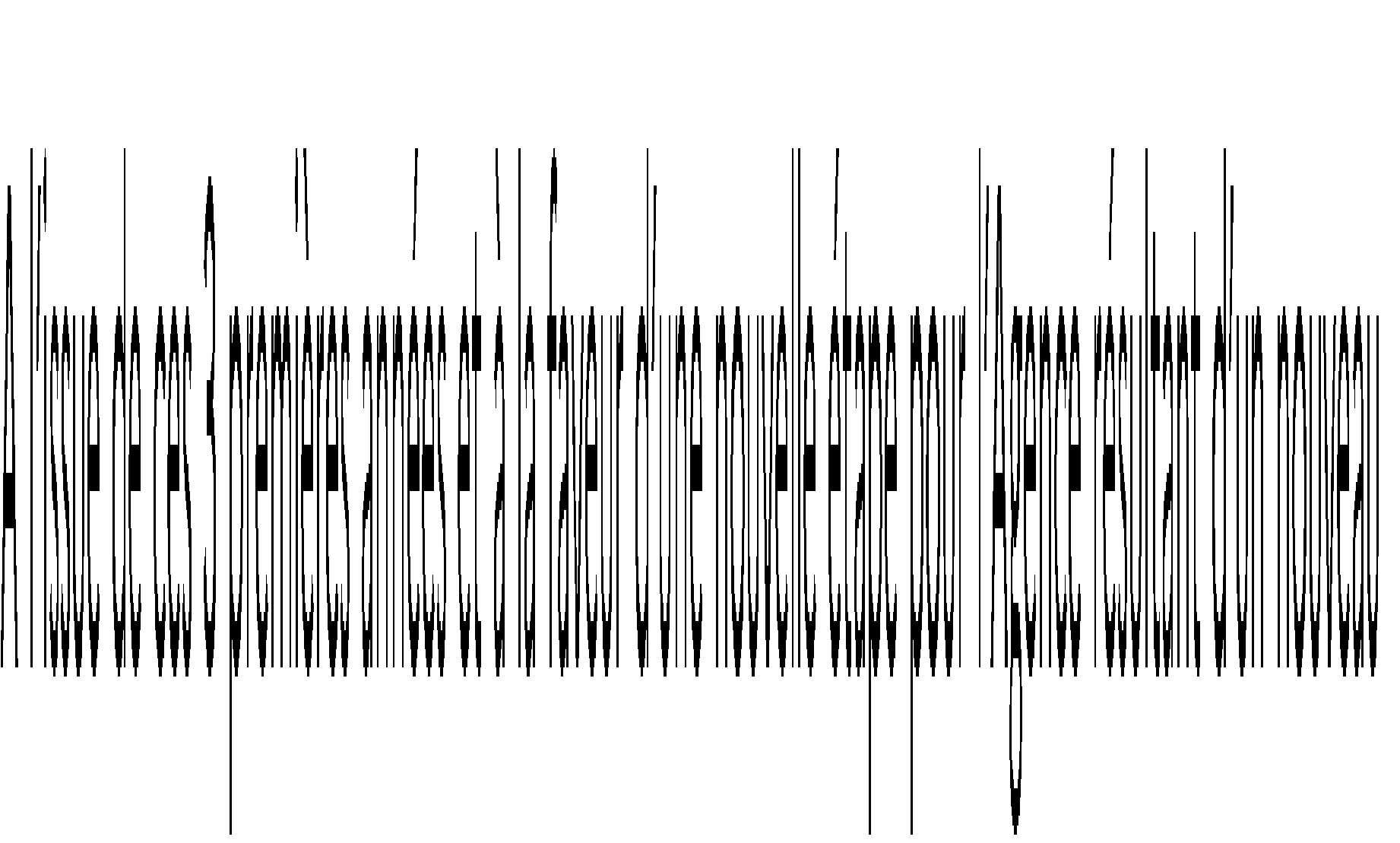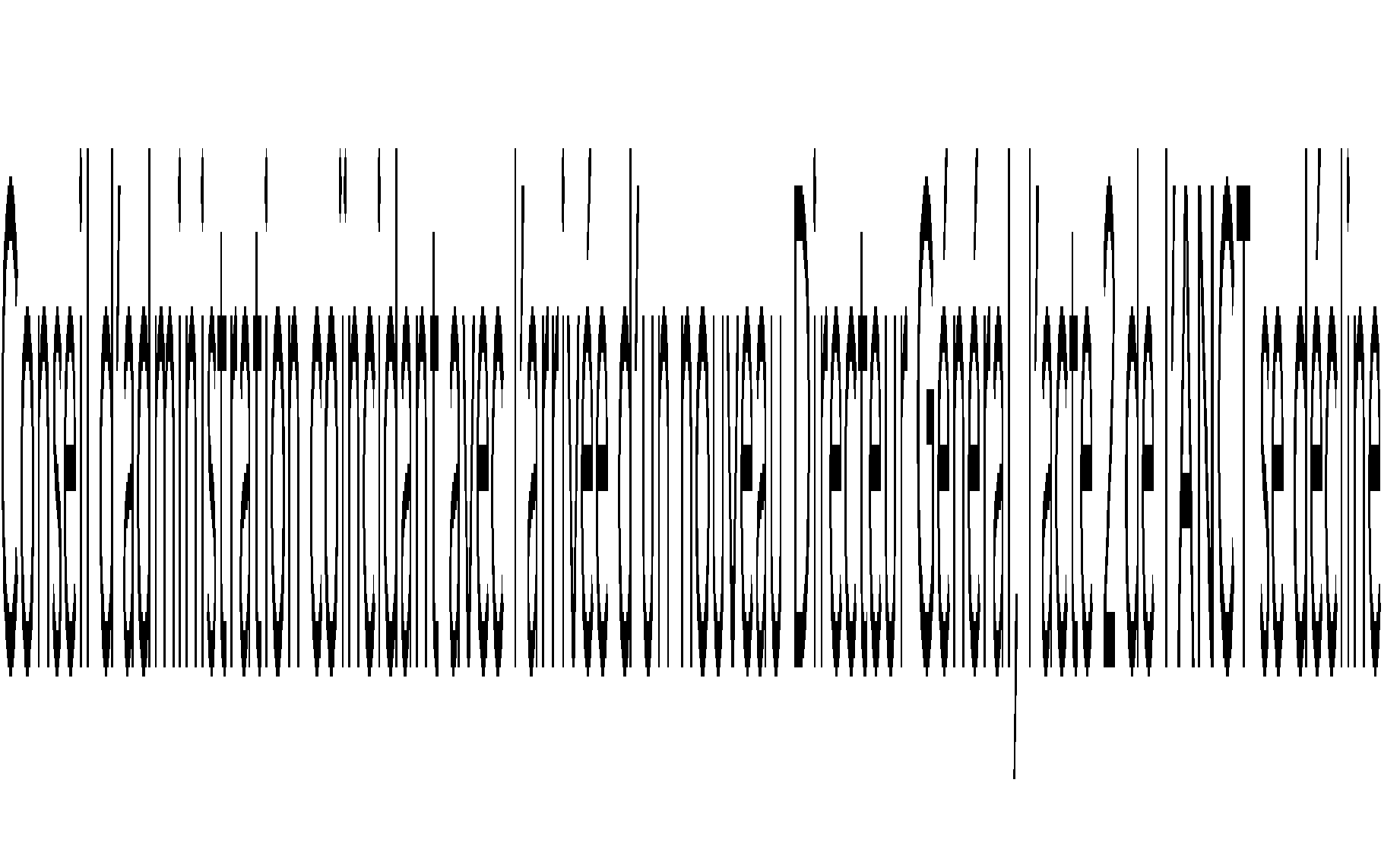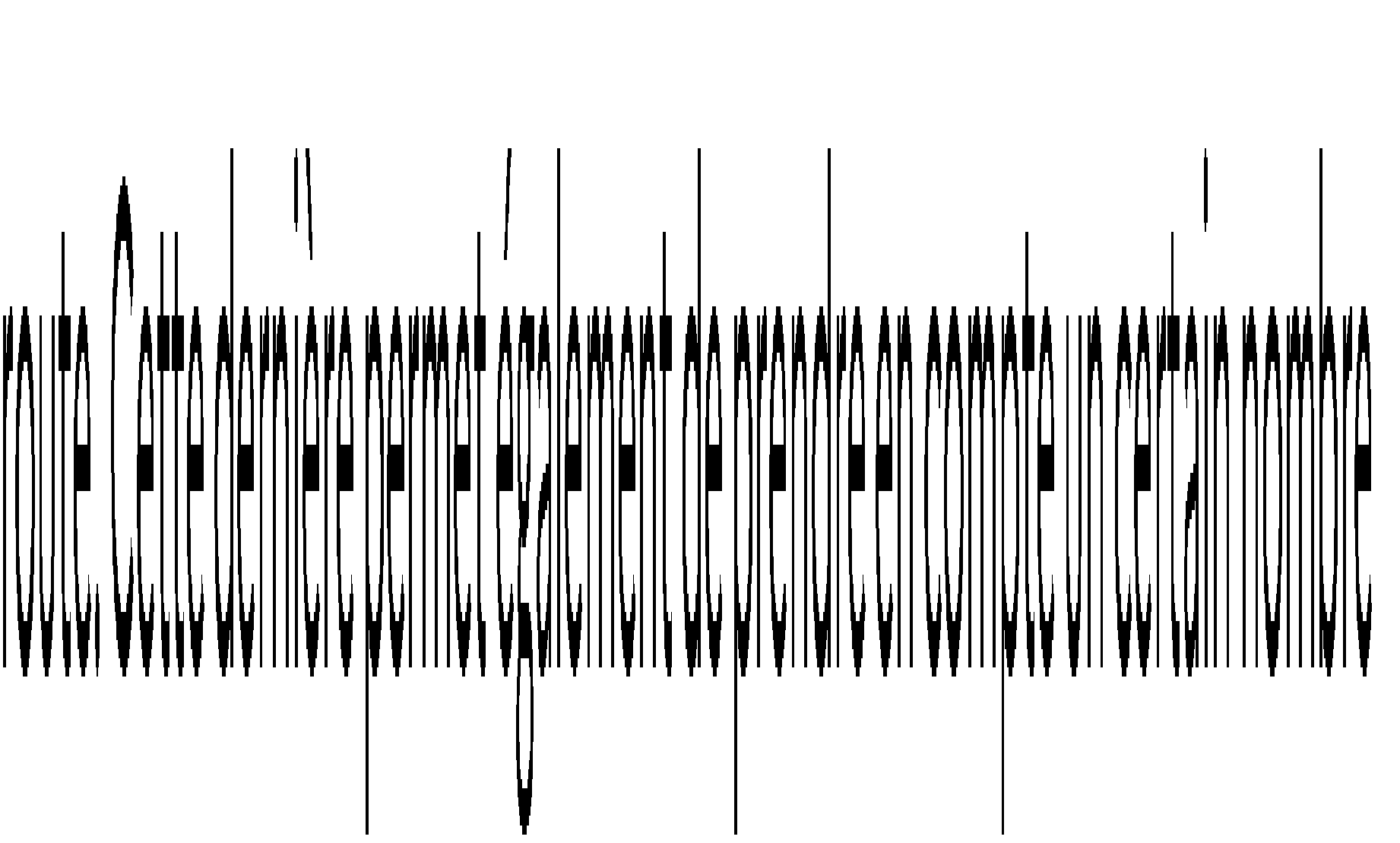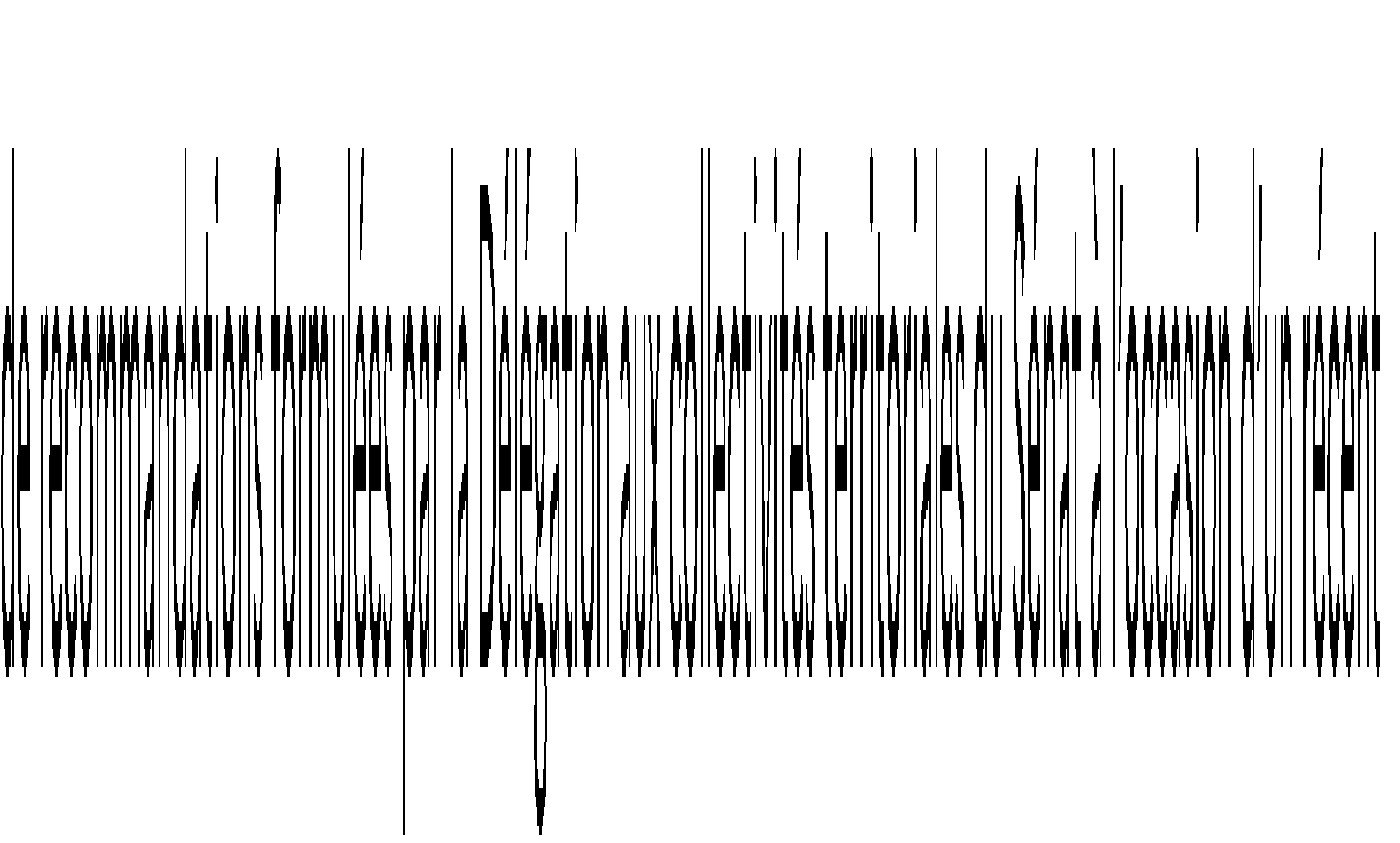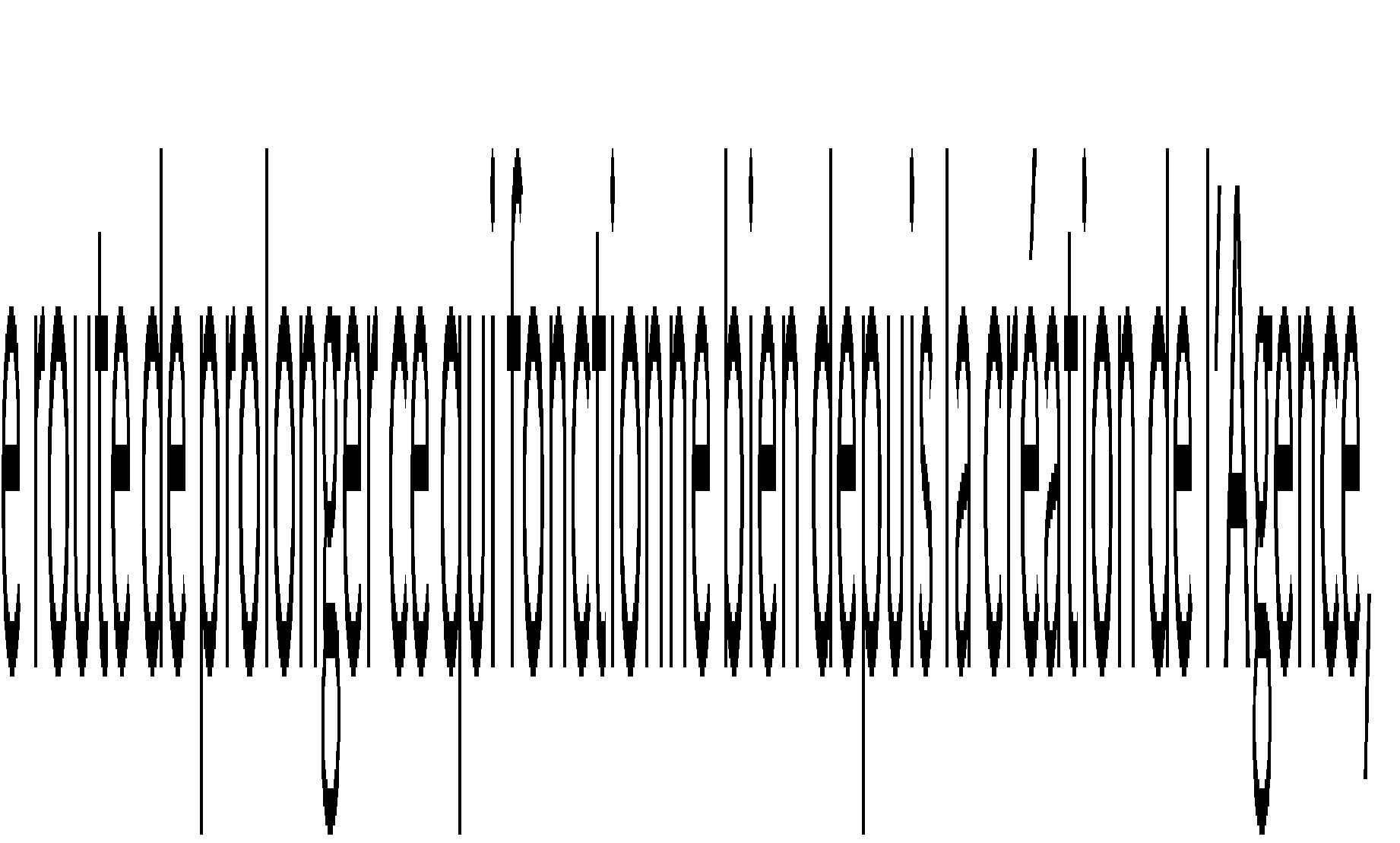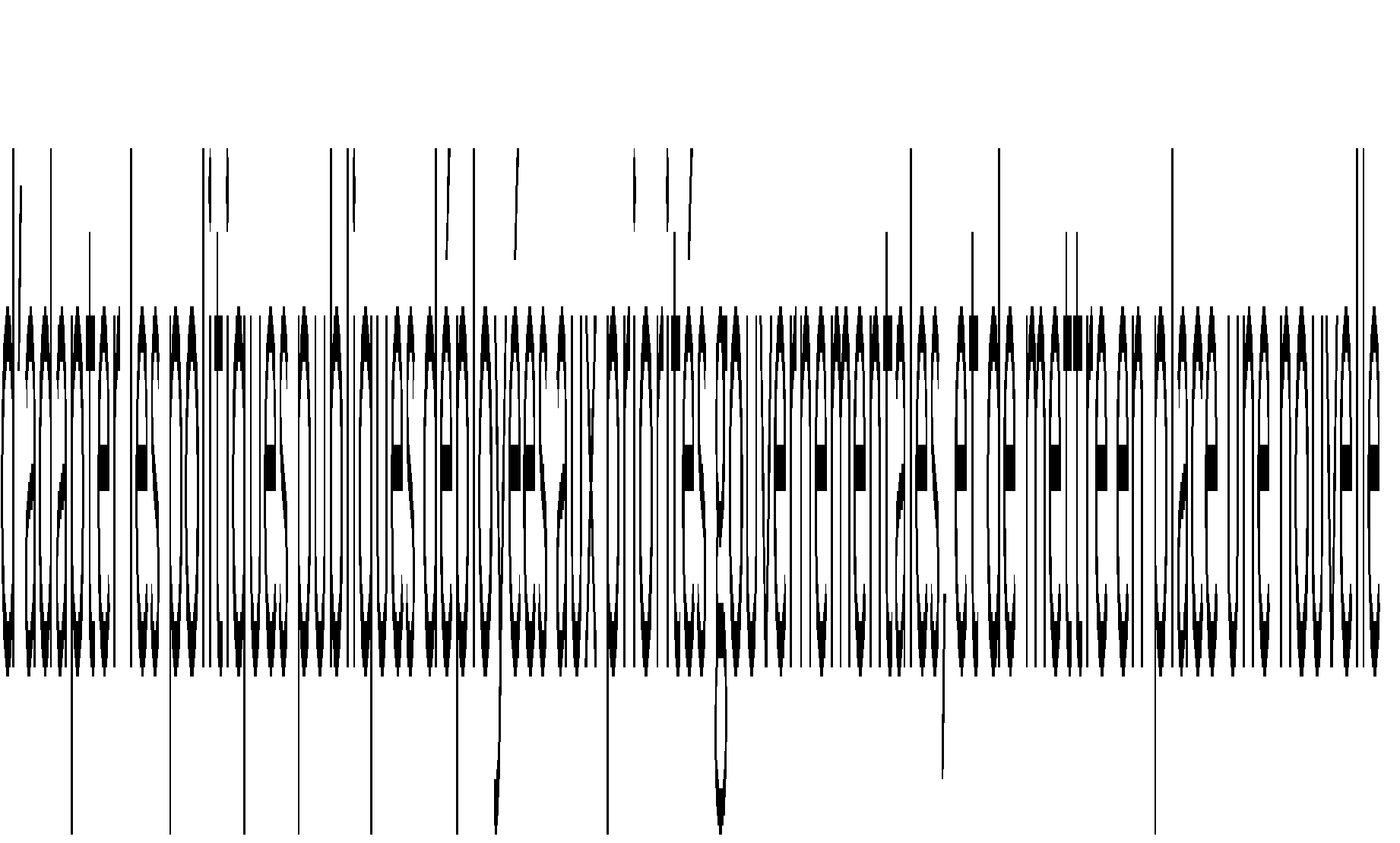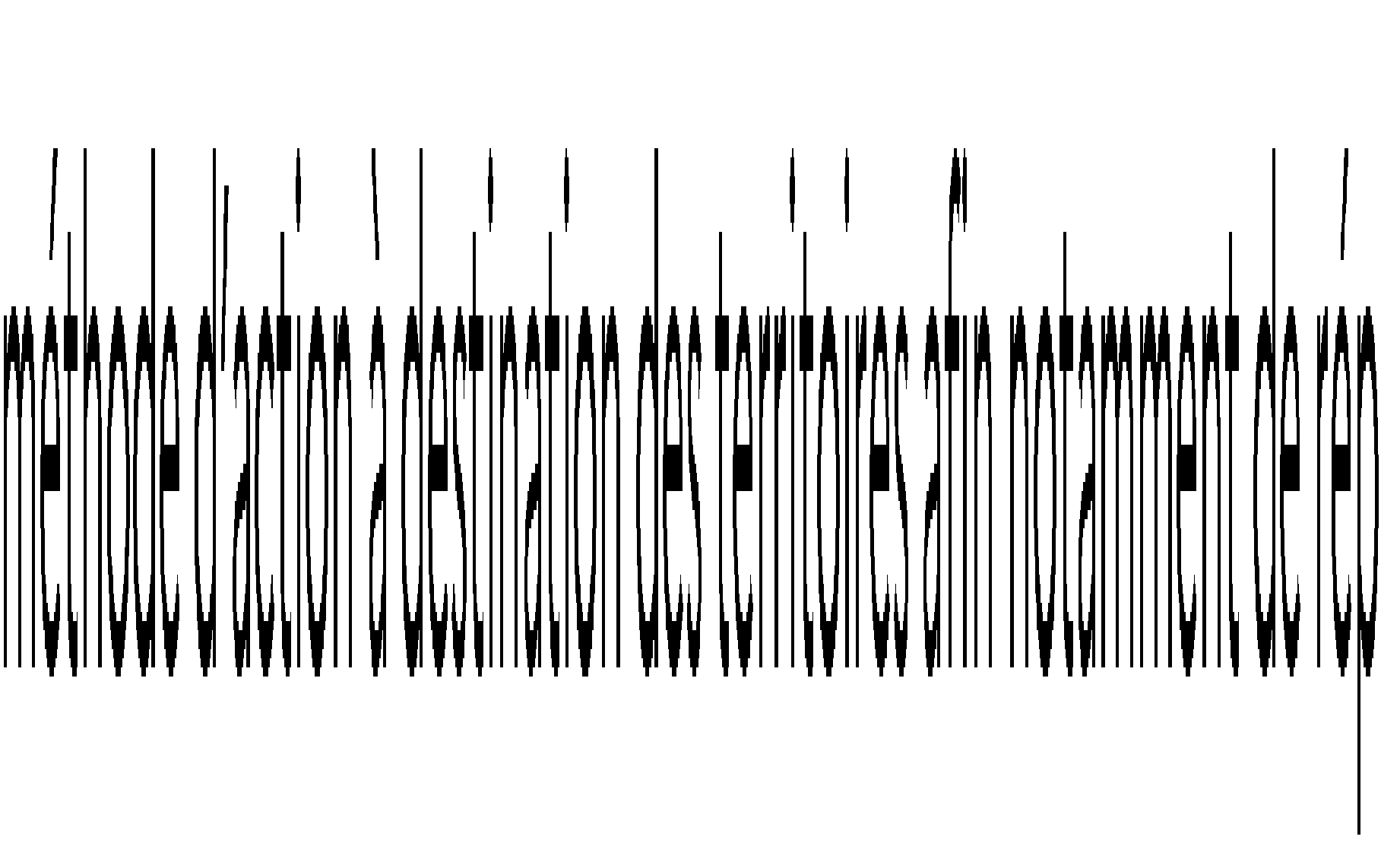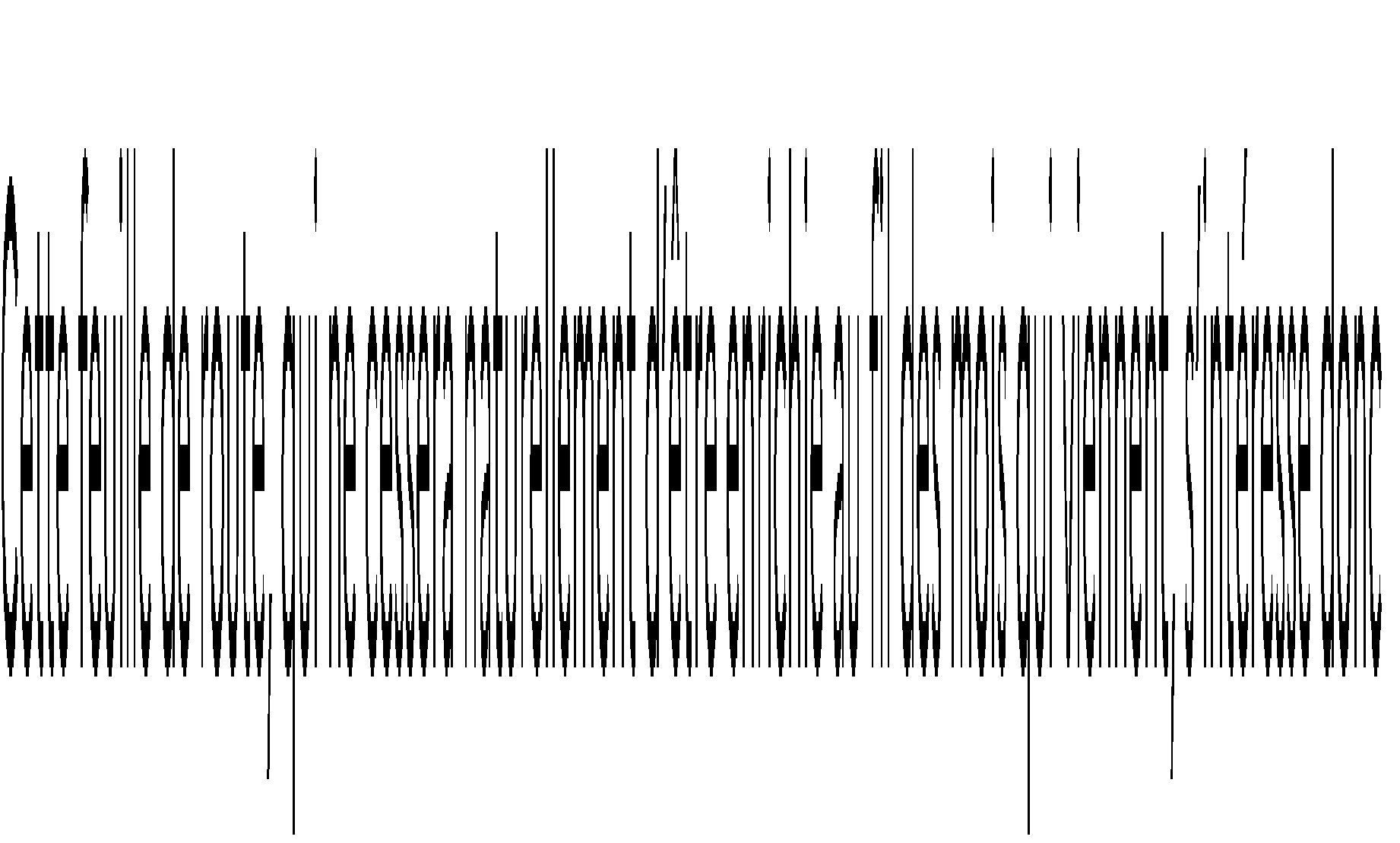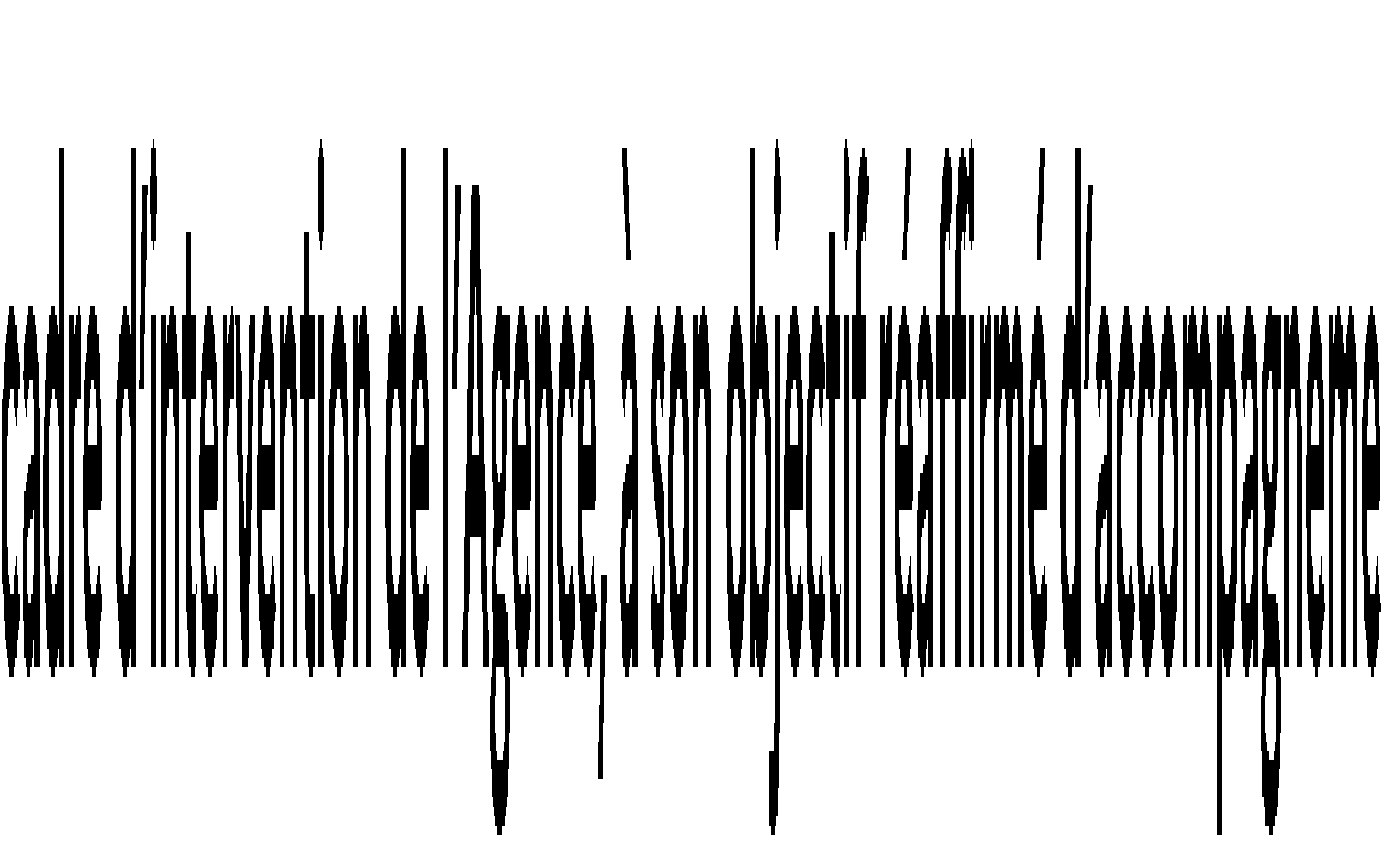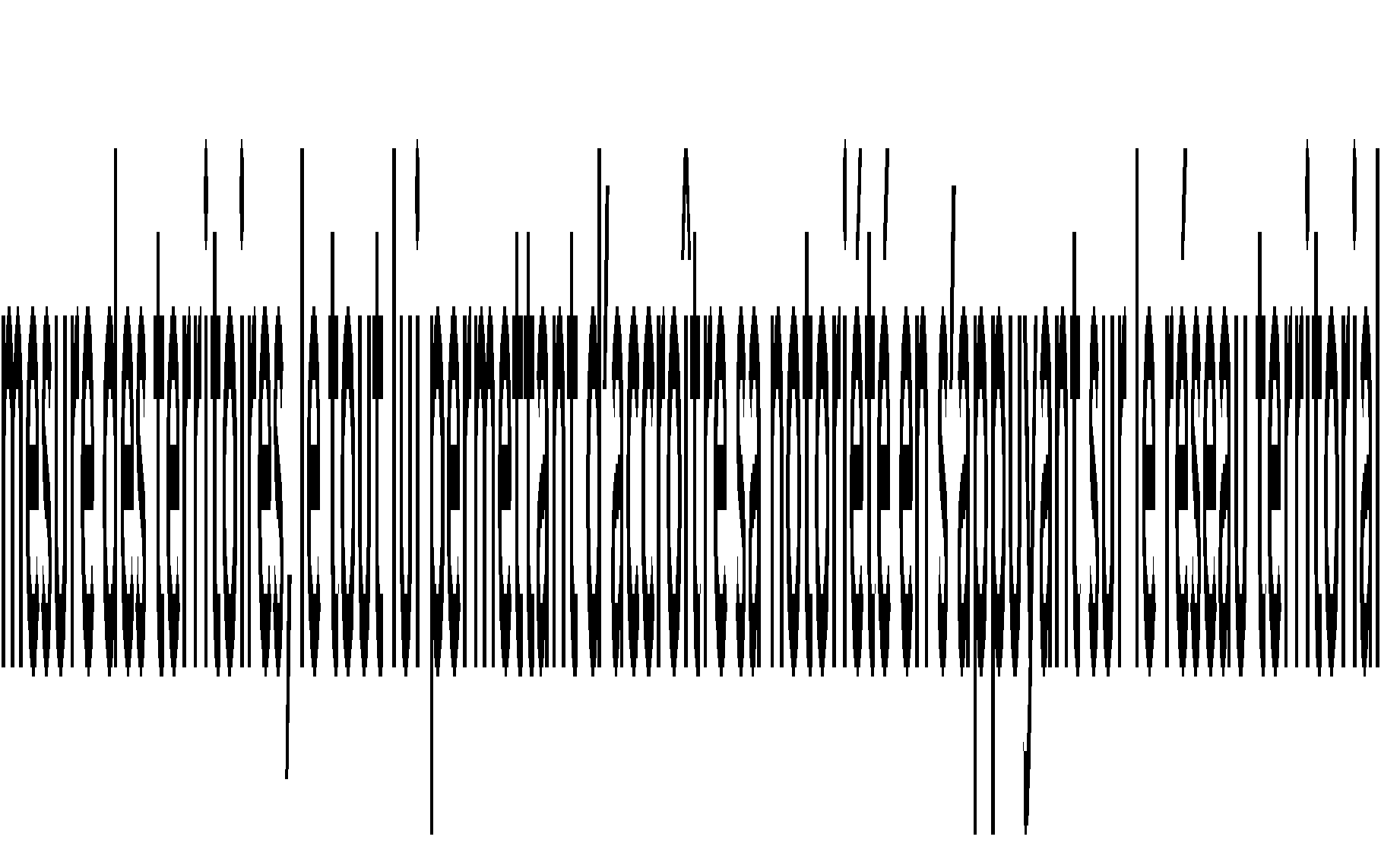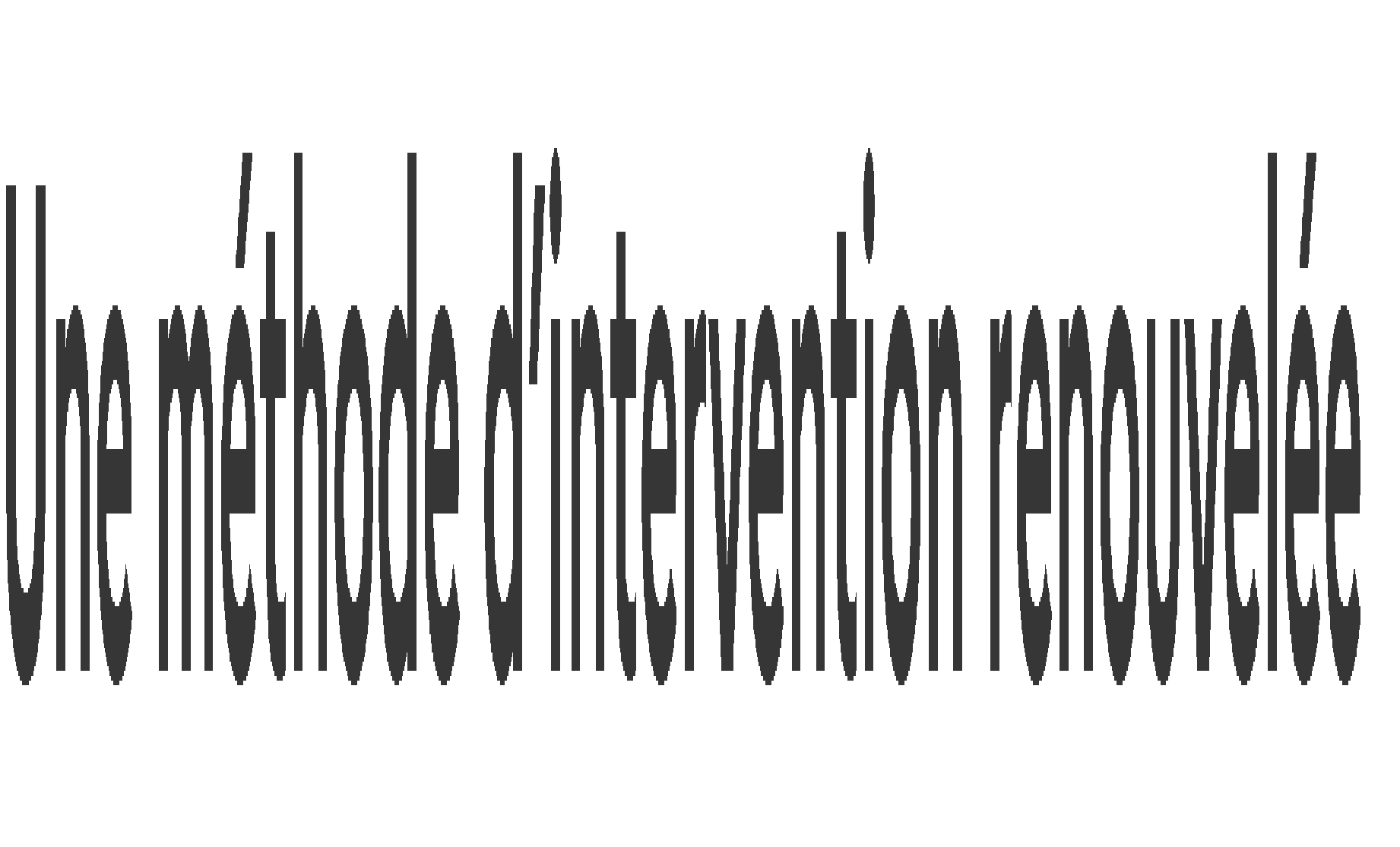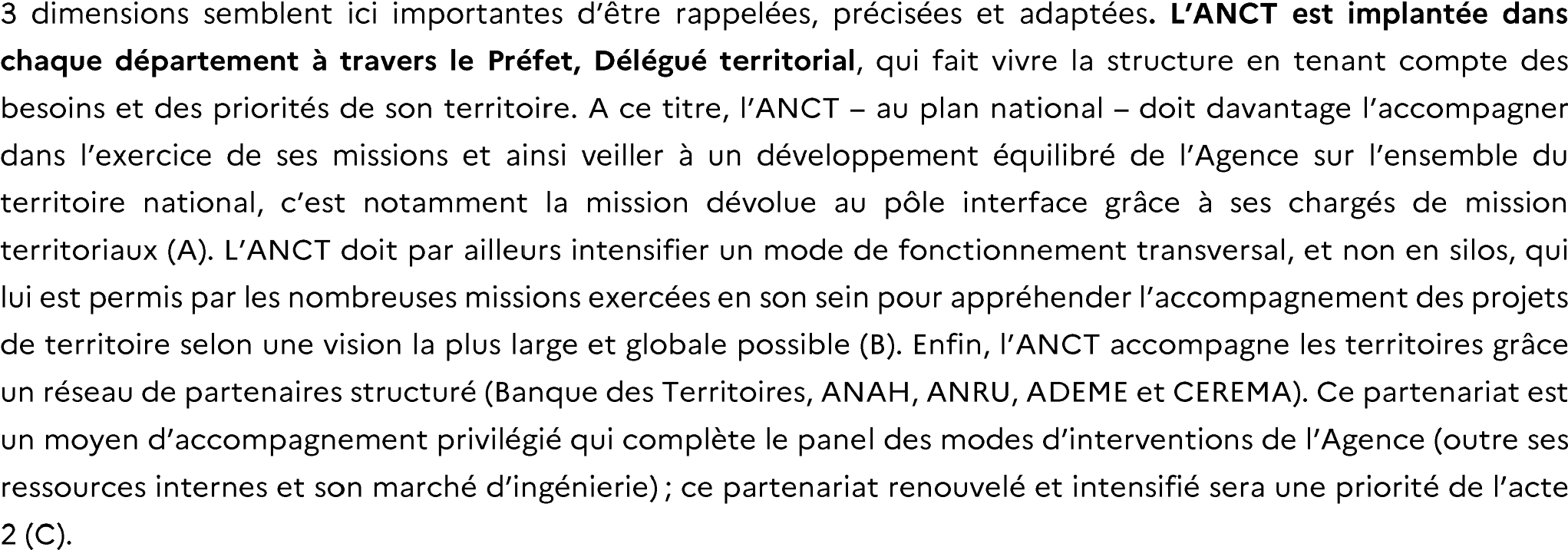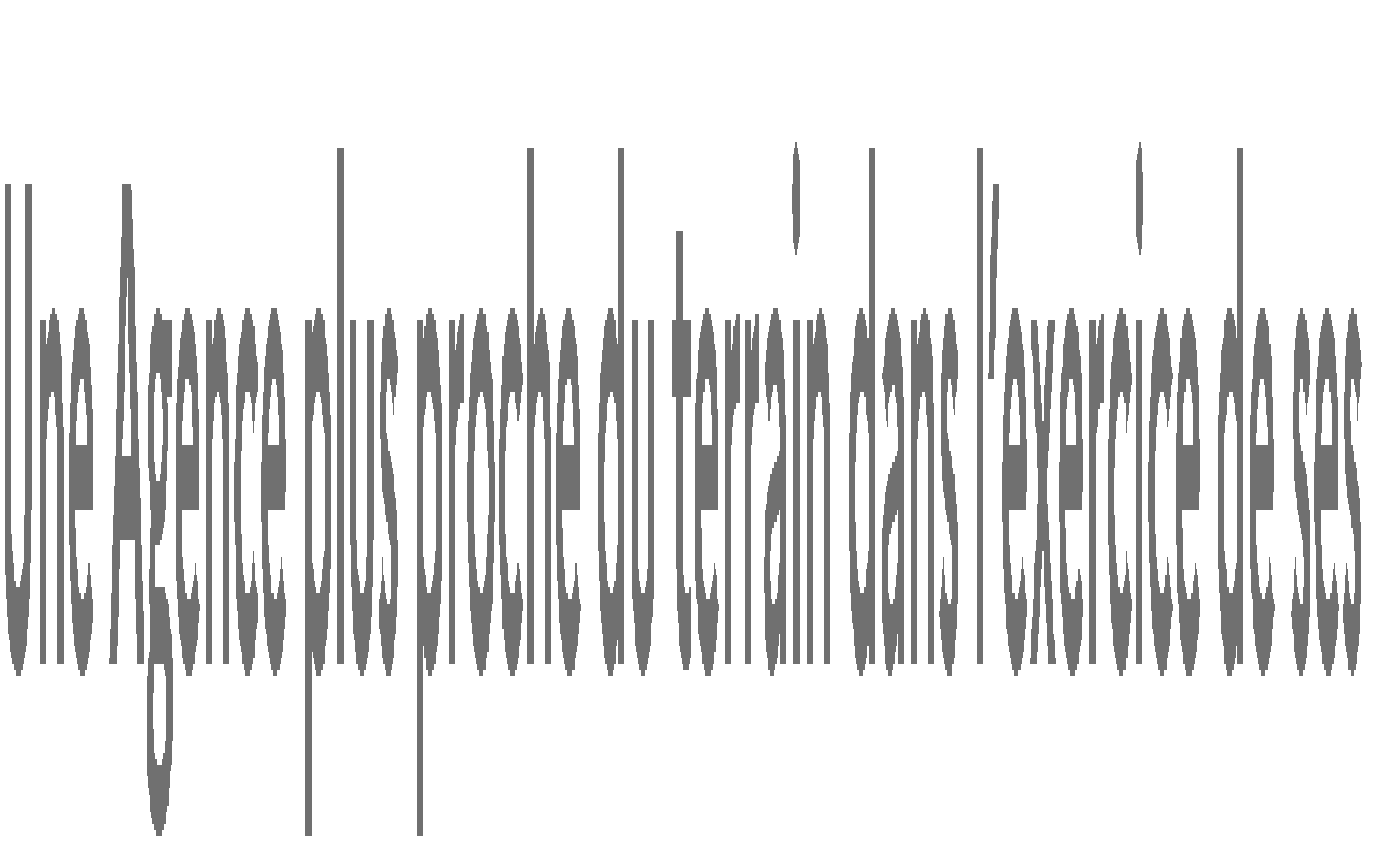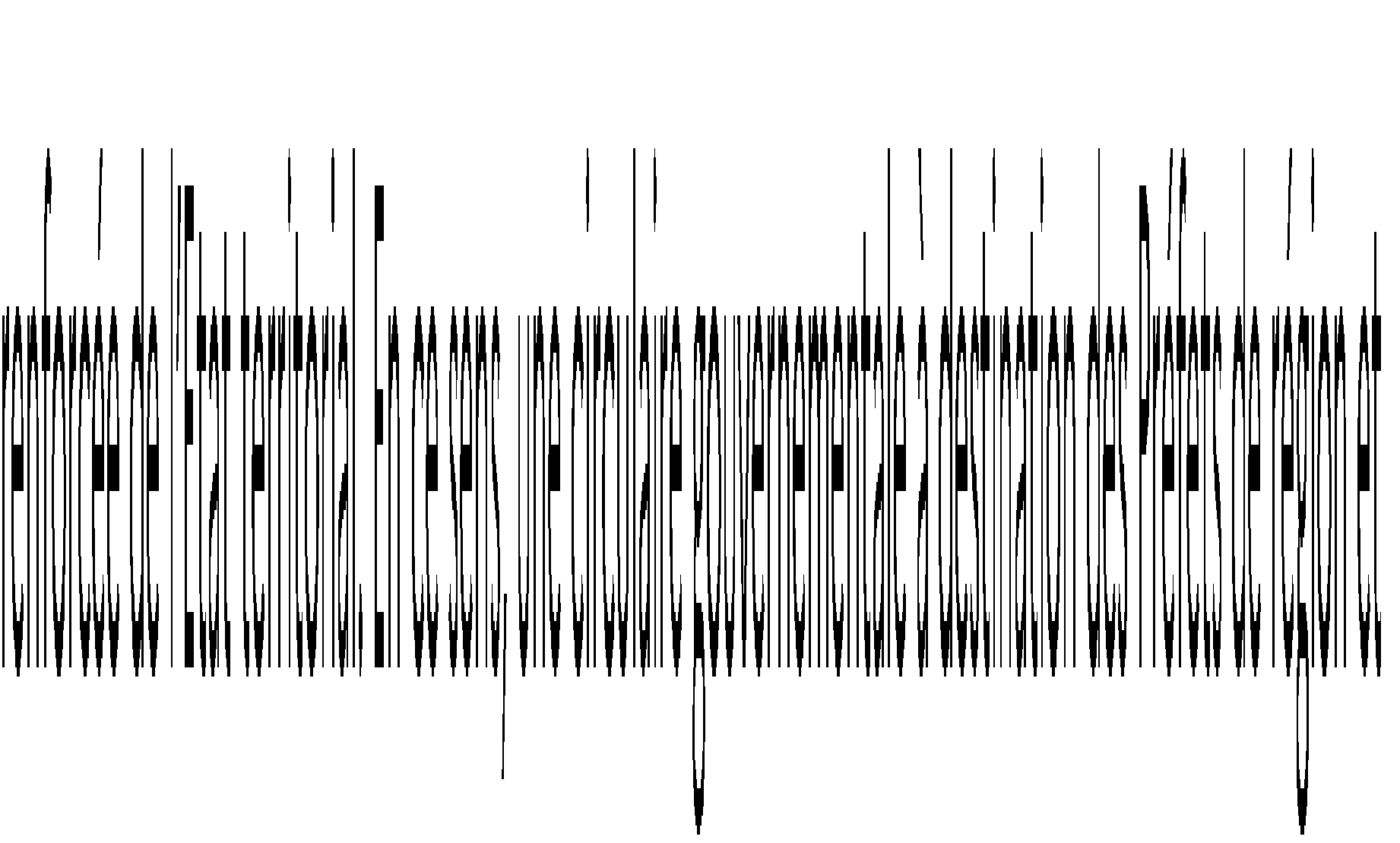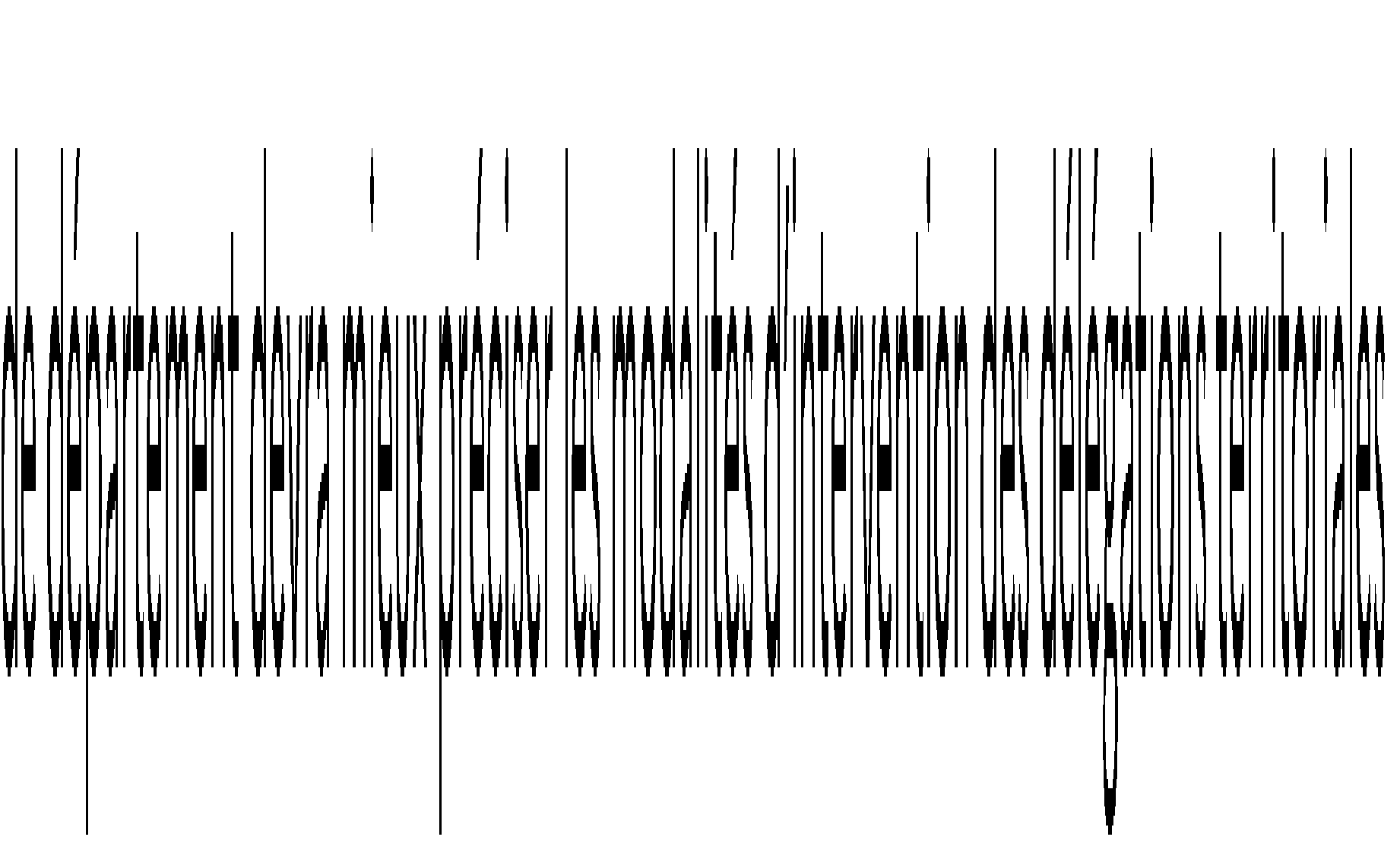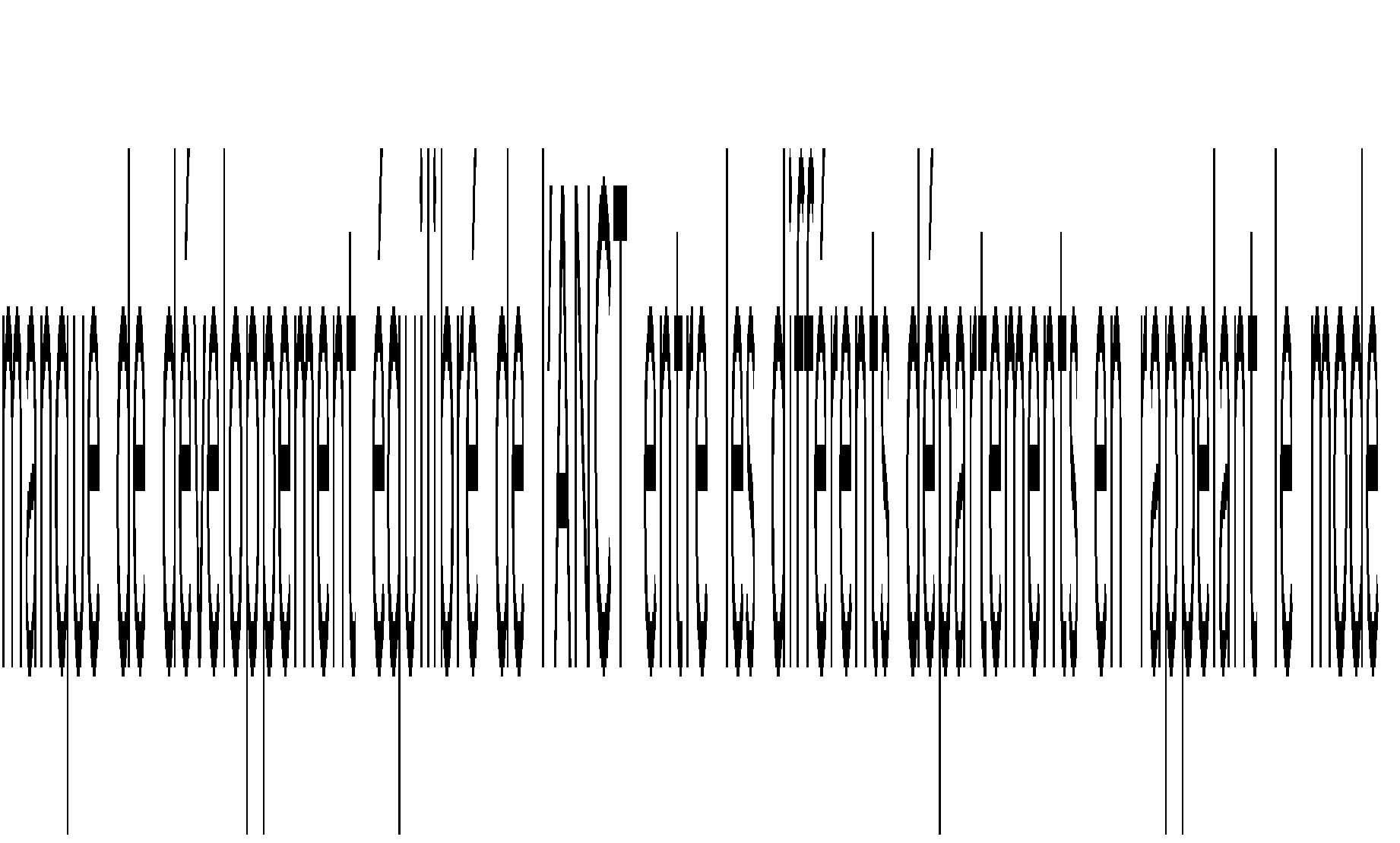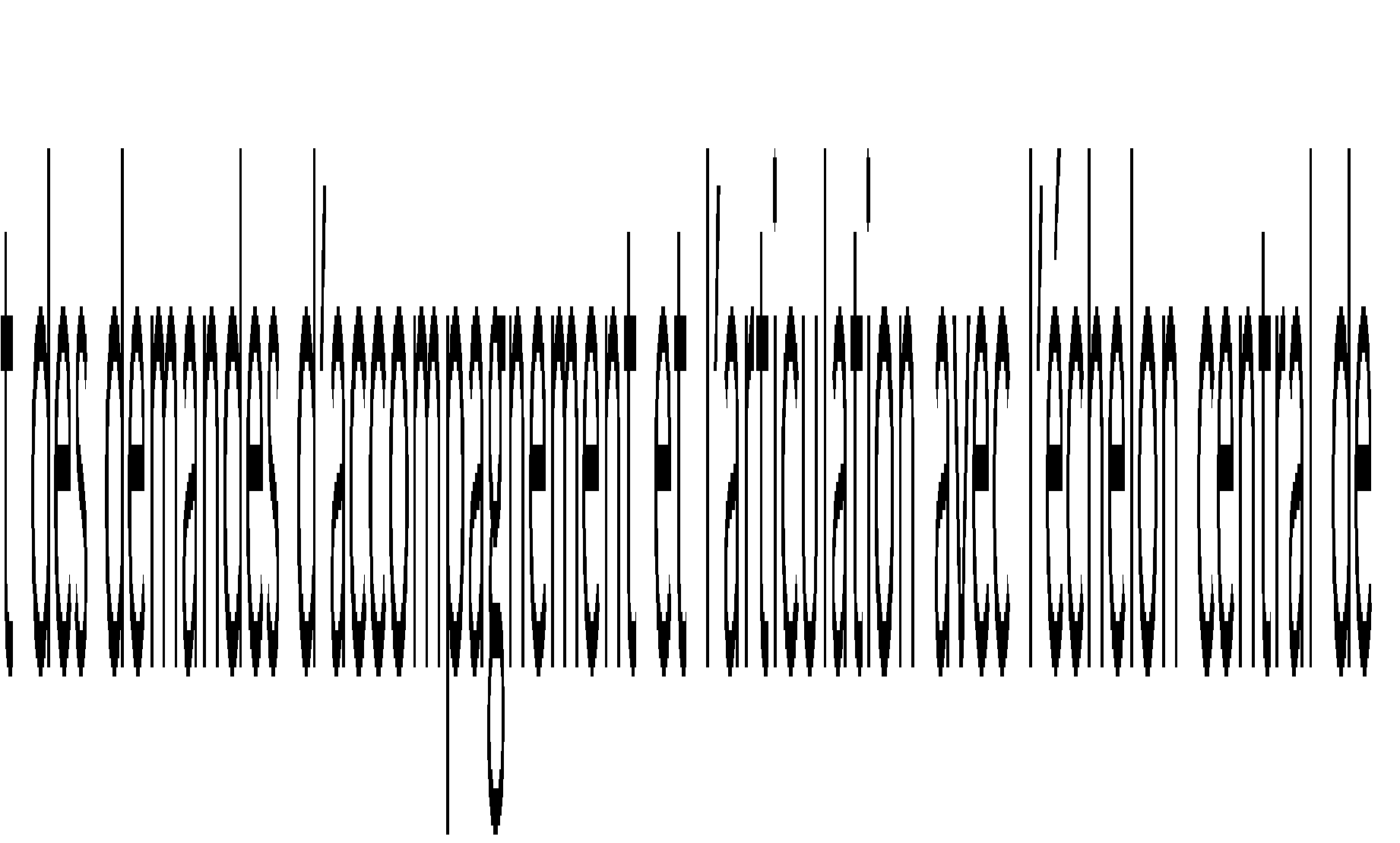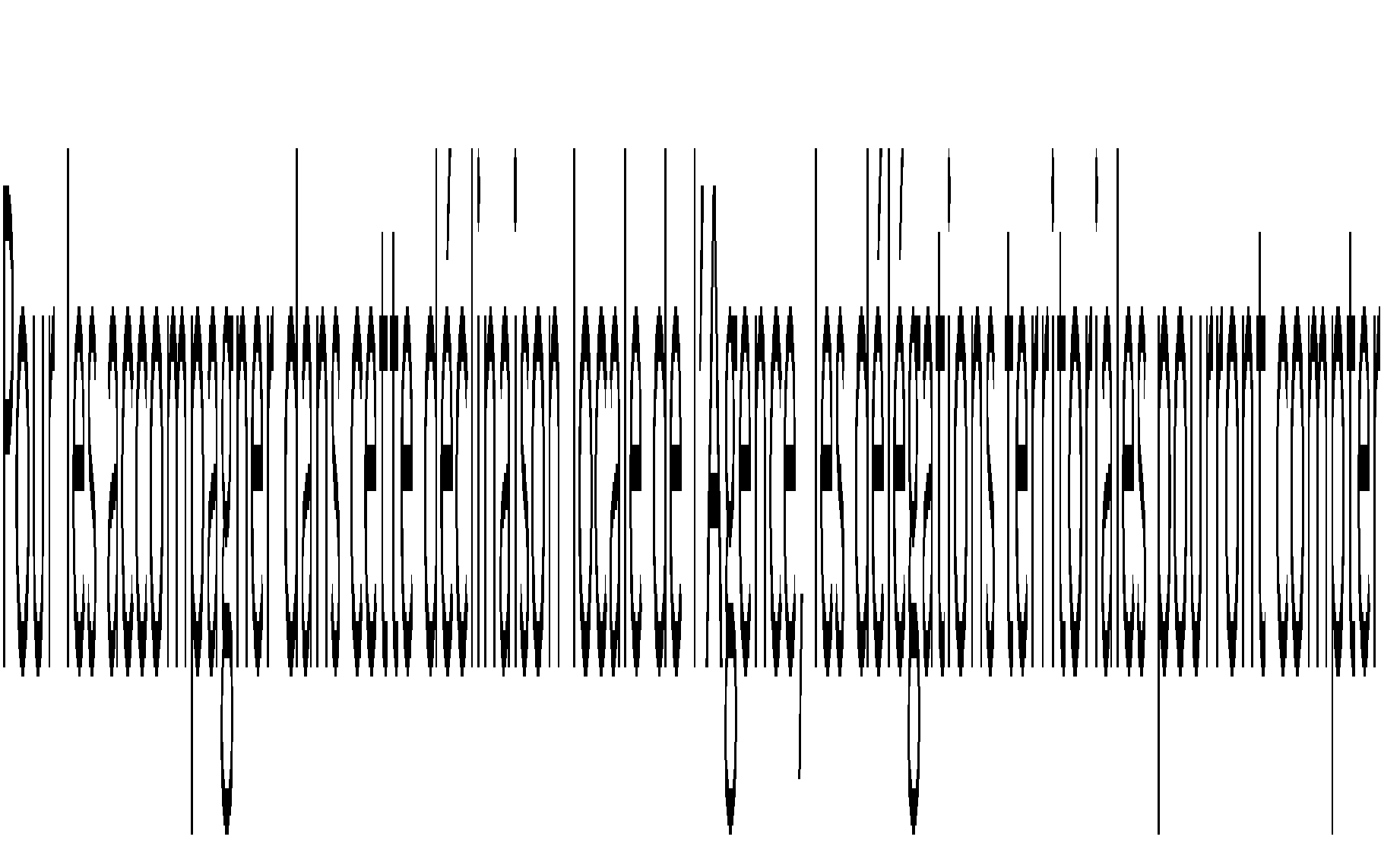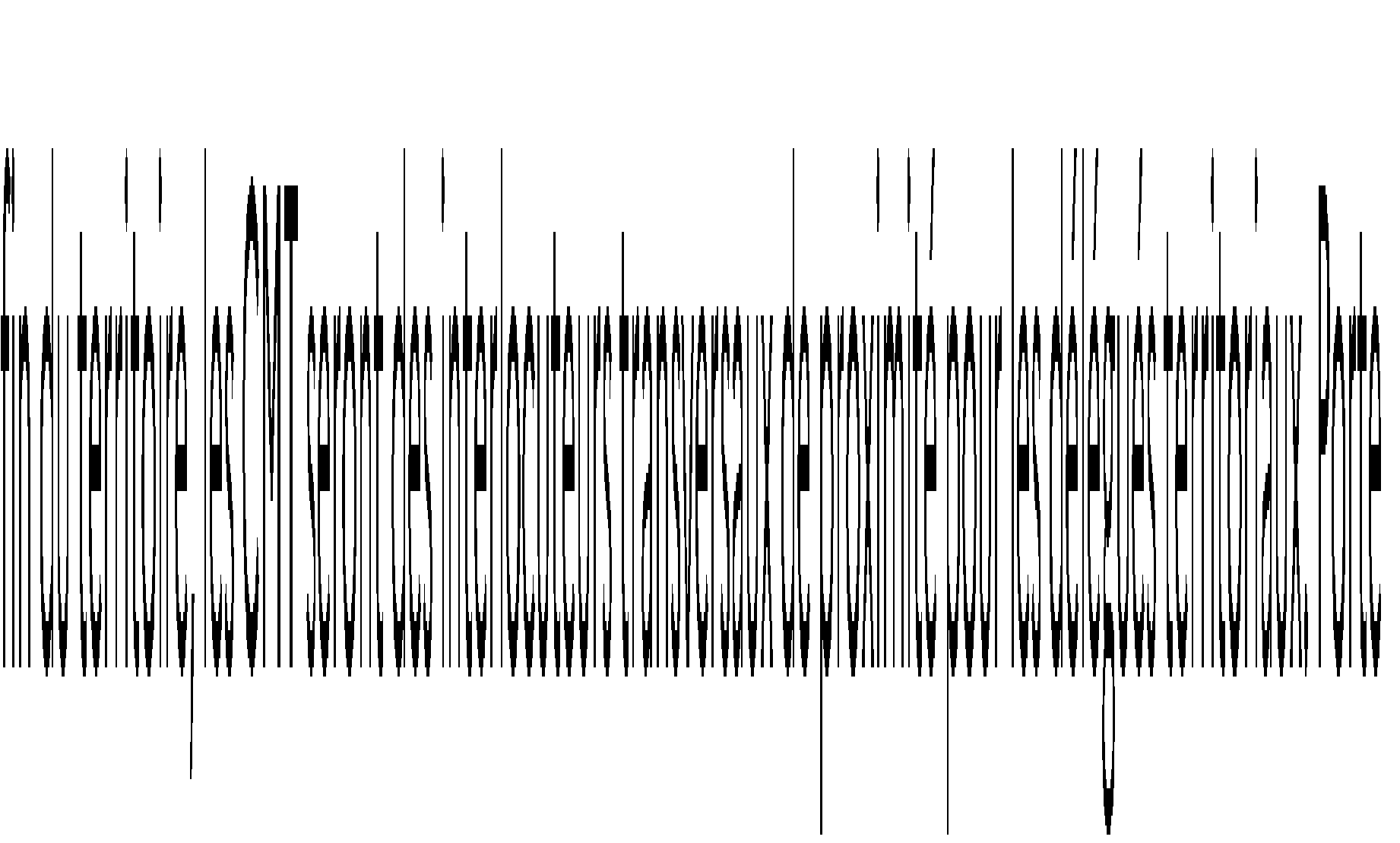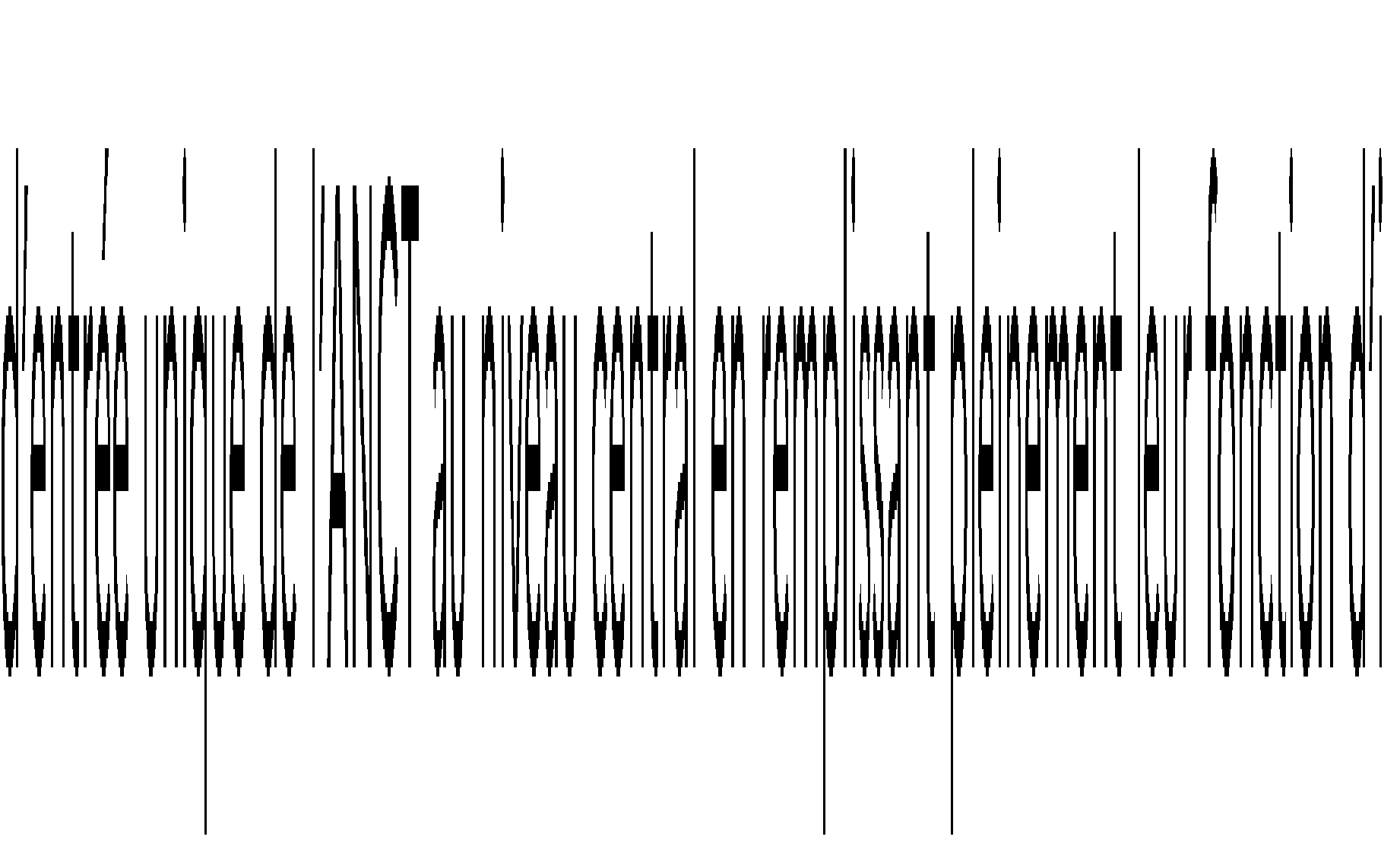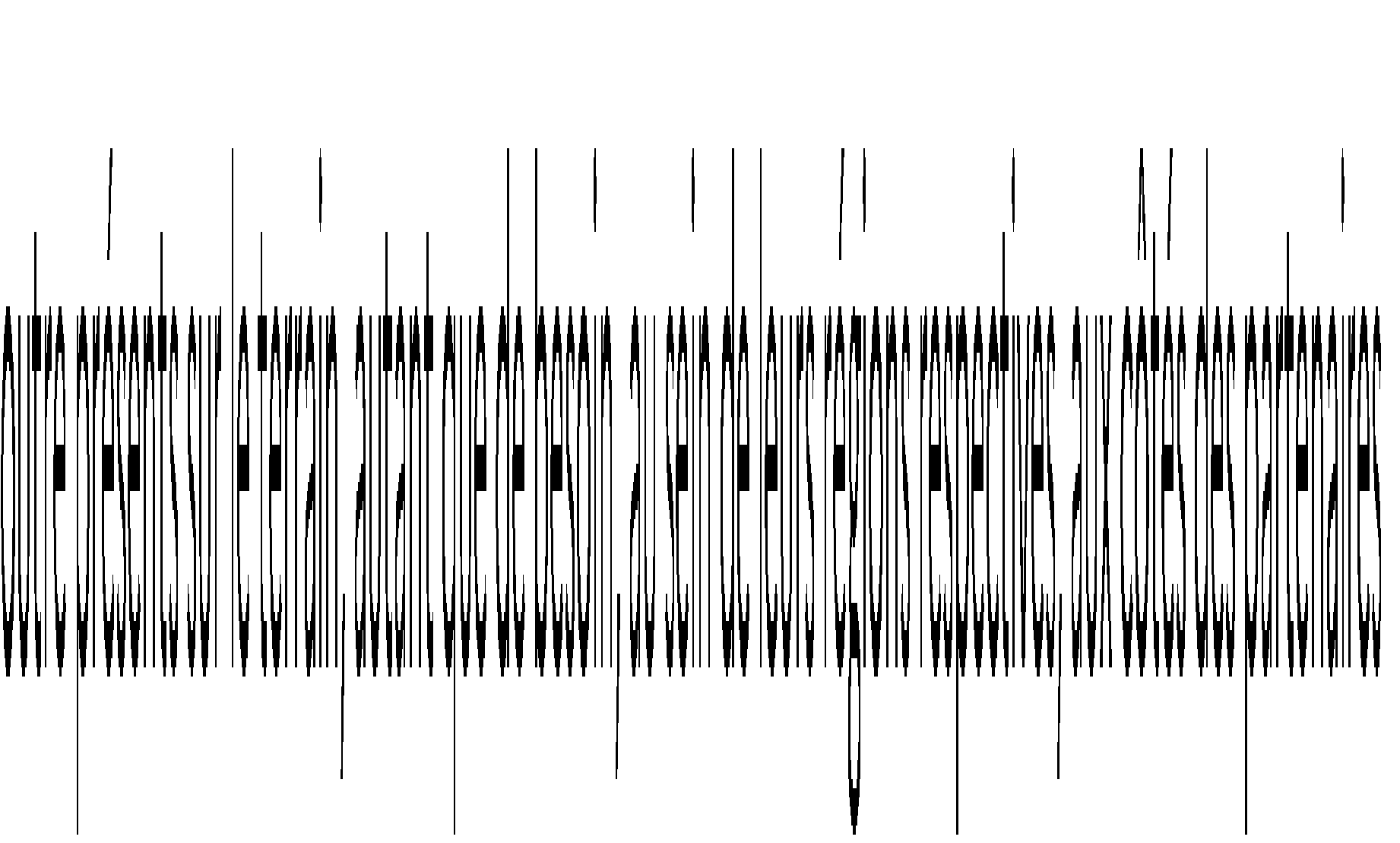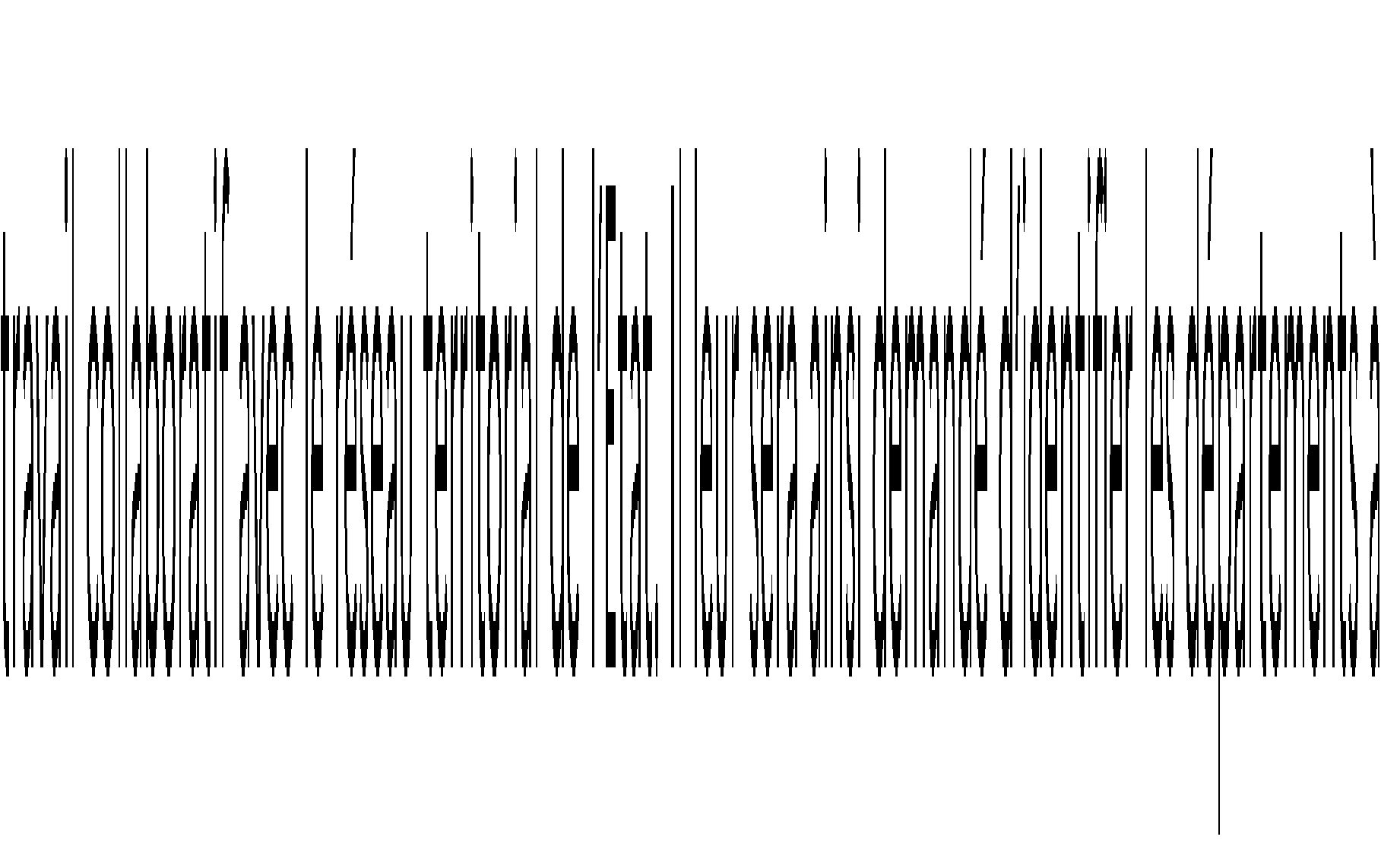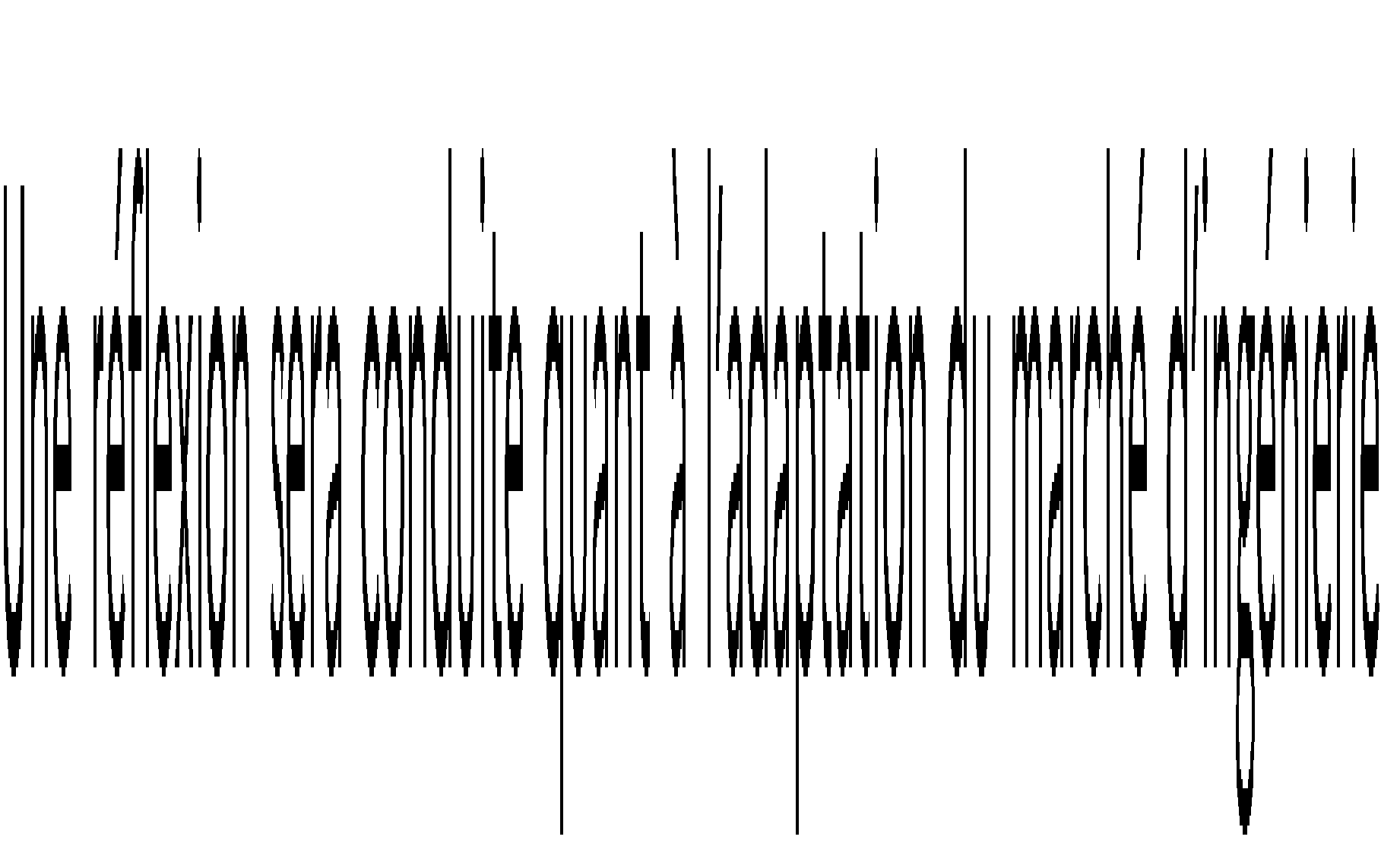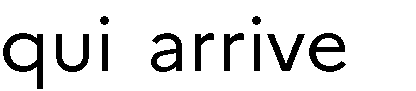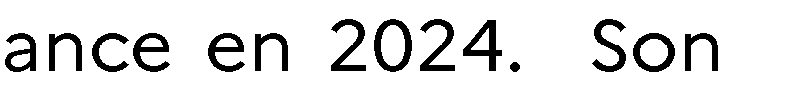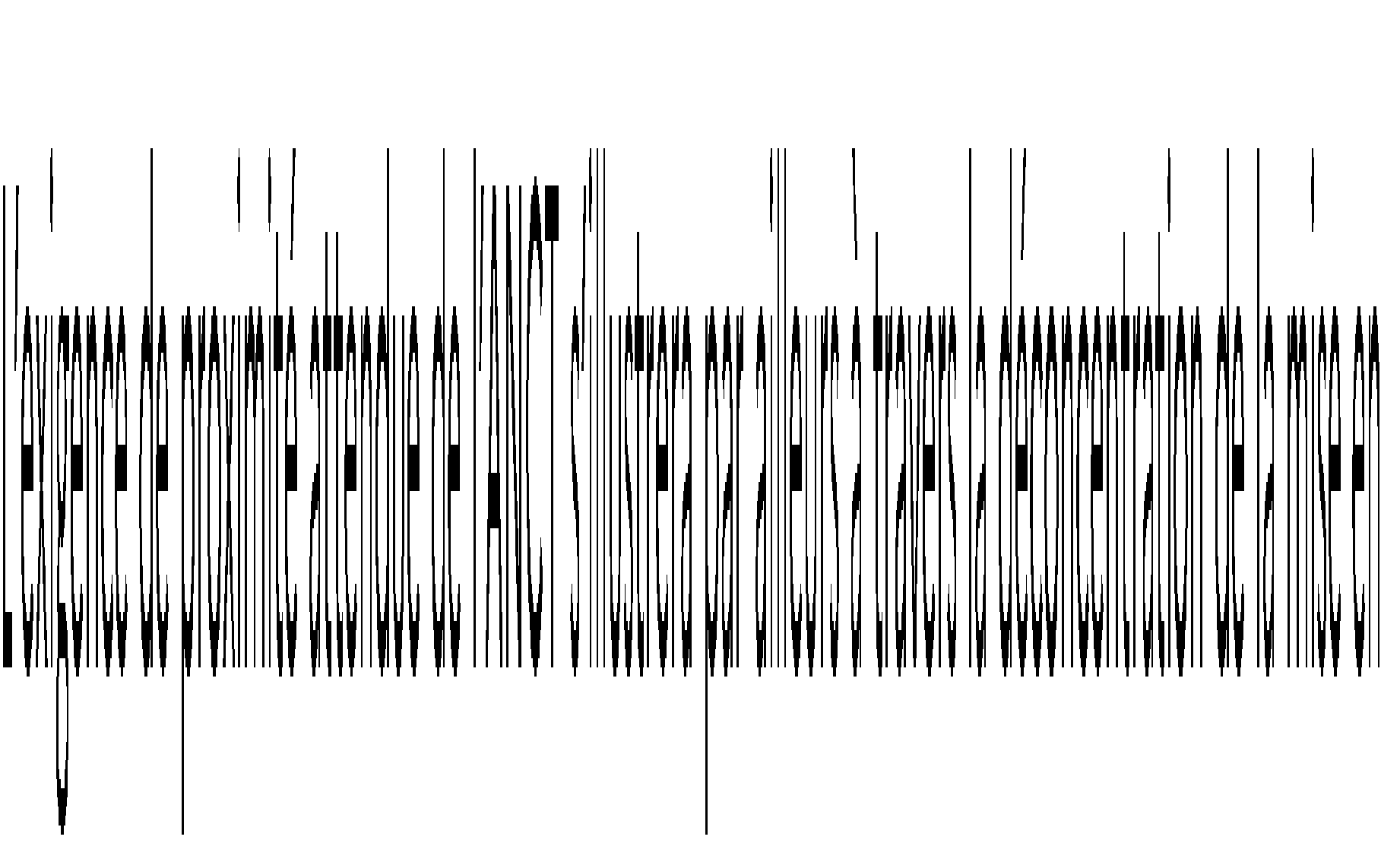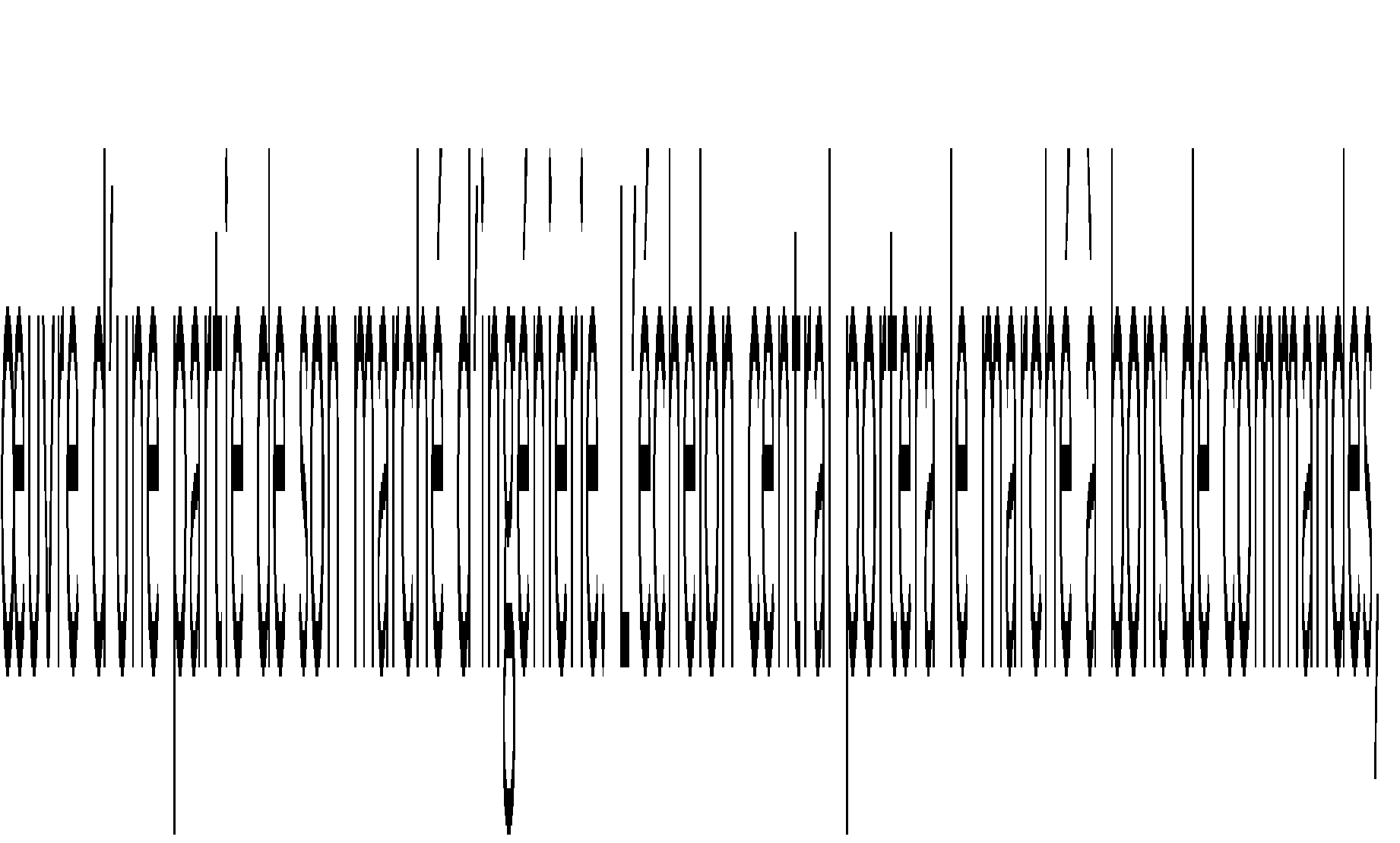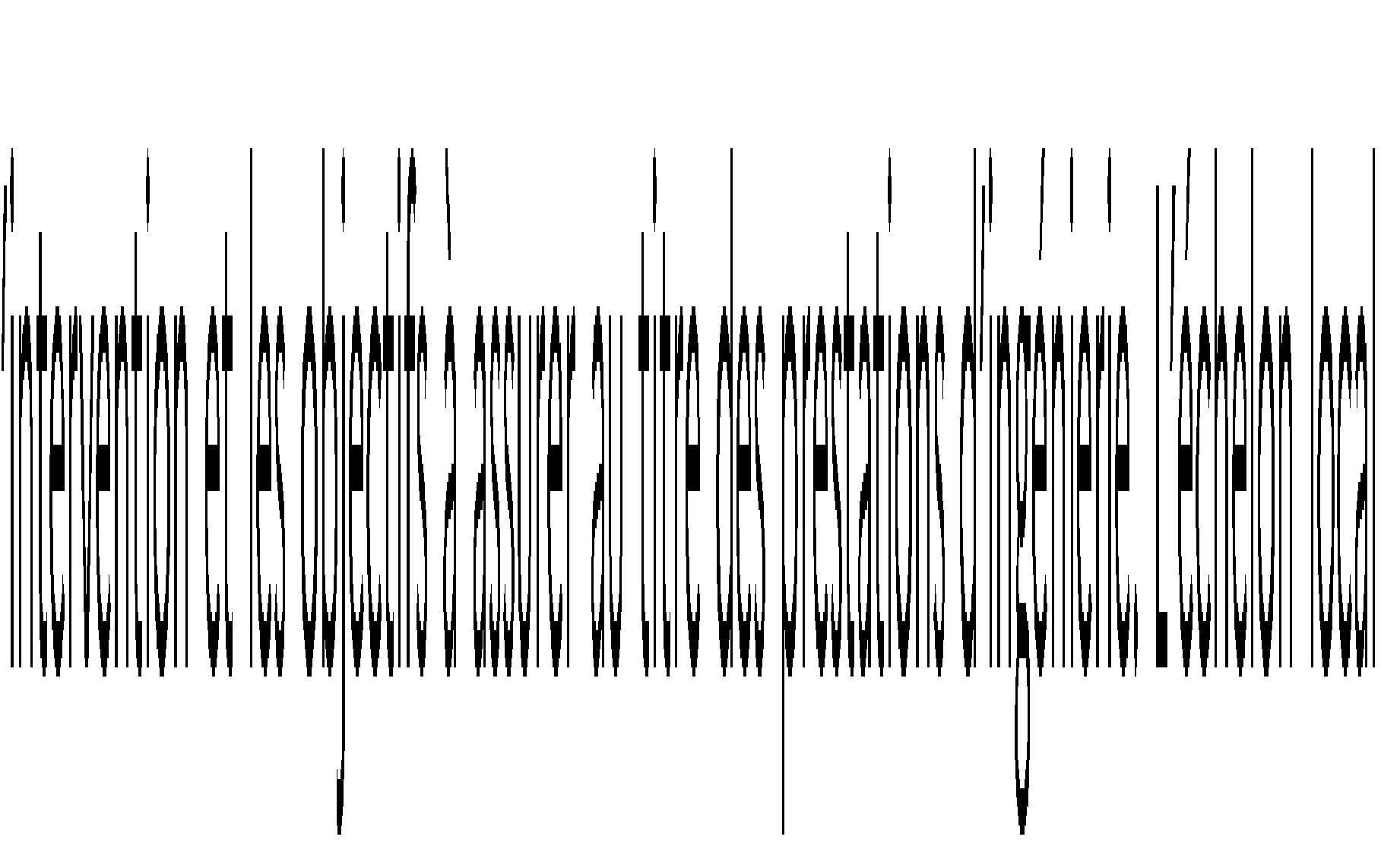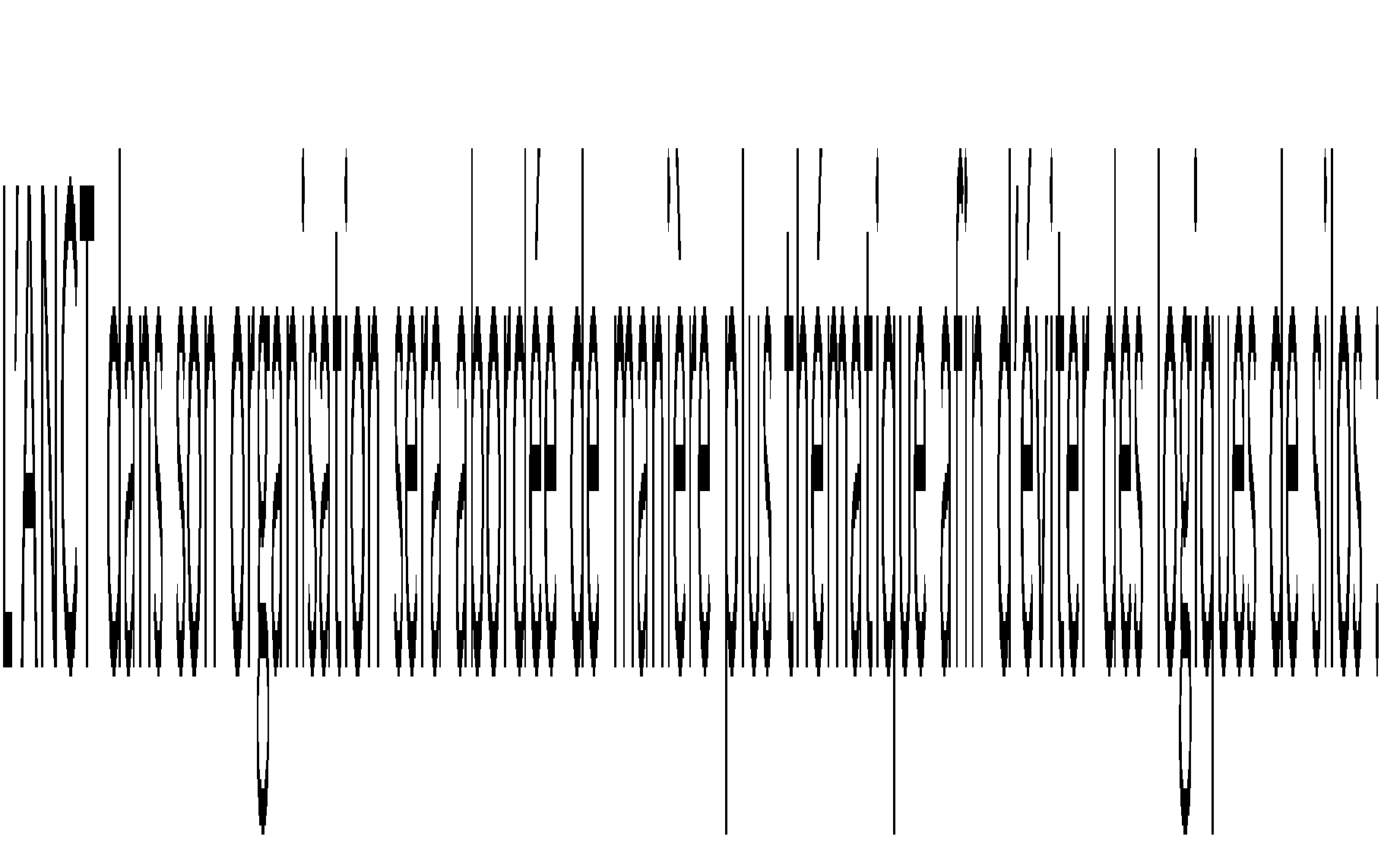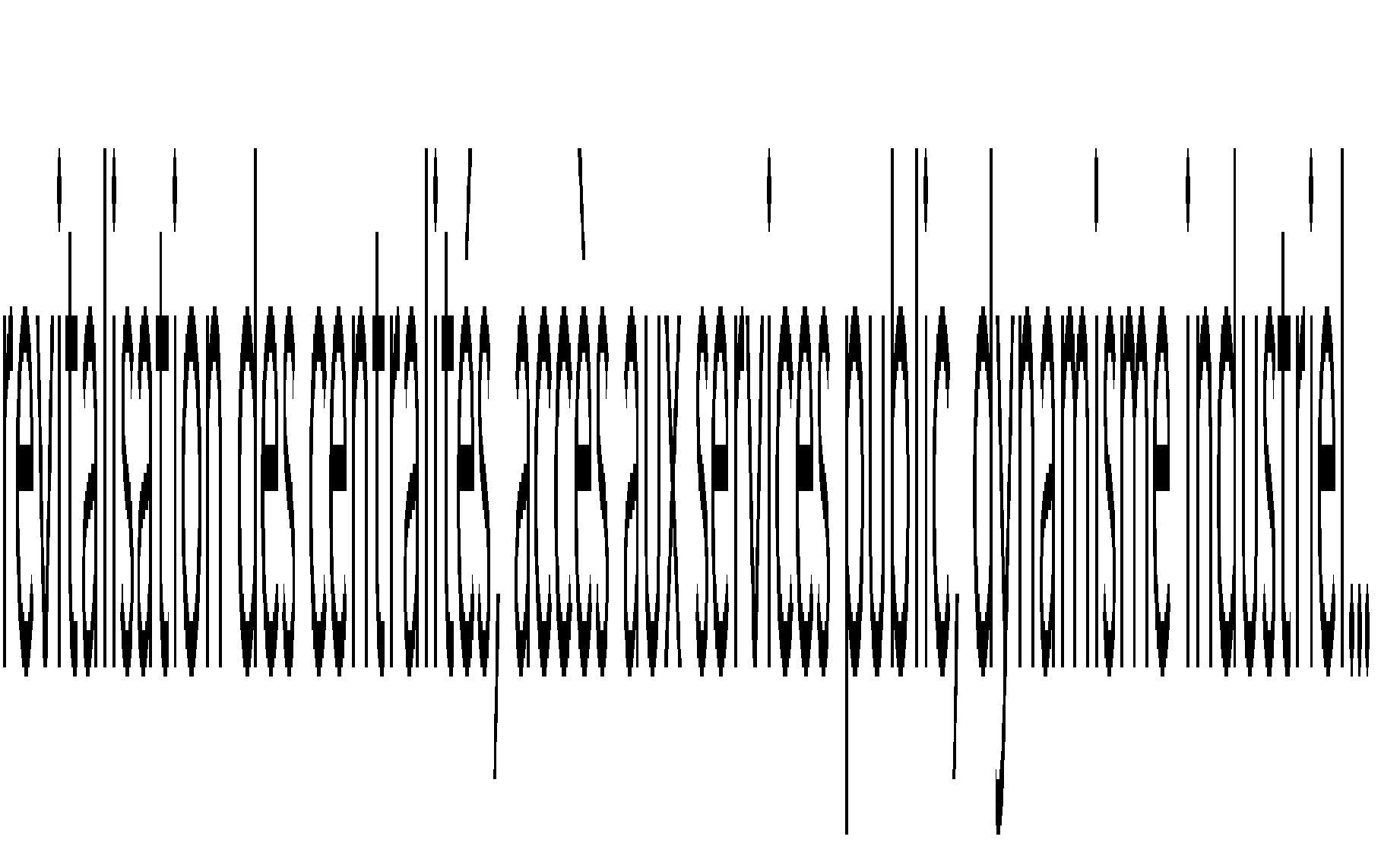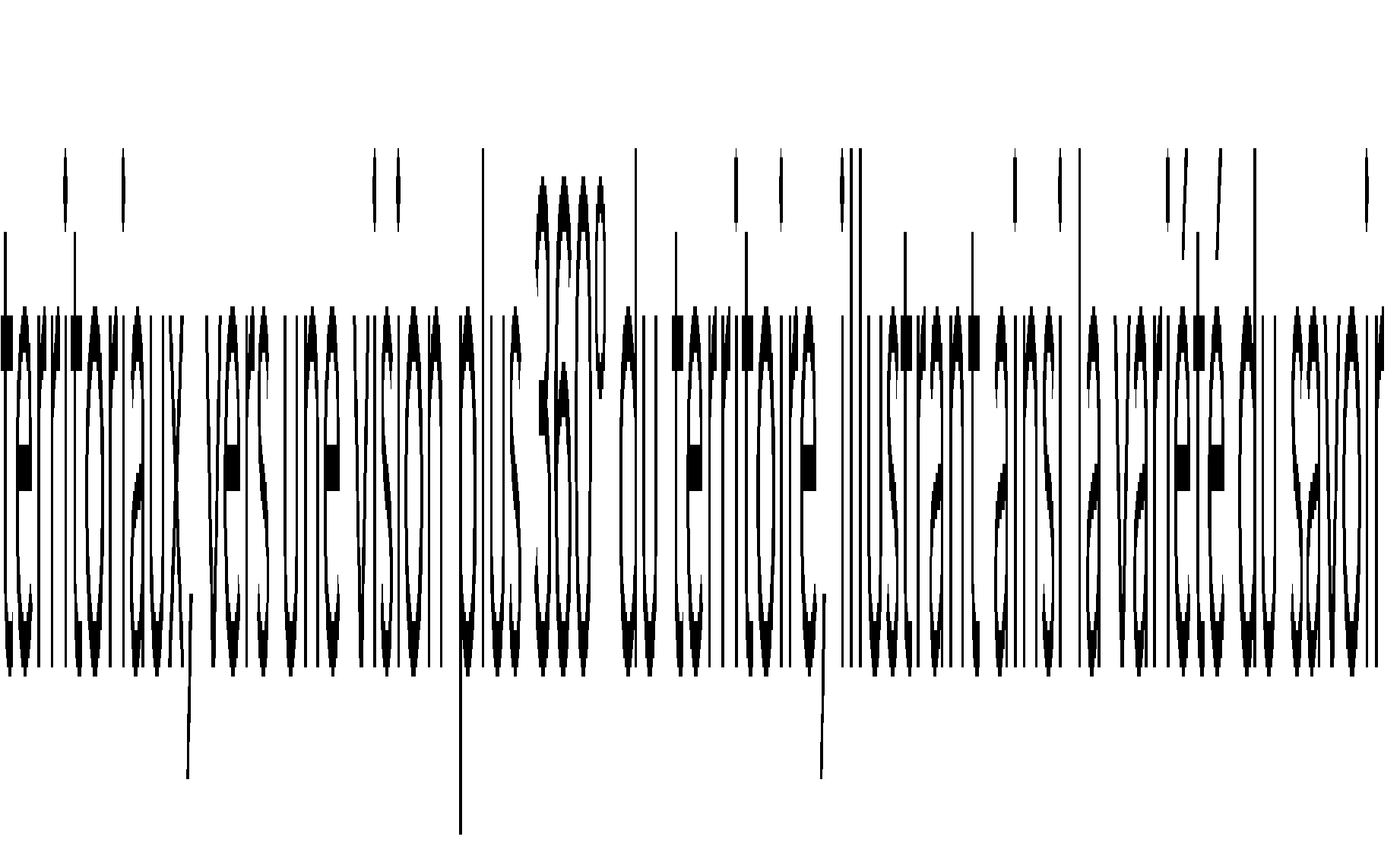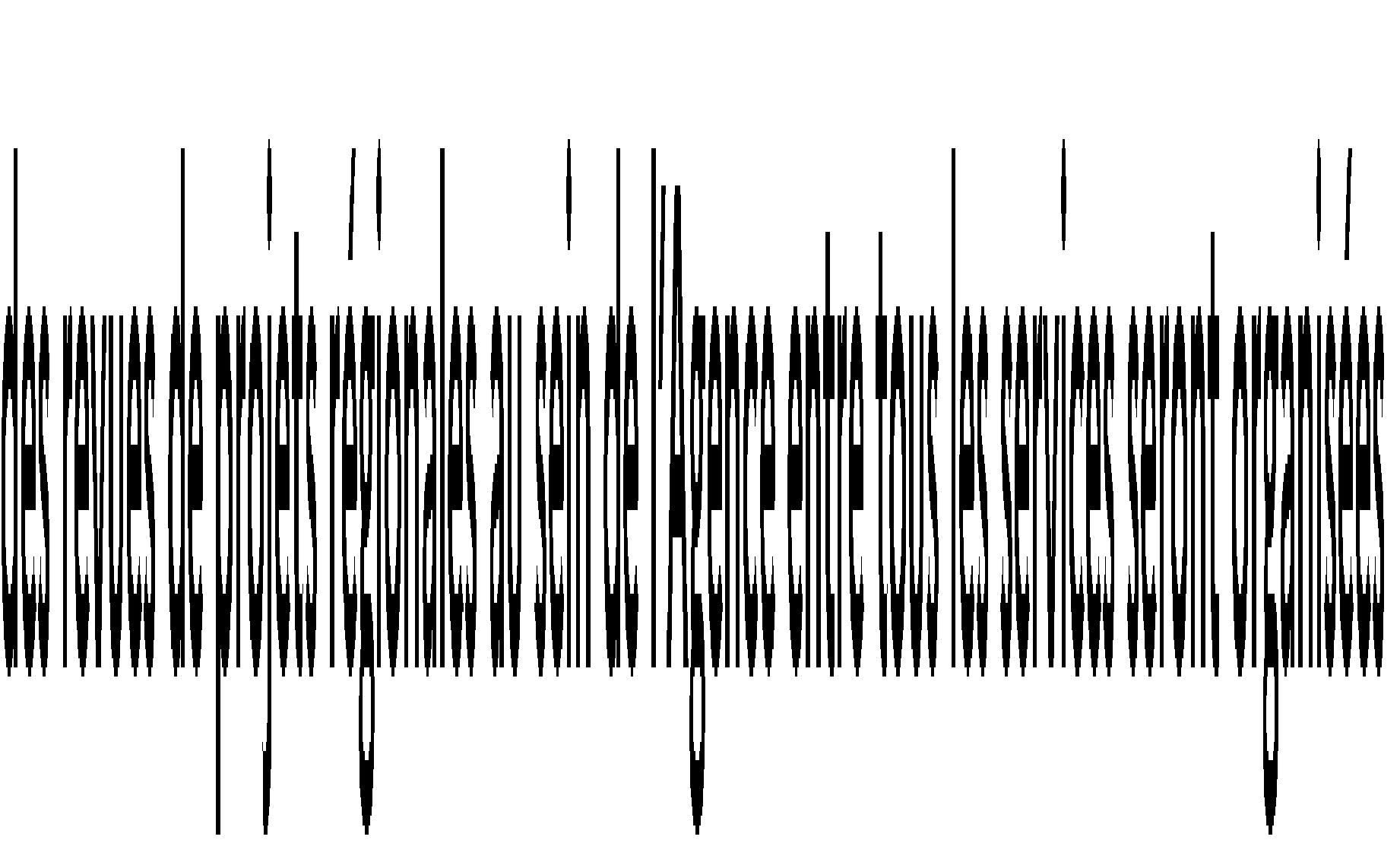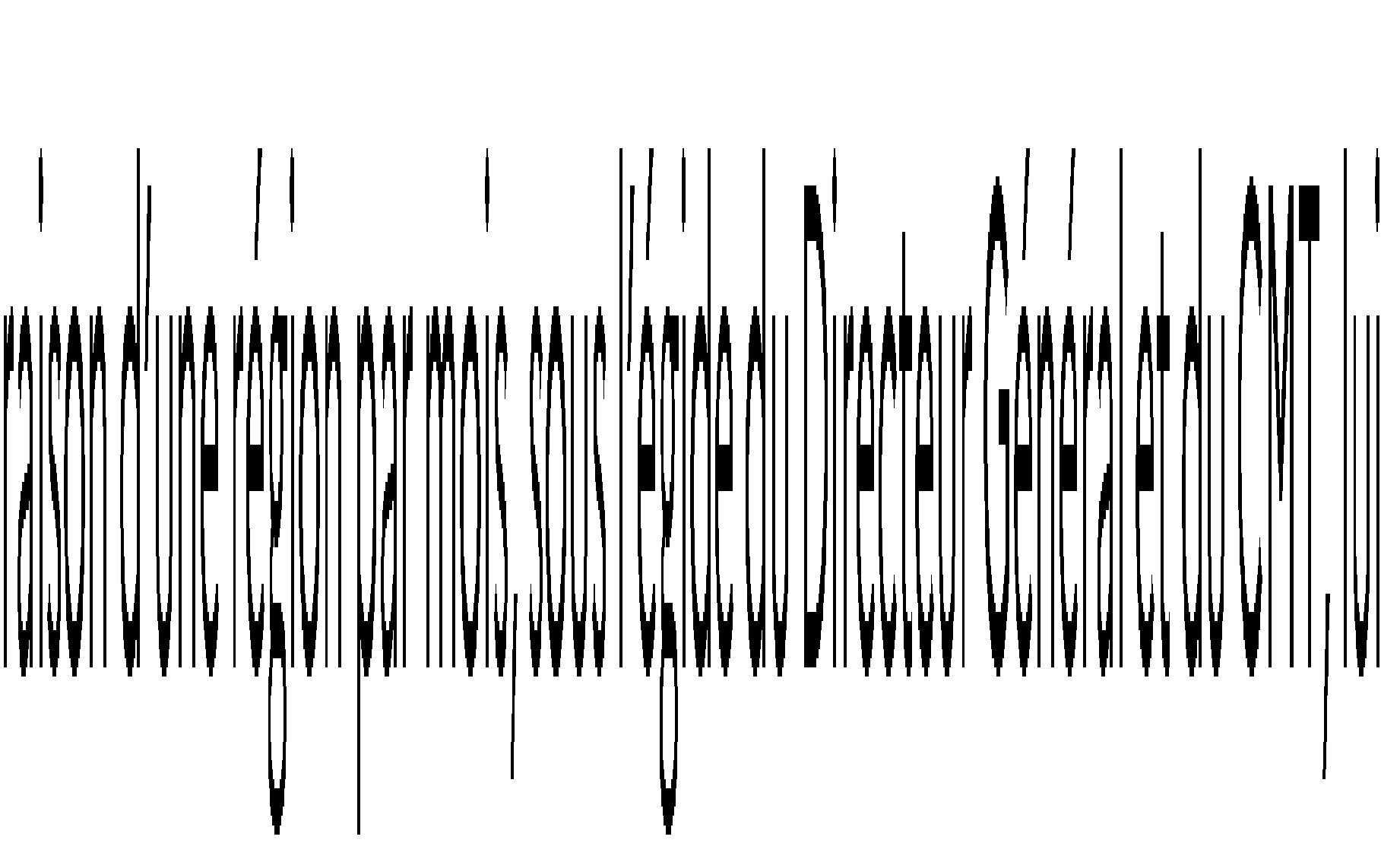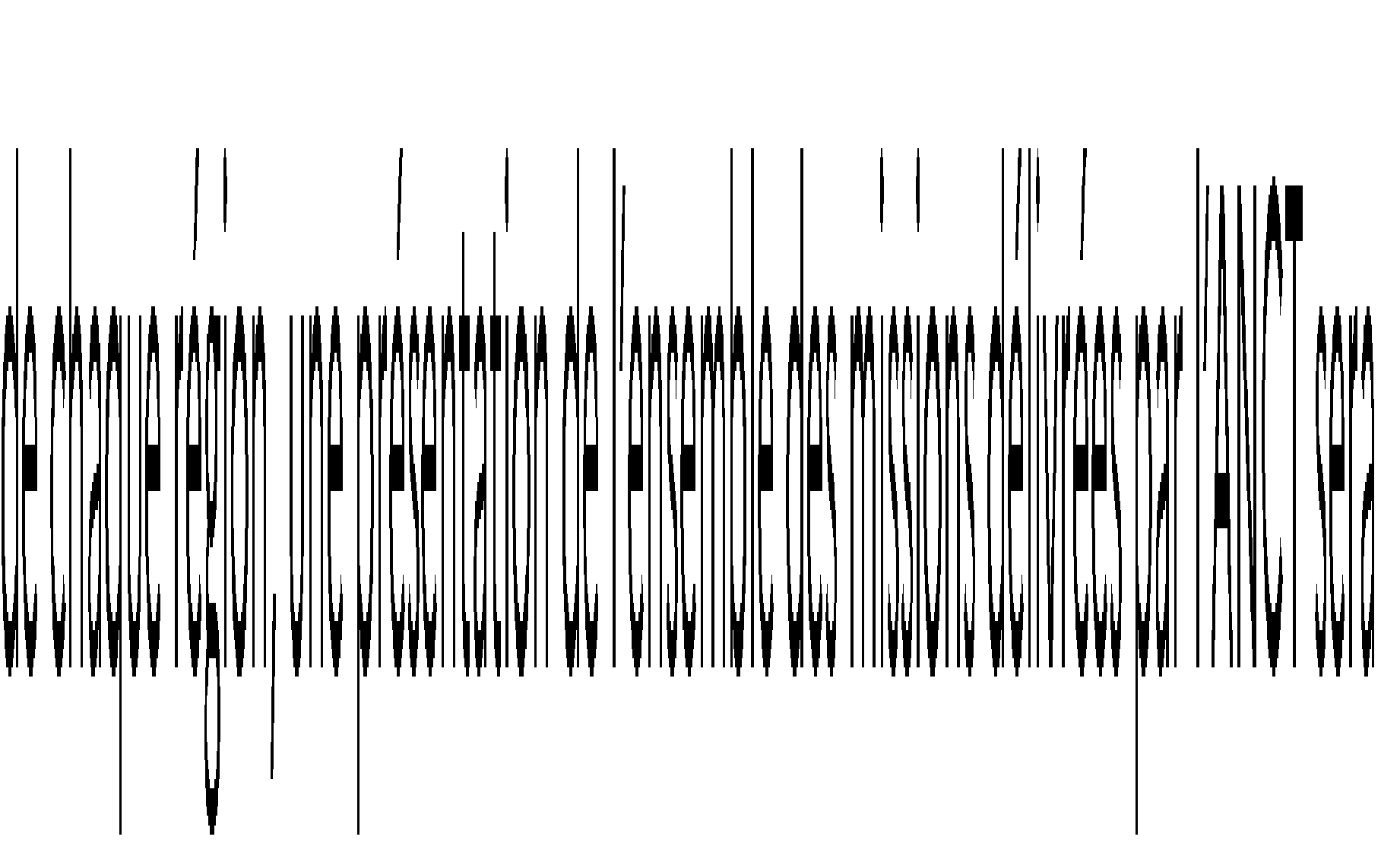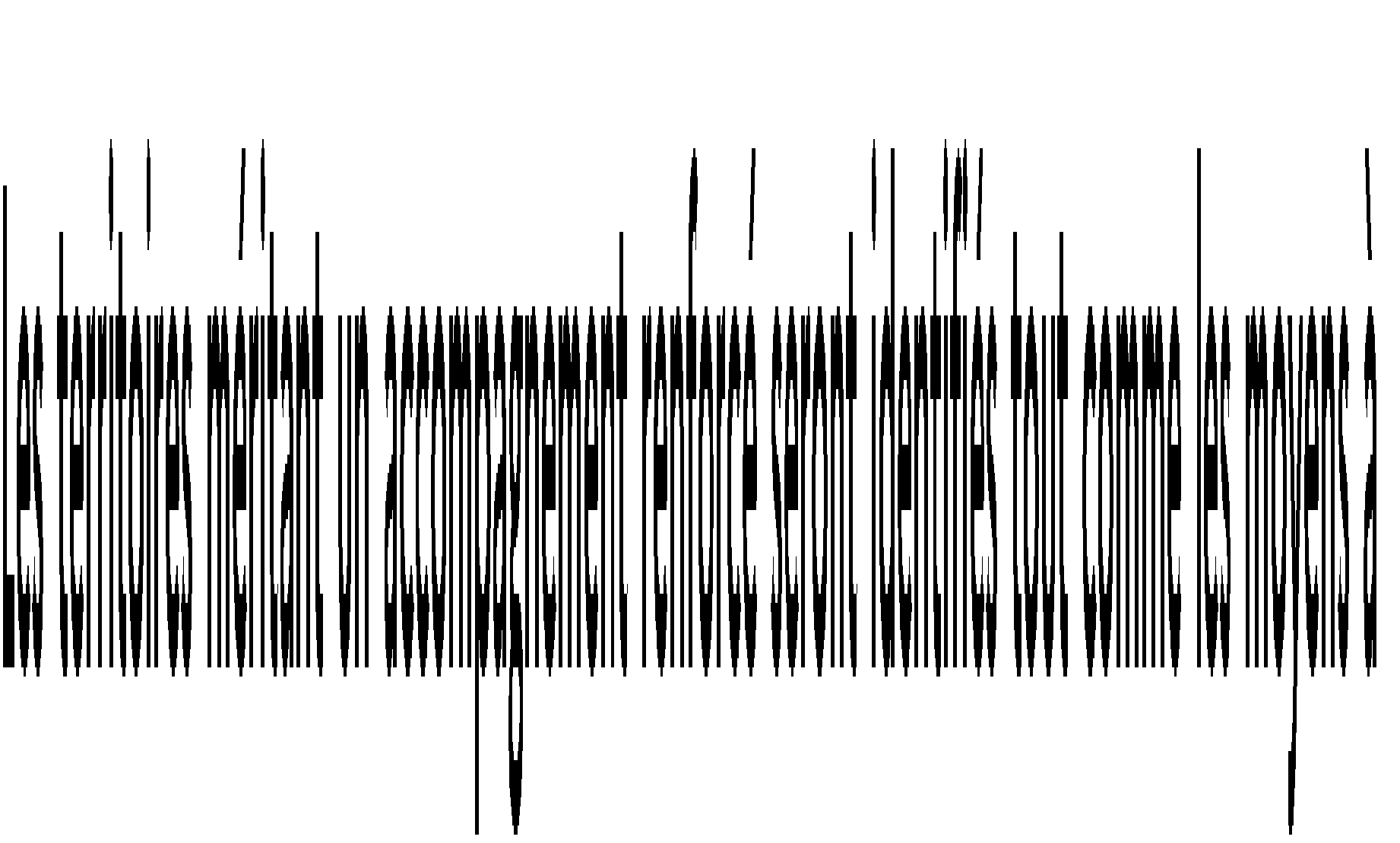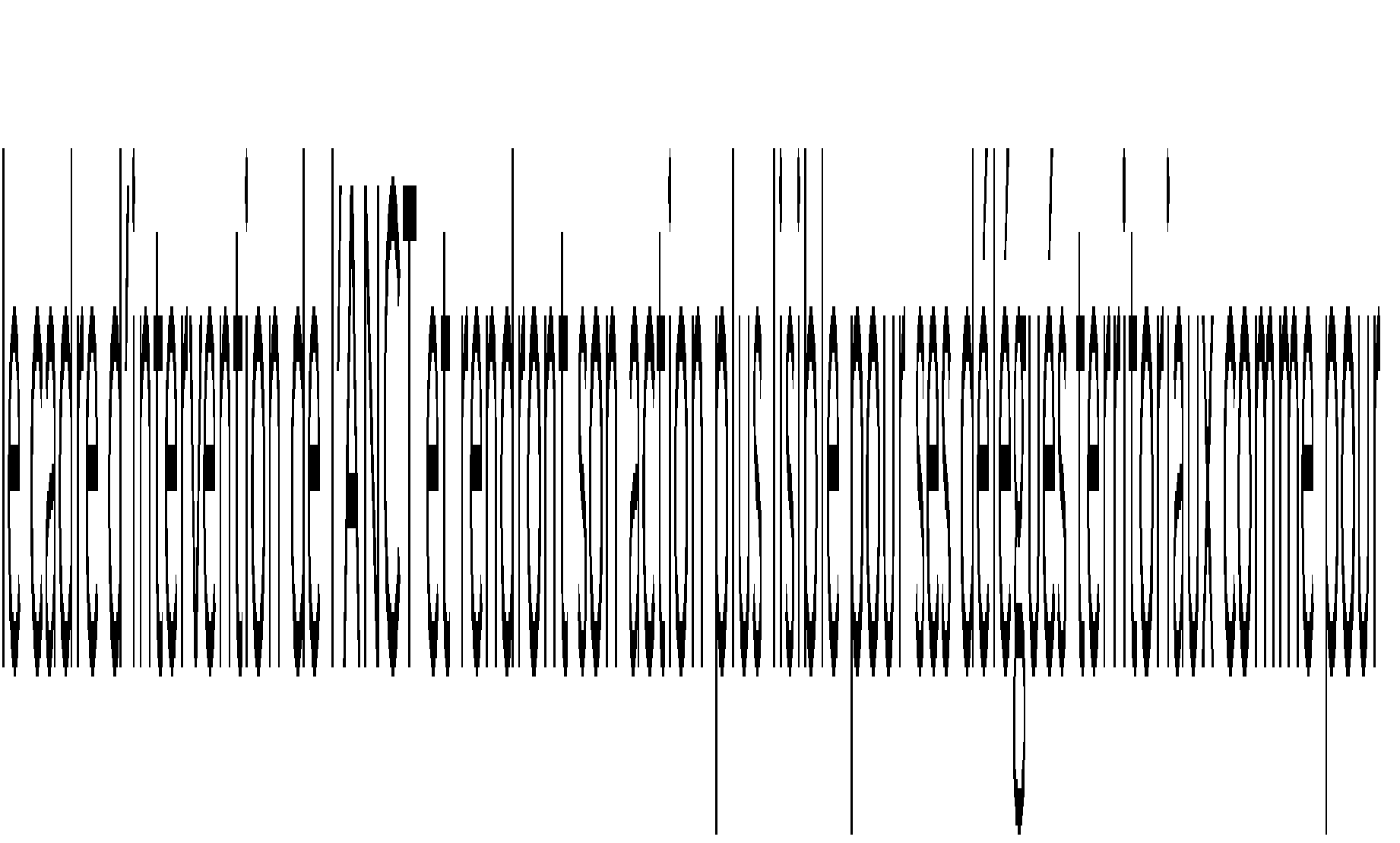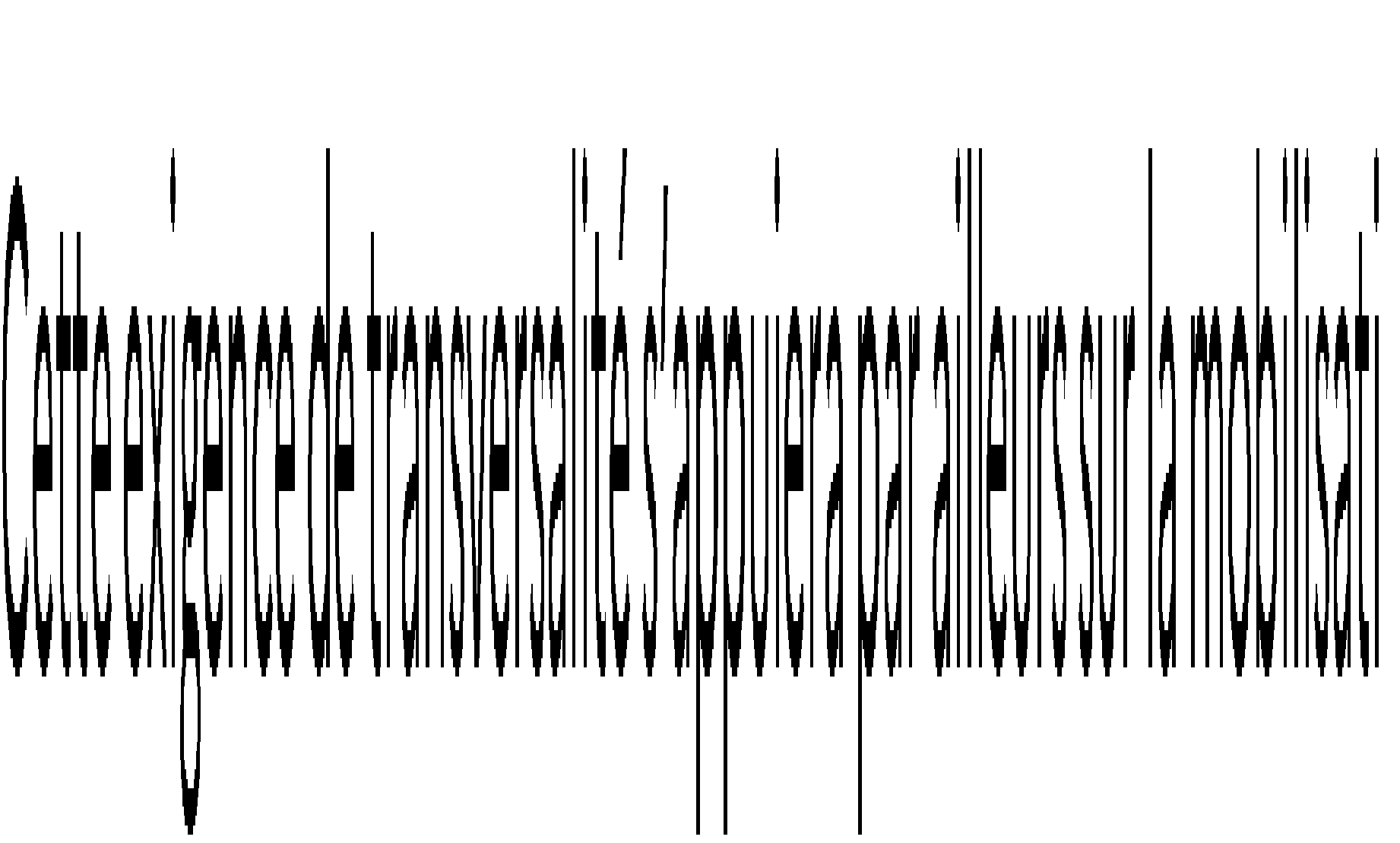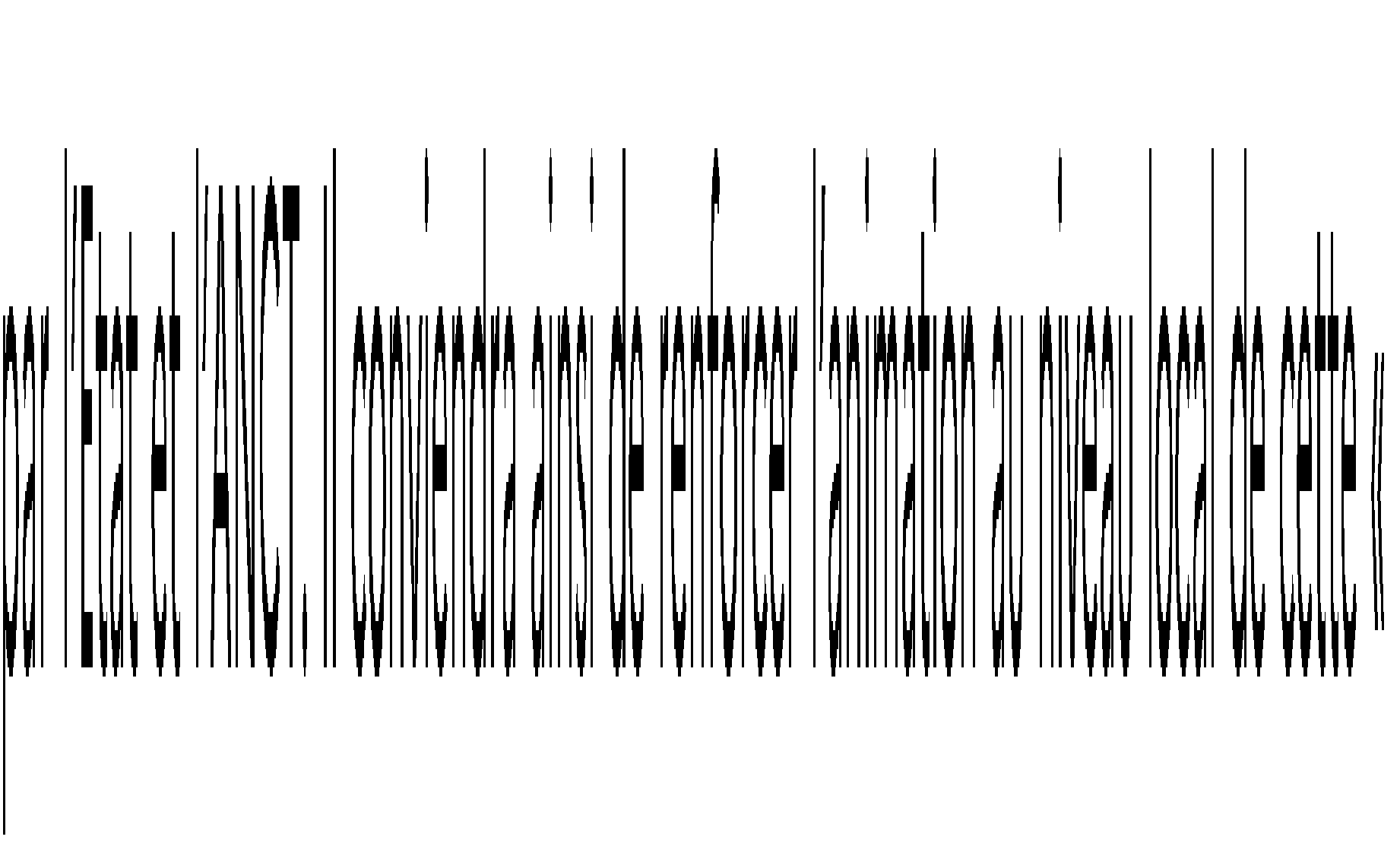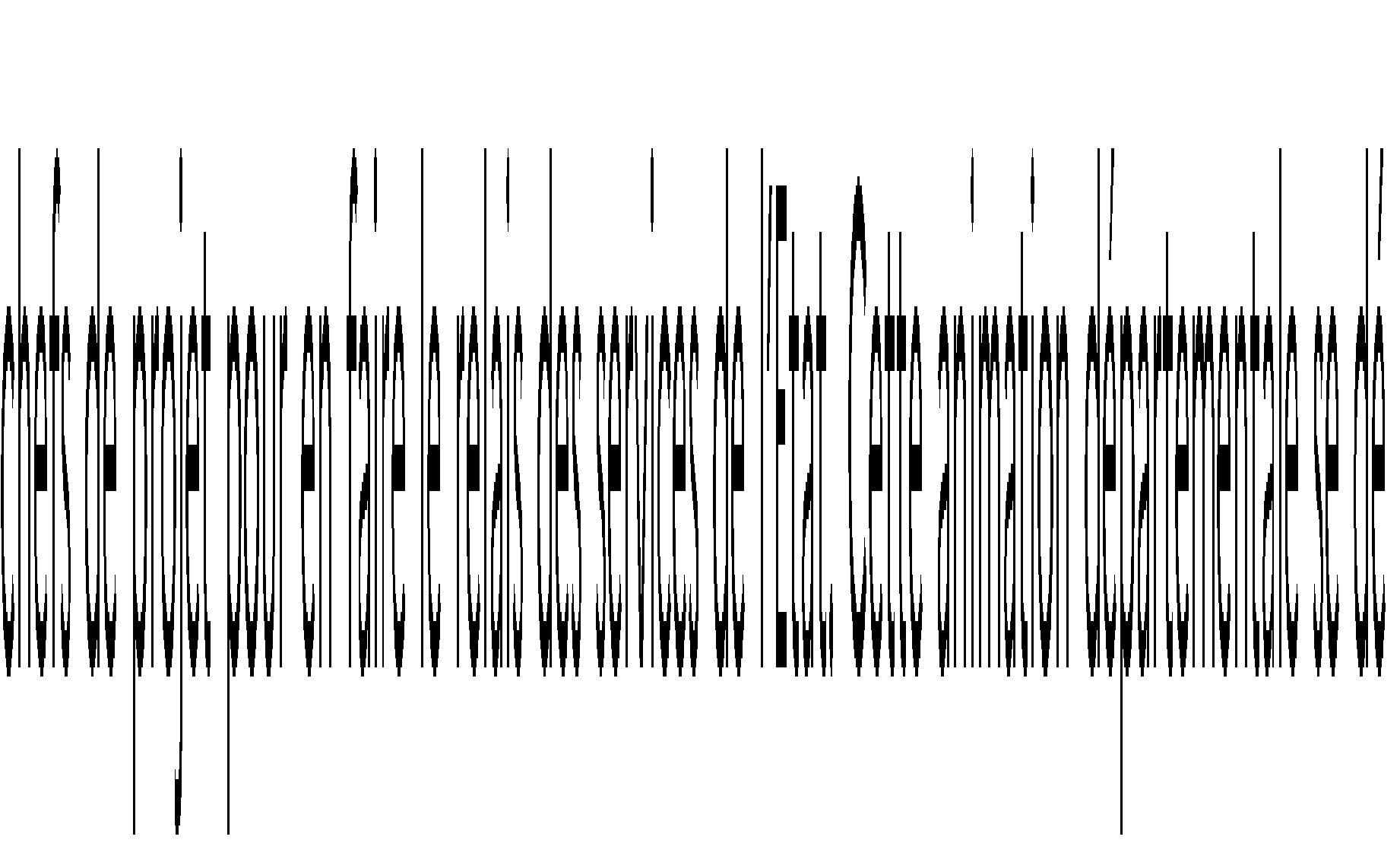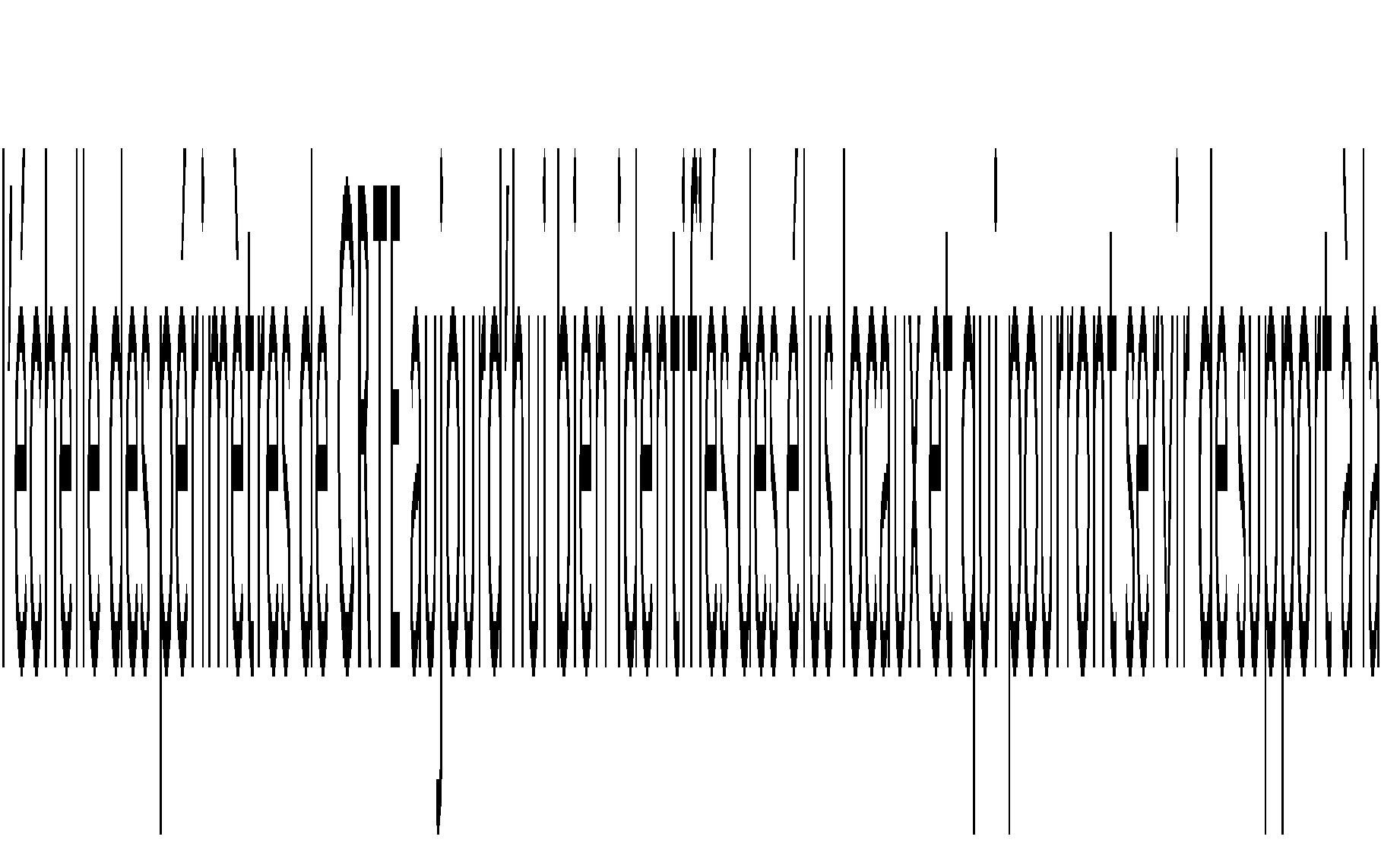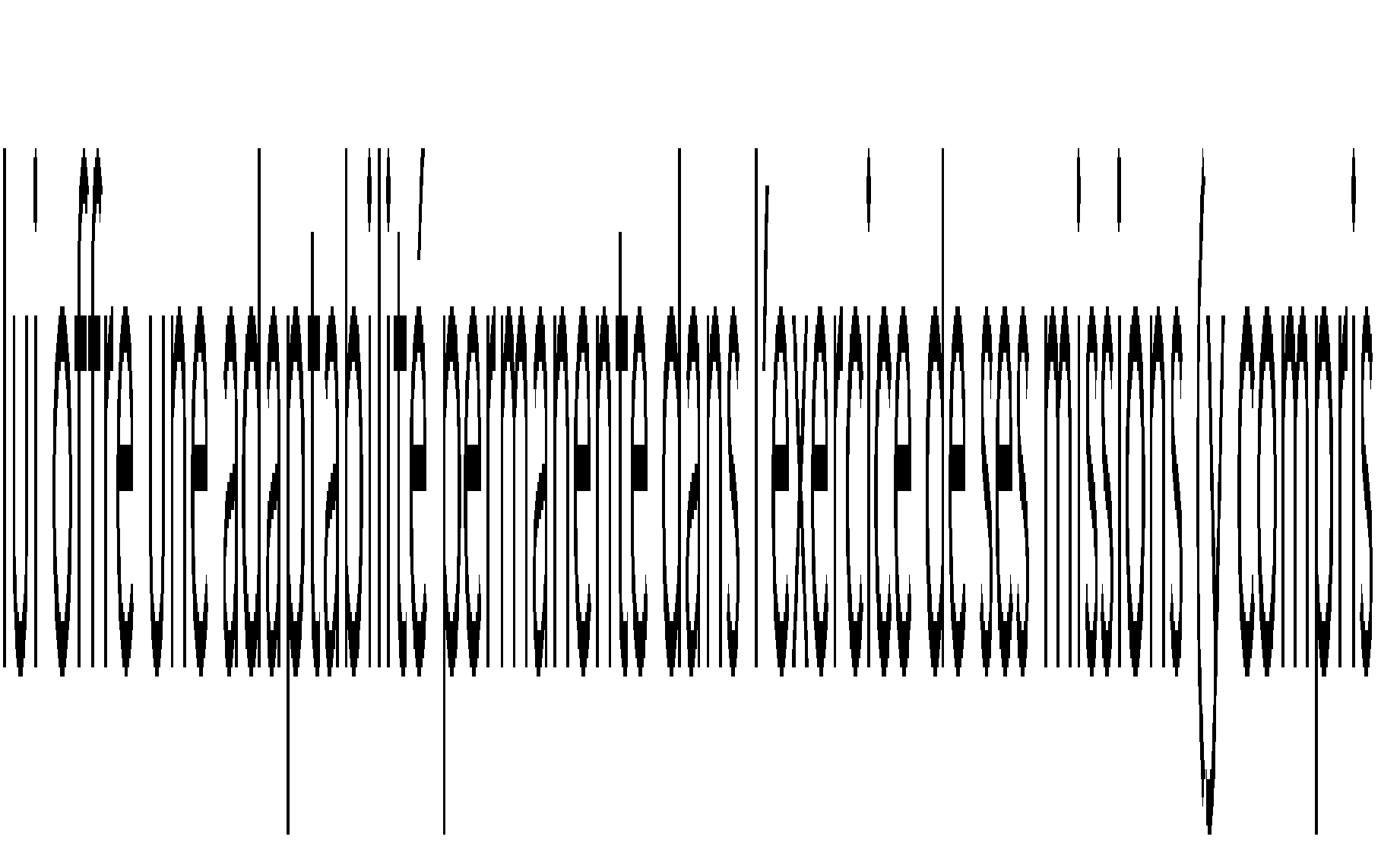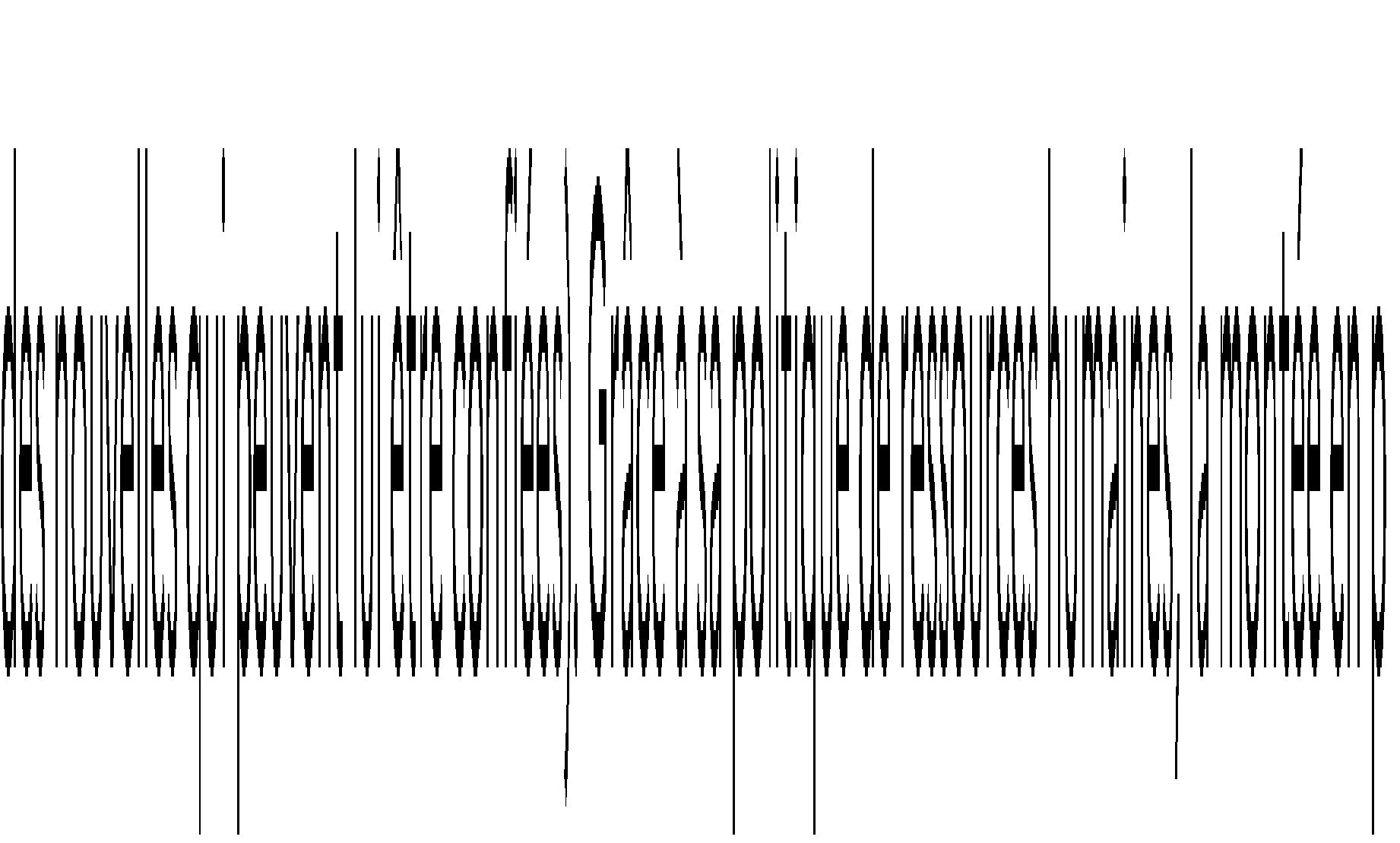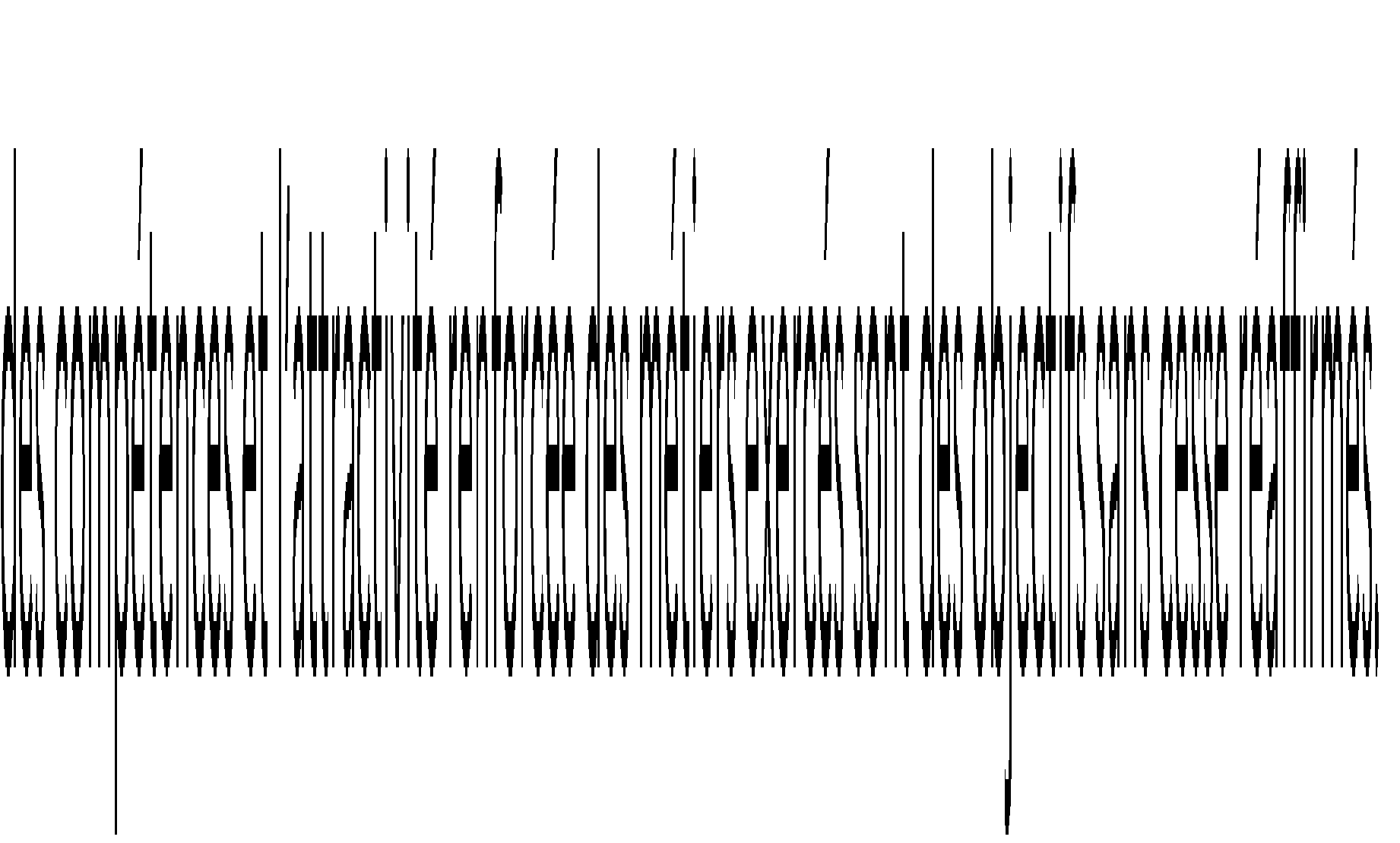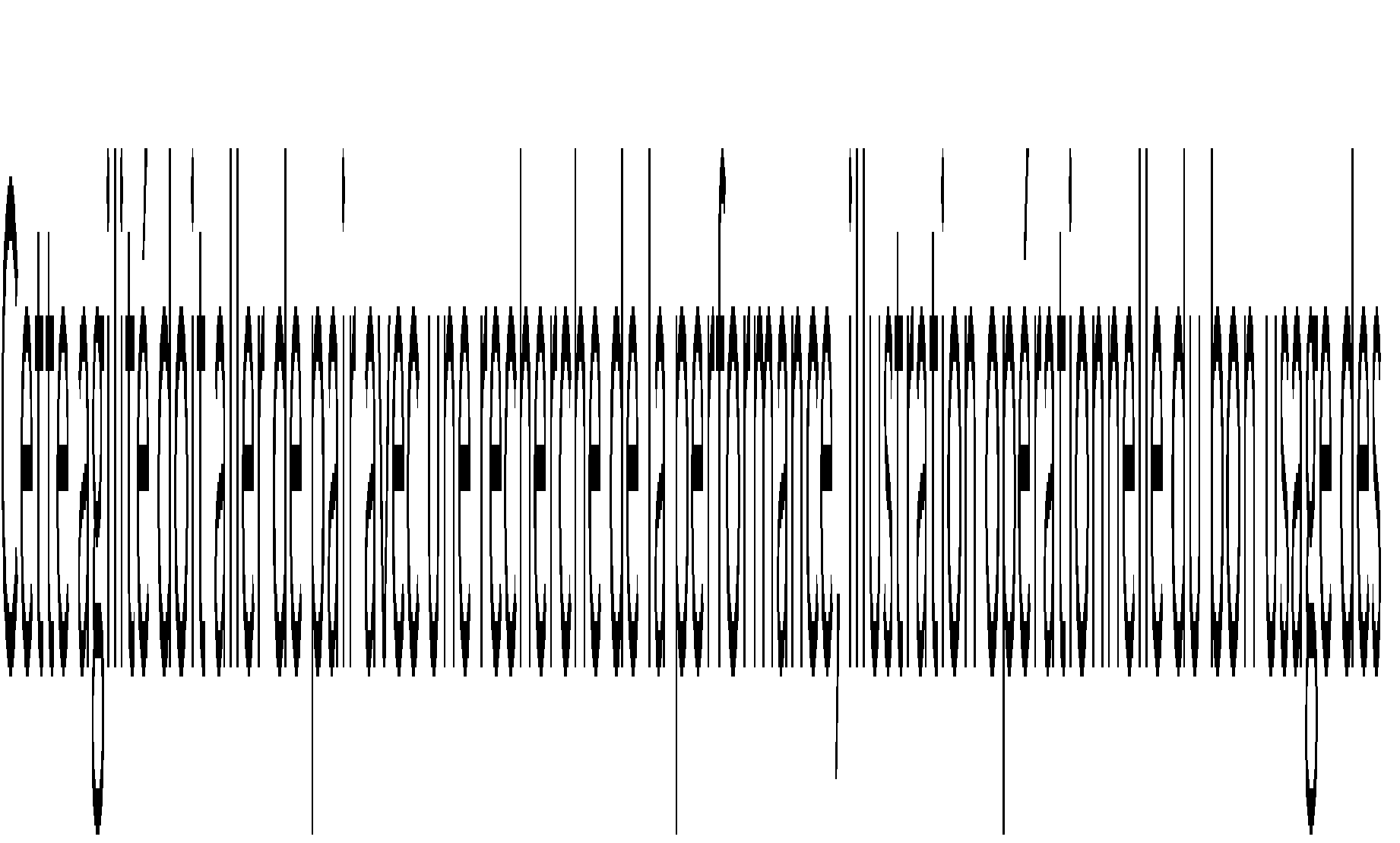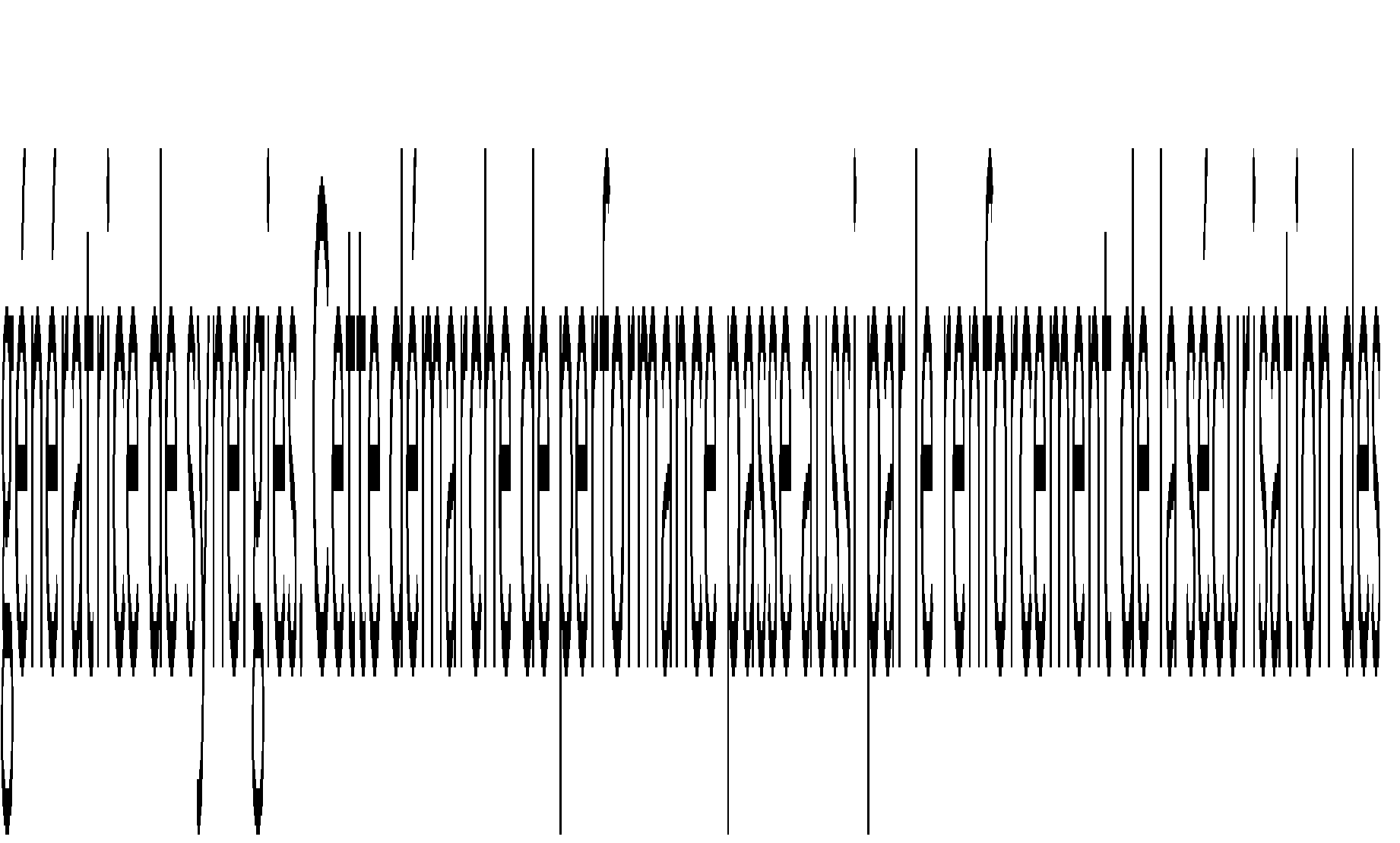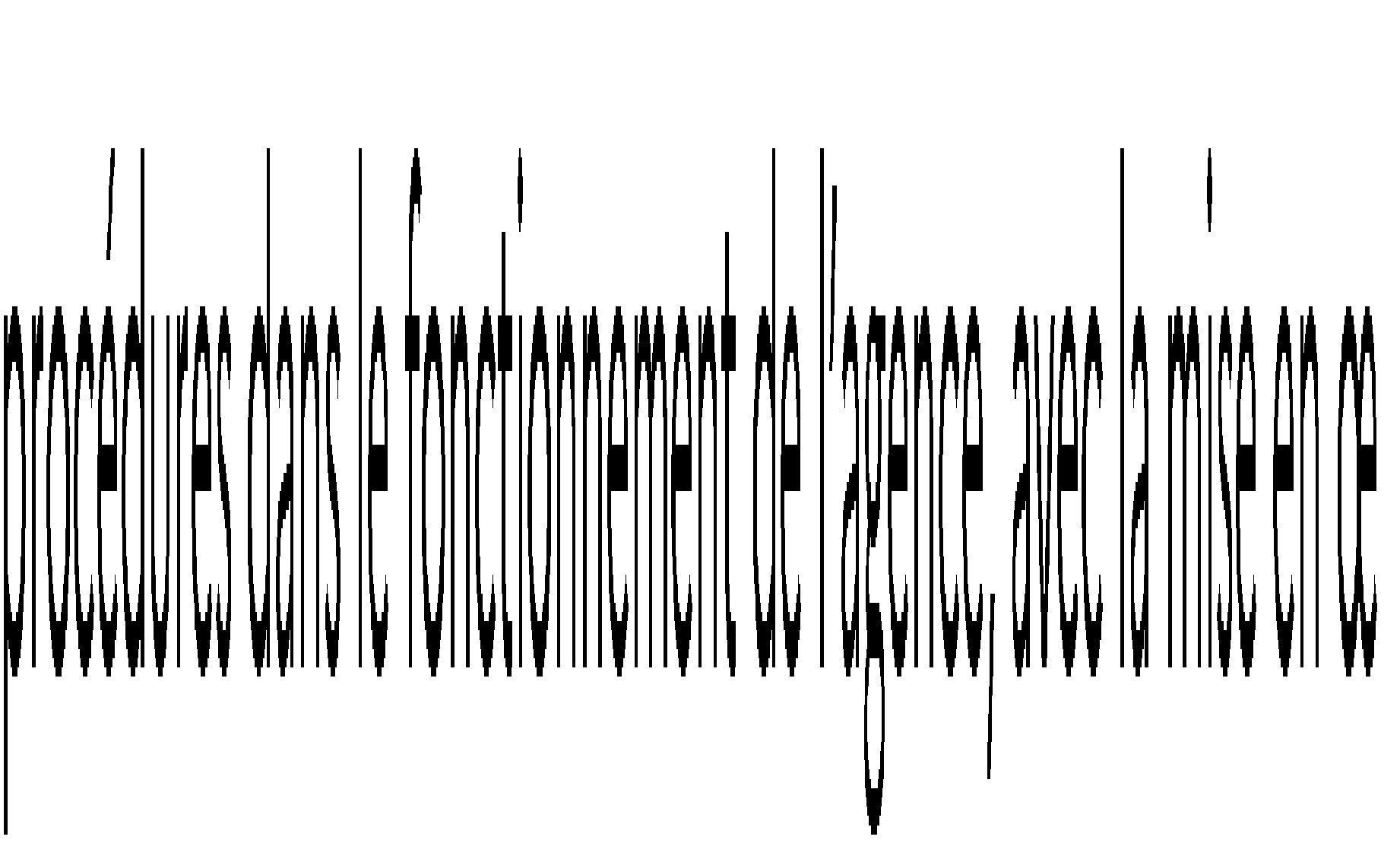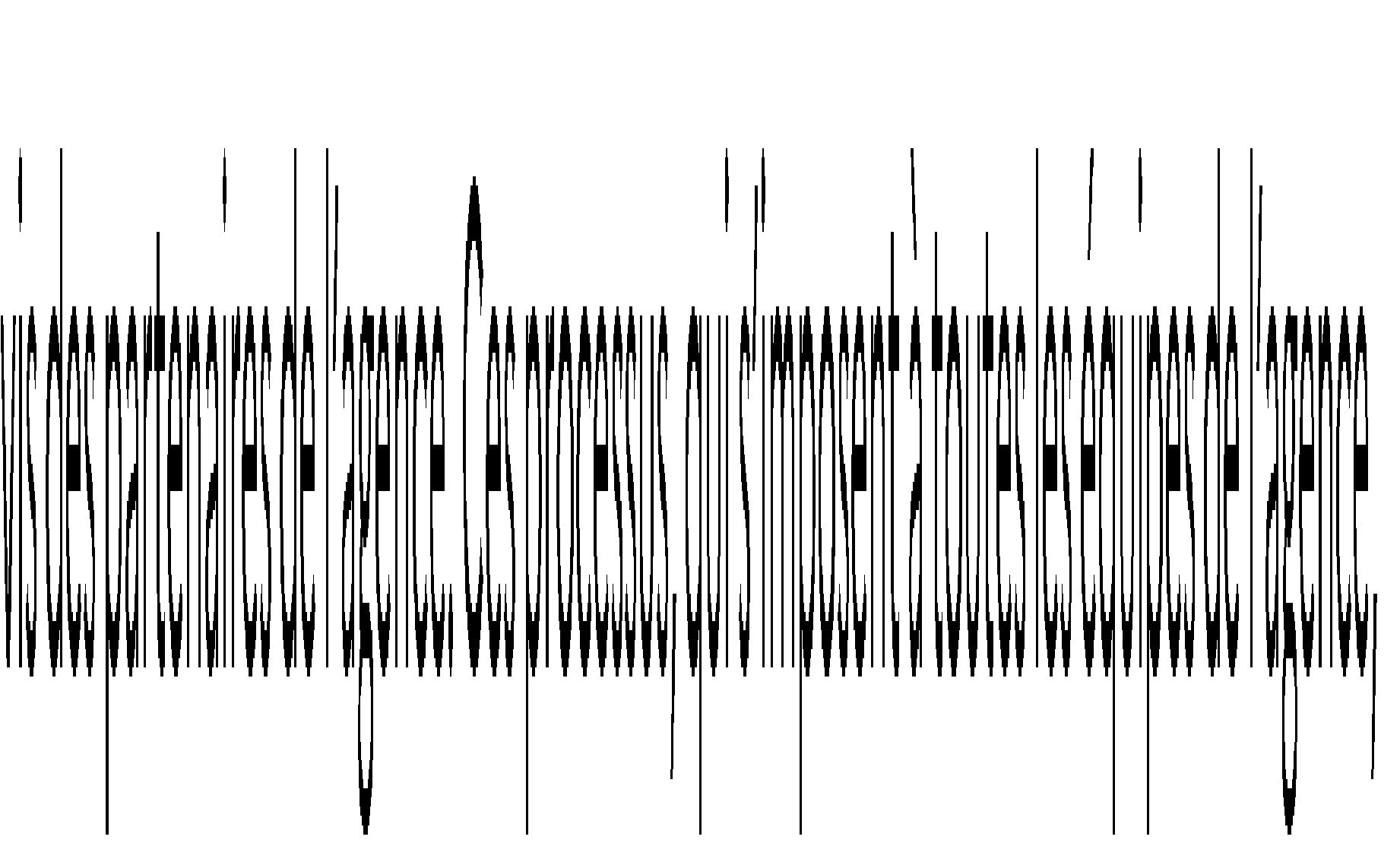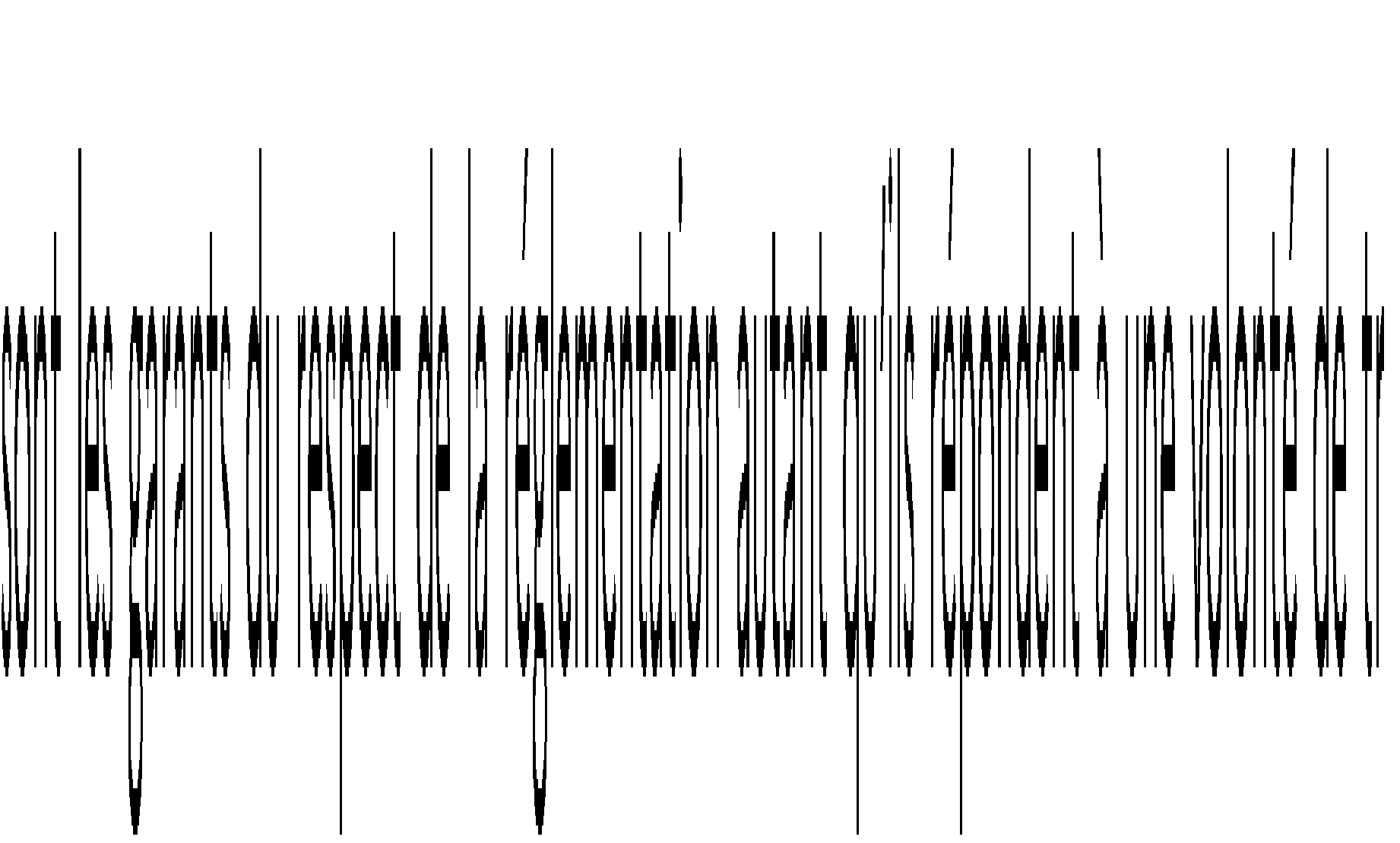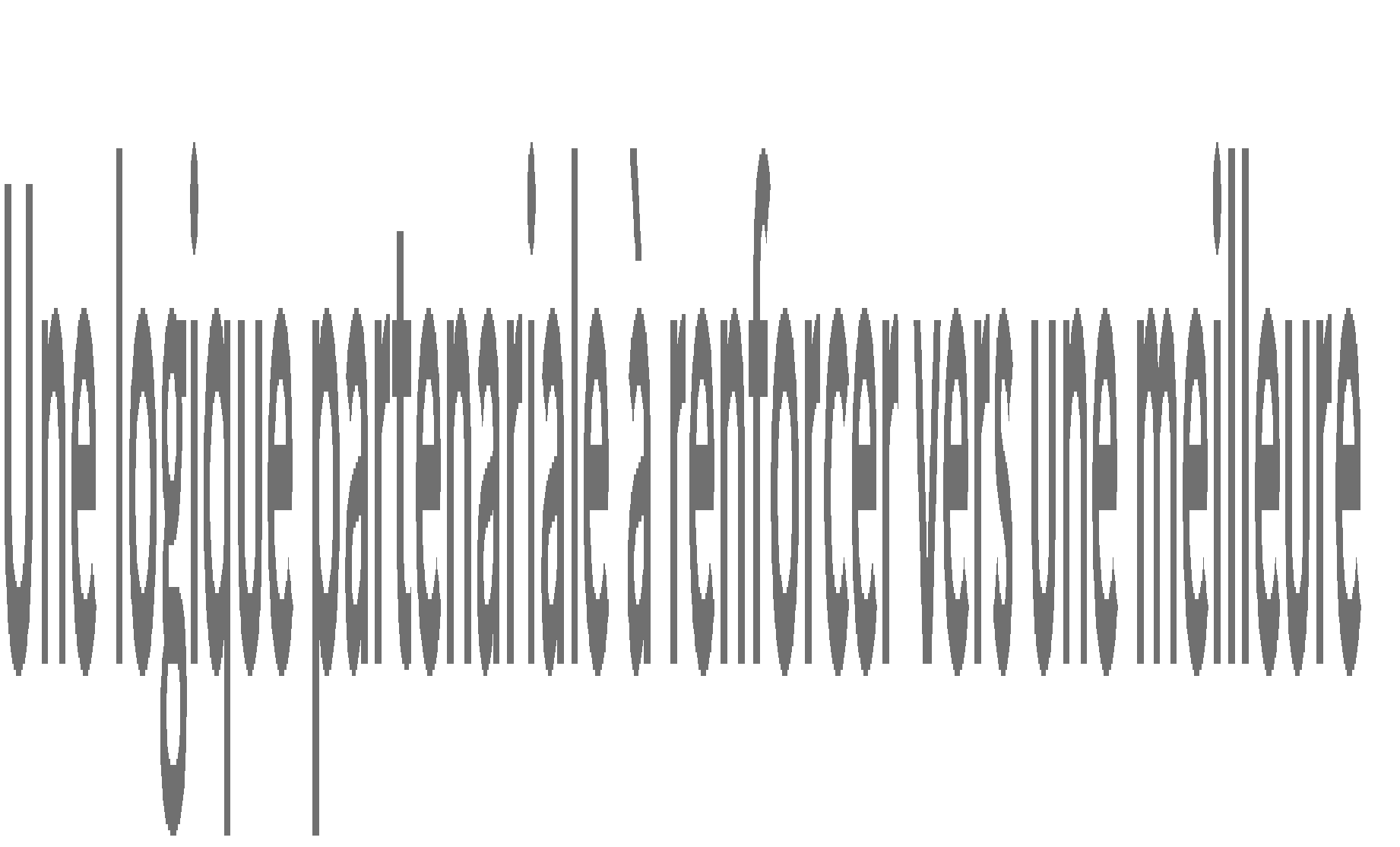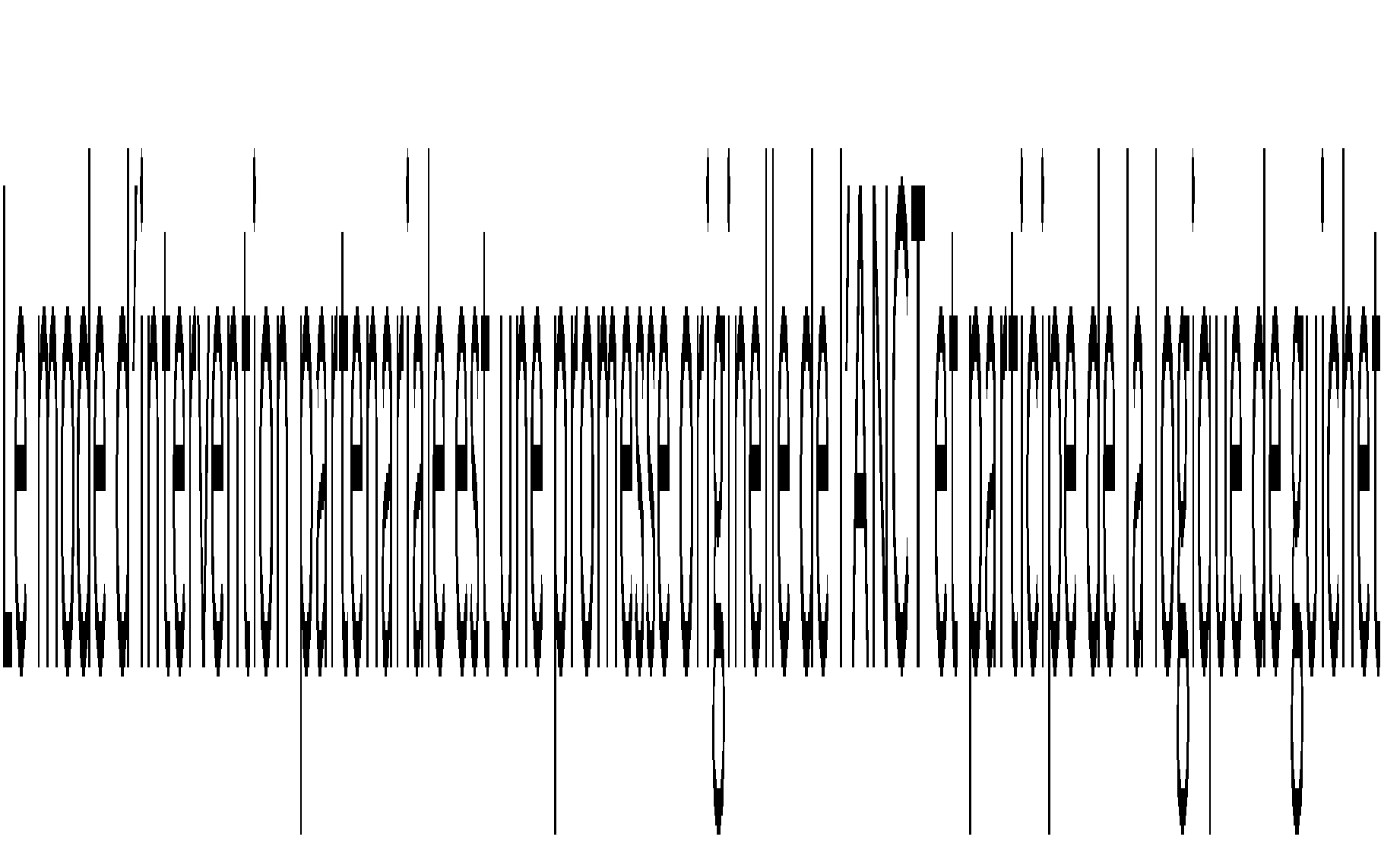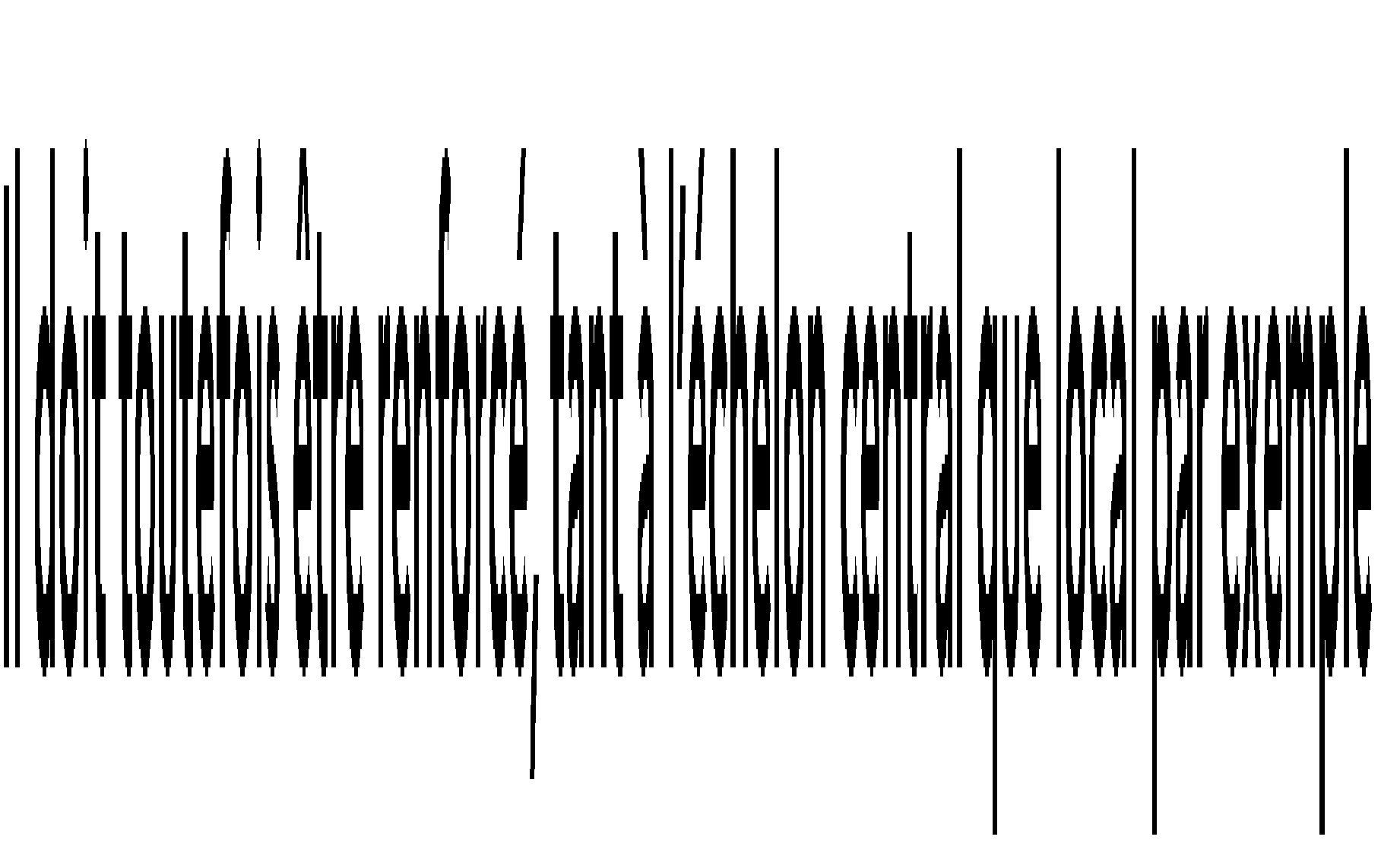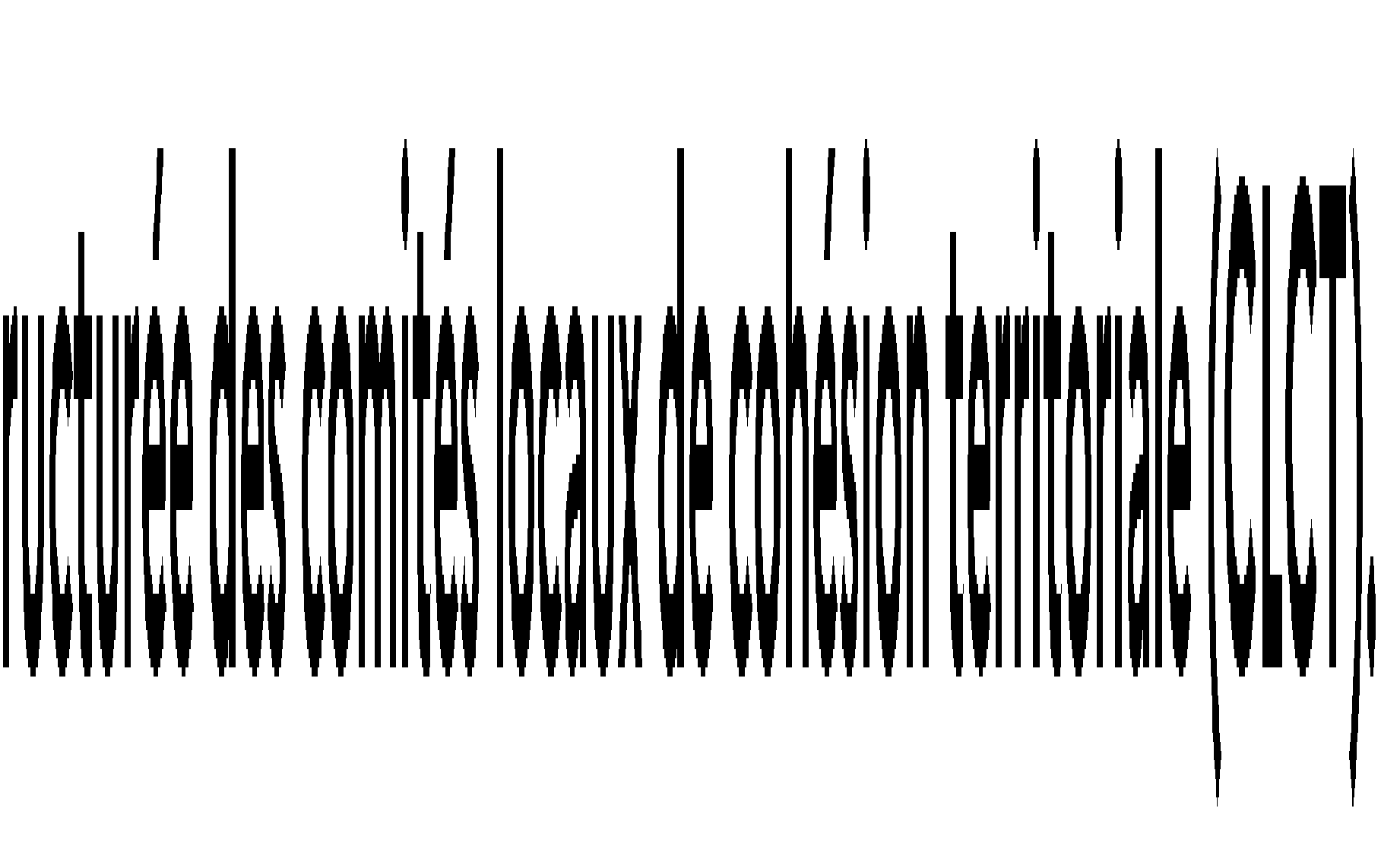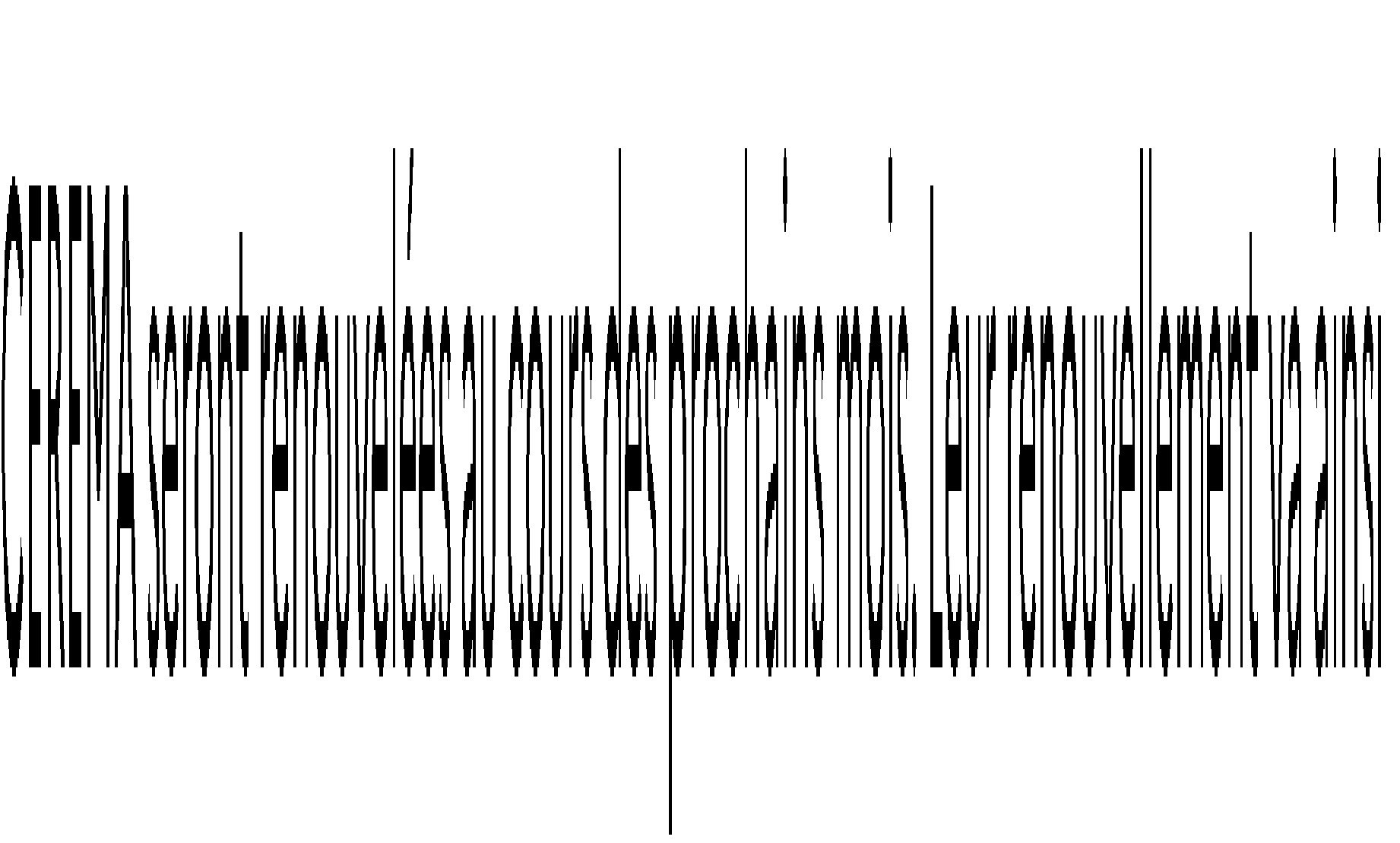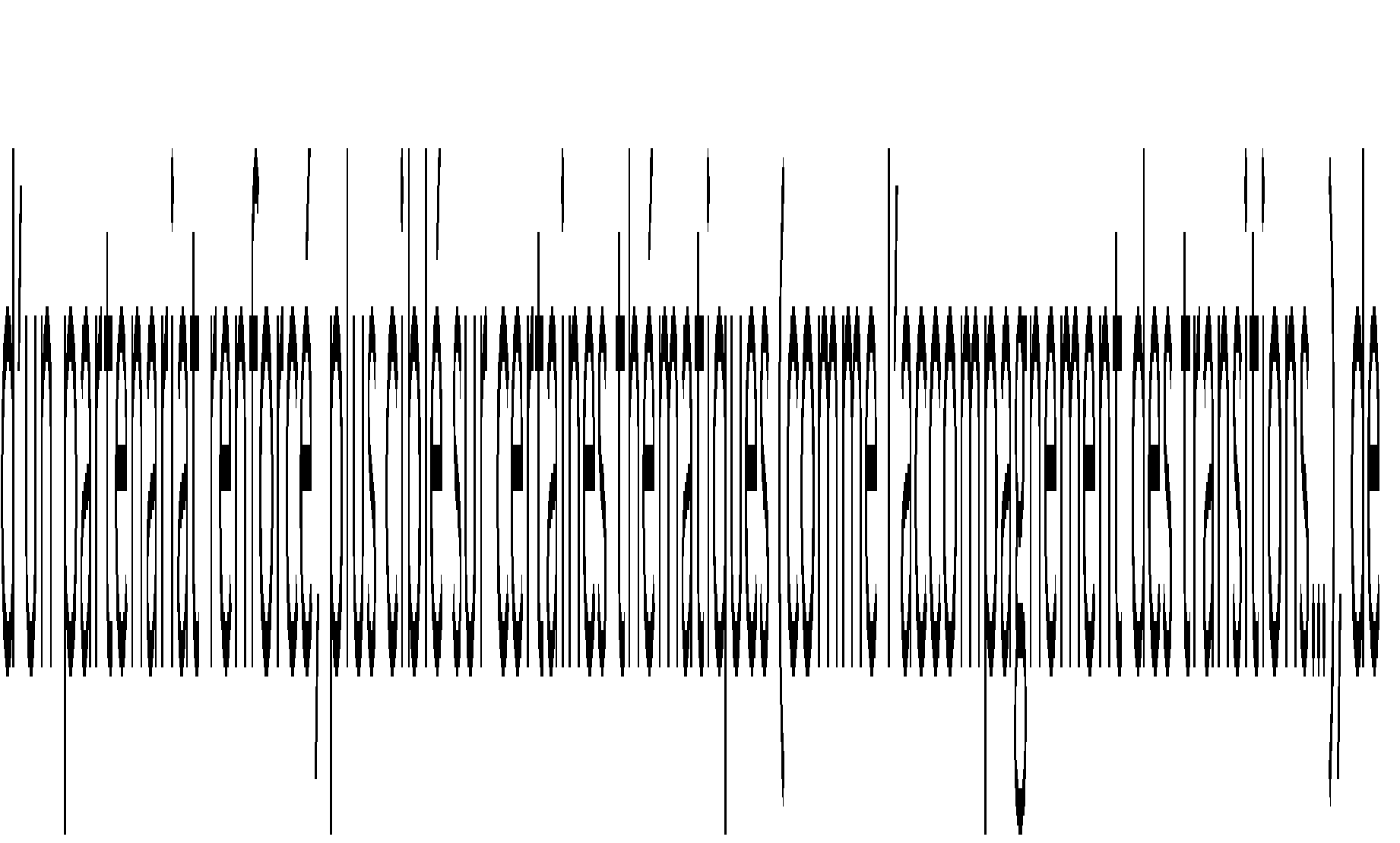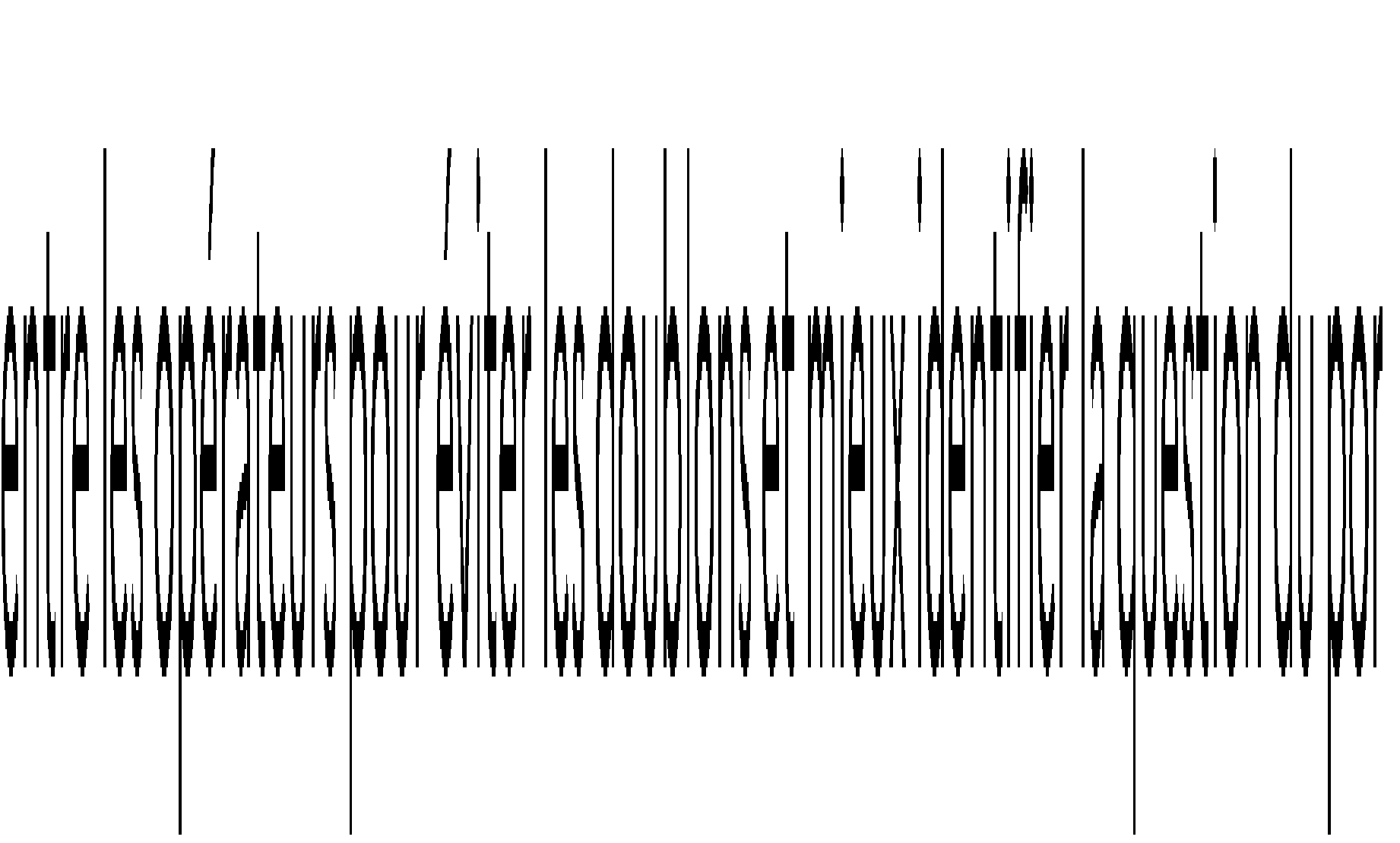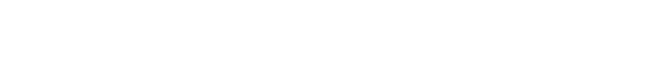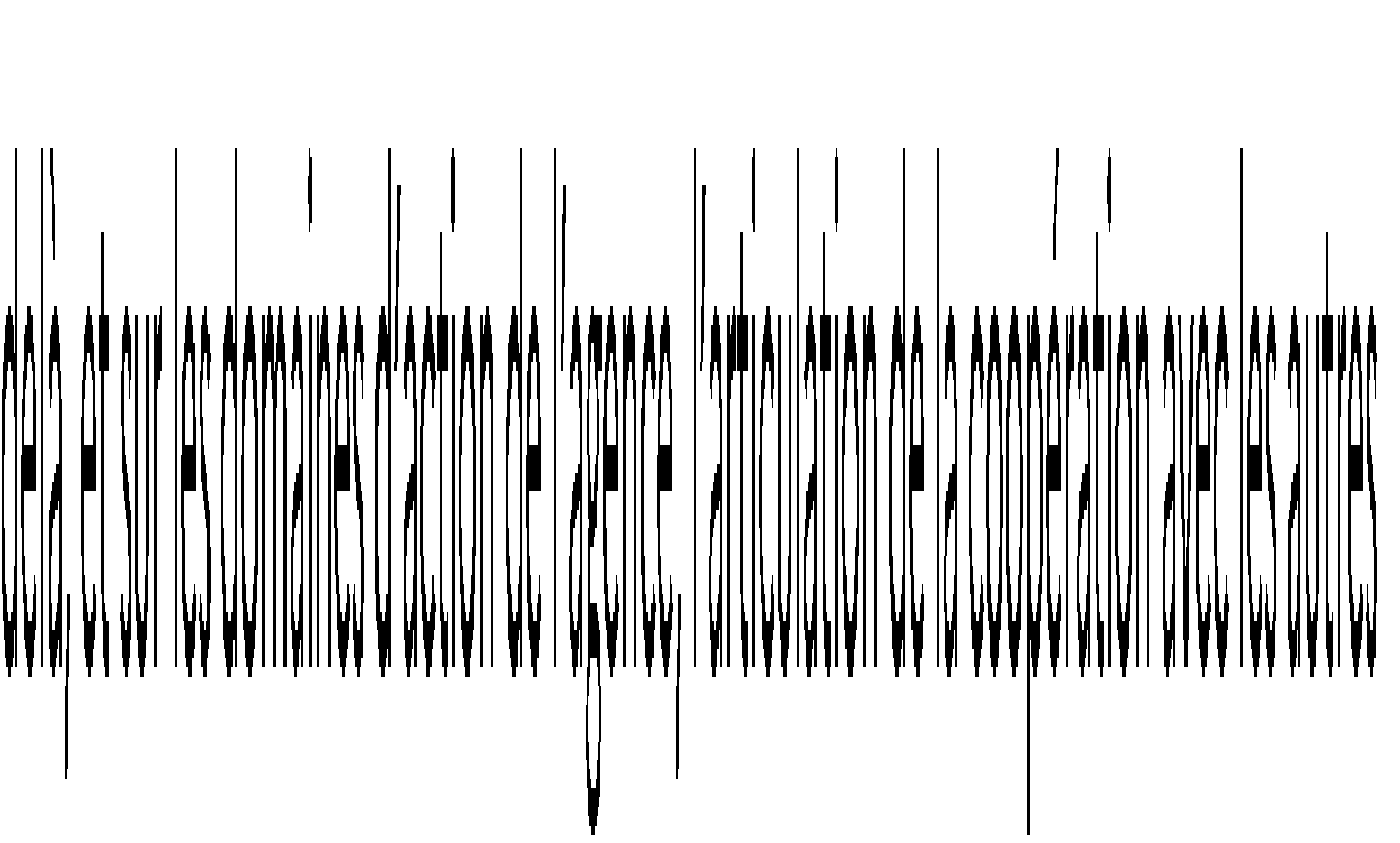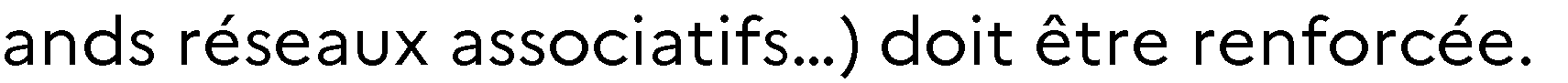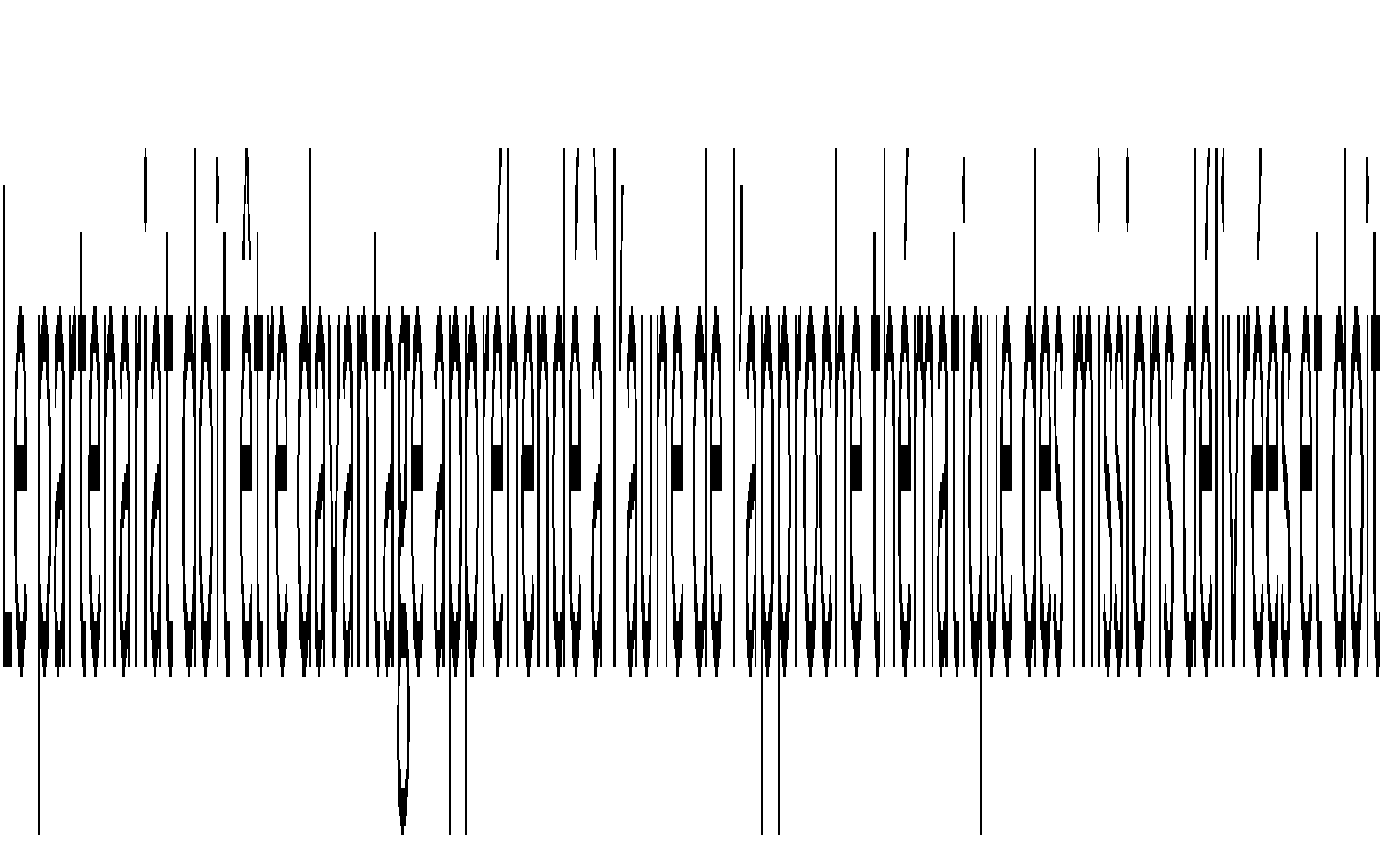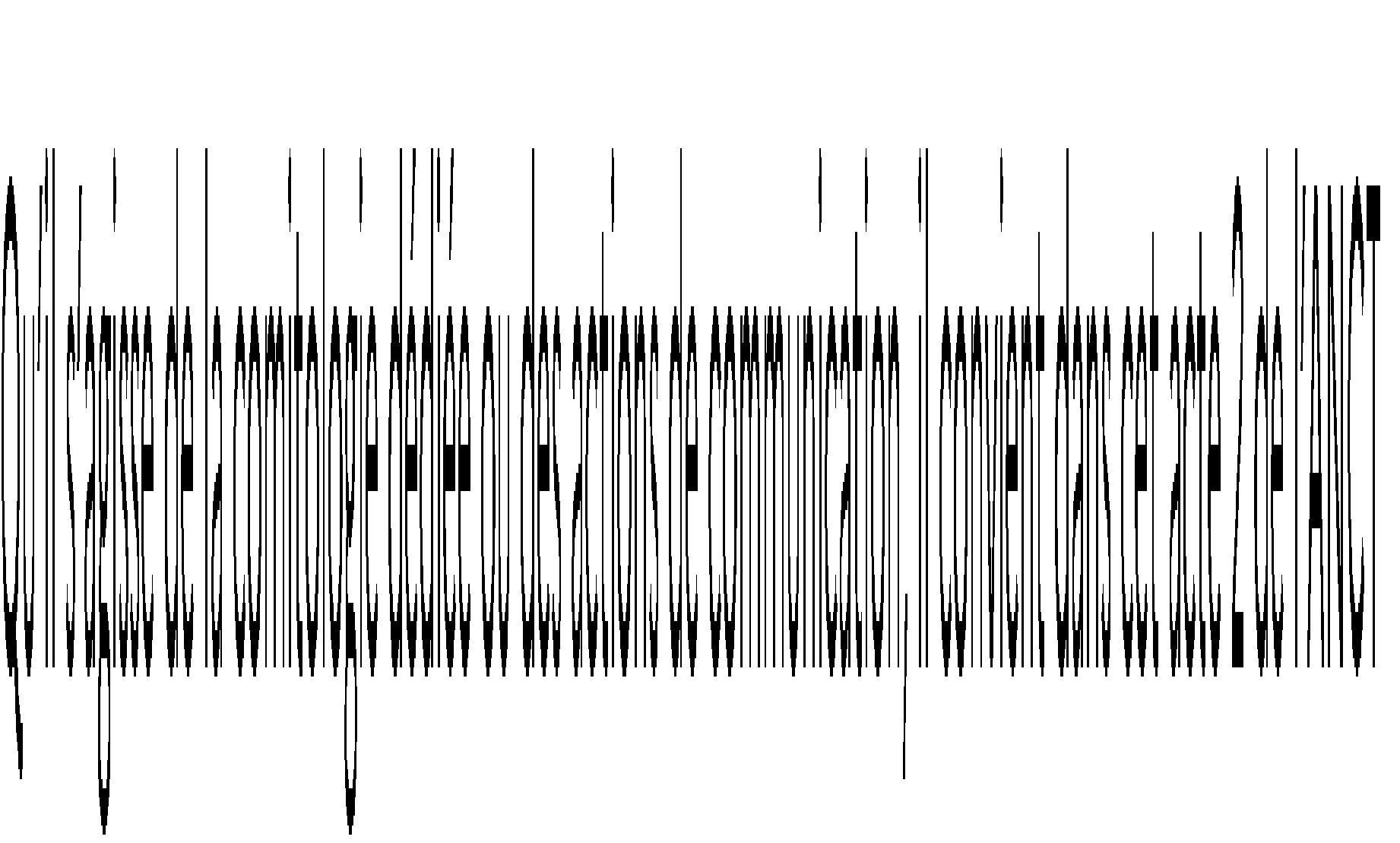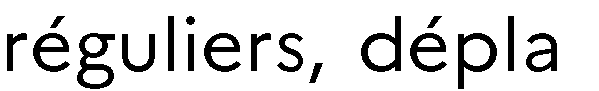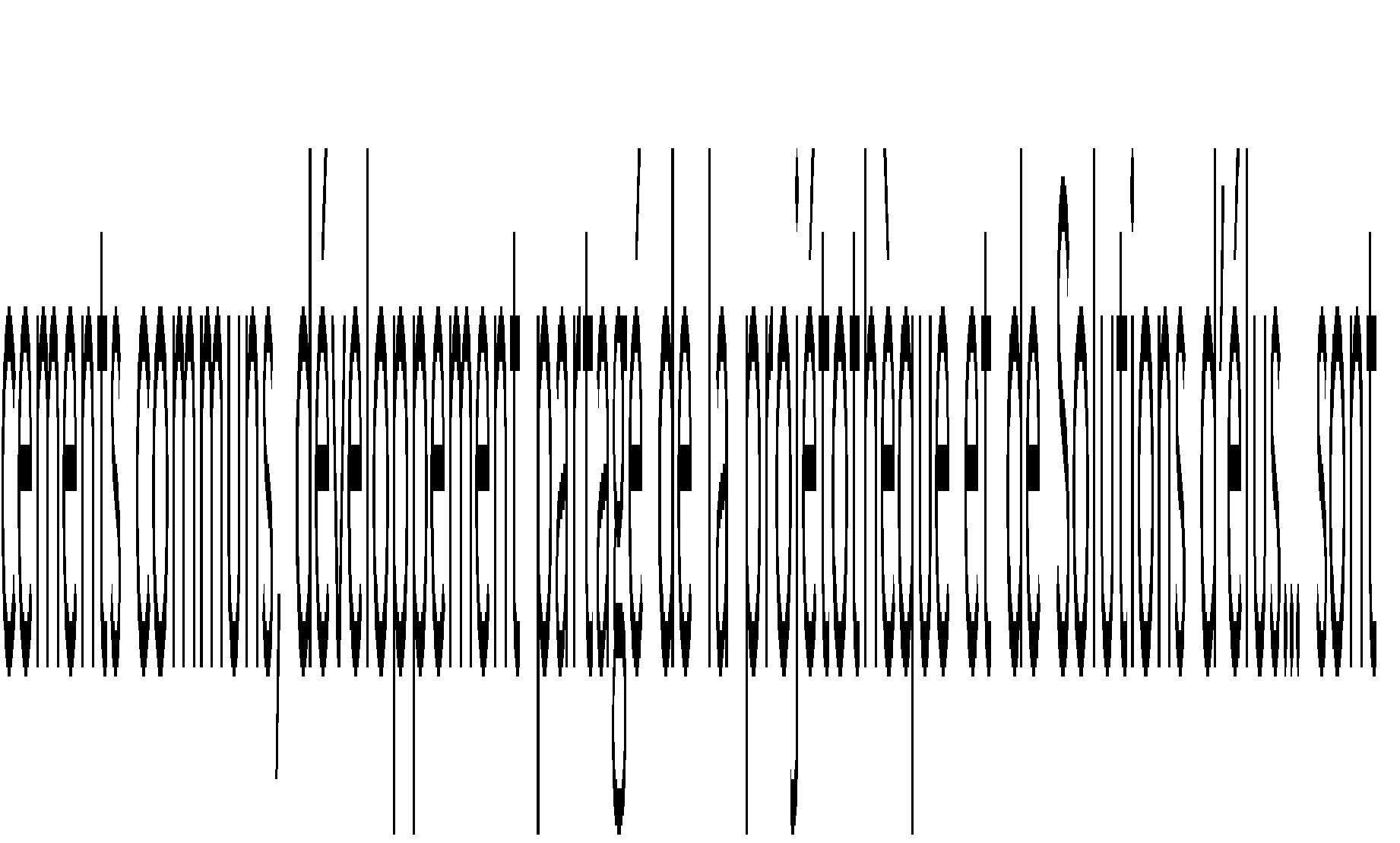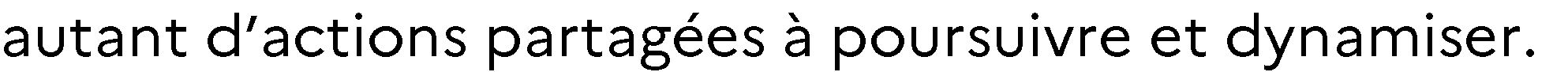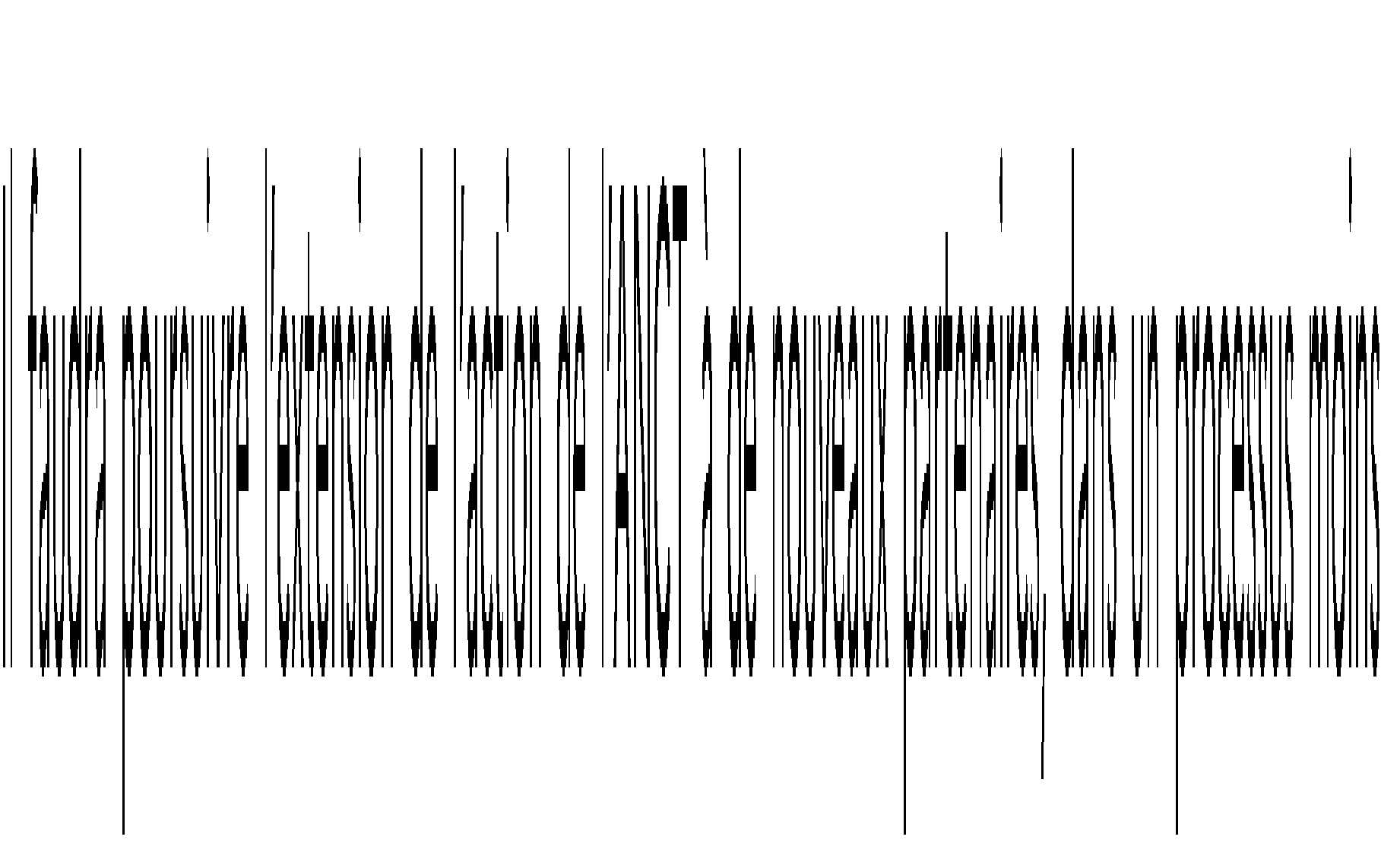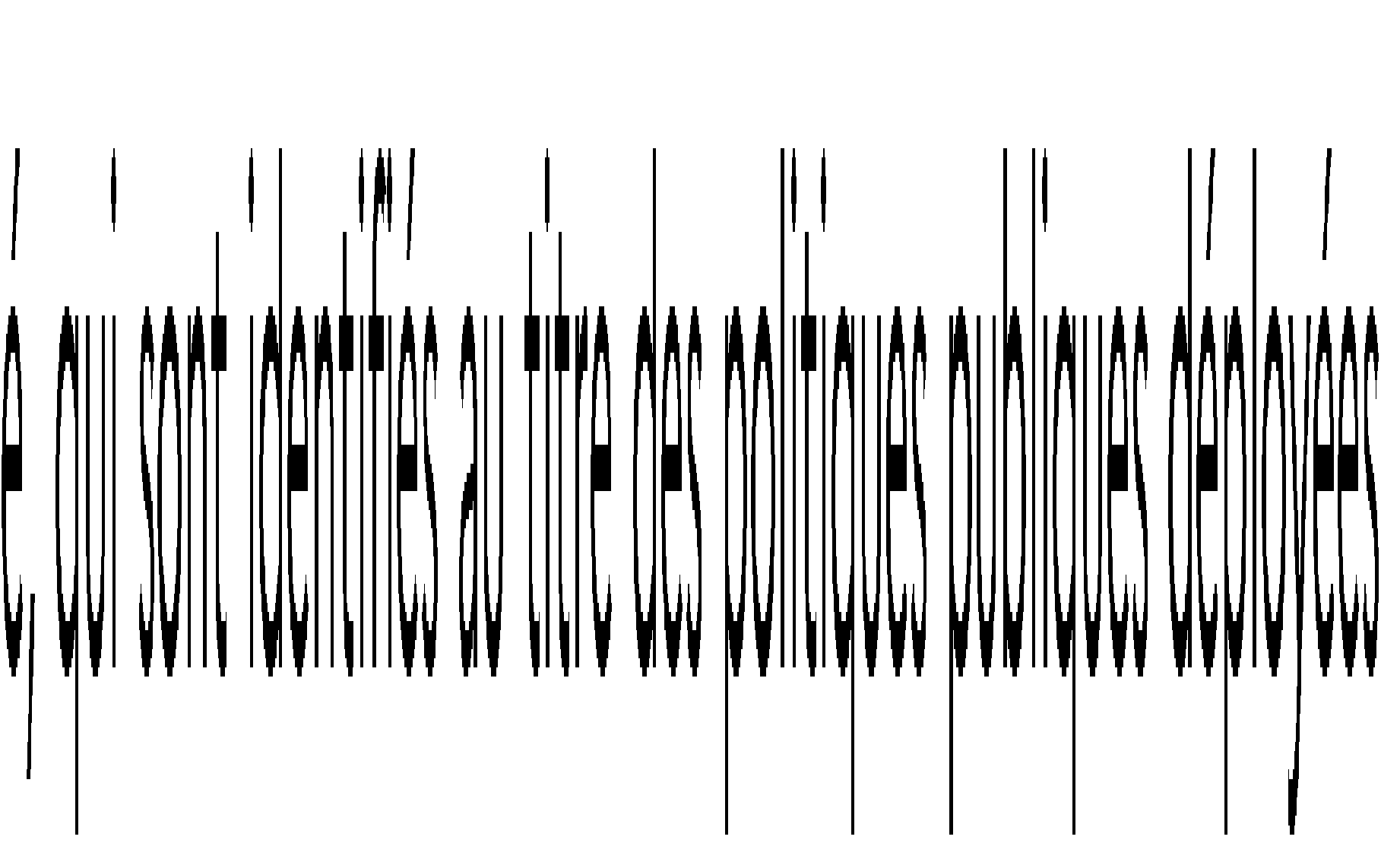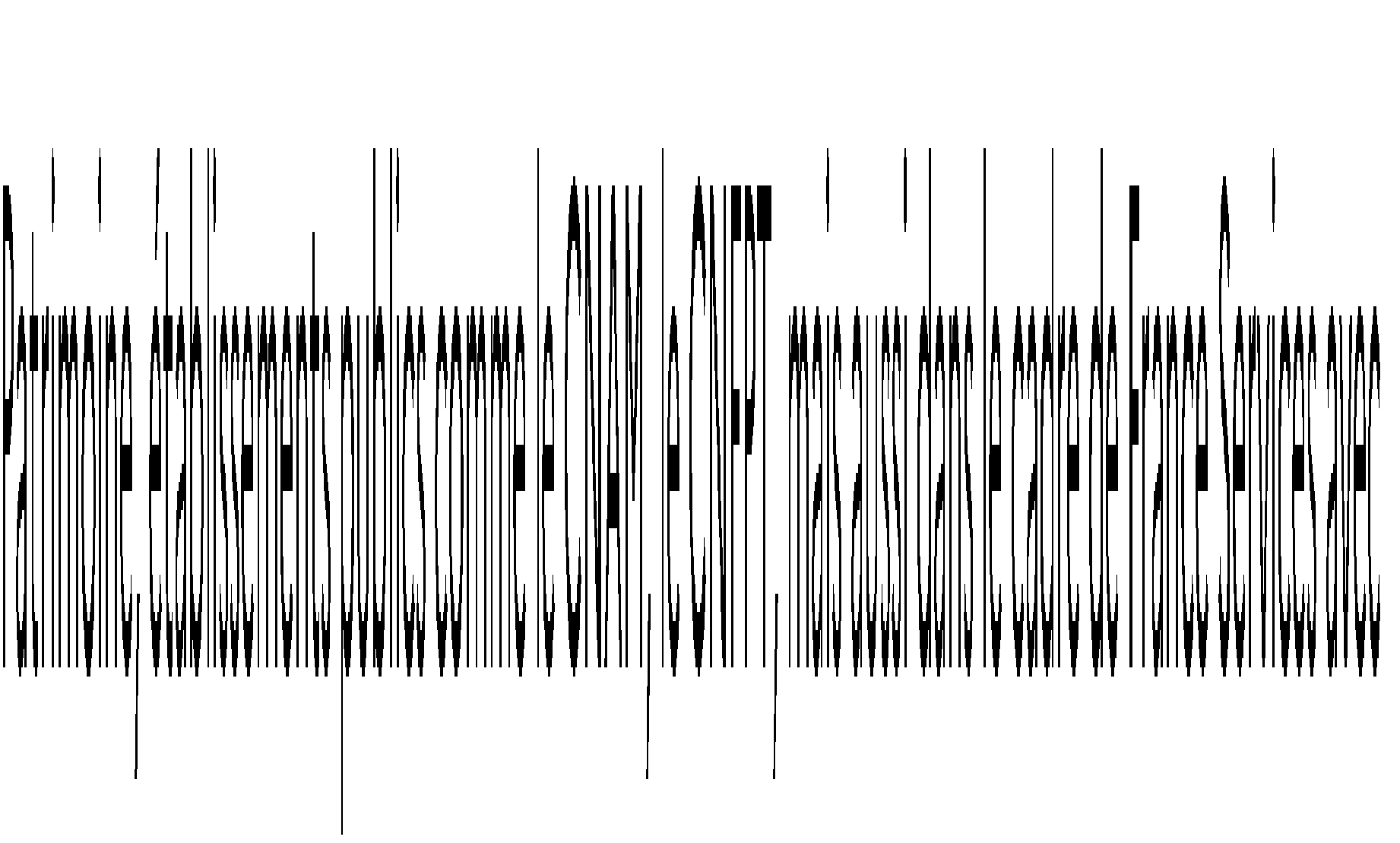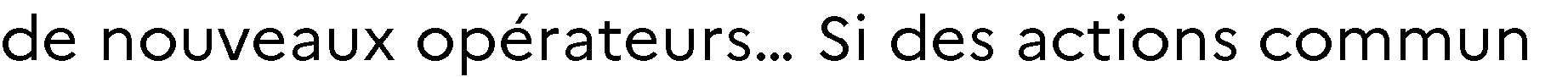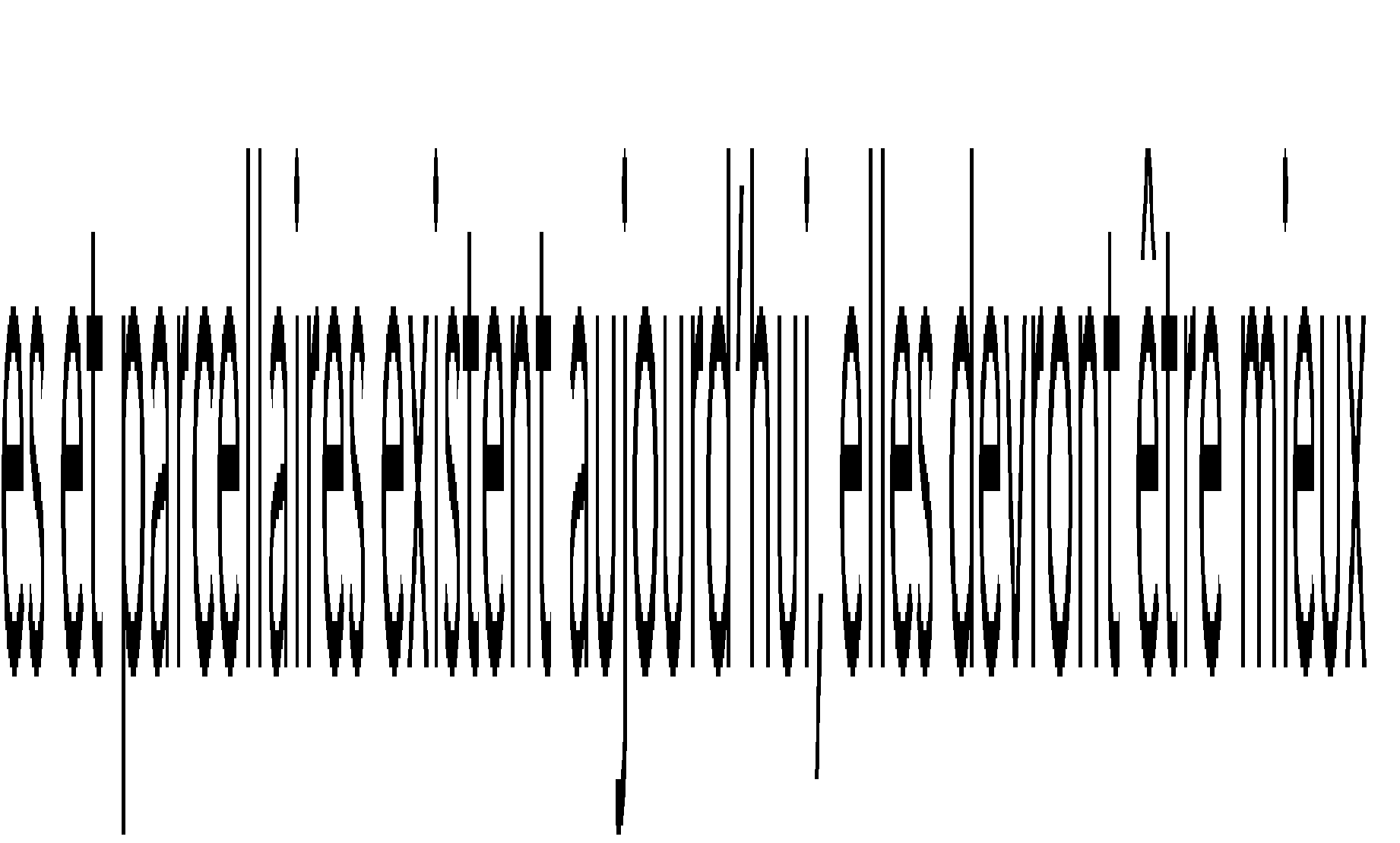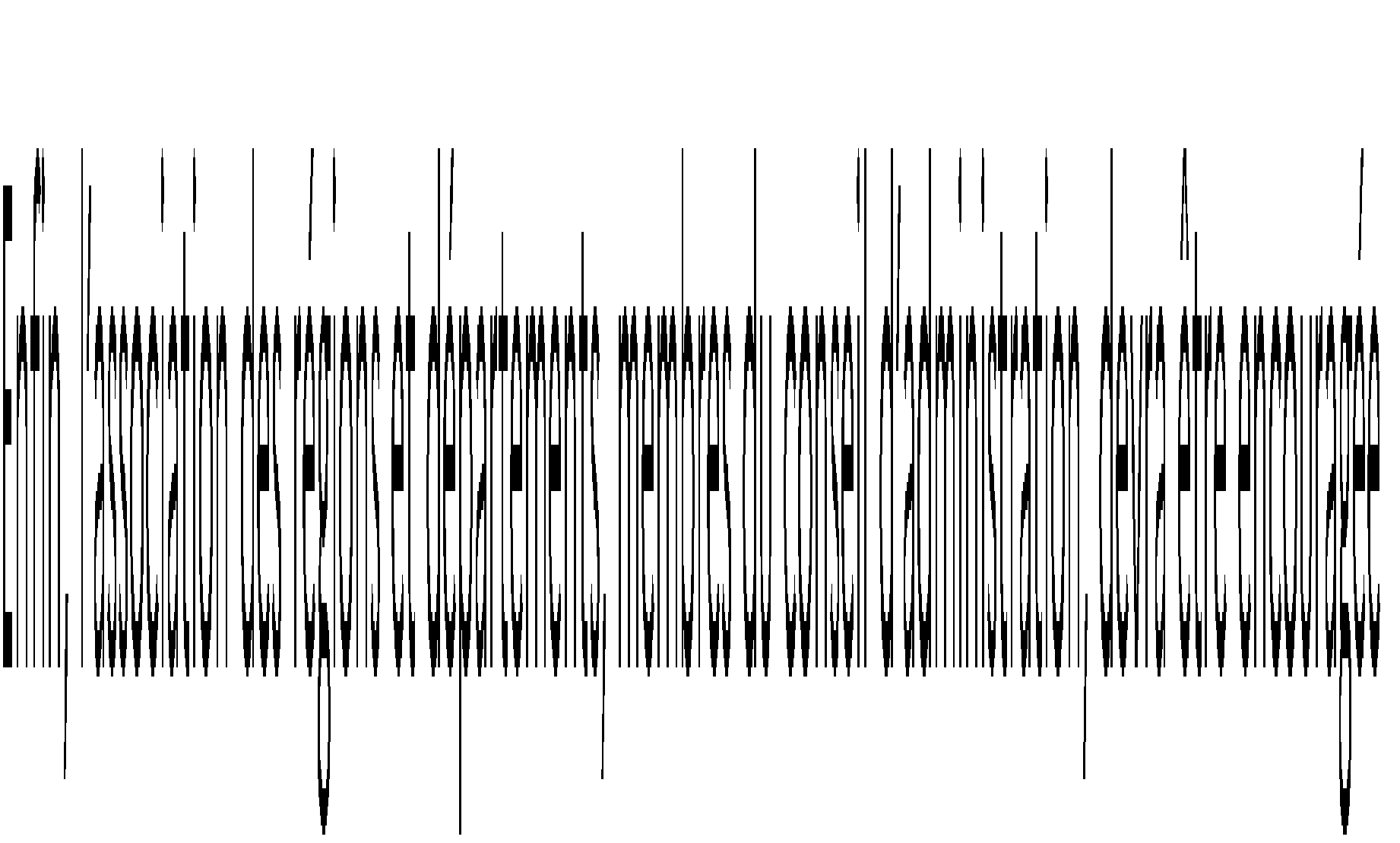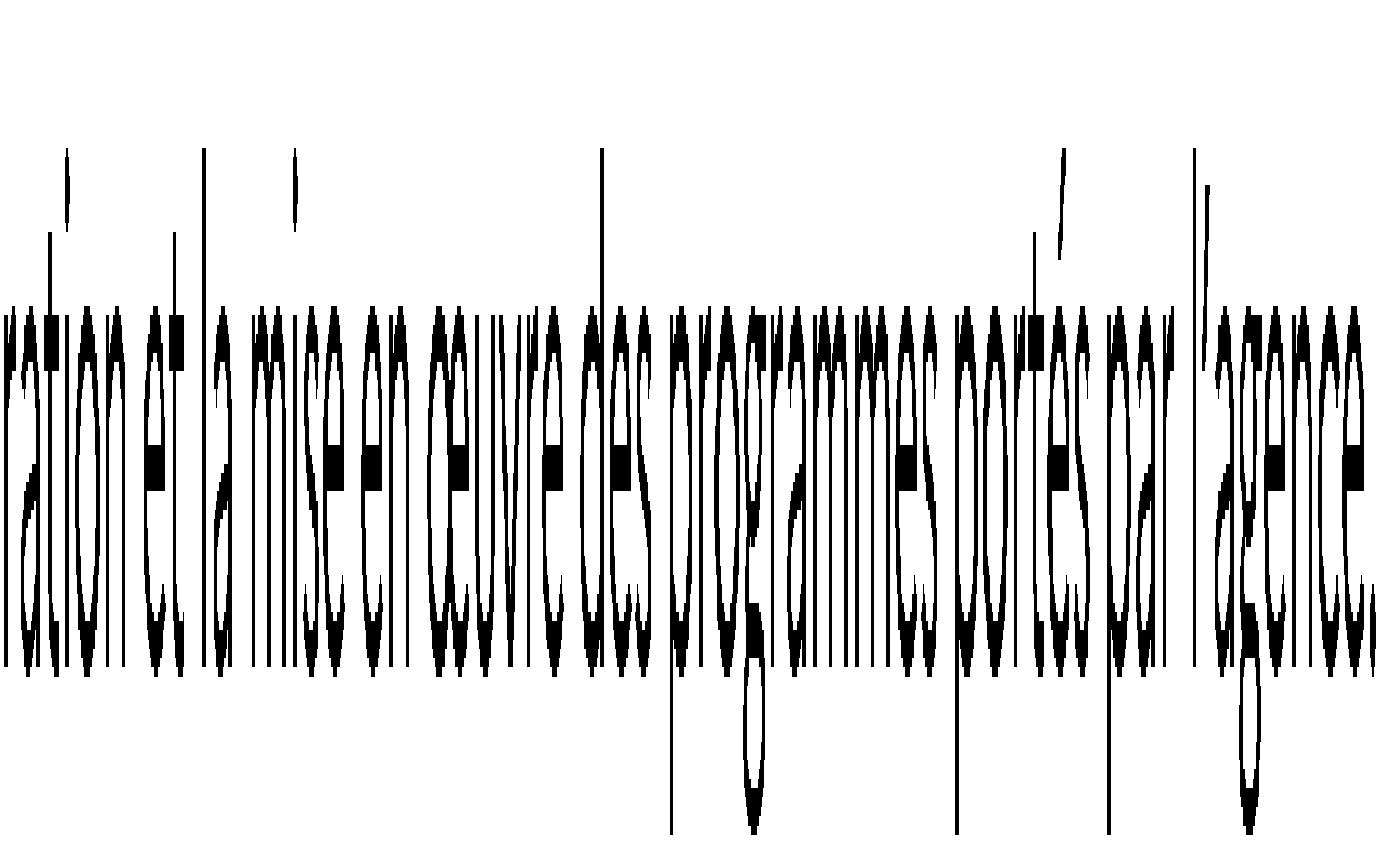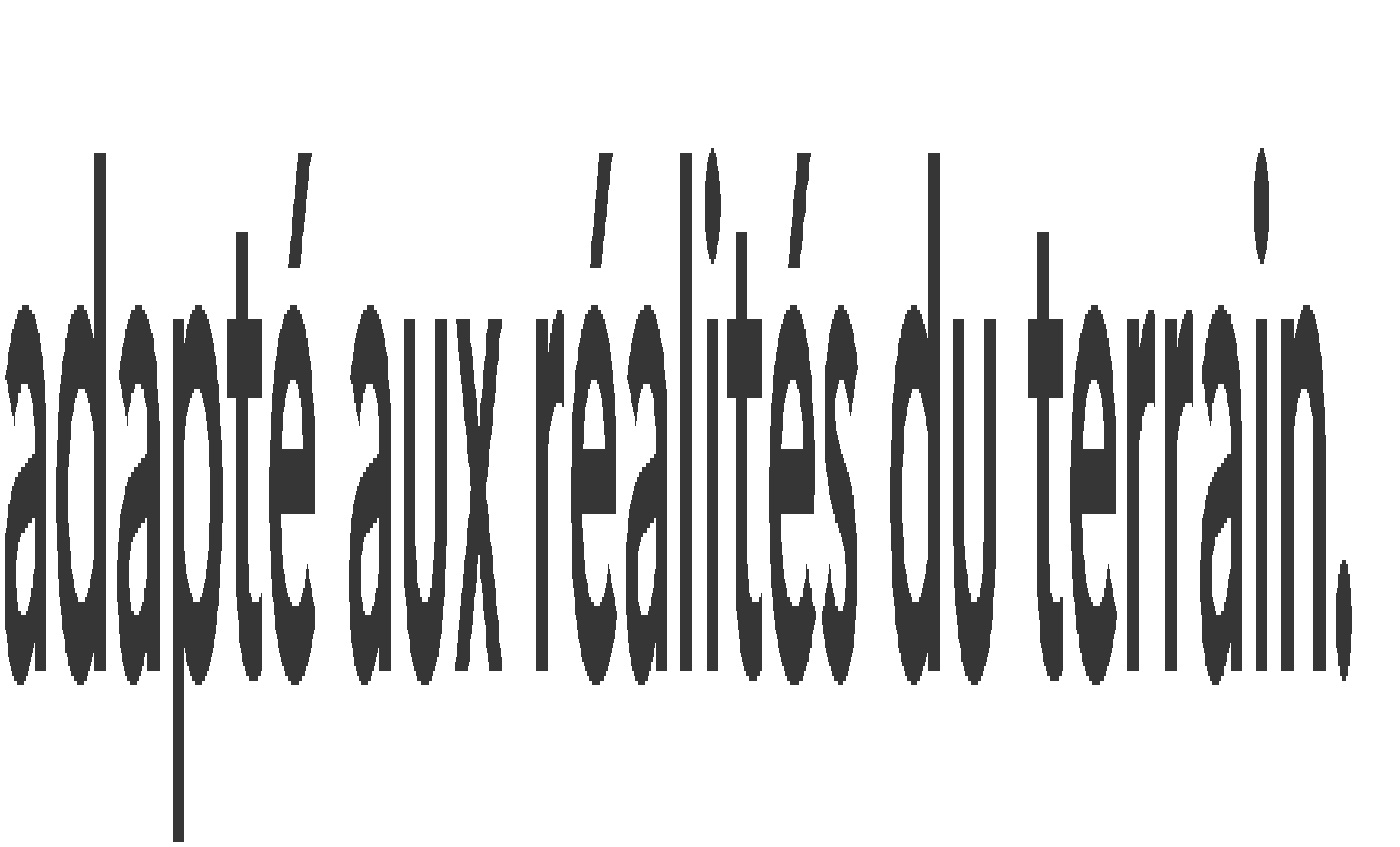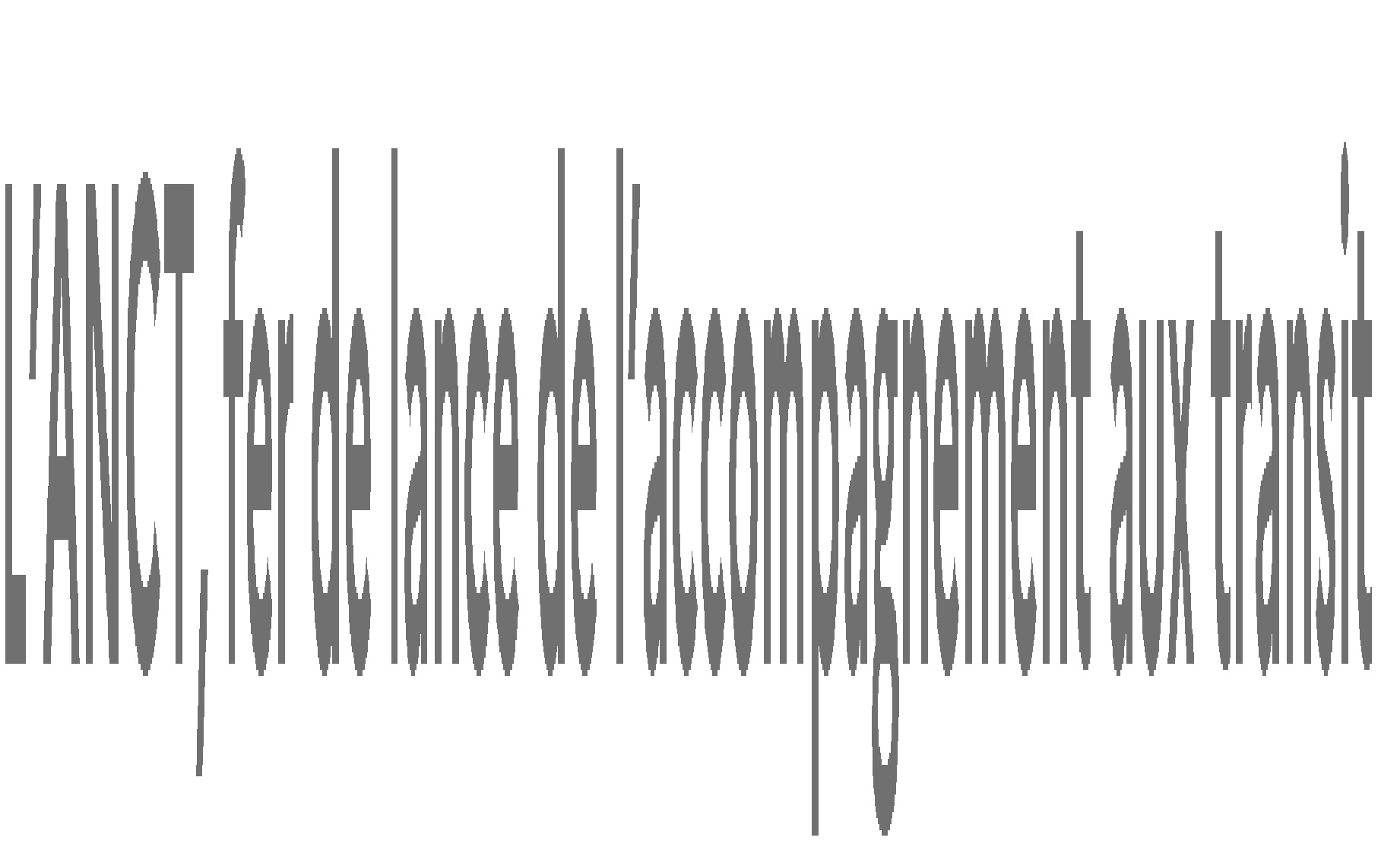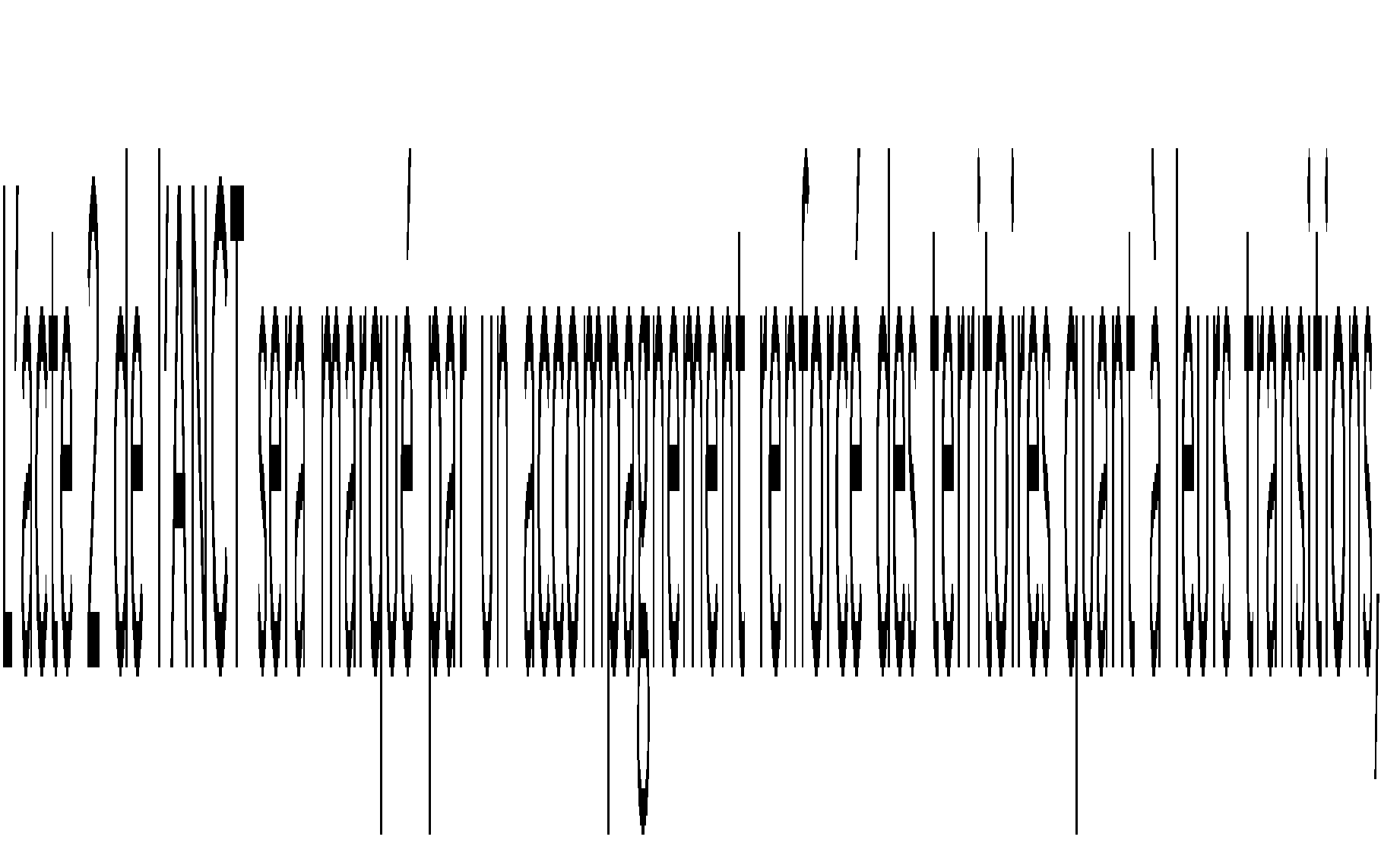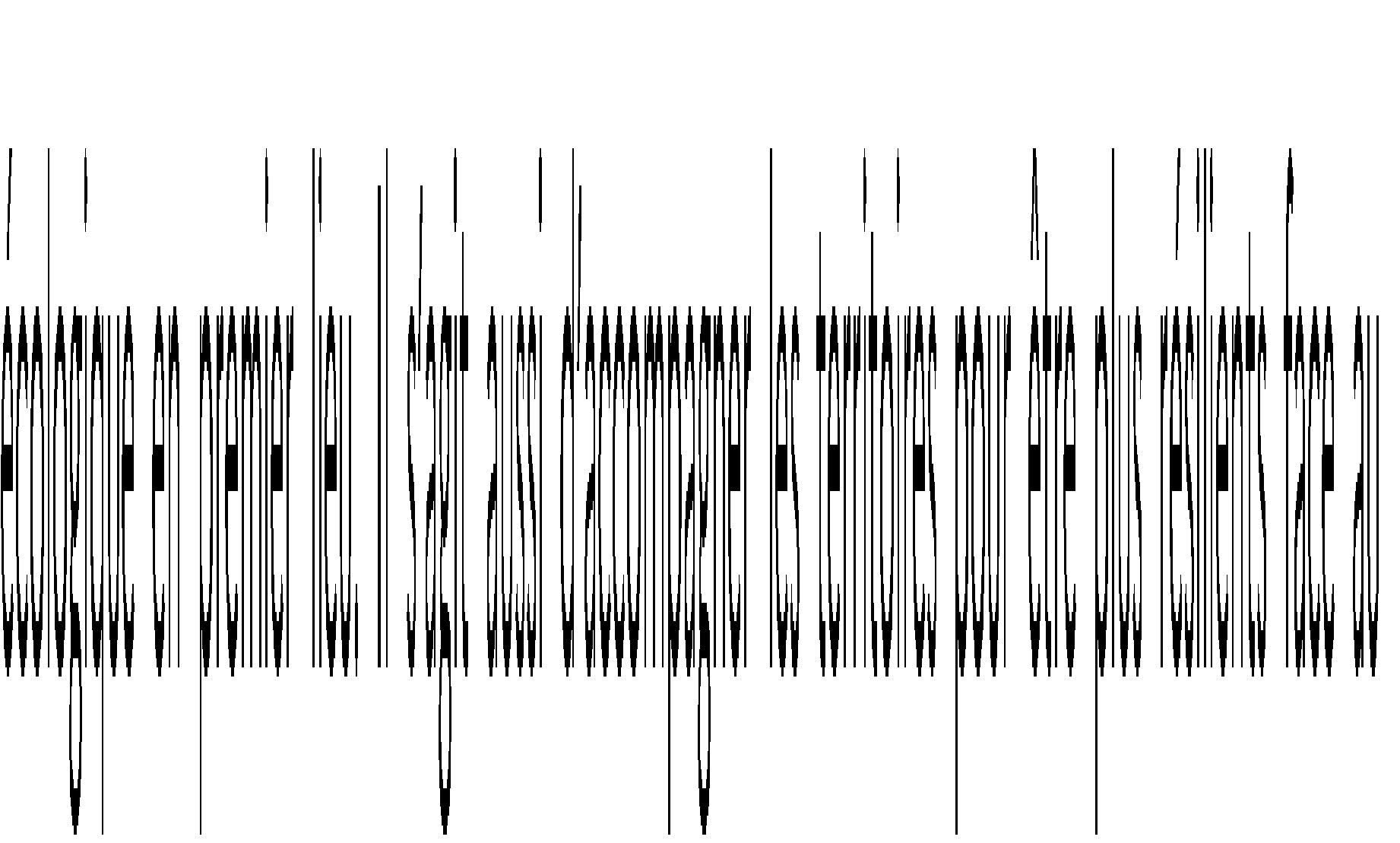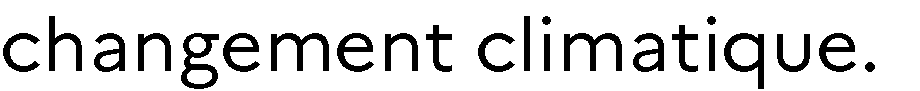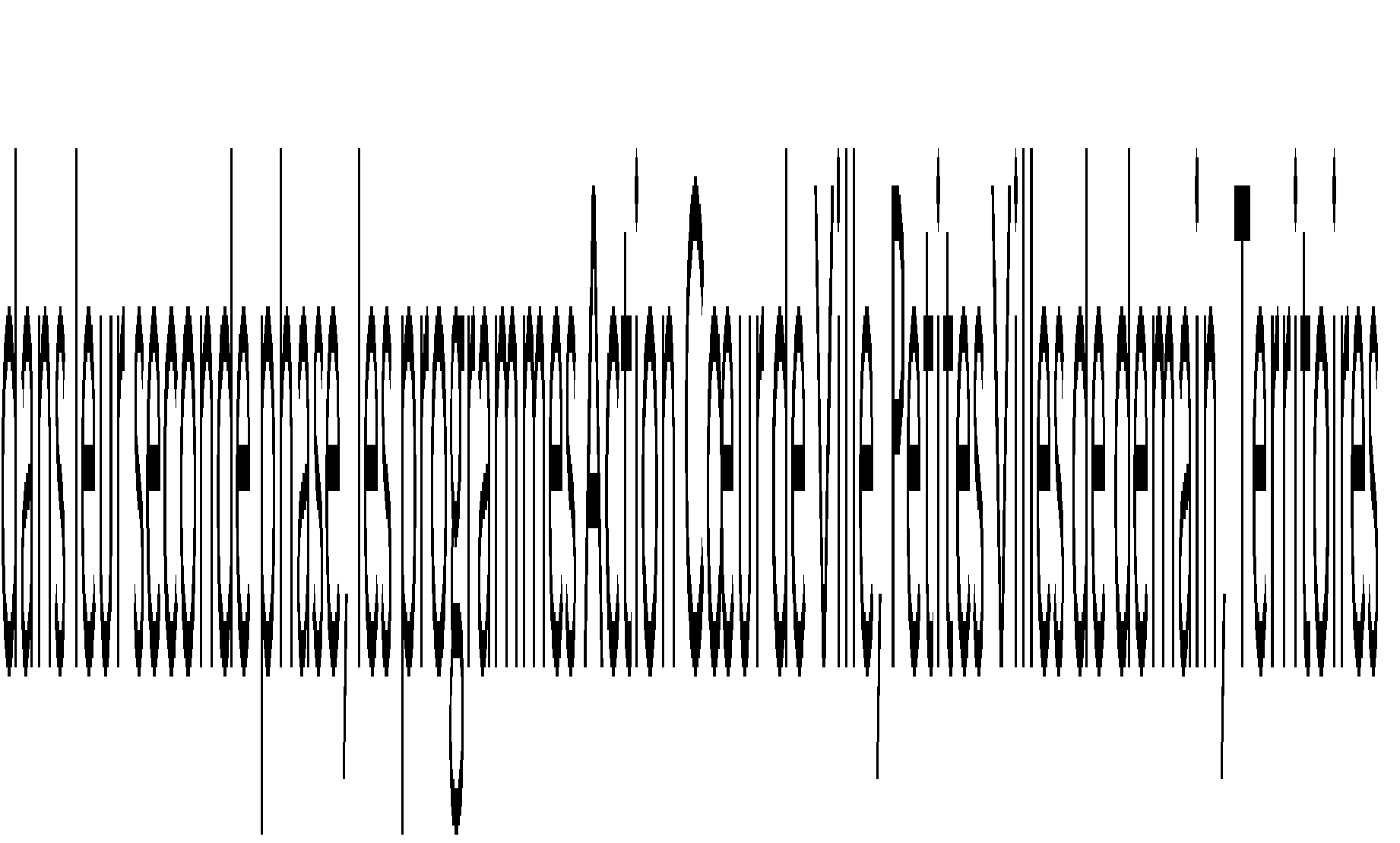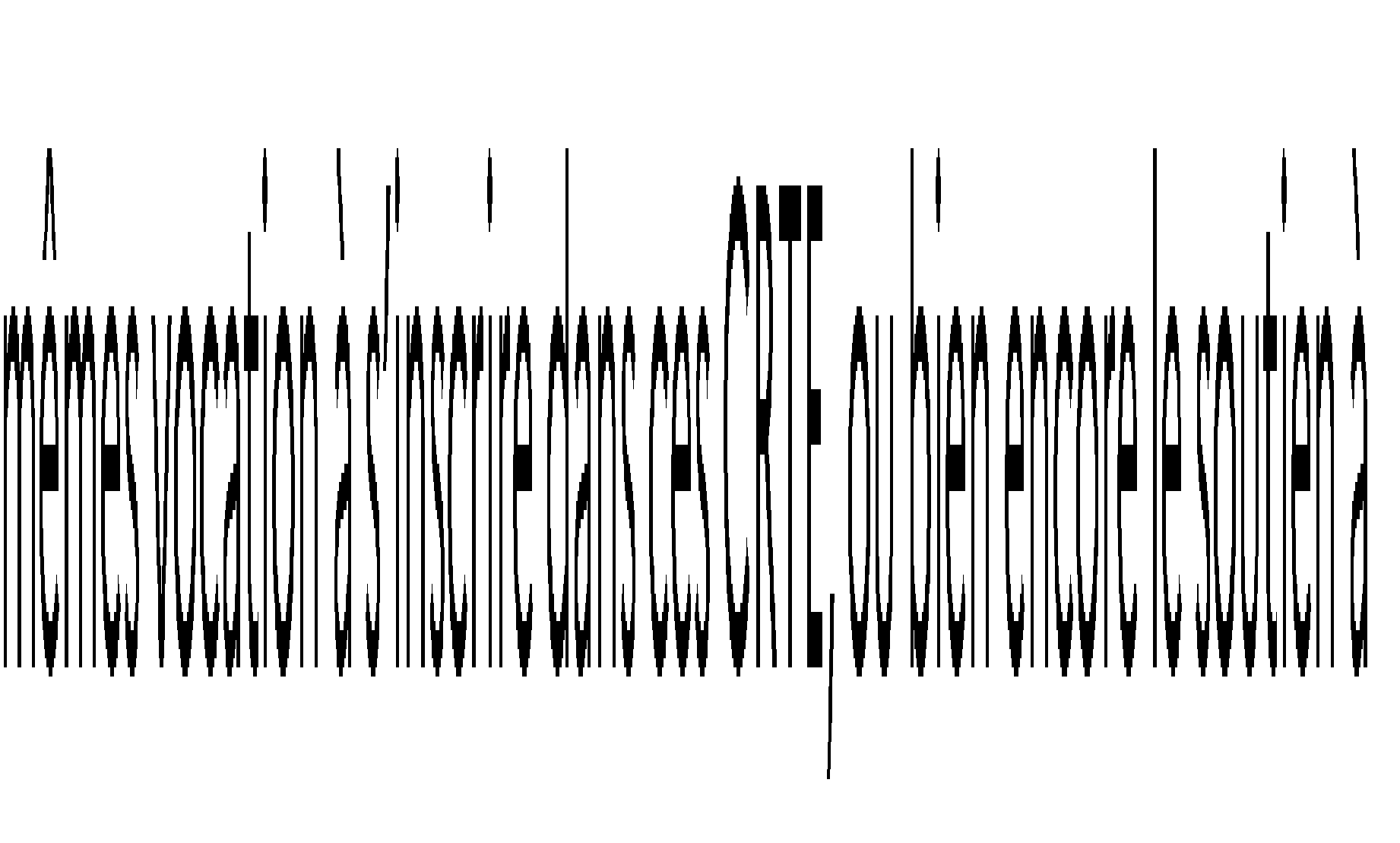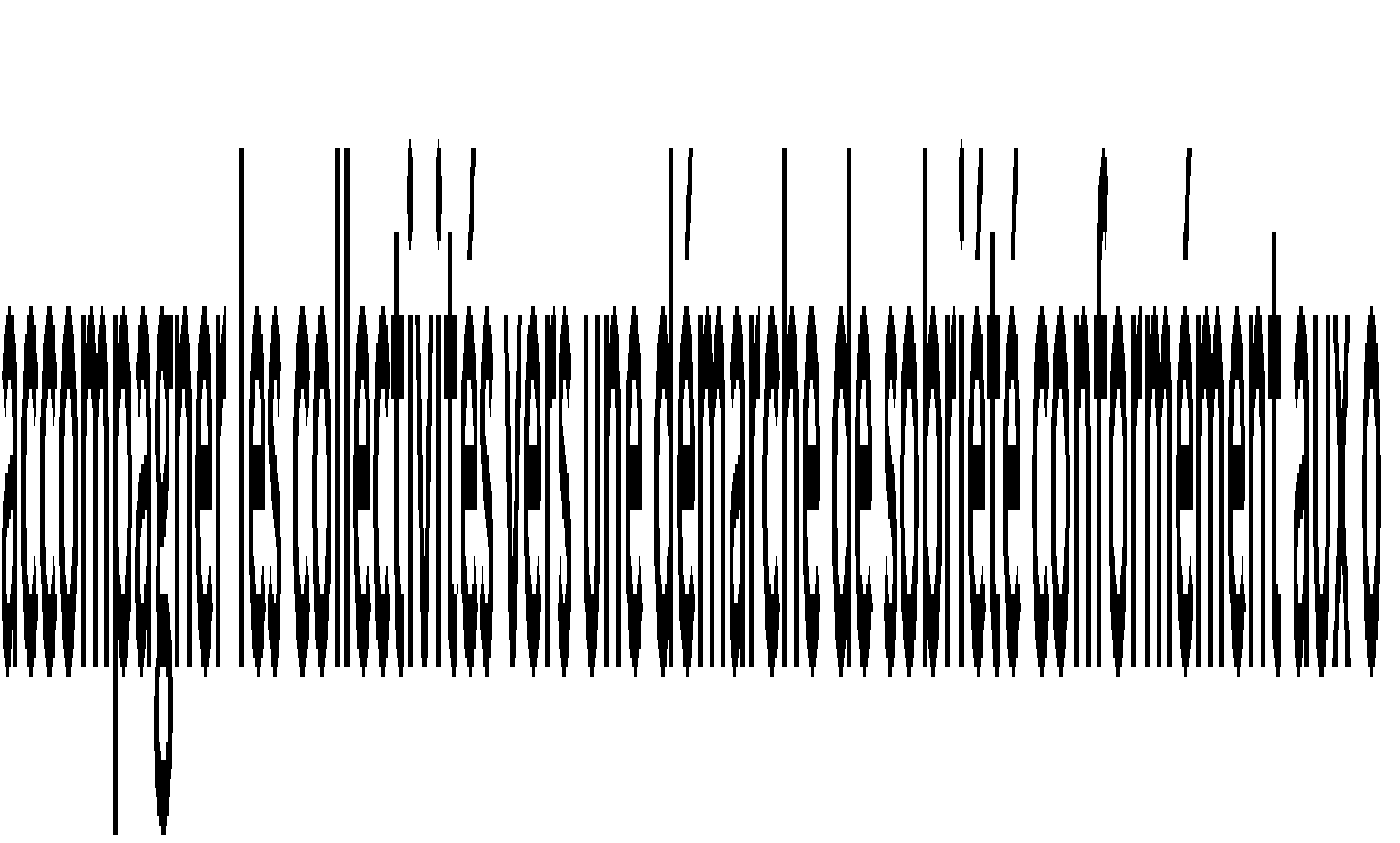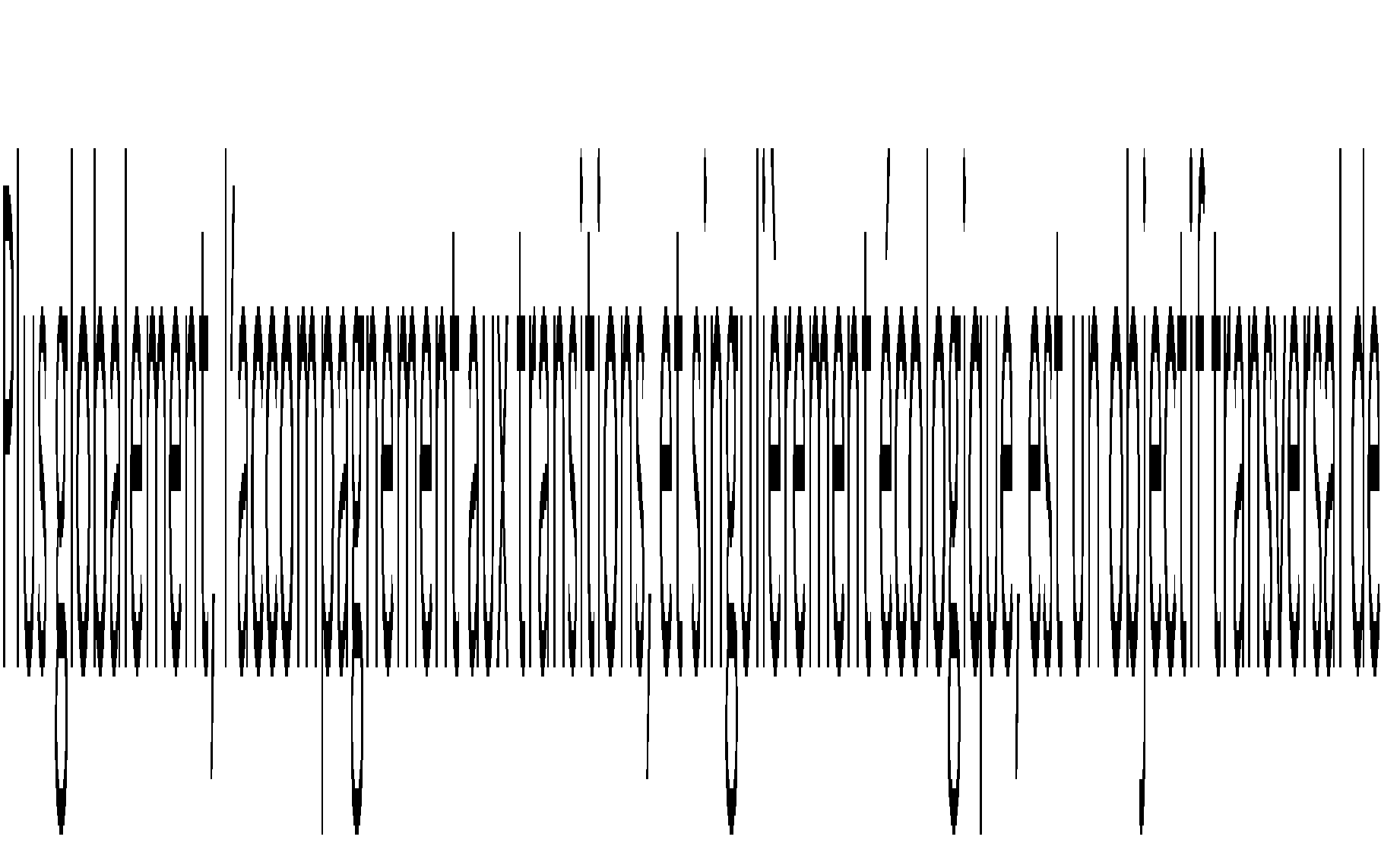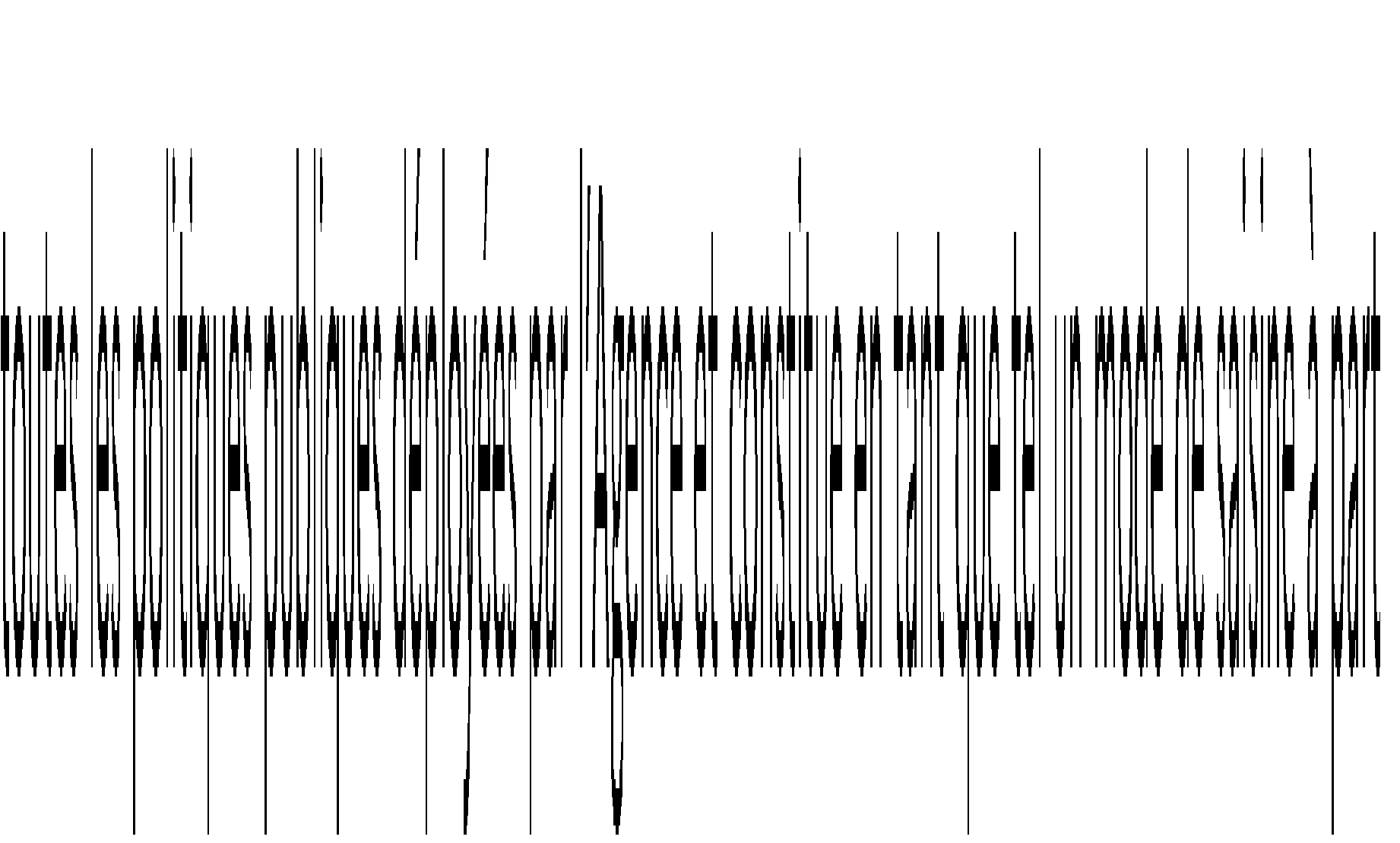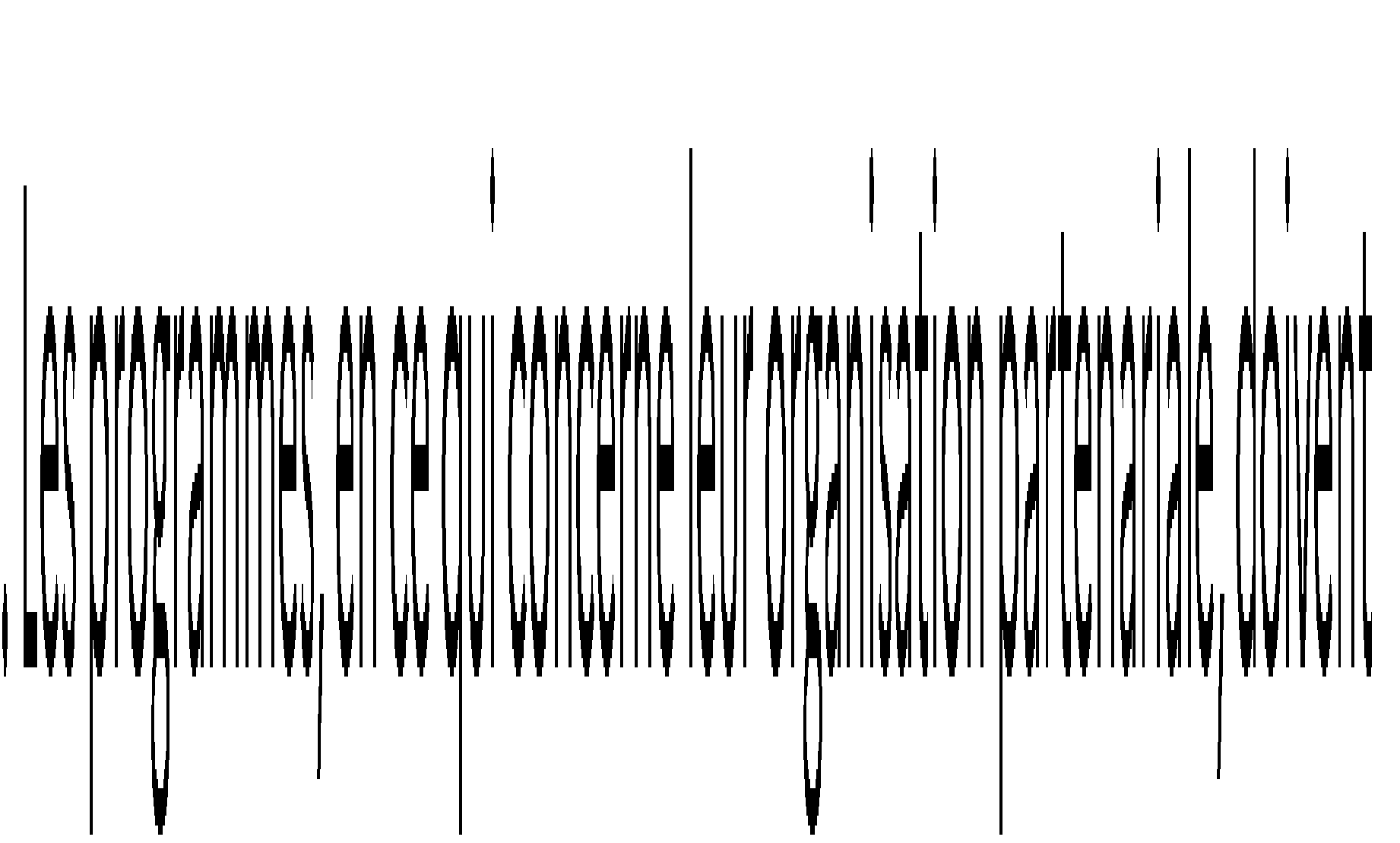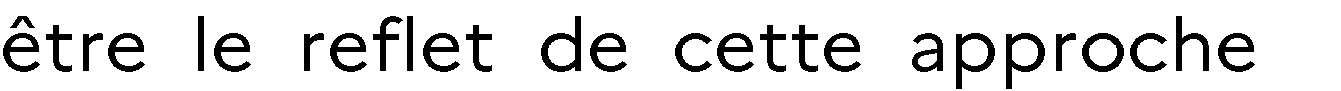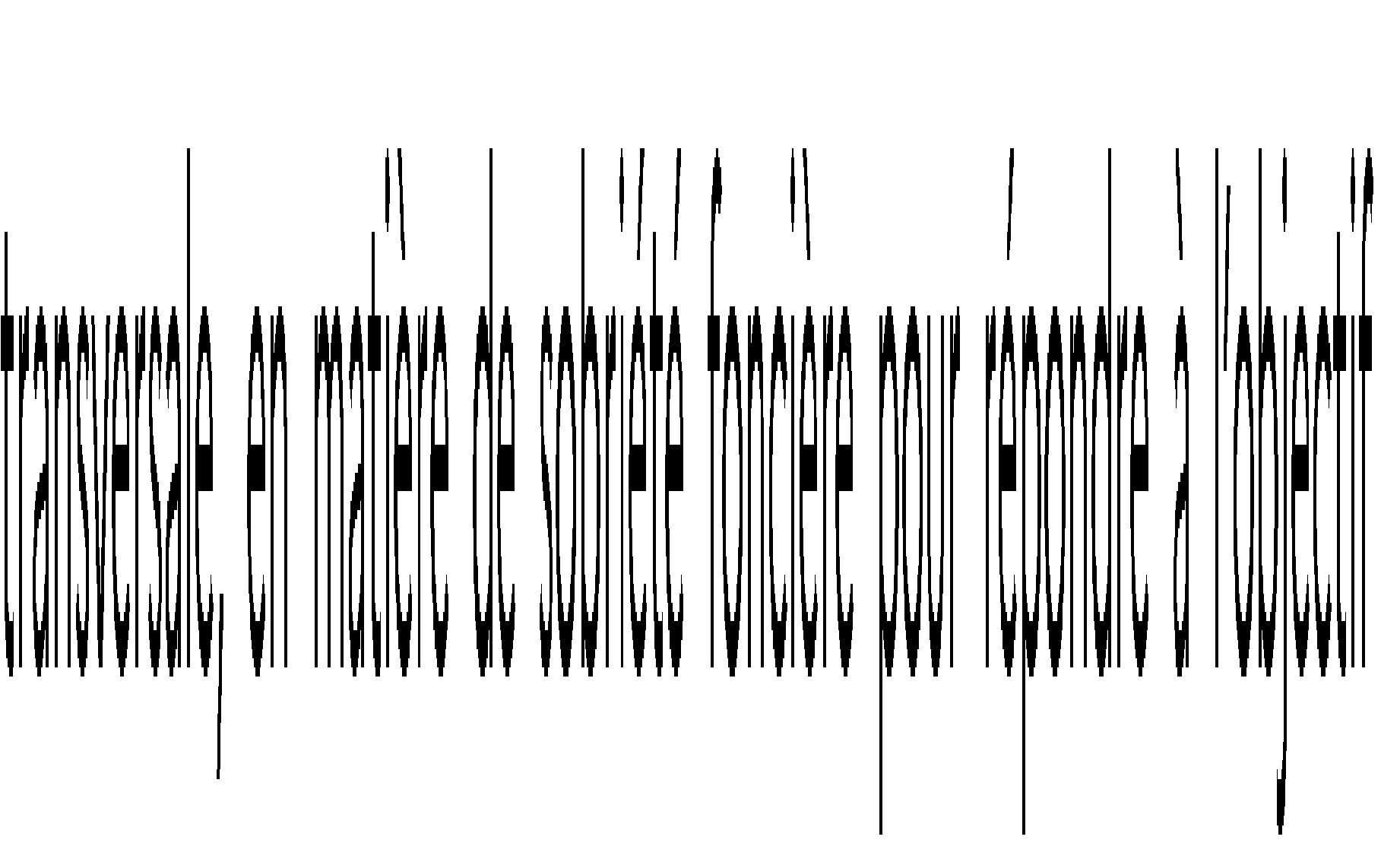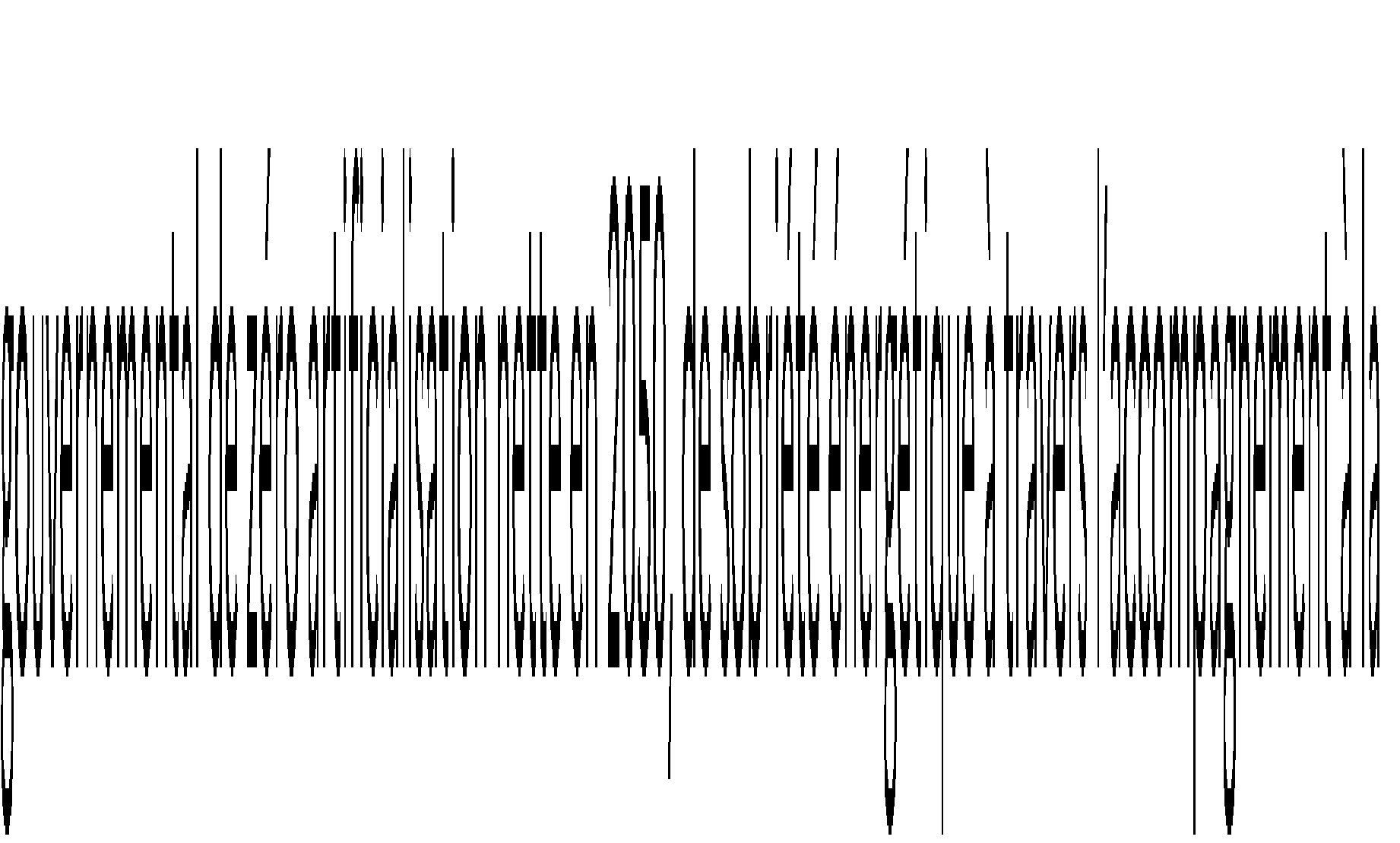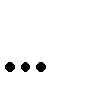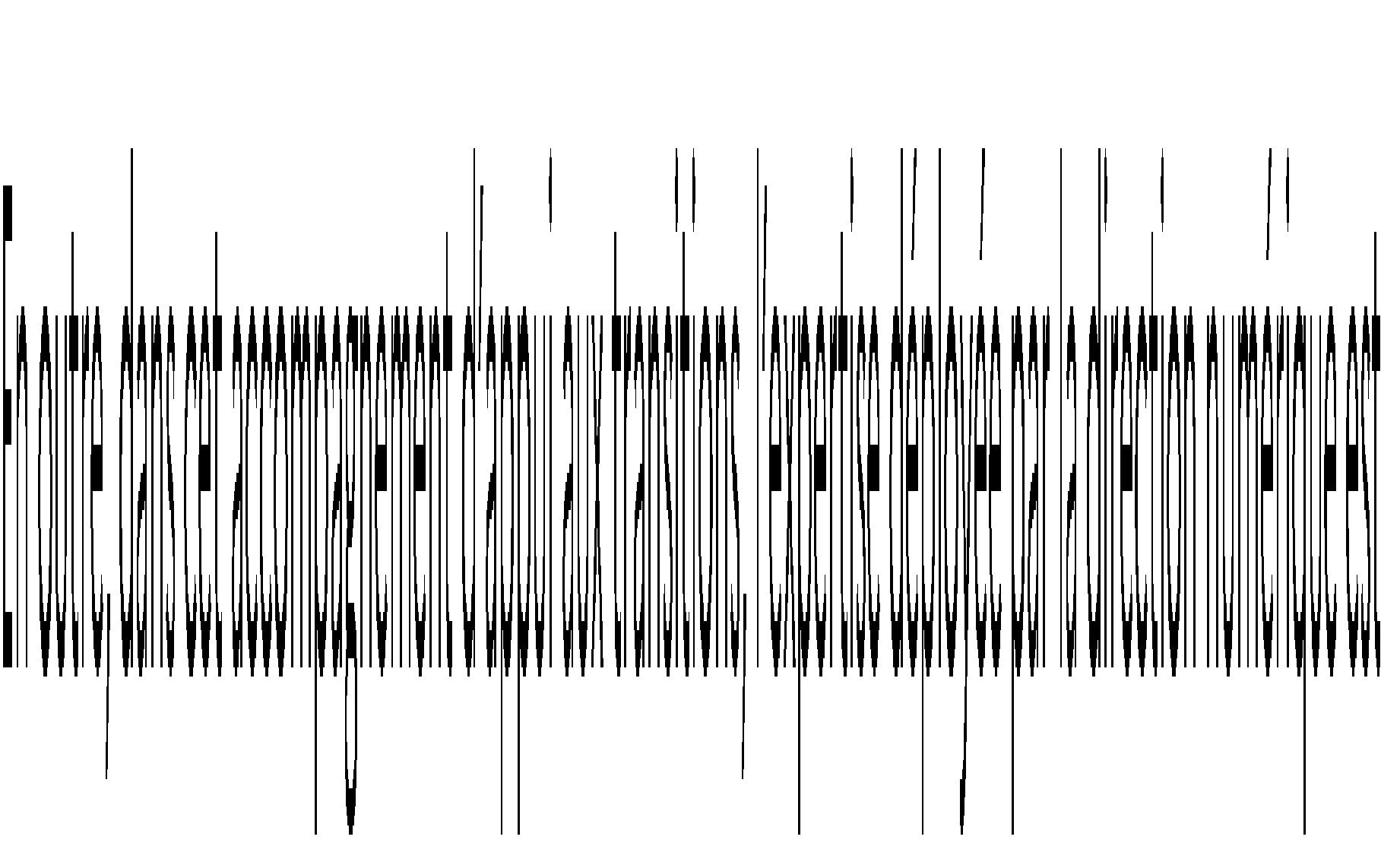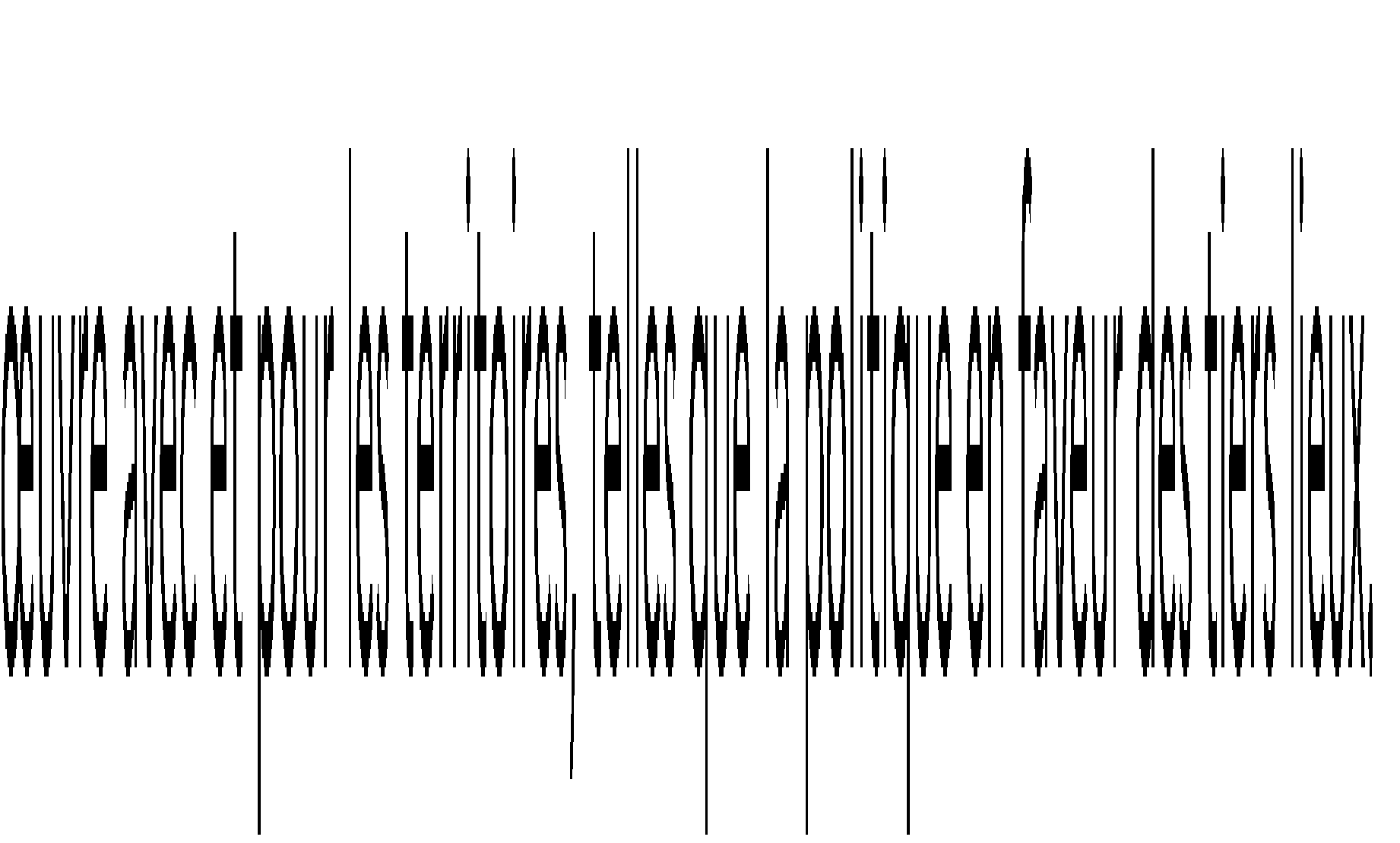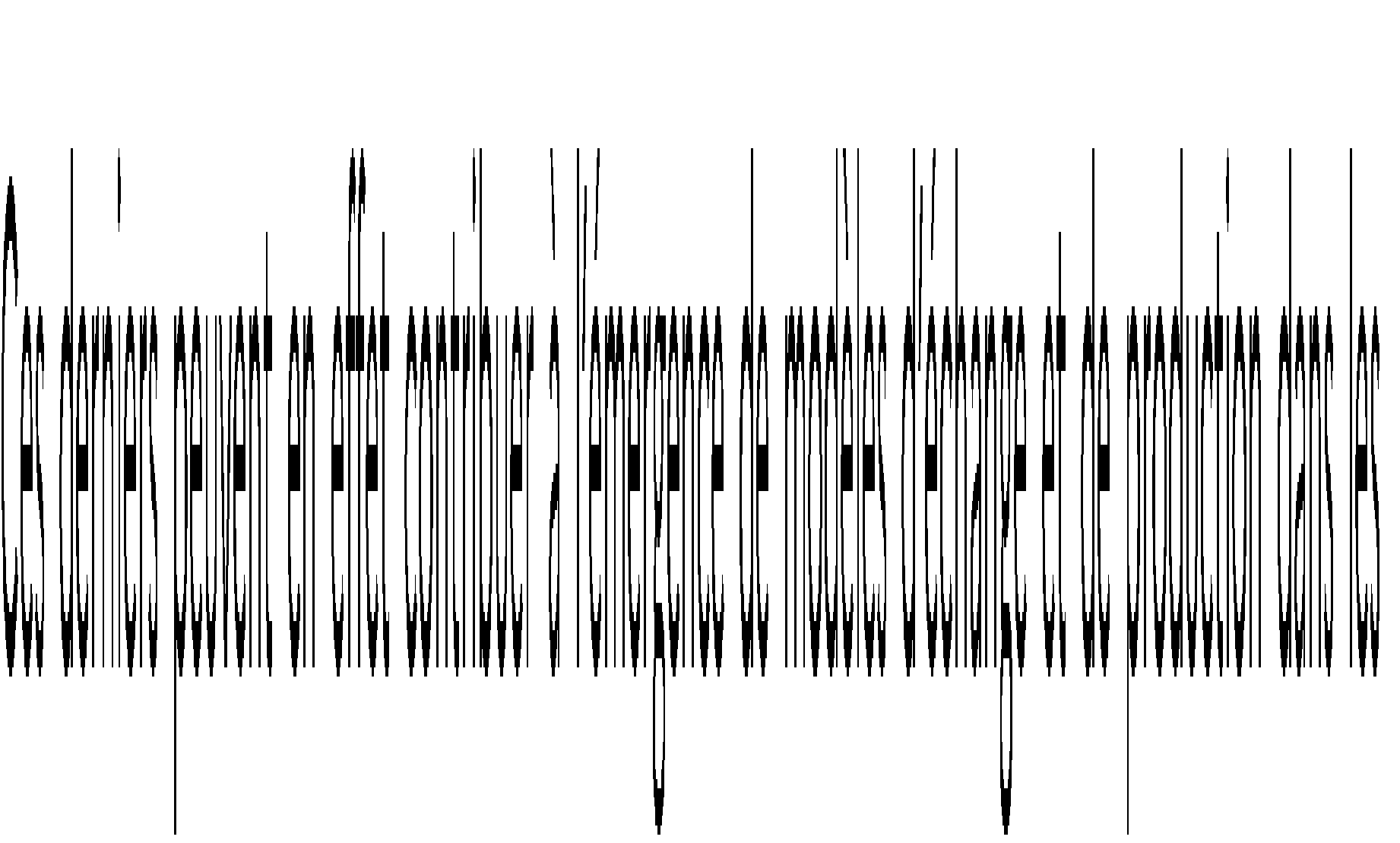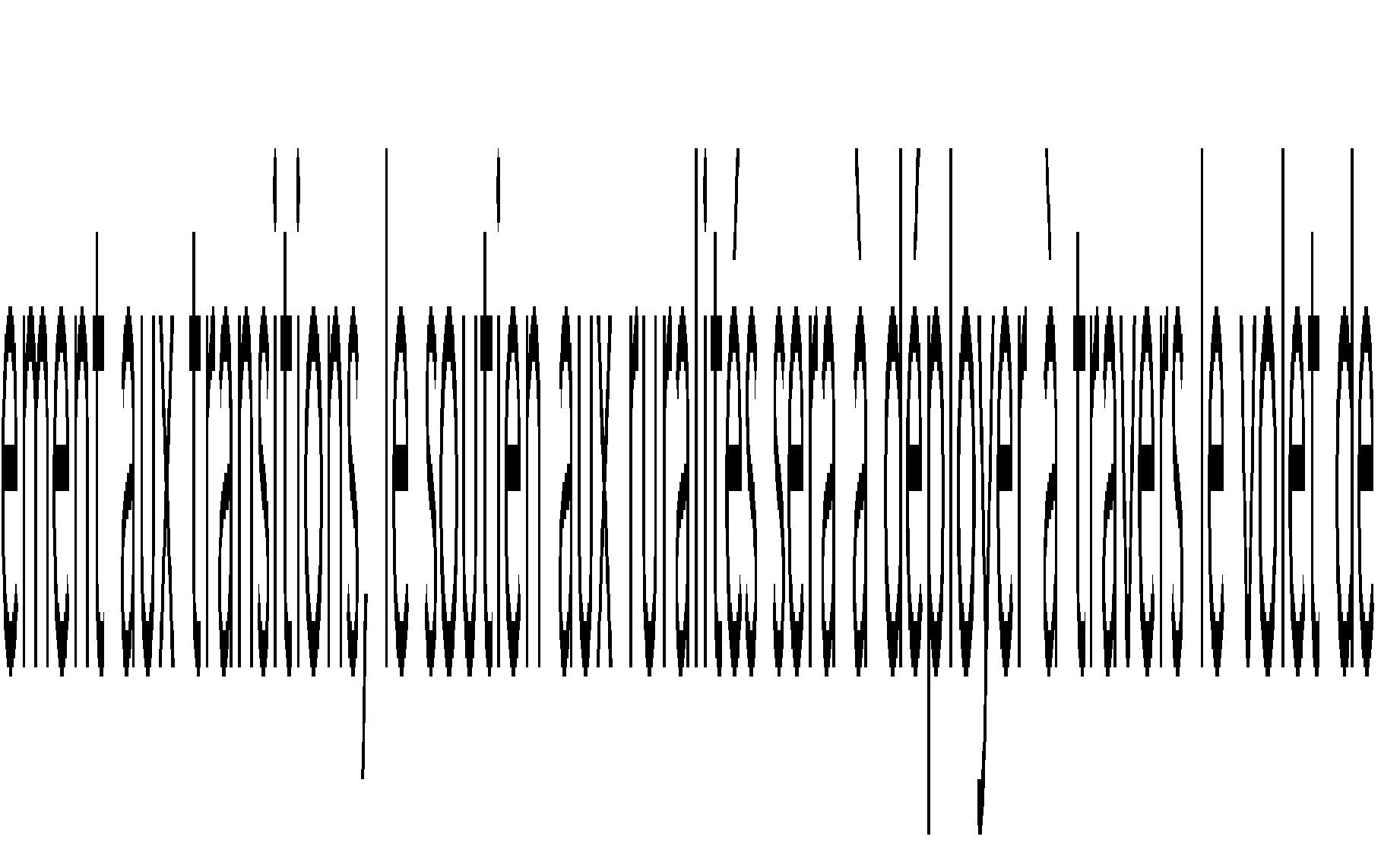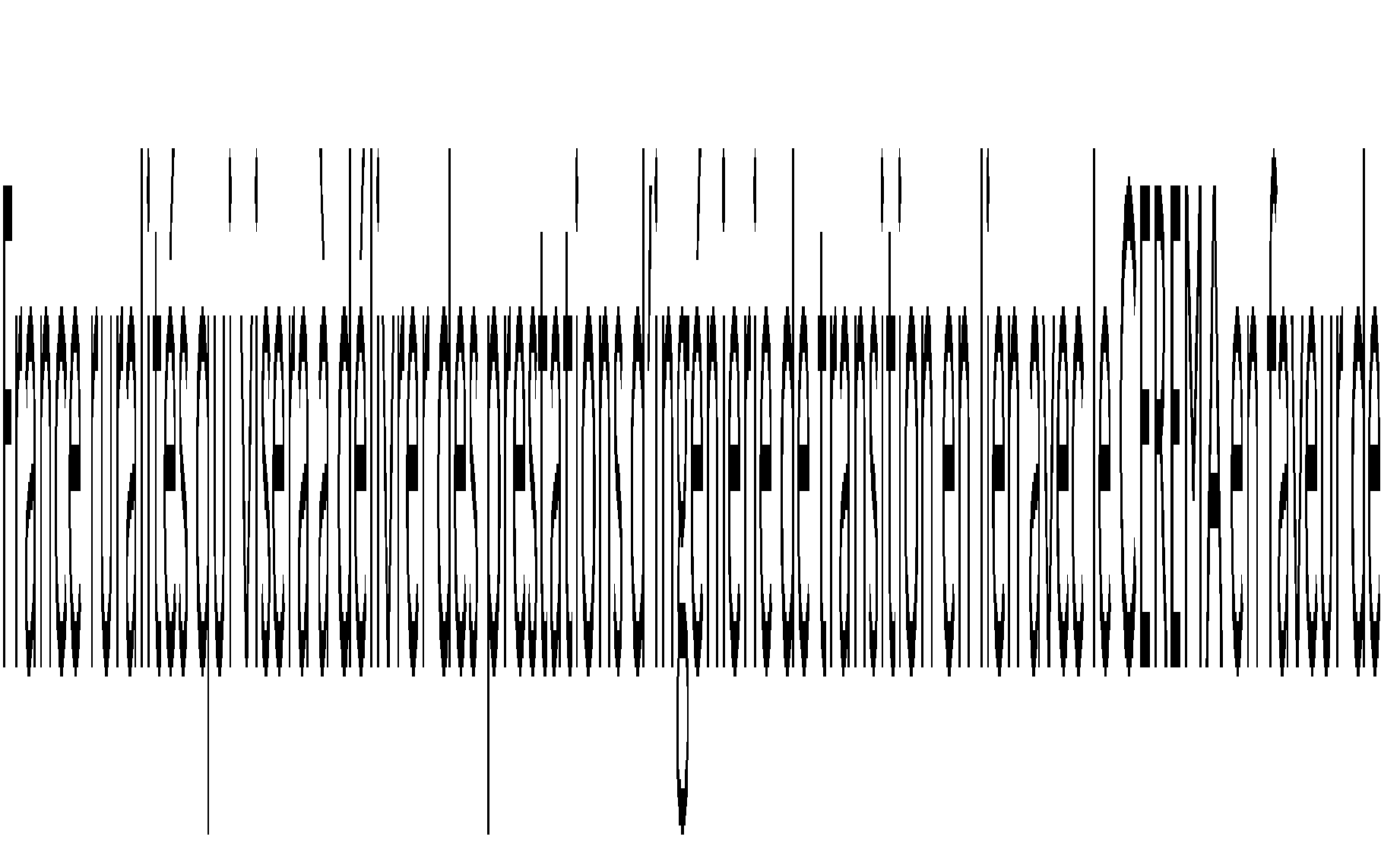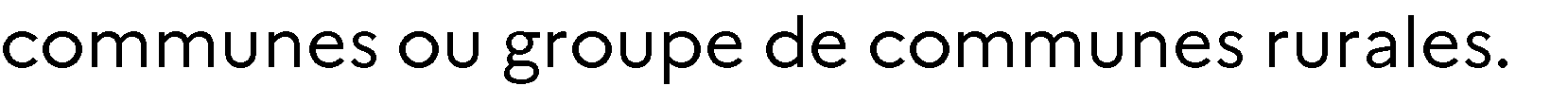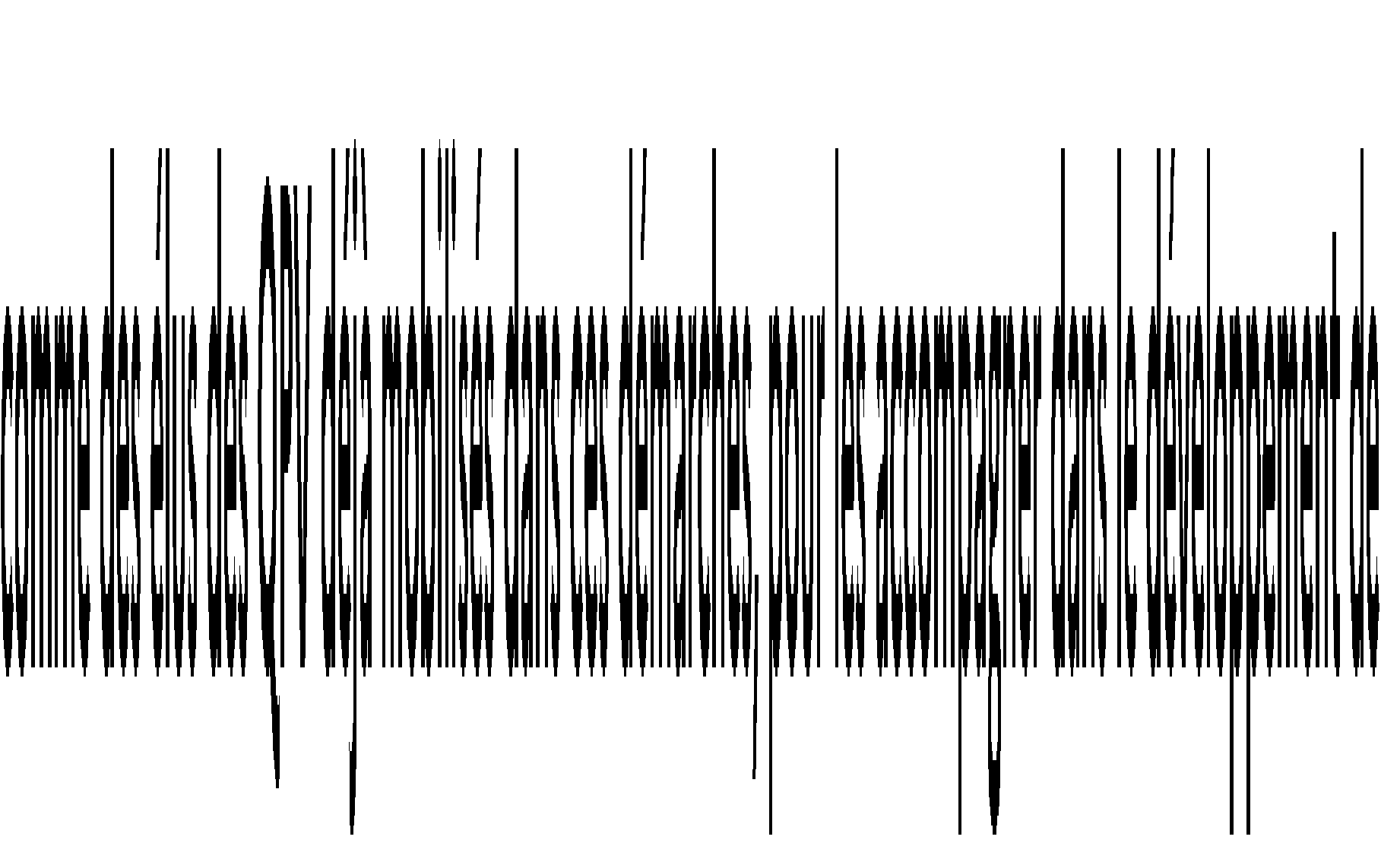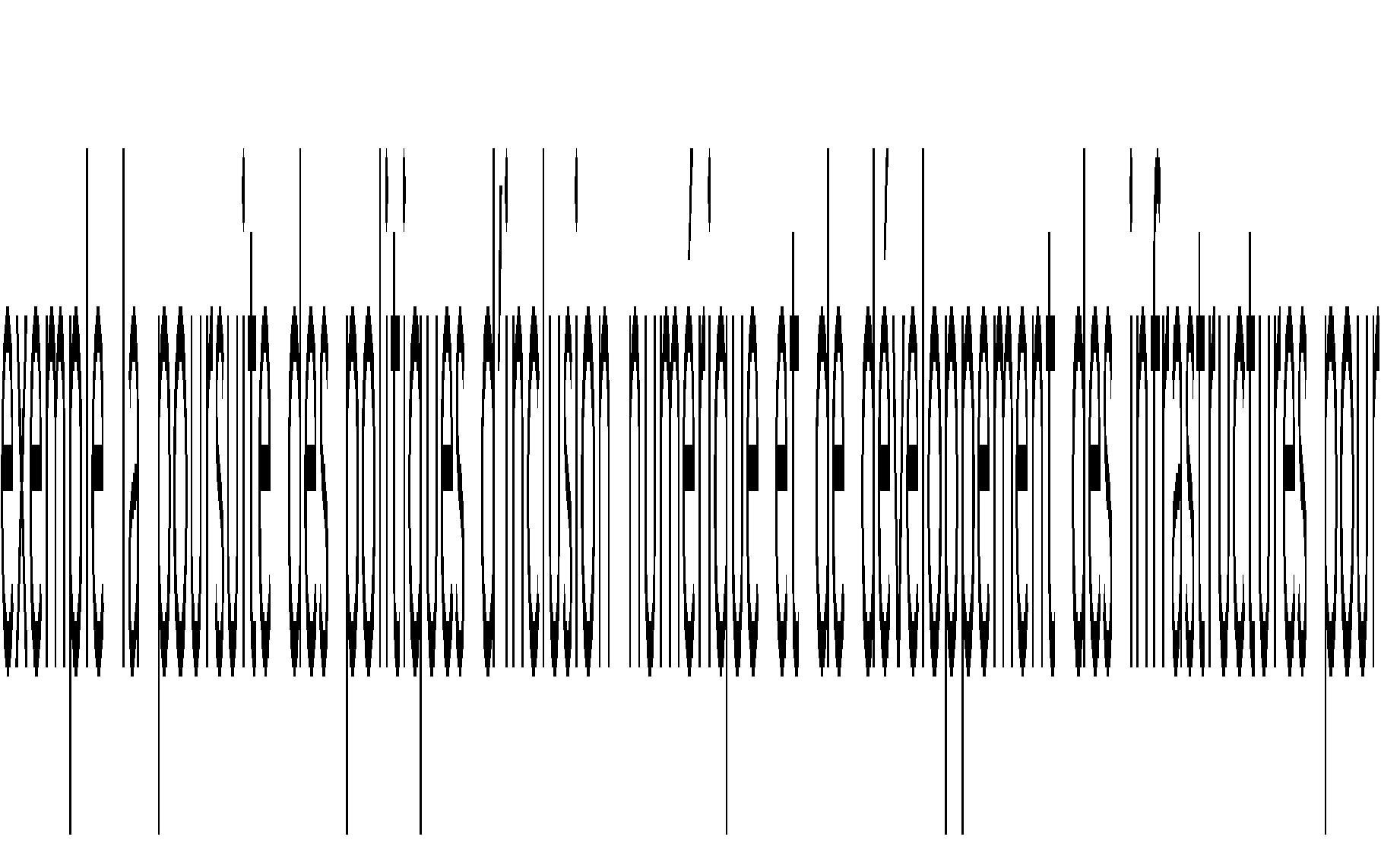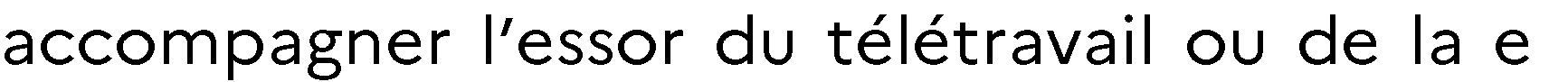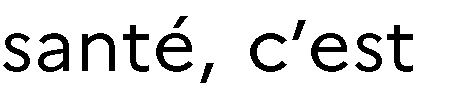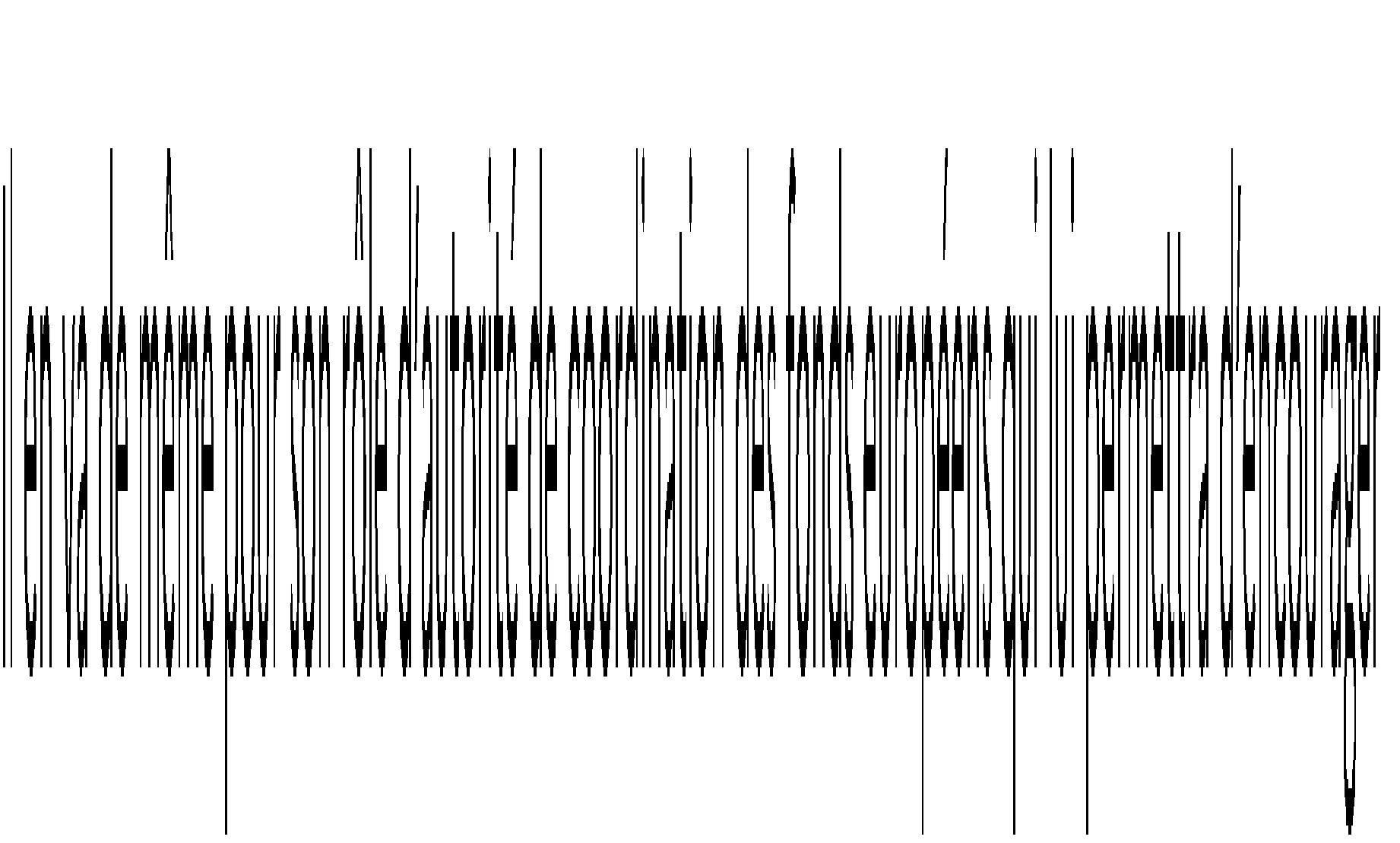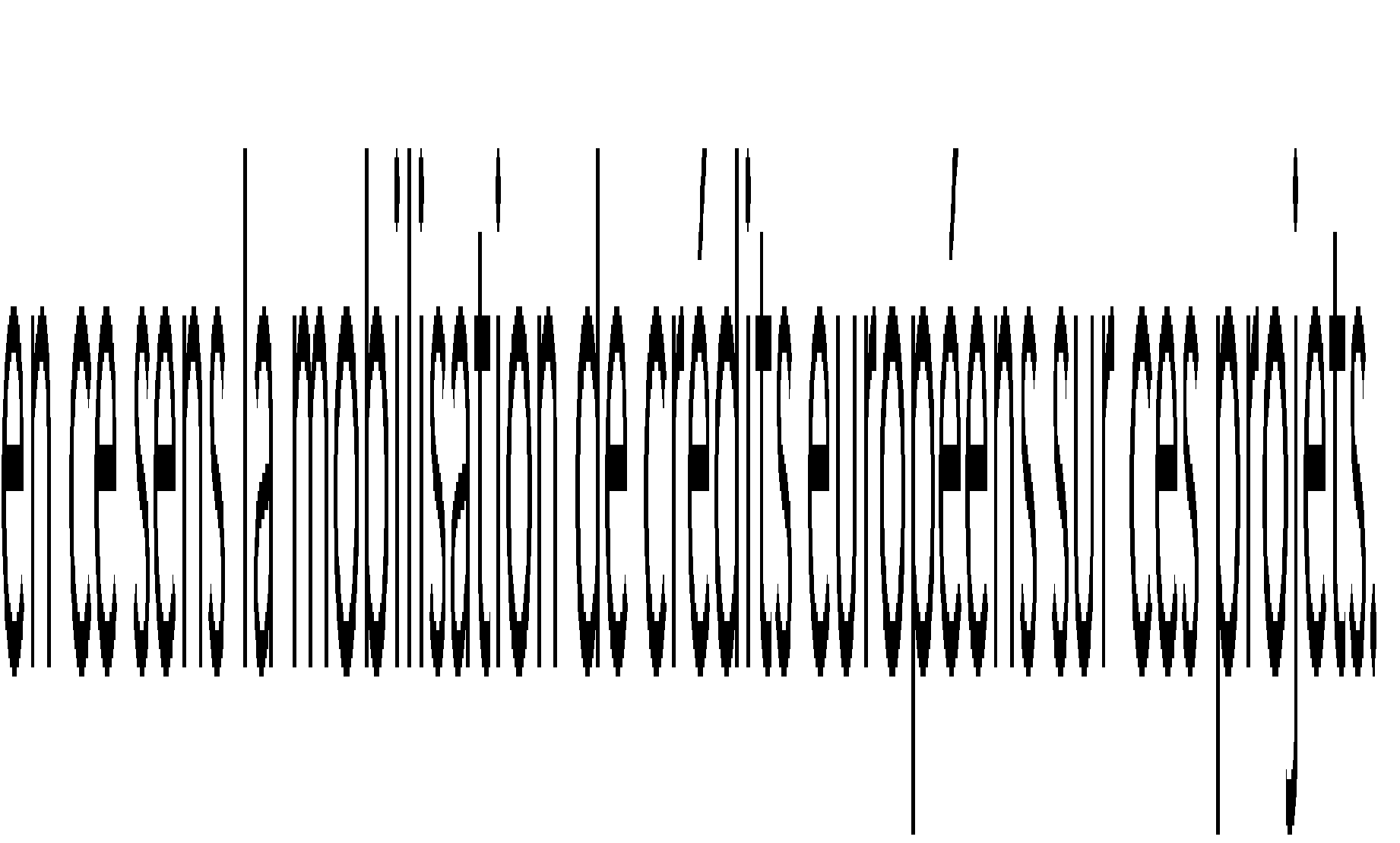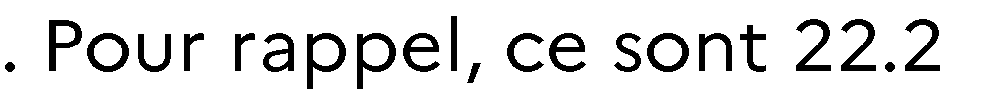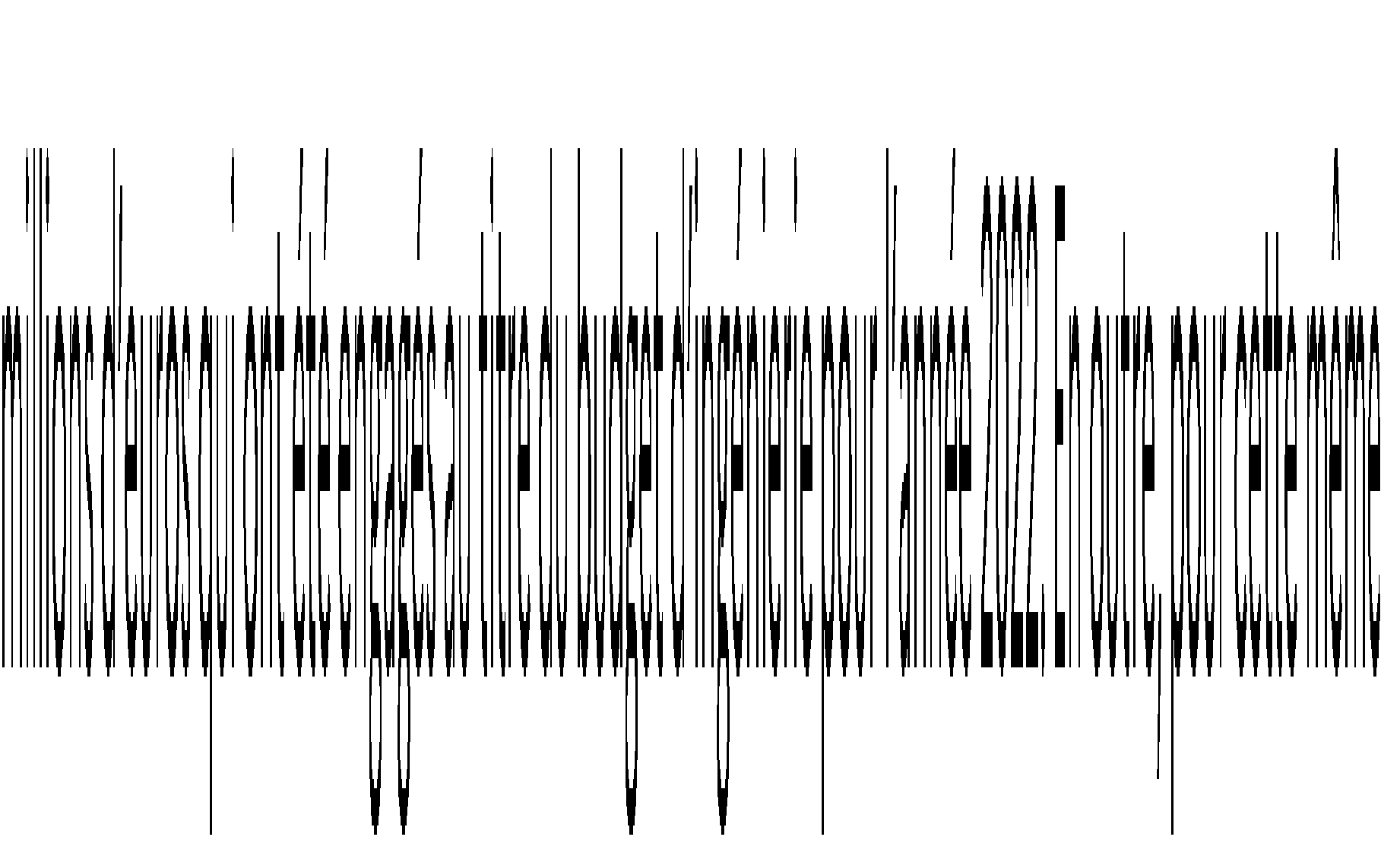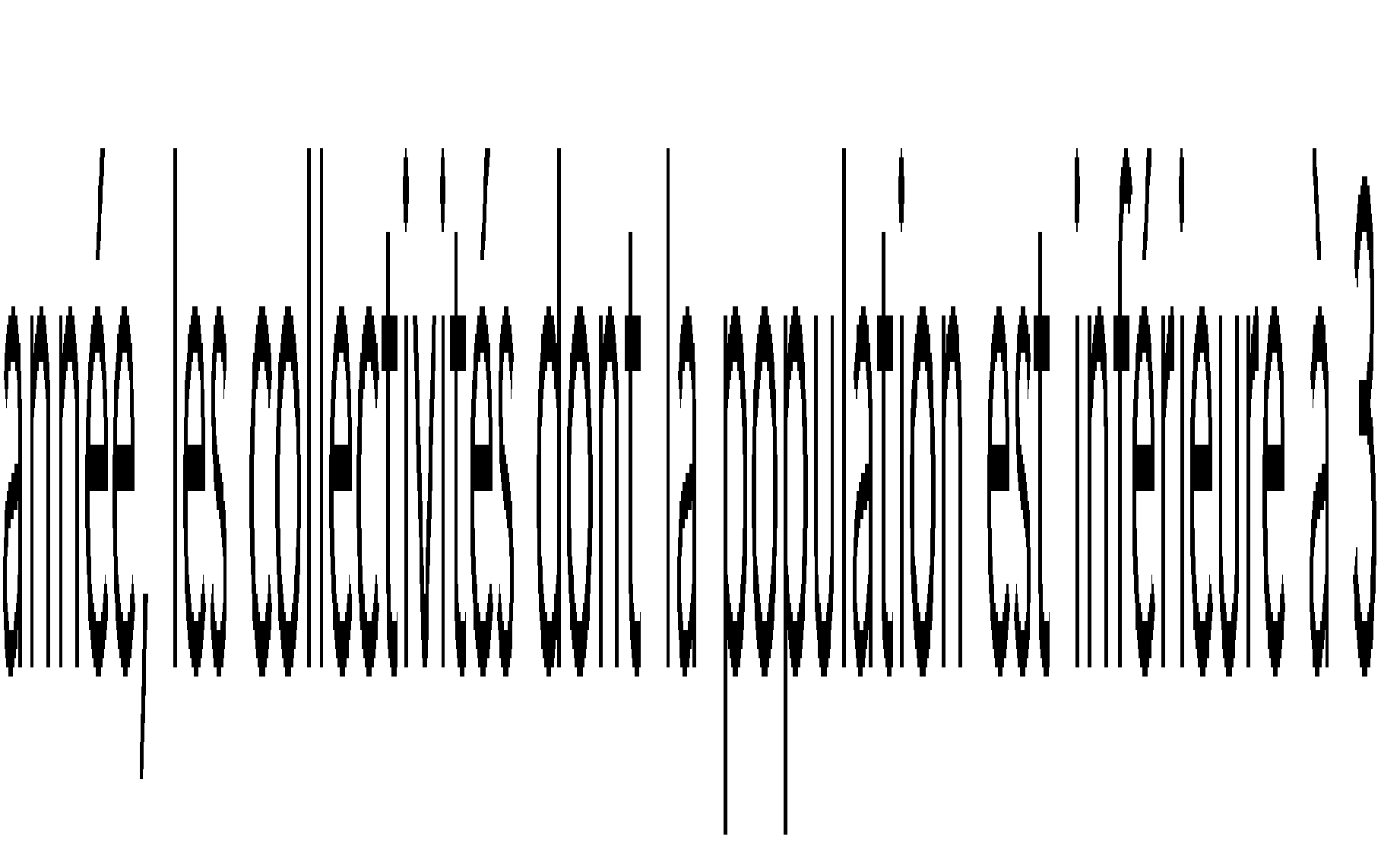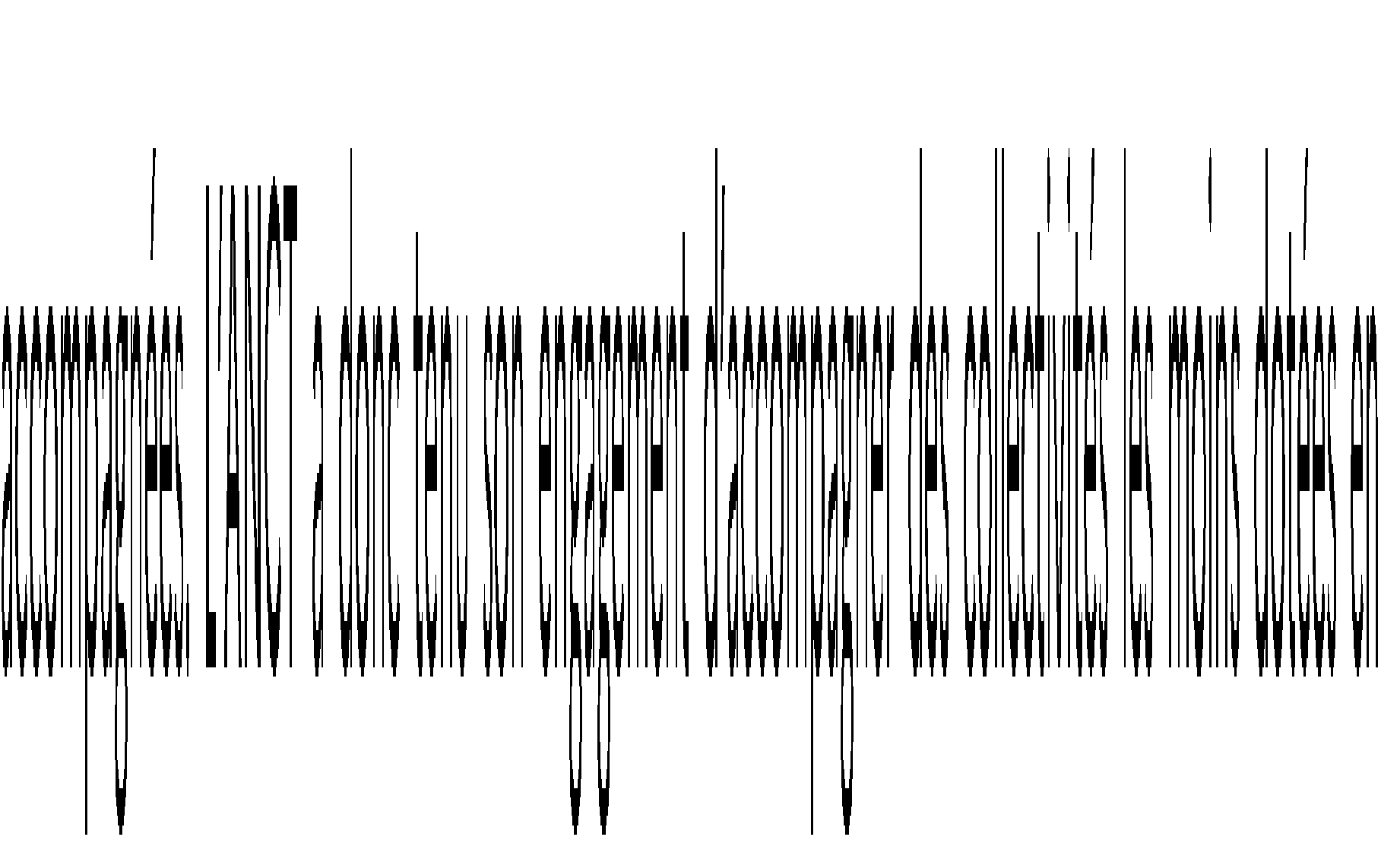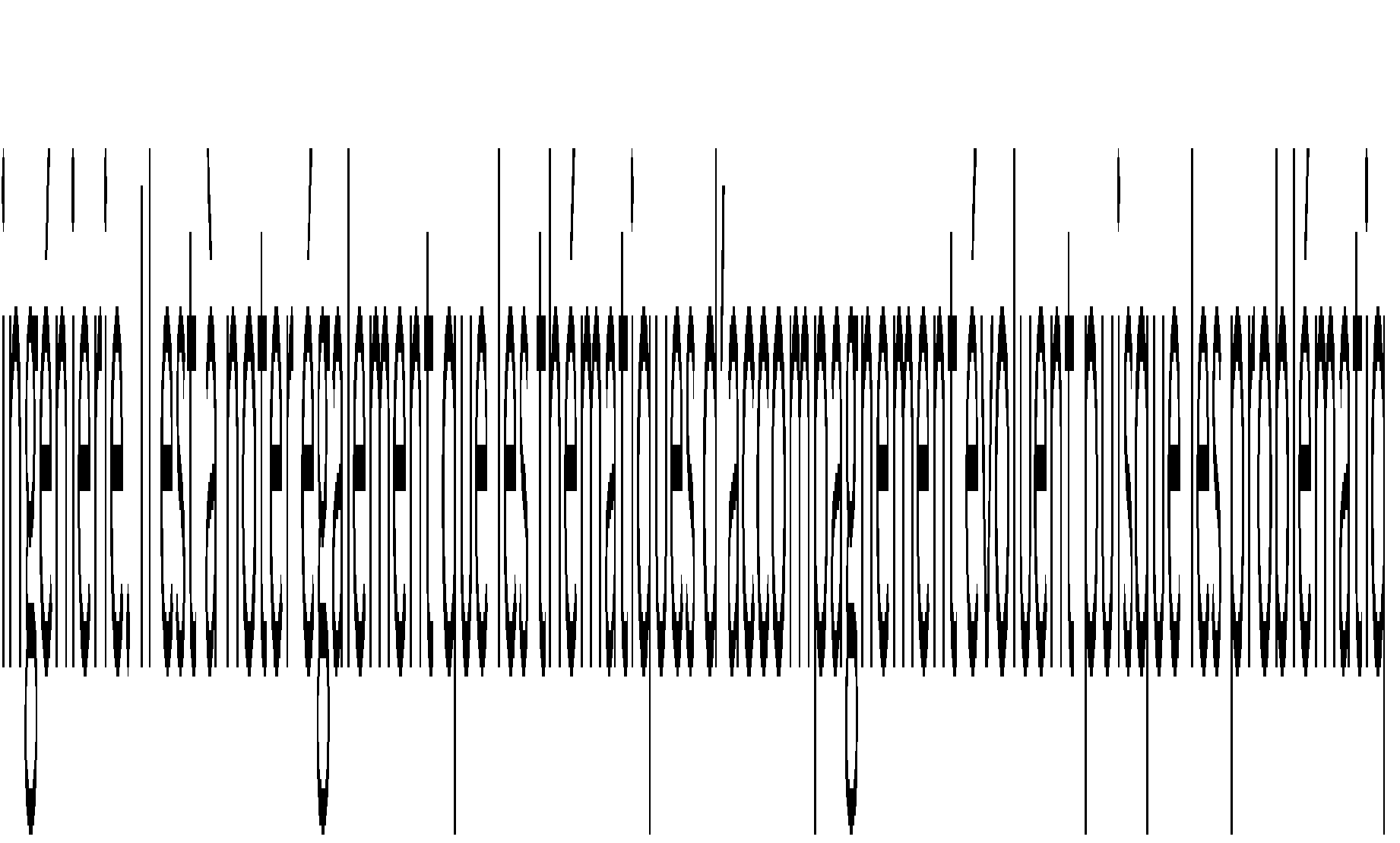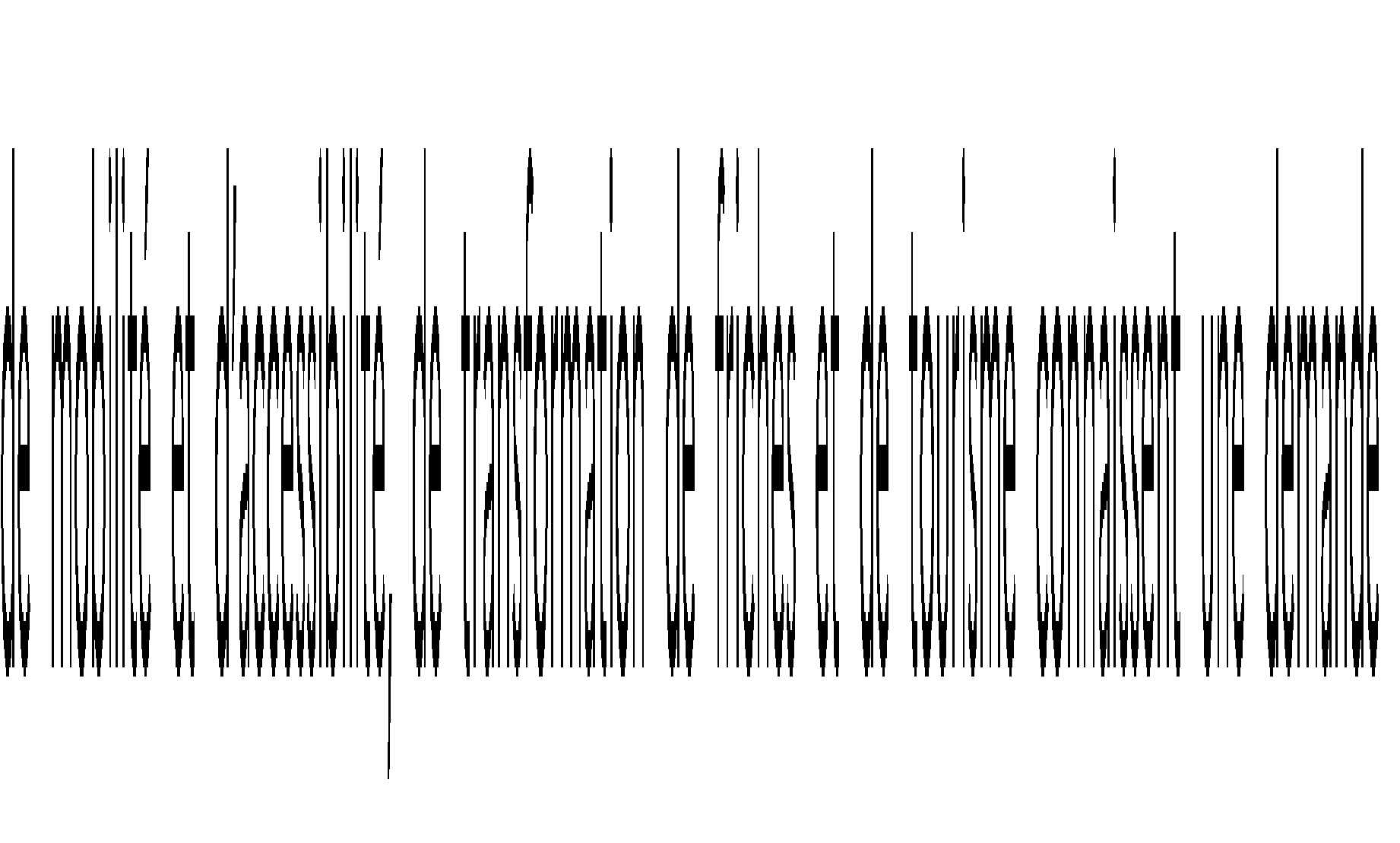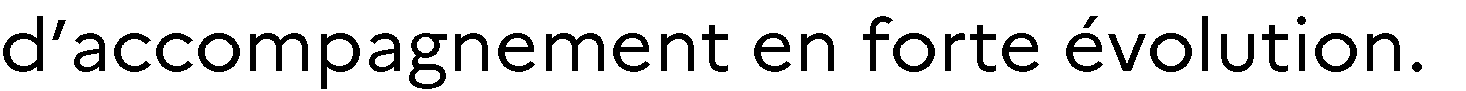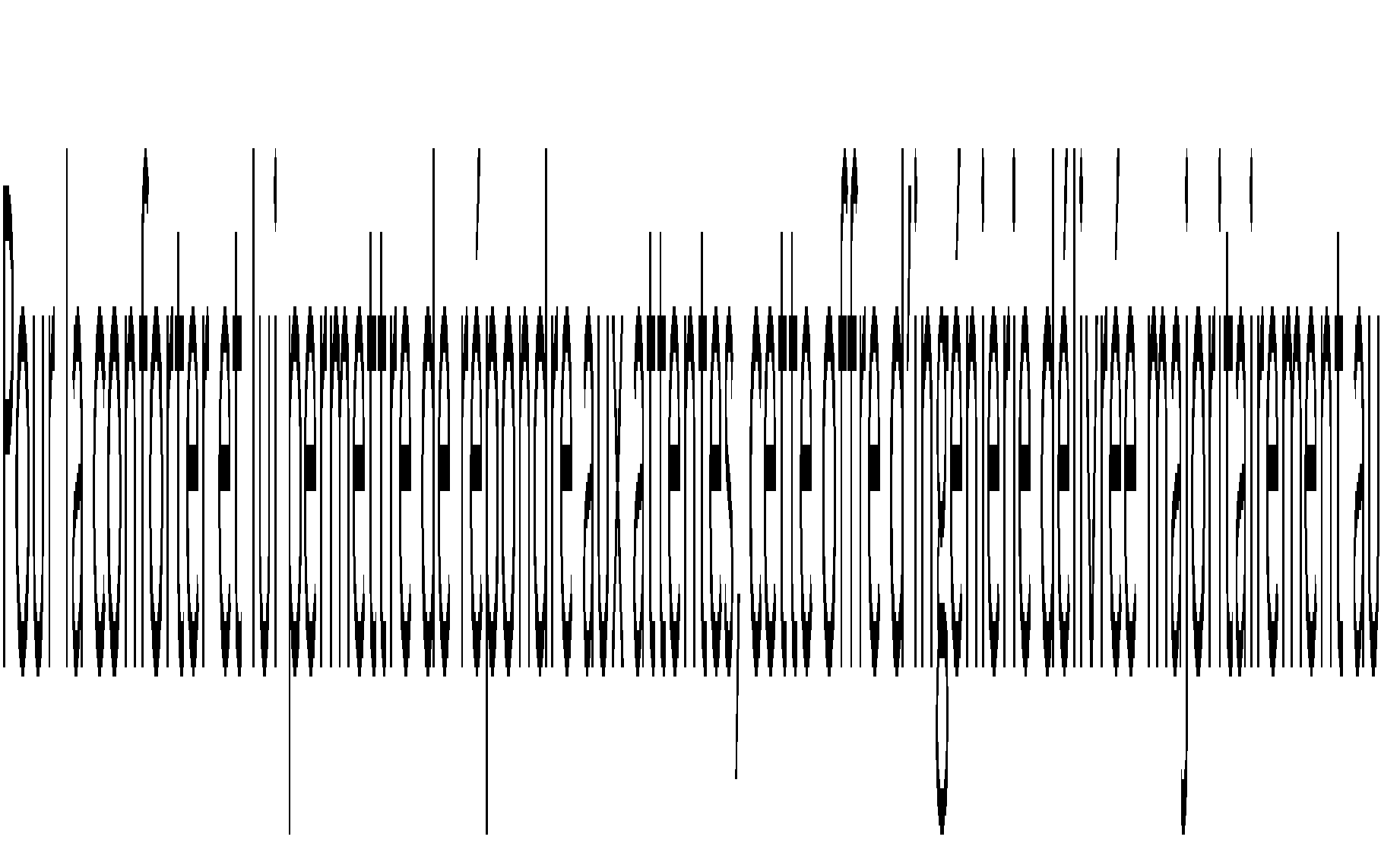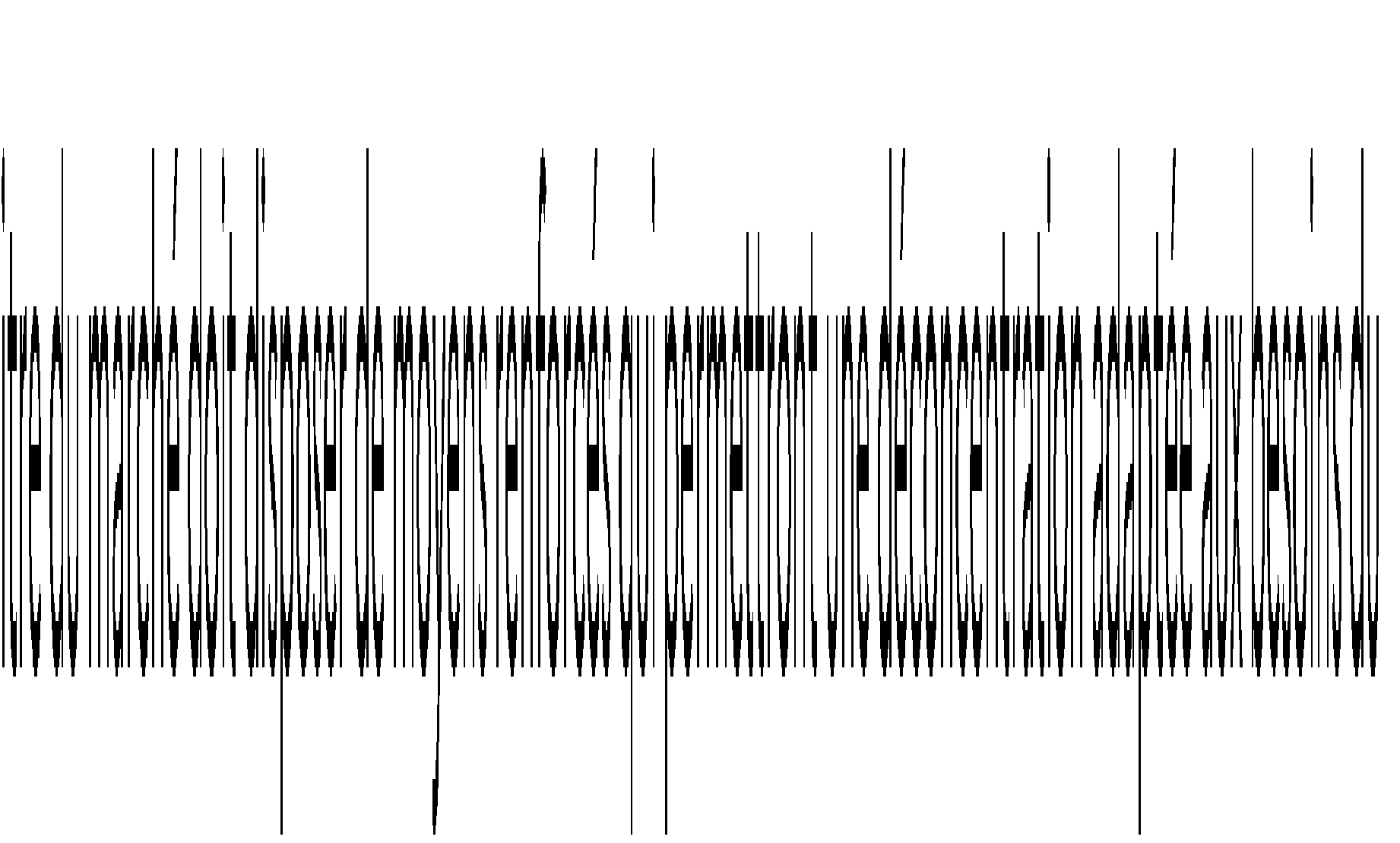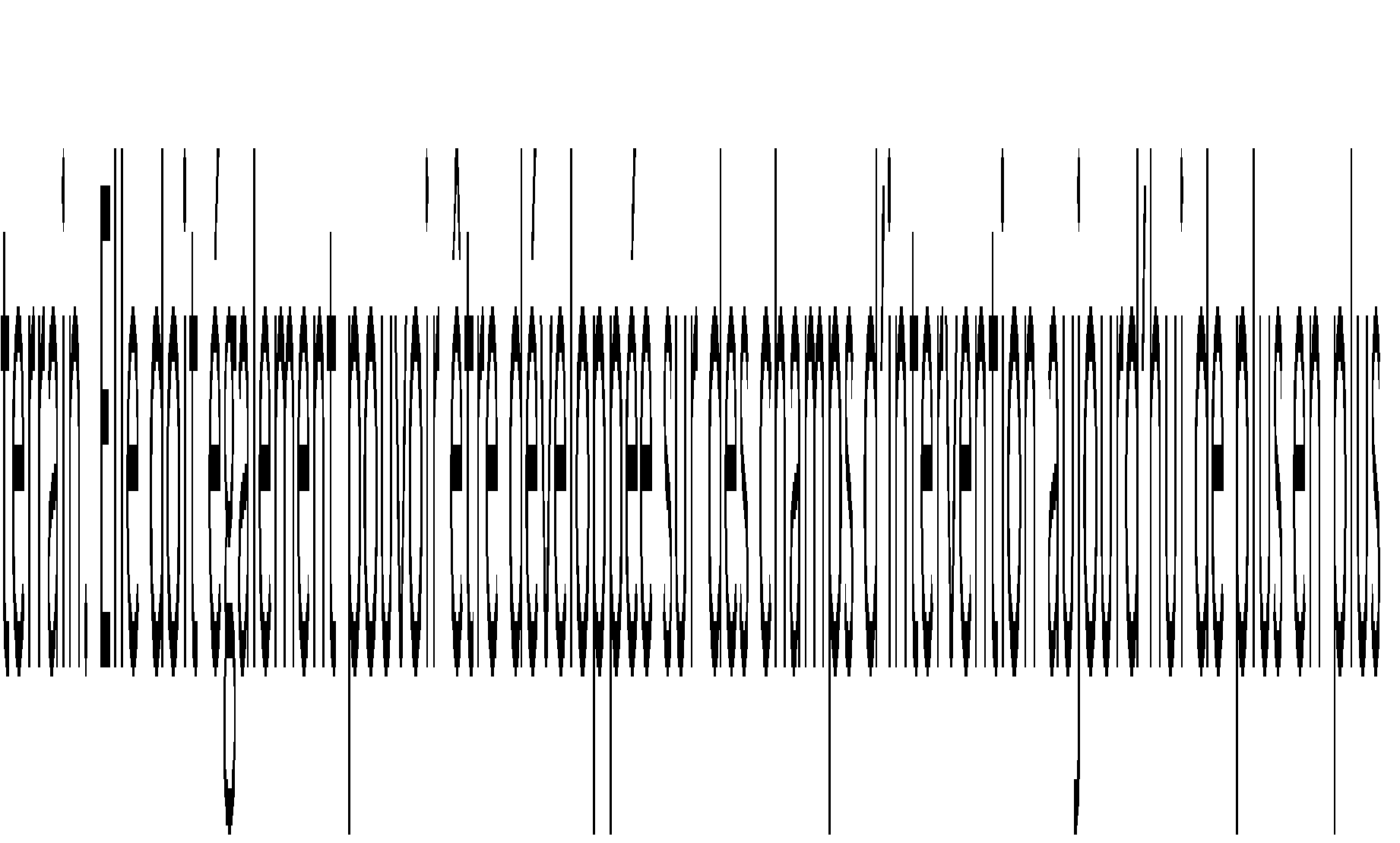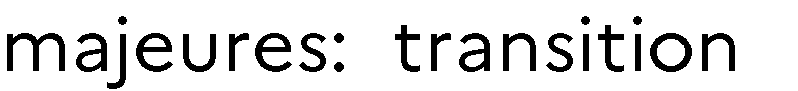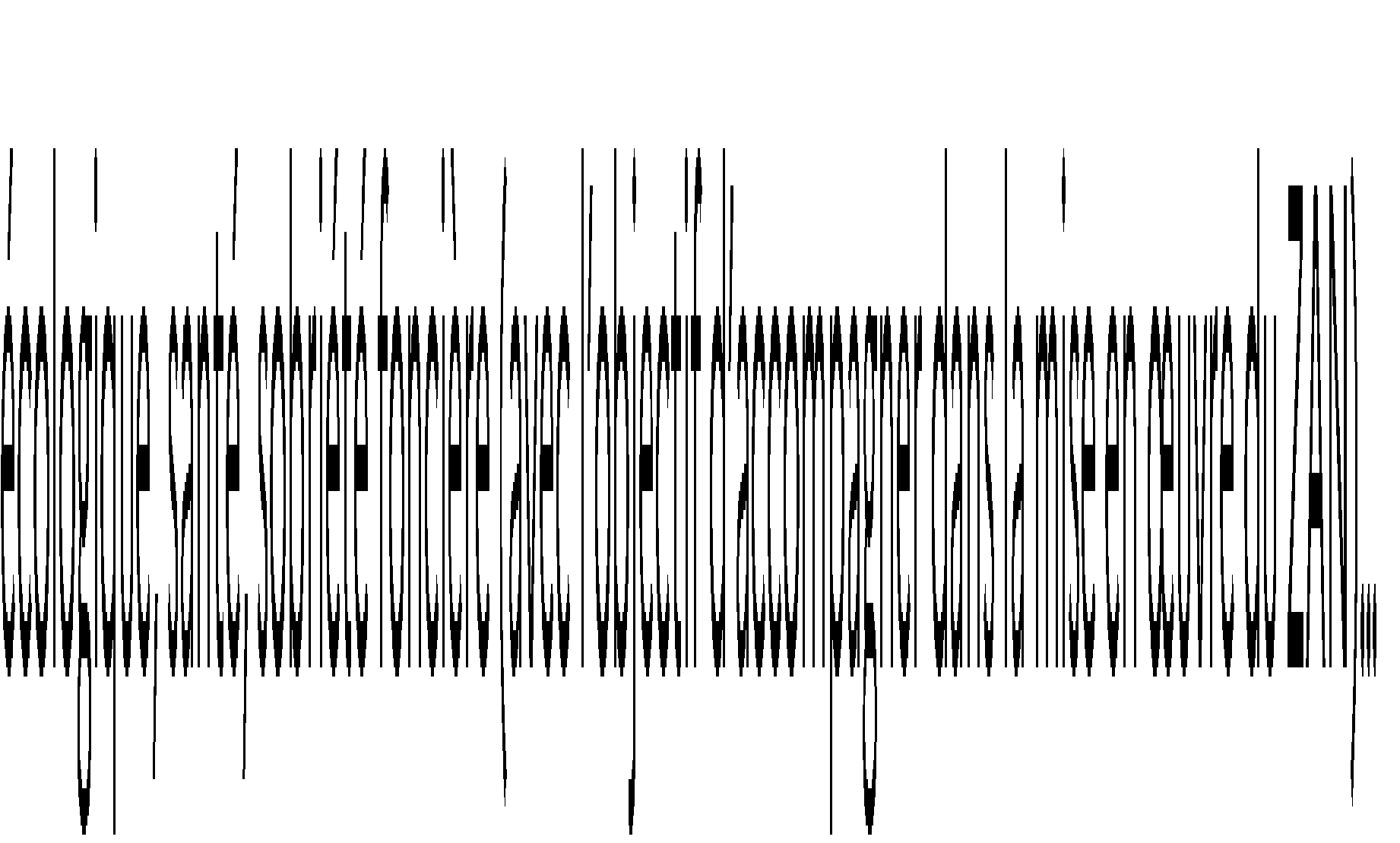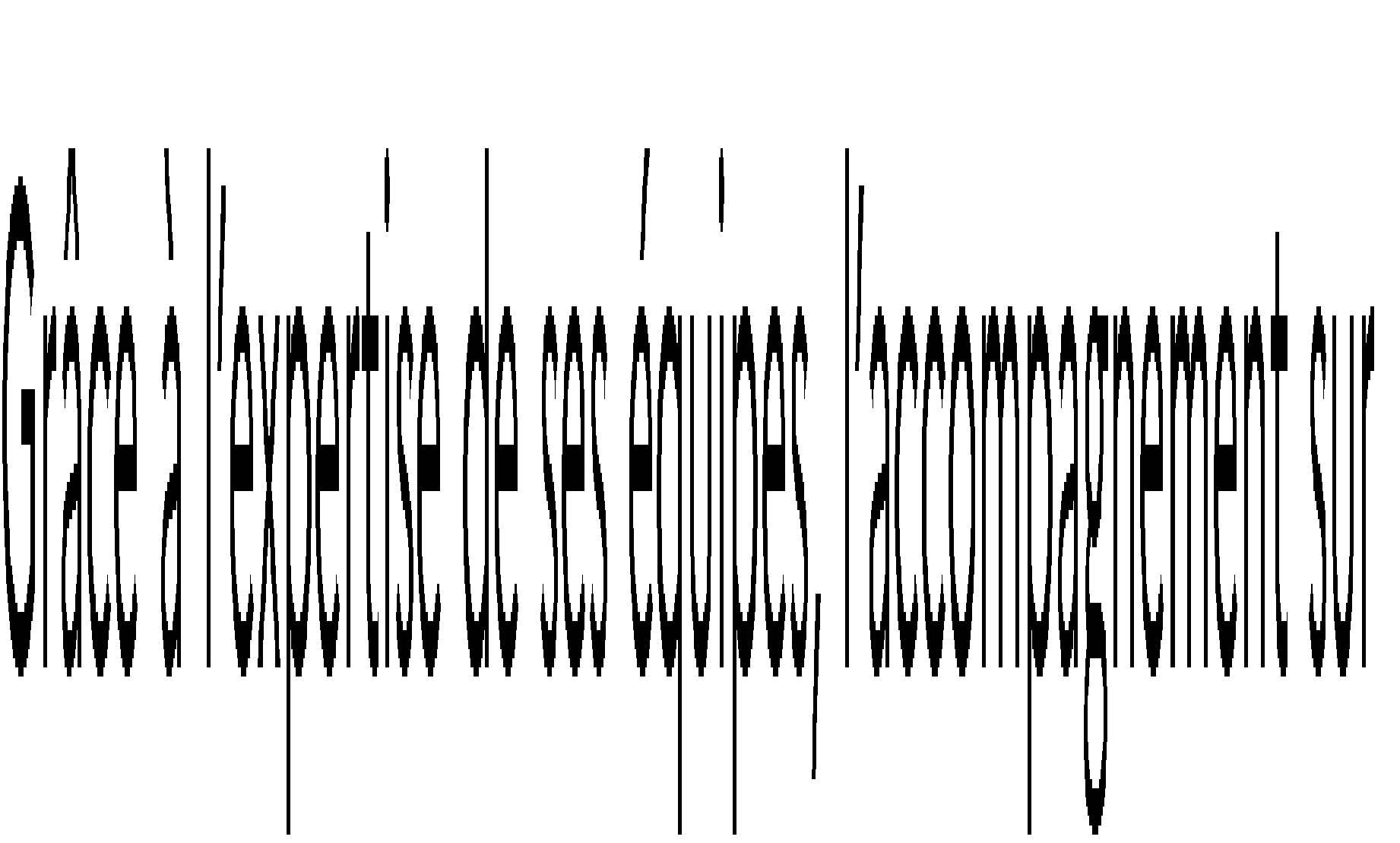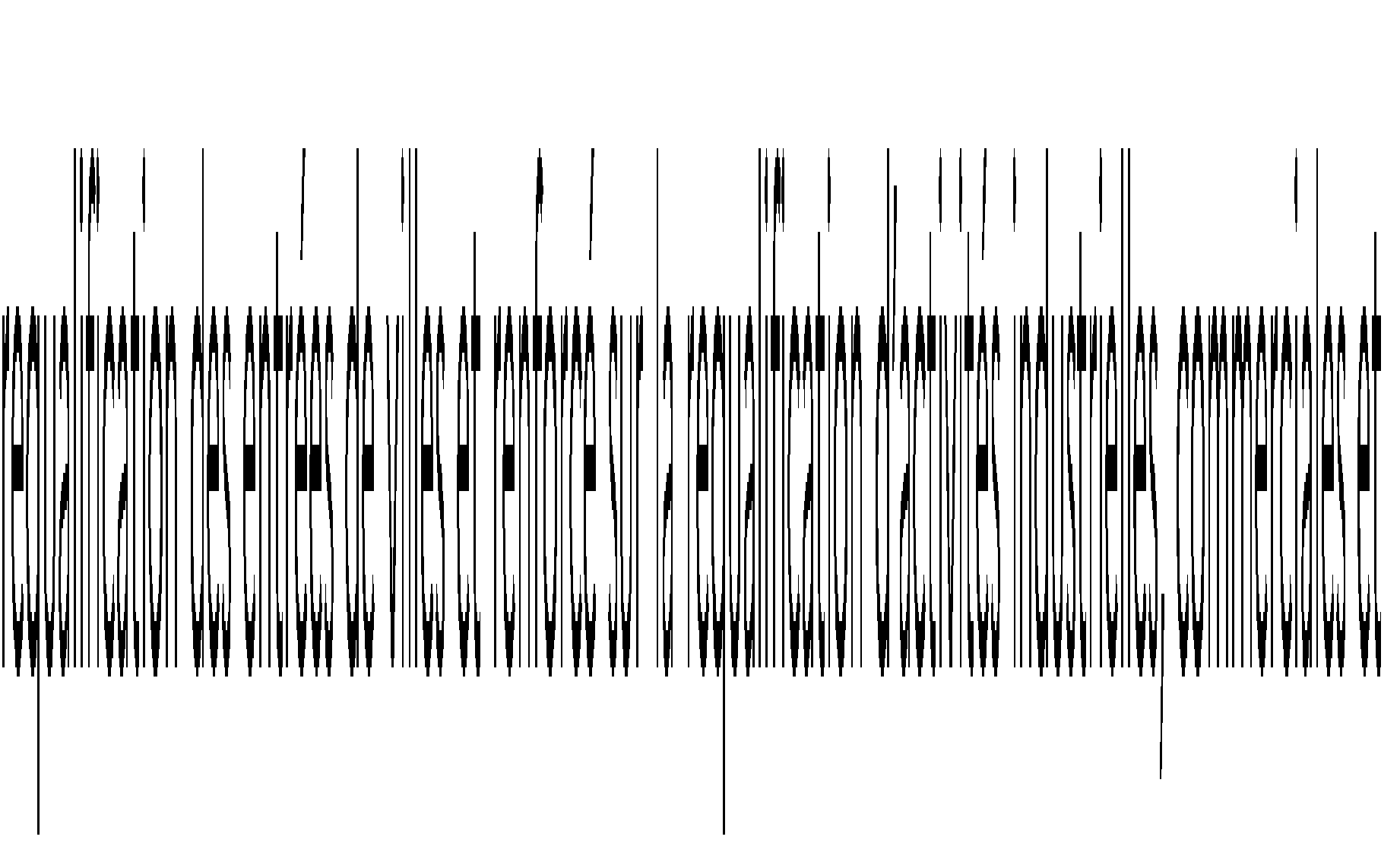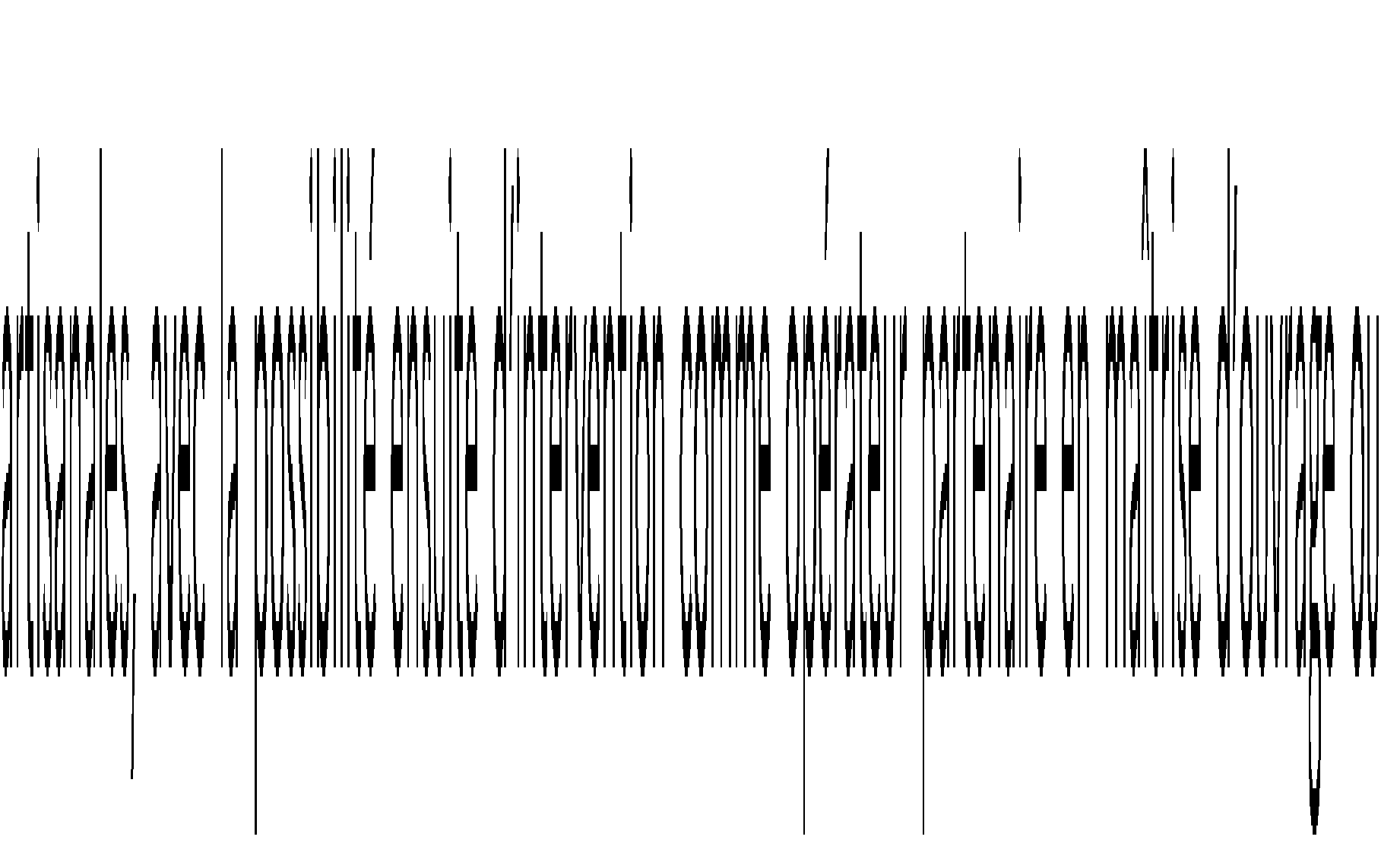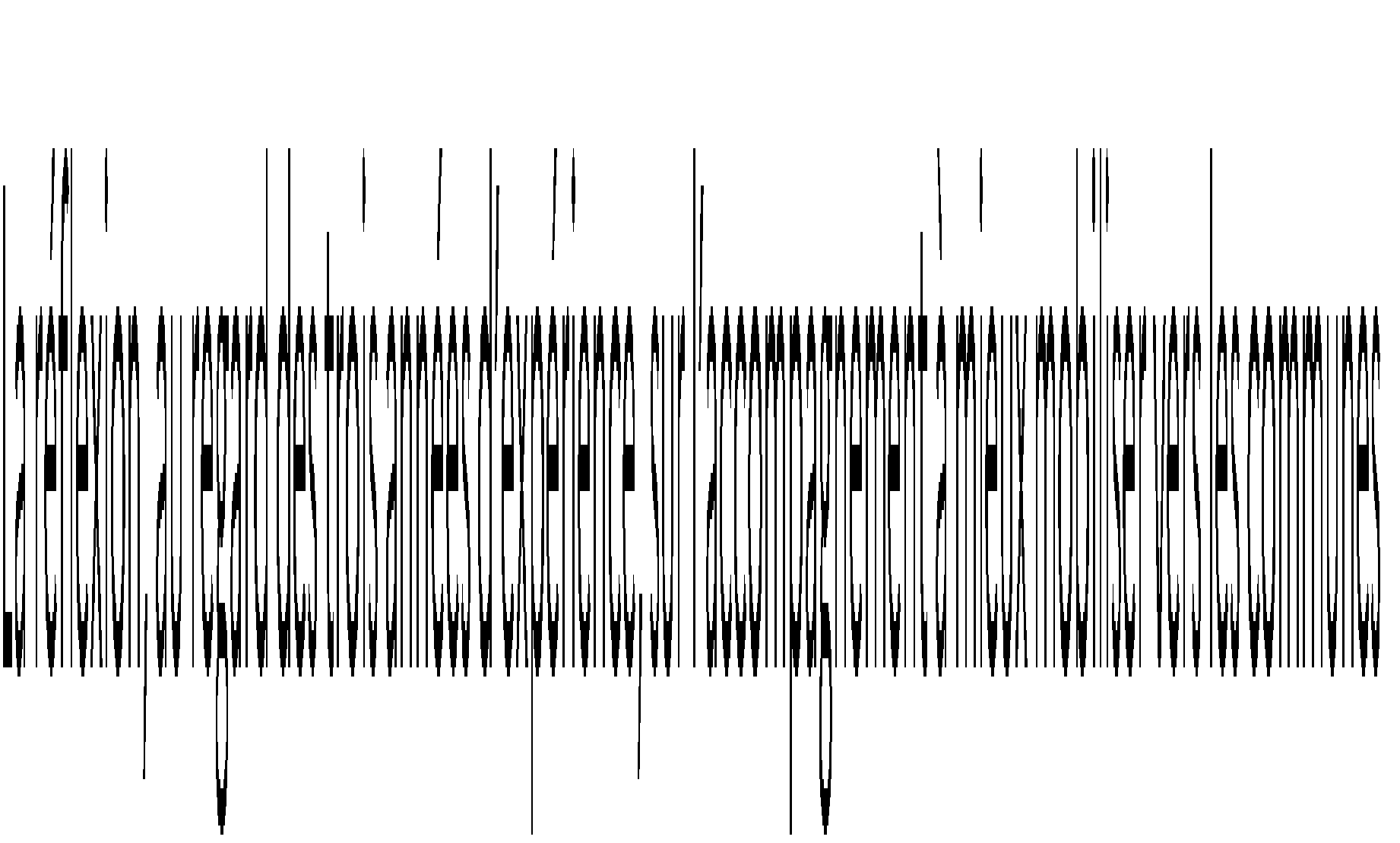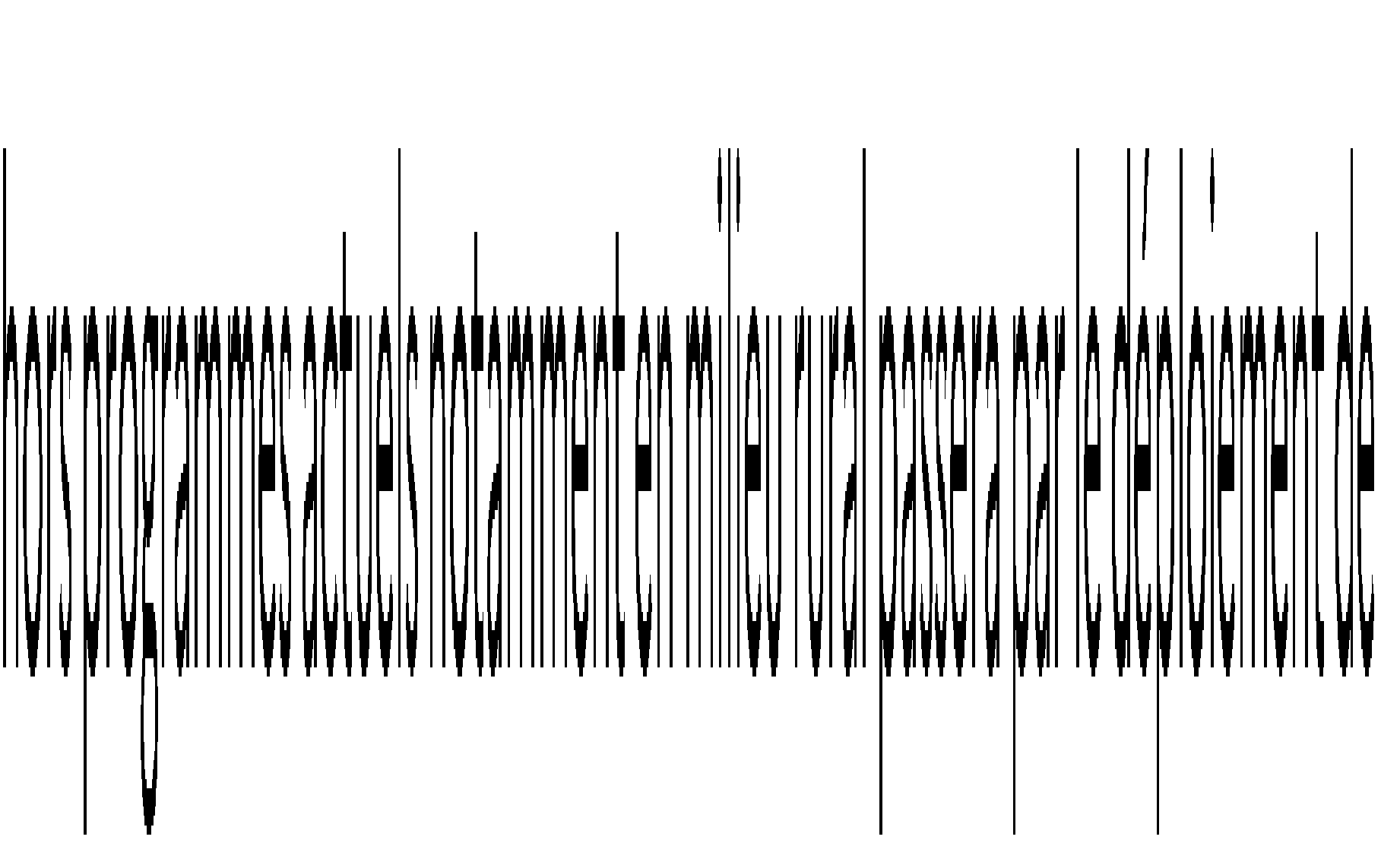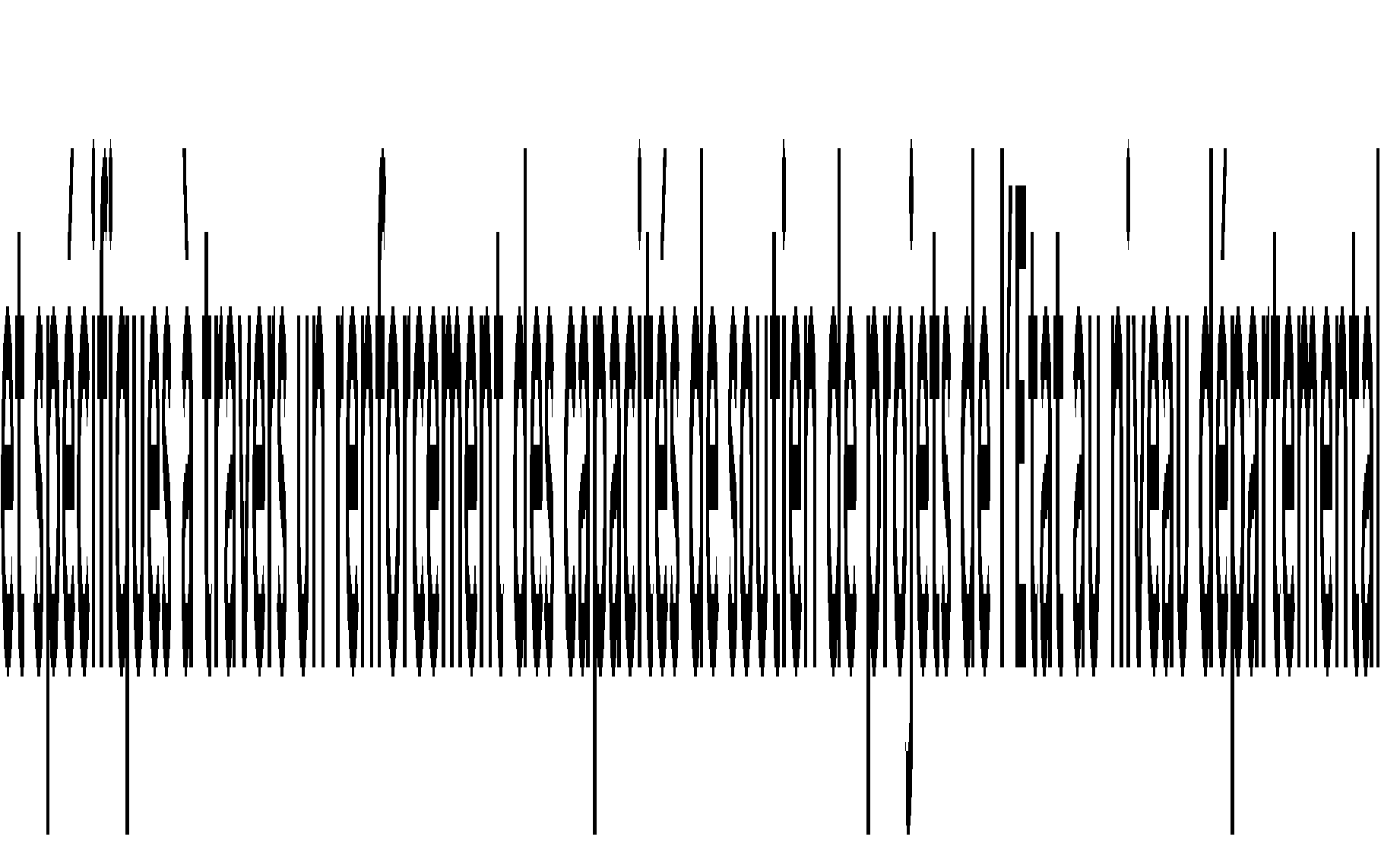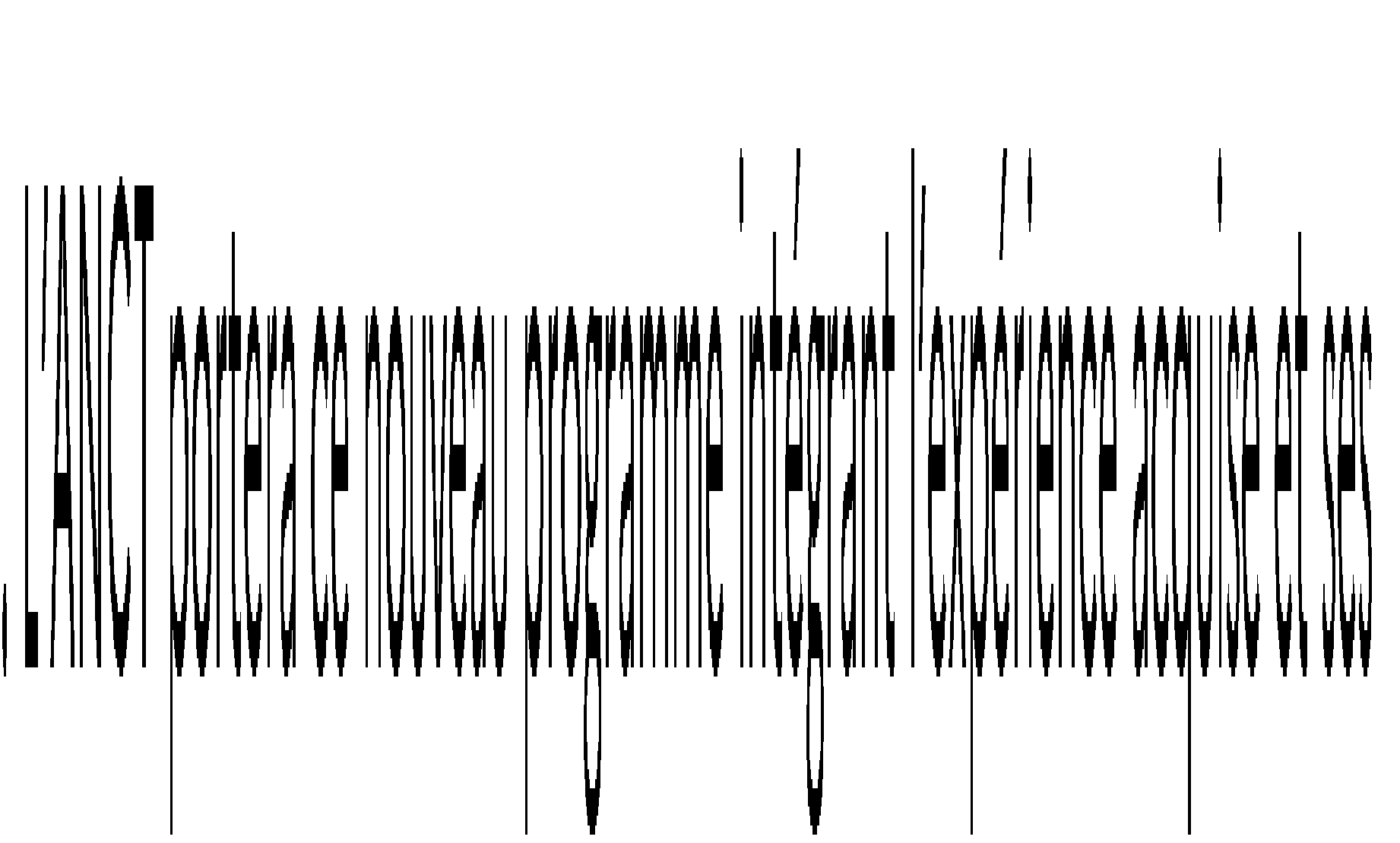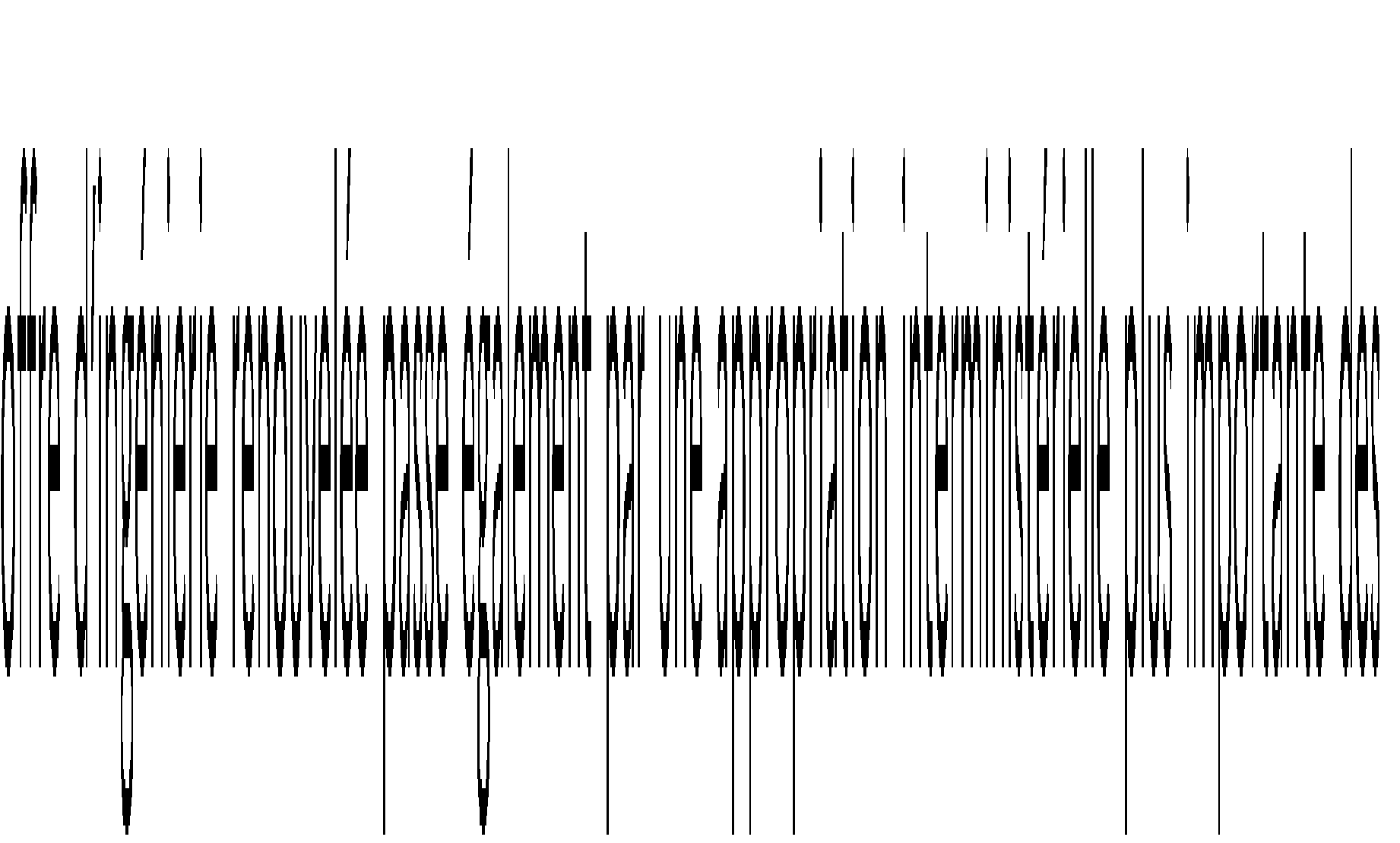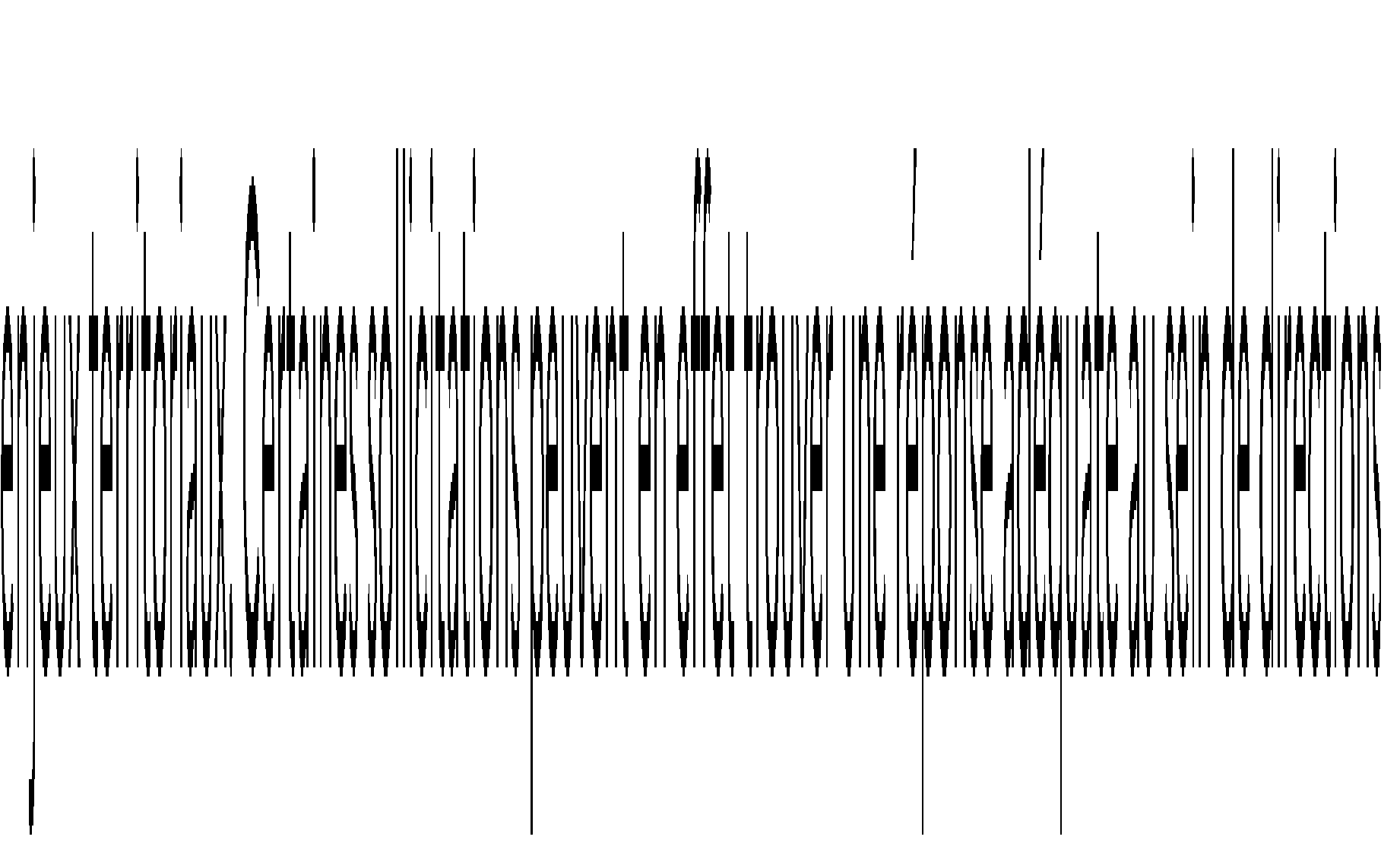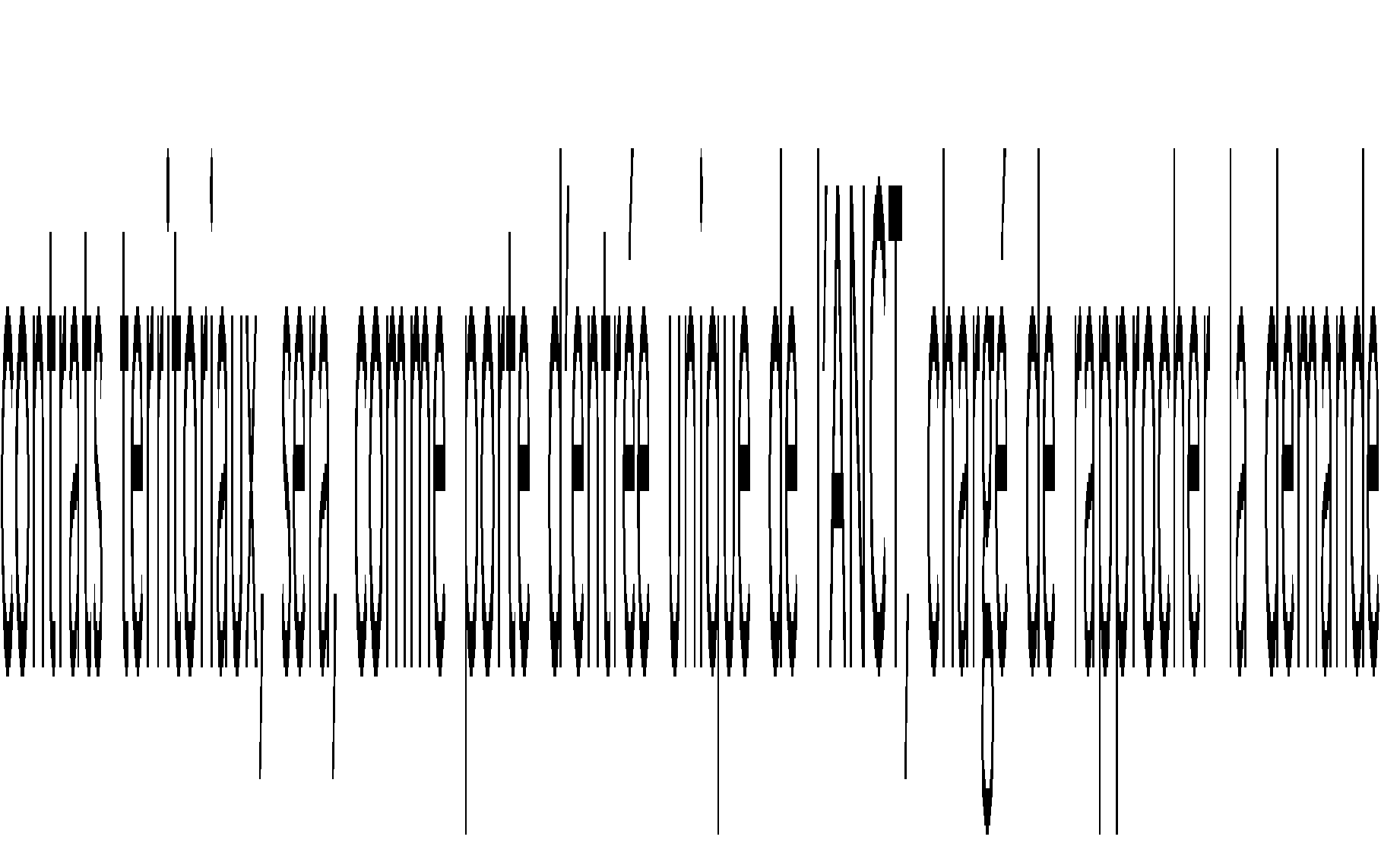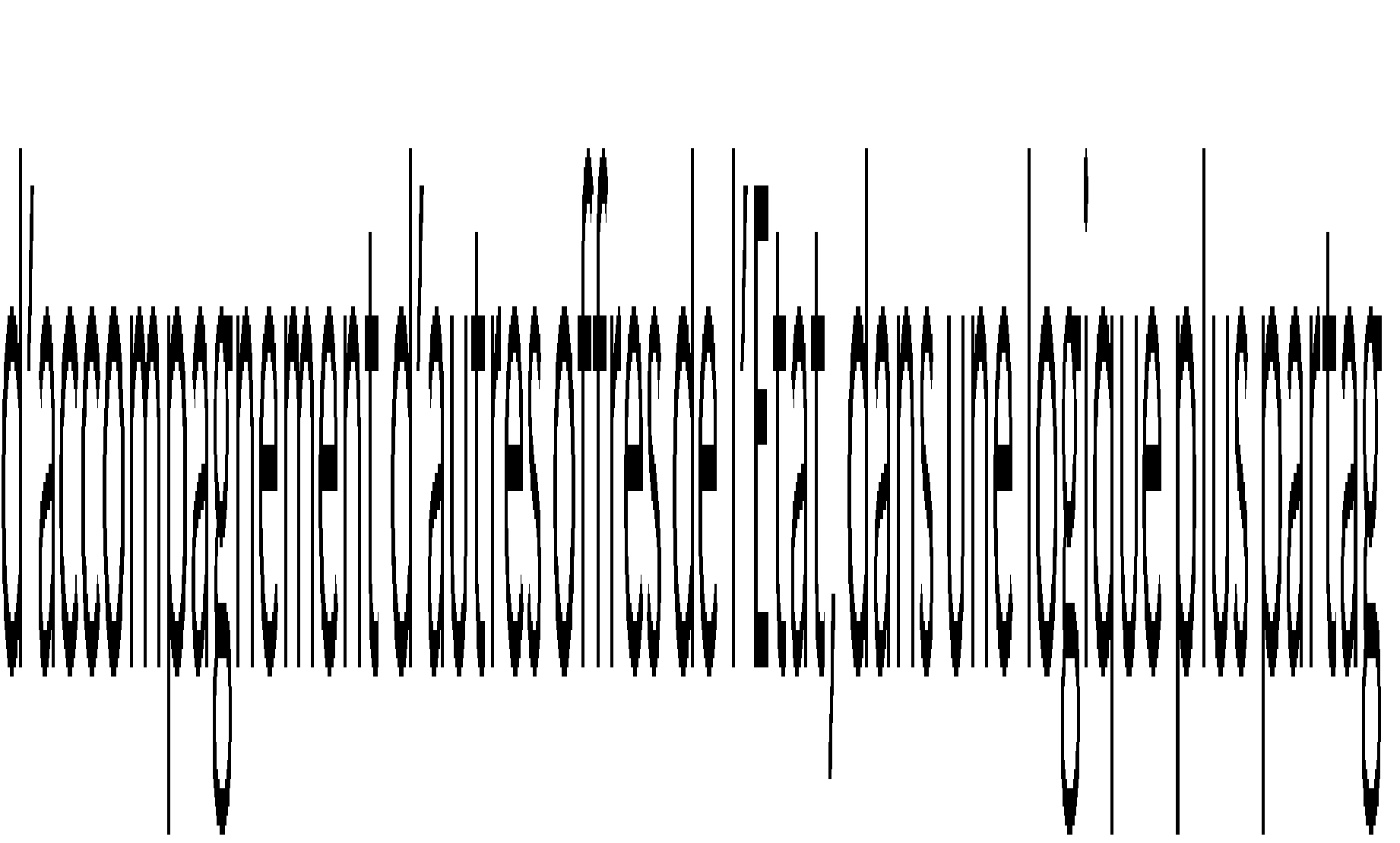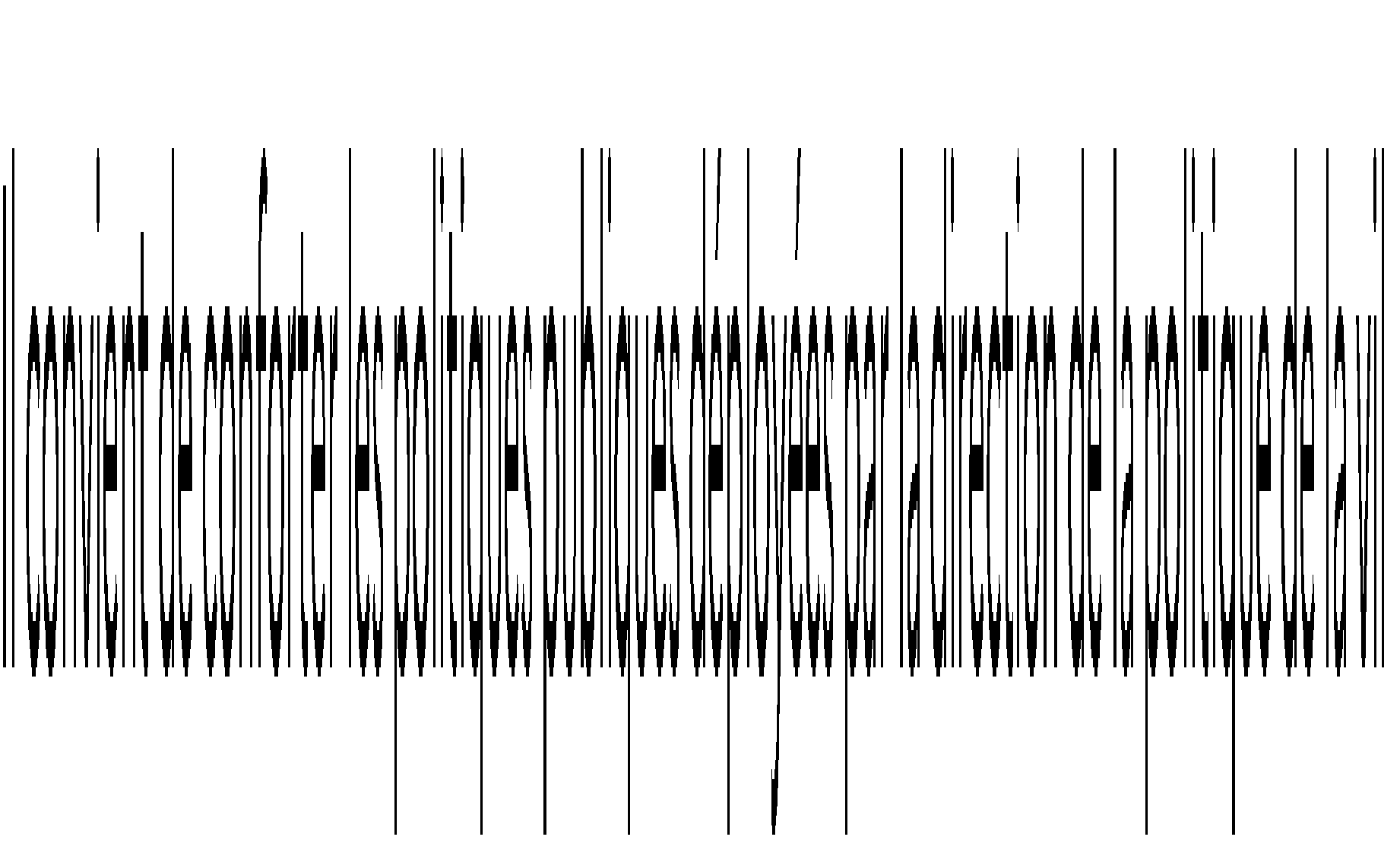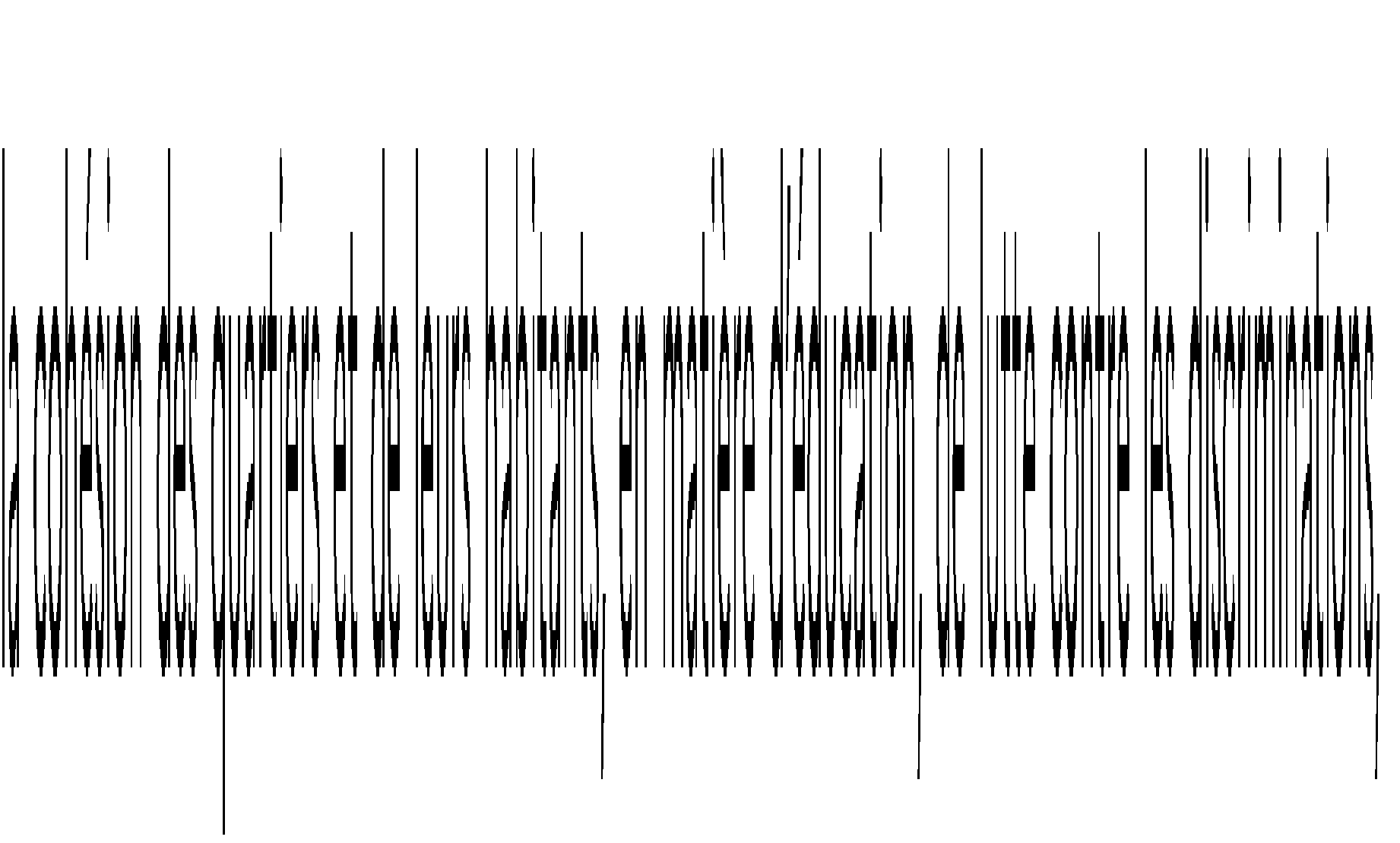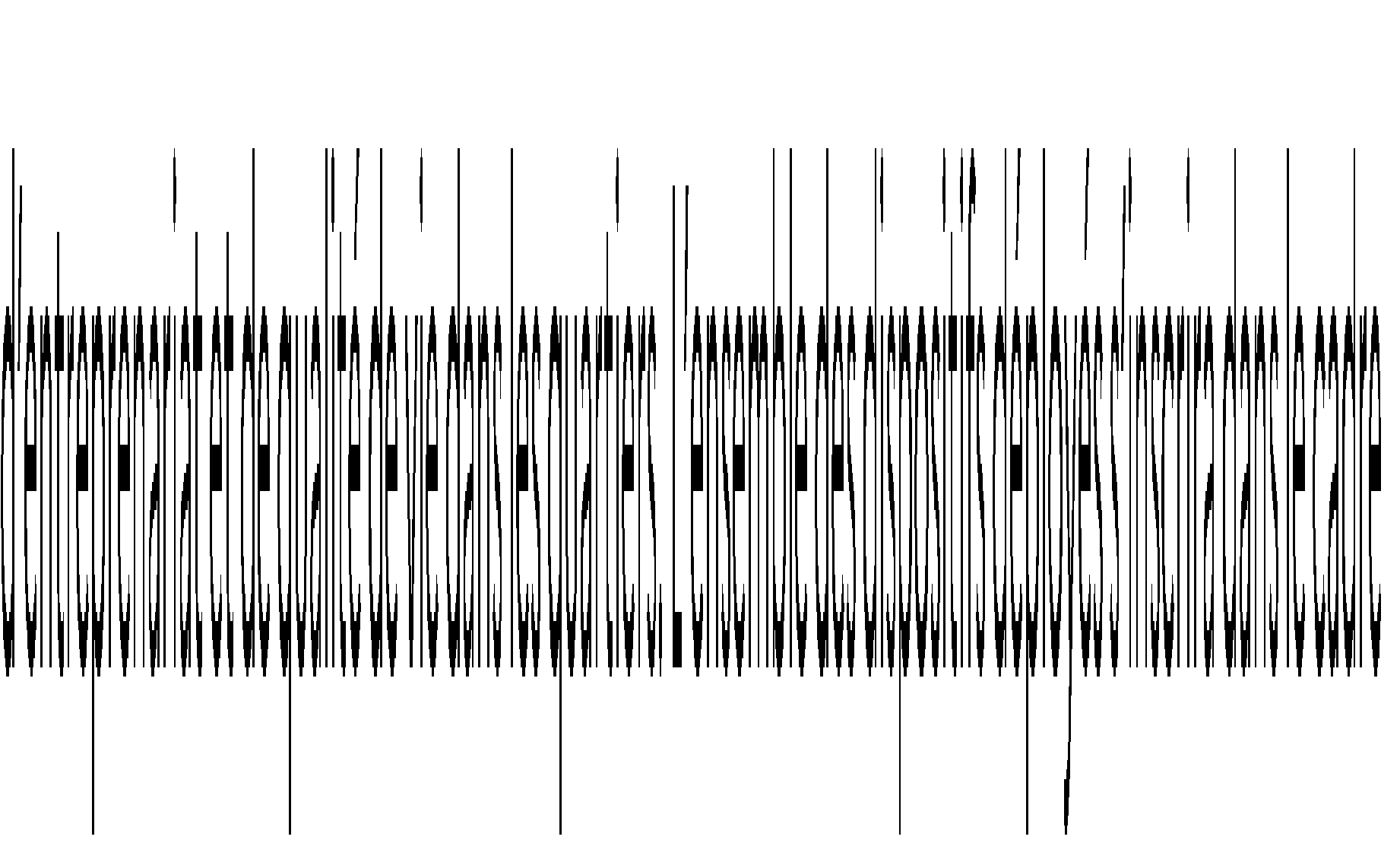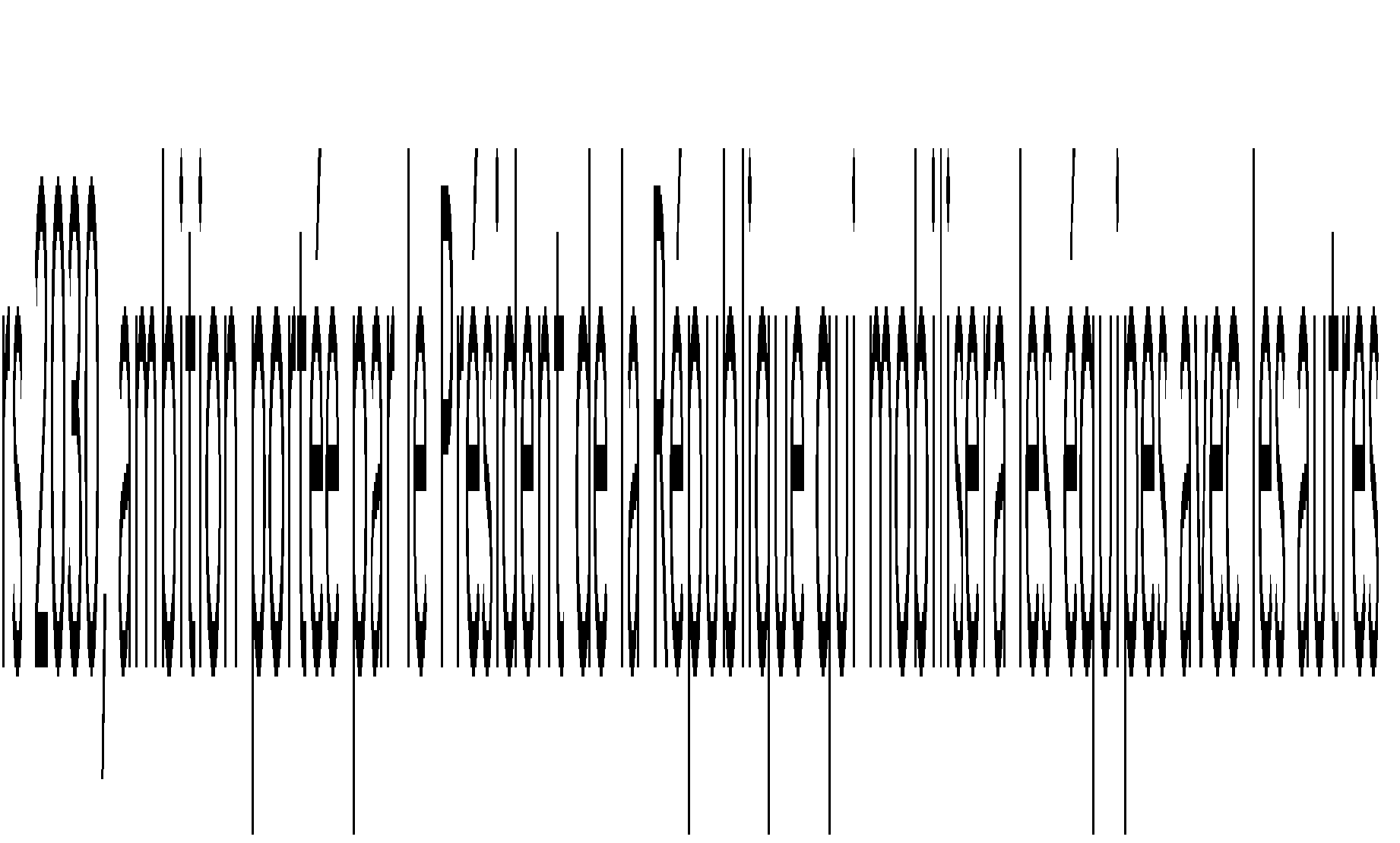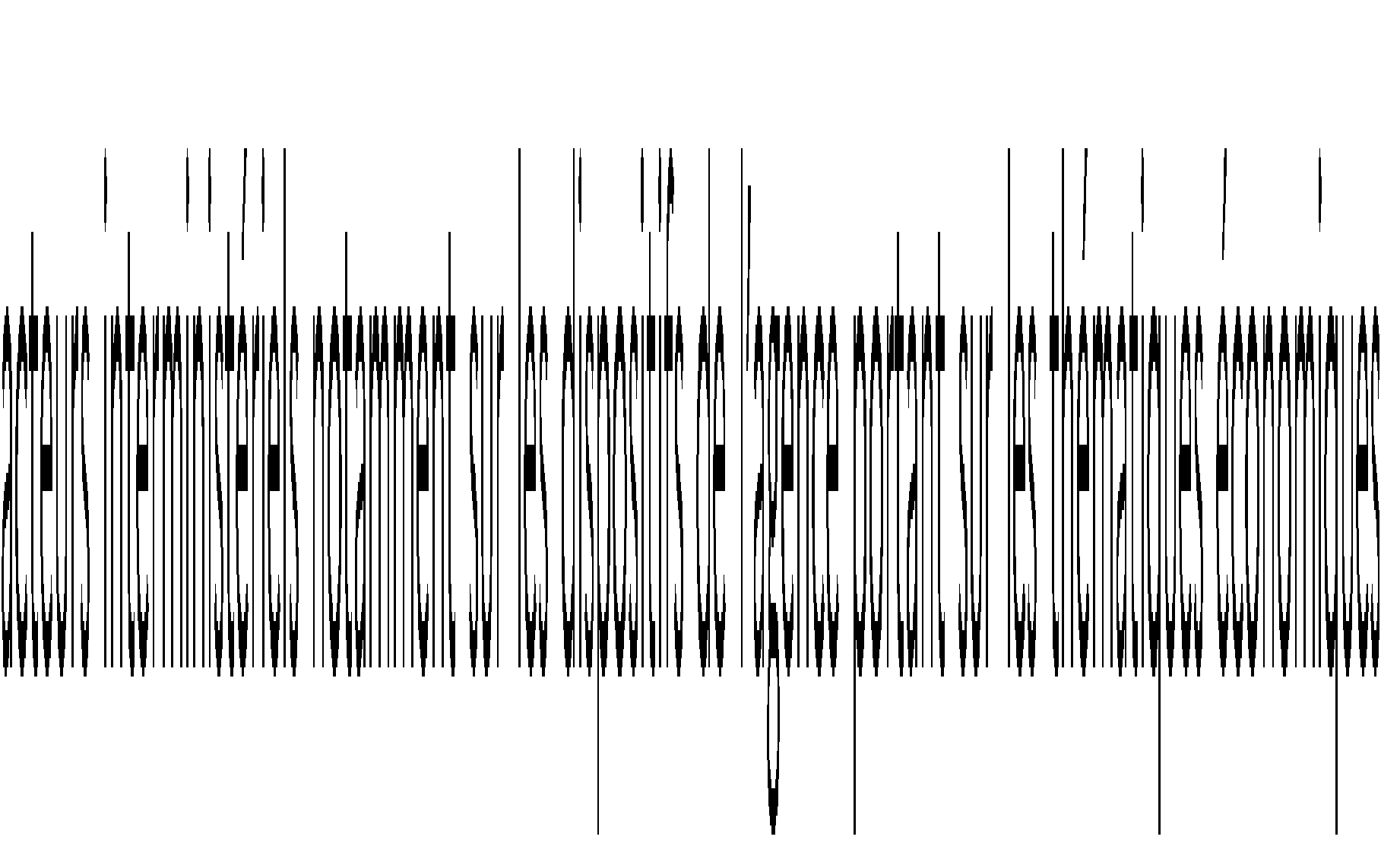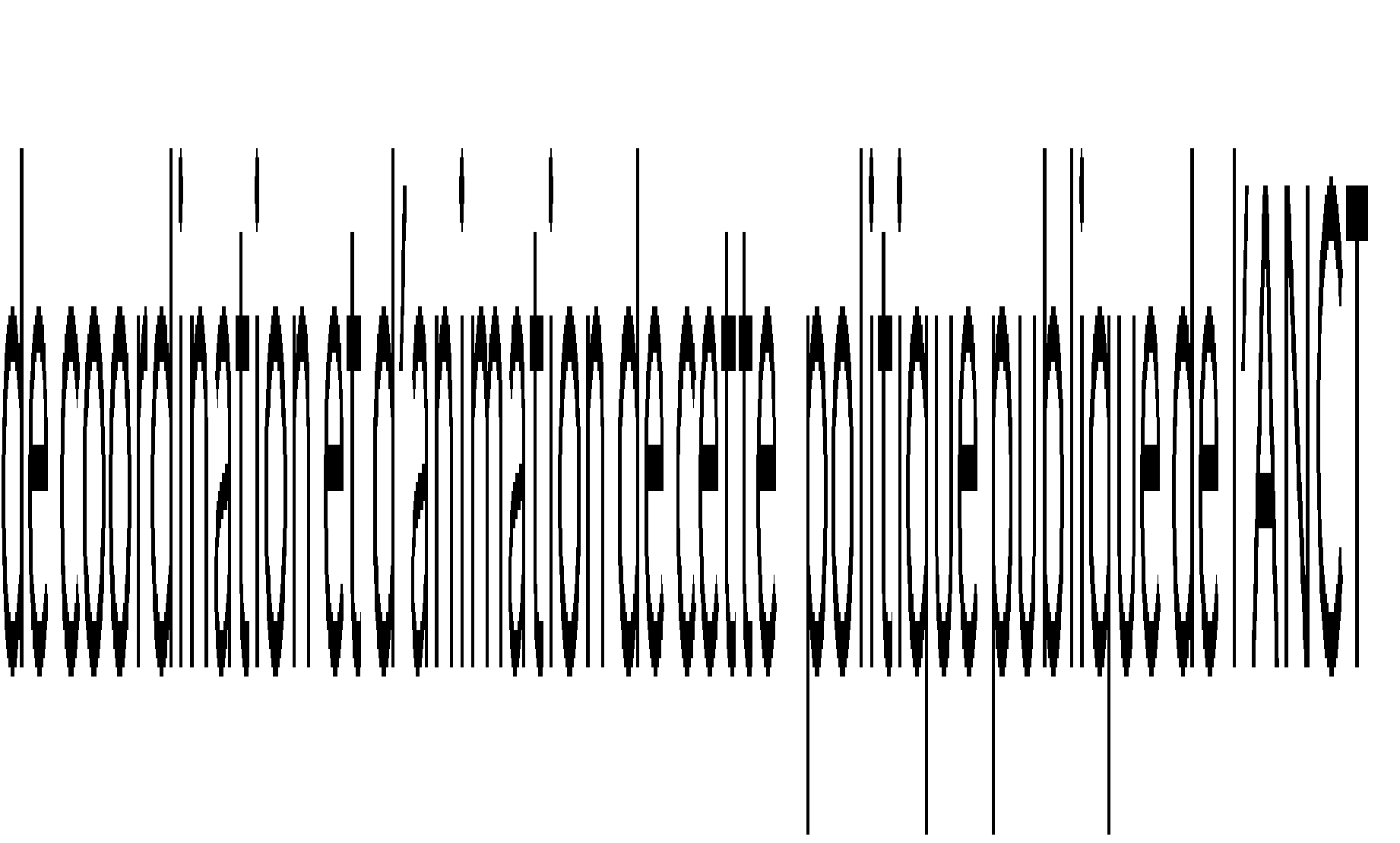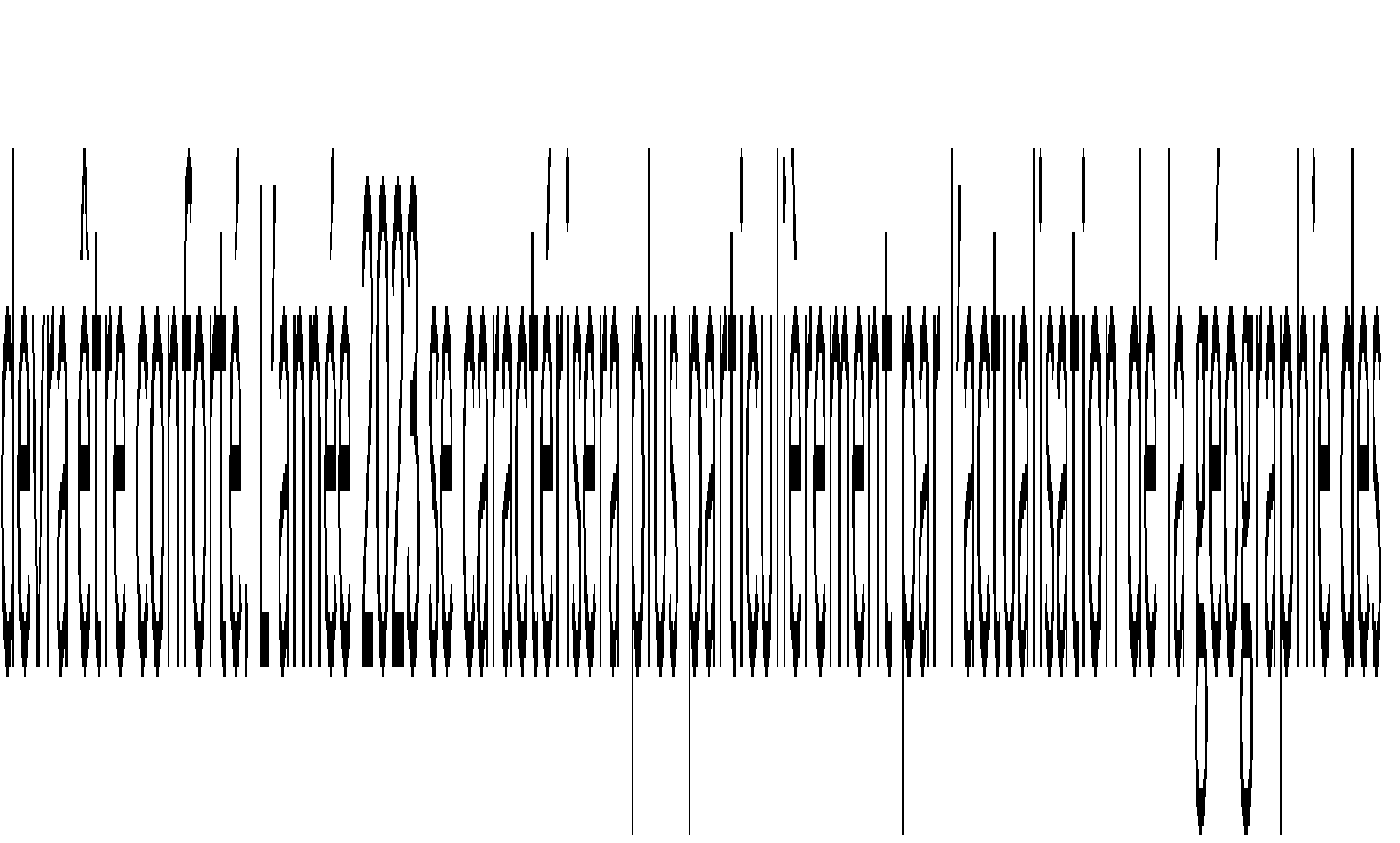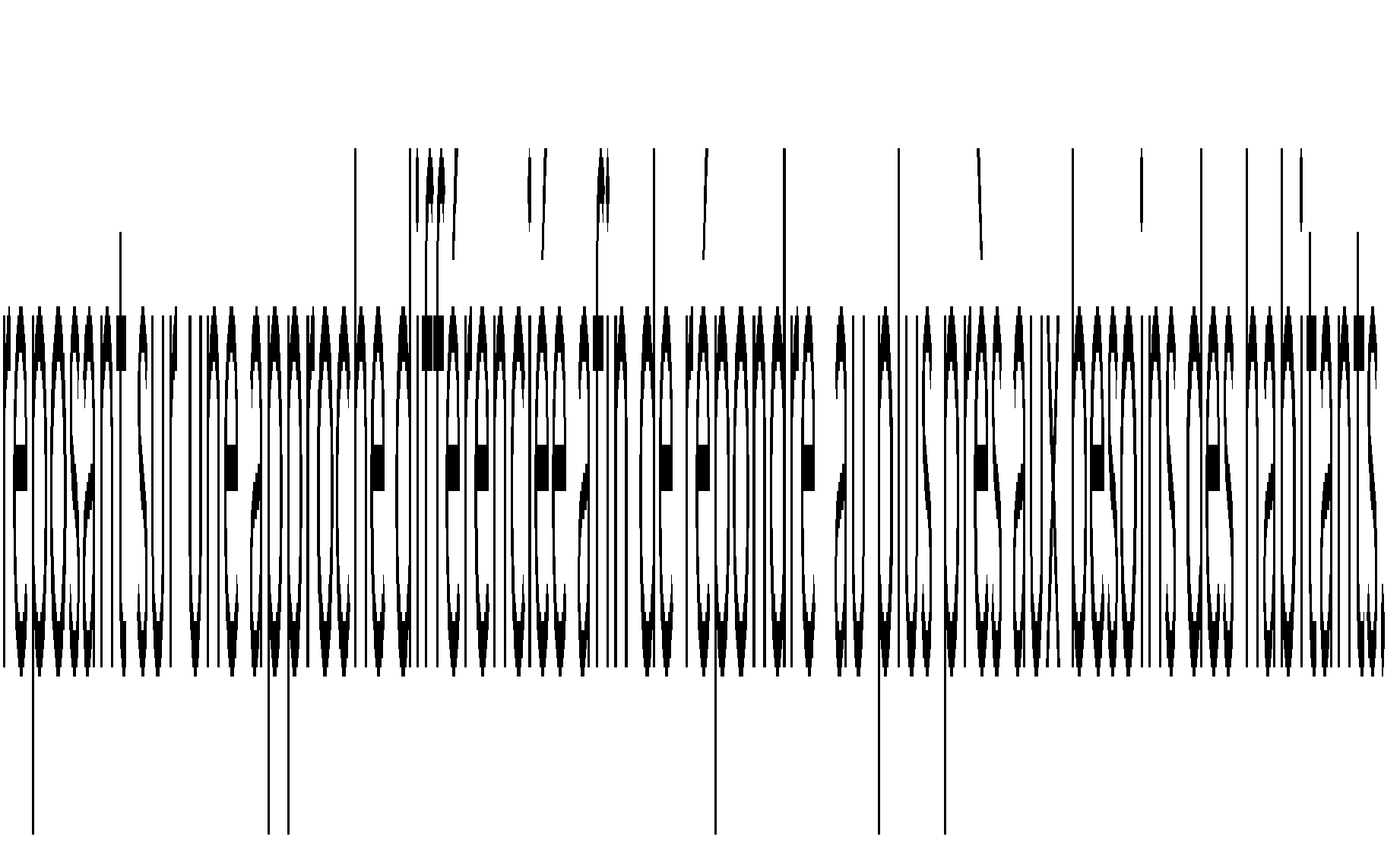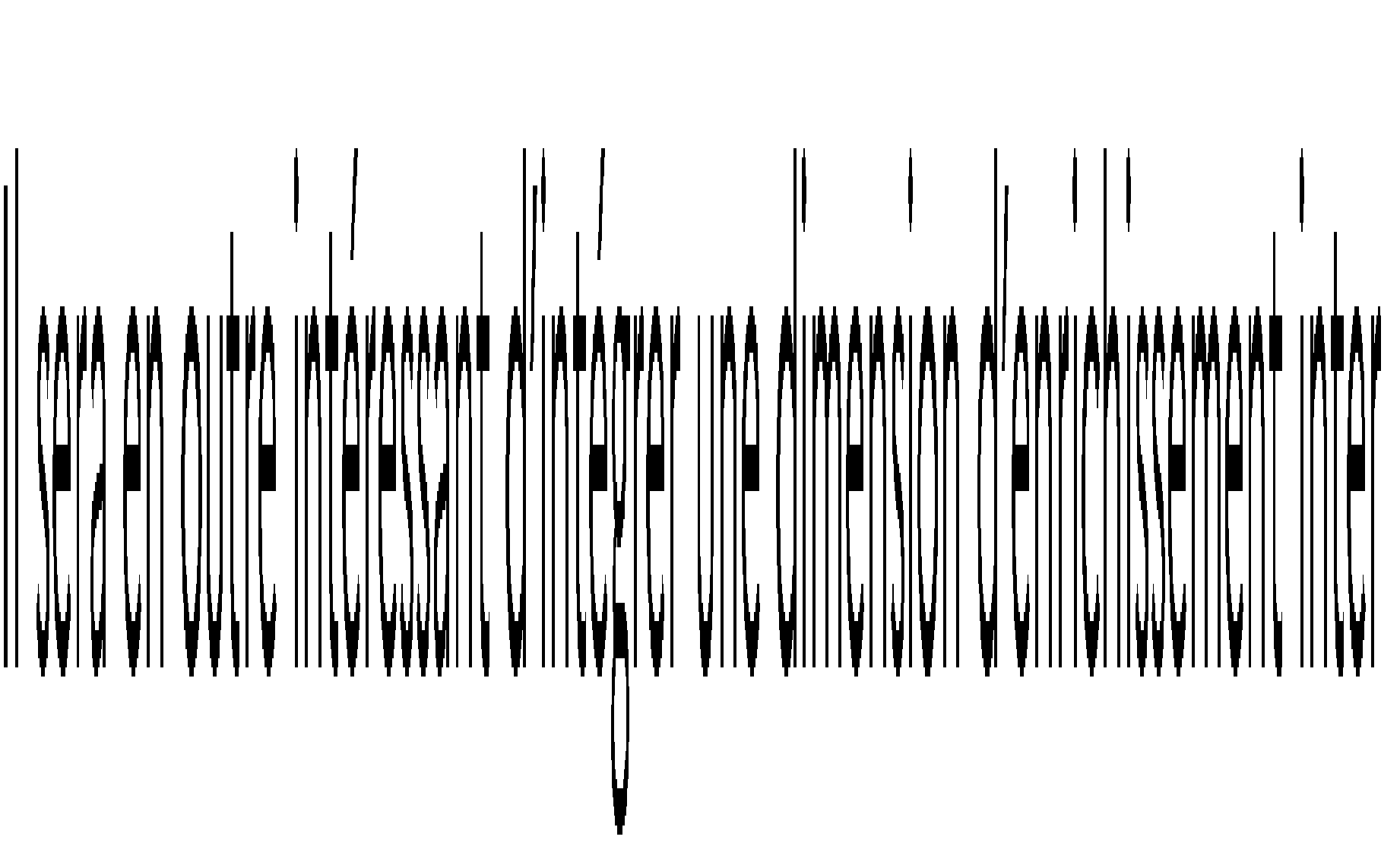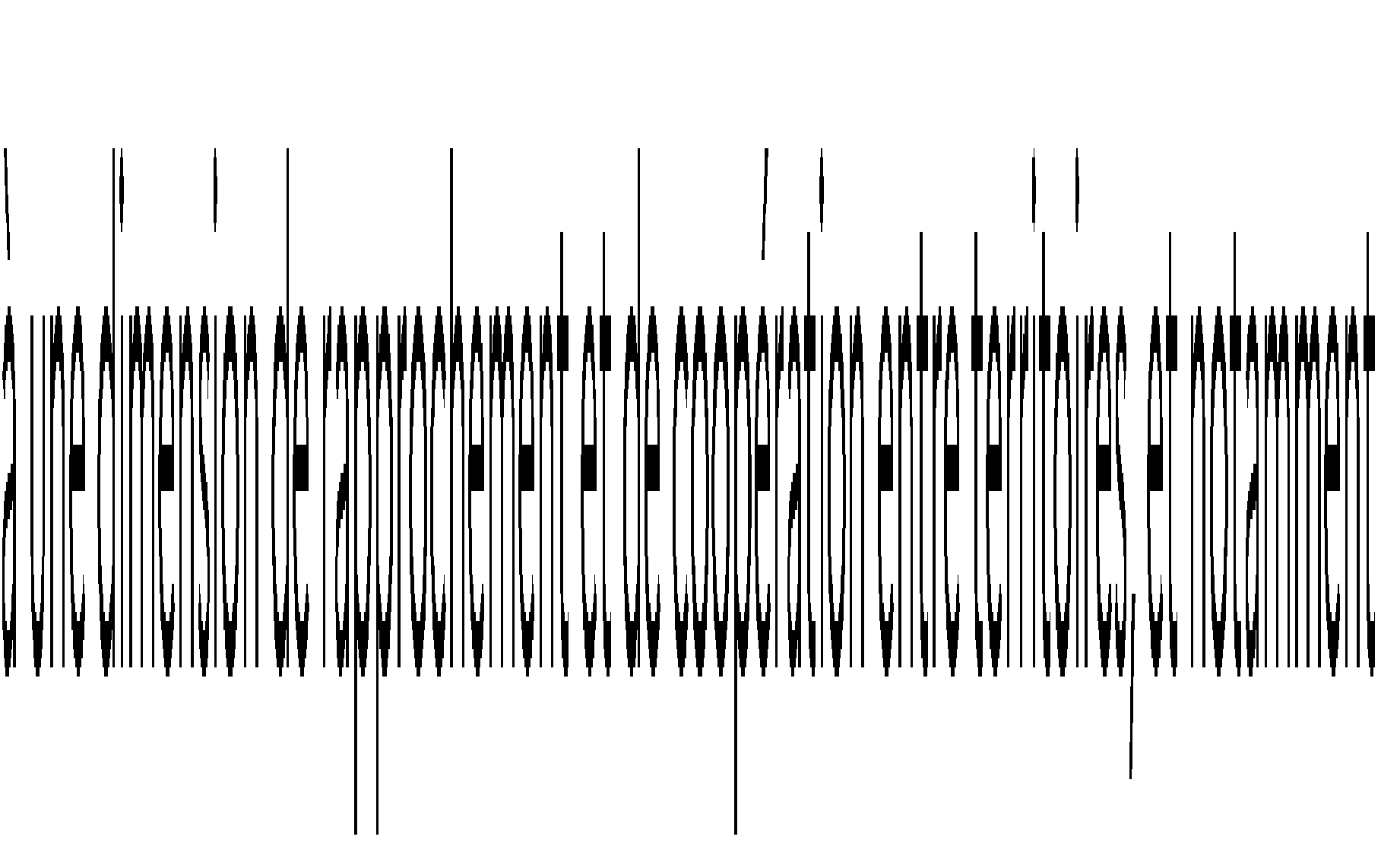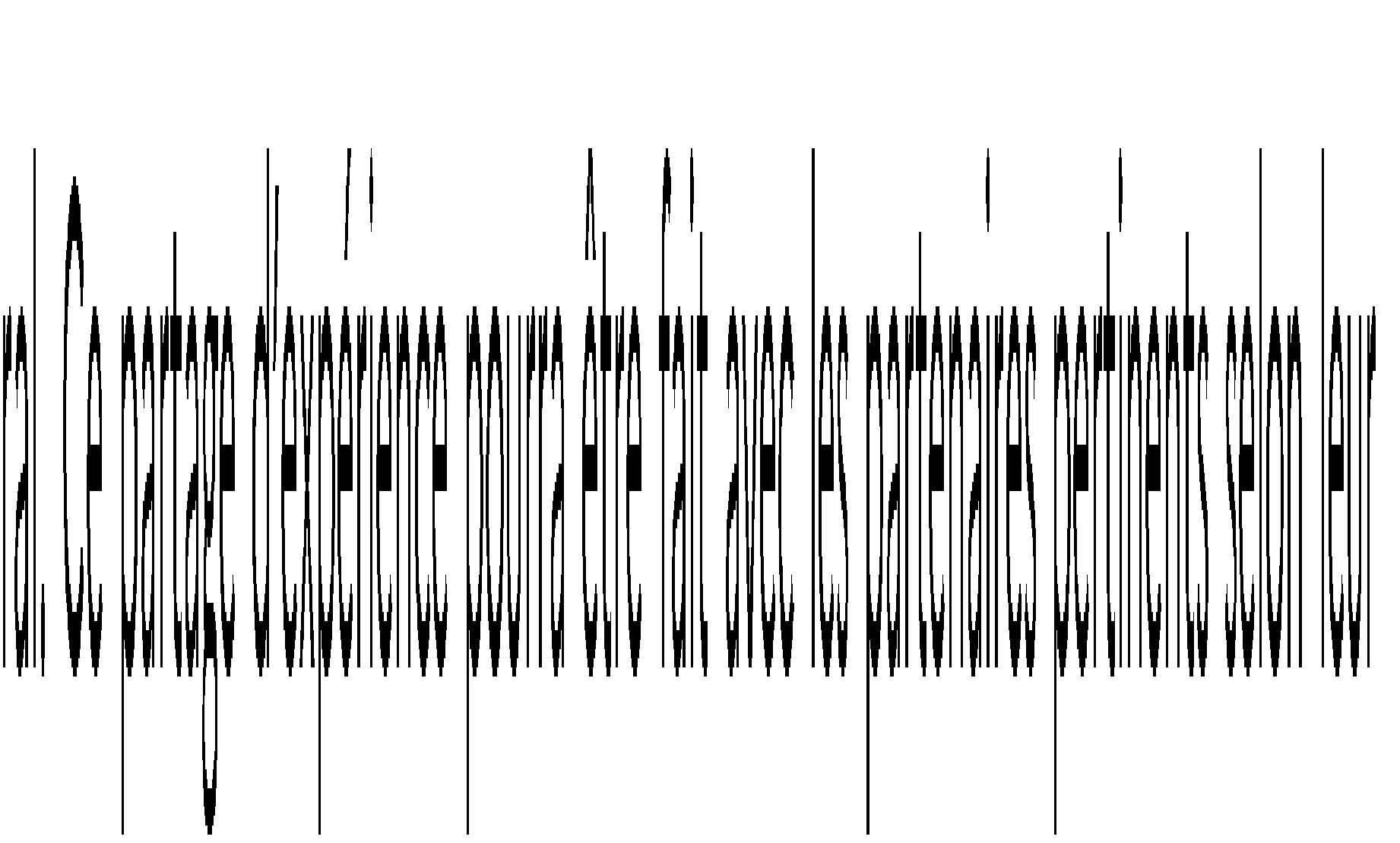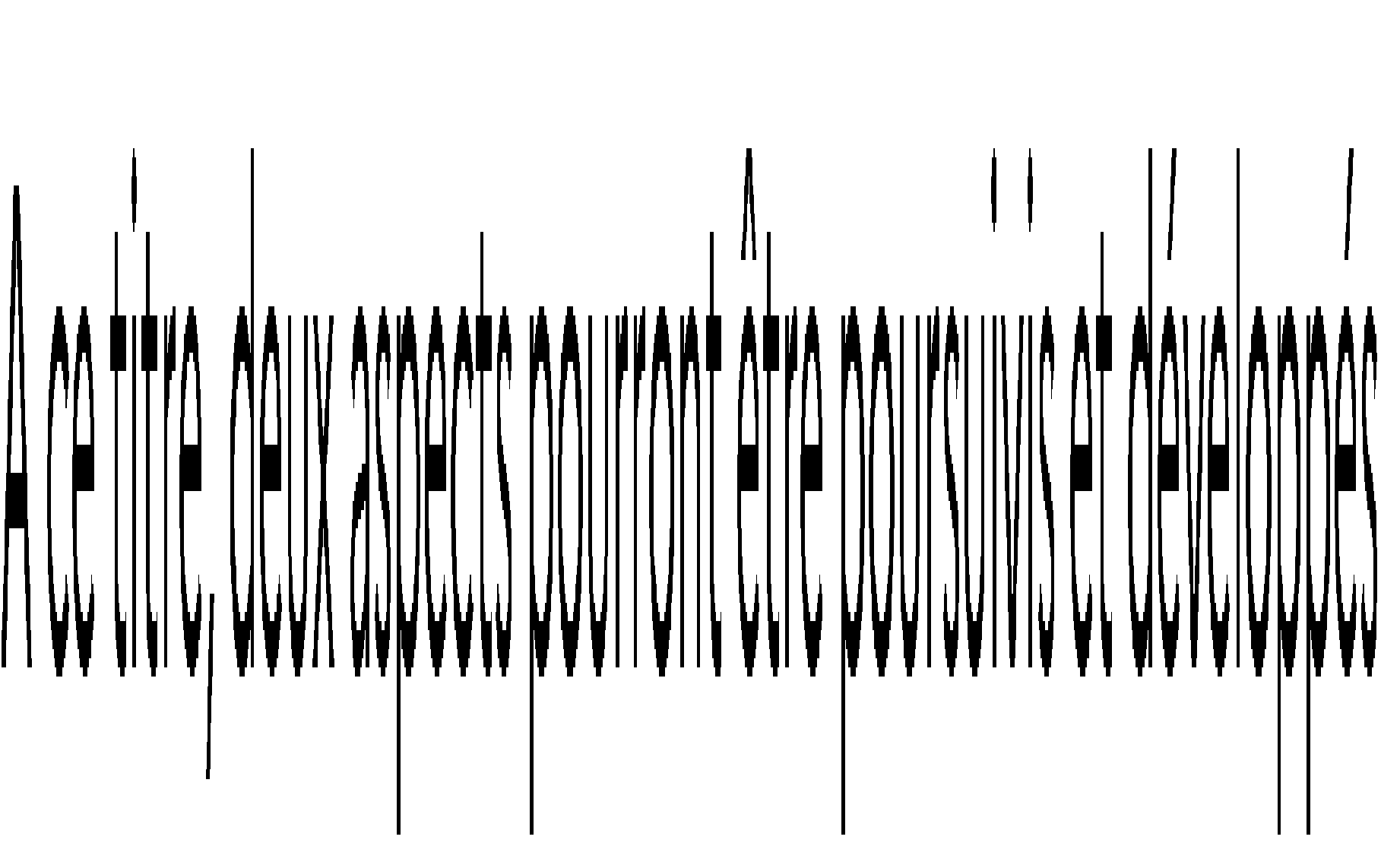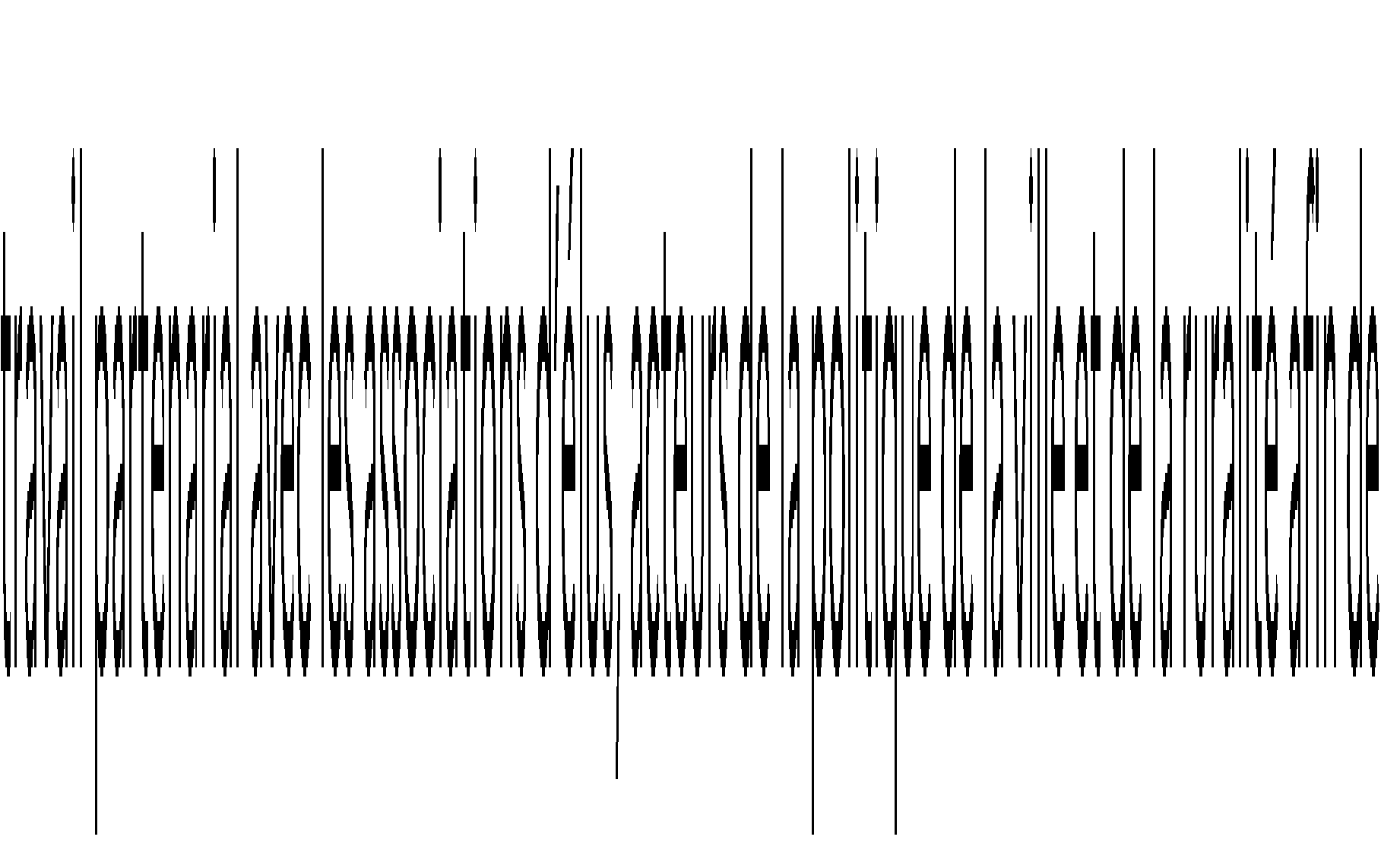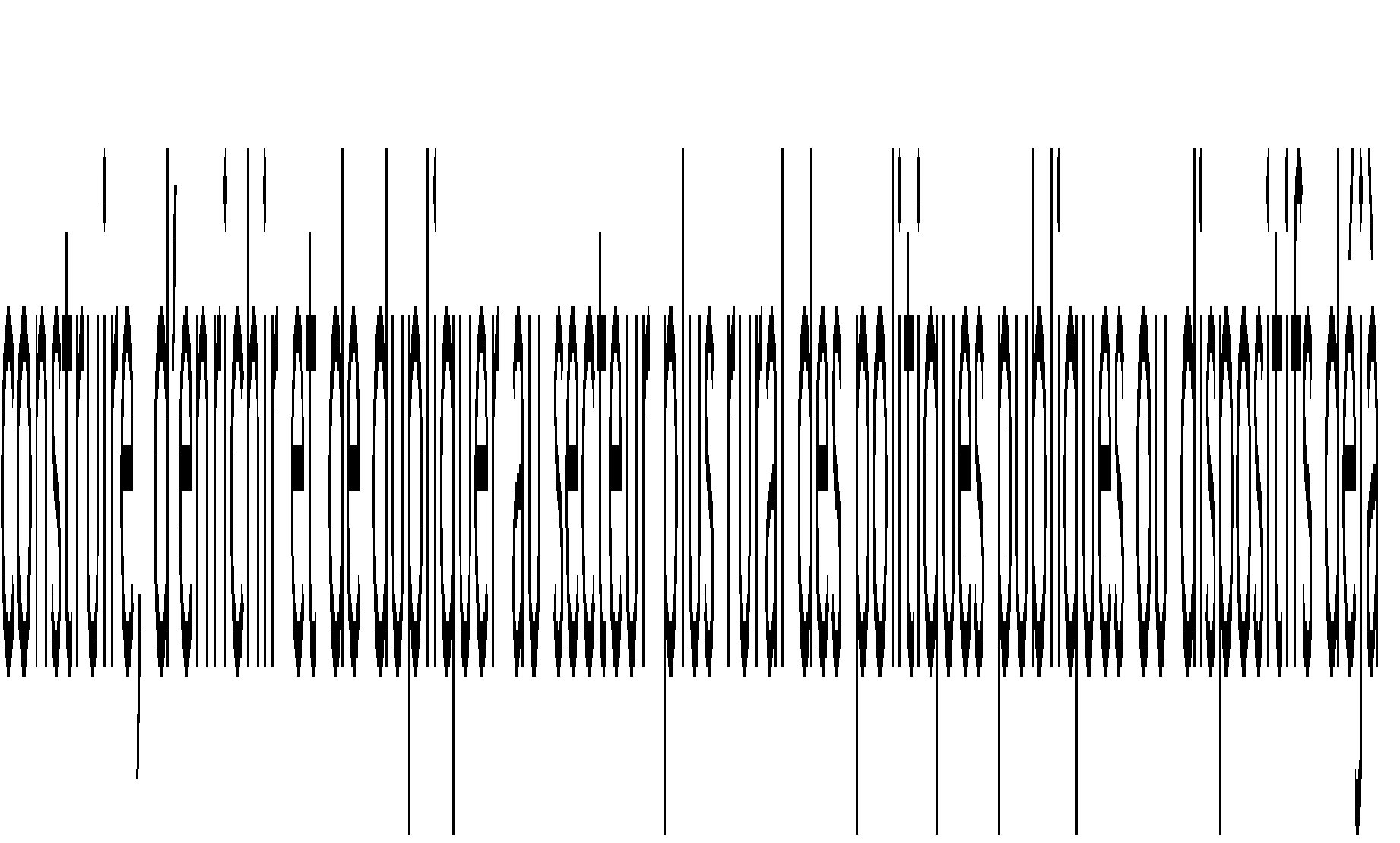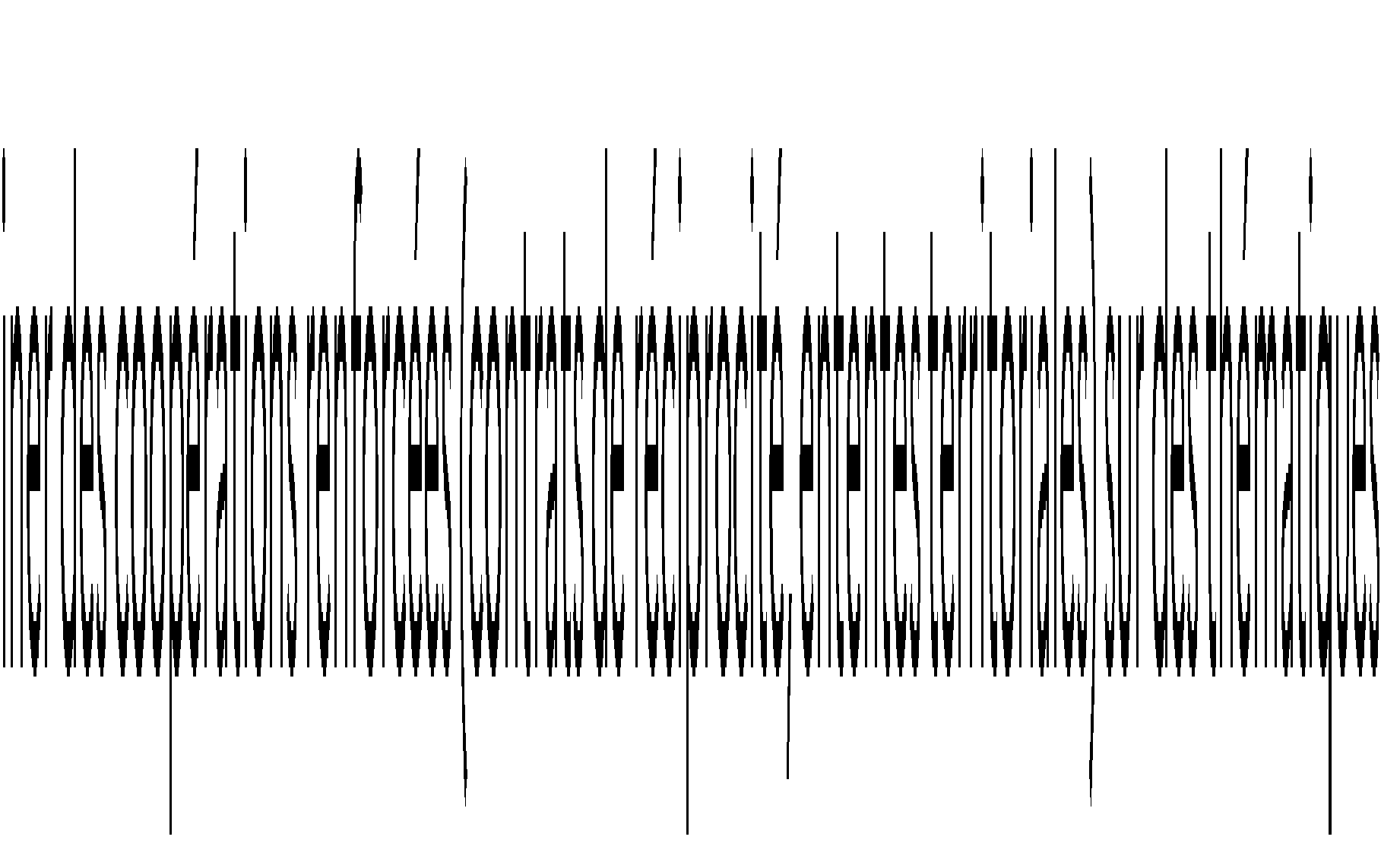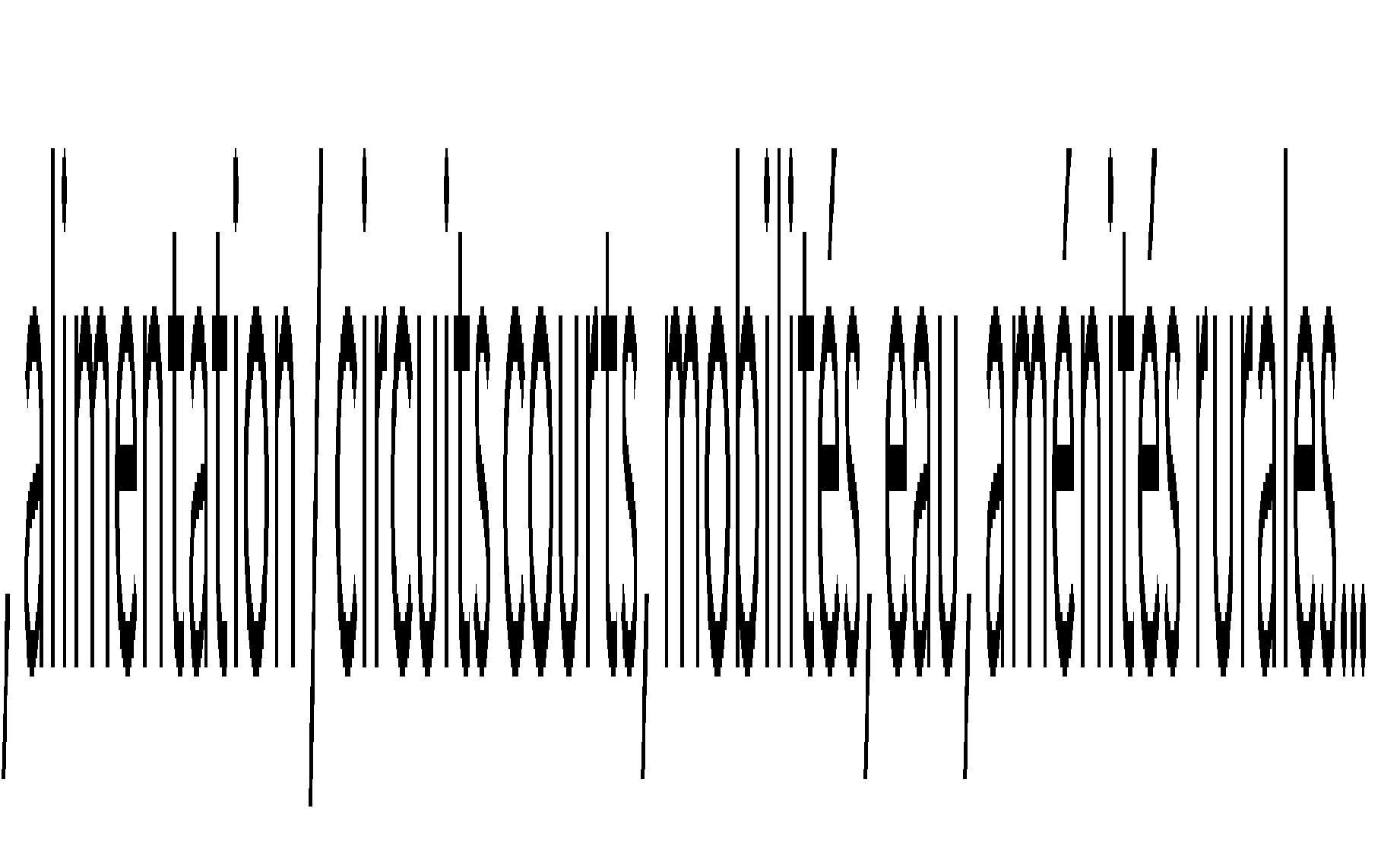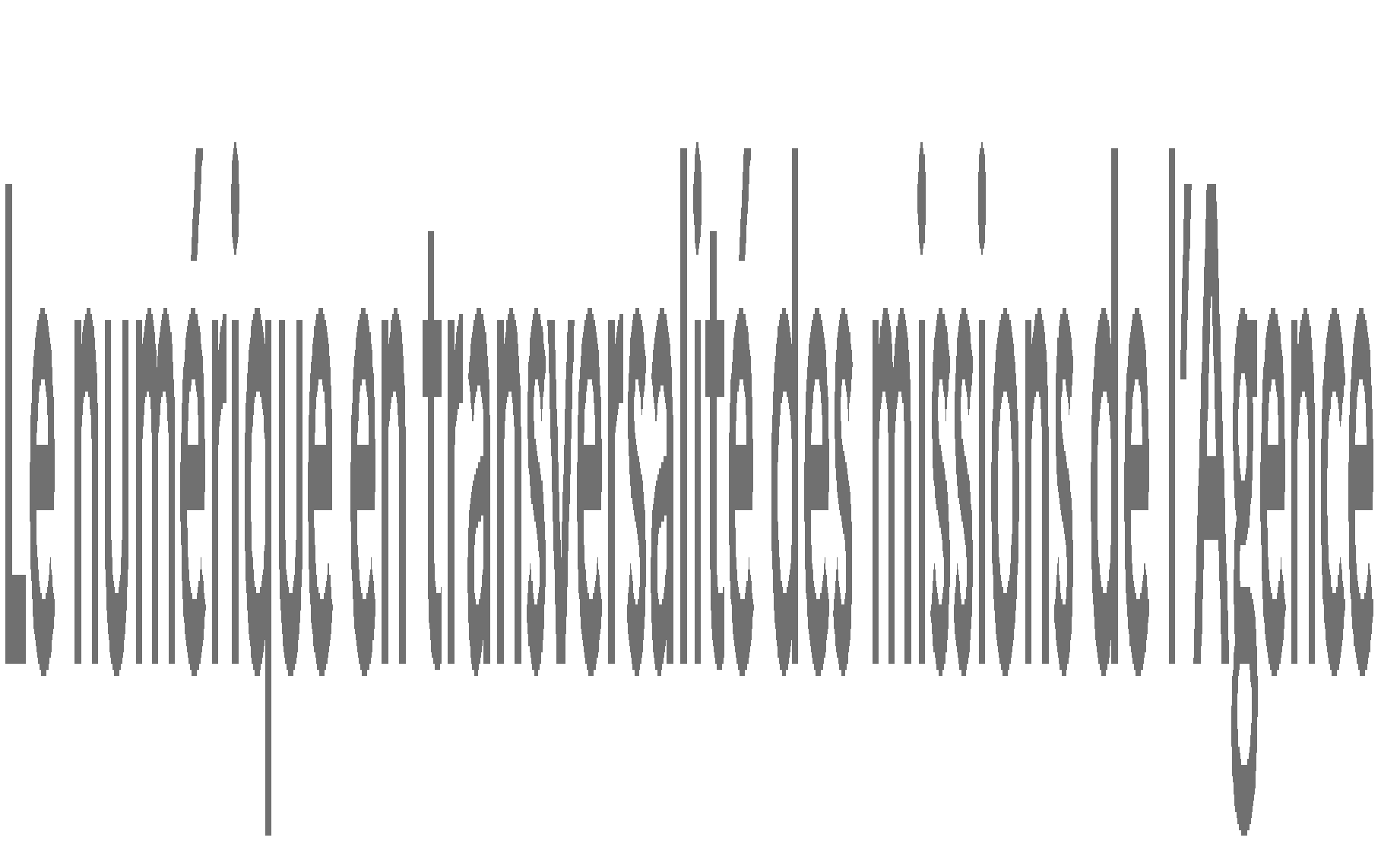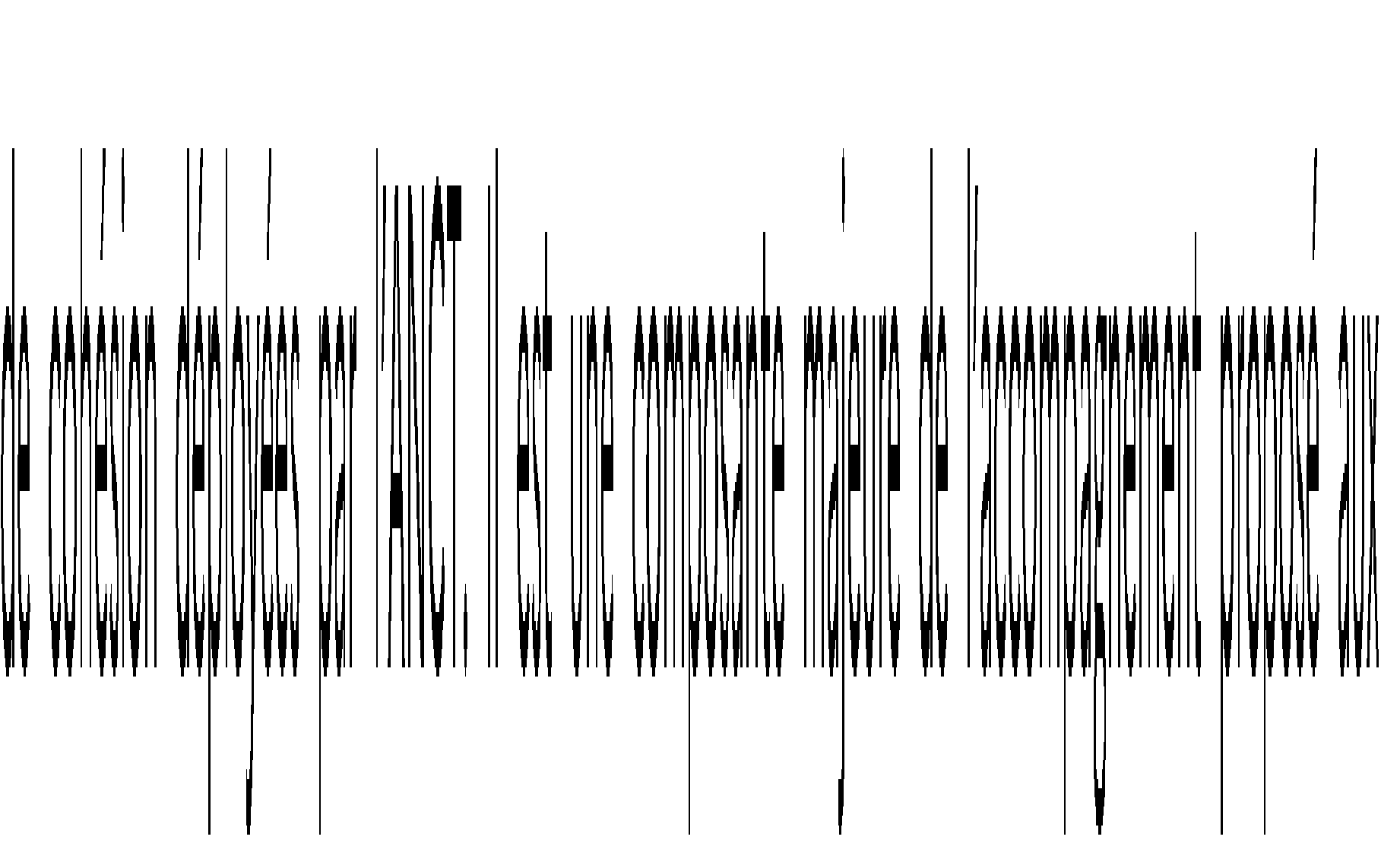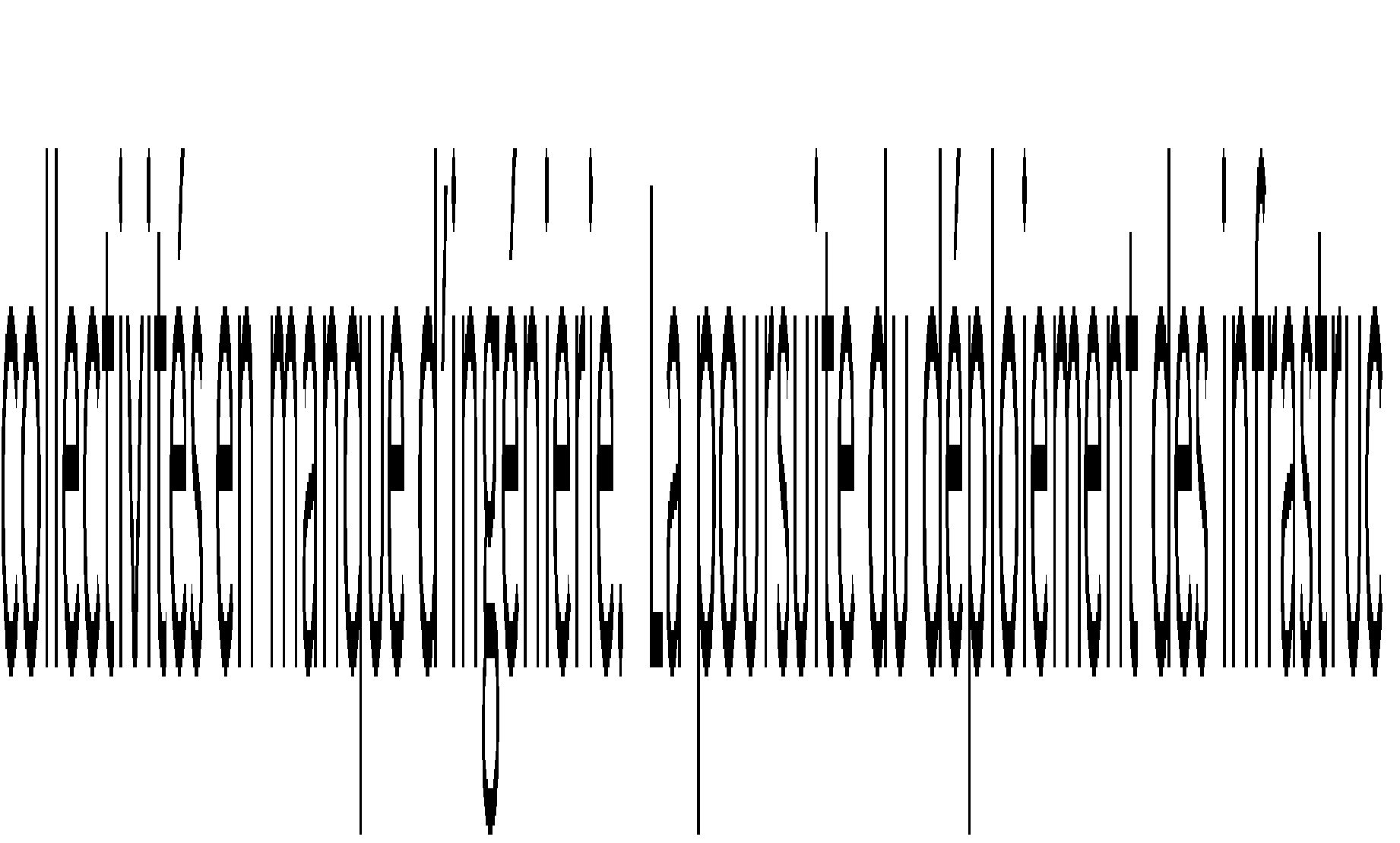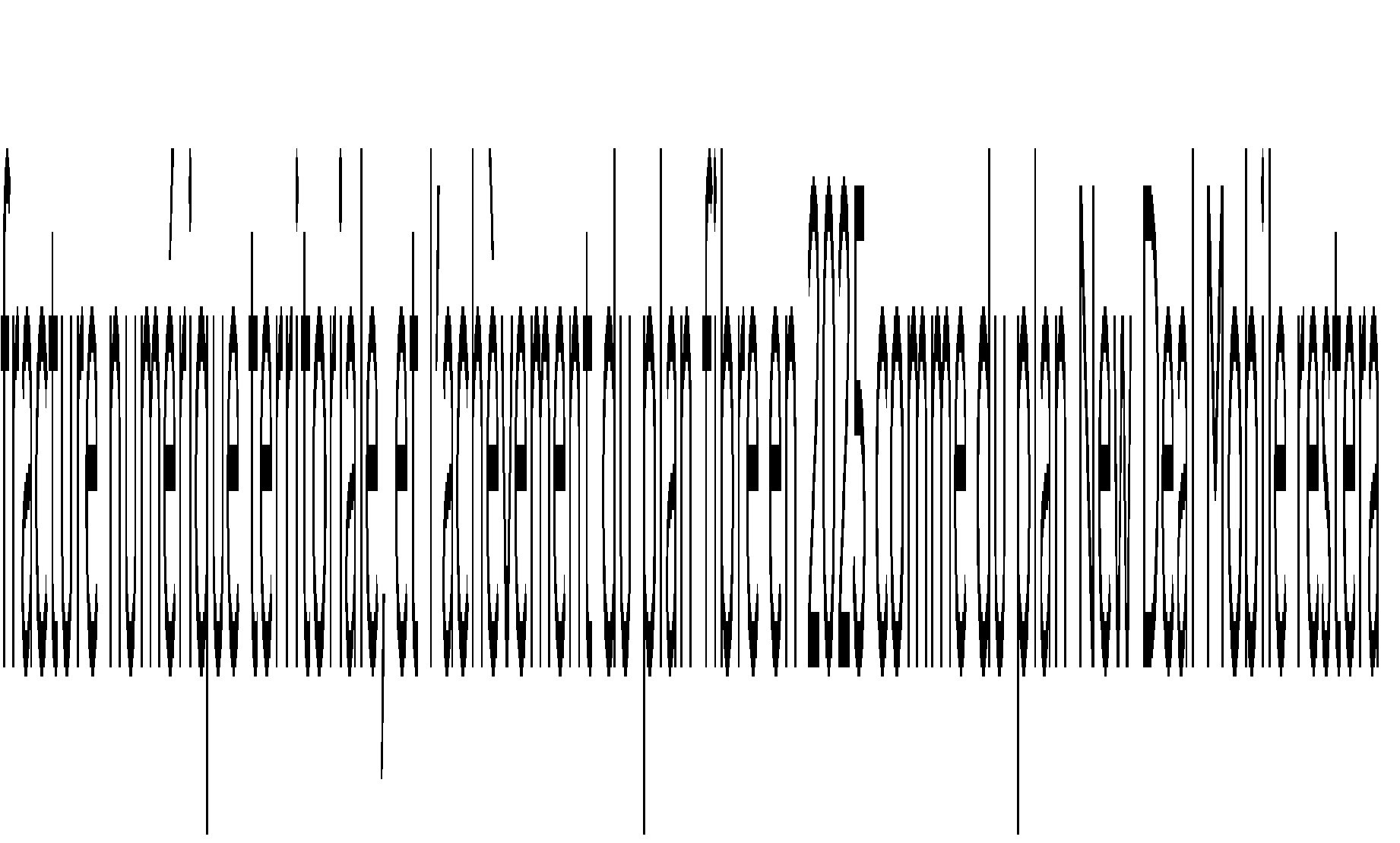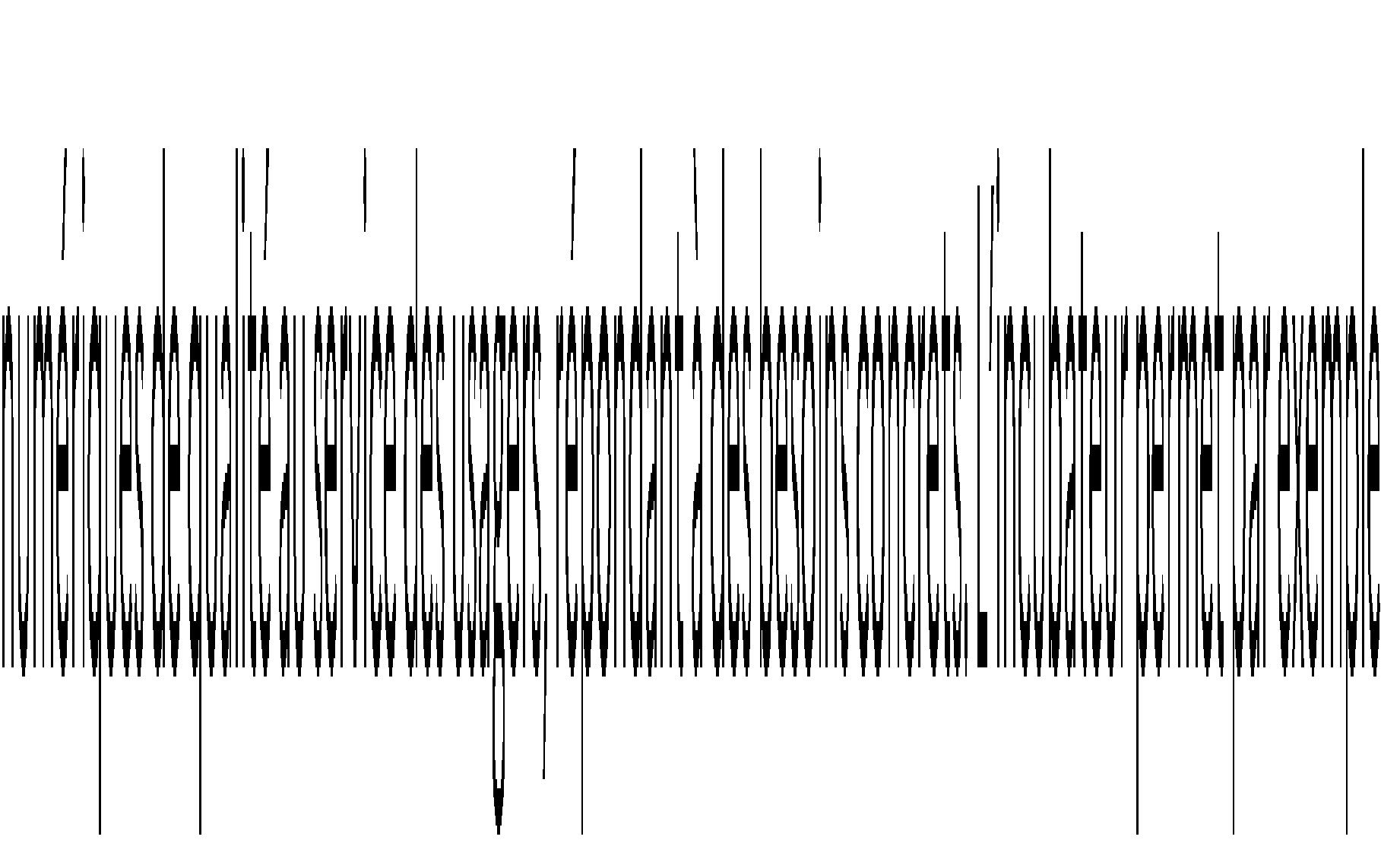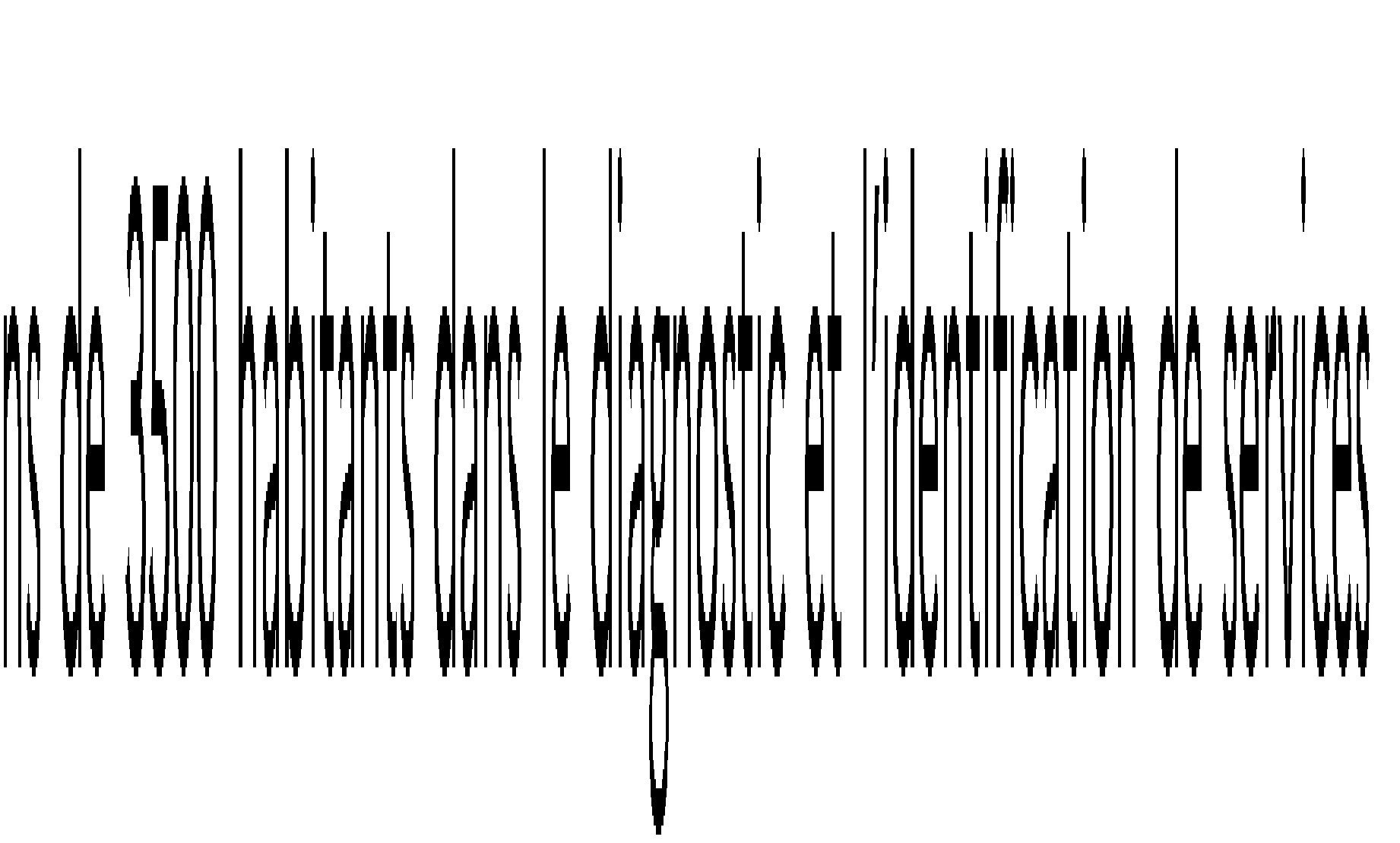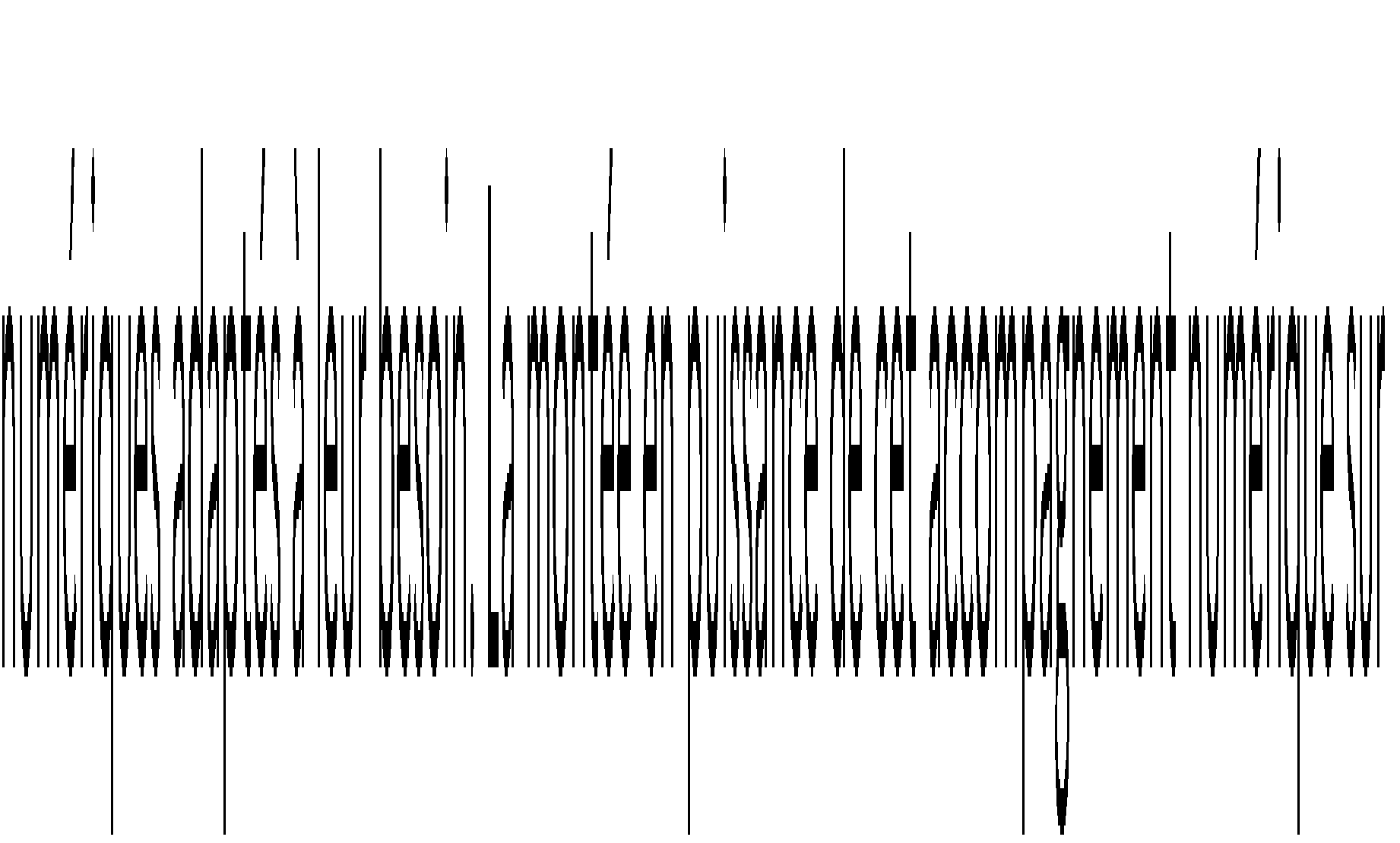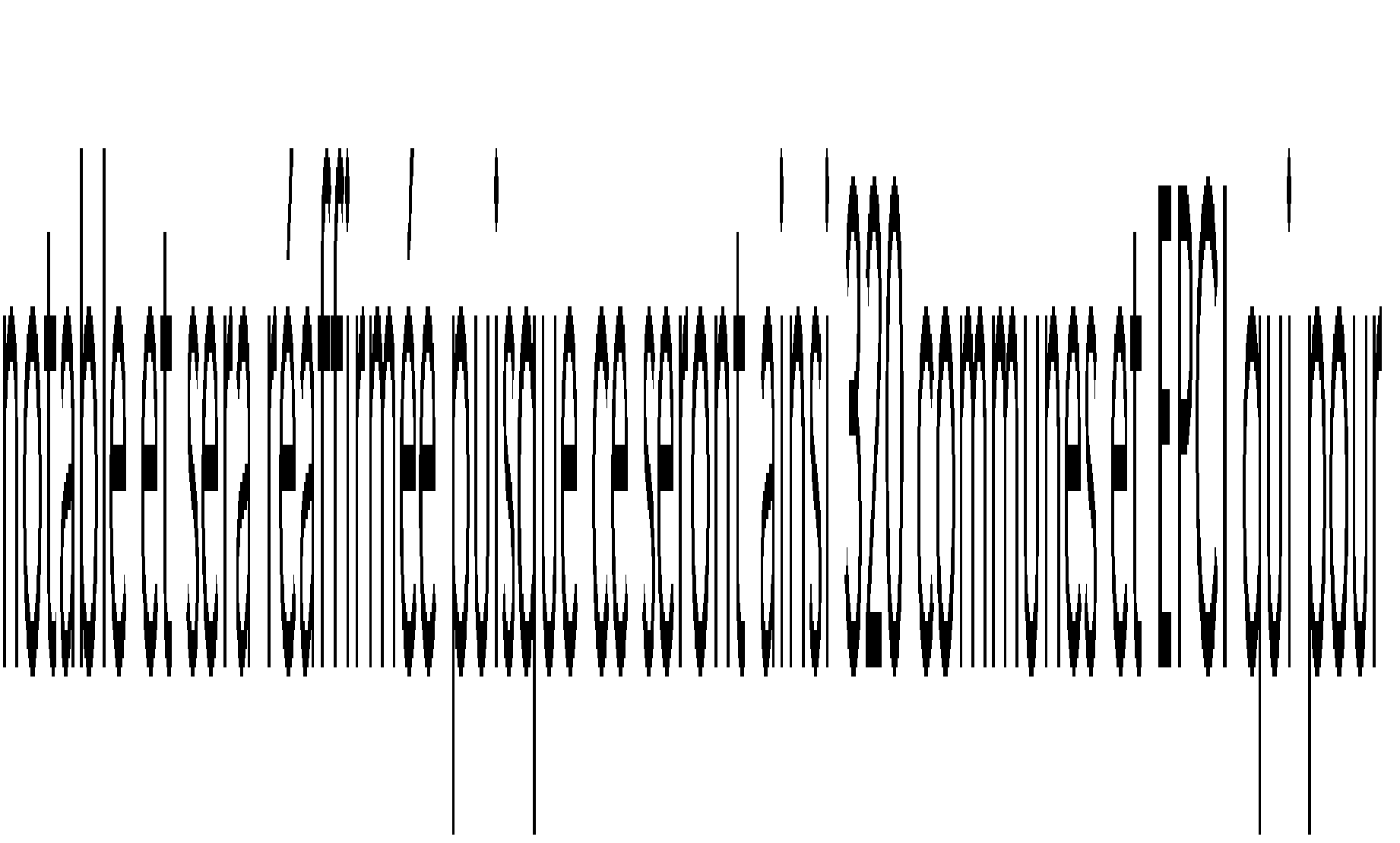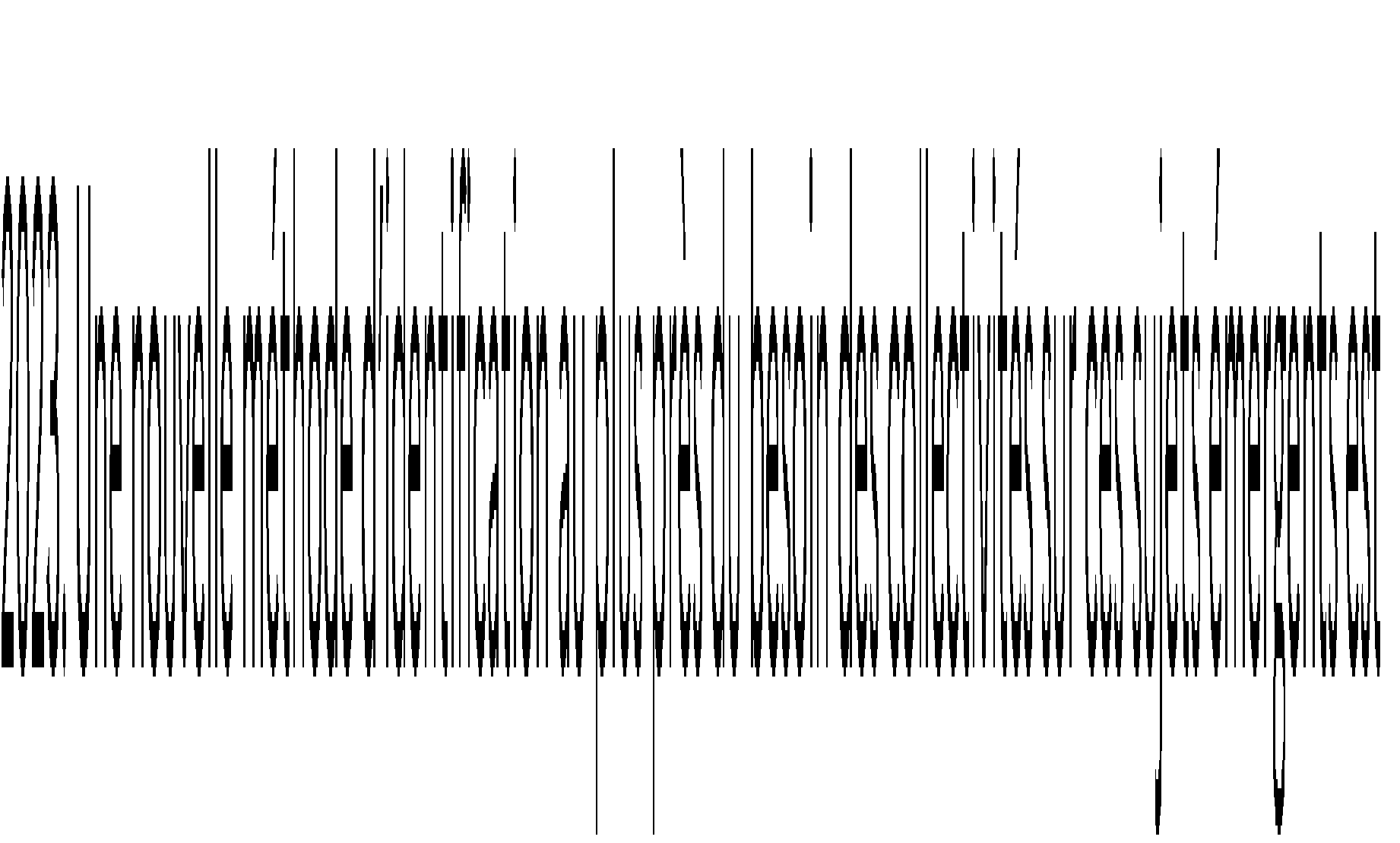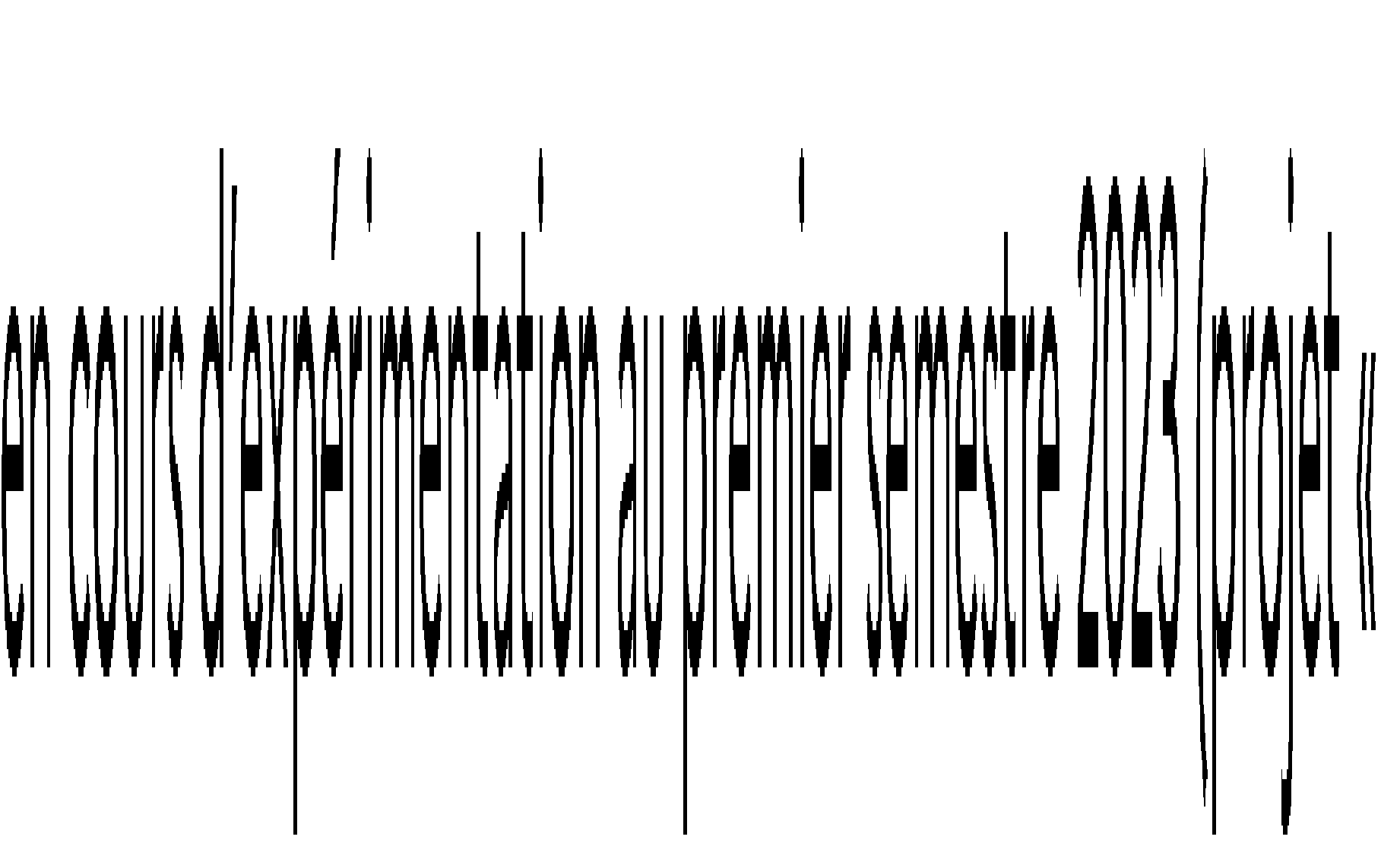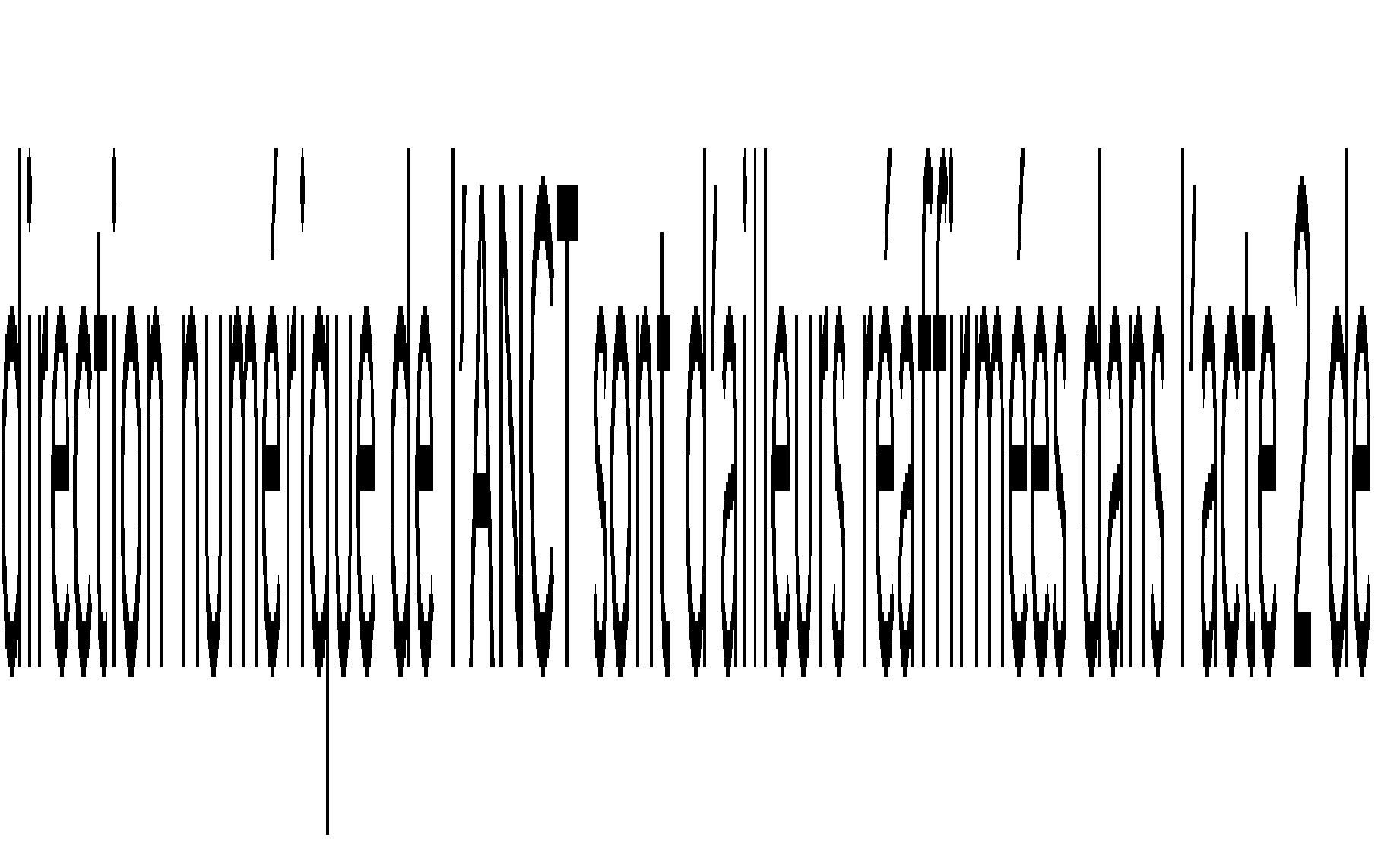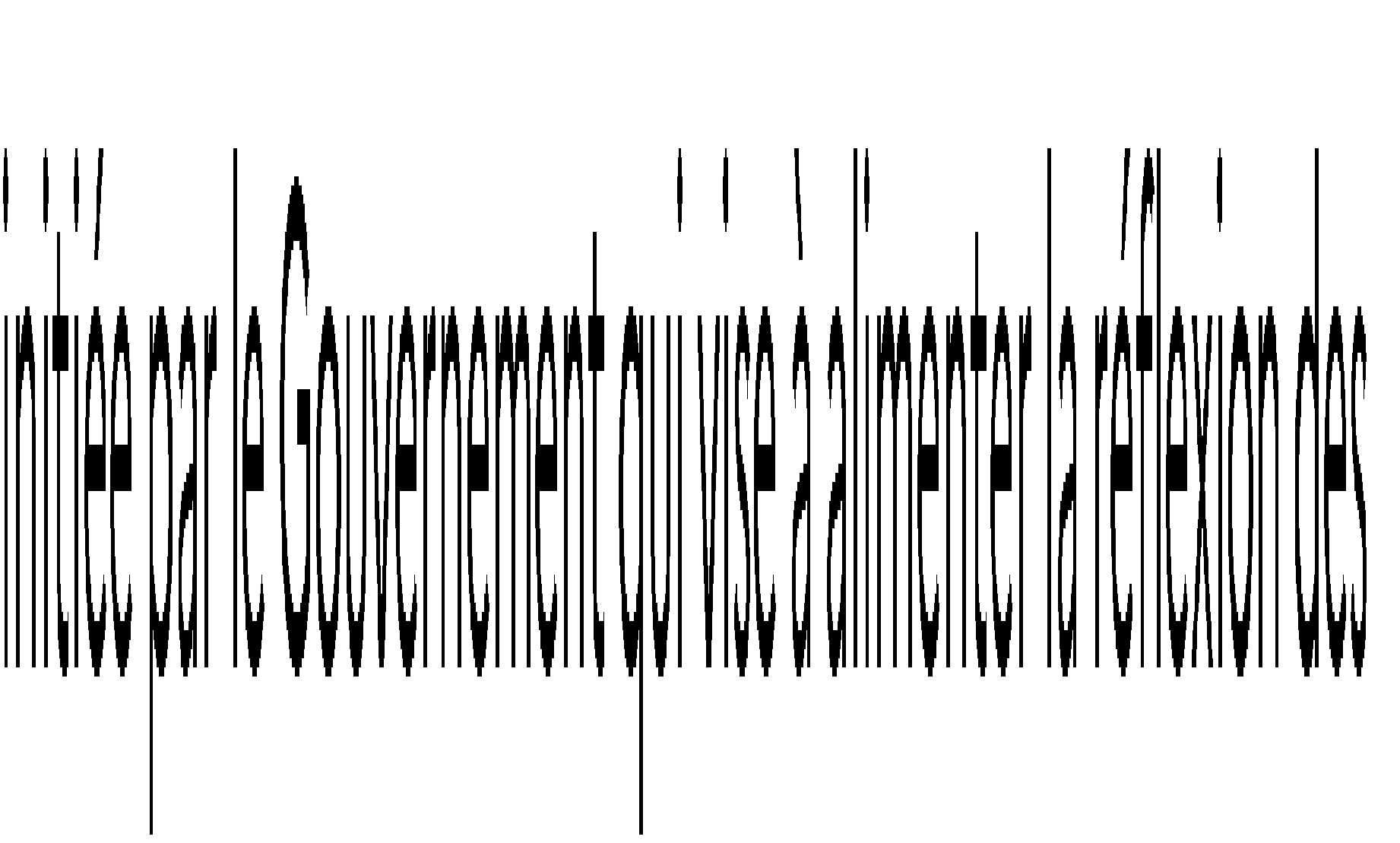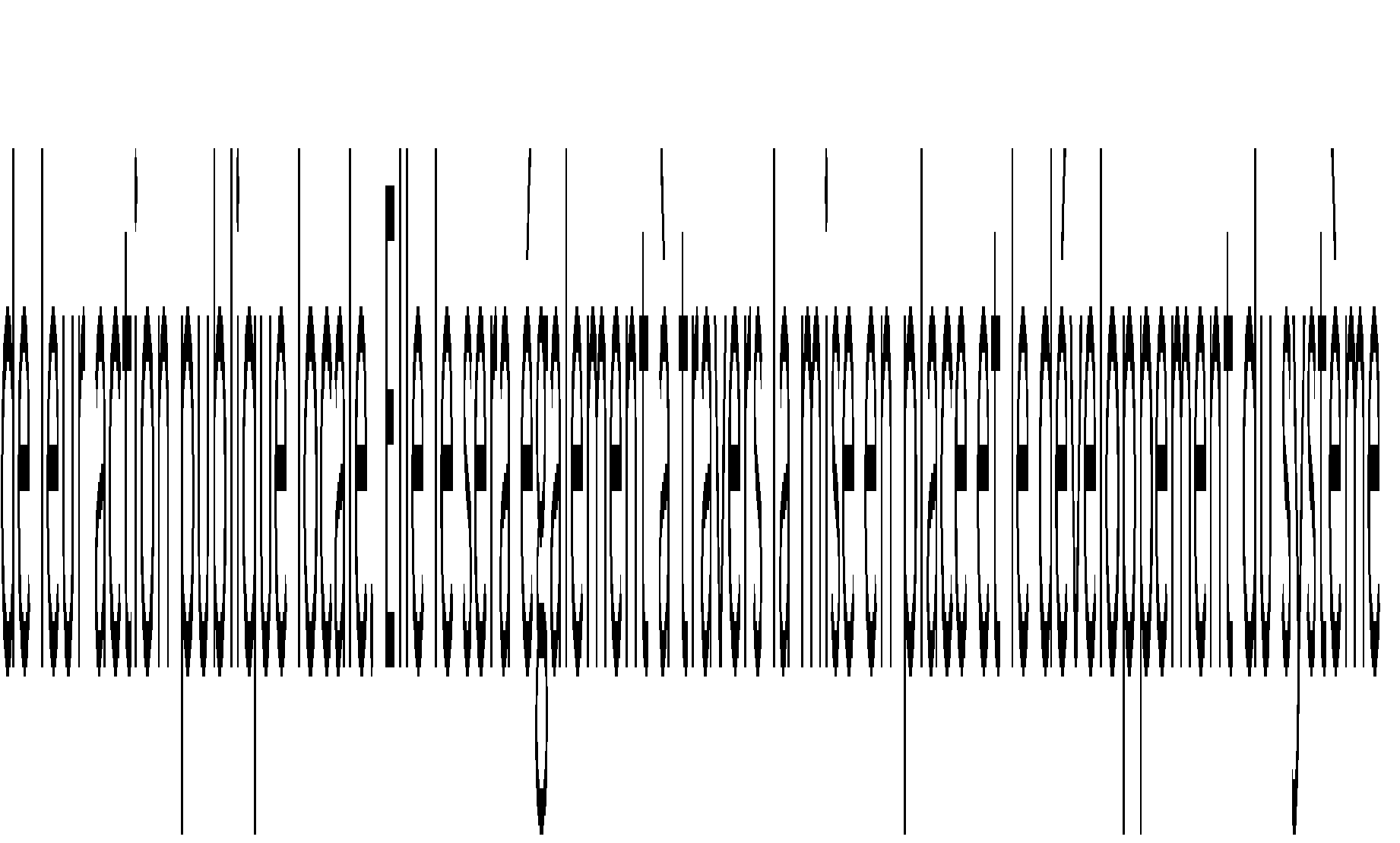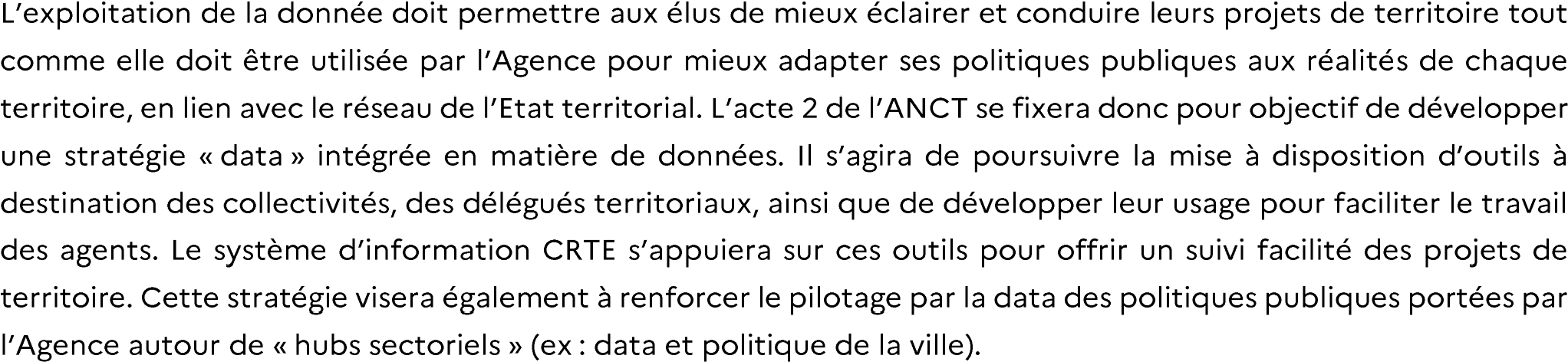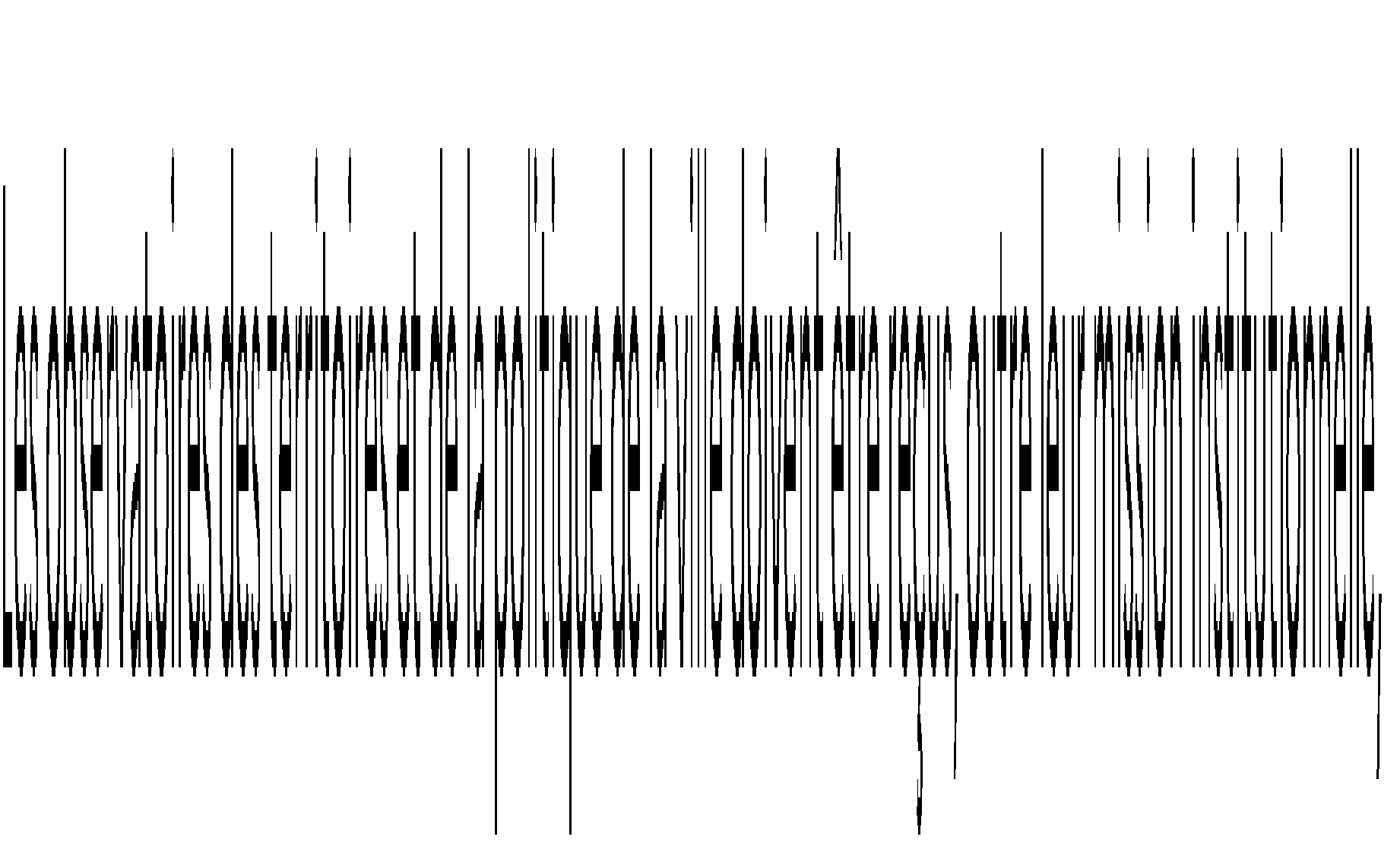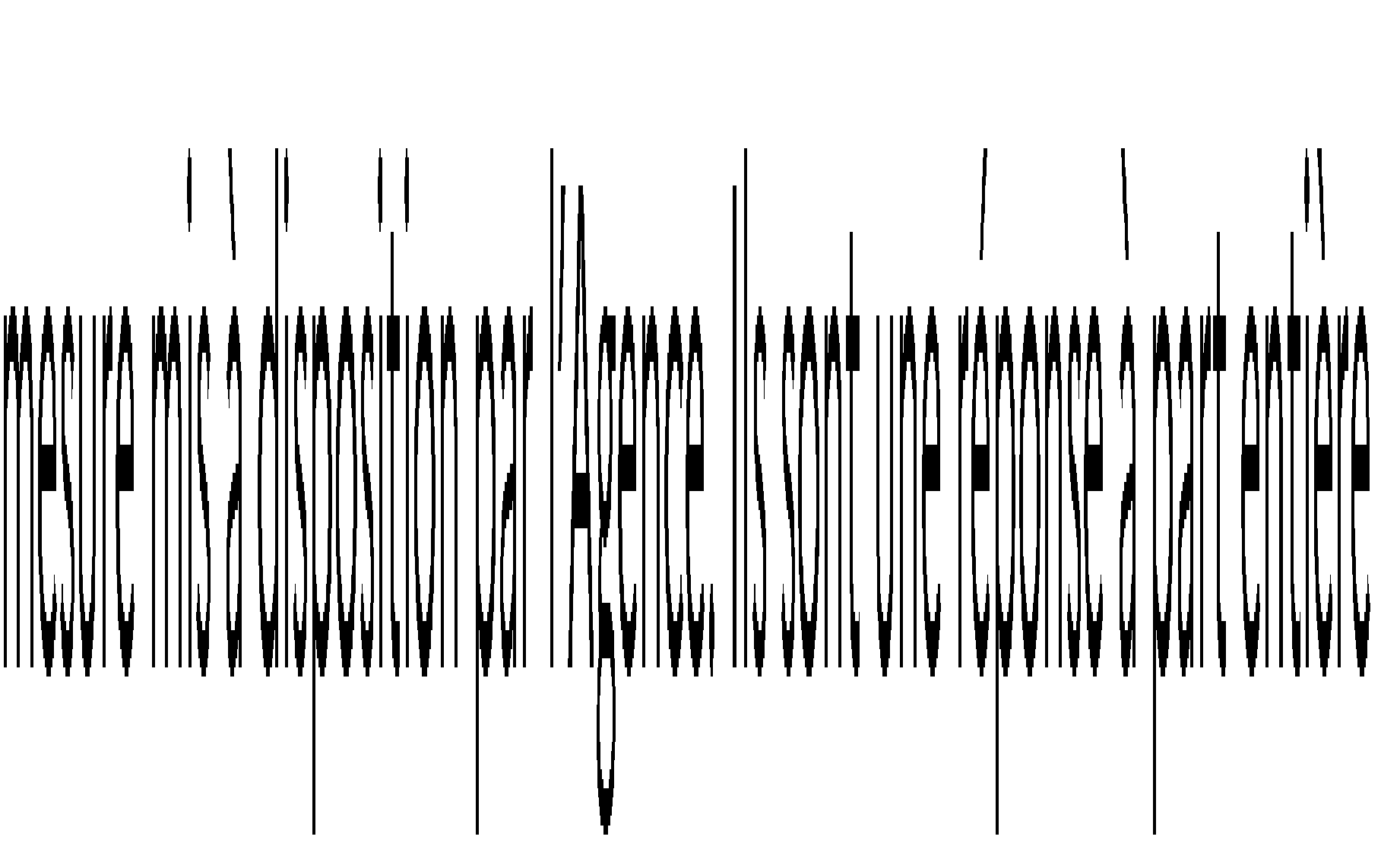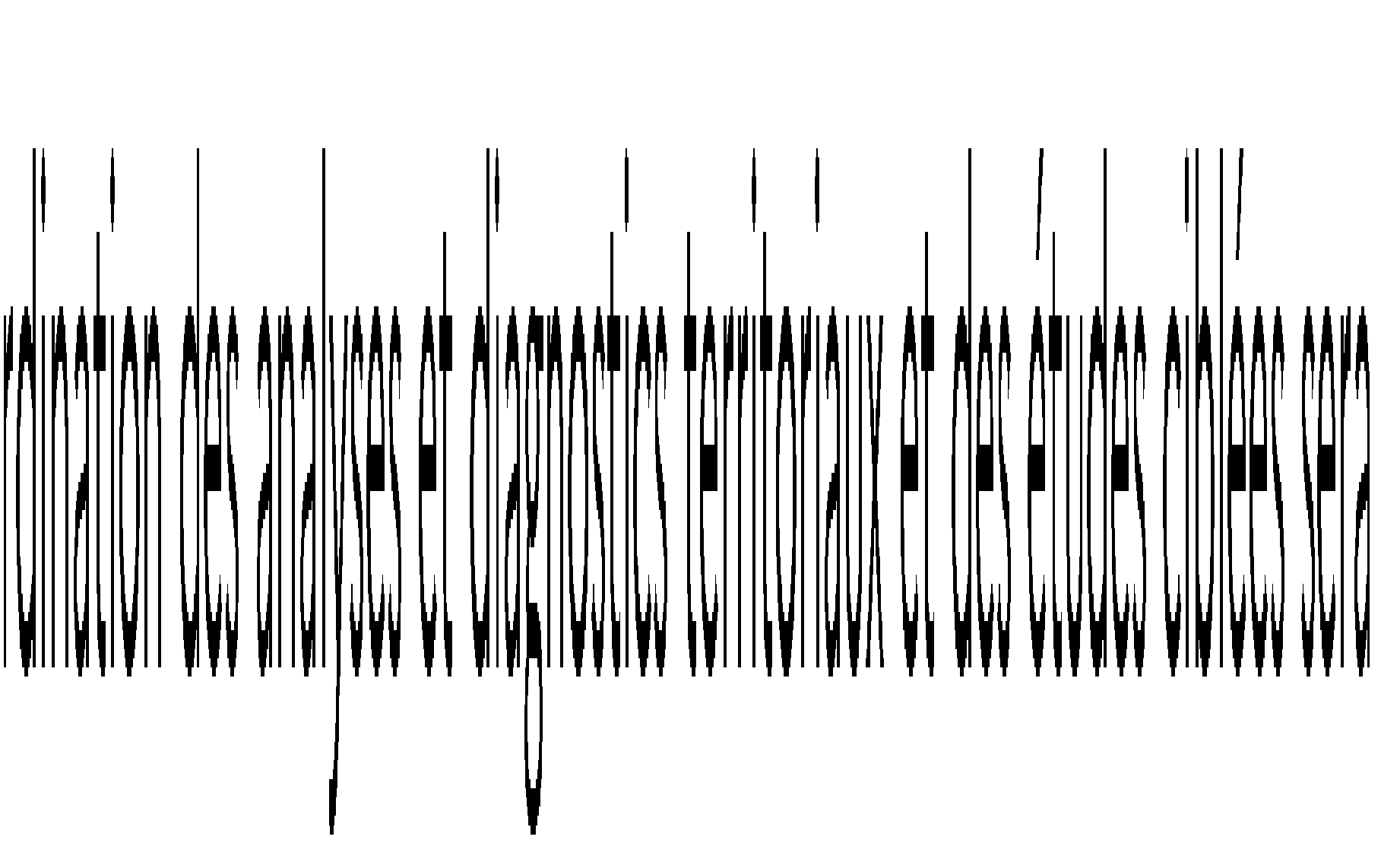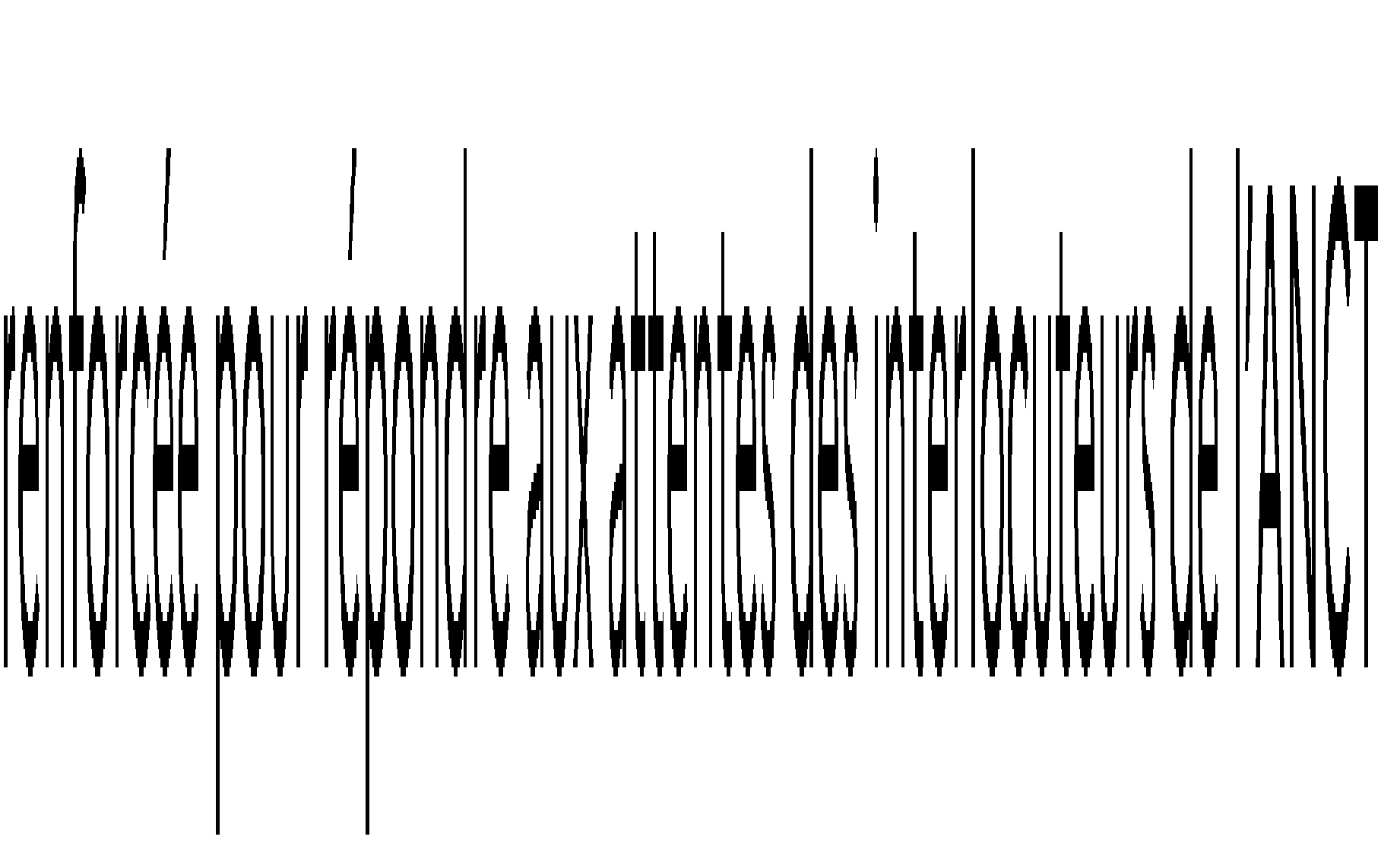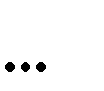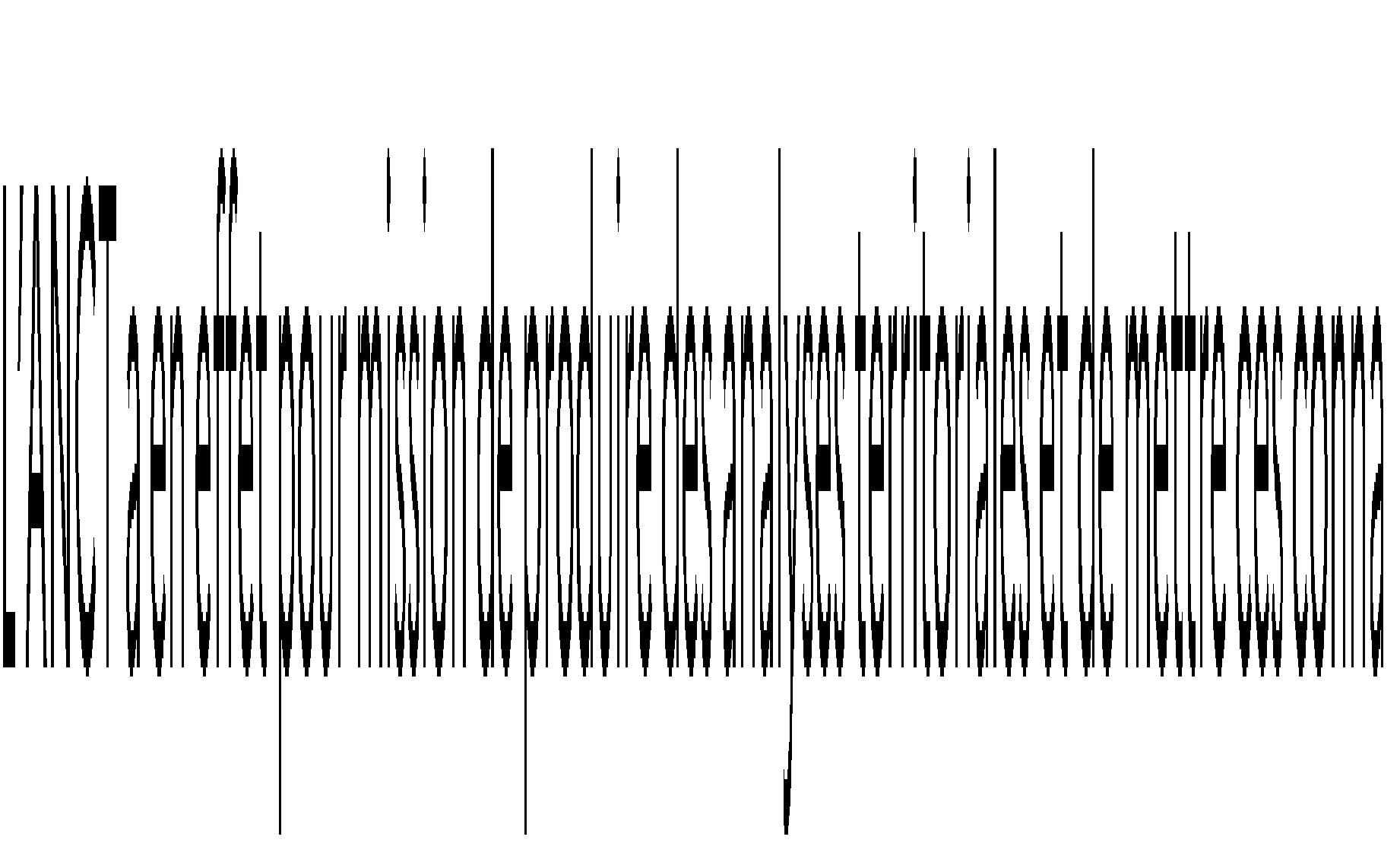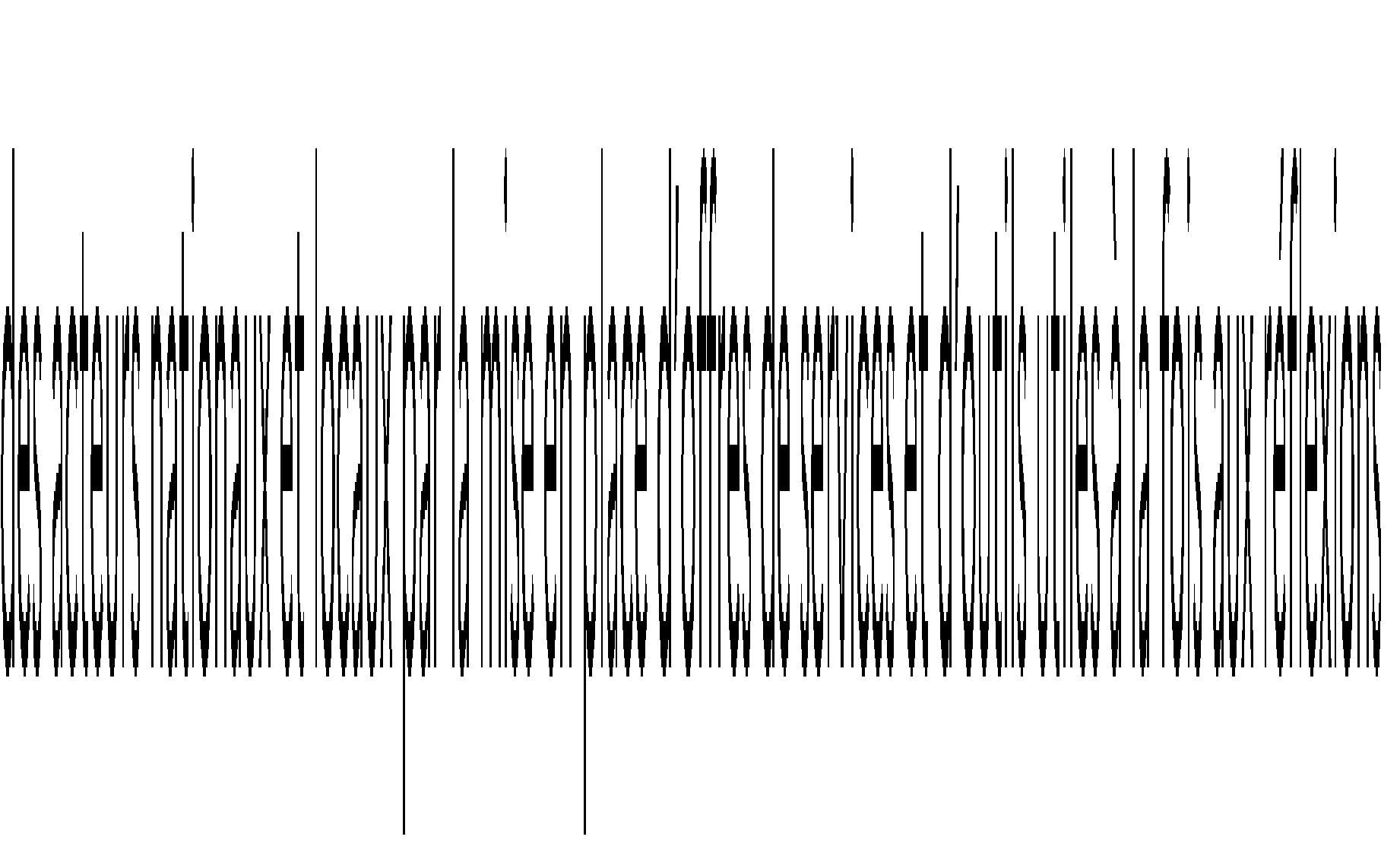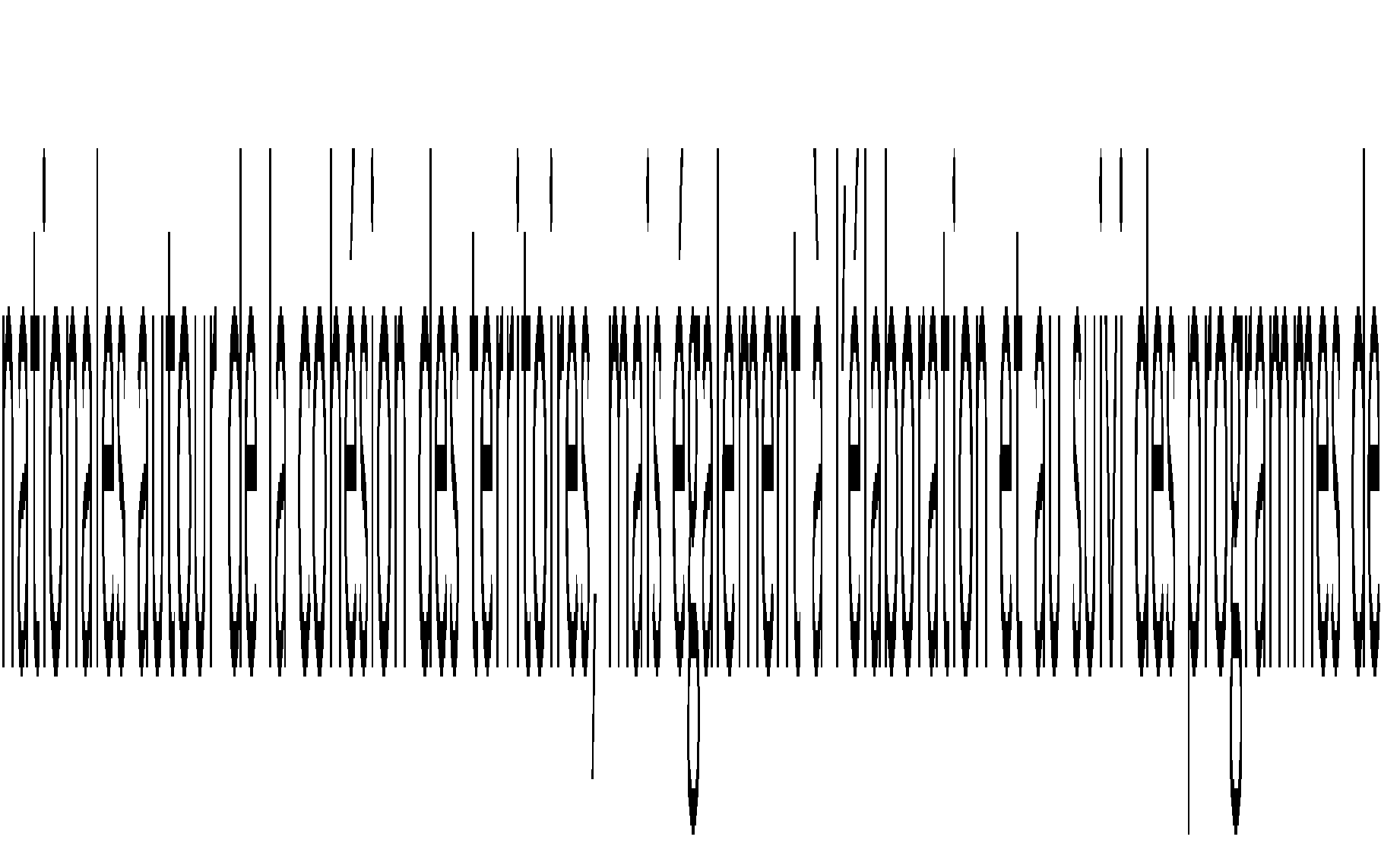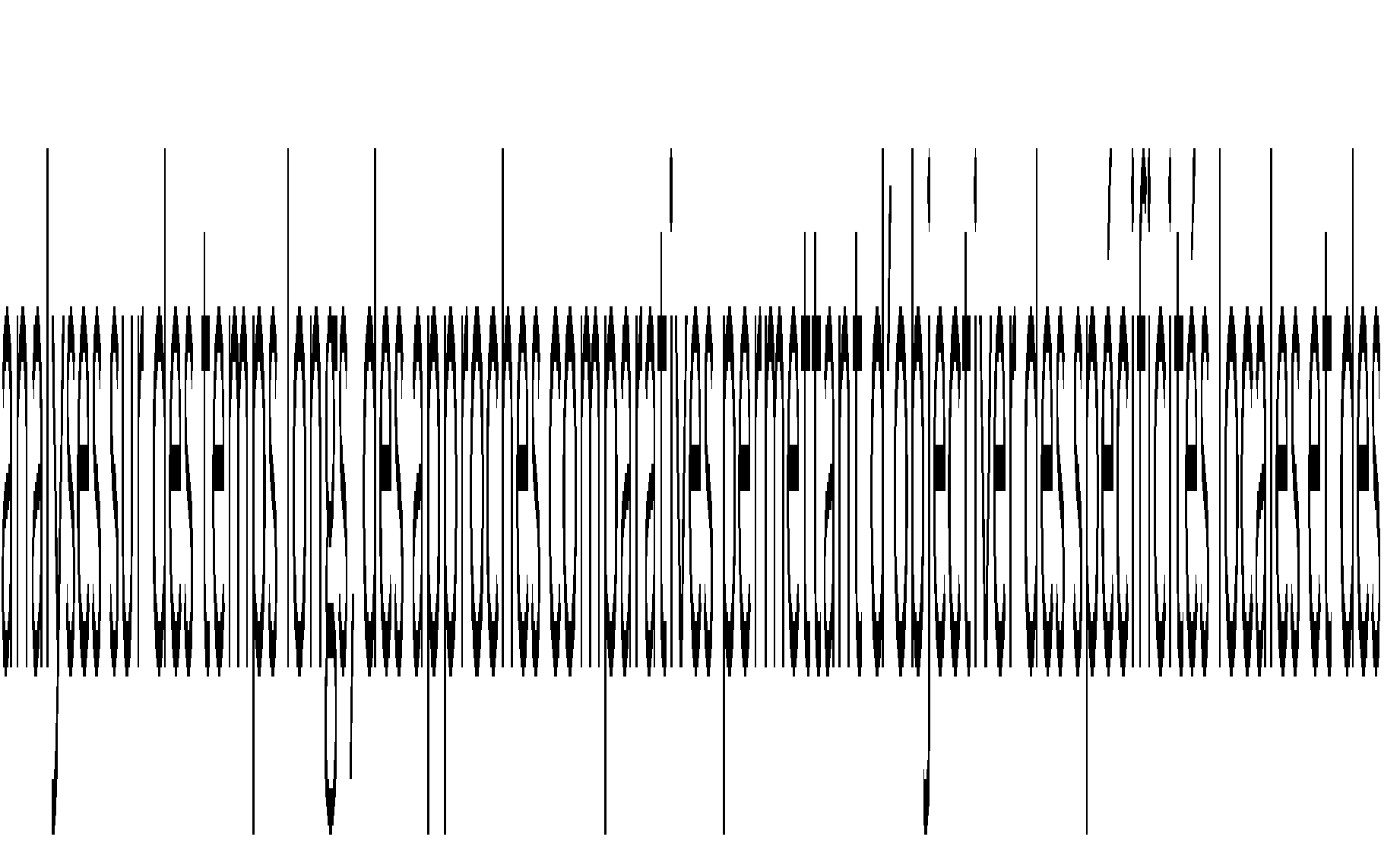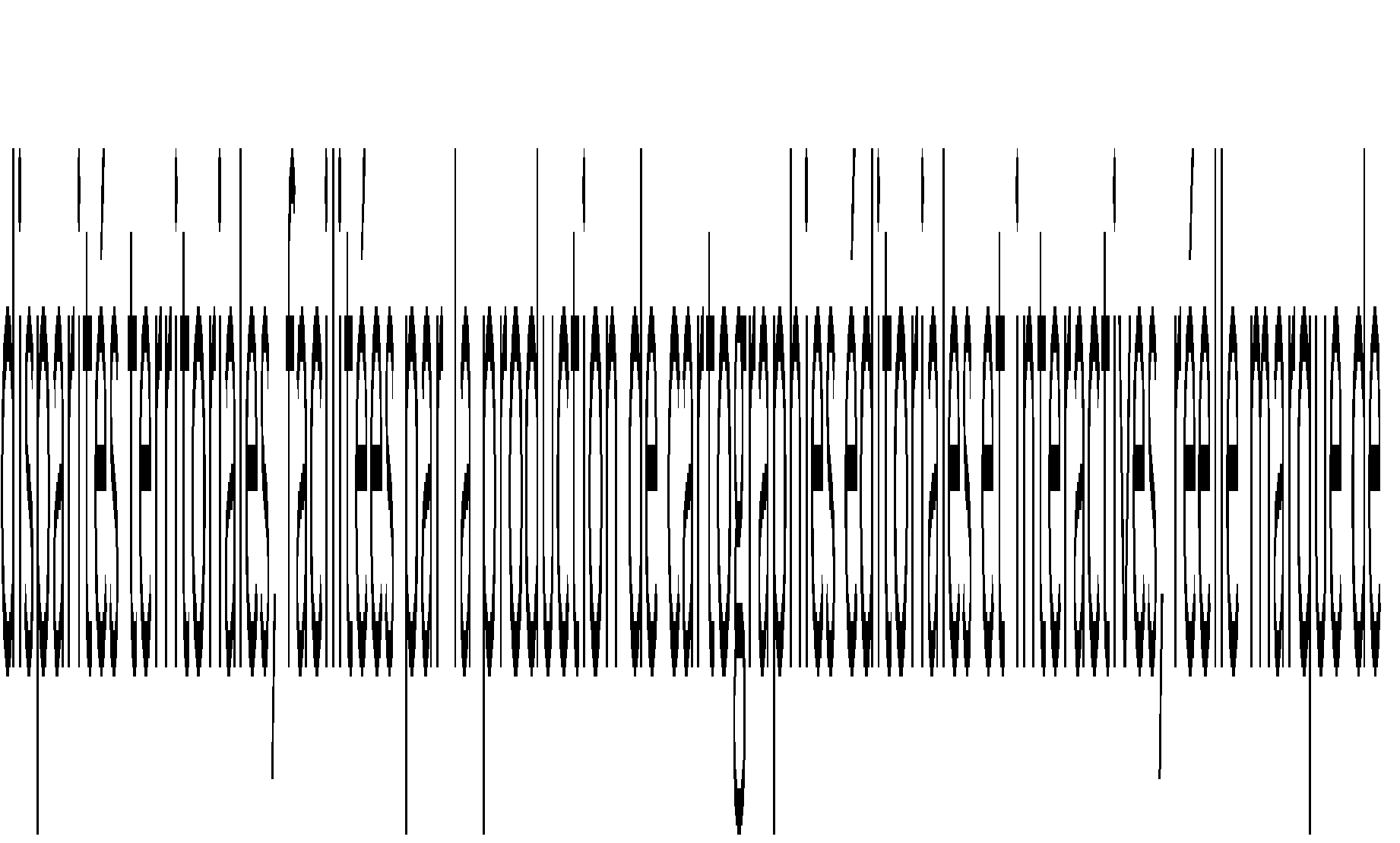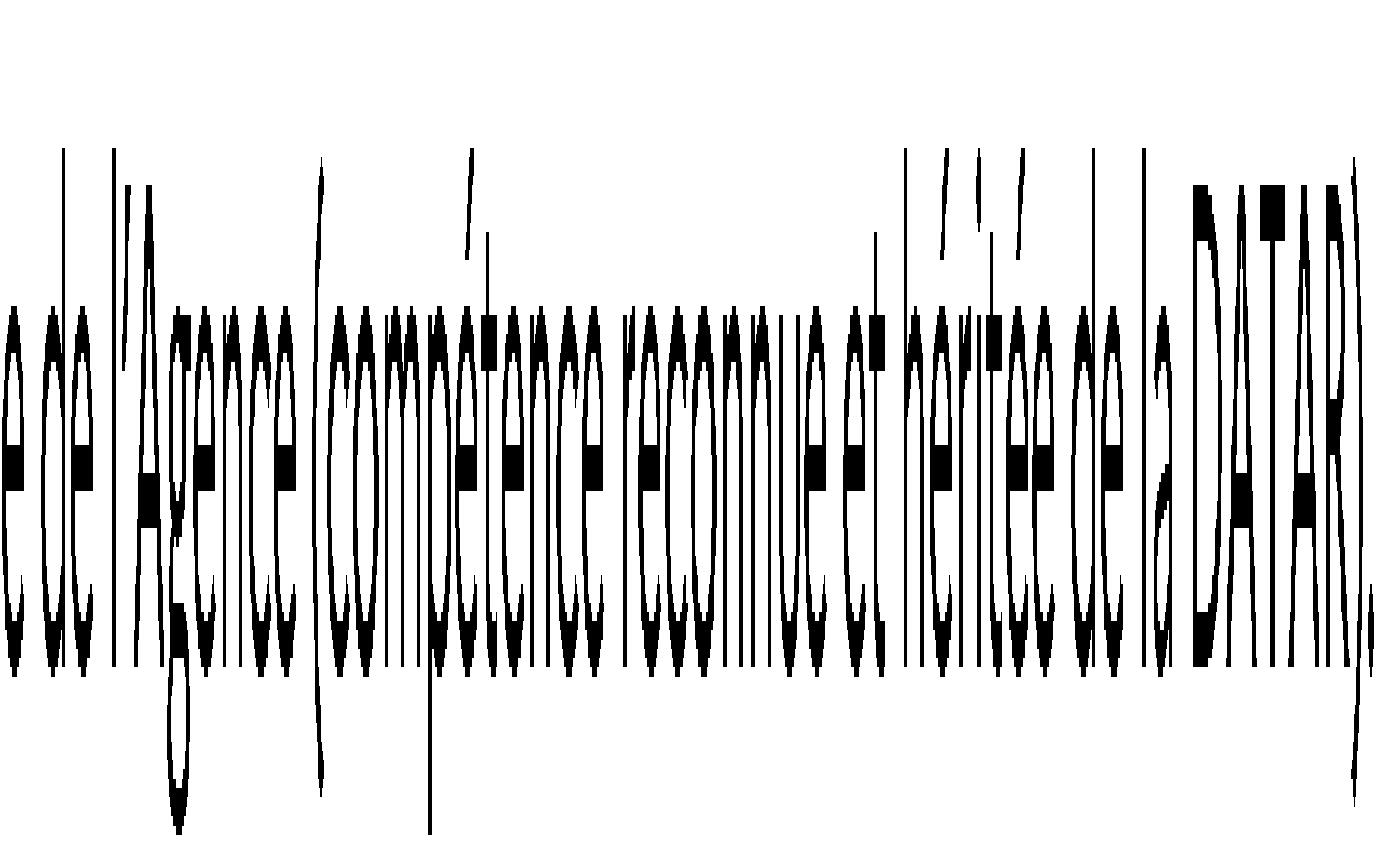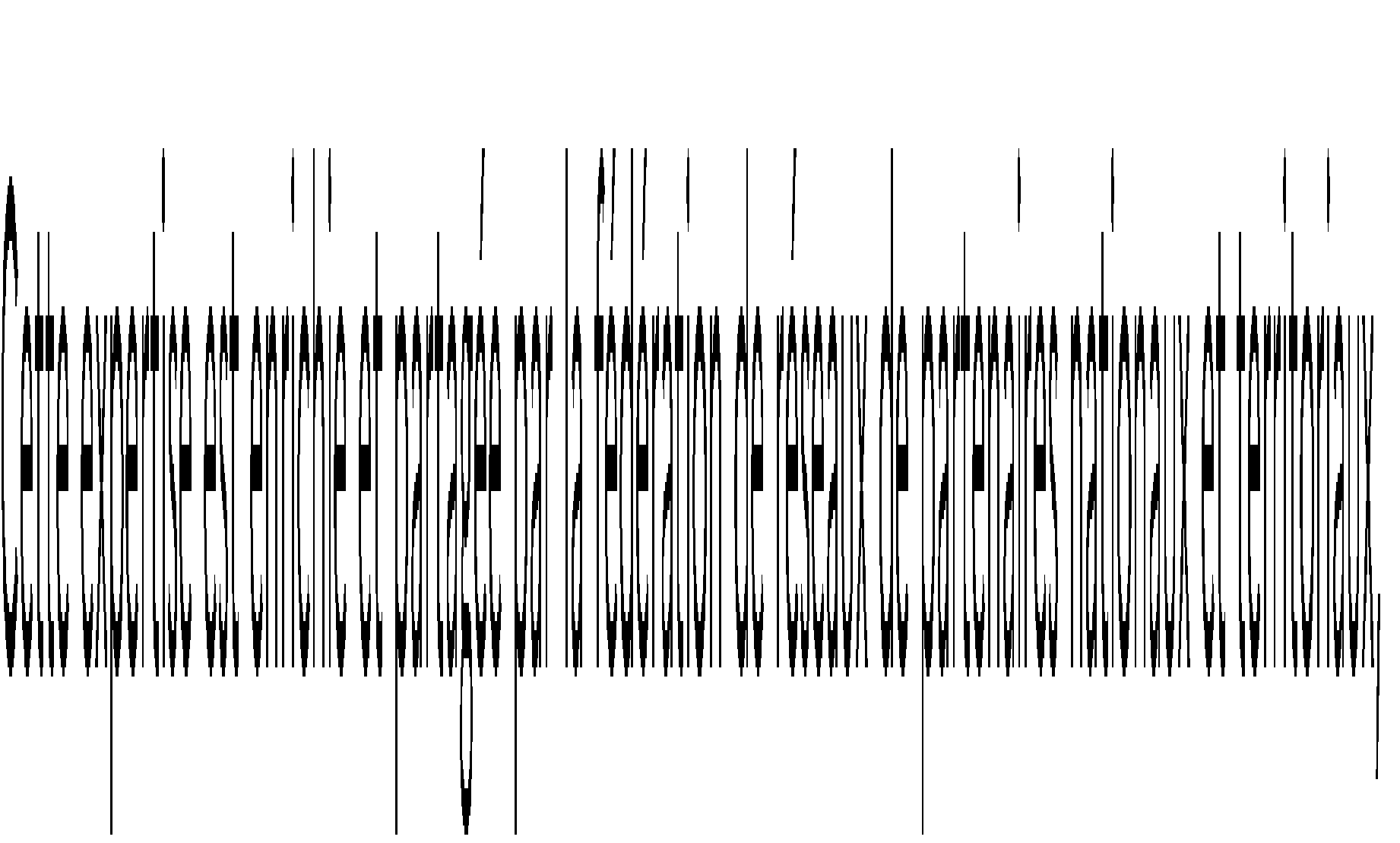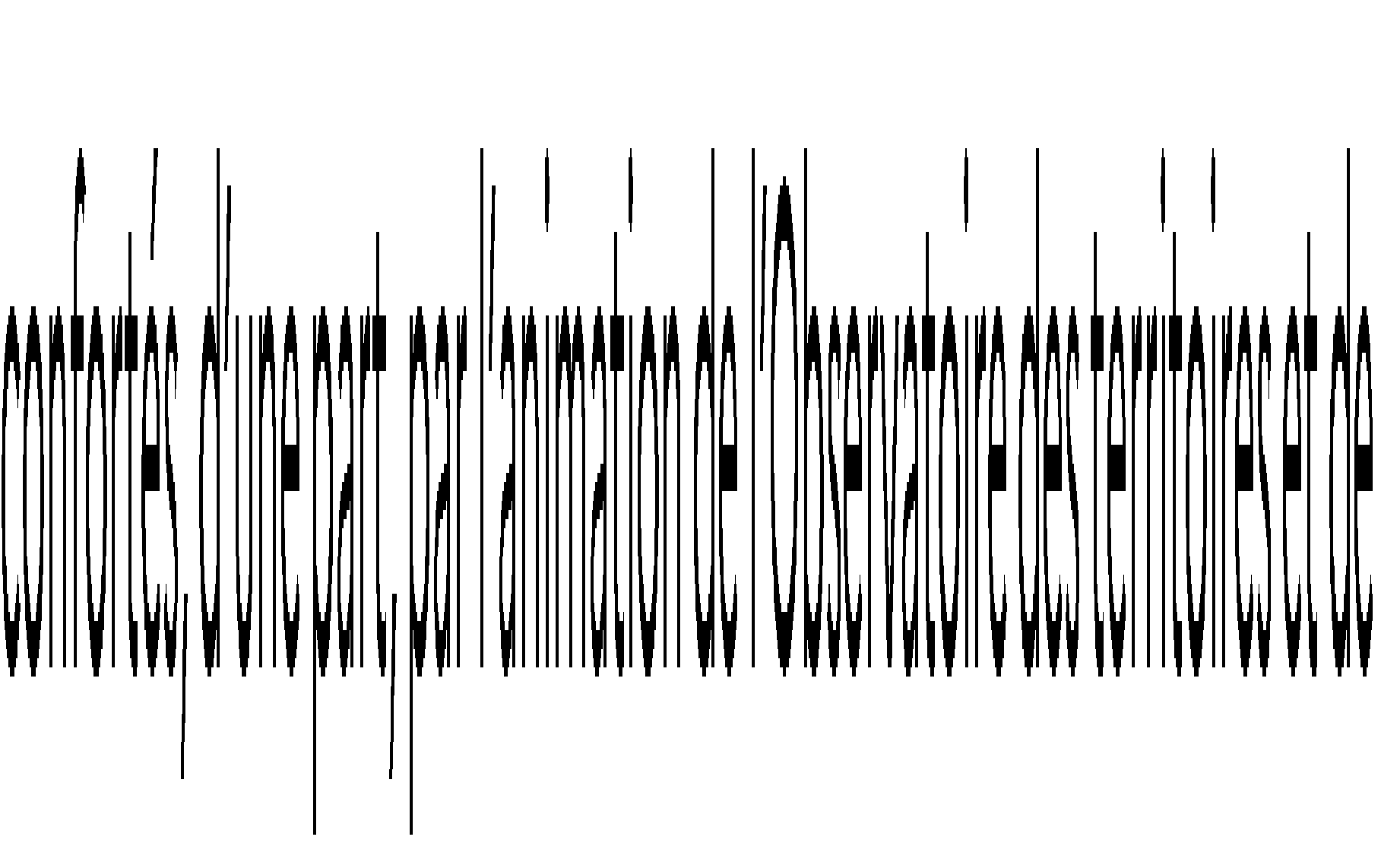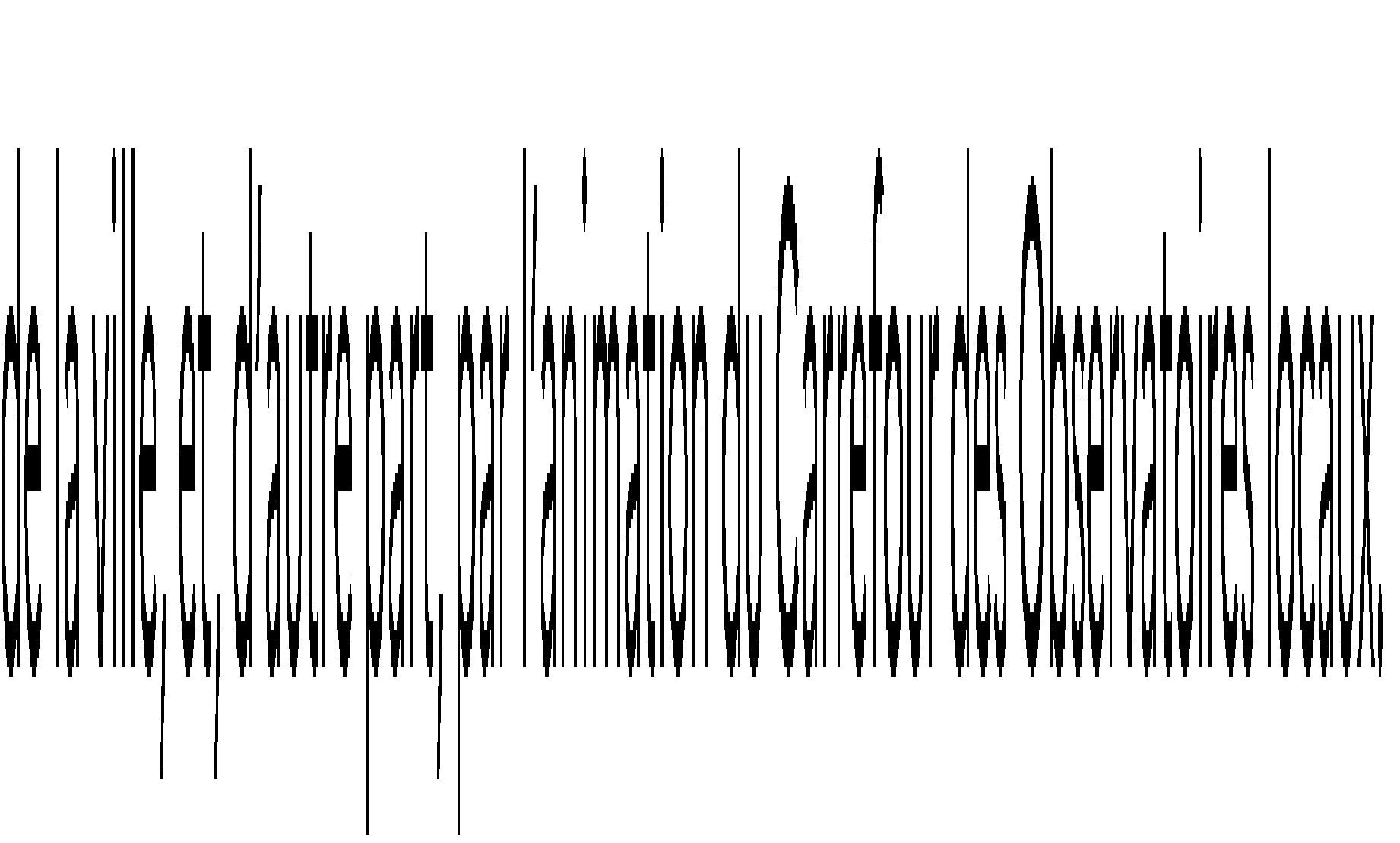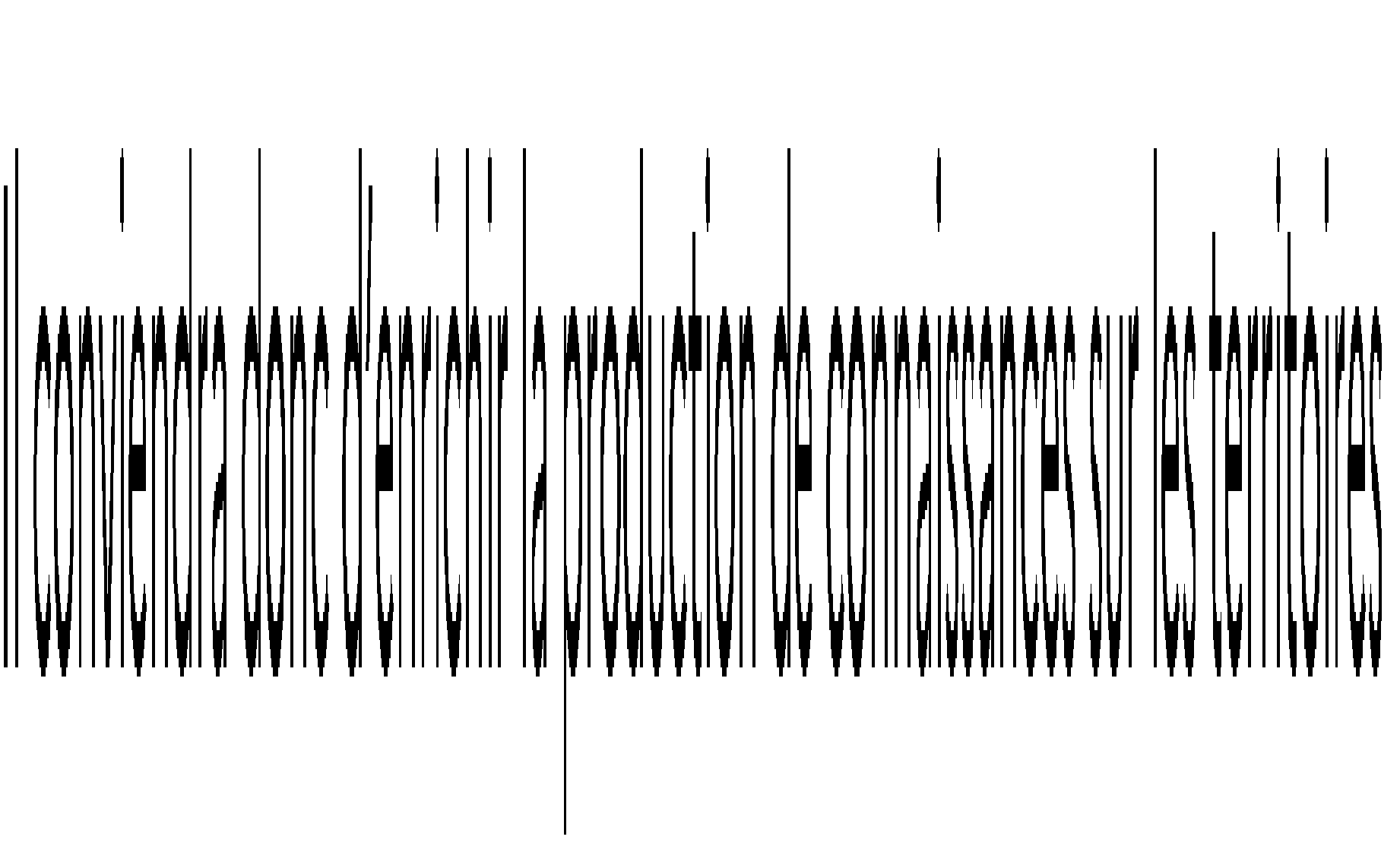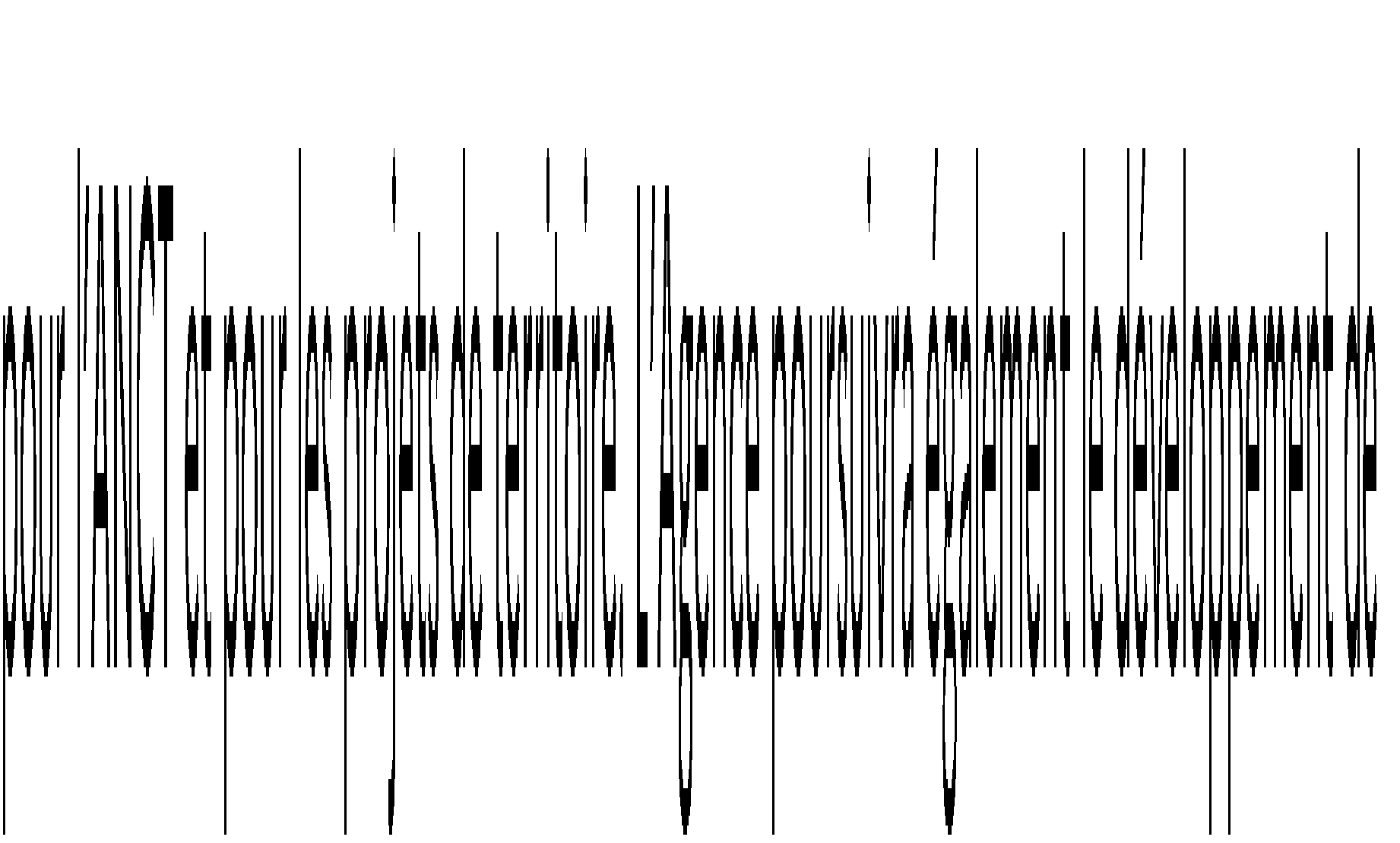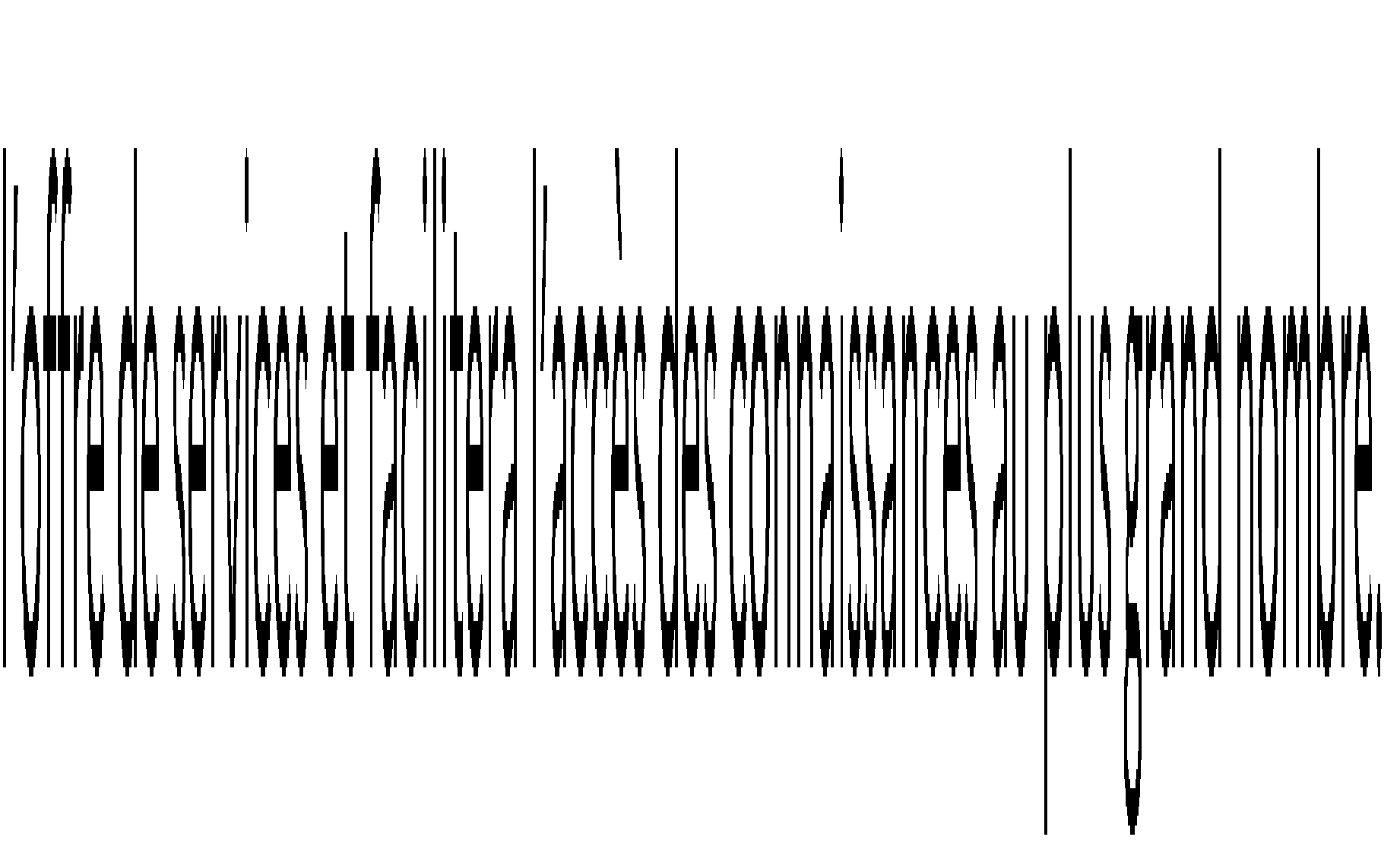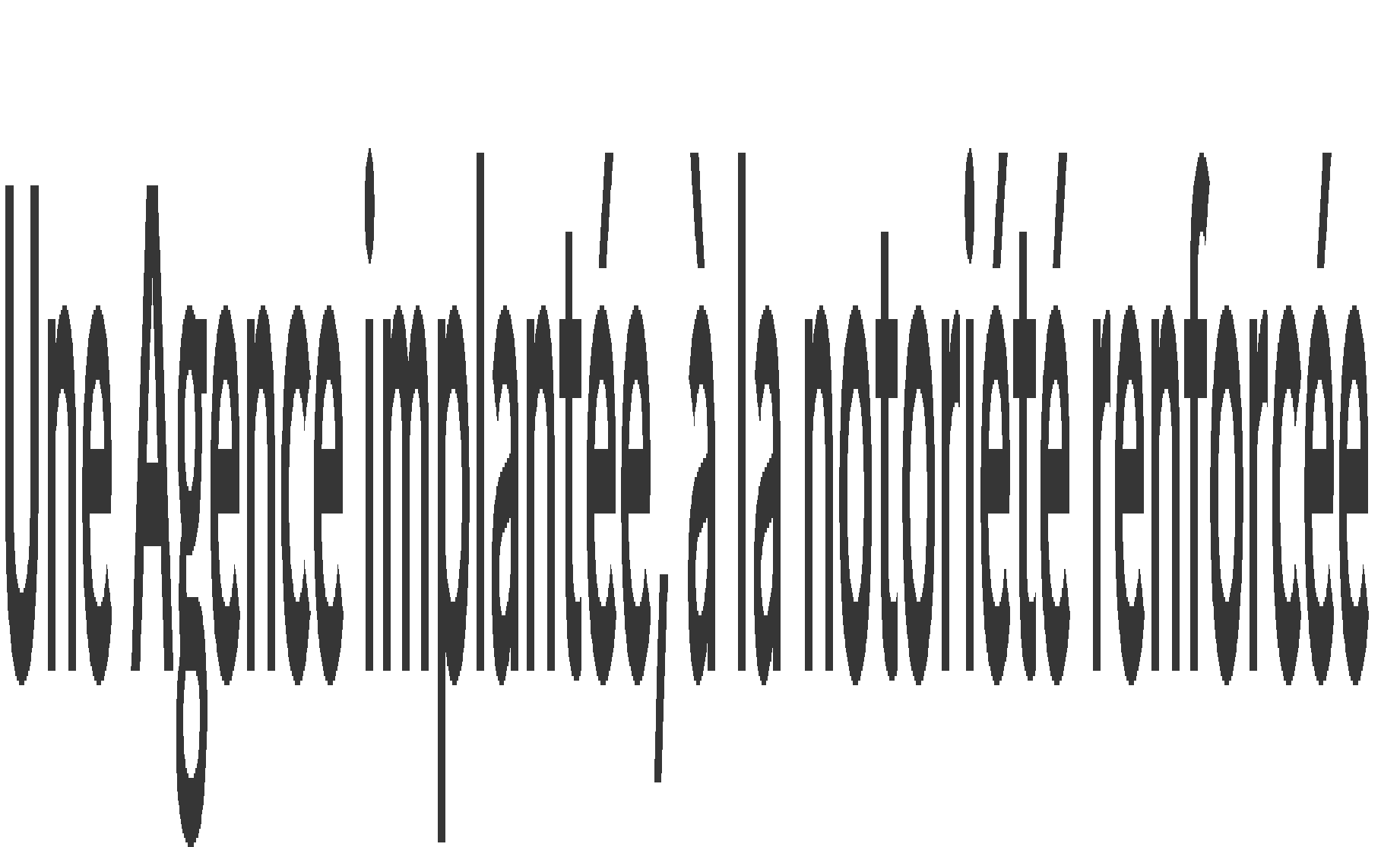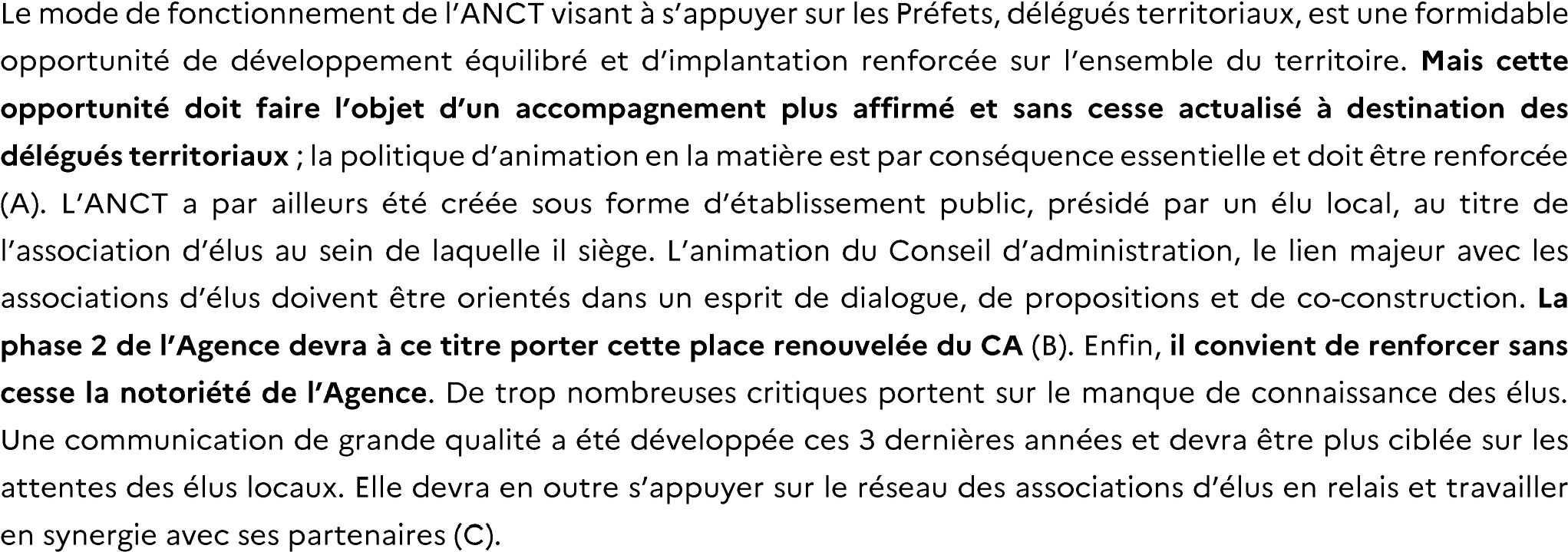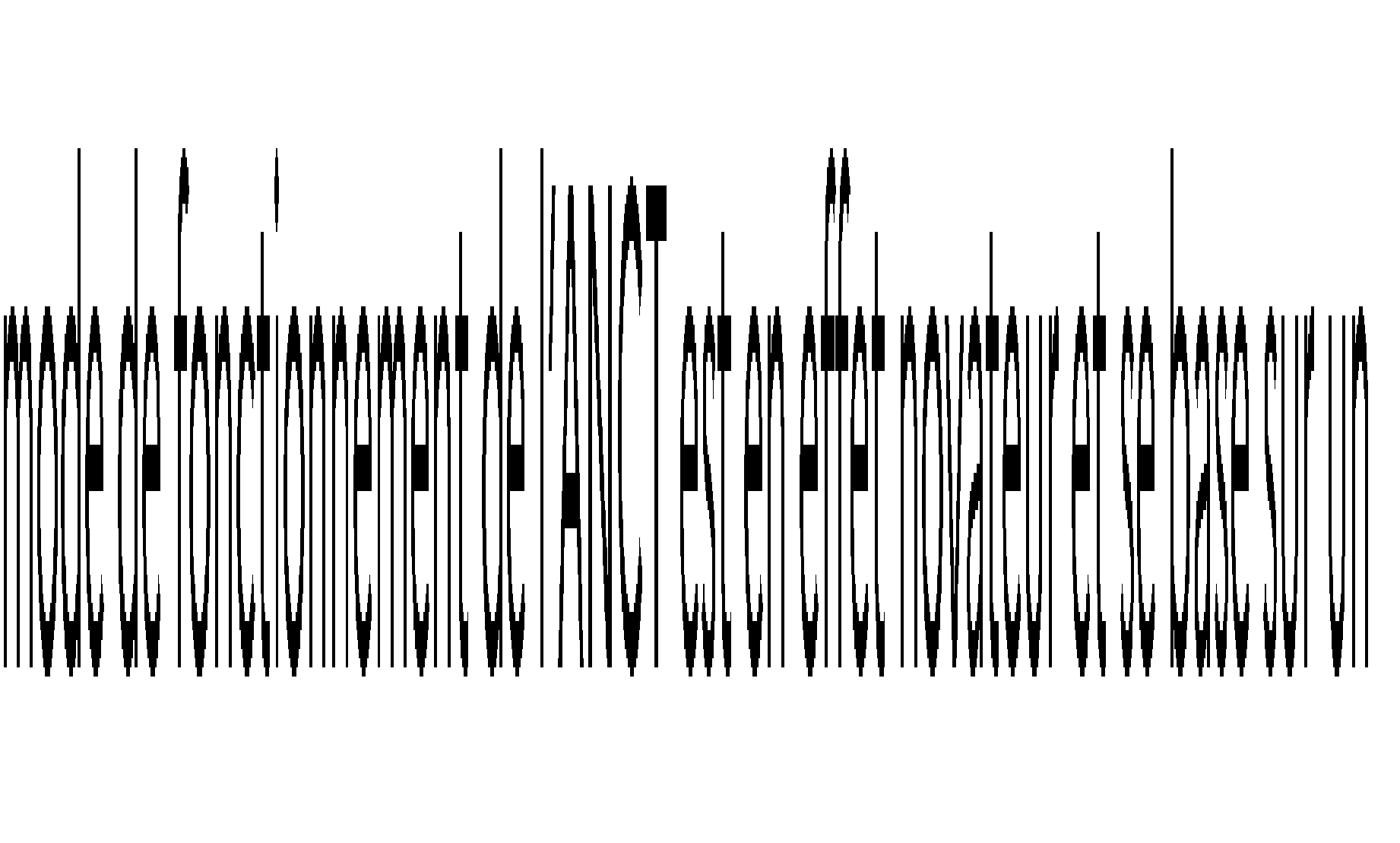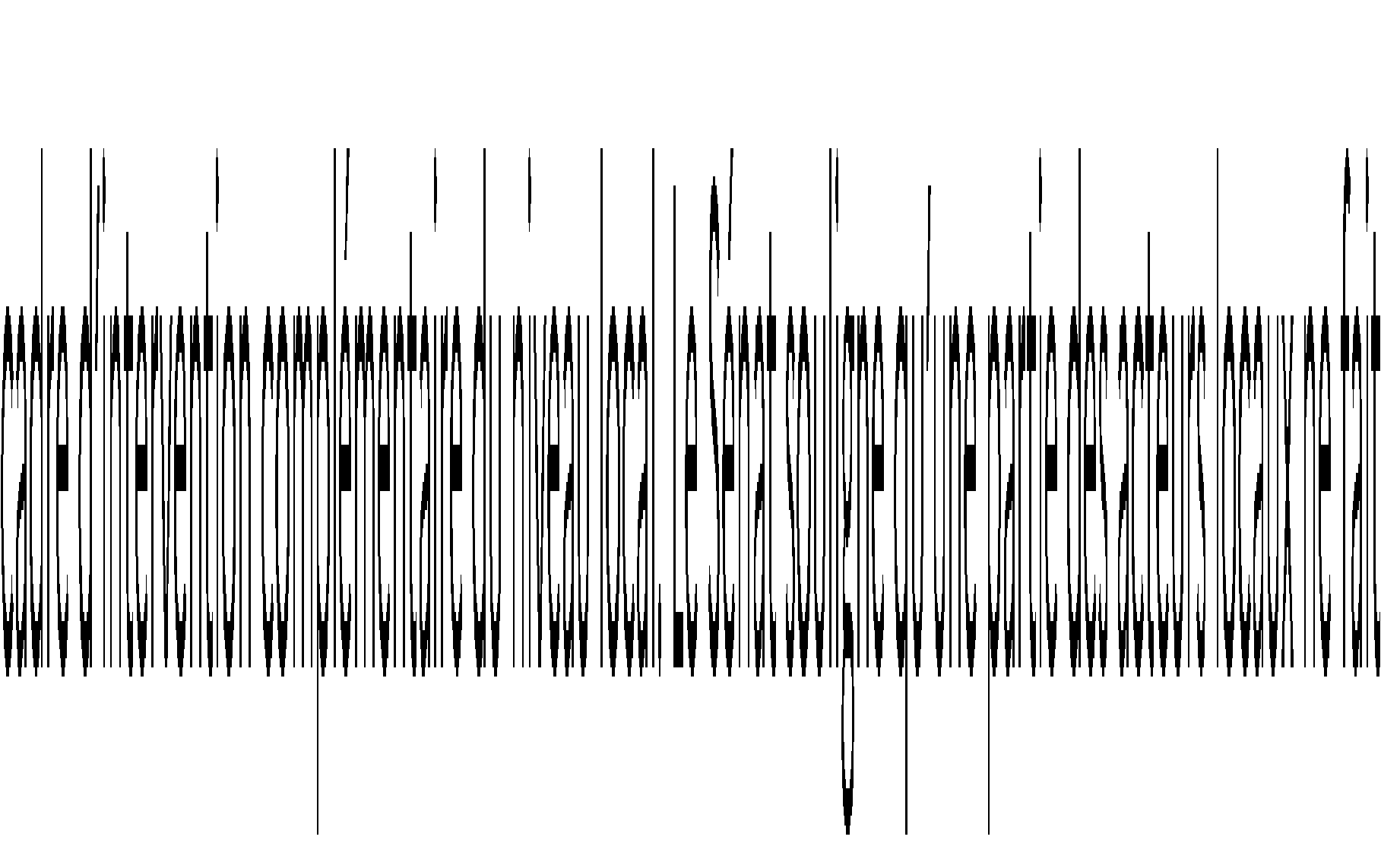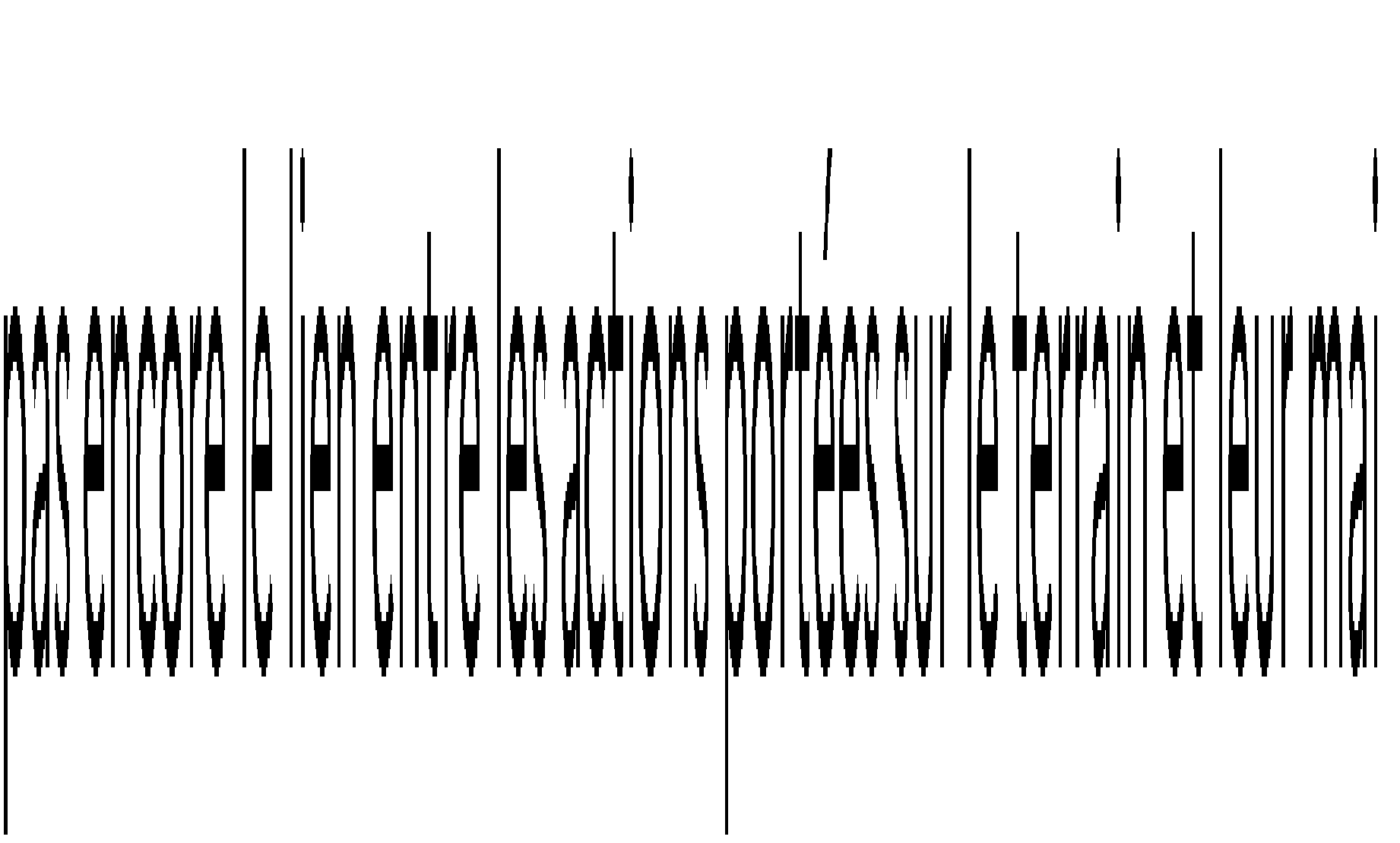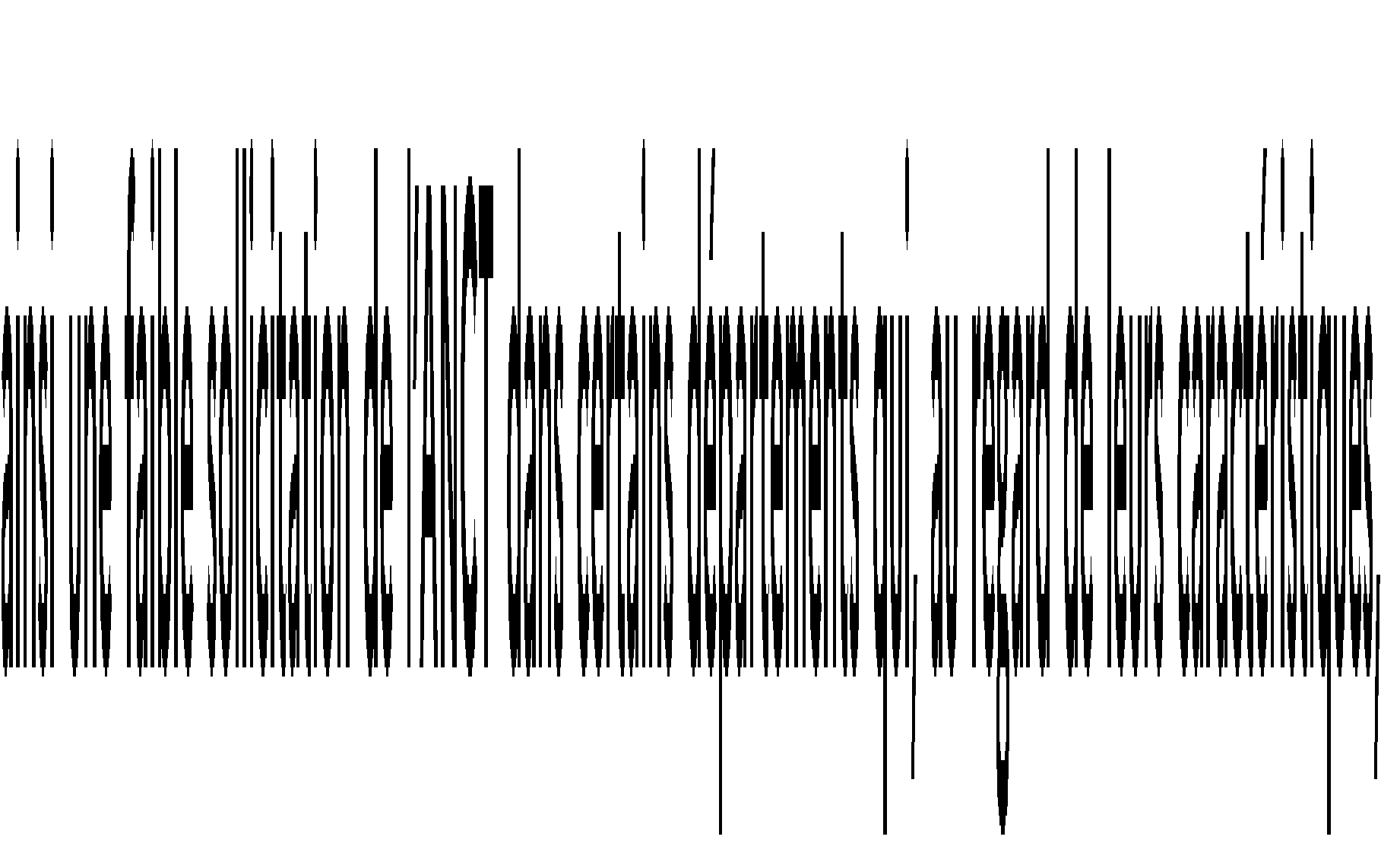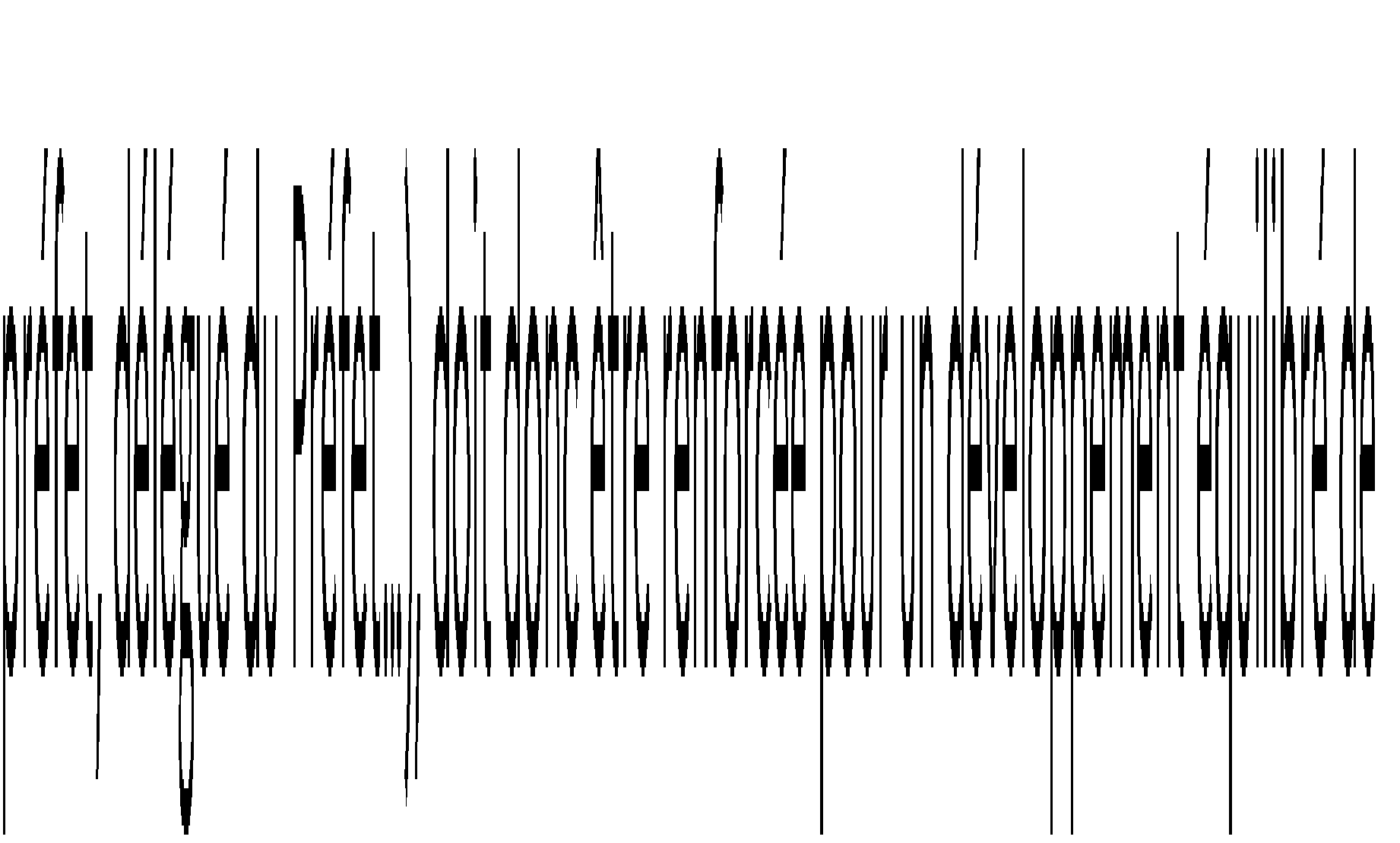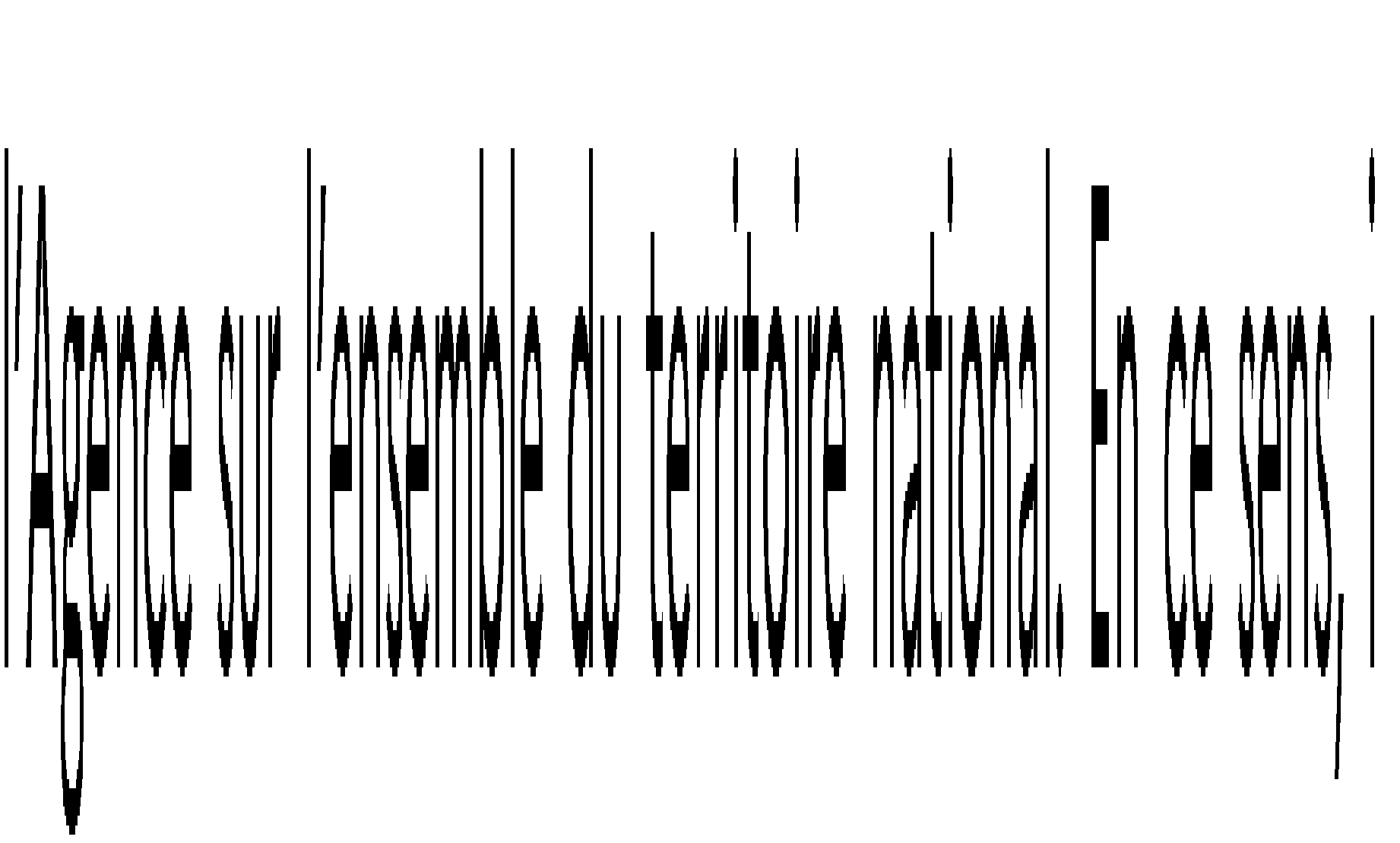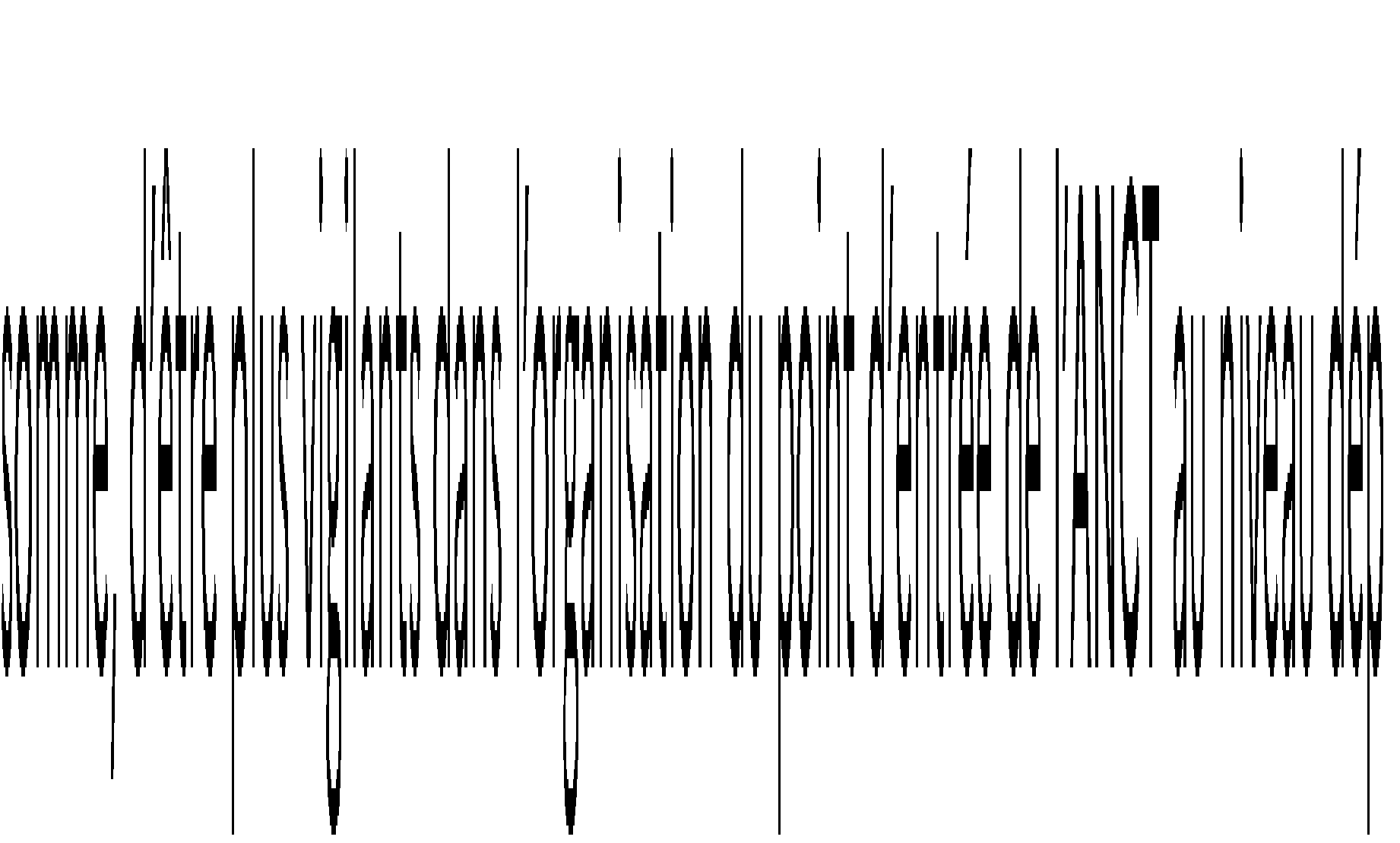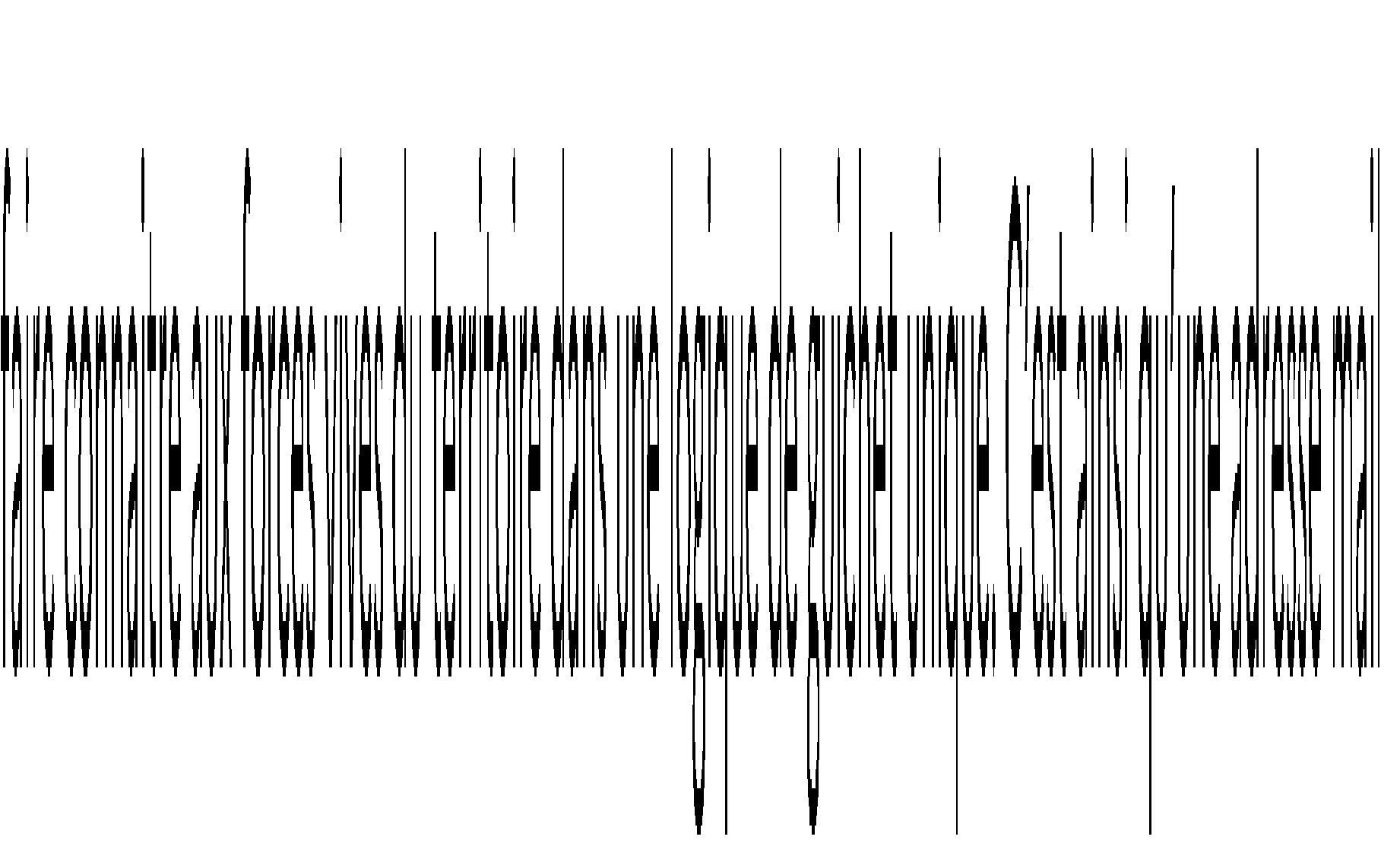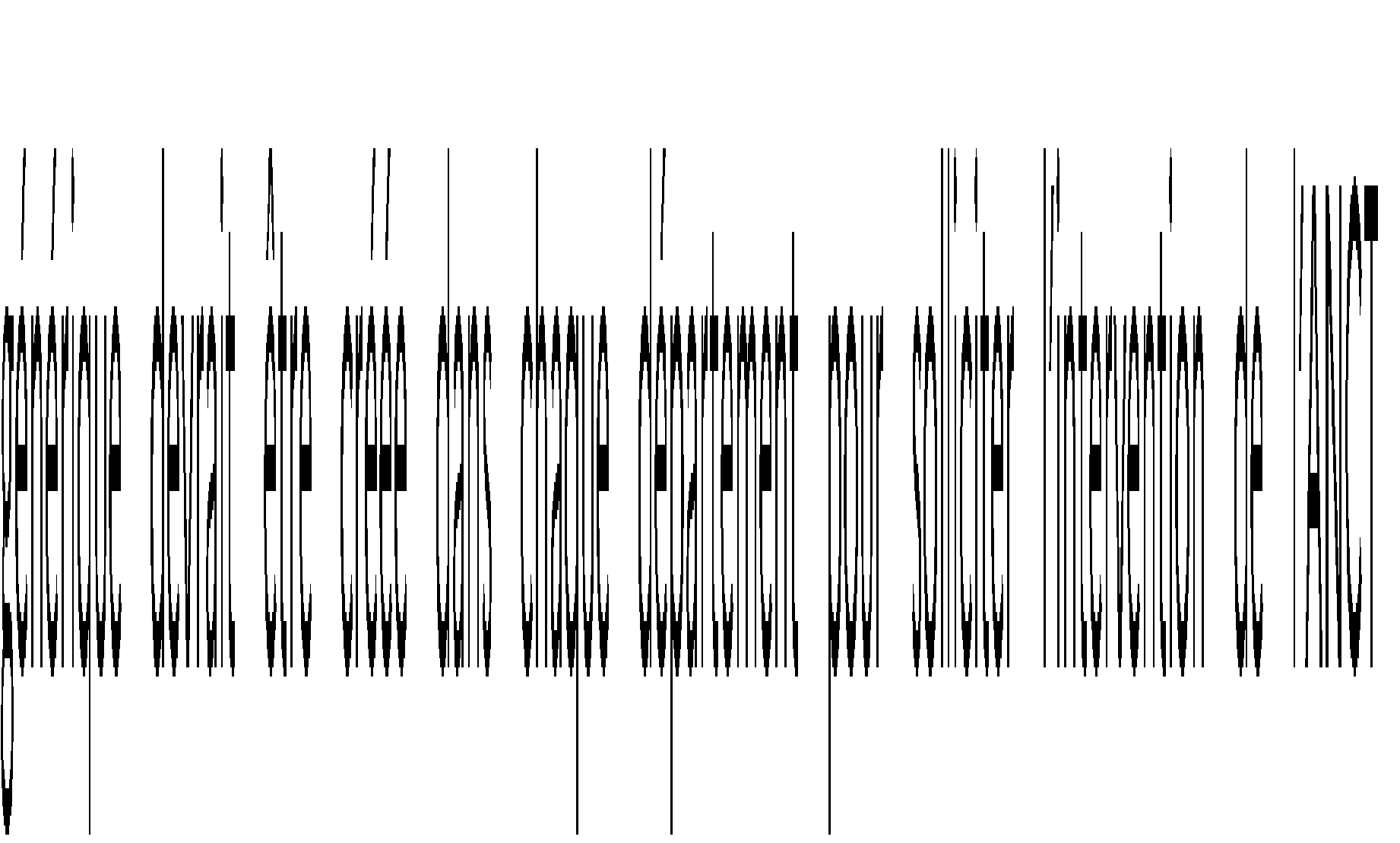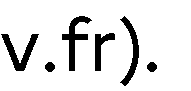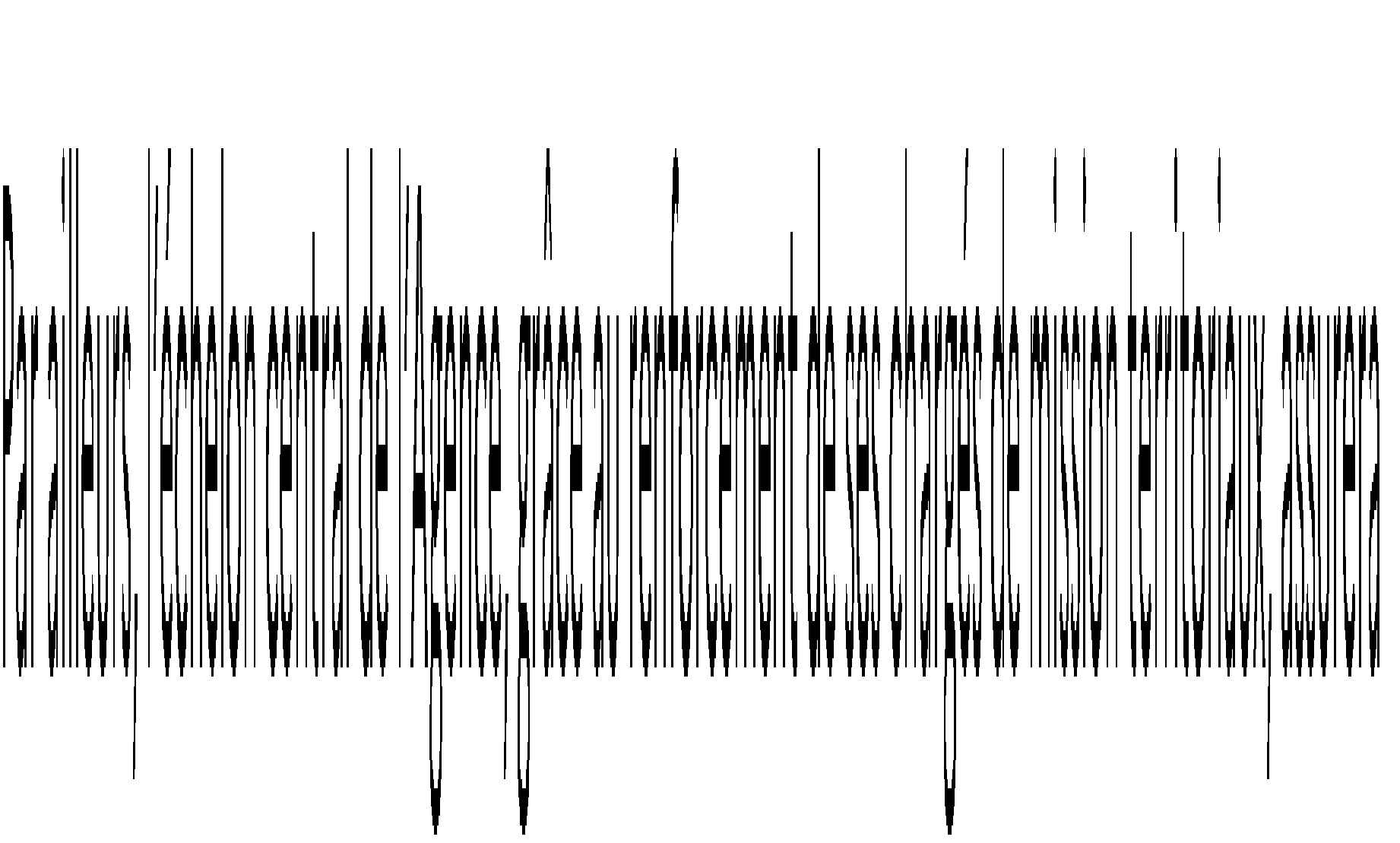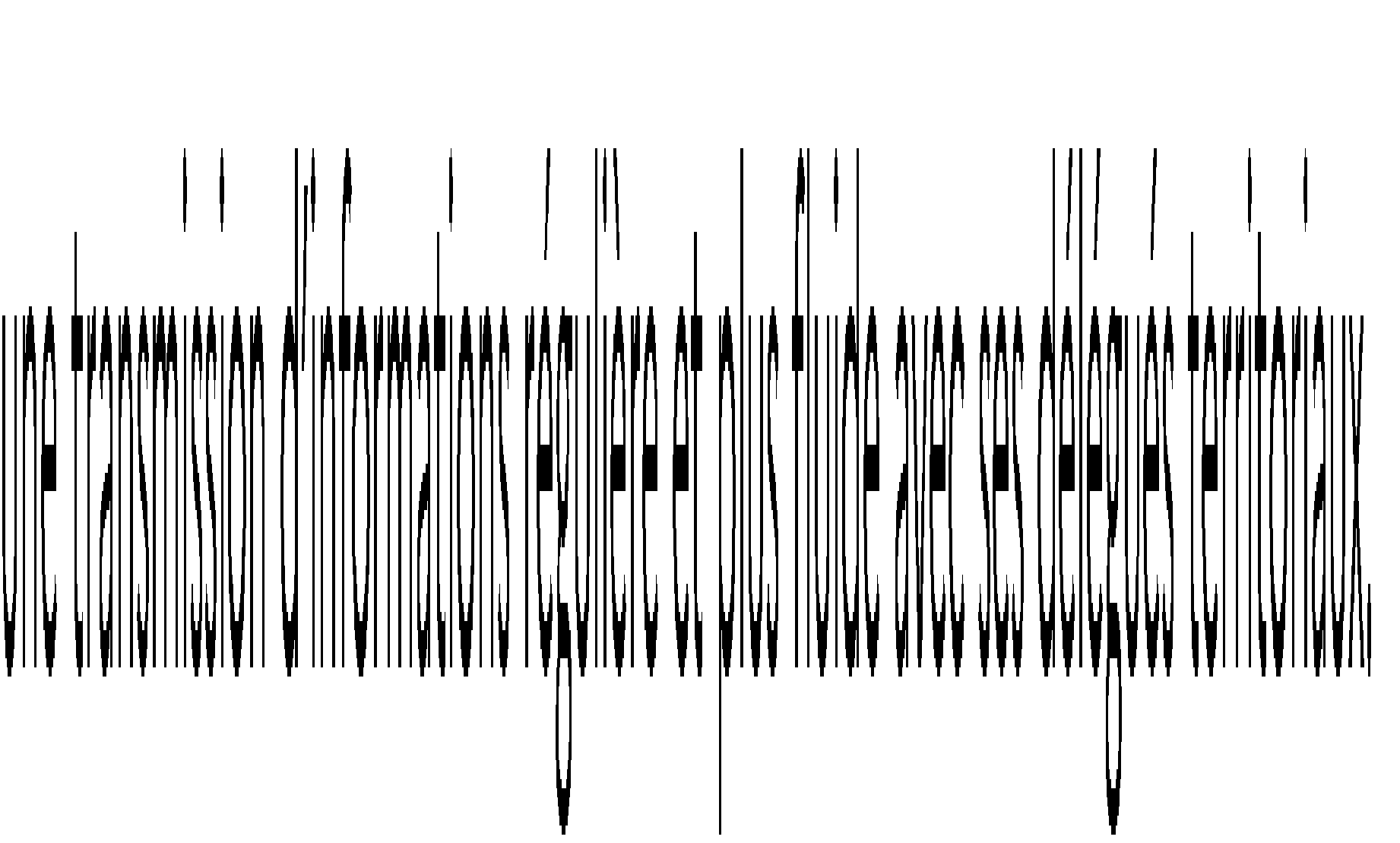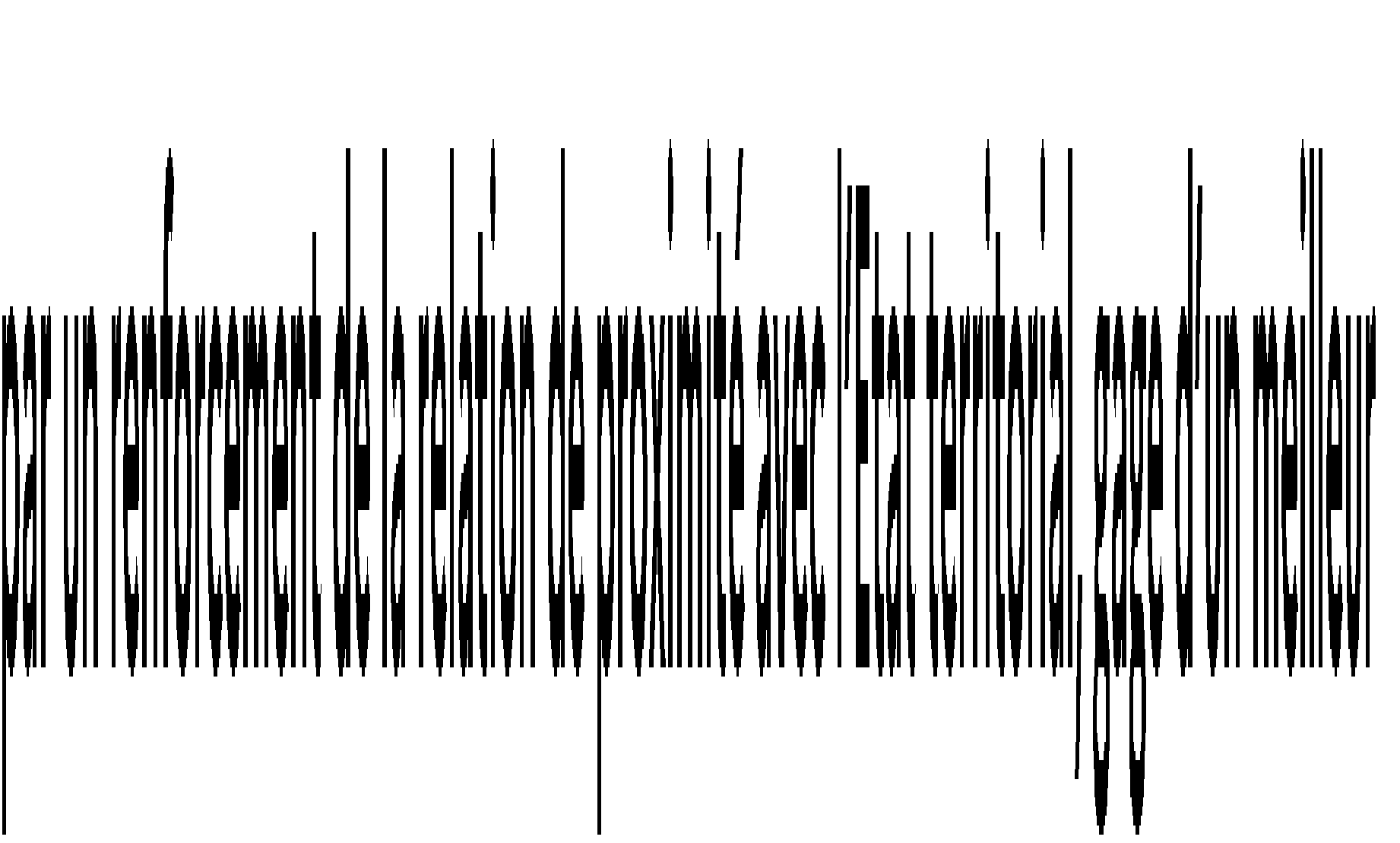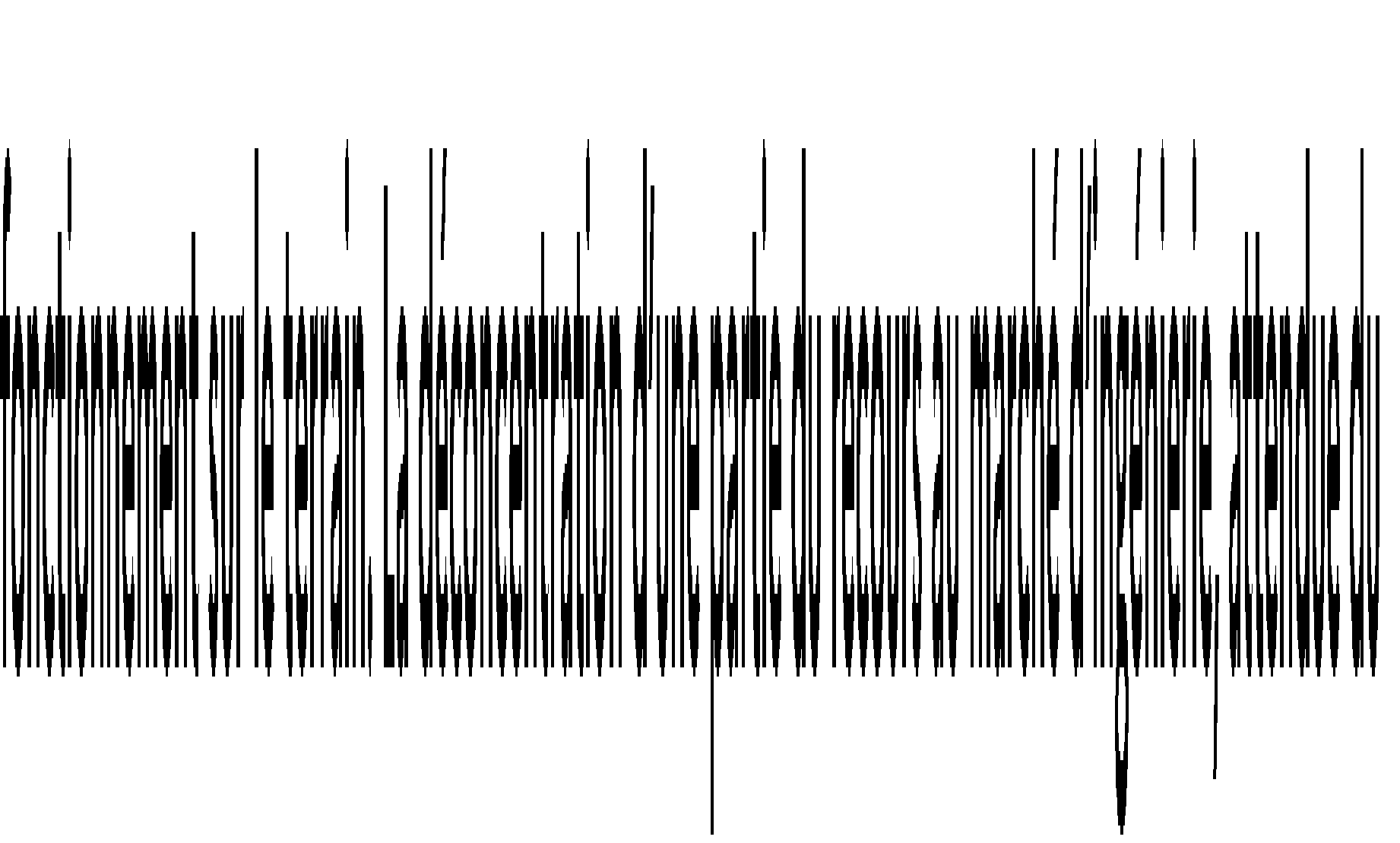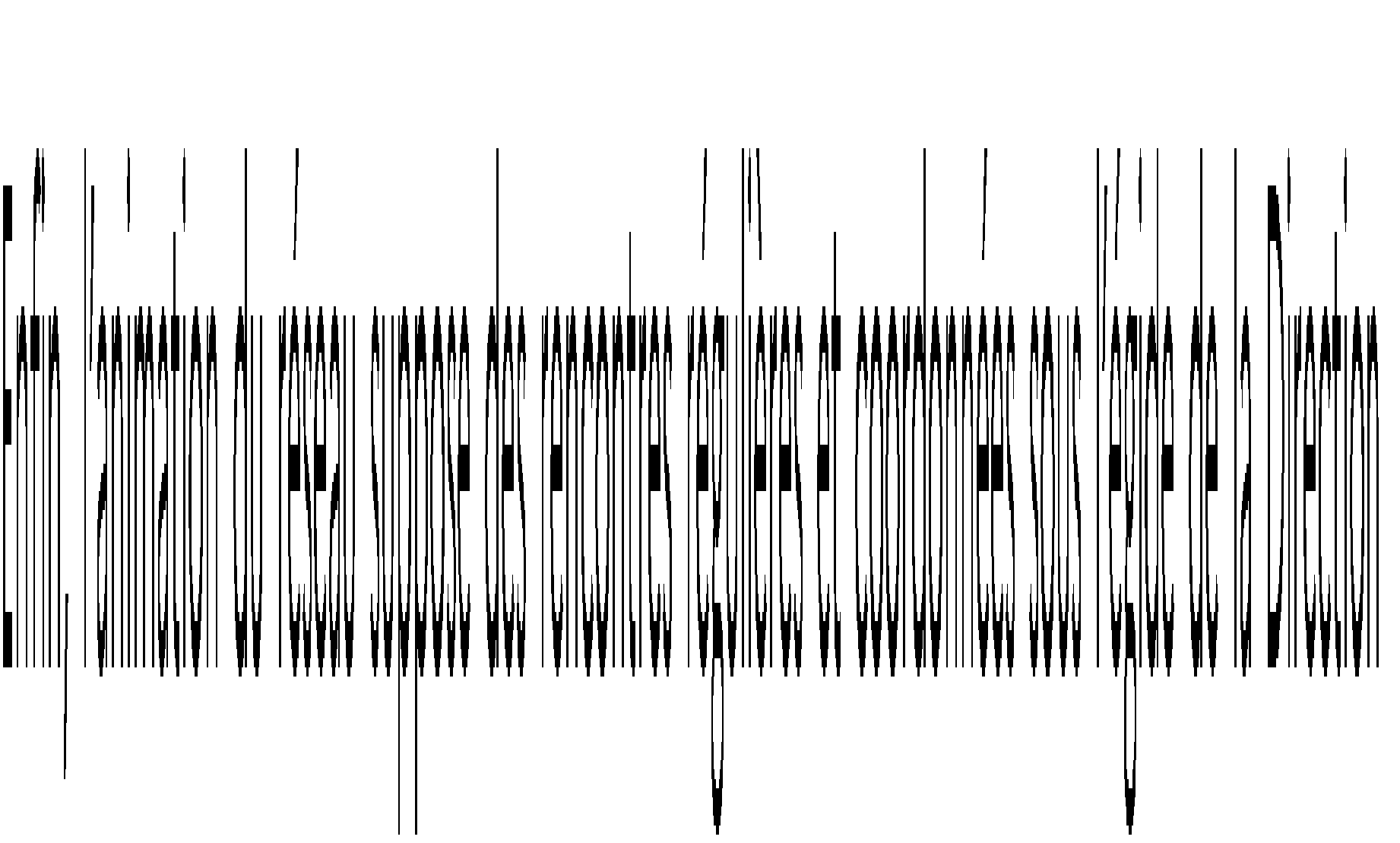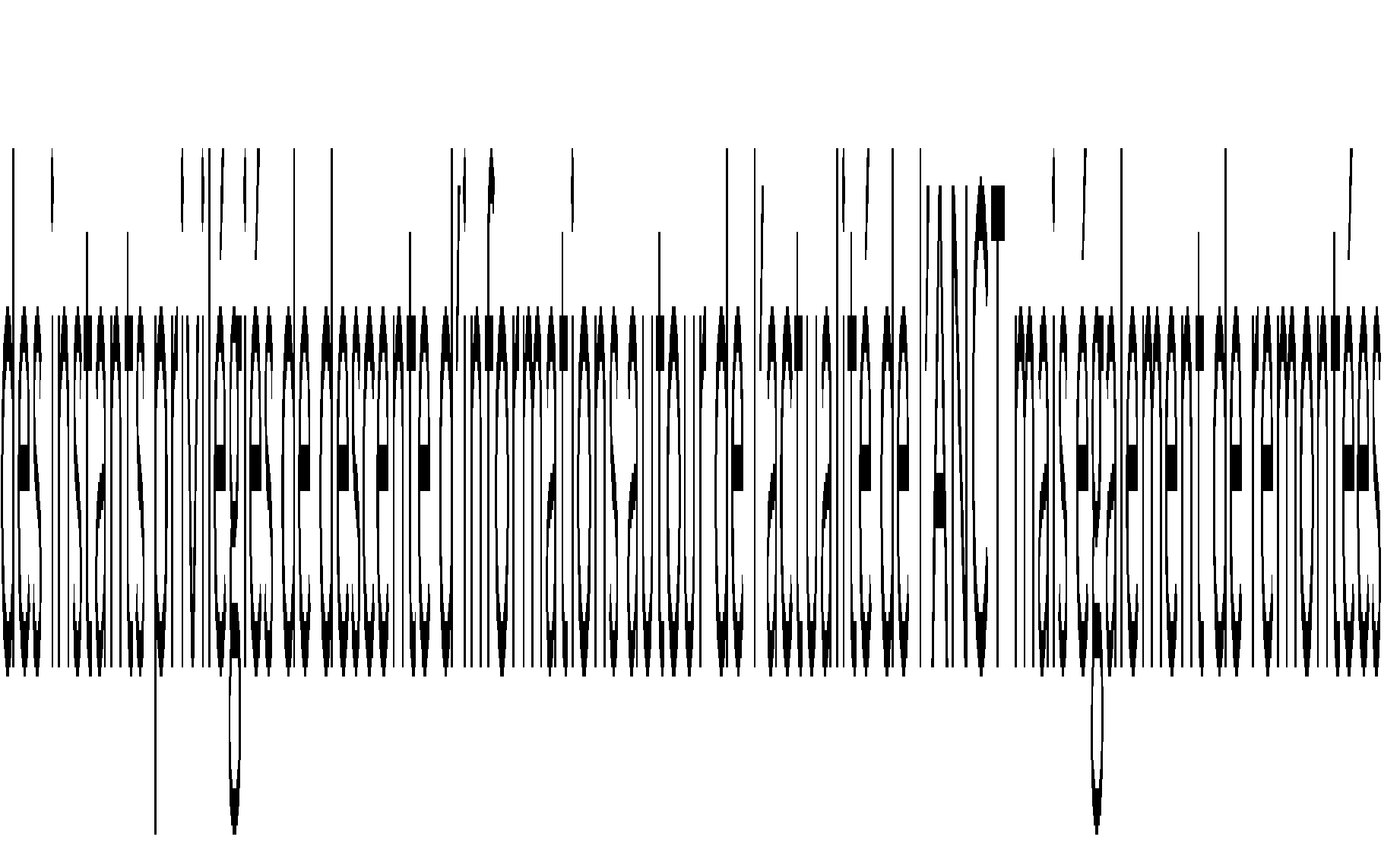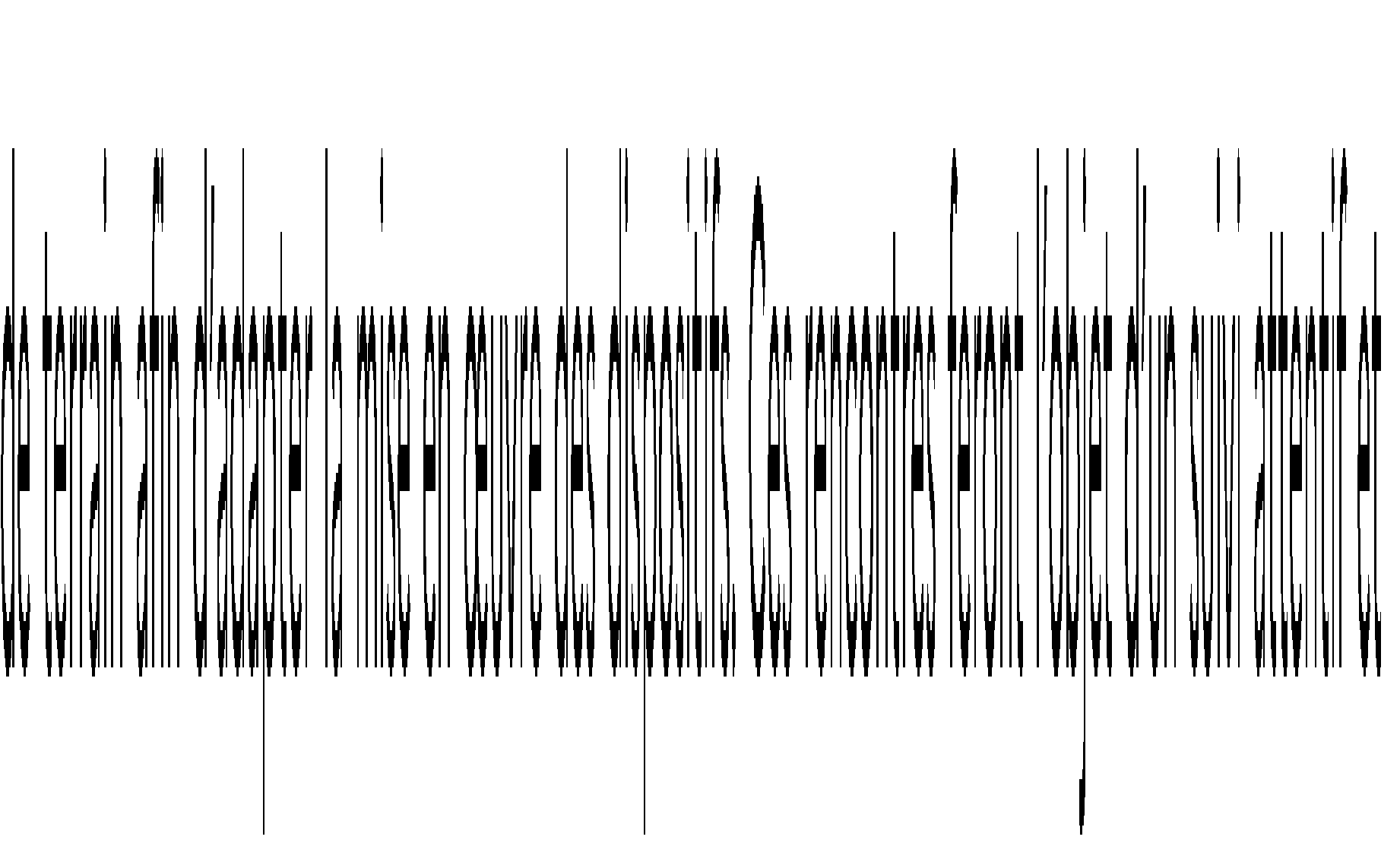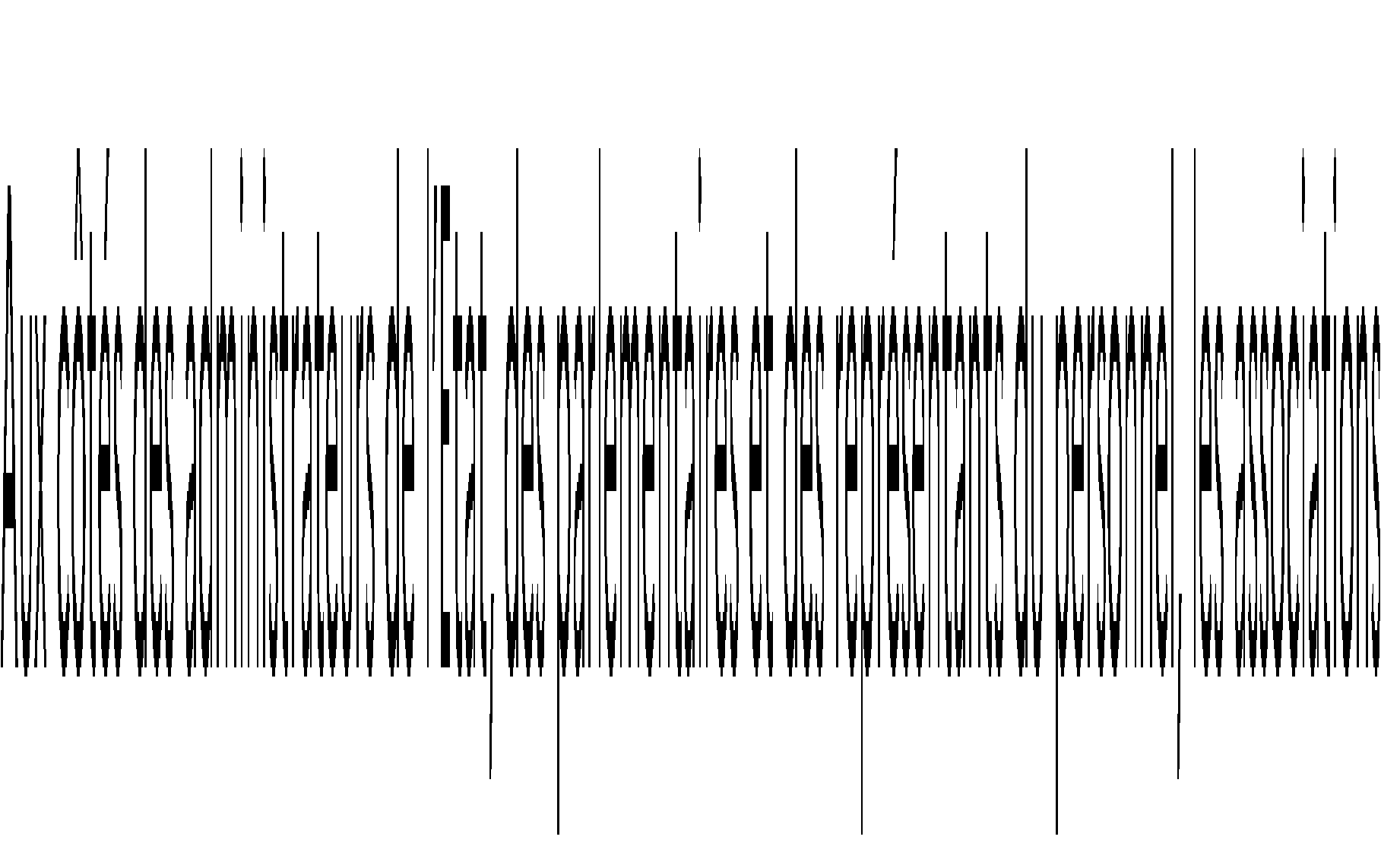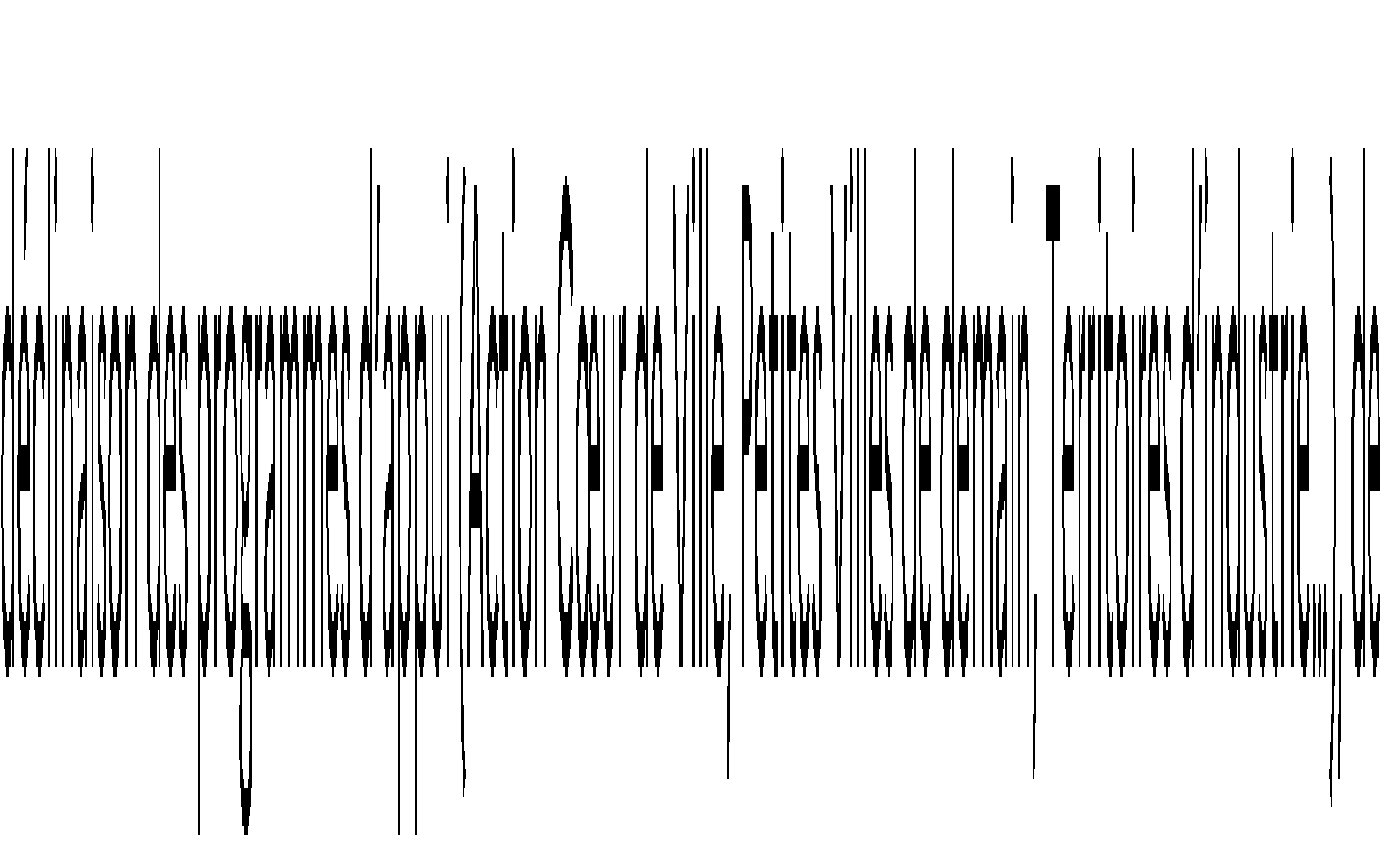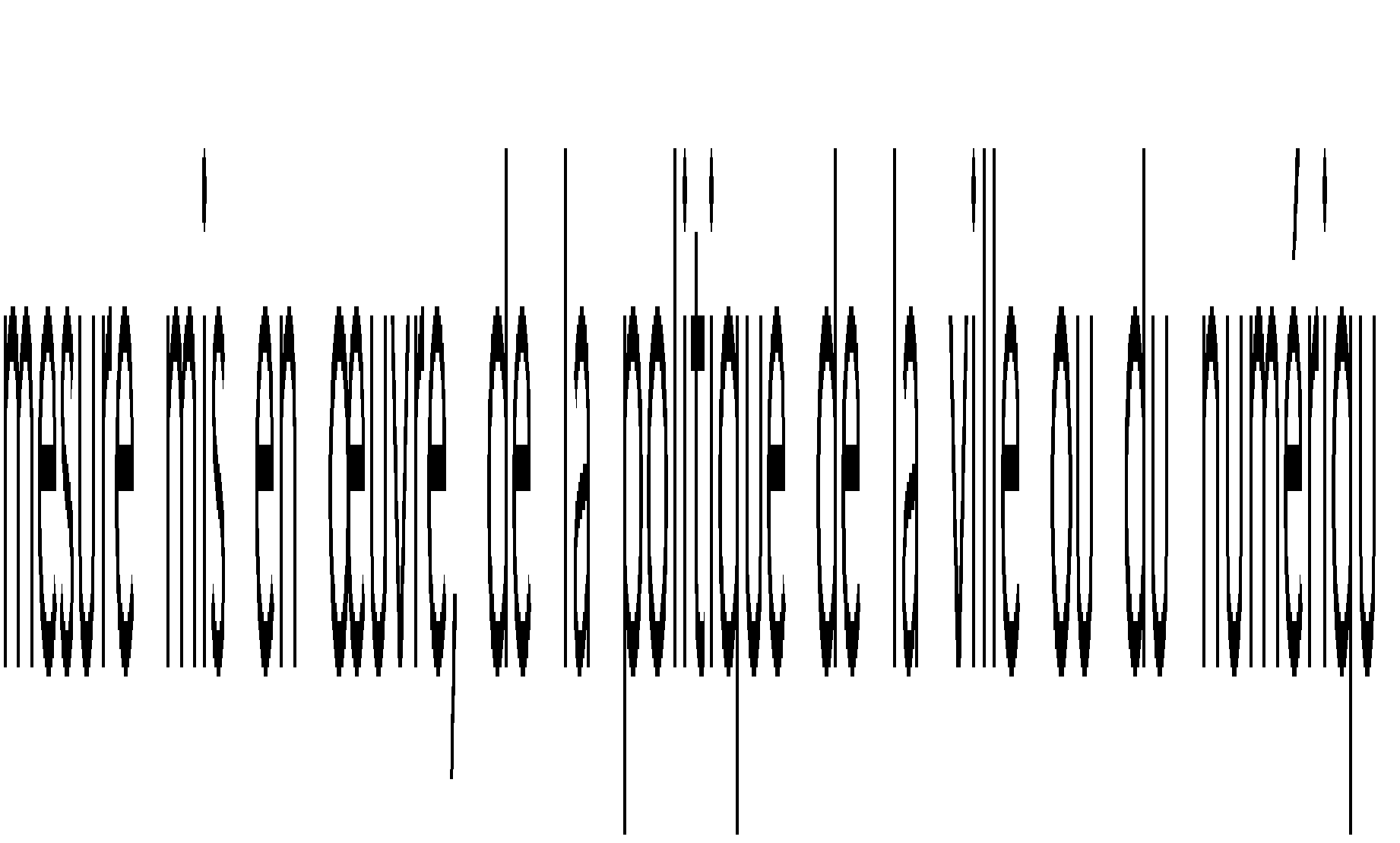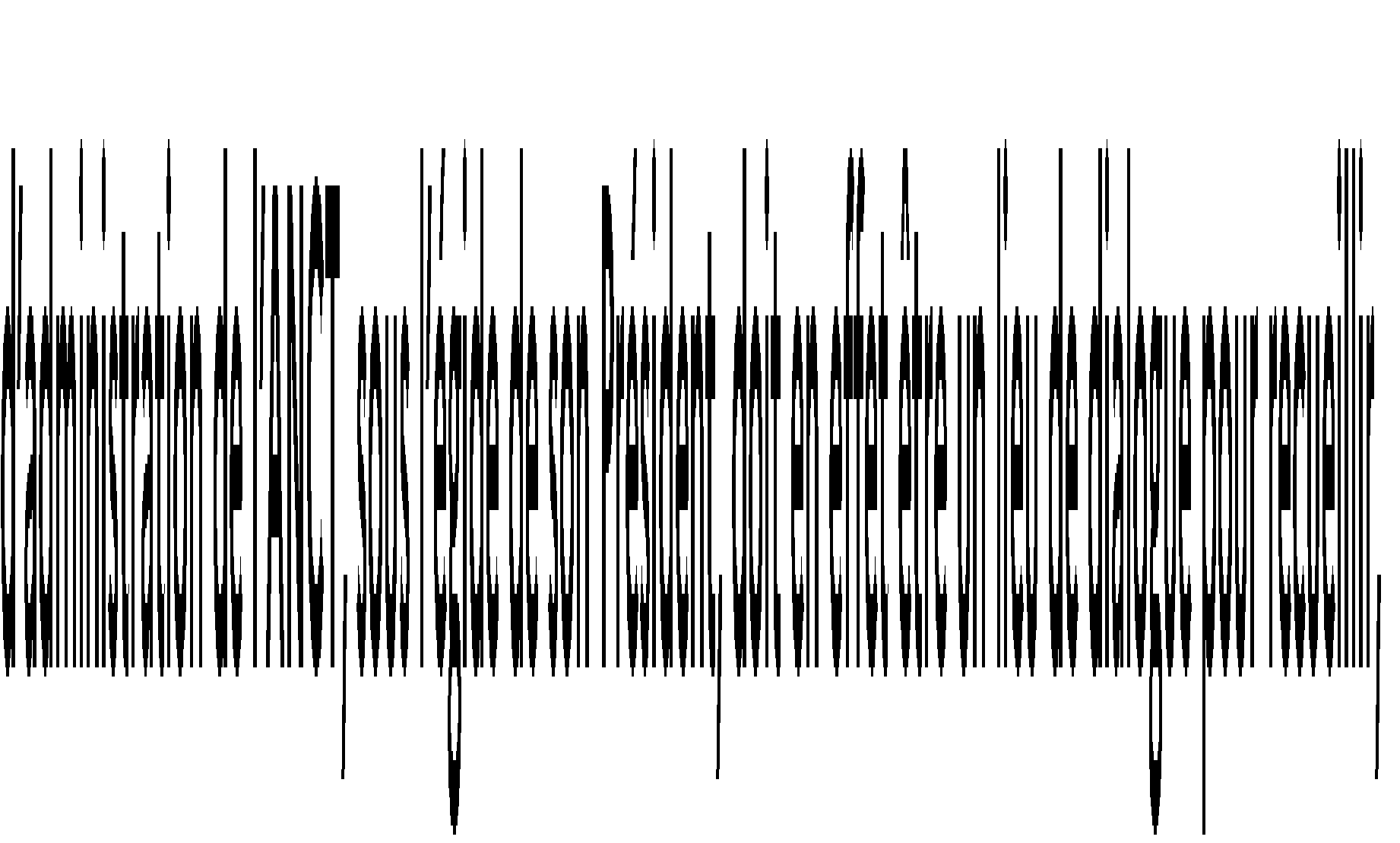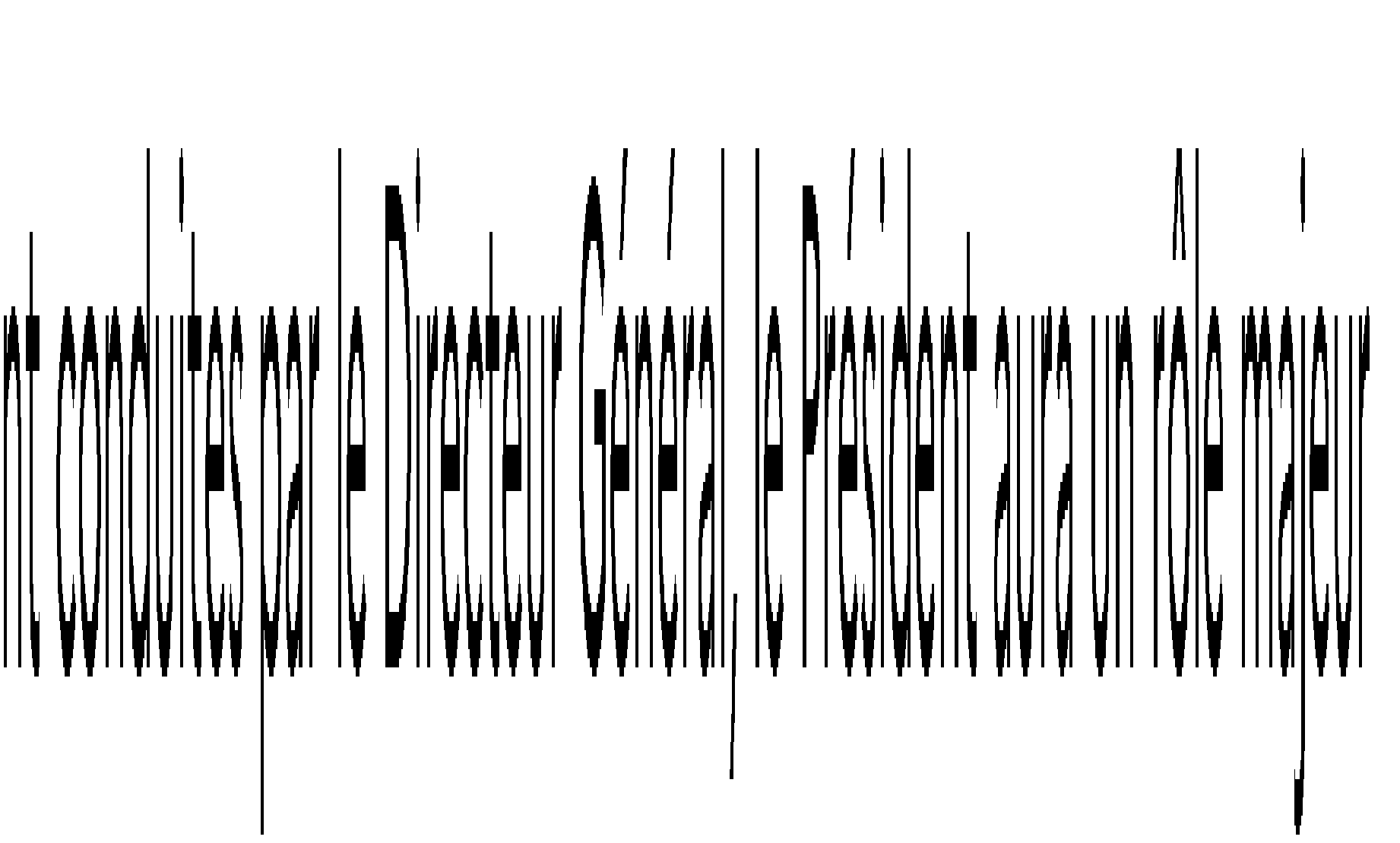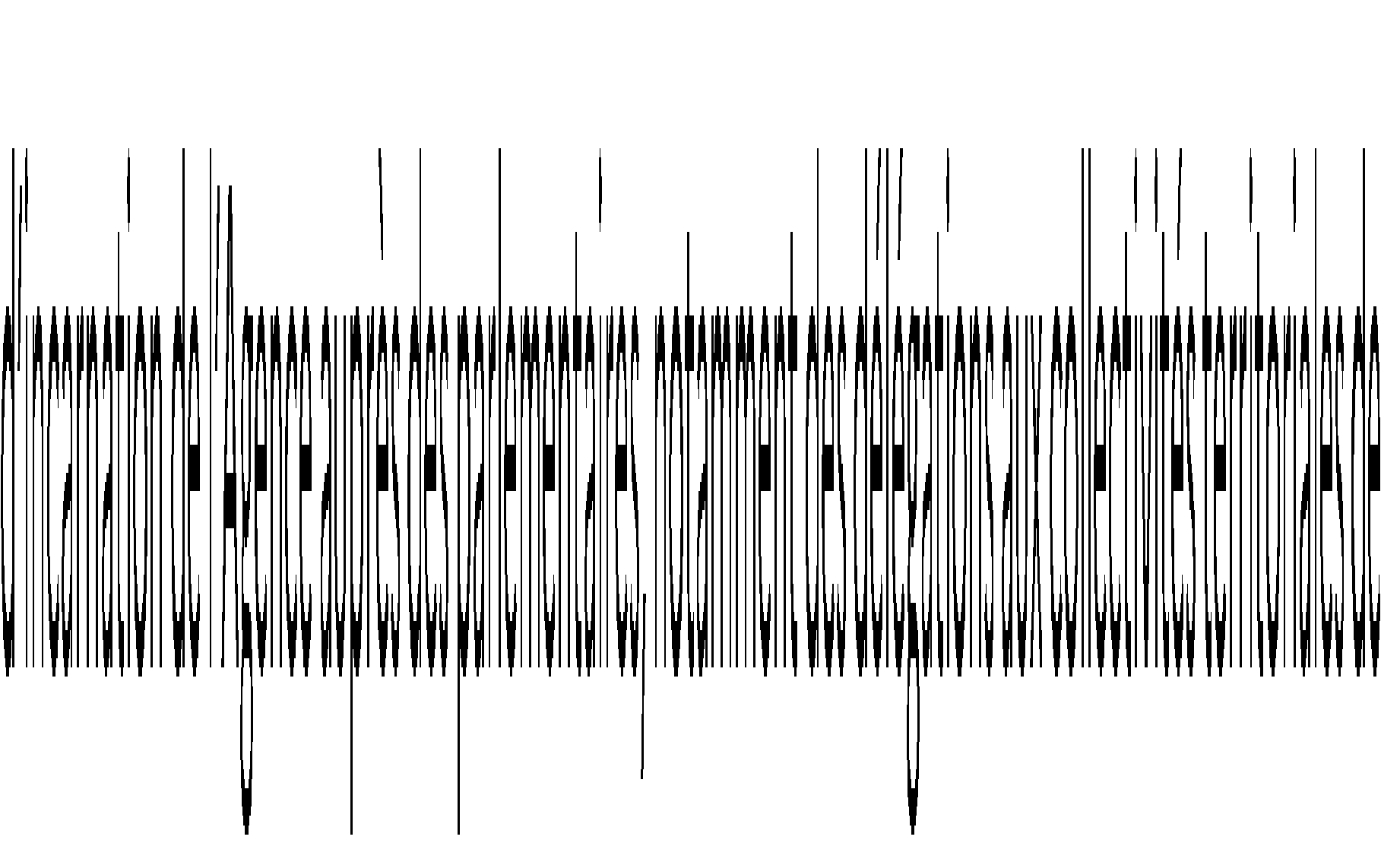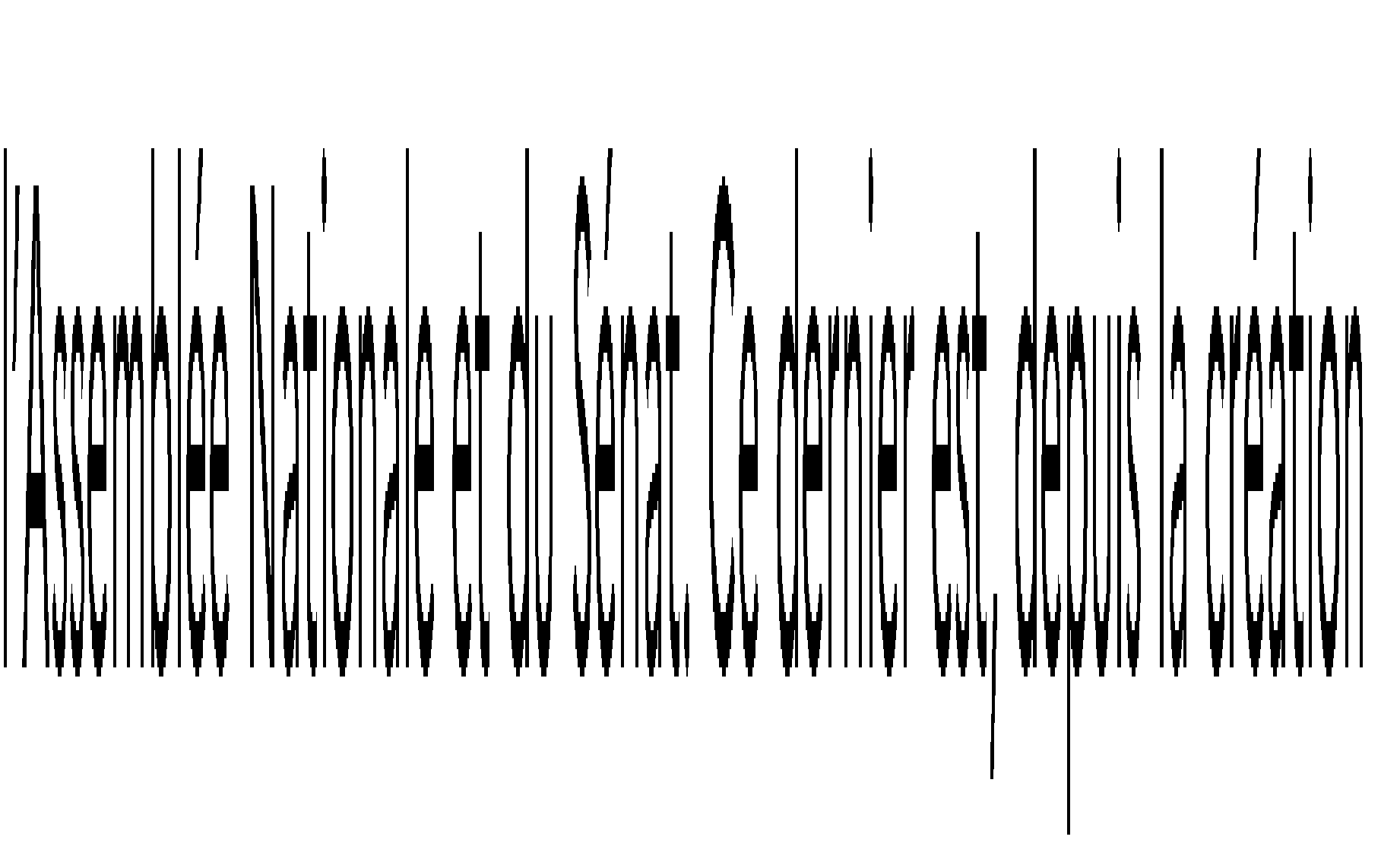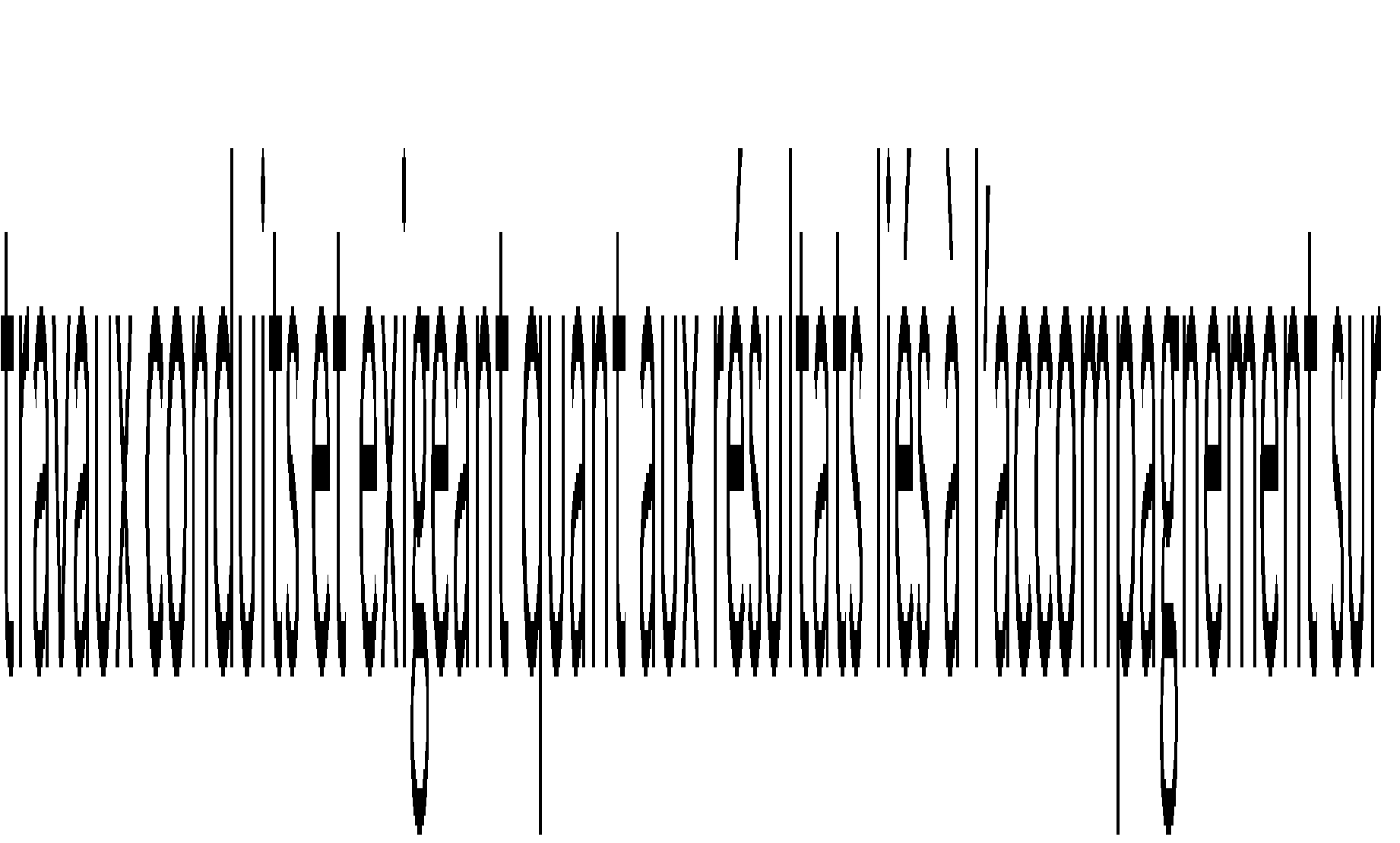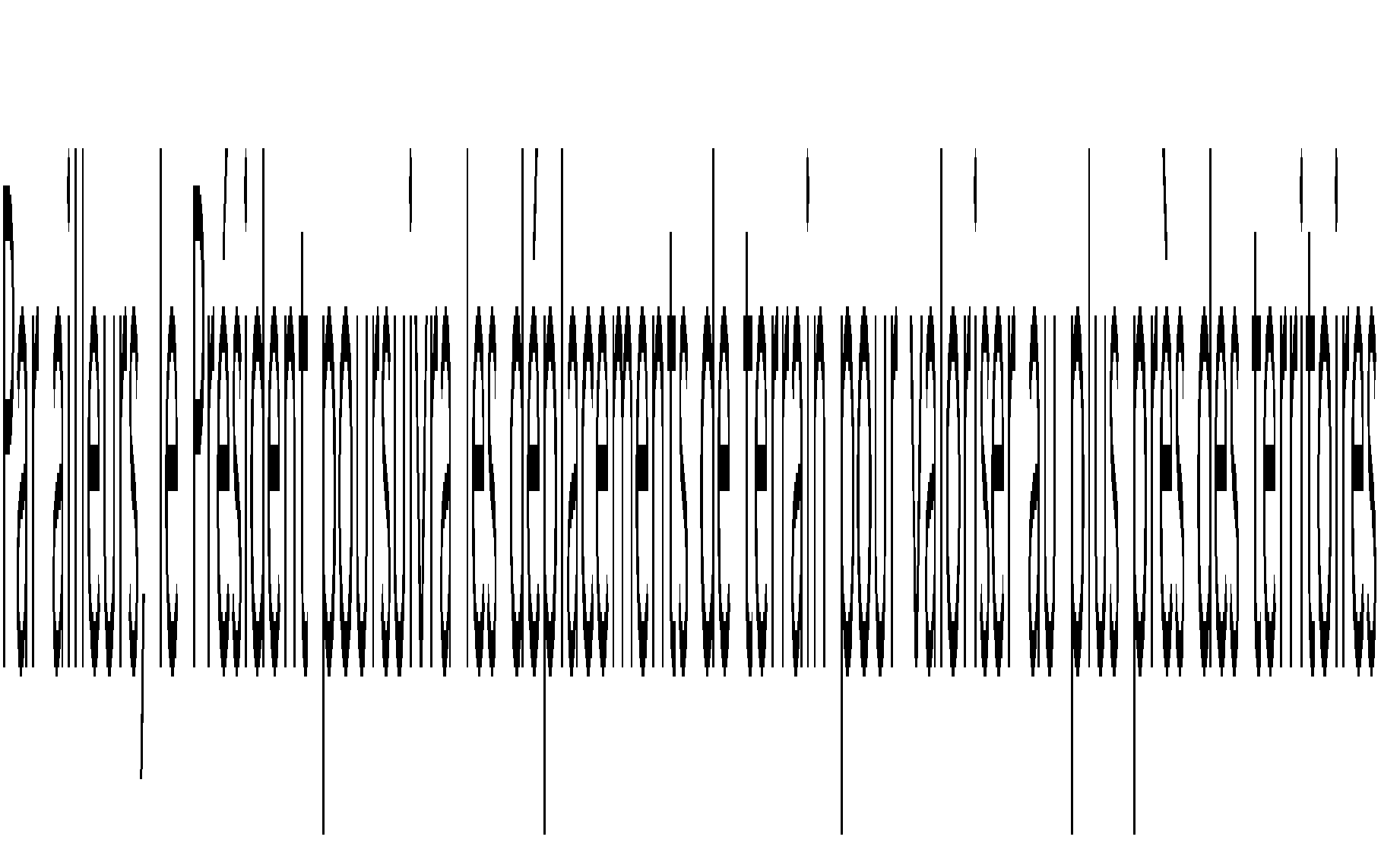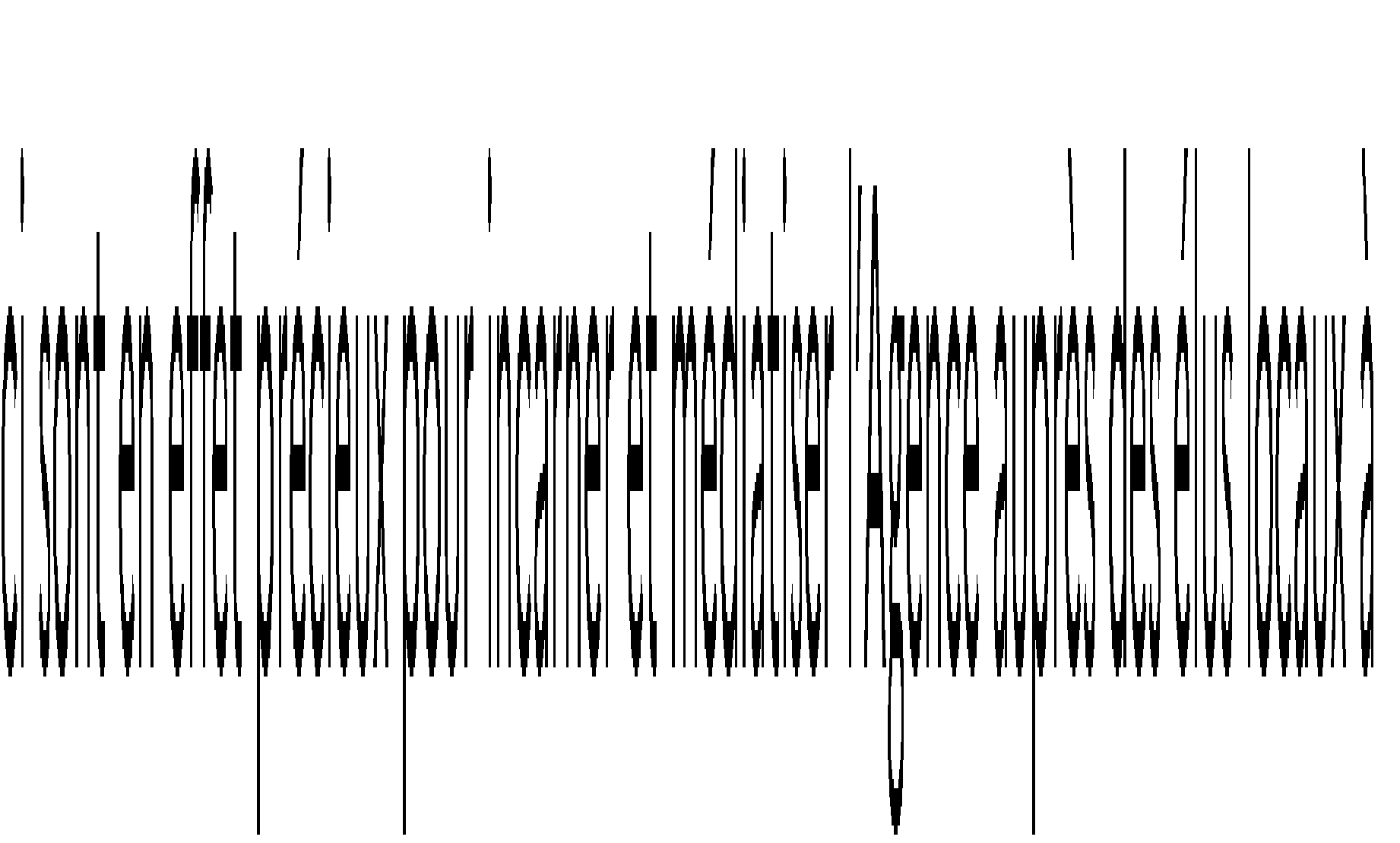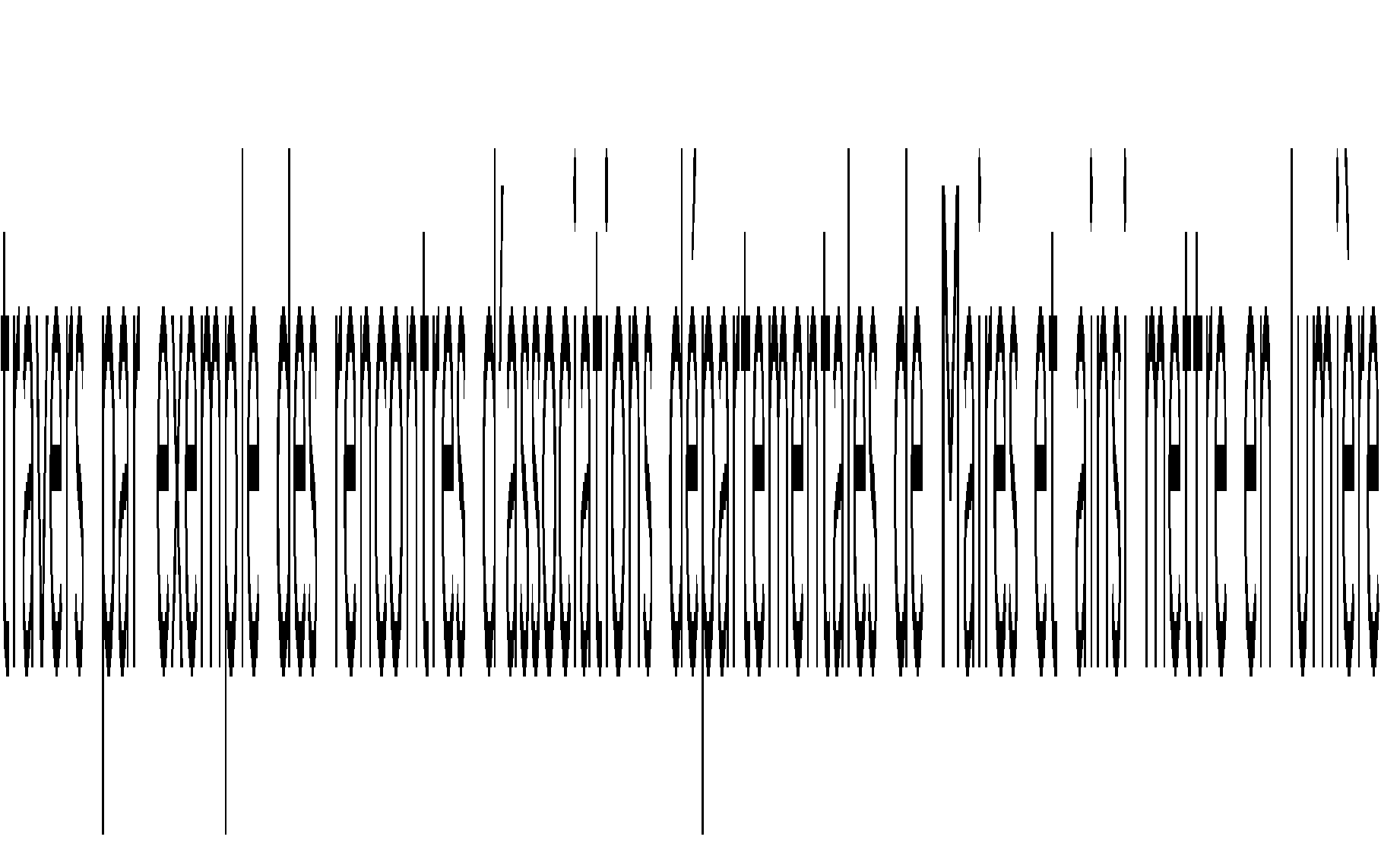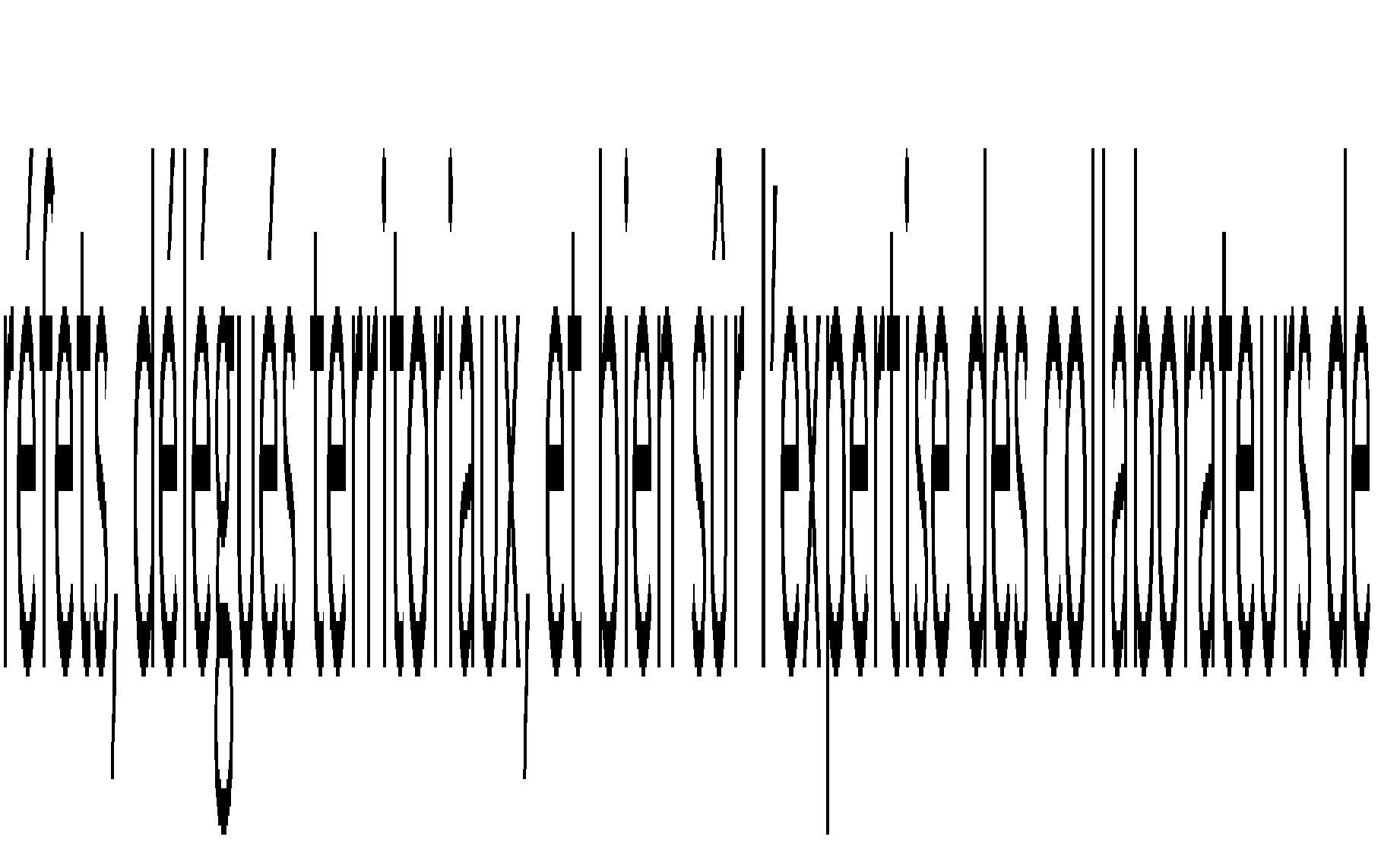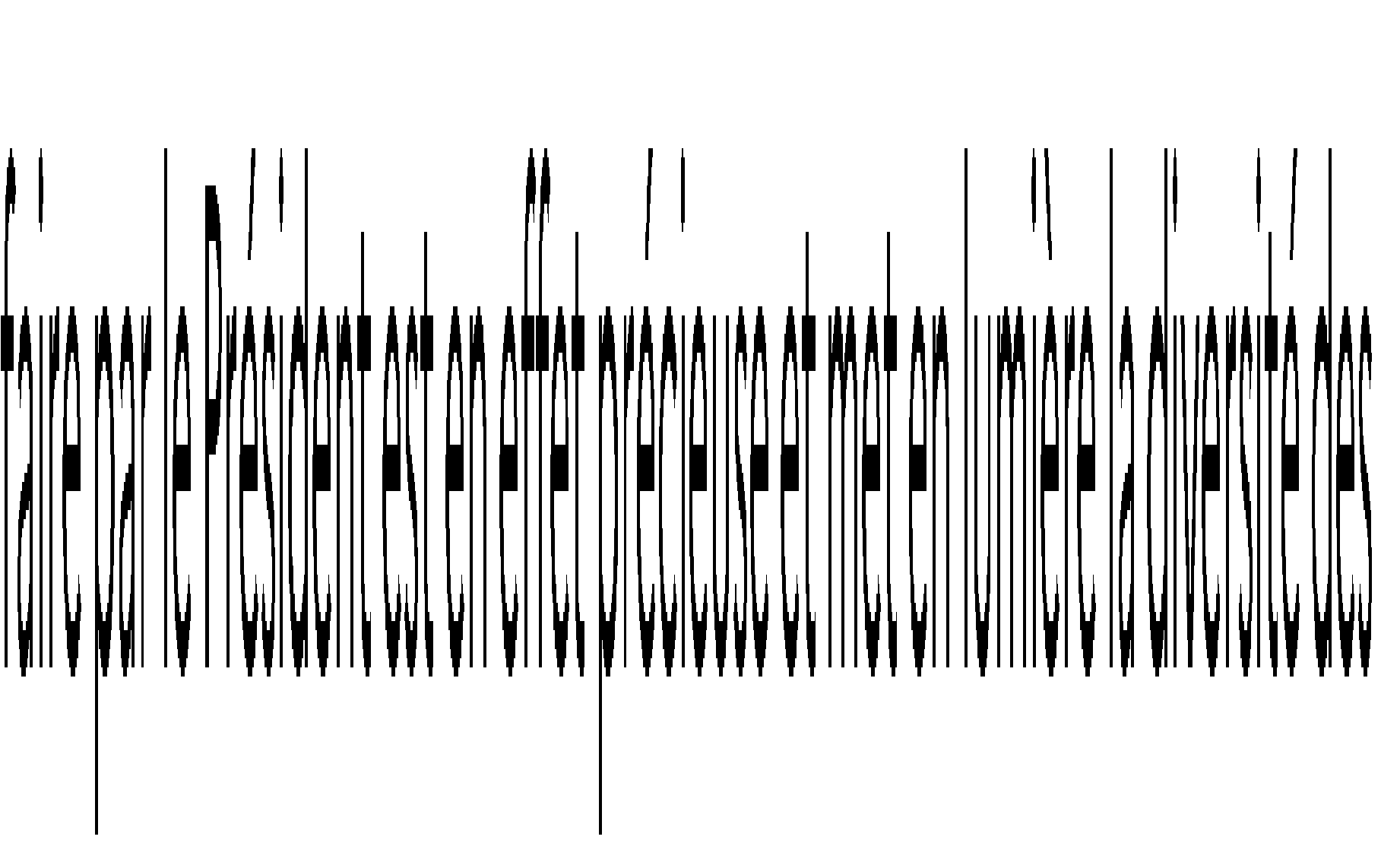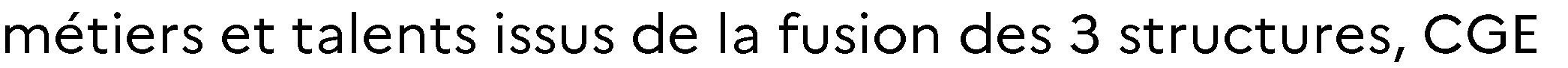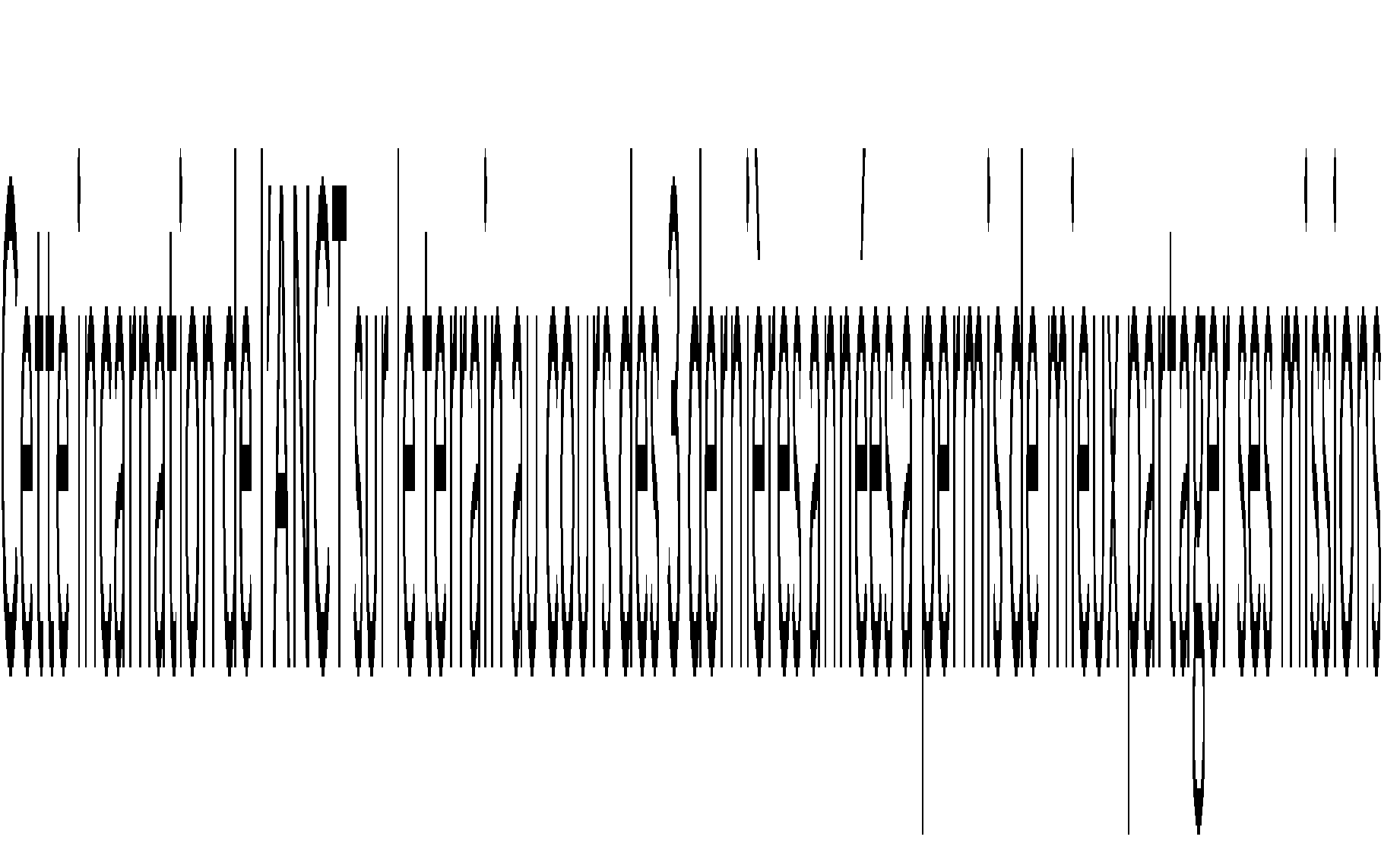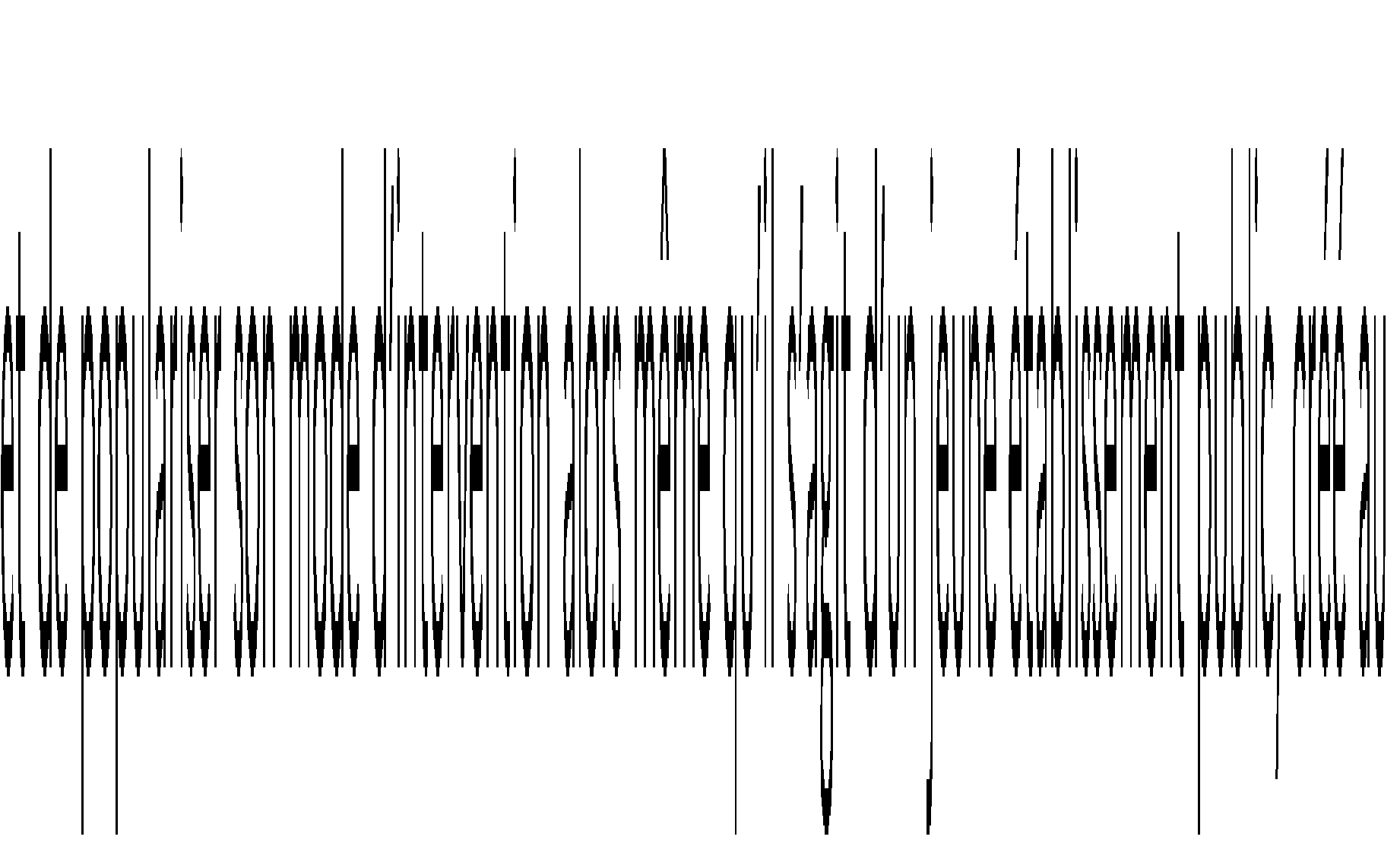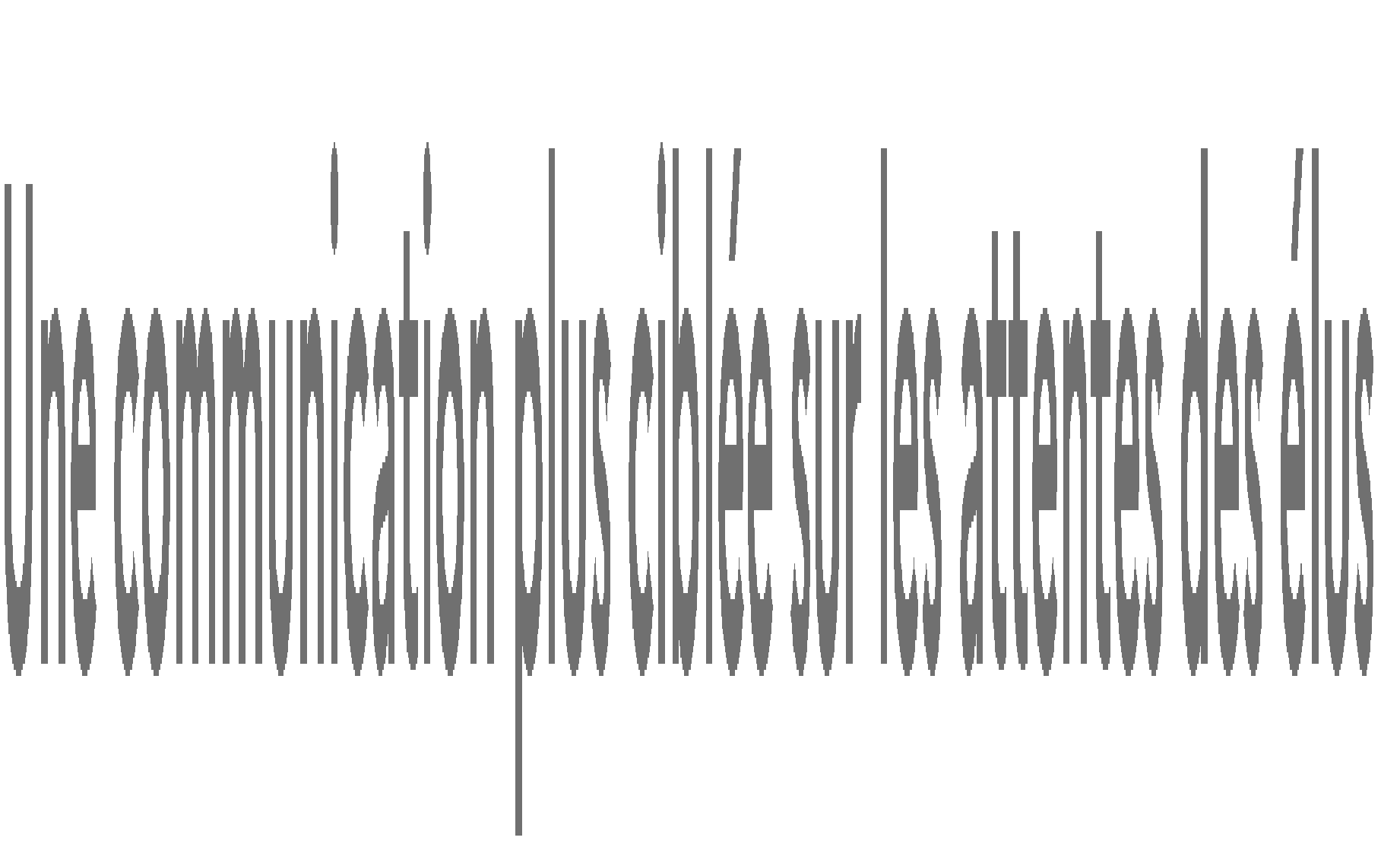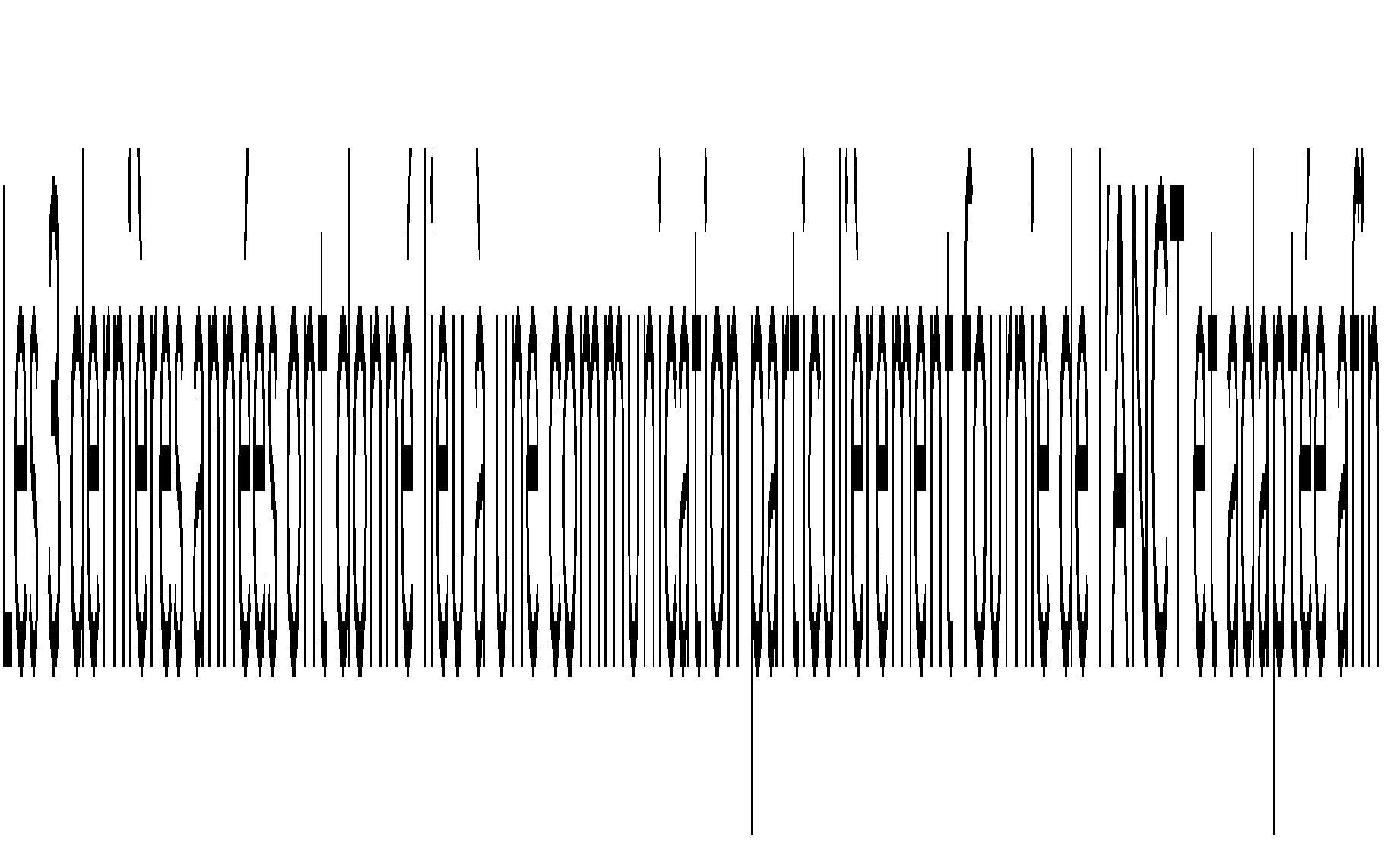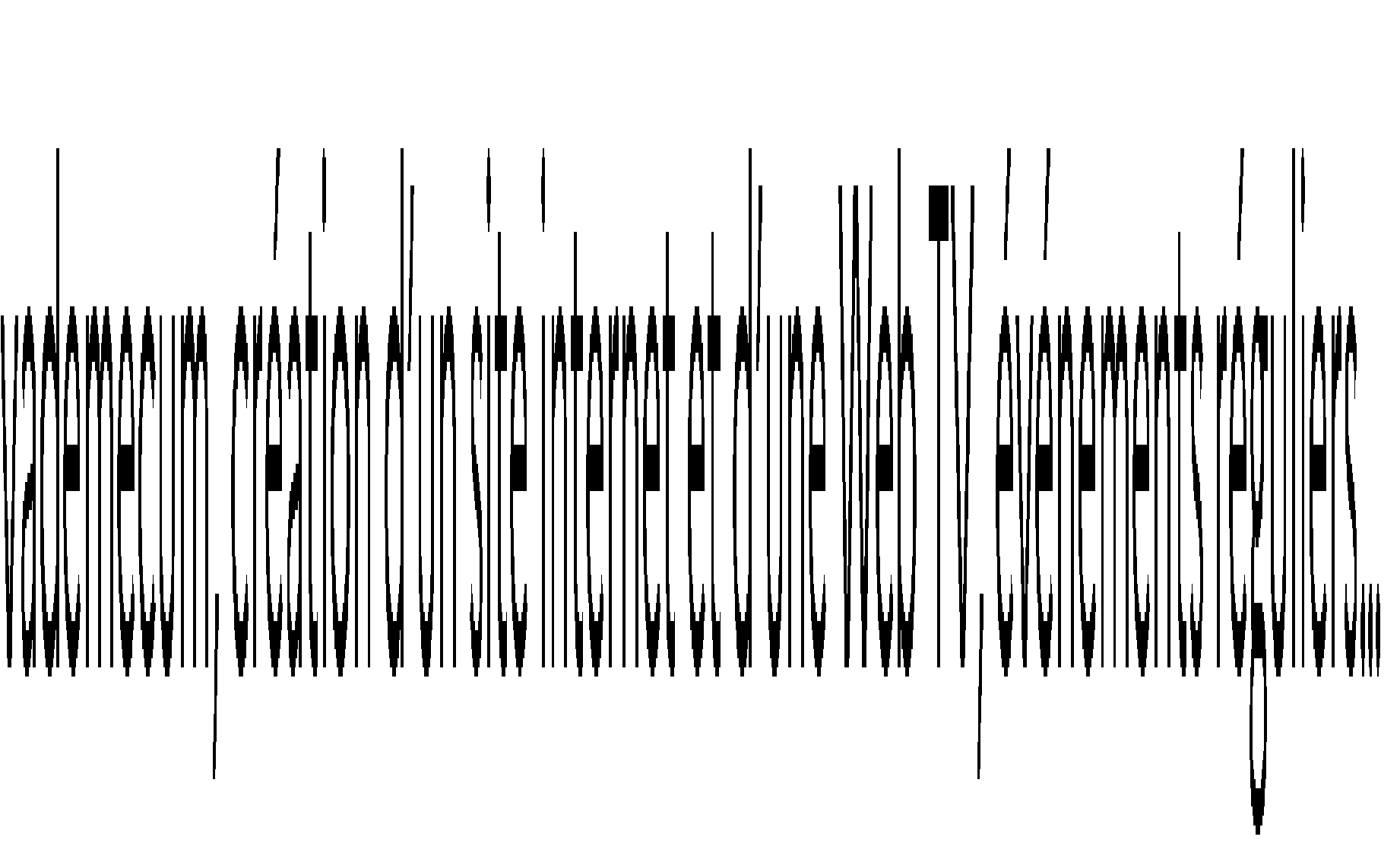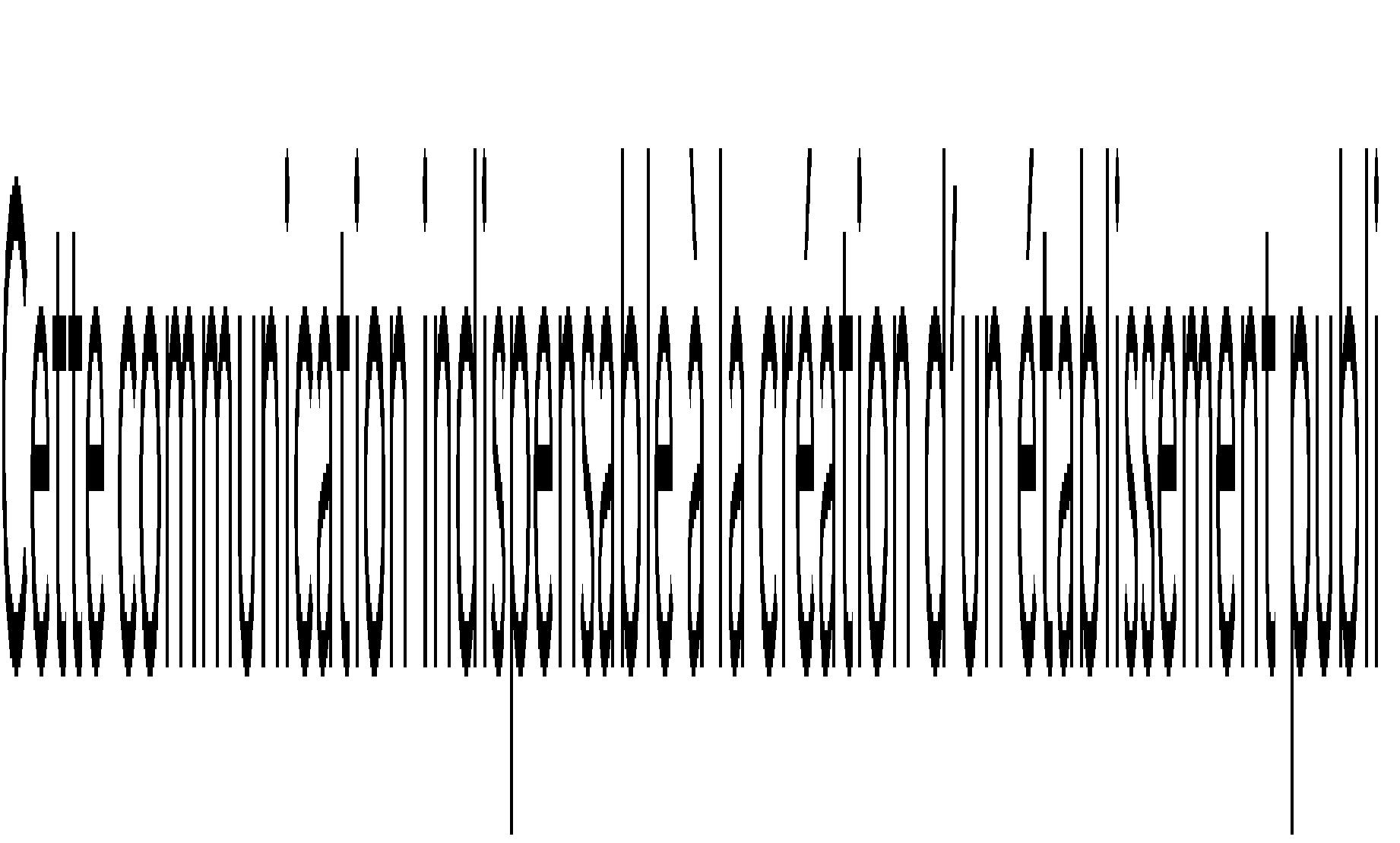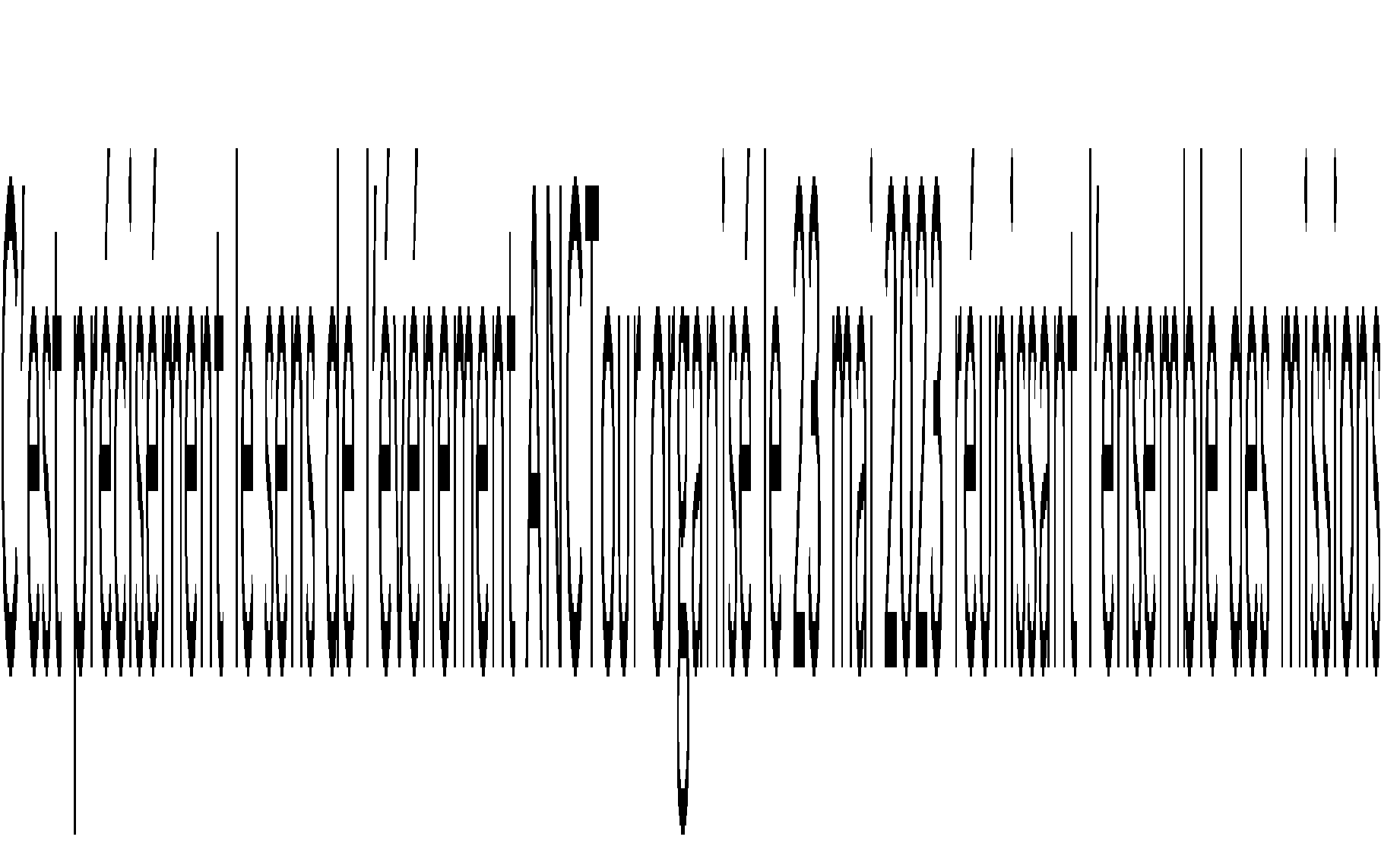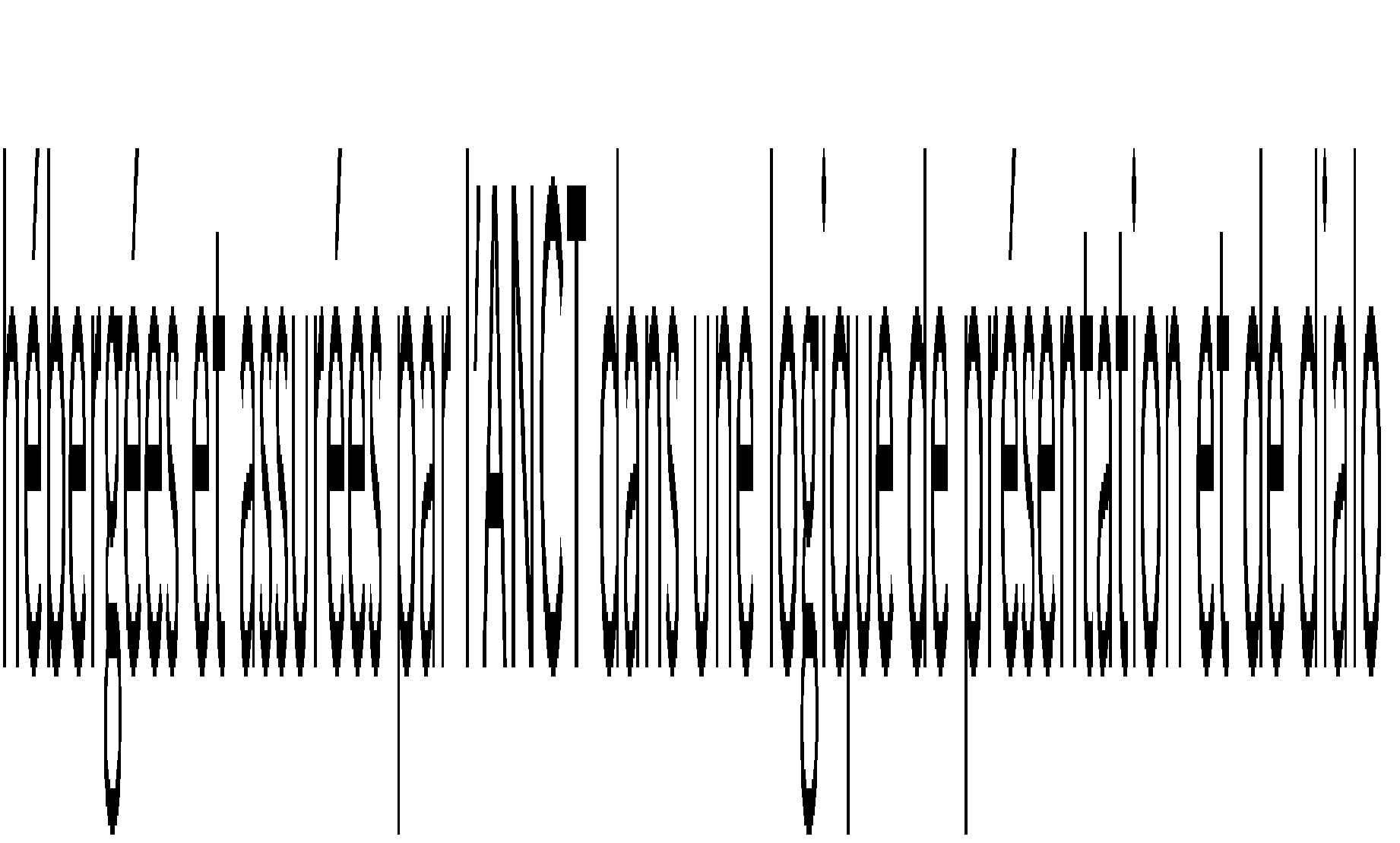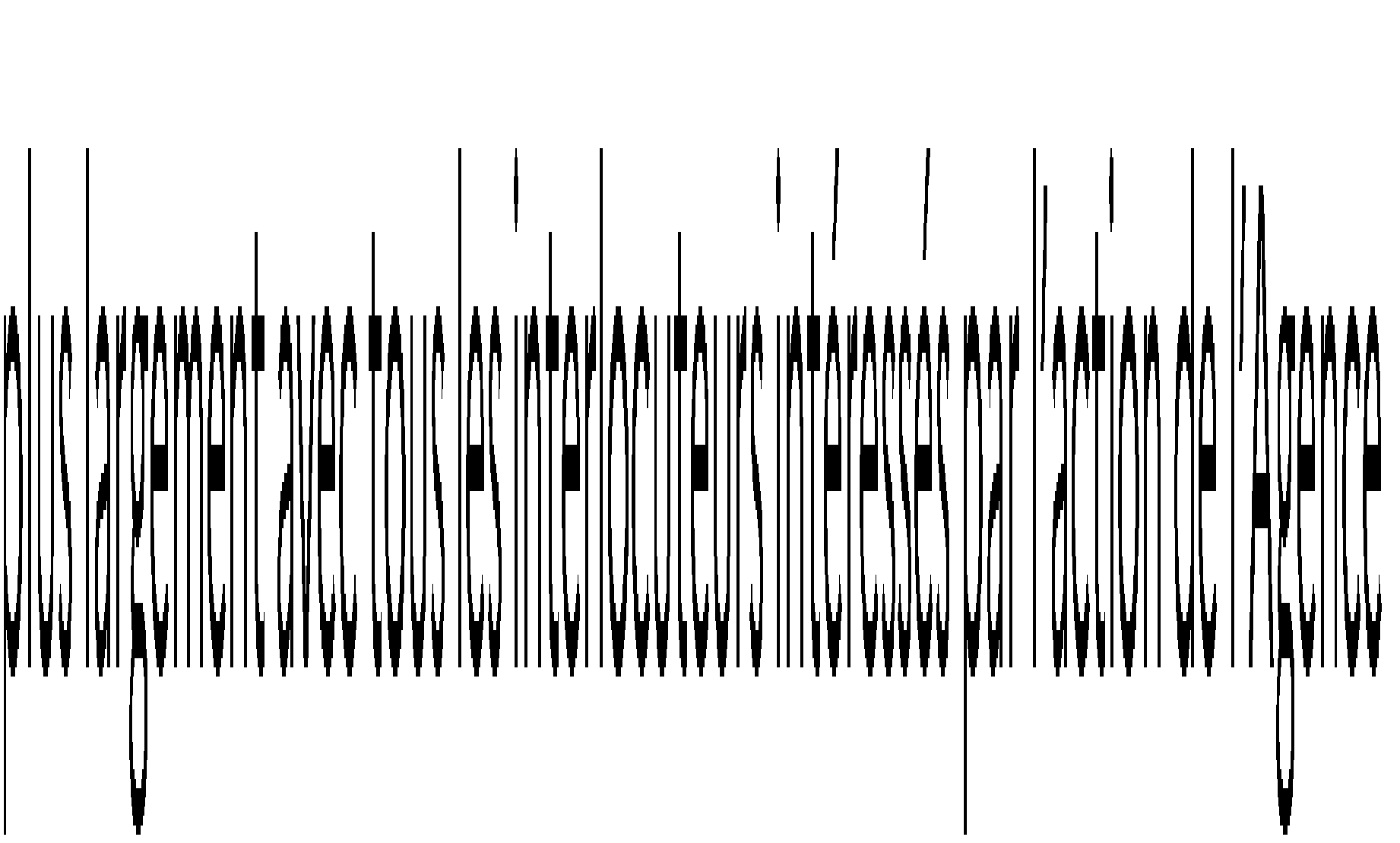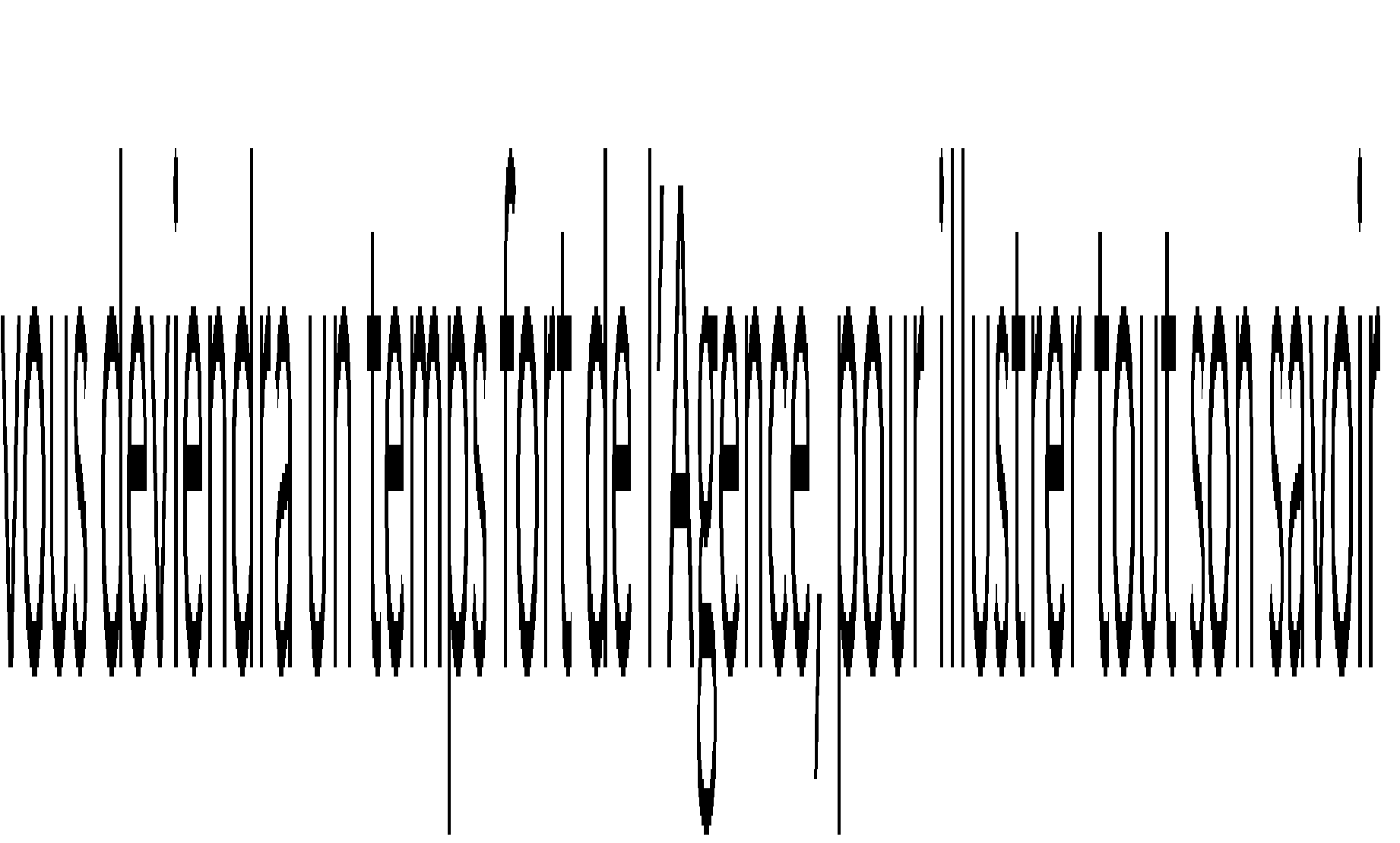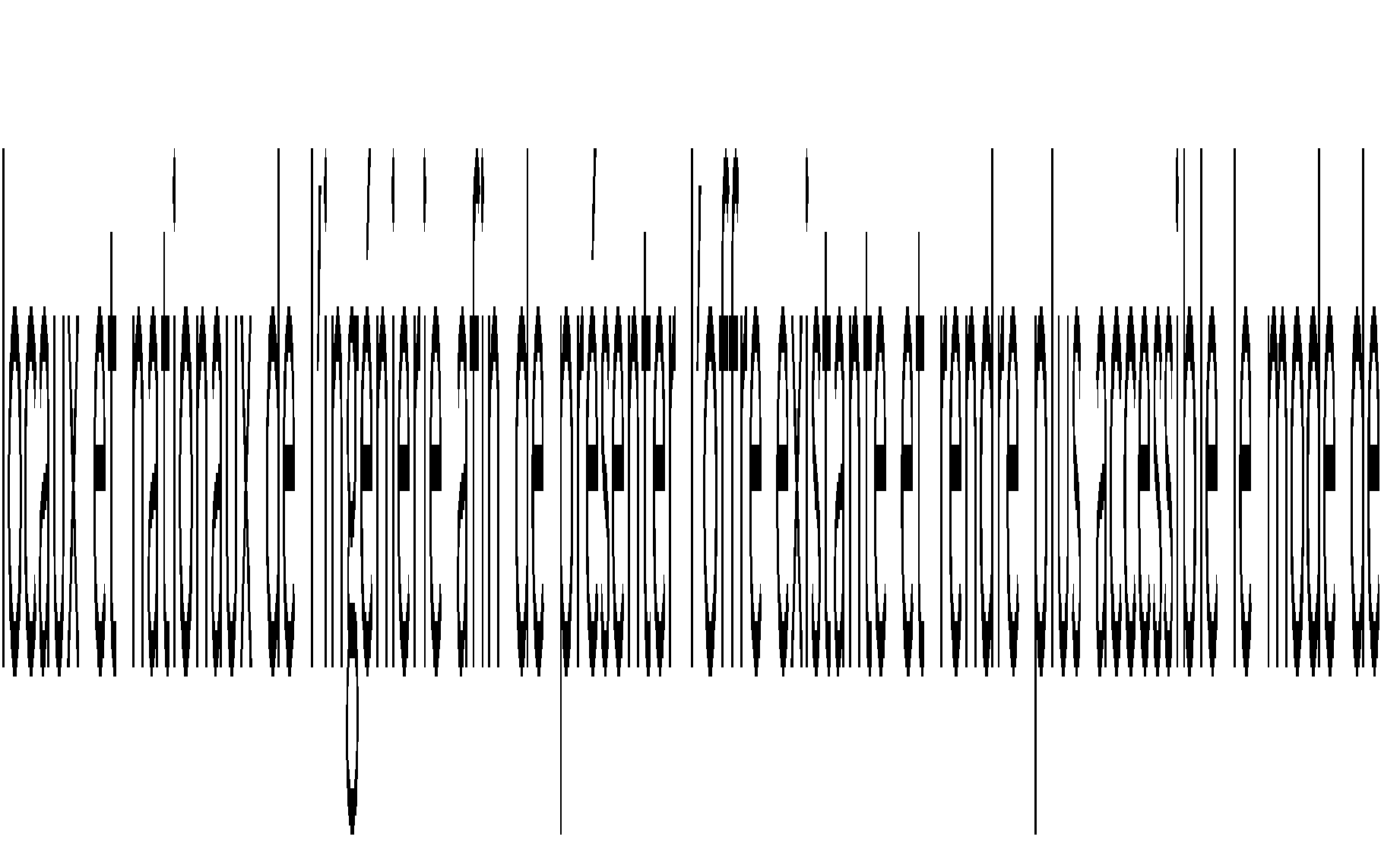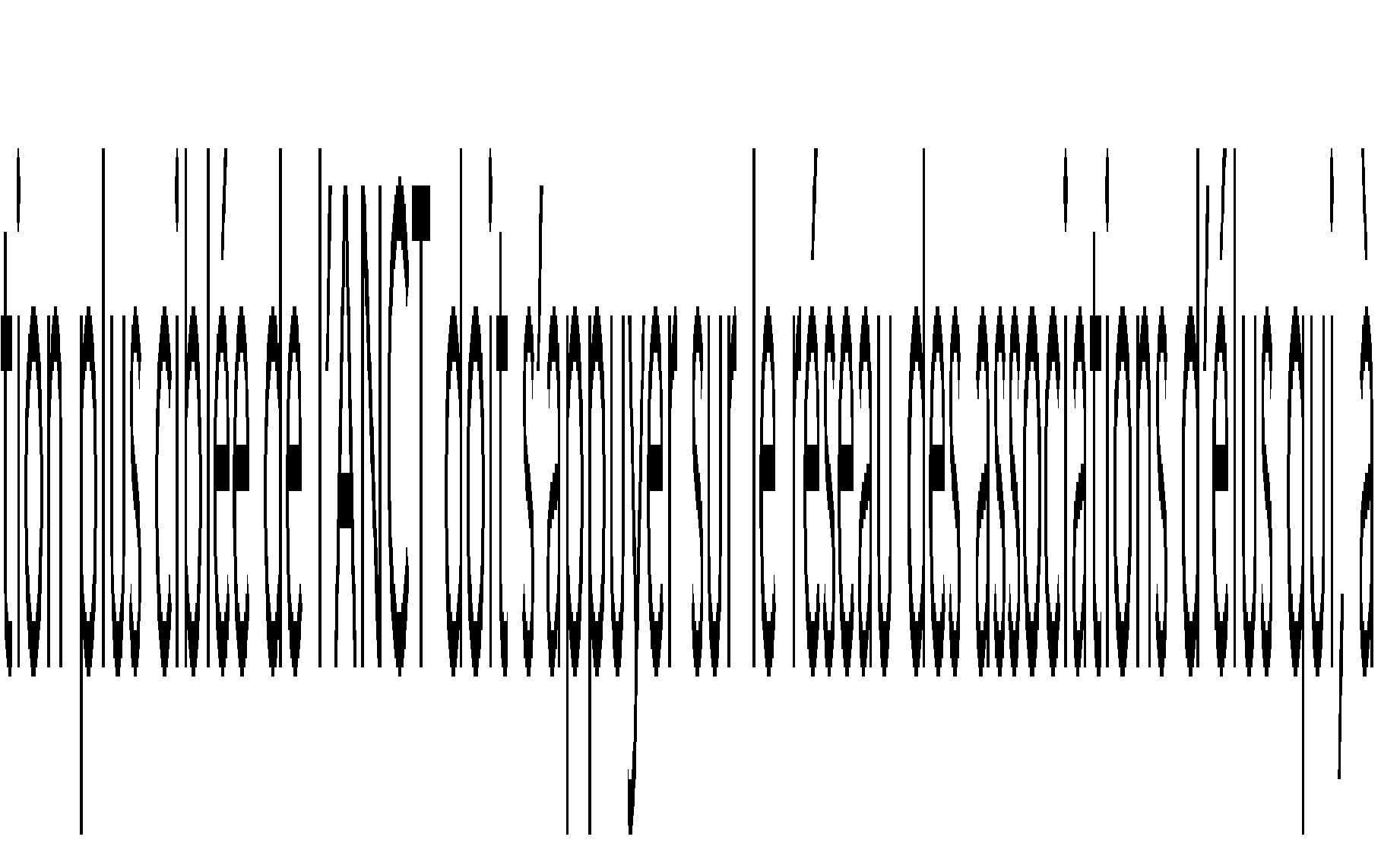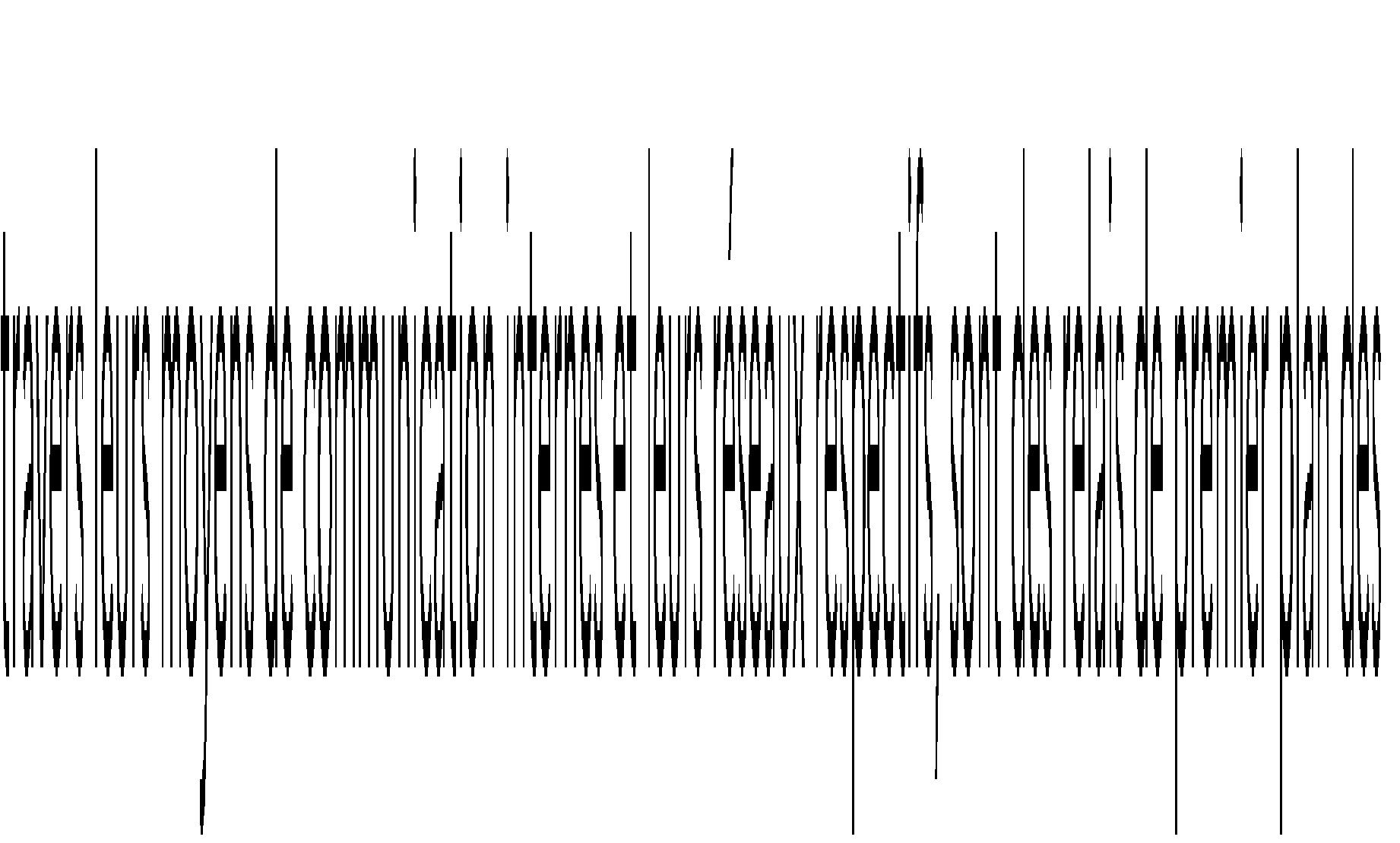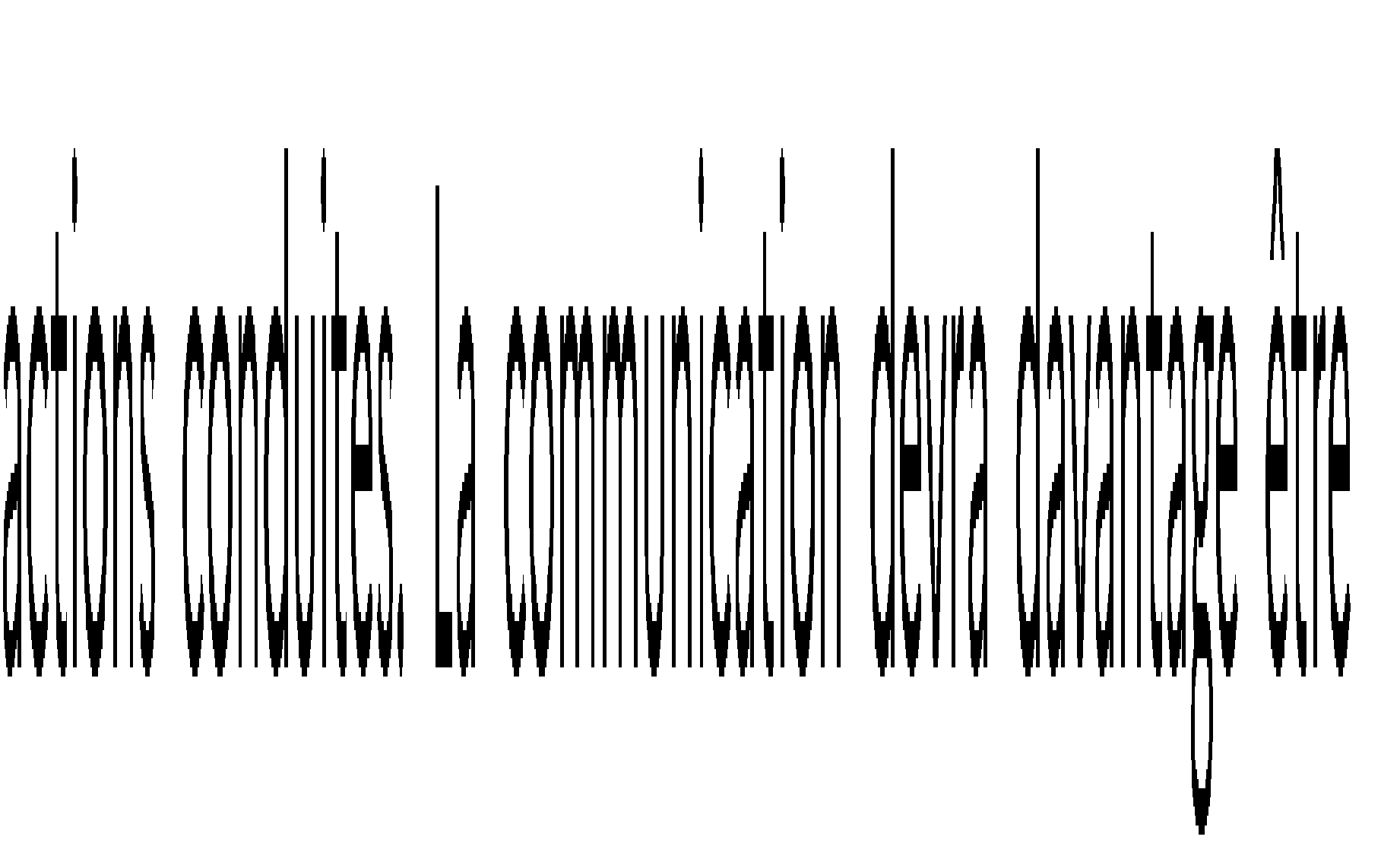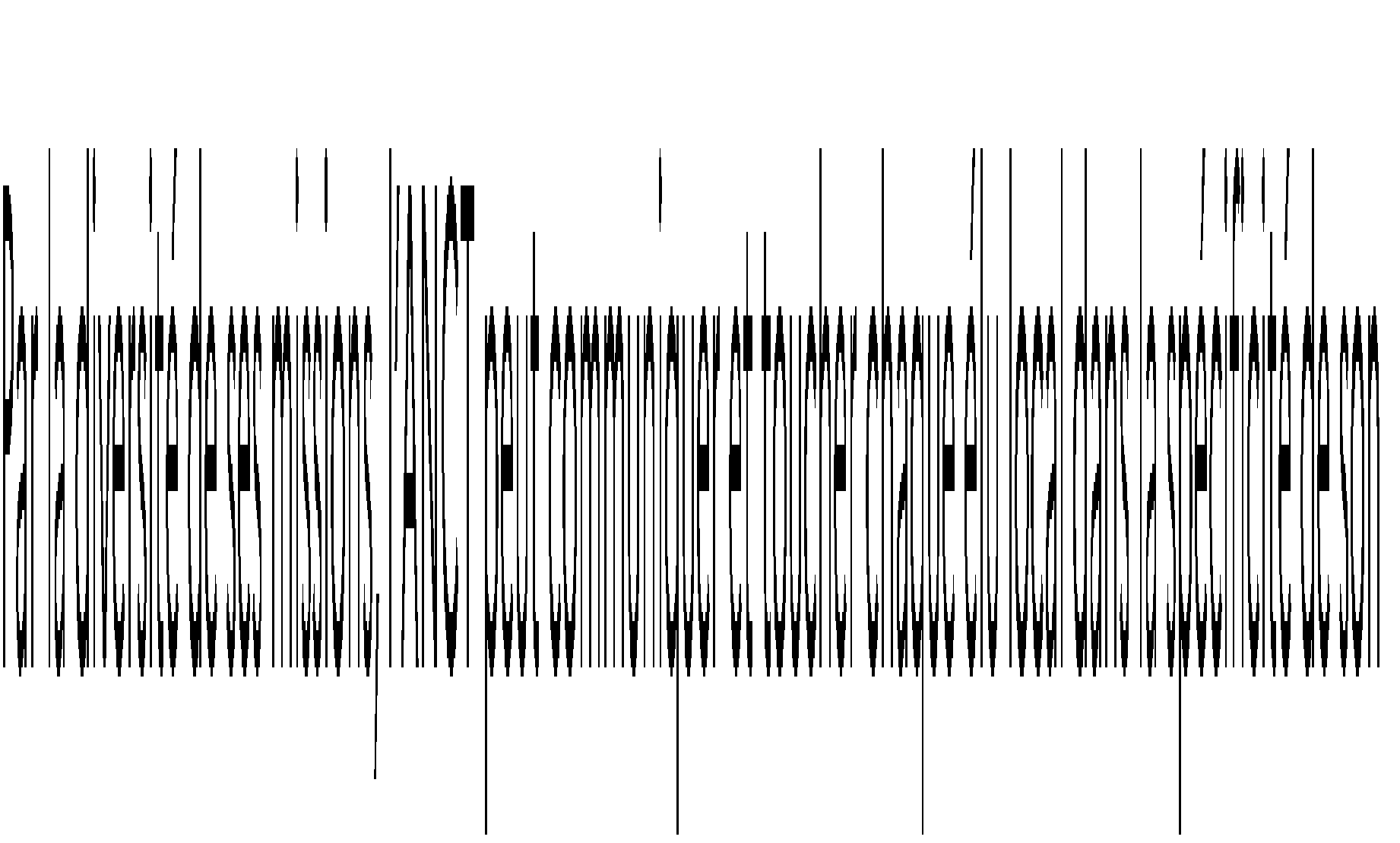- SYNTHÈSE
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- AVANT-PROPOS
- I- I. MALGRÉ DES EFFORTS, L'ANCT RESTE
DIFFICILEMENT ACCESSIBLE AUX ÉLUS DES PETITES COMMUNES
- A. UNE VOLONTÉ DE L'AGENCE D'ÊTRE PLUS
PROCHE DU TERRAIN ET D'ALLER AU CONTACT DES ÉLUS LOCAUX
- B. UNE CIRCULAIRE POUR REMOBILISER LES
PRÉFETS EN TANT QUE DÉLÉGUÉS TERRITORIAUX
- C. SYNTHÈSE DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU
RAPPORT DU SÉNAT
- A. UNE VOLONTÉ DE L'AGENCE D'ÊTRE PLUS
PROCHE DU TERRAIN ET D'ALLER AU CONTACT DES ÉLUS LOCAUX
- II. L'AGENCE A AMÉLIORÉ SON OFFRE
D'INGÉNIERIE MAIS CONTRIBUE TRÈS PEU À RENFORCER LES
ACTEURS DE L'INGÉNIERIE LOCALE
- A. L'AGENCE A RENFORCÉ SON OFFRE
D'INGÉNIERIE AFIN QU'IL N'Y AIT PAS DE PROJET ORPHELIN
- 1. La recherche d'une meilleure cohérence
dans l'action publique
- a) La recherche d'une meilleure coordination entre
opérateurs de l'État
- b) Le pouvoir de proposition et d'adaptation des
préfets dans la mise en oeuvre des programmes nationaux
- c) La deuxième génération des
CRTE conforte leur dimension multithématique
- d) L'articulation de l'action de l'Agence avec le
niveau régional encore délicate
- a) La recherche d'une meilleure coordination entre
opérateurs de l'État
- 2. Des moyens confortés et
préservés des coupes budgétaires avant
la dissolution de l'Assemblée nationale
- a) Un doublement des crédits
d'ingénierie en 2024 qui offre des droits de tirage plus
élevés sur le marché, assorti d'une déconcentration
partielle de ces crédits
- b) Le financement et cofinancement de postes
d'ingénierie
- c) Avant la dissolution de l'Assemblée
nationale, des moyens préservés des coupes budgétaires
- a) Un doublement des crédits
d'ingénierie en 2024 qui offre des droits de tirage plus
élevés sur le marché, assorti d'une déconcentration
partielle de ces crédits
- 3. Un appel à animer les acteurs de
l'ingénierie locale
- 1. La recherche d'une meilleure cohérence
dans l'action publique
- B. L'AGENCE CONTRIBUE TRÈS PEU À
RENFORCER LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE LOCALE
- C. SYNTHÈSE DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU
RAPPORT DU SÉNAT
- A. L'AGENCE A RENFORCÉ SON OFFRE
D'INGÉNIERIE AFIN QU'IL N'Y AIT PAS DE PROJET ORPHELIN
- I- I. MALGRÉ DES EFFORTS, L'ANCT RESTE
DIFFICILEMENT ACCESSIBLE AUX ÉLUS DES PETITES COMMUNES
- EXAMEN EN DÉLÉGATION
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
REÇUES
- ANNEXE 1 : RAPPEL DES 14 RECOMMANDATIONS DU
RAPPORT
POUR LESQUELLES UN SUIVI EST RÉALISÉ
- ANNEXE 2 : FEUILLES DE ROUTE DE
L'ANCT
- ANNEXE 3 : DISPOSITIFS D'ÉVALUATION
DES PROGRAMMES DE L'ANCT
N° 126
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 novembre 2024
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation (1) relatif au suivi du rapport du Sénat de 2023 sur l'ANCT,
Par Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ et Céline BRULIN,
Sénatrices
(1) Cette délégation est composée de : M. Bernard Delcros, président ; M. Rémy Pointereau, premier vice-président ; M. Fabien Genet, Mme Pascale Gruny, M. Cédric Vial, Mme Corinne Féret, MM. Éric Kerrouche, Didier Rambaud, Pierre Jean Rochette, Gérard Lahellec, Grégory Blanc, Mme Guylène Pantel, vice-présidents ; MM. Laurent Burgoa, Jean Pierre Vogel, Hervé Gillé, Mme Sonia de La Provôté, secrétaires ; M. Jean-Claude Anglars, Mmes Nadine Bellurot, Catherine Belrhiti, MM. François Bonhomme, Max Brisson, Mme Céline Brulin, MM. Bernard Buis, Cédric Chevalier, Thierry Cozic, Mme Catherine Di Folco, MM. Jérôme Durain, Daniel Gueret, Joshua Hochart, Patrice Joly, Mmes Muriel Jourda, Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-Jacques Lozach, Pascal Martin, Jean-Marie Mizzon, Franck Montaugé, Mme Sylviane Noël, M. Olivier Paccaud, Mme Anne-Sophie Patru, MM. Hervé Reynaud, Jean-Yves Roux, Mmes Patricia Schillinger, Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Lucien Stanzione, Jean-Marie Vanlerenberghe.
SYNTHÈSE
ANCT : 18 mois après le rapport du
Sénat, poursuite d'un dialogue exigeant
Le 2 février 2023, la délégation aux collectivités territoriales adoptait à l'unanimité le rapport « ANCT : se mettre au diapason des élus locaux ! »1 de Charles GUENÉ, ancien Sénateur de la Haute-Marne (Les Républicains) et Céline BRULIN. Ce rapport dressait un premier bilan de l'action de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) du point de vue des élus locaux, trois ans après sa mise en place. Le rapport avançait 14 recommandations pour renforcer la proximité de l'Agence avec les élus locaux et améliorer l'efficacité de son action.
Environ un an et demi plus tard, la délégation a souhaité faire le point sur la mise en oeuvre des recommandations formulées dans le rapport de février 2023.
Rapport d'information N°126 de Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ, Sénatrice du Calvados (Union Centriste) et Céline BRULIN, Sénatrice de Seine-Maritime (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky) fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation et adopté à l'unanimité le 7 novembre 2024.
I. L'ANCT RESTE DIFFICILEMENT ACCESSIBLE, NOTAMMENT AUX ÉLUS DES PETITES COMMUNES, MALGRÉ DES EFFORTS POUR RÉDUIRE SON DÉFICIT DE NOTORIÉTÉ
Le rapport de 2023 avait mis en évidence que, si l'Agence était bien identifiée et appréciée par ses bénéficiaires, elle restait inconnue pour la plupart des élus locaux.
Ce déficit de notoriété,
confirmé par les auditions et déplacements
effectués, ainsi que par les associations d'élus entendues, ne
permettait pas à l'Agence d'être
identifiée par les interlocuteurs concernés. Son
image semblait floue et générait une impression
d'éloignement du
terrain. Ces éléments contribuaient
à rendre plus difficile la compréhension, par des élus
locaux, de son fonctionnement et de son offre de services.
Le rapport avait également pointé l'investissement à géométrie variable des préfets, pourtant délégués territoriaux de l'Agence. Certains acteurs locaux interrogés avaient regretté un réel déficit d'incarnation de l'ANCT par certains préfets et/ou certains services déconcentrés.
Dix-huit mois plus tard, si des progrès ont été constatés en matière de rapprochement de l'Agence avec les élus locaux (A) ainsi que de remobilisation des préfets (B), l'offre de l'Agence bénéficie toujours à un nombre réduit de collectivités et peine à atteindre les élus des communes de petite taille (C).
A) UNE VOLONTÉ DE L'AGENCE D'ÊTRE PLUS PROCHE DU TERRAIN ET D'ALLER AU CONTACT DES ÉLUS LOCAUX
« Depuis
un an, nous avons multiplié les leviers pour favoriser la
proximité » déclarait
Stanislas BOURRON lors
de son audition au Sénat1(*) le 30 avril 2024.
L'Agence a adopté en conseil d'administration, le 29 juin 2023, sa nouvelle feuille de route. Tant sur sa forme que sur ses objectifs stratégiques, cette feuille de route fait écho aux recommandations du rapport de 2023.
Conformément aux souhaits exprimés par la Délégation, l'Agence a également pris plusieurs initiatives pour se rapprocher des élus locaux : organisation de « l'ANCTour » au Palais des Congrès de Paris (2023) et en Occitanie (2024), plus de 60 déplacements du président ou du directeur général réalisés dans les territoires avant l'été 2024, une présence systématique aux congrès des associations nationales d'élus et à certains congrès départementaux ainsi que l'organisation de nombreux forums locaux d'ingénierie (74 à ce jour).
Le rapport de 2023 préconisait à l'Agence
de « privilégier une communication plus simple et
déconcentrée, reposant sur le retour d'expérience des
élus locaux et de leurs associations d'élus ».
L'Agence a déclaré lors de son audition au Sénat2(*) avoir « opéré une refonte
complète de ses outils de communication, afin de rendre l'offre de
l'Agence
plus simple et plus synthétique ».
Elle a diffusé un kit de communication aux
préfets, suivi d'un webinaire de
présentation de l'Agence et de rappel de ses missions et
dispositifs. Elle diffuse régulièrement, depuis janvier 2024,
une « newsletter
ANCTerritorial » à tous les
délégués territoriaux et leurs adjoints afin de faciliter
la circulation des informations. L'ANCT est également engagée
à faire évoluer, d'ici début 2025,
son site Internet en un portail de services centré sur les
besoins des utilisateurs. À la suite des échanges avec
les rapporteures, l'Agence a pris l'engagement de préparer une
courte brochure pour des élus qui n'auraient aucune
connaissance de l'ANCT. Elle sera disponible pour le Congrès des maires
de novembre 2024.
B) UNE CIRCULAIRE POUR REMOBILISER LES PRÉFETS EN TANT QUE
DÉLÉGUÉS TERRITORIAUX
La Délégation avait mis en évidence le déficit de communication de l'Agence auprès de ses délégués territoriaux (préfets) et recommandait qu'une instruction actualisée leur soit adressée par voie de circulaire.
Conformément à cette recommandation, une circulaire interministérielle, signée par le ministre de la Transition écologique et la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, a été adressée aux préfets le 28 décembre 2023.
Cette instruction remobilise les préfets sur quatre objectifs précis :
- mettre en place, dans chaque département, un outil d'animation de l'ingénierie locale existante (un comité local de cohésion territoriale (CLCT) ou une autre formule) ;
- finaliser la cartographie de l'ingénierie départementale d'ici au 1er mars 2024 ;
- mettre en place un guichet local de
l'ingénierie, point d'entrée unique
des demandes, avec une
adresse mail du type
ingenierie@departementale.gouv.fr ;
- organiser chaque année un forum local de l'ingénierie.
Afin d'accompagner cette montée en puissance, et toujours conformément à une recommandation du rapport de 2023, l'Agence a doublé le nombre de chargés de mission territoriaux (Cmt). Ces agents sont le point d'entrée de l'ANCT et font interface avec les délégués territoriaux et leurs adjoints.
Les rapporteures se félicitent de la mise en place de cette instruction aux préfets. Cependant, elles restent attentives au rythme de sa mise en oeuvre. L'inventaire de l'ingénierie est un exercice prioritaire qui était l'une des missions premières de l'Agence à sa création. Il n'est pas normal que cette tâche ne soit pas encore achevée dans tous les départements.
De même, plusieurs Sénateurs constatent que, même s'ils restent une minorité, certains préfets ne se sont toujours pas approprié leur rôle de délégué territorial, n'ont pas communiqué d'information particulière sur l'Agence voire n'ont pas réellement mis en place d'instance de dialogue avec l'ingénierie locale.
Les rapporteures recommandent que, de manière relativement régulière, des instructions actualisées puissent rappeler aux délégués territoriaux ce qui est attendu d'eux ainsi que le bilan global de ce qui a été réalisé.
C) L'OFFRE DE L'AGENCE BÉNÉFICIE À UN NOMBRE
RÉDUIT DE
COLLECTIVITÉS
ET
PEINE À ATTEINDRE LES ÉLUS DES COMMUNES DE PETITE TAILLE
Les collectivités bénéficiant des programmes de l'ANCT sont globalement satisfaites ou très satisfaites.
Cependant, les dispositifs de l'Agence se
concentrent sur un nombre réduit de collectivités.
À
titre d'exemple, le programme Action coeur de ville (ACV)
concerne 244 villes moyennes, le programme Petites villes de demain
(PVD) concerne 1 644 territoires regroupant des communes
de moins de
20 000 habitants, et 2 458 communes sont labélisées
villages d'avenir (VA). Il en
est de même avec les
prestations d'ingénierie sur mesure.
« Depuis 2020, 1 700 collectivités ont
été accompagnées, dont plus de 54% sont des villes de
moins de 3 500 habitants »3(*). L'ensemble de ces chiffres, ramené aux
34 935 communes et 1 254 établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) recensés par la direction
générale des collectivités locales (DGCL), souligne que
le nombre de collectivités soutenues reste modeste,
en rapport avec le budget de l'Agence qui représente environ 200
millions d'euros.
En adoptant une analyse plus fine, il convient de
constater que les grandes villes et
villes moyennes sont plutôt bien couvertes par les
programmes de l'Agence
alors que, pour les communes rurales, l'écart
est manifeste : seulement
2 500 villages d'avenir pour
30 000 communes rurales au sens de l'Insee4(*).
L'offre de l'Agence peine à atteindre les élus des communes de petite taille. À ce sujet, les rapporteures rappellent le rôle essentiel de relai des associations locales de maires et le rôle de relai que peuvent avoir les parlementaires.
Les rapporteures soulignent cette limite de l'action de l'État : la politique d'aménagement du territoire se fait par « saupoudrage » et par « petites touches impressionnistes ». Le rapport avance quelques pistes pour passer de réussites localisées sur quelques territoires à une politique d'aménagement du territoire plus globale : le parrainage de collectivités avancées, l'extension des ressources au sein du site solutions d'élus, une meilleure capitalisation des projets via l'observatoire des territoires de l'ANCT, etc.
Les rapporteures plaident pour une pause dans le développement des missions de l'Agence pour lui laisser le temps de s'adapter et de conforter ses missions actuelles. Elles souscrivent à l'avis formulé par Bernard DELCROS, président de la délégation aux collectivités territoriales et Sénateur du Cantal dans le rapport intitulé « L'ANCT, une agence à consolider au service des territoires » déposé le 14 février 2024, qui insistait sur la nécessité de renforcer la transversalité de l'Agence en facilitant son action interministérielle. C'est l'un des leviers qui permettrait de mener une politique d'aménagement du territoire dans une visée globale, cohérente et transversale, bien au-delà des seules compétences de l'ANCT.
II. L'AGENCE A AMÉLIORÉ SON OFFRE D'INGÉNIERIE MAIS CONTRIBUE TRÈS PEU À RENFORCER LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE LOCALE
Le rapport de 2023 avait mis en évidence qu'en
matière d'ingénierie,
les interventions de l'Agence
suscitaient critiques et questionnements.
Il avait souligné le caractère parfois confus des interventions des différentes agences de l'État en matière d'ingénierie (doublon voire concurrence). La mise en place des Contrats de Relance et de Transition Écologique (CRTE) avait également été considérée par les élus locaux comme une occasion manquée de simplification et de renouvellement des financements. Le rapport avait souligné leur base étriquée.
L'intervention de l'Agence en matière d'ingénierie était parfois accusée de générer des effets contreproductifs lorsqu'elle se déroule en décalage avec les équilibres locaux ou en substitution de leurs acteurs. L'annonce de prestations d'ingénierie gratuites a, par exemple, entrainé une forte confusion chez les élus locaux et une forme de pénalisation des écosystèmes organisés. Le recours à une majorité de bureaux de consultants privés est parfois adapté mais il ne contribue pas à renforcer l'écosystème local.
Dix-huit mois plus tard, si l'évolution des CRTE
va dans le sens préconisé par la Délégation (A), la
mise en cohérence de l'action des opérateurs de l'État
reste perfectible (B). Les rapporteures souhaitent souligner deux points de
vigilance très forts : la pérennisation des crédits
de l'Agence face au contexte budgétaire contraint (C) et la
déclinaison pratique du guichet unique local
d'ingénierie (D).
A) LA RECHERCHE D'UNE MEILLEURE COHÉRENCE DANS L'ACTION DES OPÉRATEURS PUBLICS RESTE PARTIELLE
Depuis le rapport de 2023, l'ANCT a avancé sur plusieurs points. En 2023, l'Agence a entièrement renouvelé ses conventions quadriennales avec ses partenaires5(*) avec des engagements réciproques plus clairs. Les partenaires de l'Agence ont tous accepté de passer par le guichet départemental tenu par les préfets.
L'Agence a également produit un « qui fait quoi ? », sur l'ingénierie des six grands opérateurs de l'État à travers une brochure. Celle-ci présente des limites en termes de lisibilité mais elle est complétée par un tableau plus exhaustif permettant aux services de l'État d'orienter les demandes.
La lecture de ce « qui fait
quoi ? » illustre tout de même la dispersion
des compétences entre les opérateurs d'État. Sur
les 80 cases du « qui fait quoi ? », 65 cases
renseignent qu'un, deux, trois, quatre et jusqu'à cinq opérateurs
sont compétents sur un même sujet. Il est possible d'y lire un
signe inquiétant de dispersion de compétences, voire de doublons
et peut être même de concurrence.
B) LA DEUXIÈME GÉNÉRATION
DES CRTE CONFORTE LEUR DIMENSION MULTITHÉMATIQUE
Le rapport de 2023 recommandait de conforter les CRTE comme cadre de référence du dialogue avec l'État, ce qui impliquait de les ouvrir à tous les thèmes.
Cette recommandation a été suivie d'effets puisqu'en complément de la circulaire du 29 septembre 2023 relative à la mise en oeuvre de la territorialisation de la planification écologique, une nouvelle instruction pour la relance des CRTE a été signée le 30 avril 20246(*) par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité. Cette circulaire confirme la dimension transversale des CRTE en intégrant les thèmes de la cohésion sociale.
C) LES MOYENS DE L'AGENCE PRÉSERVÉS DES COUPES BUDGÉTAIRES AVANT LA DISSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les crédits d'ingénierie de l'ANCT ont été doublés par la loi de finances pour 2024, de sorte que l'Agence bénéficie désormais d'une enveloppe d'environ 40 millions d'euros pour tous ses dispositifs d'ingénierie.
Avant la dissolution, l'Agence affirmait n'avoir subi aucune annulation de crédits.
Les rapporteures seront attentives à la
loi de règlement du budget 2024 et surtout aux
futures mesures d'économie au programme de la loi de finances
pour 2025. Elles déplorent déjà la diminution
annoncée du « Fonds Vert » qui
permet de financer l'ingénierie.
D) L'AGENCE CONTRIBUE TRÈS PEU À RENFORCER LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE LOCALE
Si le soutien à la structuration de l'ingénierie locale était moins coûteux, plus pérenne et plus apprécié que le recours à des consultants privés, les montages permettant le soutien direct à des structures locales sont encore trop rares. Les rapporteures estiment toujours souhaitable de partager et de diffuser ce type de solutions.
Le rapport de 2023 mettait en évidence
qu'accéder au marché d'ingénierie nationale de l'ANCT
reste difficile pour les petites structures, sauf à se
constituer en groupements. Sur le marché d'ingénierie de l'ANCT
(période 2020 - 2024), les prestataires sont souvent des cabinets d'une
certaine envergure (chiffre d'affaires, nombre d'employés...). Par
ailleurs, 21 des prestataires retenus par l'ANCT ont leur siège social
en
Île-de-France alors que 20 seulement ont leur siège social
dans les autres régions. Il conviendra de vérifier quelles seront
les caractéristiques des prestataires retenus dans le nouveau
marché
(2025-2029).
E) LE GUICHET UNIQUE À LA MAIN DU PRÉFET DEVRA ABSOLUMENT FONCTIONNER PAR SUBSIDIARITÉ POUR NE PAS DÉSORGANISER LES CIRCUITS QUI FONCTIONNENT DÉJÀ
La circulaire interministérielle du 28 décembre 2023 demande notamment aux préfets de mettre en place un guichet unique local d'ingénierie.
Les rapporteures s'interrogent sur la pertinence de cette mesure dans les départements où les circuits fonctionnent. Centraliser les demandes et donner aux services de l'État le rôle d'« aiguilleurs » ne semble pas forcément une solution optimale et risque même de perturber des fonctionnements établis.
Ce guichet doit absolument fonctionner par subsidiarité et non dans une logique de centralisation.
Il existe un véritable risque, renforcé dans un contexte financier qui se tend et un marché de l'ingénierie qui va se contracter, que ce guichet unique soit en réalité un aiguillage qui permette de diriger essentiellement, voire exclusivement, les demandes en matière d'ingénierie vers les agences de l'État (Cerema, ADEME) ou les organismes retenus dans le cadre des marchés publics de l'ANCT au détriment des acteurs de l'ingénierie locale.
D'autre part, il est légitime de se demander quelle place tiendront les collectivités et les élus locaux dans cette animation alors qu'ils ne sont même pas cités dans la circulaire. Or, ces derniers sont souvent très impliqués dans l'ingénierie territoriale, comme par exemple au sein des agences techniques départementales : il serait contreproductif de ne pas en tenir compte.
Par la formulation de ces points de vigilance, les rapporteures resteront attentives à la mise en oeuvre des mesures recommandées dans les mois à venir.
Synthèse du suivi sur les quatorze recommandations du rapport de 2023
Sept recommandations ont plutôt bien été intégrées par l'ANCT ou la DGCL et suivies d'actions significatives :
- échanger avec les élus locaux et retravailler la feuille de route stratégique (recommandation n°1) ;
- remobiliser les préfets sur leur rôle de délégué territorial (recommandation n°2) ;
- doubler le nombre de chargés de mission territoriaux de l'ANCT (recommandation n°3) ;
- doter le préfet de moyens en matière d'ingénierie (recommandation n°9) ;
- créer une interface numérique
pédagogique sur le « qui fait quoi »
(recommandation n°11) ;
- conforter et élargir l'outil CRTE à la dimension sociale (recommandation n°12) ;
- développer évaluation externe et mesure
de satisfaction des bénéficiaires (recommandation n°14).
Deux recommandations ont trait à des mesures ou actions en cours :
- refondre la communication (recommandation n°5) ;
- recenser les acteurs de l'ingénierie
départementale (recommandation n°7).
Trois recommandations donnent lieu à une mise en oeuvre insatisfaisante ou au mieux contrastée :
- mettre en oeuvre des CLCT là où cela est nécessaire (recommandation n°8) ;
- améliorer le lien entre les actions de l'Agence
et celles des régions
(recommandation n°4) ;
- identifier et valoriser les dynamiques de
coopération entre territoires
(recommandation n°13).
Deux recommandations ne sont pas suivies d'effet, car non retenues par l'ANCT ou la DGCL :
- étudier la proposition « 1%o ingénierie » (recommandation n°6) ;
- instituer un comité de direction régulier entre ANCT, ADEME et Cerema (recommandation n°10).
LISTE DES RECOMMANDATIONS
|
N° |
Recommandations |
Support / action |
Suivi |
|
1 |
Échanger en direct avec les élus locaux sur le bilan et les perspectives de l'Agence, pour nourrir le débat national État / territoires et élaborer une feuille de route stratégique 2023 -2026 de l'ANCT. |
Échanges en direct avec les élus locaux : Instruction ministérielle demandant l'organisation de rencontres organisées par les préfectures, avec la présence de représentants locaux et nationaux de l'Agence, ouverte aux élus locaux (exécutifs) * Feuille de route 2023-2026 |
Recommandation mise en oeuvre de façon satisfaisante : refonte de la feuille de route, nombreux échanges en direct avec les élus locaux ... |
|
N° |
Recommandations |
Support / action |
Support / action |
|
2 |
Remobiliser les préfets sur leur rôle de délégué territorial (formation, évaluation, instructions du ministère de la Cohésion des Territoires). Positionner le sous-préfet
d'arrondissement comme interlocuteur de 1er niveau sur les questions
|
Instruction interministérielle : - mobilisation des - désignation d'un - modalités de formation, évaluation, animation, du corps préfectoral. |
Recommandation mise en oeuvre de façon satisfaisante : circulaire aux préfets, participation de l'ANCT aux séminaires de la DMATES avec le corps électoral, etc. |
|
3 |
Doubler le nombre de chargés de mission territoriaux de l'ANCT. |
Préparation budgétaire ou redéploiements. |
Recommandation mise en oeuvre de façon satisfaisante avec l'équivalent de 4 ETP ouverts et pourvus. |
|
4 |
Engager un dialogue pour intégrer les Conseils Régionaux dans le fonctionnement de l'Agence. |
Dialogue à mener à l'initiative de la DGCL. |
Recommandation insuffisamment mise en oeuvre. |
|
5 |
Privilégier une communication plus simple et déconcentrée, reposant sur le retour d'expérience des élus locaux et de leurs associations d'élus. |
Utiliser dans la communication de l'Agence des retours d'élus locaux et le relais des associations d'élus locaux. |
Recommandation en cours de mise en oeuvre. Vigilance sur les mois à venir. |
|
6 |
Étudier la proposition « 1% ou 1%o ingénierie » envisagée comme un fonds national alimenté par les collectivités pour les collectivités. |
Étude sur la proposition, présentation de scénarios chiffrés. |
Recommandation non retenue par la DGCL. |
|
7 |
Terminer les recensements départementaux de l'ingénierie. |
Instruction ministérielle demandant qu'un catalogue en ligne soit mis en place dans toutes les préfectures, et diffusé à tous les élus et leurs collectivités.
|
Recommandation en cours de mise en oeuvre. Le calendrier n'a pas été respecté et l'action reste inachevée à ce stade.
|
|
8 |
Sur les territoires où la dynamique d'animation et de structuration de l'ingénierie locale a fait défaut, encourager le préfet à l'impulser, notamment via les CLCT et leur déclinaison dans une instance technique (revue de projets) régulière. |
Instruction ministérielle de rappel des principes et diffusion des bonnes pratiques. |
Recommandation dont l'examen précis de la mise en oeuvre nécessiterait des investigations de terrain. L'action de l'ANCT est à saluer, mais cette recommandation n'est pas pour autant effective partout. |
|
9 |
Doter le préfet de moyens humains et financiers en matière d'ingénierie et doter l'Agence d'une ingénierie propre mobilisable sur le terrain. |
Instruction ministérielle aux préfets sur les bonnes pratiques. * Fonds dédié pour les préfets. * Redéploiements internes à l'Agence ou relèvement du plafond d'emplois via le Projet de Loi de Finances. |
Recommandation mise en oeuvre avec la déconcentration partielle du marché d'ingénierie aux préfets de département. |
|
10 |
Instituer un comité de direction commun régulier entre ANCT, ADEME et Cerema. |
Réalisation d'une feuille de route partagée notamment pour une meilleure coordination. |
Recommandation non retenue par l'ANCT. |
|
11 |
Créer une interface numérique pédagogique sur le « qui fait quoi ? ». |
Interface expérience utilisateur. |
Recommandation mise en oeuvre. |
|
N° |
Recommandations |
Support / action |
Support / action |
|
12 |
Conforter l'outil CRTE, élargi notamment à la dimension sociale, comme cadre de référence de la mise en oeuvre des politiques publiques de l'État. |
Avenant aux CRTE actuel. |
Recommandation mise en |
|
13 |
Identifier et valoriser les dynamiques de coopération entre territoires. |
À définir par l'ANCT : recensement des initiatives, refonte de programmes nationaux, programme dédié, instructions dans les programmes nationaux... |
Recommandation partiellement mise en oeuvre. |
|
14 |
Mesurer le niveau de satisfaction des programmes nationaux et mener des évaluations externes des dispositifs. |
Grille de satisfaction à réaliser par l'ANCT commune aux programmes (baromètre annuel par exemple). * Calendrier d'évaluations externes à prioriser sur les programmes et missions de l'Agence. |
Recommandation mise en oeuvre. |
AVANT-PROPOS
Le 2 février 2023, la délégation aux
collectivités territoriales a adopté
à l'unanimité le rapport « ANCT : se mettre au
diapason des élus locaux ! »7(*) de Charles
GUENÉ, Sénateur de la Haute-Marne (Les Républicains) et
Céline BRULIN, Sénatrice de Seine Maritime (Communiste
Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky).
Ce rapport dressait, du point de vue des élus locaux, un premier bilan de l'action de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), trois ans après sa mise en place, sachant que le Sénat a joué un rôle essentiel dans cette création8(*).
Il analysait principalement la manière dont les élus percevaient l'Agence et quelle plus-value cette dernière leur apportait dans l'exercice quotidien de leur mission.
Ce rapport avançait 14 recommandations pour renforcer la proximité de l'Agence avec les élus locaux et améliorer son action.
Environ un an et demi plus tard, la délégation a souhaité faire le point sur la mise en oeuvre des recommandations formulées dans ce rapport.
Elle a donc confié à Sonia de LA PROVÔTÉ, Sénatrice du Calvados (Union Centriste) et Céline BRULIN (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky) la mission de suivre leur mise en oeuvre.
Cette démarche s'inscrit dans le
renforcement du contrôle parlementaire et tout
particulièrement dans les mesures
« GRUNY » détaillées
dans l'encadré ci-dessous.
Le renforcement du contrôle parlementaire
À l'initiative du Président Gérard LARCHER, le Sénat a lancé, au printemps 2021, une mission de réflexion sur le contrôle sénatorial.
À l'issue d'une large consultation menée avec les présidents de groupe, de commission et de délégation, Madame Pascale GRUNY, rapporteur et vice-président du Sénat, a présenté onze propositions qui s'articulent autour de six objectifs, pour améliorer l'efficacité du contrôle de l'action du Gouvernement. Elles ont été mises en oeuvre dès le début de l'année 2022.
Les 6 objectifs pour renforcer la lisibilité des travaux du Sénat et le contrôle parlementaire sont :
- clarifier les modes de contrôle : utiliser une nomenclature homogène pour les travaux de contrôle, commune à toutes les instances du Sénat ;
- mieux cibler les priorités du contrôle sénatorial : centrer le programme de contrôle des commissions permanentes et des délégations sur 3 à 4 thèmes prioritaires par instance, de manière à se laisser une marge de manoeuvre pour déclencher des missions « flash », et veiller au pluralisme politique et à la bonne organisation de l'agenda sénatorial ;
- renforcer la coordination entre les différentes instances : organiser une concertation en amont de la Conférence des Présidents, poursuivre ces efforts de coordination tout au long de l'année, et, pour les commissions, il s'agira de davantage solliciter les délégations et l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), dans une logique de complémentarité, non de concurrence ;
- densifier les travaux de contrôle en mobilisant toute la palette des outils disponibles : déclencher des missions « flash » tout au long de l'année pour être plus réactifs face à l'actualité, établir avant chaque mission de contrôle une feuille de route, mobiliser les ressources disponibles pour mener les travaux de contrôle, solliciter les prérogatives de commission d'enquête pour renforcer l'information dont dispose le Parlement et évaluer l'application des lois, sur le plan quantitatif et qualitatif ;
- assurer le suivi des propositions du Sénat pour garantir leur bonne mise en oeuvre, ce qui implique les actions suivantes :
ü harmoniser les règles d'adoption des propositions et des rapports de contrôle : pour éclairer le vote, les membres de la commission, de la délégation ou de l'instance temporaire ont accès aux propositions du rapporteur avant l'adoption du rapport ;
ü privilégier les propositions opérationnelles, quitte à en réduire le nombre, pour garantir leur efficacité et faciliter leur mise en oeuvre ;
ü assurer la mise en oeuvre du volet parlementaire des propositions en rédigeant, si nécessaire, une proposition de loi, des amendements ou une proposition de résolution ;
ü présenter les propositions de façon harmonisée dans le tableau de mise en oeuvre et de suivi (TMiS) ;
ü mettre en place un « droit de suite » du rapporteur pour qu'il puisse suivre le degré de mise en oeuvre de ses propositions ;
ü procéder, au niveau des commissions et délégations, à un bilan annuel de la mise en oeuvre de leurs propositions.
- mieux communiquer sur les travaux de contrôle du Sénat : élaborer une stratégie de communication pour faire « vivre » la mission de contrôle tout au long des travaux, en respectant le pluralisme politique, renforcer la communication en ligne, en lien avec la stratégie numérique du Sénat et la refonte du site Internet et assurer la visibilité territoriale des travaux du Sénat.
Source : Sénat9(*)
Les rapporteures ont donc adressé plusieurs questionnaires aux différents organismes concernés par les recommandations, au premier rang desquels la direction générale des collectivités territoriales (DGCL) et l'ANCT.
Le 23 mai 2024, les rapporteures ont également été à l'initiative de l'organisation d'une table ronde en séance plénière de la délégation sur la mise en oeuvre des recommandations qui a donné lieu à un rapport d'étape10(*).
Enfin, à l'issue de cette table ronde, d'autres échanges sont intervenus avec l'Agence sur la base de questionnaires complémentaires.
Il convient de noter que le rapport initial avait été adopté au moment où l'Agence changeait de gouvernance, avec les arrivées de :
- Christophe BOUILLON élu le 13 décembre
2022 à la présidence de l'ANCT par les membres du conseil
d'administration. Il est maire de
Barentin (76) et président de
l'Association des petites villes de France (APVF) ;
- Stanislas BOURRON nommé le 5 décembre 2022 directeur général de l'ANCT. Il était depuis 2016, directeur général des collectivités locales au ministère de l'Intérieur.
Les rapporteures se sont donc attachées à évaluer la façon dont l'Agence a oeuvré pour tenter de réduire son déficit de notoriété et rendre accessibles ses dispositifs et offres de services à tous les niveaux de collectivité (partie I) et l'appui que fournit l'Agence aux collectivités en matière d'ingénierie (partie II).
I- I. MALGRÉ DES EFFORTS, L'ANCT RESTE DIFFICILEMENT ACCESSIBLE AUX ÉLUS DES PETITES COMMUNES
Le rapport avait mis en évidence que, si l'Agence était bien identifiée et appréciée de ses bénéficiaires, elle restait inconnue pour une part importante des élus.
À titre d'exemple, lors d'une consultation des
élus locaux sur la plateforme du Sénat, à la question
« connaissez-vous l'ANCT ? » plus de la moitié des
élus (52 %) répondaient par la négative, tandis que
les trois quarts des répondants (74 %) reconnaissaient ne pas avoir
fait appel à ses
services. Ce déficit de
notoriété, confirmé par les auditions et
déplacements, ainsi que par les associations d'élus, ne
permettait pas à l'Agence d'être
identifiée par les interlocuteurs
intéressés. Son image semblait floue et générait
une impression d'éloignement du terrain. Ces éléments
contribuaient à rendre plus difficile la compréhension, par des
élus locaux, de son fonctionnement et de son offre de services.
Le rapport avait également pointé l'investissement à géométrie variable des préfets, pourtant délégués territoriaux de l'Agence. Certains acteurs locaux interrogés avaient regretté un réel déficit d'incarnation de l'ANCT par certains préfets et/ou certains services déconcentrés. En effet, certains représentants de l'État s'étaient contentés de présenter l'Agence au moment de sa création, comme un exercice imposé, sans plus investir le sujet.
Rappel des recommandations relatives à cette thématique
Faire connaître l'Agence et ses offres :
- échanger en direct avec les élus locaux sur le bilan et les perspectives de l'Agence, pour nourrir le débat national État/territoires (recommandation n° 1.a) ;
- élaborer une feuille de route stratégique 2023-2026 de l'ANCT (recommandation n° 1.b) ;
- privilégier une communication plus simple et déconcentrée, reposant sur le retour d'expérience des élus locaux et de leurs associations d'élus (recommandation n° 5) ;
- mesurer le niveau de satisfaction des programmes nationaux par les élus locaux et mener des évaluations externes des dispositifs (recommandation n° 14).
Remobiliser les préfets et leur fournir un appui :
- remobiliser les préfets sur leur rôle de délégué territorial (recommandation n° 2.b) ;
- doubler le nombre de chargés de mission territoriaux de l'ANCT (recommandation n° 3).
Source : Recommandations du rapport du Sénat, « ANCT : se mettre au diapason des élus
locaux ! » rappelées en avant-propos de ce rapport.
A. UNE VOLONTÉ DE L'AGENCE D'ÊTRE PLUS PROCHE DU TERRAIN ET D'ALLER AU CONTACT DES ÉLUS LOCAUX
Le rapport11(*) du Sénat publié en février 2023, comme l'enquête de la Cour des comptes12(*) de février 2024, ou encore le rapport d'information13(*) de Bernard DELCROS au nom de la commission des finances pour donner suite à l'enquête de la Cour des comptes, rappellent le défaut de visibilité de l'Agence à l'échelle locale.
Ils notent également les progrès réalisés en la matière.
Ainsi le rapport de Bernard DELCROS constate-t-il que « la démarche visant à améliorer localement l'identification de l'ANCT est aujourd'hui engagée, même si sa démarche de communication doit encore être consolidée »14(*).
« Depuis un an, nous avons multiplié les leviers pour favoriser la proximité » confirmait Stanislas BOURRON lors de son audition au Sénat15(*) le 30 avril 2024.
L'Agence a effectivement accentué son effort de proximité (1) même si ses offres bénéficient à un nombre limité de collectivités et peinent à atteindre les petites communes (2).
1. La nouvelle gouvernance de l'Agence a accentué son effort de proximité et clarifié sa feuille de route
a) Une feuille de route clarifiée et engagée
L'Agence a adopté en conseil
d'administration à l'unanimité, le
29 juin
2023, une nouvelle feuille de route (disponible en annexe 1)
structurée autour de trois grands axes :
- la mise en place d'une méthode renouvelée afin de rendre l'Agence plus proche du terrain ;
- le renforcement de l'accompagnement sur mesure, incluant une dimension forte d'accompagnement des territoires vers leur transition écologique ;
- le renforcement de l'implantation de l'ANCT, dans une démarche de consolidation de la relation de proximité avec l'État territorial et du rôle du conseil d'administration en matière d'instance de dialogue.
Ce document, qui énonce des objectifs stratégiques clairs et les décline opérationnellement est plus conforme à l'esprit d'une feuille de route que celui qui existait précédemment. Tant sur sa forme que sur ses objectifs stratégiques, cette feuille de route semble faire écho aux recommandations du Sénat.
b) Un effort de proximité multiforme
Suite aux demandes des rapporteures, l'ANCT a fait état de plusieurs de ses initiatives visant à se rapprocher des élus locaux. Comme mentionné précédemment, la feuille de route de l'Agence fait très largement écho à cette « préoccupation de proximité » exprimée par le Sénat.
Pour fêter ses trois ans d'existence, l'ANCT a organisé le 23 mai 2023, au Palais des congrès de Paris, « l'ANCTour ». Ce premier événement national avait vocation à donner aux visiteurs, en particulier aux élus locaux, une vision globale de ce que l'Agence peut leur proposer, à travers ses programmes, dispositifs et modes d'accompagnement.
L'Agence signale aux rapporteures que « l'ANCTour a été un succès : il a réuni plus de 4 000 participants dont 5 ministres parmi les acteurs du développement des territoires (élus locaux et nationaux, chefs de projets de territoire, chargés de développement économique, professionnels de l'aménagement du territoire, urbanistes, opérateurs et services de l'État, associations de proximité ou têtes de réseau, étudiants, chercheurs) engageant pleinement la volonté de l'ANCT "d'aller vers" (...). En plus de renforcer la notoriété de l'Agence, cet événement a permis des temps d'échanges, comme des temps de partage d'expérience, avec les élus sur nos accompagnements en ingénierie. Il a aussi pu répondre à un enjeu stratégique essentiel de l'organisation, qui était la fédération en interne des équipes, transcendant l'organisation par services ou programmes »16(*).
L'événement a été reconduit dans la région Occitanie, à Toulouse, le 11 juin 2024. L'espace forum était organisé en 6 villages thématiques, intégrant une nouvelle fois des espaces d'agora permettant le partage d'expériences des élus et acteurs locaux, des tables rondes en prise directe avec les actualités d'ingénierie, de la transition écologique, du numérique, de l'aménagement...
En complément, le président et le directeur général de l'ANCT ont multiplié les échanges directs avec plus de 60 déplacements réalisés dans les territoires avant l'été 2024. Certains de ces déplacements ont particulièrement visé les territoires où les marges de progression de l'Agence semblaient les plus importantes.
L'Agence signale, en réponse aux rapporteures, que « ces déplacements qui ont lieu à la demande d'élus, de préfets - à l'occasion de CLCT, d'assemblée générale des maires, d'inaugurations - ont permis de constater :
- la dynamique présente sur le terrain dans tous les programmes portés par l'Agence ("Action coeur de ville", "Petites villes de demain", "territoires d'industrie", "France service", "politique de la ville", "tiers lieux"...) avec une forte mobilisation et satisfaction des élus et acteurs locaux ;
- la connaissance croissante de l'Agence au-delà de ses programmes, renforcée par l'impact de "Villages d'avenir" et un accueil très favorable pour l'accompagnement sur mesure ;
- le rôle d'ensemblier de l'Agence, la transversalité de nos actions à travers l'ensemble de nos programmes et aussi l'amplification de l'action de l'ANCT dans les territoires visités via la mobilisation des équipes locales. Parfois aussi, ces déplacements permettent de mieux comprendre les difficultés locales pour s'emparer de certains outils d'ingénierie et les freins existants »17(*).
Par ailleurs, le Président et/ou le directeur général de l'Agence sont systématiquement présents au congrès des dix associations nationales d'élus et participent à des congrès départementaux.
Au niveau local, les CLCT, qui se réunissent au moins deux fois par an, constituent ainsi le cadre privilégié pour ces temps d'échanges déconcentrés. Les CLCT permettent, entre autres, d'orienter les travaux de l'Agence dans le département, d'identifier, de mobiliser et de coordonner les ressources en ingénierie ainsi que de communiquer sur l'action de l'ANCT.
De plus, de nombreux forums locaux d'ingénierie se sont tenus à l'initiative des délégués territoriaux de l'Agence. Lors de la table ronde organisée par la délégation le 23 mai 2024, le président de l'ANCT a déclaré avoir recensé 74 forums locaux d'ingénierie.
Enfin, la mesure de la satisfaction des élus locaux passe aussi par la qualité de l'évaluation des programmes et des dispositifs par ces derniers. Il convient de souligner qu'outre la « filature bienveillante mais exigeante » du Sénat, l'Agence fait l'objet de plusieurs travaux évaluatifs internes et externes. L'annexe 2 met en évidence que les programmes de l'ANCT sont largement évalués. En ce sens, la recommandation n° 14 du rapport du Sénat semble plutôt bien suivie.
c) Une communication en cours de refonte pour être tournée vers les besoins des demandeurs
Stanislas BOURRON déclarait lors de son audition au Sénat18(*) avoir « opéré une refonte complète de nos outils de communication, afin de rendre l'offre de l'Agence plus simple et plus synthétique ».
L'Agence a diffusé un kit de communication aux préfets, suivi d'un webinaire de présentation de l'Agence et de rappel de ses missions et dispositifs.
L'Agence diffuse, depuis janvier 2024, une « newsletter ANCTerritorial ». Il s'agit d'un courriel qui reprend les actualités de l'Agence et l'agenda du mois en cours. Cette newsletter est envoyée à tous les délégués territoriaux et leurs adjoints et permet de faciliter la circulation des informations.
Depuis avril 2024, l'ANCT mobilise un outil (Canva) qui permet d'avoir accès à un kit de communication complet, comprenant les supports existants de l'ANCT : kakémono par préfecture, présentation PowerPoint de l'ANCT et de ses programmes, brochure de l'offre de services, dépliant et poster des offres d'ingénierie des six partenaires, modèles de flyers, cartes de visite personnalisables...
L'Agence fournit une licence professionnelle de cet outil et une formation à tous les délégués territoriaux et leurs adjoints qui le souhaitent, afin de renforcer l'efficacité de leur communication.
Cet outil fournit également aux préfets un exemple de cartographie de l'ingénierie publique territoriale à adapter selon chaque département (voir ci-dessous).
Source : ANCT
L'Agence a également publié une nouvelle plaquette de ses offres de services.
Brochure de présentation de l'ANCT
Source : ANCT
En complément, le site « solutions d'élus » a été déployé en 2023 et valorise des projets et initiatives reproductibles.
L'ANCT s'est également engagée à faire évoluer, d'ici début 2025, son site Internet en un portail de services centré sur les besoins des utilisateurs (voir encadré ci-dessous). Ce service ambitionne de devenir le point d'entrée privilégié des collectivités vers les différents outils à leur disposition, améliorant ainsi l'accompagnement de leurs projets en cours de déploiement.
« Mon Espace
Collectivité » propose d'appliquer le principe du
« Dites-le nous une fois » où
une information saisie est automatiquement synchronisée auprès
d'autres services d'État, réduisant ainsi le temps administratif
et améliorant la lisibilité de l'offre de services.
« Mon Espace Collectivité » s'inscrira
donc au sein d'un écosystème d'outils déjà à
disposition des collectivités : Aides Territoires, Démarches
Simplifiées, Grist19(*)...
Le projet vise à améliorer l'accessibilité, la cybersécurité, à réduire les coûts et à se conformer au nouveau système de design de l'État pour harmoniser la présence numérique de l'Agence.
« Mon Espace Collectivité » : plateforme tournée vers les attentes des usagers
Conçu par l'Incubateur des territoires de l'ANCT, ce nouvel espace Internet doit faciliter la gestion et l'accompagnement des projets territoriaux par les services de l'État.
Cette initiative s'inscrit dans les objectifs de l'Agence et de ses délégués territoriaux dans le cadre de la mise en place du guichet unique de l'ingénierie pour les collectivités territoriales.
Fonctionnalités attendues de « Mon Espace Collectivité » :
- agréger plusieurs services existants pour les élus, agents de collectivités et services déconcentrés ;
- faciliter le dialogue entre État et collectivités via un espace de concertation ;
- permettre de suivre l'avancée de la maturation d'un projet en fonction des recommandations ;
- faire le lien avec les aides financières et les aides en ingénierie adéquates, permettant de postuler directement ;
- permettre de visualiser des données socio-démographiques et financières concernant le territoire de l'utilisateur.
« Mon Espace Collectivité » deviendra un outil de pilotage et de suivi permettant, entre autres, le suivi, la valorisation et le développement des Contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Cette configuration implique une pluralité d'acteurs, faisant de « Mon Espace Collectivité » la plateforme privilégiée pour réaliser ces échanges20(*).
Source : ANCT21(*)
Dans l'attente de cette plateforme de services, les rapporteures constatent qu'une grande partie de ces éléments sont destinés aux délégués territoriaux, à leurs adjoints et aux services déconcentrés. Cette évolution était nécessaire mais elle n'est pas suffisante.
En effet, la recommandation n° 5 du rapport du Sénat relative à la communication visait essentiellement à revoir la communication de l'Agence à l'attention des élus locaux. Si la plaquette de présentation des offres a été remodelée, les rapporteures considèrent qu'il est toujours difficile, pour les élus, de s'y retrouver.
Dans les échanges de travail avec l'Agence, son directeur général a précisé que, pour tenir compte des remarques des Sénatrices, l'Agence préparait, pour la rentrée de septembre / octobre 2024, une brochure courte d'accès à l'information pour des élus qui n'auraient aucune connaissance de l'ANCT.
2. Mais l'offre de l'Agence bénéficie à un nombre réduit de collectivités et peine à atteindre les élus des communes de petite taille
Il convient de se rappeler que la faible notoriété de l'Agence n'est pas surprenante pour un organisme créé il y seulement quatre ans, qui exerce des missions très variées, le tout dans un contexte de crise sanitaire qui n'a pas permis les déplacements sur le terrain.
Malgré des progrès certains, l'Agence peut difficilement élargir son nombre de bénéficiaires et reste difficile à atteindre pour des élus de communes de petite taille.
a) Avec ses moyens actuels, l'Agence peut difficilement élargir ses offres à toutes les collectivités
Les collectivités bénéficiant des programmes de l'ANCT sont globalement satisfaites ou très satisfaites de cette opportunité. Les évaluations des programmes par leurs bénéficiaires, que nous avons précédemment évoquées, sont souvent très positives pour l'Agence.
Cependant, les dispositifs de l'Agence se concentrent sur un nombre réduit de collectivités.
À titre d'exemple, le programme
« Action coeur de ville » (ACV) concerne 244
villes moyennes, le programme « Petites villes de
demain » (PVD) concerne 1 644 territoires regroupant des
communes de moins de
20 000 habitants, et 2 458 communes sont
labélisées « Villages
d'avenir » (VA).
Ce point est souligné avec constance dans
l'ensemble des auditions de l'ANCT au Sénat. À titre
d'exemple, lors de l'audition de l'Agence en avril 202422(*) notre collègue Laurent
SOMON déclarait que « les communes qui ne font pas partie de
ces dispositifs se trouvent souvent pénalisées ».
Notre collègue
Patrice
JOLY a
également pris position en ce sens : « mon
département comporte 45 communes faisant partie de ces dispositifs et
260 communes frustrées ».
Le bilan en matière de prestation
d'ingénierie sur mesure de l'Agence est du même ordre. En
effet, Christophe BOUILLON rappelait, lors de la table ronde de la
délégation du 23 mai 2024 : « depuis 2020,
1 700 collectivités ont été accompagnées,
dont plus de 54 % sont des villes de moins de 3 500 habitants, qui
bénéficient d'une ingénierie prise en charge à
100 % par l'Agence. Nous avons donc, par ce biais, accompagné des
collectivités qui ne relèvent pas des programmes nationaux, mais
qui sont tout de même accompagnées par l'Agence
»23(*).
L'ensemble de ces chiffres, ramenés aux 34 935 communes et 1 254 EPCI recensés par la DGCL, soulignent que le nombre de collectivités soutenues reste modeste, en rapport avec le budget de l'Agence qui représente environ 200 millions d'euros.
Christophe BOUILLON reconnaissait la difficulté à atteindre toutes les collectivités : « Y a-t-il des trous dans la raquette ? J'ai parlé des grands programmes de la première vague : 250 communes "Action coeur de ville", 1 600 communes "Petites villes de demain", 2 500 communes "Villages d'avenir". La ministre a annoncé une nouvelle vague. Mais, effectivement, cela ne couvre pas absolument tout le monde. En revanche, notre capacité d'accompagnement est réelle et peut concerner la totalité des communes, notamment si le dossier est complexe. N'hésitez donc pas à nous solliciter ».24(*)
En adoptant une analyse plus fine, il convient de constater que moyennes et grandes villes sont plutôt bien couvertes par les programmes de l'Agence.
C'est surtout pour les communes rurales que
l'écart est manifeste : s'il existe plus de 30 000 communes
rurales au sens de l'Insee25(*), seulement
2 500 sont
« Villages d'avenir ». L'Agence souligne
cependant que, dans un certain nombre de départements, listés
ci-dessous, 100 % des communes candidates ont été retenues.
Elle signale également que le dispositif reste ouvert et donc que les
communes bénéficiaires ont, par rotation, vocation à se
renouveler.
Liste des départements dont les candidatures au programme « Villages d'avenir » ont toutes été retenues
|
Région |
Département |
Nombre de communes candidates |
Nombre de communes retenues en première vague |
|
PACA |
05 - Hautes-Alpes |
57 |
57 |
|
GRAND EST |
08 - Ardennes |
20 |
20 |
|
PACA |
13 - Bouches-du-Rhône |
17 |
17 |
|
CORSE |
2A - Corse-du-Sud |
25 |
25 |
|
CORSE |
2B - Haute-Corse |
36 |
36 |
|
OCCITANIE |
48 - Lozère |
30 |
30 |
|
OCCITANIE |
66 - Pyrénées-Orientales |
15 |
15 |
|
OCCITANIE |
82 - Tarn-et-Garonne |
40 |
40 |
|
PACA |
83 - Var |
15 |
15 |
|
BFC |
90 - Territoire de Belfort |
25 |
25 |
|
DOM |
971 - Guadeloupe |
4 |
4 |
|
DOM |
972 - Martinique |
5 |
5 |
|
DOM |
973 - Guyane |
6 |
6 |
Source : ANCT
Les rapporteures soulignent tout de même cette limite de l'action de l'État : la politique d'aménagement du territoire se fait par « saupoudrage » et par « petites touches impressionnistes ».
Elles appellent l'Agence à passer de réussites localisées sur quelques territoires à une politique d'aménagement du territoire plus globale.
Ce « passage à l'échelle », qui est aussi un garant d'une meilleure équité territoriale de l'action de l'État, repose probablement sur des moyens budgétaires et humains supplémentaires.
Mais il est probablement aussi possible d'explorer, à moyens constants, quelques autres pistes.
Par exemple, il serait possible que les communes qui ont réussi ces transformations puissent parrainer des collectivités moins avancées (partage des « bonnes pratiques »).
Le site Internet « Solutions d'élus » participe aussi à cette diffusion. Il valorise des projets et initiatives duplicables mais l'appropriation des projets reste probablement difficile pour certaines collectivités.
L'observatoire des territoires, qui est un des services administratifs de l'ANCT peut, sans doute, jouer un rôle, en repérant les projets qui fonctionnent et en favorisant leur capitalisation et le « passage à l'échelle ».
L'Agence a signalé faire évoluer son rôle afin de renforcer le lien entre ses études et son action opérationnelle. À titre d'exemple, l'Observatoire des territoires réalise désormais des revues régionales.
Il s'agit d'un diagnostic du territoire régional et de ses fragilités sur la base de plusieurs indicateurs composites. Ce diagnostic est destiné aux préfets des départements concernés. La superposition de ce diagnostic avec la carte des interventions de l'Agence permet de procéder à des ajustements dans les programmes et politiques publiques de l'ANCT. Cela permet de mettre en évidence des zones géographiques où des fragilités structurelles existent et doivent faire l'objet d'une attention particulière.
L'Agence dispose enfin, de plusieurs outils qui pourraient évoluer pour profiter à plus de collectivités. Par exemple, la plateforme « territoires en commun », dédiée à l'ingénierie de la coopération et de l'engagement citoyen, est ouverte à toutes les collectivités. L'objectif est de faciliter la mise en relation des acteurs, de faire circuler les bonnes pratiques, d'inspirer et d'outiller les collectivités désireuses de développer des politiques territoriales coopératives et démocratiques. À l'inverse, le « Forum des solutions » est une série de rendez-vous thématiques qui sont réservés aux villes du programme ACV. Chaque rendez-vous présente des projets innovants répondant aux problématiques rencontrées par ces villes. Il pourrait être ouvert à des villes qui ne sont pas parties prenantes du programme.
Cette problématique du « passage à l'échelle » interroge aussi la priorité à fixer à l'Agence dans les années à venir.
Certains souhaitent une pause dans le développement des missions de l'Agence pour lui laisser le temps de s'adapter, de conforter ses missions actuelles et de consolider ses réussites. D'autres souhaitent que l'Agence élargisse encore son champ d'action pour faire d'elle l'intermédiaire de référence sur l'ensemble des sujets relatifs à l'aménagement du territoire.
Dans le rapport d'information intitulé «
L'ANCT, une agence à consolider au service des territoires
» déposé le 14 février 2024,
Bernard DELCROS
plaidait pour la première option.
En effet, cette phase de consolidation pourrait lui permettre de renforcer la transversalité de l'Agence et son action interministérielle afin qu'elle s'impose, bien au-delà de ses compétences et des programmes actuels, comme la structure pilote des questions d'aménagement du territoire. Elle serait la garante de la cohérence des politiques de l'État et porterait une vision et une action globales et transversales.
Il convient, en effet, de rappeler que « l'ANCT
avait dû faire face à une montée en charge très
rapide, à un empilement continu de nouvelles missions sans avoir
été toutes identifiées lors de sa création et sans
que les moyens nécessaires pour les mener à bien aient toujours
été mis à sa disposition au bon
moment ».
Bernard DELCROS insistait d'ailleurs sur la nécessité de
convenir, à l'avenir, lorsqu'une nouvelle mission est confiée
à l'Agence, « d'examiner en amont les moyens
nécessaires pour que cette mission soit menée à bien
».26(*)
Un temps de pause pourrait lui permettre de mieux assoir ses réussites et pouvoir passer à l'échelle sur certains sujets grâce à une intervention interministérielle davantage coordonnée.
Enfin, pour nuancer aussi cette critique relative au « passage à l'échelle », l'Agence soulignait que, sur plusieurs de ses programmes, tel ACV, elle n'a pas particulièrement de demandes de villes qui en seraient exclues et qui souhaiteraient le rejoindre.
Au fil du temps, l'Agence s'est plutôt efforcée d'intégrer dans les programmes les communes volontaires qui s'en donnaient les moyens.
Autre nuance, relative à PVD cette fois-ci : les chargés de projet ont souvent, par leur positionnement, un rayonnement intercommunal qui bénéficie aux autres communes du groupement y compris celles qui ne sont pas strictement PVD.
Enfin, sur l'ingénierie sur
mesure, l'Agence affirme que la
quasi-totalité des demandes
qui lui ont été adressées est traitée et a
reçu une réponse favorable.
b) L'offre de l'Agence peine à atteindre les élus des communes de petite taille
Les rapporteures se félicitent de la volonté de l'Agence d'accroître sa proximité avec les élus locaux. Cependant, comme nombre de leurs collègues, elles mesurent au quotidien que les offres de l'Agence peinent à être connues de tous.
À ce titre, le rapport recommandait l'organisation
de rencontres à l'échelle locale, mobilisant des
élus de toutes strates, sur des projets concrets ayant impliqué
l'Agence. Dans l'esprit des rapporteures, ces échanges pourraient
prendre la forme de réunions déconcentrées hors
préfecture. L'enjeu serait d'évoquer, avec les élus
locaux, le bilan et les perspectives de l'Agence. Ces réunions auraient
le mérite de projeter l'Agence sur le terrain,
de la faire
connaître, de la confronter aux perceptions locales et sans doute de
renforcer la cohésion entre niveau local et national de l'ANCT. Elles
permettraient aussi de recueillir la perception des élus locaux sur
leurs besoins et attentes, ainsi que des suggestions pertinentes pour
l'avenir.
Dans les échanges avec les rapporteures, l'Agence reconnait qu'il est difficile de toucher les 520 000 élus locaux de France. Lors de son audition du 30 avril 2024, Stanislas BOURRON déclarait en ce sens : « certaines communes ne nous connaissent pas, ce qui est normal. Nos déplacements visent à faire connaître les dispositifs que nous portons. Notre objectif n'est pas d'être connus mais de nous assurer que, si un projet mérite d'être accompagné et bute sur une difficulté, nous puissions être utiles »27(*).
À ce sujet, le rôle des associations
locales de maires est important, car il peut constituer un
relai pour mieux faire connaître les offres de l'Agence.
À titre d'exemple, lors de son audition au Sénat, le directeur
général de l'ANCT déclarait sur les financements du
« Fonds Vert » : « à
l'instant où je vous parle, je constate simplement qu'un certain
nombre de communes auraient besoin de nous solliciter, mais ne le font
pas. Nous cherchons donc à nous appuyer
sur les
associations d'élus : " Association des maires de France et
des
présidents d'intercommunalité " (AMF), "
Association des maires ruraux de
France " (AMRF). Je vous invite
également à nous signaler tous les projets
bloqués
»28(*).
L'Agence signale aussi une rencontre très fructueuse avec les directeurs des associations départementales des maires lors de leurs journées professionnelles annuelles. Ils sont un relai très pertinent pour toucher les élus locaux. Cette rencontre a vocation à se reproduire pour échanger et mieux faire connaître les programmes de l'Agence.
Le relai des parlementaires est aussi
recherché par l'Agence.
Ainsi Christophe BOUILLON signalait-il lors
de son audition du
23 mai dernier : « nous menons, en
outre, un travail permanent d'explication en direction des élus. Nous
avons fait le choix, il y a quelques mois, d'envoyer à l'ensemble des
parlementaires un document expliquant l'impact territorial de l'Agence à
travers les différents programmes qu'elle porte, ce qui constitue un bon
début d'information. Je me félicite que des parlementaires
présentent ce document aux élus de leur
territoire »29(*).
Il déclarait également « si vous identifiez, en tant que Sénateurs, des dossiers bloqués, vous pouvez proposer à l'élu concerné de s'adresser au préfet ou au sous-préfet, parce que le chemin existe »30(*).
En effet, sans doute l'élément le plus important pour assurer cet accompagnement, est-il le rôle tenu par le délégué territorial de l'Agence et ses services qui doivent faire le relai entre les besoins du terrain et les dispositifs de l'Agence.
B. UNE CIRCULAIRE POUR REMOBILISER LES PRÉFETS EN TANT QUE DÉLÉGUÉS TERRITORIAUX
1. Une circulaire aux délégués territoriaux qui rappelle leur rôle et fixe leurs objectifs prioritaires
Le Sénat avait mis en évidence le déficit de communication de l'Agence à ses délégués territoriaux. La recommandation n° 2 du rapport visait à remédier à ce point en proposant la diffusion d'une circulaire aux préfets.
Le directeur général de l'ANCT convenait qu'obtenir la signature d'une telle circulaire était un « enjeu majeur »31(*).
Conformément à cette recommandation sénatoriale, une circulaire interministérielle, signée par le ministre de la transition écologique et la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, a donc été adressée aux préfets le 28 décembre 2023.
Cette instruction demande aux préfets de mettre en oeuvre 4 mesures pour permettre à l'Agence d'atteindre ses objectifs :
- renforcer l'action de proximité dans l'optique d'adapter encore davantage l'action de l'Agence aux besoins exprimés par les collectivités ;
- veiller à la mise en place, dans chaque
département, d'un outil d'animation de l'ingénierie locale
existante. Cet outil d'animation de l'ingénierie est sous
l'autorité des préfets et sous le pilotage opérationnel du
secrétaire général de la préfecture. Il peut
être le CLCT ou « tout autre format » que
le préfet choisira.
Cet outil devait permettre de finaliser la
cartographie départementale de l'ingénierie d'ici au
1er mars 2024 ;
- mettre en place un guichet local de
l'ingénierie. Point d'entrée unique de l'offre
d'ingénierie, il doit permettre aux élus d'être
orientés facilement. Ce guichet sera une adresse mail du type
ingenierie@departementale.gouv.fr.
L'Agence a précisé par écrit en réponse aux
questions des rapporteures, en juin 2024, que
« ce guichet
existe déjà dans les deux tiers des départements où
nous assurons un suivi très régulier » 32(*) ;
- organiser un forum local de l'ingénierie annuel,
dont la
première édition devra se tenir avant la fin du
premier
trimestre 2024. L'Agence a précisé par écrit,
en réponse aux questions des rapporteures, que plus de 74 forums
ont déjà été organisés ou prévus dans
l'ensemble des départements à l'été 2024.
Au-delà de cette circulaire, la remobilisation des préfets passe par une dimension d'animation et de management. À ce titre, la direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur (DMATES) signale faire régulièrement « intervenir les services de l'ANCT lors des séminaires du corps préfectoral, regroupant notamment les secrétaires généraux et sous-préfets d'arrondissement, permettant de présenter aux acteurs territoriaux les actualités des programmes de l'Agence »33(*).
En outre, les acteurs locaux qui suivent les programmes de l'ANCT sont interrogés lors du processus d'évaluation du préfet et peuvent s'exprimer sur les résultats obtenus par celui-ci, son engagement en tant que développeur et facilitateur des projets locaux.
Enfin, afin d'apporter aux délégués territoriaux le soutien nécessaire pour qu'ils puissent mieux déployer l'action de l'Agence sur le terrain, le rapport du Sénat avait demandé de doubler le nombre de chargés de mission territoriaux. Ces agents constituent, en effet, le point d'entrée unique de l'ANCT au niveau local mais aussi des interlocuteurs transversaux de proximité pour les délégués territoriaux et leurs adjoints.
Cette recommandation s'est traduite par un relèvement du plafond d'emplois à hauteur de quatre équivalents temps plein au titre du renforcement du maillage territorial de l'Agence. L'équipe comporte désormais, à l'été 2024 : 12 chargés de mission territoriaux et 5 adjoints (AURA34(*), Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et outre-mer) contre seulement 8 agents en février 2023.
Ces chargés de mission territoriaux réalisent, à l'occasion des nouvelles nominations dans les préfectures, un travail constant de présentation de l'offre de l'Agence et de ses modalités d'intervention notamment en matière d'ingénierie, ainsi qu'une explicitation de la manière de constituer le CLCT comme cadre local d'animation.
Le directeur général de l'ANCT a
souligné, dans ses échanges avec les rapporteures, l'impact
très positif de cette mesure en signalant que
la
quasi-totalité des préfets a désormais bien
identifié les chargés de mission territoriaux et leurs missions.
2. Une mise en oeuvre qu'il faut faire vivre dans le temps
Les rapporteures se félicitent de la mise en place de cette instruction aux préfets. Cependant, elles restent attentives au rythme de sa mise en oeuvre.
L'inventaire de l'ingénierie est un exercice prioritaire qui conditionne l'accompagnement pour les collectivités.
Dans le rapport du Sénat de février 2023,
les rapporteurs avaient sondé les préfectures sur cet inventaire
et avaient reçu la réponse de
62 préfectures : 32
n'avaient pas fait d'inventaire, 18 avaient des éléments partiels
d'inventaire et seulement 13 l'avaient réalisé.
En mai 2024, l'ANCT signale que 32 cartographies sont
finalisées et
45 sont en cours de finalisation. Par
déduction, les rapporteures concluent que, dans 21 départements,
le travail n'est pas encore mené ou achevé.
Il n'est pas normal que, plus de 4 ans et demi après la mise en place de l'Agence et alors que c'était l'une de ses missions de départ prioritaires, seulement 32 départements aient réalisé cet inventaire, quand bien même 45 seraient encore en train de l'achever.
Suite aux demandes d'explications adressées par les rapporteures à l'Agence, cette dernière fait état, en août 2024, de seulement 7 départements qui n'ont pas encore engagé ce travail et précise que, suite à ses relances, tous les autres départements ont engagé ou achevé ces inventaires.
Par ailleurs, malgré cette circulaire, dans les différentes auditions et tables rondes mentionnées dans ce rapport, plusieurs Sénateurs constatent que, même s'ils restent une minorité, certains préfets ne se sont toujours pas approprié leur rôle de délégué territorial, n'ont pas communiqué d'information particulière sur l'Agence voire n'ont pas réellement mis en place un CLCT régulier et fonctionnel.
La Cour des comptes, dans son contrôle sur « la mise en place et la viabilité de l'Agence nationale de la cohésion des territoires »35(*), estime que « l'appropriation par les préfets de département de leurs missions en tant que délégués territoriaux est inégale, conduisant à des dynamiques variables selon les territoires ».
Les rapporteures recommandent que des instructions régulières puissent rappeler aux délégués territoriaux ce qui est attendu d'eux, tout en dressant le bilan global de ce qui a été réalisé.
Enfin, les réponses écrites au questionnaire des rapporteures ont mis en évidence quelques différences d'interprétation, entre la DMATES et l'ANCT, sur le rôle du préfet.
En effet, la DMATES a fourni, en réponse aux questionnaires des rapporteures, la réponse suivante : « la question de la remobilisation des préfets sur leur rôle de délégué territorial ne peut s'envisager sans appréhender celle de la restructuration de l'organisation de l'ANCT. L'article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que " le [délégué territorial] veille à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l'Agence, d'une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d'ingénierie et, d'autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du CGCT ". Ainsi, les préfets et sous-préfets ont-ils un rôle de coordination entre les différents acteurs territoriaux mais ne sauraient se substituer aux actions propres menées par les agents de l'ANCT. Dès lors, on ne peut que constater que l'ANCT ne dispose pas d'échelon local propre dont une partie pourrait être positionnée dans les services déconcentrés de l'État afin d'offrir un appui technique, local et spécialisé dans les enjeux étatiques, au profit du délégué territorial. En raison de cette absence, ce sont les agents des services préfectoraux et des directions déconcentrées qui mettent en oeuvre les programmes de l'ANCT, en plus des missions qui leurs sont dévolues »36(*).
Autrement dit, la DMATES pose la question de l'échelon territorial de l'Agence.
La notion de délégué territorial est définie clairement à l'article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : « le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'État comportant un échelon territorial et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'État ».
Si c'est bien la loi, dont la valeur juridique s'impose à ce décret, qui fait du préfet le délégué territorial de l'Agence, il n'en reste pas moins que l'ANCT n'a aucun échelon ou service territorial. Or, ce décret précise quelles sont les missions dévolues au préfet en tant que délégué territorial, à savoir essentiellement la représentation et la coordination des actions de l'établissement avec les actions conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'État.
Dès lors, il semble que, pour la DMATES, une évolution du décret serait nécessaire pour que préfet puisse exercer pleinement ses missions de délégué territorial.
La DGCL et l'ANCT, de leur côté, se réfèrent essentiellement à la loi qui institue le préfet comme délégué territorial.
Vos rapporteures interprètent aussi, en filigrane, ces nuances d'interprétation à l'aune des difficultés d'effectifs dans les services de l'État.
À ce sujet, il convient de rappeler que le renforcement du préfet et des services déconcentrés de l'État est une priorité de la délégation aux collectivités territoriales.
Le rapport, adopté à l'unanimité par
la délégation aux collectivités territoriales du
Sénat en septembre 2022 intitulé « À la
recherche de l'État dans les territoires » et porté
par Agnès CANAYER et Éric KERROUCHE, avait mis en évidence
le constat d'une baisse des moyens de l'État dans les
territoires. Par exemple, en 2011 les effectifs physiques des
directions départementales interministérielles (DDI)
s'élevaient à 39 796 agents, mais ces directions ne comptaient
plus que 25 474 agents en 2020, soit une chute de
36 %.
Plusieurs des recommandations de ce rapport visaient à renforcer le préfet, à mieux l'ancrer localement et à lui donner les moyens de répondre aux attentes des élus locaux.
C. SYNTHÈSE DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT DU SÉNAT
Finalement, les rapporteures estiment que les recommandations suivantes ont été plutôt bien intégrées par l'ANCT et suivies d'actions significatives qui vont dans le sens préconisé par le Sénat :
- élaborer la feuille de route stratégique
2023 - 2026 de l'ANCT
(recommandation n° 1.b) ;
- échanger en direct avec les élus locaux
sur le bilan et les perspectives de l'Agence, pour nourrir le débat
national
État /territoires (recommandation n° 1.a) ;
- remobiliser les préfets sur leur rôle de délégué territorial (recommandation n° 2.b) ;
- doubler le nombre de chargés de mission
territoriaux de l'ANCT
(recommandation n° 3) ;
- mesurer le niveau de satisfaction des programmes nationaux par les élus locaux et mener des évaluations externes des dispositifs (recommandation n° 14).
Pour la dernière recommandation concernée
par cette partie
(recommandation n° 5 : privilégier une
communication plus simple et déconcentrée, reposant sur le retour
d'expérience des élus locaux et de leurs associations
d'élus), les rapporteures ont bien noté les évolutions en
cours, notamment celle du site Internet et celle de la future plaquette
informative pour les élus qui semblent aller dans le bon sens mais sans
pouvoir, encore, vérifier l'effectivité de leur mise en
oeuvre.
II. L'AGENCE A AMÉLIORÉ SON OFFRE D'INGÉNIERIE MAIS CONTRIBUE TRÈS PEU À RENFORCER LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE LOCALE
La loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires lui confie la mission de faciliter « l'accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d'ingénierie juridique, financière et technique, qu'elle recense »37(*).
Pour autant, la notion « d'ingénierie » recoupe des besoins et des domaines très différents : la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre, la conduite de projet, l'expertise financière, culturelle, administrative, de nombreuses expertises techniques... Même la notion d'ingénierie de projet peut recouper des réalités très diverses.
L'ANCT s'est positionné sur ce qui peut être qualifié « d'ingénierie amont », c'est-à-dire une ingénierie qui intervient pour définir, faire émerger, formaliser et cadrer les projets : diagnostics, projets de territoire, études de faisabilité ou définition d'un projet, conduite d'une concertation ou intégration du volet participation des habitants, et recherche de financements.
Le rapport de 2023 avait mis en évidence qu'en matière d'ingénierie, les interventions de l'Agence suscitaient critiques et questionnements.
Il avait souligné la profusion des dispositifs en matière d'ingénierie et le caractère parfois confus des interventions des différentes agences de l'État. Le constat du rapport était sans appel : certaines interventions frisent le doublon voire sont en concurrence. Il était attendu que l'ANCT trouve aussi une meilleure articulation avec le niveau régional qui est celui des grandes contractualisations en matière d'aménagement du territoire et de cohésion territoriale. La mise en place des CRTE avait également été considérée par les élus locaux comme une occasion manquée de simplification et de renouvellement des financements. Il était attendu que les élus locaux soient mieux informés et mieux accompagnés dans ce maquis.
De plus, l'intervention de l'Agence en matière d'ingénierie était parfois accusée de générer des effets contreproductifs lorsqu'elle se déroulait en décalage avec les équilibres locaux ou en substitution de leurs acteurs. L'annonce de prestations d'ingénierie gratuites a, par exemple, entrainé une forte confusion chez les élus locaux et une forme de pénalisation des écosystèmes organisés. Enfin, le recours à une majorité de bureaux de consultants privés est parfois adapté mais il ne contribue pas à renforcer l'écosystème local.
Plusieurs recommandations allaient dans le sens d'une inflexion de la logique actuelle afin que l'intervention de l'Agence vise avant tout à développer les acteurs locaux de l'ingénierie.
Rappel des recommandations relatives à cette thématique
Pour accompagner et aiguillonner les élus locaux :
- positionner le sous-préfet d'arrondissement comme interlocuteur de 1er niveau sur les questions d'ingénierie : orientation des élus et relai des offres (recommandation 2.a) ;
- créer une interface numérique
pédagogique sur le « qui fait quoi ? »
(recommandation n° 11)
Pour rationaliser les interventions publiques :
- instituer un comité de direction commun régulier entre l'ANCT, l'ADEME et le Cerema (recommandation n° 10) ;
- conforter l'outil CRTE, élargi notamment à la dimension sociale, comme cadre de référence de la mise en oeuvre des politiques publiques de l'État (recommandation n° 12) ;
- engager un dialogue pour intégrer les Conseils régionaux dans le fonctionnement de l'Agence (recommandation n° 4) ;
Pour renforcer les acteurs locaux de l'ingénierie :
- identifier et valoriser les dynamiques de coopération entre territoires (recommandation n° 13) ;
- terminer les recensements départementaux de l'ingénierie (recommandation n° 7) ;
- sur les territoires où la dynamique d'animation et de structuration de l'ingénierie locale a fait défaut, encourager le préfet à l'impulser, notamment via les CLCT et leur déclinaison dans une instance technique (revue de projets) régulière (recommandation n° 8) ;
- doter le préfet de moyens humains et financiers en matière d'ingénierie et doter l'Agence d'une ingénierie propre mobilisable sur le terrain (recommandation n° 9) ;
- étudier la proposition « 1% ou 1%o ingénierie » envisagée comme un fonds national alimenté par les collectivités pour les collectivités (recommandation n° 6).
Source : Recommandations du rapport du Sénat, « ANCT : se mettre au diapason des élus locaux ! » rappelées en avant-propos de ce rapport.
A. L'AGENCE A RENFORCÉ SON OFFRE D'INGÉNIERIE AFIN QU'IL N'Y AIT PAS DE PROJET ORPHELIN
1. La recherche d'une meilleure cohérence dans l'action publique
a) La recherche d'une meilleure coordination entre opérateurs de l'État
Depuis la publication du rapport du Sénat en 2023, l'Agence a signalé plusieurs travaux.
L'Agence a signé, à la fin du mois de
novembre 2023, de nouvelles conventions quadriennales qui
prévoient des engagements réciproques impliquant notamment des
opérateurs qui ne bénéficient pas d'un maillage
territorial. Les partenaires de l'Agence ont tous accepté de
passer par le guichet départemental tenu par les préfets
en cas de
besoin. Comme le signalait le directeur général de
l'ANCT lors de son audition au Sénat, « les conventions
signées avec les opérateurs en novembre dernier ne sont pas du
tout identiques aux précédentes. En effet, celles qui portaient
sur des engagements financiers ont été très
compliquées à mettre en oeuvre. Nous avons donc
privilégié une logique différente, reposant sur la
reconnaissance systématique d'un guichet unique départemental en
cas de besoin. Nous avons insisté pour que les opérateurs
acceptent que le chemin d'accès à l'information se situe au
niveau départemental. Puis, nous avons insisté
pour qu'ils partagent avec nous la totalité de leur offre
d'ingénierie. Nous avons organisé et
classé ces informations, par thématiques et par types,
recensé les différents acteurs et les outils disponibles. Ces
données sont reprises dans un petit document synthétique,
mis à disposition des préfets, afin qu'ils puissent
guider les collectivités. Il s'agissait d'une exigence
législative. Les informations forment une sorte de bible des
soutiens divers, sont exploitables et accessibles sur la plateforme
aides-territoires.beta.gouv.fr, qui doit nous en transférer
la gestion dans quelques mois »38(*).
L'Agence a effectivement procédé à un recensement intégral de l'offre d'ingénierie des opérateurs de l'État : Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), Agence nationale de l'habitat (Anah), ADEME, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), Banque des territoires (BdT) du groupe Caisse des dépôts et consignations (CDC) et bien sûr ANCT.
Le résultat est un document exhaustif et un document de communication, sous forme de plaquette de type « qui fait quoi ? », sur l'ingénierie des six grands opérateurs de l'État.
Source : ANCT
Présenté notamment aux Sénateurs
lors de la table ronde du
23 mai 2024, le document a recueilli un
enthousiasme mitigé.
Malgré cet effort de synthèse, ce document présente plusieurs limites.
D'une part, il est difficile à lire,
à comprendre et ne livre pas de solutions en tant que telles.
Le contenu ou la nature des lignes « types d'offre
d'ingénierie » sont difficiles à cerner. Un élu
peut constater qu'en matière « d'urbanisme, logement,
aménagement », quatre acteurs (ANCT, Cerema, Anah, Anru)
sont compétents sur le volet « ingénierie en
amont ». Mais est-il bien avancé dans sa
quête d'accompagnement ? Comment savoir lequel
solliciter ? Quel
est l'acteur qui est la « porte
d'entrée » ? Comment comprendre la cohérence
voire la complémentarité entre les acteurs ?
D'autre part, ce tableau semble souligner la
dispersion des compétences entre les opérateurs
d'État. Le tableau comprend
80 cases : 15 d'entre
elles signalent qu'un seul opérateur est compétent alors que,
dans 65 autres cases, il y a un, deux, trois, quatre et jusqu'à cinq
opérateurs compétents. Il est possible d'y lire un signe
inquiétant de dispersion de compétences, voire de doublons et
peut être même de concurrence. Ce point plaide en faveur
d'une fusion de ces opérateurs comme nous y reviendrons plus avant dans
ce rapport.
Un autre effort de rapprochement entre opérateurs à signaler réside, au niveau régional, dans des réunions de travail entre les préfectures, la Dreal, l'ANCT, le Cerema, l'ADEME, tenues dans une perspective de contribution aux travaux des conférences des parties (COP39(*)) régionales. Plus récemment, à la demande du ministre, se sont tenues des rencontres de travail entre l'ANCT, le Cerema, l'ADEME, l'OFB40(*), les agences de l'eau pour proposer aux collectivités une offre d'ingénierie sur les questions d'adaptation au changement climatique.
Les rapporteures notent les efforts réalisés dans ce sens mais rappellent que la recommandation n° 10 suggérait l'instauration d'un comité de direction commun régulier entre l'ANCT, l'ADEME et le Cerema.
L'ANCT a indiqué, en réponse au
questionnaire des rapporteures,
qu' « un comité de
direction commun n'apporterait rien de plus qu'un organe supplémentaire
à animer, sans apporter davantage de sujets communs aux six
opérateurs partenaires qu'il n'en existe aujourd'hui et qui sont
déjà traités dans le cadre du CNC41(*) et de ses déclinaisons
techniques très régulières et organisées entre
équipes. (...) La forme souple du CNC permet de traiter les sujets
communs aux six qui ne recouvrent qu'une partie de l'activité de
chacun »42(*).
Le Comité national de coordination (CNC)
La loi de création de l'ANCT, a également mis en place un Comité national de coordination (CNC) qui réunit les directeurs généraux ou présidents directeurs généraux des 6 opérateurs partenaires : ANCT, Cerema, ADEME, Anru, Anah, Banque des territoires (Caisse des dépôts et consignation).
Ces six établissements ont en commun d'agir notamment au bénéfice des collectivités territoriales, mais de manière très différente les uns des autres : objets, statuts juridiques, modes d'intervention, champs d'expertise, compétences....
Ce CNC sert à l'ANCT, au regard de sa grande transversalité de fonction et de son positionnement, à donner les actualités ministérielles sur les questions liées à la cohésion des territoires : actualisation des QPV43(*), lancement de France Ruralités, déploiement des CRTE...
L'ANCT est, par ailleurs, membre des conseils d'administration de tous les opérateurs membres du CNC, à l'exception de la BDT qui est une institution financière.
Elle a signé avec chacun de ces 6 partenaires des
conventions-cadres renouvelées en 2024, après une première
période triennale. Le CNC a été le lieu de débat
pour déterminer les grandes lignes à fixer dans les
conventions-cadres.
Source : Sénat sur la base des éléments fournis par l'ANCT
Les rapporteures rappellent qu'il existe un comité de direction commun avec le Cerema et l'ADEME se réunissant tous les 3 mois et estiment malgré tout qu'une instance de cette nature devrait exister entre l'ANCT, l'ADEME, le Cerema, même sur une périodicité plus lâche à définir.
b) Le pouvoir de proposition et d'adaptation des préfets dans la mise en oeuvre des programmes nationaux
Dans les éléments écrits fournis par l'ANCT aux rapporteures, il est mentionné que « les préfets disposent de pouvoir de proposition et d'adaptation en lien avec les acteurs locaux sur l'organisation de l'ingénierie des programmes. Par exemple, les chefs de projets PVD sont souvent intercommunaux mais parfois communaux. Dans la Creuse, ils sont réunis au sein du département. Les chefs de projet "Villages d'avenir" sont aussi positionnés différemment en fonction des situations locales : en préfecture, sous-préfecture, DDT... »44(*).
Les rapporteures se félicitent de cette reconnaissance du pouvoir d'adaptation des préfets et souhaitent que les préfets se saisissent pleinement de la possibilité qui leur est offerte de suggérer des adaptations pertinentes aux contextes locaux.
c) La deuxième génération des CRTE conforte leur dimension multithématique
Le rapport du Sénat ne pouvait éluder ce sujet puisqu'il intervenait au moment où les élus locaux étaient invités à boucler les CRTE dans les territoires. Le rapport relayait à la fois les attentes et espoirs suscités par ce nouvel outil mais aussi les limites ou déceptions qu'il générait. Le rapport recommandait de conforter les CRTE comme cadre de référence du dialogue avec l'État, ce qui impliquait de l'ouvrir à tous les thèmes.
Le CRTE est considéré par plusieurs
rapports sénatoriaux comme un espace de dialogue et un
espace intégrateur, à l'échelle
plutôt de la maille intercommunale. Cet exercice permet de concentrer les
moyens autour d'équipements ou d'enjeux structurants pour les
élus à l'échelle de cet
espace de dialogue et de mise
en forme des programmes
nationaux. Cet outil permet de partager une vision
pour un bassin de vie et une stratégie sur le moyen terme.
Dans la continuité et en complément de la
circulaire du
29 septembre 2023 relative à la mise en
oeuvre de la territorialisation de la planification écologique, une
nouvelle instruction pour la relance des CRTE a
été signée le 30 avril 202445(*) par le
ministre de l'Intérieur et des outre-mer, le ministre de la Transition
écologique et de la Cohésion des territoires, et la ministre
déléguée chargée des Collectivités
territoriales et de la Ruralité. Cette instruction
détaille la méthode et le calendrier pour engager une
deuxième étape des CRTE afin d'accélérer la
concrétisation des projets locaux dont ceux issus des travaux de
territorialisation de la planification écologique.
Cette circulaire confirme la dimension transversale des CRTE en intégrant les thèmes de la cohésion sociale. Ces contrats doivent permettre aux préfets de contractualiser « en particulier avec les maires », sur les sujets les plus divers, « outre les questions de transition écologique ». Le texte cite notamment « des axes relatifs au développement économique, aux services publics, à la santé, à la ruralité, à la culture, à la cohésion sociale, à l'alimentation »46(*).
Les CRTE vont devenir le « contrat chapeau
» qui devra être « cohérent avec l'ensemble
des contractualisations locales préexistantes »47(*). L'Agence rappelle notamment
que les CRTE ont vocation à devenir « le cadre de dialogue
normal entre l'État et les collectivités », dans le
cadre d'un « projet de territoire
partagé ». La
circulaire livre un calendrier qui doit aboutir à une « mise
à
jour » des contrats d'ici la fin de l'année
2024.
La recommandation n° 10 du rapport du Sénat a donc été suivie d'effet.
d) L'articulation de l'action de l'Agence avec le niveau régional encore délicate
Le rapport du Sénat mettait en évidence des marges de progression entre le déploiement des programmes et actions de l'Agence et les politiques publiques régionales.
Interrogée par vos rapporteures sur les évolutions relatives à ce point, l'ANCT avance quelques éléments.
L'Agence rappelle que les régions sont membres de son conseil d'administration, via Régions de France (RdF), et font donc déjà partie du fonctionnement institutionnel de l'Agence.
L'Agence qualifie également le lien avec
l'association RdF de « très
régulier » et signale plusieurs exemples de
bonne collaboration. À titre d'exemple, l'Agence valorise le travail
conjoint mené avec la Région
Grand Est.
Dans cette région, l'ANCT et le Conseil
régional travaillent ensemble sur différents chantiers : COP
régionale, Cellule Régionale France Mobilités, Tourisme
(travaux menés par « Atout France »),
friches industrielles (travail multi-partenarial à venir sous
l'impulsion de l'ADEME), territoires de montagnes (articulation CR /
Commissariat du Massif des Vosges) ou encore les Pactes territoriaux de relance
et de transition écologique (PTRTE), tous signés conjointement
par la préfète de région et le président du Conseil
régional. Les maisons de la Région sont également
présentes aux différents COPIL48(*) ou réunions de suivi
des PTRTE qui se tiennent au niveau départemental. De plus, l'ANCT et la
Région Grand Est accompagnent conjointement et de manière
complémentaire des projets de
collectivités : maintien
d'une « Maison familiale rurale » (Mfr) sur la
commune de Gugnécourt (Vosges), l'ANCT en ingénierie sur mesure
sur la faisabilité du projet et la région pour les questions de
formation, etc.
L'Agence signale également l'existence d'un dialogue structuré avec les régions dans le cadre de la mise en oeuvre des fonds européens de cohésion dont elle est l'autorité de coordination inter-fonds. Le comité État-régions sur les fonds européens est l'instance politique pour acter de ces travaux et des perspectives. Le comité État-régions constitue un moment privilégié environ deux fois par an49(*), de dialogue à un niveau politique (ministre/président délégué de RdF) entre les régions et l'État. L'Agence assume le secrétariat du comité en lien avec RdF et prépare les éléments portés à l'ordre du jour pour information ou décision.
Au-delà de ce comité, l'Agence organise ainsi des réunions de directeurs Europe plusieurs fois par an et apporte un appui quotidien aux équipes des régions chargées de la mise en oeuvre des fonds par le biais de groupes de travail thématiques par exemple pour les Régions ultrapériphériques (RUP).
Cette collaboration se traduit également, lors des déplacements du président ou du directeur général de l'ANCT, par la présence des régions pour témoigner des synergies locales pour accompagner les territoires en difficultés.
L'ANCT, dans sa réponse écrite au questionnaire des rapporteures, reconnaissait cependant que « les liens et l'implication avec chacune d'entre elles sur chaque programme ou dispositif (politique de la ville, ACV, ruralités...) sont dépendants de contextes locaux et de travaux menés au niveau régional »50(*).
De son côté, l'association RdF,
sollicitée par les rapporteures, pose un constat dont la
tonalité est sensiblement différente :
« en dépit des recommandations formulées dans le
rapport du Sénat il y a plus d'un an, les régions n'ont
pas constaté de changement significatif dans le fonctionnement de
l'ANCT. Régions de France maintient donc les
observations critiques qu'elle avait émises dans le cadre de sa
contribution au rapport précité. Plus précisément,
s'agissant des relations entre l'Agence et les régions, si un
comité État-régions se réunit bien deux fois par
an, il s'agit d'un exercice le plus souvent formel, dont il ne saurait
être conclu qu'il traduit une pleine coordination entre l'action des
collectivités régionales et celle de l'Agence. À titre
d'exemple, les programmes étatiques "Action coeur de ville" ou
encore "Petites villes de demain" ont été conçus
de façon autonome et continuent de vivre leur vie, sans tenir compte des
politiques conduites par les régions en matière
d'aménagement du territoire. Il en est de même des
CRTE -
contrats desquels les régions ne sont pas signataires, à
l'exception de la Région Grand Est »51(*).
2. Des moyens
confortés et préservés des coupes budgétaires avant
la dissolution de l'Assemblée nationale
Les crédits d'ingénierie de l'ANCT ont été doublés par la loi de finances pour 2024, de sorte que l'Agence bénéficie désormais d'une enveloppe d'environ 40 millions d'euros pour tous ses dispositifs d'ingénierie.
a) Un doublement des crédits d'ingénierie en 2024 qui offre des droits de tirage plus élevés sur le marché, assorti d'une déconcentration partielle de ces crédits
Une partie de ces crédits concerne le marché d'ingénierie qui permet de mutualiser la commande publique sur ces enjeux pour de très nombreuses collectivités. Le marché ne comporte pas de limite en tant que telle, il convient que l'ANCT puisse simplement tenir dans son enveloppe budgétaire globale de 40 millions d'euros qui comprend ce marché et les autres dispositifs de financement d'ingénierie (financement de postes notamment, voir ci-après).
À titre d'illustration, le montant engagé
sur le marché d'ingénierie en 2023, avant que les crédits
soient doublés (et donc sur une enveloppe de
20 millions d'euros)
dépassait les 10 millions d'euros.
De plus, début 202452(*), et dans la droite ligne de
la
recommandation n° 9 du Sénat, 15 millions des
crédits du marché d'ingénierie sur mesure sont
déconcentrés à la main des préfets de
département. Cela représente une enveloppe d'environ
150 000 euros par département.
Pour répondre directement à un besoin exprimé par une collectivité que l'ingénierie locale ne sait satisfaire, les préfets peuvent désormais mobiliser directement l'un des trois lots régionaux du marché d'ingénierie : diagnostic de territoire, concertation et appui au cadrage de projets.
Cette modalité d'appui en ingénierie s'inscrit en complémentarité avec deux autres dispositifs :
- l'enveloppe déconcentrée du volet ingénierie du « Fonds vert » qui permet de financer l'ingénierie d'animation et de planification dans les champs de la transition écologique pour laquelle l'Agence a été désignée comme pilote au niveau national en 2024. Le directeur général de l'Agence déclarait, lors de son audition au Sénat : « le fait que cette enveloppe soit sous notre responsabilité favorise la cohérence d'action du soutien de l'État au niveau local »53(*) ;
- l'ingénierie sur mesure mise en place par le niveau central de l'ANCT qui permet, via le chargé de mission territorial d'activer les autres lots du marché d'ingénierie ou l'intervention d'un opérateur partenaire (Cerema majoritairement).
Par ailleurs, l'ANCT inclut, de plus en plus,
dans ses crédits d'intervention un volet d'ingénierie
ouvert au financement. À titre d'illustration, le fonds
« Avenir Montagne », doté de 331 millions
d'euros sur deux ans (2021 et 2022), comportait un volet investissement
(300 millions d'euros) et un volet ingénierie (31 millions
d'euros).
b) Le financement et cofinancement de postes d'ingénierie
L'ANCT finance, ou participe au financement, à la formation et l'animation de plusieurs postes en matière d'ingénierie dans les territoires. Il est notamment possible d'évoquer :
- 120 chefs de projets « Villages d'avenir » financés intégralement par l'État et positionnés dans les services départementaux de l'État. L'ANCT a recruté et formé ces chefs de projet ;
- 904 postes de chefs de projet PVD qui viennent renforcer les équipes communales et intercommunales auprès des élus, pour mener à bien leur projet de revitalisation. L'ANCT participe, aux côtés de la Banque des Territoires et de l'Anah, au cofinancement de ces postes qui peut s'élever à 75 % du coût chargé annuel du poste ;
- le cofinancement de 4 000 postes de conseillers numériques, à hauteur de 50 000 euros par an. Ils sont répartis dans les collectivités locales qui ont un rôle clé pour faciliter l'accès aux démarches administratives et pour former la partie de la population en difficultés face aux systèmes numériques et dématérialisés.
Il est assez délicat d'obtenir une lisibilité parfaite sur ces dispositifs et crédits d'ingénierie.
À ce propos, dans son rapport de février 202454(*), Bernard DELCROS estimait que la lisibilité financière des programmes pilotés par l'ANCT était à parfaire. Les dispositifs que conduit l'Agence sont nombreux et variés et les modalités de financement sont aussi d'une grande diversité, engageant les crédits de nombreuses missions du budget de l'État.
Le rapporteur spécial précisait alors
: « dans certains cas, les crédits sont
intégrés au budget de l'Agence, comme par exemple pour les
maisons "France services" au travers de la subvention pour charges de
service public. Dans d'autres cas, l'Agence pilote des programmes dont les
financements ne transitent pas par son budget, ce qui a pour effet de disperser
l'information financière. Il ne s'agit pas pour moi de militer pour une
intégration dans le budget de l'Agence des crédits de tous les
programmes qu'elle pilote, mais simplement de défendre l'idée que
nous devons disposer d'une meilleure information et d'une meilleure
lisibilité financière de l'ensemble des programmes. Elle serait
utile pour comprendre la globalité des crédits affectés
par l'État aux actions mises en oeuvre ou pilotées par l'Agence.
Ainsi, nous pourrions mieux faire le lien entre ces actions et leur impact sur
le
territoire » (...). Les élus doivent disposer d'une
parfaite connaissance des moyens engagés par l'État au titre de
l'ensemble des programmes confiés à
l'Agence »55(*).
Pour y remédier, la Cour des comptes, dans son
rapport56(*) de
février 2024, suggérait une adaptation du document de
politique transversale consacré à l'aménagement du
territoire qui pourrait ainsi présenter une synthèse
financière pour chacun des programmes nationaux.
Les rapporteures souscrivent également à cette proposition, notamment pour donner la visibilité aux dispositifs porteurs d'ingénierie, indispensables pour mener à bien les projets.
c) Avant la dissolution de l'Assemblée nationale, des moyens préservés des coupes budgétaires
Stanislas BOURRON déclarait lors de son audition
à la commission de l'aménagement du territoire et du
développement durable : « en ce qui concerne les
économies budgétaires, l'Agence n'a subi aucune annulation de
crédits. Grâce au vote du Parlement, les crédits du
programme 112 "impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire" et du
programme 147 "politique de la ville" sont même en
augmentation. Les annulations et les gels portent, en effet, essentiellement
sur des crédits non utilisés, de surcroît
complémentaires. Nous sommes donc en mesure de mener la plupart de nos
opérations, d'autant que les crédits de la politique de la ville
ont fortement
augmenté »57(*).
Les rapporteures seront attentives à trois éléments :
- la loi de règlement du budget.
Il s'agira de s'assurer que cette
non-réduction des
crédits en cours d'exécution a bien été suivie
d'effets ;
- les annonces de réductions drastiques du « Fonds vert ». Il convient de rappeler qu'il bénéficie aux collectivités territoriales et surtout qu'il permet de financer de l'ingénierie indispensable pour mener à bien les projets, notamment par des collectivités qui sont peu dotées en moyens propres ;
- les futures mesures d'économie qui seront sans doute au programme de la loi de finances pour l'année 2025.
3. Un appel à animer les acteurs de l'ingénierie locale
Même si ces points ont déjà été présentés, il convient de rappeler que l'intervention de l'Agence vise aussi à animer l'ingénierie locale.
À ce titre, elle est supposée recenser les acteurs de l'ingénierie territoriale, animer les CLCT, mettre en place un guichet unique d'aiguillage des demandes, organiser des forums locaux de l'ingénierie, etc.
B. L'AGENCE CONTRIBUE TRÈS PEU À RENFORCER LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE LOCALE
1. La problématique du renforcement de l'ingénierie locale reste entière
a) Les prestataires d'envergure locale sont assez peu représentés dans le marché 2020-2024
Le rapport sénatorial initial mettait en évidence que le choix de recourir à des prestataires privés pour faire face aux besoins d'ingénierie était une solution qui se discutait.
Certes, le recours à des prestataires établis permet, dans les cas où l'ingénierie fait défaut localement, de pouvoir apporter un niveau d'expertise non disponible à l'échelle départementale et pour autant indispensable.
En revanche, le recours à ces prestataires établis pénalise l'ingénierie de proximité, implantée sur le terrain, au fait des rouages et des contextes locaux, pouvant capitaliser sur ses acquis. L'ingénierie de proximité perd ainsi une occasion de se développer. Pour ces structures, pouvoir accéder au marché d'ingénierie nationale de l'ANCT reste difficile sauf à se constituer en groupement.
Comme le rappelait la Cour des comptes dans sa
communication à la commission des finances du Sénat
intitulée « L'ANCT : un outil à
consolider » transmise en février 2024, l'Agence
« a passé 76 marchés en 2021 et 69 en 2022, sans
compter les recours à des centrales d'achat, pour un montant total de
dépenses de 47,4 millions d'euros en 2022 (...). L'ANCT recourt
fréquemment à des prestations intellectuelles, qui ont
représenté 7,5 millions d'euros en 2021 et
11,6 millions
d'euros en 2022. La plupart de ces marchés sont passés sous la
forme d'accords-cadres, divisés pour certains en lots. Les cahiers des
charges de ces marchés définissent des prestations
standardisées, dont les prix sont fixés par des bordereaux de
prix unitaires. Sur cette base, les bons de commande sont émis en cas de
besoin. Ces achats de prestations intellectuelles devraient être
précédés d'une meilleure définition quantitative du
besoin, et préciser dès la publication le volume
prévisionnel du besoin, ou a minima une fourchette. Le
critère prix pourrait être davantage pris en compte dans les
attributions, et sa pondération explicitée dans l'analyse des
offres »58(*).
Les rapporteures se sont intéressées aux prestataires retenus sur le marché d'ingénierie de l'ANCT (période 2020 - 2024) pour mieux cerner les structures retenues - qui bénéficiaient donc des crédits de l'Agence - par l'appel d'offres.
Deux classements sont plutôt parlants.
Classement par chiffre d'affaires des prestataires
retenus sur les
lots du marché d'ingénierie de
l'ANCT
|
Montant du chiffre d'affaires du prestataire |
Nombre de prestataires concernées |
Exemple de prestataire |
|
plus de 50 millions d'euros |
6 |
Egis Conseil, Ernst & Young Advisory, CGI Business Consulting... |
|
de 10 à 50 millions d'euros |
8 |
Setec Organisation, Espelia, Biotope... |
|
de 5 à 10 millions d'euros |
3 |
Rouge Vif... |
|
de 1 à 5 millions d'euros |
8 |
Plateau urbain, Mensia Conseil, Idate... |
|
moins de 1 million d'euros |
16 |
CERUR, O + Urbanistes, COOP TIERS LIEUX... |
Source : Sénat sur la base des
éléments transmis par l'ANCT
Classement par lieu de siège social des
prestataires retenus sur
les lots du marché d'ingénierie de
l'ANCT
|
Régions |
Nombre de prestataires |
|
Île-de-France |
21 |
|
Autres régions |
20 |
Source : Sénat sur la base des
éléments transmis par l'ANCT
Malgré un certain soin apporté à constituer des lots régionaux et une attention pour retenir des prestataires de taille modeste, les structures de taille importante sont plus susceptibles d'être retenues. Pour être juste, il convient de constater que les prestataires d'envergure modeste, souvent à rayonnement local, sont aussi présents.
Cette analyse est issue de l'accord-cadre de prestations
d'ingénierie de l'Agence, conclu pour la période
2020-2024. Cet accord comprenait
36 lots : 27 lots
mono-attributaires et 9 multi-attributaires. Pour ces derniers, les bons de
commande sont attribués à tour de rôle.
L'ANCT a travaillé en 2024 sur le nouveau
marché d'ingénierie en tenant compte de ces 4 ans
d'expérience. Ce nouvel accord-cadre de prestations d'ingénierie
a modifié le format des lots (lots régionaux revus) et leur
contenu (en allant plus loin sur l'ingénierie
pré-opérationnelle). Il est désormais composé de 26
lots - régionaux (14) ou thématiques
nationaux (12) - pouvant
utilement être combinés afin de répondre aux besoins des
collectivités. La notification de l'accord-cadre et son début
d'exécution devraient intervenir au plus tard en janvier 2025.
Le directeur général de l'Agence déclarait à ce sujet, lors de la plénière de la délégation, qu'« au niveau national, le marché de l'ingénierie est en train d'être renouvelé, avec des lots régionaux qui permettent de répondre à cette demande locale bien légitime »59(*).
Il conviendra de vérifier quelles seront les caractéristiques des prestataires retenus dans le nouveau marché.
b) Le soutien direct à des structures locales est encore marginal
Le précédent rapport du Sénat mettait en avant plusieurs exemples qui démontraient qu'un soutien à la structuration de l'ingénierie locale était moins coûteux, plus pérenne et plus apprécié que le recours à des consultants privés, disposant d'une expertise mais souvent déconnectés des problématiques locales.
En effet, le soutien à l'ingénierie ne doit pas forcément passer par le recours à un prestataire privé externe. Parfois, passer un marché pour réaliser une action est plus onéreux que de recruter un agent au sein d'une structure locale qui permet de répondre à des besoins identifiés.
À défaut de soutenir les acteurs locaux,
l'offre de l'Agence pourrait être mieux articulée avec ces
derniers. Mais cela ne semble pas être le
cas, comme le relève
la Cour des comptes, dans son rapport de
février 202460(*) :
« contrairement à ce qu'affichaient les intentions
initiales, selon lesquelles 90 % des demandes devaient trouver une
réponse locale, l'offre de l'ANCT est insuffisamment articulée
avec les autres offres existantes offertes par les départements et
parfois par les intercommunalités. Pourtant, les CLCT, associant les
élus locaux et les représentants des structures intervenant dans
le champ de l'ingénierie, devraient avoir vocation à constituer
le cadre, qui permettrait aux préfets d'assurer cette coordination et de
fédérer les acteurs. Ce n'est cependant le cas que dans une
minorité de départements »61(*).
Renforcer cette articulation passera donc, notamment, par
les
CLCT. Au-delà, il serait souhaitable que le préfet puisse
aussi soutenir, par le biais d'une subvention
accompagnée d'une convention triennale par exemple, la mise en place
d'une forme d'ingénierie qui fait défaut au sein d'une structure
d'ingénierie locale. Par le biais de cette subvention, la structure
pourrait recruter une nouvelle compétence ou développer une
activité pertinente localement.
L'Agence a signalé aux rapporteures qu'elle était attentive à ce type de solutions. Elle indique également, dans le cadre de la réflexion sur le devenir et la capitalisation des programmes, tenir compte des exemples où les chefs de projets sont particulièrement positionnés dans une posture mutualisée.
Si le rapport du Sénat avait identifié quelques exemples pertinents, l'Agence pourrait missionner ses chargés de mission territoriaux pour recenser, en lien avec les délégués territoriaux, les situations de soutien aux acteurs locaux de l'ingénierie, afin de capitaliser et de diffuser les solutions qui lui semblent les plus pertinentes.
2. Le guichet unique à la main du préfet devra absolument fonctionner par subsidiarité pour ne pas désorganiser les circuits qui fonctionnent déjà
Pour rappel, la circulaire interministérielle du 28 décembre 2023 adressée aux préfets demande notamment :
- la mise en place d'un guichet unique local d'ingénierie, sous forme d'un mail de type « ingenierie@departement.gouv.fr ». L'objectif affiché est de centraliser en un point unique les demandes d'ingénierie des collectivités ;
- la mise en place d'une animation de l'ingénierie « sous votre autorité [l'autorité du préfet] et le pilotage opérationnel du secrétaire général de la préfecture ».
Cette consigne suscite deux interrogations principales de la part des rapporteures.
D'une part, dans des départements où les acteurs sont identifiés, où les circuits fonctionnent, il n'est pas sûr qu'un guichet unique qui centralise les demandes et donne aux services de l'État le rôle d'« aiguilleurs », soit une solution optimale.
La circulaire précise en effet
« qu'un grand nombre d'élus a accès de
lui-même et sans difficulté à l'appui en
ingénierie dont il a besoin pour conduire ses projets. Toutefois, pour
les élus qui ne trouveraient pas spontanément de réponse
à leur besoin, nous devons leur permettre d'être orientés
facilement vers le dispositif ou l'opérateur susceptible de les
appuyer ». Le directeur général de l'ANCT a tenu
à préciser que ce guichet unique serait un point
d'entrée pour les élus qui ne savent pas orienter leur demande.
Autrement dit, c'est un fonctionnement par
subsidiarité.
Il conviendra de veiller à ce que cette logique de subsidiarité soit bien respectée en pratique, et qu'elle ne débouche pas sur une logique de centralisation.
Ce fonctionnement porte le risque que ce guichet unique soit en réalité un aiguillage, qui permette de diriger essentiellement, voire exclusivement, les demandes en matière d'ingénierie vers les agences de l'État (Cerema, ADEME) ou les organismes retenus dans le cadre des marchés publics de l'ANCT.
Dans un contexte financier qui va se tendre et un marché qui risque de se contracter, il sera important que, dans chaque département, les demandes d'ingénierie puissent être identifiées par tous les acteurs, particulièrement les acteurs de l'ingénierie locale, et ne soient pas « accaparées » par les agences de l'État.
D'autre part, il est légitime de se demander quelle place tiendront les collectivités et les élus locaux dans cette animation alors qu'ils ne sont même pas cités. Ces derniers sont souvent très impliqués dans l'ingénierie territoriale, comme par exemple au sein des agences techniques départementales, et il serait contreproductif de ne pas en tenir compte.
Le directeur général de l'ANCT signale que ce dialogue entre préfecture et élus s'effectue dans les CLCT, qui sont parfois informellement co-présidés par des élus locaux.
Aussi, les rapporteures prennent acte de ces éléments mais restent vigilantes sur la façon dont vont se mettre en oeuvre ces mesures dans les mois à venir.
C. SYNTHÈSE DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT DU SÉNAT
Finalement, les rapporteures estiment que les recommandations suivantes ont été plutôt bien intégrées par l'ANCT et suivies d'actions significatives qui vont dans le sens préconisé par le Sénat :
- conforter l'outil CRTE, élargi notamment à la dimension sociale, comme cadre de référence de la mise en oeuvre des politiques publiques de l'État (recommandation n° 12) ;
- créer une interface numérique
pédagogique sur le « qui fait
quoi ? »
(recommandation n° 11) ;
- positionner le sous-préfet d'arrondissement comme interlocuteur de 1er niveau sur les questions d'ingénierie : orientation des élus et relai des offres (recommandation 2.a) ;
- doter le préfet de moyens humains et financiers en matière d'ingénierie et doter l'Agence d'une ingénierie propre mobilisable sur le terrain (recommandation n° 9) ;
Pour la recommandation n° 7 (terminer les recensements départementaux de l'ingénierie), les rapporteures ont bien noté les efforts de l'Agence pour convaincre et relancer les préfets, mais estiment que l'objectif n'est pas encore complétement atteint.
Pour la recommandation n° 10 (instituer un comité de direction commun régulier entre l'ANCT, l'ADEME et le Cerema), les rapporteures ont bien noté une différence d'appréciation avec l'ANCT et maintiennent leur recommandation.
Pour la recommandation n° 14 (engager un dialogue pour intégrer les Conseils régionaux dans le fonctionnement de l'Agence), les rapporteures ont également noté des divergences d'appréciation et appellent les partenaires à poursuivre leurs échanges pour mieux coordonner leurs actions respectives.
Pour la recommandation n° 13 (identifier et valoriser les dynamiques de coopération entre territoires), les rapporteures ont bien noté une différence d'approche de l'Agence qui semble plus attentive à ce type de dynamique locale. Elles appellent l'Agence à poursuivre la réflexion pour valoriser dans ses programmes, y compris financièrement, les collectivités qui s'engagent dans des coopérations, des mutualisations et des approches collectives.
Pour la recommandation n° 8 (sur les territoires
où la dynamique d'animation et de structuration de l'ingénierie
locale a fait défaut, encourager le préfet à l'impulser,
notamment via les CLCT), les rapporteures notent la relance de la
dynamique des CLCT dans les territoires, même si ces
comités
regroupent des réalités très différentes d'un
département à
l'autre. Elles appellent à poursuivre la
diffusion des bonnes pratiques et à la capitalisation
d'expérience en la matière. Elles invitent à s'appuyer sur
les circuits qui fonctionnent déjà et soulignent l'importance de
reconnaitre le rôle des élus locaux et des diverses structures
d'ingénierie dans lesquelles ils s'investissent, dans l'animation des
acteurs de l'ingénierie locale.
Enfin, les rapporteures ont bien noté que la recommandation n° 6 (étudier la proposition « 1% ou 1%o ingénierie » envisagée comme un fonds national alimenté par les collectivités pour les collectivités) qui s'adressait à la DGCL, n'a pas été suivie d'effet, ce qu'elles regrettent.
EXAMEN EN DÉLÉGATION
Lors de sa réunion du 7 novembre 2024, la délégation aux collectivités territoriales a autorisé la publication du présent rapport.
M.
Bernard Delcros, président. -
Le 2 février 2023, notre délégation
adoptait à l'unanimité le rapport « ANCT : se
mettre au diapason des élus
locaux ! » de
Céline Brulin et Charles Guené. Ce compte rendurapport dressait
un premier bilan de l'action de l'Agence nationale de cohésion des
territoires (ANCT) du point de vue des élus locaux, trois ans
après sa mise en place. Le document avançait
14 recommandations visant à améliorer la proximité de
l'Agence avec les élus locaux et l'efficacité de son action.
Environ 18 mois plus tard, la délégation a
souhaité évaluer la prise en compte de sces recommandations. Ce
travail de suivi a été confié à
Sonia de La
Provôté et Céline Brulin.
Ce « droit de suite » s'inscrivait lui-même dans la mise en oeuvre des recommandations du rapport dit « Gruny » qui visaitpour un meilleur contrôle parlementaire des travaux du Gouvernement.
Pour effectuer ce suivi, les travaux de nos collègues ont débuté par une table ronde, le 23 mai dernier, en présence de la Direction générale des collectivités locales (DGCL), de la DMATES et de l'ANCT. Le compte rendu de cette table ronde a constitué un rapport d'étape.
Nos collègues Sonia de La Provôté et Céline Brulin ont poursuivi leur travail et présentent ce matin leurs conclusions.
Mme Sonia De La Provôté, rapporteure. -Merci Monsieur le présidenNous tenons d'abord à remercier Mayeul Placès pour sa vigilance et son écoute dans la réalisation de ce rapport qui revêt beaucoup d'importance, de surcroît dans le contexte actuel. Nous avons été chargées avec Céline Brulin de réaliserd'exercer ce fameux « droit de suite » du rapport de février 2023, intitulé « ANCT : se mettre au diapason des élus locaux ! ». Notre mission a consisté à examiner les 14 recommandations du rapport initial pour évaluer leur mise en oeuvre, qu'elle soit totale, partielle ou inexistante. L'objectif n'était pas de refaire le rapport initial, déjà très complet, ni même de porter un jugement en tant que tel sur l'ANCT, mais plutôt de contrôler l'application des recommandations du Sénat.
Cette clarification est importante, car certains collègues sont sensibles à la question de l'impact concret de l'ANCT. Lorsqu'une recommandation a été suivie d'effets, nous pouvons nous en féliciter collectivement, car le but de notre travail est d'influer sur les décisions. Cependant, dire qu'une recommandation a été suivie d'effets, ne revient pas pour autant à donner un blanc-seing à l'Agence.
Vous avez rappelé, Monsieur le président,
la table ronde du
23 mai dernier. Nous avons poursuivi le
travail avec l'ANCT et interrogé ses partenaires. Nous nous sommes aussi
appuyés sur le travail de la Cour des comptes qui a examiné le
fonctionnement de l'Agence en février 2024, soit un an après
notre rapport. Une audition de la commission des Finances du Sénat
pour suite à donner sur ceCe contrôle sur la mise en place
etrelatif à la viabilité de l'ANCT, effectué à la
demande de la commission des finances du Sénat, a donné lieu
à une audition pour suite à donner, ayant elle-même
donné lie, a aboutiu à un rapport d'information de notre
président, Bernard Delcros.
Ce rapport iIntitulé « L'ANCT, une
agence à consolider au service des
territoires » ce
rapport a aussi permis de poursuivre ced'approfondir le suivi exigeant de
l'Agence par le Sénat.
Notre présentation se concentrera sur deux thèmes principaux. Premièrement, bien que l'Agence ait fait des efforts pour améliorer sa notoriété, elle reste difficilement accessible et lisible, notamment pour les élus des petites communes. Deuxièmement, malgré une amélioration de son offre d'ingénierie, l'Agence contribue encore peu au renforcement des acteurs de l'ingénierie locale ou, du moins, à unela coopération pour permettant d'éviter les doublons.
Mme Céline Brulin, rapporteure. - Le rapport de 2023 soulignait que l'Agence, bien qu'appréciée par ses bénéficiaires, restait méconnue de la plupart des élus locaux. Une consultation sur la plateforme du Sénat avait révélé que plus de la moitié des élus ayant participé à la consultationrépondants ignoraient son existence.
Le rapport avait également pointé l'implication variable des préfets, pourtant délégués territoriaux de l'Agence, certains ne l'intégrant pas du tout localement. Suite àÀ la suite deSuite à ces constats, plusieurs recommandations avaient été formulées pour améliorer la visibilité et l'accessibilité de l'Agence, afin qu'elle soit plus à même de remplir ses missions. Le suivi de ces recommandations se décline en trois points.
Premièrement, l'Agence a bien intégré la nécessité d'être mieux identifiée, plus proche du terrain et d'aller à la rencontre des élus locaux.
Elle a élaboré une nouvelle feuille de route, entièrement remaniée par rapport à celle de 2020. Ce document a été adopté à l'unanimité par son conseil d'administration en juin 2023, lequel comprend plusieurs élus locaux représentant les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette feuille de route fait désormais écho, tant sur sa forme que sur ses objectifs stratégiques, aux recommandations du précédent rapport de la délégation.
Conformément aux souhaits exprimés par la délégation, l'Agence a pris plusieurs initiatives pour se rapprocher des élus locaux dont :
l'organisation de « l'ANCTour » au Palais des Congrès de Paris (2023) et en Occitanie (2024). ; Elle a organisé plus de 60 déplacements du nouveau président et du nouveau directeur général réalisés dans les territoires avant l'été 2024. Elle a assuré une présence systématique aux congrès des associations nationales d'élus et à certains congrès départementaux. Enfin, elle a mis en oeuvre 74 forums départementaux d'ingénierie à ce jour.
En matière de communication, l'Agence a déployé une stratégie plus claire et plus lisible envers ses délégués territoriaux. Elle a diffusé un kit de communication aux préfets. Elle a créé un webinaire de présentation rappelant ses missions et dispositifs. Elle diffuse régulièrement depuis janvier 2024 une « newsletter ANCTerritorial » à tous les délégués territoriaux et leurs adjoints pour faciliter la circulation des informations. Elle s'est engagée à faire évoluer d'ici début 2025 son site Internet en un portail de services centré sur les besoins des utilisateurs. Enfin, l'Agence prépare une courte brochure destinée aux élus n'ayant aucune connaissance de l'ANCT, disponible pour le prochain Congrès des maires de novembre 2024.
Sur ces points, les recommandations de la délégation ont donc été plutôt bien suivies, même si tous les chantiers ne sont pas encore totalement aboutis et nécessiteront des efforts renouvelés dans le temps.
Il est aussi logique, qu'avec les années, l'Agence gagne en notoriété, d'autant plus que son démarrage était intervenu dans le contexte particulièrement défavorable de la crise sanitaire, qui avait rendu impossible tout déplacement sur le terrain.
Mme Sonia De La Provôté, rapporteure. - Le deuxième point concerne l'incarnation locale de l'Agence. Le rapport de 2023 a mis en lumière deux sujets essentiels.
D'une part, le déficit de communication de l'Agence vers ses délégués territoriaux, les préfets. Le rapport préconisait l'envoi d'une circulaire pour clarifier ce qui était attendu et les objectifs qui étaient fixés aux délégués territoriaux. Cette recommandation a été suivie d'effets, puisqu'une circulaire interministérielle a été adressée aux préfets le 28 décembre 2023. Cette instruction remobilise les préfets, en tant que délégués territoriaux de l'ANCT, autour de quatre objectifs précis. Il leur revient de mettre en place, dans chaque département, d'un outil d'animation de l'ingénierie locale existante, un comité local de cohésion territoriale ou une autre formule, de finaliser de la carte de l'ingénierie départementale d'ici au 1er mars 2024. Ils doivent également instaurer un guichet local de l'ingénierie, point d'entrée unique des demandes et organiser chaque année un forum local de l'ingénierie.
Si la délégation a été entendue, dans les intentions, certains aspects restent à finaliser.
Par exemple, l'inventaire de l'ingénierie départementale, rappelé dans la circulaire, n'est toujours pas achevé dans tous les départements quatre ans après la mise en place de l'Agence, alors qu'il figurait parmi les missions prioritaires pour identifier les doublons, les redondances ou la concurrence.
D'autre part, le rapport de 2023 avait mis en évidence le manque de chargés de mission territoriaux. Ces derniers, qui font l'interface entre le terrain et les services internes de l'ANCT, étaient en nombre insuffisant pour assurer un fonctionnement correct. L'Agence a obtenu la création de postes nécessaires, permettant d'augmenter significativement le nombre de chargés de mission territoriaux. La délégation a donc été entendue.
Mme Céline Brulin, rapporteure. - Troisièmement, malgré les efforts déployés, l'offre de l'ANCT ne bénéficie qu'à un nombre limité de collectivités et peine à atteindre les élus des petites communes.
Bien que les collectivités
bénéficiaires soient généralement satisfaites ou
très satisfaites, les dispositifs de l'Agence se concentrent sur un
nombre restreint d'entre elles. Ainsi, parmi les programmes
emblématiques, « Action coeur de
ville » concerne 244 villes moyennes ;
« Petites villes de demain » touche
1 644 territoires regroupant des communes de moins de 20 000
habitants et « villagesVillages d'avenir »
labélise 2 458 communes. Il en va de même pour les
prestations d'ingénierie sur mesure qui ont, quant à elles,
bénéficié à environ
1 800 collectivités en quatre ans.
Ces chiffres doivent être mis en perspective avec le budget modeste de l'Agence qui s'élève à environ 200 millions d'euros. Une analyse plus détaillée révèle que les grandes villes et les villes moyennes sont plutôt bien couvertes par ses programmes. En matière d'ingénierie sur mesure, l'ANCT indique que la quasi-totalité des demandes qui lui sont adressées, et qui sont en phase avec ses missions, trouvent une solution. Dans certains territoires, l'Agence dit ne recevoir aucune sollicitation. Cependant, l'ensemble de ces chiffres, ramené aux 34 935 communes et 1 254 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) révèle que le nombre de collectivités soutenues reste très modeste. L'écart est particulièrement marqué pour les communes rurales, avec seulement 2 500 « vVillages d'avenir » sur 30 000 communes rurales, selon la définition de l'Insee. Nous avons finalement le sentiment que la politique d'aménagement du territoire se fait par « saupoudrage » et par « petites touches impressionnistes ». En effet, l'ANCT peine à transformer des réussites localisées en une politique plus vaste.
Cette problématique du « passage à l'échelle » nous interroge sur la priorité à fixer à l'Agence dans les années à venir. Trois options peuvent être envisagées. Premièrement, certains souhaitent une pause dans le développement des missions de l'Agence pour lui laisser le temps s'adapter, de conforter ses missions actuelles et de consolider ses réussites. Deuxièmement, d'autres aimeraient qu'elle élargisse encore son champ d'action pour devenir l'intermédiaire de référence sur l'ensemble des sujets relatifs à l'aménagement du territoire. Enfin, troisièmement, certains préféreraient la disparition pure et simple de l'Agence. Il resterait alors à définir quels services de l'État prendraient le relais et avec quels moyens. Monsieur le président, dans votre rapport intitulé « L'ANCT, une agence à consolider au service des territoires », vous plaidiez pour la première option, celle d'une pause. Nous pensons aussi que cette phase de consolidation permettrait à l'Agence de renforcer sa transversalité et son action interministérielle afin qu'elle s'impose bien au-delà de ses compétences et programmes actuels comme la structure pilote des questions d'aménagement du territoire, garante de la cohérence des politiques de l'État et porteuse d'une vision globale et transversale. Autrement dit, un temps de pause permettrait de consolider ses réussites et de travailler à un « passage à l'échelle » sur certains sujets, grâce à une intervention interministérielle plus coordonnée.
Mme Sonia De La Provôté, rapporteure. - Le second thème de cette présentation a trait à l'intervention de l'ANCT en matière d'ingénierie. Nous savons tous que la notion « d'ingénierie » recoupe des besoins et des domaines très différents : maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, conduite de projets, expertise financière, culturelle, administrative ou encore technique, ingénierie en matière de portage foncier, etc. L'ANCT s'est positionnée sur « l'ingénierie amont » visant à définir, faire émerger, formaliser et cadrer les projets : diagnostics, projets de territoire, études de faisabilité ou de définition d'un projet, conduite d'une concertation ou intégration du volet participation des habitants, mais aussi recherche de financements.
Le rapport de notre délégation était très critique sur l'articulation entre ingénierie de l'État et ingénierie territoriale. Les interventions de l'ingénierie d'État étaient souvent perçues comme redondantes ou concurrentes, rarement en soutien des acteurs locaux. L'Agence était parfois accusée de générer des effets contre-productifs, en intervenant en décalage avec les équilibres locaux ou en se substituant à leurs acteurs. Le recours fréquent à des bureaux de consultants privés est parfois adapté, mais ne contribue pas au renforcement de l'écosystème local et peut créer de la confusion. La délégation avait formulé plusieurs recommandations visant à améliorer l'articulation entre les différents acteurs. L'objectif était de rendre l'ingénierie des opérateurs de l'État plus cohérente et de la positionner en soutien des acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés, là où le besoin se fait sentir.
Le suivi de ces recommandations peut se résumer en quatre points. Les deux premiers sont présentés par Céline Brulin.
Mme Céline Brulin, rapporteure. - En réponse au caractère parfois confus des interventions des différentes agences de l'État en matière d'ingénierie, avec des doublons, voire de la concurrence, l'Agence a déployé plusieurs actions. En 2023, elle a entièrement renouvelé ses conventions quadriennales avec ses partenaires, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), l'ADEME, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), et la Banque des territoires (BdT)) avec des engagements plus clairs. Elle a également produit une brochure intitulée « Qui fait quoi ? », examinée le 23 mai dernier, présentant les ingénieries des six grands opérateurs de l'État.
Sur ces sujets, la situation est encore loin d'être satisfaisante. Pour ne mentionner qu'un exemple, la lecture du « Qui fait quoi ? » illustre la dispersion des compétences entre les opérateurs de l'État : sur les 80 cases du tableau projeté à l'écran, 65 renseignent qu'un, deux, trois, quatre et jusqu'à cinq opérateurs sont compétents sur un même sujet. Cette observation peut être interprétée comme un signe inquiétant de dispersion des compétences, voire de doublons et de concurrence potentielle. Les recommandations de notre précédent rapport ne sont que partiellement suivies sur ce point.
Deuxièmement, les CRTE avaient vocation à fédérer les élus autour d'un projet de territoire et de servir de socles aux projets à développer. Le rapport de 2023 soulignait le caractère étriqué des CRTE, cantonnés aux sujets écologiques et à quelques thèmes relatifs aux équipements structurants. Cette recommandation a été suivie d'effets, comme en témoigne la nouvelle instruction interministérielle pour la relance des CRTE, signée le 30 avril dernier. Celle-ci confirme la dimension transversale des CRTE en intégrant les thèmes de la cohésion sociale, conformément au souhait exprimé dans notre rapport.
Mme
Sonia De La Provôté,
rapporteure. - Troisièmement,
malgré l'augmentation significative de l'enveloppe
consacrée à l'ingénierie, de
20 à 40 millions
d'euros entre 2023 et 2024, force est de constater que l'Agence contribue
très peu à renforcer les acteurs de l'ingénierie locale.
Cette enveloppe finance certes des postes, notamment dans le programme
« vVillages d'avenir », mais le marché de
l'ANCT est la plupart du temps sollicité pour les demandes s'adressant
à l'Agence.
Les montages permettant le soutien direct à des structures locales restent encore trop rares. Or, l'accès au marché d'ingénierie nationale de l'ANCT demeure difficile pour les petites structures, sauf à se constituer en groupements. Une analyse détaillée du marché d'ingénierie de l'ANCT sur la période 2020-2024 révèle que les prestataires sont souvent des cabinets d'envergure plutôt nationale (chiffre d'affaires, effectifs, etc.) avec un siège social souvent situé en région parisienne. Il ressort que 21 des prestataires retenus par l'ANCT ont leur siège social en Île-de-France contre 20 seulement dans d'autres régions. Nous soulignons à nouveau la nécessité pour l'ANCT d'inventer des modalités d'intervention pour soutenir les acteurs locaux de l'ingénierie. Ce sont eux qui connaissent le mieux les territoires.
De plus, l'Agence doit concentrer ses moyens dans les départements les plus en difficulté. Certains n'ont que peu ou pas besoin de l'ANCT, il faut avoir la lucidité de le reconnaître. L'ingénierie de l'État est nécessaire sur des sujets spécifiques et complexes tels que la dépollution, la gestion des déchets et de l'eau, domaines où les compétences locales sont souvent insuffisantes.
Quatrièmement, il faut revenir sur la circulaire que nous évoquions au début de notre présentation. Un de ses quatre objectifs est la mise en place d'un guichet unique local d'ingénierie, sous la forme d'une adresse mail du type ingenierie@departementale.gouv.fr. Si l'on en croit la circulaire, ce guichet doit fonctionner en subsidiarité, et non dans une logique de centralisation qui désorganiserait les territoires où les choses fonctionnent bien. Il s'agit en effet d'un point d'entrée pour les élus qui « ne trouveraient pas spontanément de réponse à leur besoin ».
Il ne faudrait pas que ce guichet unique soit, en réalité, un aiguillage destiné à diriger essentiellement, voire exclusivement, les demandes en matière d'ingénierie vers les agences de l'État (Cerema, ADEME, etc.) ou les organismes retenus dans le cadre des marchés publics de l'ANCT. Dans un contexte financier qui va se tendre et un marché qui risque de se contracter, il sera important que, dans chaque département, les demandes d'ingénierie puissent être identifiées par tous les acteurs, et que ces demandes ne soient pas « accaparées » par les agences de l'État.
Enfin, il est légitime de se demander quelle place tiendront les collectivités et les élus locaux dans cette animation alors qu'ils ne sont même pas cités dans la circulaire. Or, ces derniers sont souvent très impliqués dans l'ingénierie territoriale, par exemple, au sein des agences techniques départementales : il serait contre-productif de ne pas en tenir compte.
Ces points de vigilance nous incitent à rester attentives à la mise en oeuvre de nos recommandations dans les mois à venir.
Mme Céline Brulin, rapporteure. - Sur les quatorze recommandations du rapport de 2023, sept ont plutôt été suivies d'actions significatives par l'ANCT ou la DGCL et vont dans le sens préconisé par la délégation. Deux sont en cours de mise en oeuvre. Trois autres connaissent une mise en oeuvre contrastée, voire insatisfaisante. Enfin, deux recommandations n'ont pas été suivies d'effets.
Mme Sonia De La Provôté, rapporteure. - Enfin, un dernier point de vigilance lié au contexte financier ne saurait être ignoré.
Comme nous l'avons rappelé, les
crédits d'ingénierie de l'ANCT ont été
doublés par la loi de finances pour 2024 et portés à
environ d'environ
40 millions d'euros. Avant la dissolution, le directeur
général de l'ANCT nous assurait que l'Agence n'avait subi aucune
annulation de crédits en
2024. Cependant, dans un contexte de
recherche d'économies, des inquiétudes persistent quant à
l'avenir, le budget de l'Agence étant jugé très modeste au
regard des ambitions fixées. Il conviendra donc de rester attentif.
Nous déplorons la diminution annoncée du « Fonds vert » qui permet de financer de l'ingénierie utile pour accompagner les collectivités dans les territoires. La réduction des moyens d'ingénierie entraînera inévitablement une diminution du nombre de projets. On ne peut se permettre d'avoir des doublons, ne serait-ce que pour préserver la dépense publique.
M. Hervé Gillé. - Merci pour ce compte- rendu et ce suivi très intéressants qui mériteraient d'être diffusés auprès du public et directement communiqué aux parties prenantes. Je suis surpris de constater que l'ingénierie proposée par l'Agence demeure très insuffisante en termes de complémentarité avec l'ingénierie territoriale.
CCette situation est inacceptable et révèle
une incapacité à travailler sous forme de « bourse
de compétences ». Dans l'idéal, cette
« bourse de
compétences » supposerait
un guichet d'entrée et une collecte de l'ensemble des compétences
mobilisables, territoriales et d'État. On essayerait de répondre
au mieux dans le cadre de cette « bourse aux
compétences » aux besoins exprimés. mobiliser les
compétences tant territoriales que nationales afin de répondre au
mieux aux besoins exprimés.
Il est indispensable d'adopter une approche plus souple et agile pour accompagner les collectivités locales. Dans cette logique, nous devrions avoir une Une forme de contractualisation entre avec l'ANCT et devrait être établie avec l'ensemble des collectivités territoriales. Il serait utile d'avoir un . Cela devrait aboutir à un guide desguide des compétences mobilisables à l'échelle des départements et des régions qui pose la question de comment on mutualise et actualise ses compétences pour répondre au mieux aux besoins.
Mme Muriel Jourda. - Il est intéressant de noter que, par le passé, la collaboration avec les ingénieurs de la Direction départementale de l'équipement (DDE) fonctionnait plutôt efficacement, notamment pour les petites communes.
Je m'interroge par ailleurs sur les possibilités de réaliser des économies sur le long terme au regard des nombreuses redondances observées dans le tableau distribué en mai.
Les recommandations ont-elles été hiérarchisées en fonction de leur niveau de priorité ? Si oui, les plus urgentes ont-elles reçu une réponse ?
Mme Patricia Schillinger. - La Direction générale des Finances publiques (Dgfip) offre-t-elle également ses services aux collectivités, cette possibilité étant peu connue des communes ?
M. Patrice Joly. - Les problèmes de superposition et de compétition semblent être davantage présents dans les territoires riches.
Bien qu'initialement sceptique face à cette approche nationale, je constate au contraire une avancée globalement positive dans la prise en compte de l'ingénierie comme un besoin à satisfaire dans la Nièvre, même si l'identification précise des moyens reste un défi. Sans doute, le contact direct entre les élus et les responsables départementaux de l'administration facilite-t-il l'orientation vers les besoins dans les petits départements. Outre les moyens octroyés via les marchés publics signés par l'ANCT, des financements commencent à être mobilisés en faveur d'une ingénierie adaptée aux dossiers présentés.
Le potentiel de l'ANCT en matière d'ingénierie gagnerait donc à être mieux connu des collectivités. Une journée d'information organisée dans mon département a permis de sensibiliser efficacement les élus communaux et intercommunaux aux outils proposés par l'Agence. Ces actions concrètes sur le terrain sont à mon sens plus efficaces que la distribution de plaquettes d'information, qui ne sont pas toujours disponibles au moment opportun.
Par ailleurs, les programmes tels que « Petites villes de demain », « Action coeur de Ville » ou « vVillages d'avenir », sont positifs, car ils favorisent le développement local. Néanmoins, ces initiatives ne pourront jamais se substituer à une véritable politique d'aménagement du territoire, absente depuis plusieurs décennies.
Une approche ascendante est nécessaire, soutenue par des outils comme l'ANCT et des programmes dédiés, à condition qu'ils soient dotés de moyens financiers suffisants, plusieurs programmes, à l'exception d' « Action coeur de ville », n'ayant pas bénéficié de crédits spécifiques. Cette situation crée une disparité entre les communes bénéficiaires de ces programmes et les autres. Les communes non incluses dans ces dispositifs craignent de ne plus avoir accès aux financements traditionnels que sont la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), ou le Fonds vert, désormais priorisés pour les projets inscrits dans ces programmes.
En conclusion, les moyens financiers adéquats doivent être accessibles pour réaliser les projets permis grâce à l'ingénierie, et il est urgent de mettre en place une véritable politique d'aménagement du territoire.
M. Laurent Burgoa. - Vous nous avez indiqué que le budget de l'ANCT pour l'ingénierie avait doublé passant de 20 à 40 millions d'euros. J'aimerais connaître le taux de consommation de ce budget.
Je constate par ailleurs, au sein de mon département du Gard, que les trois quarts des élus ne connaissent pas l'Agence, ce qui m'interroge sur la pertinence de maintenir en place ce type de structure. Je partage enfin totalement l'avis de Muriel Jourda concernant l'efficacité de la DDE par le passé.
Mme Céline Brulin, rapporteure. - Il convient de souligner que les expériences varient considérablement d'un département à l'autre. L'implication des préfets, en tant que délégués territoriaux, est donc essentielle.
Je partage la vision exprimée par Hervé Gillé. Il est en effet surprenant de constater qu'en dépit des difficultés liées à la crise sanitaire, le recensement des acteurs de l'ingénierie locale n'a toujours pas été achevé dans près du tiers des départements
C'est bien ce qui a été dit par la sénatrice mais ce n'est pas ce qui correspond à la réalité. Il y a 21 départements. Donc je propose de supprimer cette précision.
, cette tâche constituant pourtant la mission première de l'ANCT.
Concernant le problème des doublons, un document plus lisible et précis, montrant une réalité moins tranchée que le tableau présenté, nous a depuis été transmis par l'Agence. Néanmoins, ces redondances persistent et pour les éviter, les différentes agences de l'État devraient commencer par se concerter et travailler ensemble. Il s'agit là d'une première étape indispensable. Or, le comité de direction commun à tous ces opérateurs que nous appelons de nos voeux n'a toujours pas été lancé. Cela révèle une réelle difficulté de la part de ces entités à collaborer.
Les crédits d'ingénierie ont été presque entièrement consommés.
Si je partage le point de vue de Patrice Joly sur la nécessité de mettre en place une véritable politique d'aménagement du territoire, je m'interroge sur la pertinence de la confier à une agence de l'État. Cette compétence ne devrait-elle pas rester régalienne ?
Mme Sonia De La Provôté, rapporteure. - Je souhaiterais revenir sur les nombreux atouts et avantages dont disposent les services et opérateurs de l'ingénierie locale. Par leur ancrage territorial, leur connaissance de l'antériorité des territoires et leur capacité à les porter vers l'avenir, ces entités demeurent souvent les mieux placées pour réfléchir efficacement à l'aménagement du territoire. De plus, les acteurs de l'ingénierie locale jouent un rôle crucial dans l'acculturation des élus avec qui ils entretiennent une relation de confiance et de proximité, favorisant une réflexion commune sur des sujets complexes tels que la sobriété foncière. Cette tâche ne peut être menée par une entité nationale telle que l'ANCT. Qu'il s'agisse des agences d'urbanisme, des organismes de portage foncier ou encore des Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), cet ensemble d'acteurs d'ingénierie locale forme un vivier d'intelligence commune dans les territoires, qu'il convient de valoriser et de ne pas évincer au profit d'une intelligence extérieure.
Concernant les marchés publics, les financements destinés à l'ingénierie, bien que partiellement déconcentrés et mis à la disposition des préfets, n'atteignent pas l'ingénierie publique locale. Ces marchés sont pré-attribués par thématiques, ce qui favorise de facto l'arrivée d'une ingénierie externe aux territoires.
Quant au rôle de l'ANCT dans l'aménagement du territoire, la mission de l'Agence semble a priori relever davantage de la démonstration, comme en témoigne le programme « Action coeur de ville ». Ce dispositif, initialement prévu pour 200 villes, aurait pu concerner 600 à 700 villes. Cette approche démontre les limites de l'ANCT en termes d'aménagement du territoire au niveau national. S'appuyer sur le tissu de l'ingénierie locale permettrait d'avoir une vision plus complète et fine des besoins en matière d'aménagement du territoire.
Mme Céline Brulin, rapporteure. - En réponse à la question de Muriel Jourda, les recommandations ont été globalement suivies d'effets, notamment en ce qui concerne le rapprochement avec les élus locaux, l'élaboration d'une feuille de route plus pertinente et la remobilisation des préfets en tant que délégués territoriaux. Cependant, malgré des améliorations significatives, la situation n'est pas encore optimale.
Une autre recommandation, bien que non- prioritaire et relevant davantage de la DGCL, me semble par ailleurs importante. Il s'agit du concept « 1 pour 1000 ingénieries », inspiré du modèle du « 1 % culture », visant à créer un fonds alimenté par les investissements les plus conséquents des grandes collectivités. L'objectif serait de mobiliser des moyens pour soutenir les collectivités plus modestes, selon un principe de ruissellement. Dans le contexte financier actuel, cette piste mériterait d'être approfondie.
Mme Sonia De La Provôté, rapporteure. - Outre l'aspect financier, il est essentiel d'instaurer une concertation régulière entre les acteurs tels que l'ANCT, le Cerema, l'ADEME, l'ANRU, et d'autres organismes similaires. Cette démarche devrait précéder, ou éventuellement se dérouler en parallèle, de la recherche d'une convergence avec l'ingénierie locale.
Si un opérateur étatique est identifié comme plus performant dans la réalisation de l'ingénierie territoriale, cela peut fragiliser et mettre en difficulté des systèmes qui fonctionnent efficacement depuis longtemps. Ces enjeux doivent également être examinés à la lumière des questions budgétaires et financières.
M. Bernard Delcros, président. - Je vous remercie pour votre travail approfondi sur un sujet qui touche le coeur des territoires. Je souhaiterais formuler plusieurs observations. D'abord, la visibilité et l'identification sur le terrain de l'ANCT dépendent largement des préfets dans les départements dont le rôle à ce niveau est crucial. Ce processus ne peut se faire au niveau national à travers des dépliants.
La question des ingénieries revêt
également une importance capitale.
En effet, le creusement rapide
des écarts a pu être constaté entre les grandes
collectivités dotées de services administratifs
d'ingénierie, et les petites collectivités qui manquent de
ressources. Ces dernières se trouvent souvent
désavantagées face aux opportunités offertes par les
appels à projets, notamment ceux lancés par l'État. Pour
répondre à ce défi, des initiatives ont été
mises en place ces dernières années. L'ANCT a
développé des solutions d'ingénierie, soit par le soutien
à des emplois dans le cadre de programmes comme « Petites
villes de demain » ou « vVillages
d'avenir », soit par le biais de marchés à bons
de commande. Ces derniers permettent aux chargés de mission
d'accéder directement à des bureaux d'études
spécialisés sans avoir à lancer des appels d'offres
complexes. Mais, là encore, la connaissance de ces possibilités
dépend des préfets et l'efficacité des dispositifs varie
donc selon les départements.
Le budget alloué à l'ingénierie est passé de 10 millions d'euros initialement à 20 millions l'année dernière, puis à 40 millions en 2024. Cette augmentation concerne à la fois le soutien aux emplois et les marchés à bons de commande.
Les crédits dédiés à l'ingénierie locale doivent être préservés, car ils permettent à de nombreuses petites collectivités d'accéder à des opportunités qu'elles ne pourraient pas saisir autrement. En tant que rapporteur spécial de la mission « Cohésion Cohésion des territoires », je veille d'ailleurs à maintenir un niveau de financement adéquat pour l'ANCT, notamment dans le domaine de l'ingénierie.
D'autres communes devraient pouvoir accéder aux programmes « Villages villages d'avenir ». Par ailleurs, ce dispositif ne doit pas exclure les autres collectivités des investissements prioritaires. Les départements devraient rester vigilants afin d'éviter que ce programme ne devienne la seule ligne directrice.
Comme vous l'avez rappelé, j'avais plaidé dans mon rapport pour une pause dans le développement des missions de l'Agence. J'ai découvert que de nombreuses missions lui avaient été confiées au fil du temps, dont certaines m'étaient inconnues, par exemple le « Plan France Très Haut débit » et des questions liées aux fonds européens. En accumulant trop de missions, l'ANCT risque de ne plus pouvoir effectuer efficacement son travail sur le terrain.
Au-delà de ces mesures, une question essentielle se pose : sommes-nous capables demain de bâtir une vision globale et cohérente d'une politique d'aménagement du territoire, qui ne se limite pas seulement aux aspects matériels, mais inclut aussi les aspects humains ? L'enjeu est de pouvoir afficher une politique durable et inscrite dans le long terme.
Les recommandations sont adoptées.
La délégation adopte, à l'unanimité, le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES REÇUES
- Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) ;
- Direction générale des collectivités locales (DGCL) ;
- Direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur (DMATES) ;
- Régions de France (RF) ;
- Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) ;
- Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).
ANNEXE 1 : RAPPEL DES 14 RECOMMANDATIONS DU RAPPORT
POUR LESQUELLES UN SUIVI EST RÉALISÉ
|
N° |
Recommandations |
Destinataire(s) de la recommandation |
Acteur(s) concerné(s) |
Calendrier prévisionnel |
Support / action |
|
1- RAPPROCHER l'AGENCE DES ÉLUS LOCAUX |
|||||
|
1 |
Échanger en direct avec les élus
locaux sur le bilan et les perspectives de l'Agence, pour
nourrir le débat national
État / territoires et élaborer une
feuille de route stratégique |
Échanges en direct avec les élus locaux : Ministère de la Cohésion des Territoires et
ministère de l'Intérieur (DGCL / * Feuille de route : Président / conseil d'administration de l'ANCT |
Échanges en direct avec les élus locaux : Préfectures, (organisateurs) et ANCT Feuille de route : Direction de l'Agence |
Échanges en direct avec les élus locaux : 1er semestre 2023 * Feuille de route : Finalisation à l'été 2023 |
Échanges en direct avec les élus locaux : Instruction ministérielle demandant l'organisation de rencontres organisées par les préfectures, avec la présence de représentants locaux et nationaux de l'Agence, ouverte aux élus locaux (exécutifs) * Feuille de route : 2023-2026 |
|
2 |
Positionner le sous-préfet d'arrondissement comme interlocuteur de 1er niveau sur les questions d'ingénierie : orientation des élus et relai des offres. Remobiliser les préfets sur leur rôle de délégué territorial (formation, évaluation, instructions du ministère de la Cohésion des Territoires). |
Ministère de la Cohésion des Territoires et ministère de l'Intérieur (DGCL /DMATES) |
DMATES, DGCL, ANCT, corps préfectoral |
Septembre 2023 au plus tard |
Instruction interministérielle : - mobilisation des - désignation d'un - modalités de formation, évaluation, animation, du corps préfectoral |
|
3 |
Doubler le nombre de chargés de mission territoriaux de l'ANCT. |
Ministère de la Cohésion des Territoires (DGCL) |
ANCT |
Courant 2023 |
Préparation budgétaire ou redéploiements |
|
4 |
Engager un dialogue pour intégrer les conseils régionaux dans le fonctionnement de l'Agence. |
Ministère de la Cohésion des Territoires (DGCL et ANCT) |
Régions de France, Régions |
1er semestre 2023 |
Dialogue à mener à l'initiative de la DGCL. |
|
5 |
Privilégier une communication plus simple et déconcentrée, reposant sur le retour d'expérience des élus locaux et de leurs associations d'élus. |
Direction de l'ANCT |
Préfet en tant que délégué territorial de l'Agence, associations d'élus locaux |
2023 |
Création d'un guide pratique pour les élus
locaux Utiliser dans la communication de l'Agence des retours d'élus locaux et le relai des associations d'élus locaux |
|
2- DÉVELOPPER LES TERRITOIRES EN MATIÈRE D'INGÉNIERIE |
|||||
|
6 |
Étudier la proposition « 1% ou 1%o ingénierie » envisagée comme un fonds national alimenté par les collectivités pour les collectivités. |
Ministère de la Cohésion des Territoires (DGCL / ANCT) |
Consultation de l'ANPP |
1er semestre 2023 |
Étude sur la proposition, présentation de scénarios chiffrés |
|
7 |
Terminer les recensements départementaux de l'ingénierie. |
Ministère de la Cohésion des Territoires (DGCL / DMATES) |
Délégués territoriaux de l'Agence
ANCT et Services déconcentrés de l'État en lien avec les partenaires |
Fin 2023 |
Instruction ministérielle demandant qu'un catalogue en ligne soit mis en place dans toutes les préfectures, et diffusé à tous les élus et leurs collectivités
|
|
8 |
Sur les territoires où la dynamique d'animation et de structuration de l'ingénierie locale a fait défaut, encourager le préfet à l'impulser, notamment via les CLCT et leur déclinaison dans une instance technique (revue de projets) régulière. |
Ministère Cohésion des Territoires (DGCL / DMATES) |
Délégués territoriaux de l'Agence Services déconcentrés de l'État et partenaires ANCT |
Permanent |
Instruction ministérielle de rappel des principes et diffusion des bonnes pratiques |
|
9 |
Doter le préfet de moyens humains et financiers en matière d'ingénierie et doter l'Agence d'une ingénierie propre mobilisable sur le terrain. |
Pour les préfets : DMATES Pour l'ANCT : DGCL |
ANCT Services déconcentrés de l'État |
Courant 2023 |
Instruction ministérielle aux préfets sur les bonnes pratiques * Fonds dédié pour les préfets * Redéploiements internes à l'Agence ou relèvement du plafond d'emplois via le projet de loi de finances |
|
10 |
Instituer un comité de direction commun régulier entre ANCT, ADEME et Cerema. |
Enseignement supérieur et de la Recherche (ADEME), Cohésion des Territoires (ANCT, Cerema) |
Directions ANCT, Cerema, ADEME |
1er semestre 2023 pour une feuille de route partagée à la rentrée 2023 |
Réalisation d'une feuille de route partagée notamment pour une meilleure coordination |
|
11 |
Créer une interface numérique pédagogique sur le « qui fait quoi ? ». |
Direction ANCT |
Cerema, ADEME, BdT, et aussi ANRU, ANAH |
Engager les travaux en 2023 |
Interface expérience utilisateur |
|
3 - CONSOLIDER ET SIMPLIFIER L'EXISTANT |
|||||
|
12 |
Conforter l'outil CRTE, élargi notamment à la dimension sociale, comme cadre de référence de la mise en oeuvre des politiques publiques de l'État. |
Premier ministre Ministère de la Cohésion des territoires |
Préfets |
2023 |
Avenant aux CRTE actuels |
|
13 |
Identifier et valoriser les dynamiques de coopération entre territoires. |
Direction ANCT |
Associations d'élus locaux |
2023 |
À définir par l'ANCT : recensement des initiatives, refonte de programmes nationaux, programme dédié, instructions dans les programmes nationaux... |
|
14 |
Mesurer le niveau de satisfaction des programmes nationaux et mener des évaluations externes des dispositifs. |
DGCL / |
1er semestre 2023 |
Grille de satisfaction à réaliser par l'ANCT commune aux programmes (baromètre annuel par exemple) * Calendrier d'évaluations externes à prioriser sur les programmes et missions de l'Agence |
|
ANNEXE 2 : FEUILLES DE ROUTE DE
L'ANCT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ANNEXE 3 : DISPOSITIFS D'ÉVALUATION DES PROGRAMMES DE L'ANCT
|
|
Évaluations internes |
Évaluations externes |
|
Programme « Nouveaux lieux, nouveaux liens » · Dispositif AMI Manufactures de proximité |
L'Inspection générale de l'Administration (IGA) est en cours de réalisation d'une mission d'évaluation. |
|
|
L'Agence a fait réaliser une enquête évaluative des impacts de l'appel à manifestation d'initiative (AMI) sur les Fabriques de territoire, entre septembre 2020 et décembre 2022. Cette enquête met en évidence que l'AMI a eu un effet décisif sur la structuration, la salarisation et la professionnalisation des tiers-lieux lauréats. Les lauréats ont généré une contribution majeure sur l'accueil, la mise en lien et l'accompagnement de porteurs de projets. Si les tiers-lieux ont permis le développement d'un lien d'hyper-proximité, l'ouverture aux habitants des territoires demeure un défi. Les lauréats ont contribué de façon importante à l'accès aux services de proximité et aux services publics dont ils étaient les relais. Toutefois, ils sont peu parvenus à faire évoluer les pratiques et représentations des collectivités concernant l'aménagement du territoire. |
||
|
Réalisée par l'Agence Phare, cette évaluation a été rendue fin 2023 après deux ans de travail. Elle a établi des constats positifs : Ø un maillage territorial réussi avec une répartition propice aux territoires fragiles (29 % des Fabriques situées en Zone de revitalisation rurale et 51 % en Quartier prioritaire de la ville), intégrant ainsi l'objectif majeur de l'AMI pour garantir la cohésion des territoires et être outil correctif d'inégalités ; Ø une diversité respectée : le choix de critères méthodologiques (ouverture de la gouvernance, pluralité des partenariats, mixité de l'offre de services, etc.) plutôt que thématique (offre culturelle, accès aux droits, espace de travail partagé, etc.) a permis une sélection, en taille, en type d'activité et en forme juridique, variée et respectueuse de l'écosystème des tiers-lieux ; Ø une valeur socio-économique positive avec le déploiement de multi-activités augmentant l'offre de service de bassin géographique et proposant des modèles inventifs favorisant la cohésion territoriale. Sur le volet de la cohésion sociale, la réhabilitation de lieux physiques emblématiques de convivialité (café, cantine), le déploiement de multi-activités et d'événements festifs permettant de générer des rencontres entre populations, ont pu se déployer là où de telles activités monothématiques ne sauraient autrement trouver de modèle économique. Publiée en mars 2024. |
||
|
Programme « Société numérique » · Dispositif conseillers numériques France Services |
À l'automne 2021 et au printemps 2022, un questionnaire de satisfaction relatif au déploiement des conseillers numériques a été lancé en deux vagues. Plus du tiers des conseillers numériques y ont répondu. Les questions portaient sur les thématiques
Quelques résultats : Ø plus de ¾ des conseillers interviennent sur plusieurs sites. Les conseillers proposent majoritairement des interventions sur un mode individuel (60 %) que collectif (30 %). Près de la moitié des conseillers ont effectué une immersion dans le territoire de leur prise de poste ; Ø les publics sont essentiellement autonomes pour leur venue auprès des conseillers : plus de 40 % sont venus d'eux-mêmes parce qu'ils avaient entendu parler de la présence du conseiller et plus de 30 % venaient déjà et ont découvert la présence du conseiller. Dans plus de 8 cas sur 10, les publics viennent pour bénéficier d'un accompagnement à des outils numériques ; Ø les personnes âgées et les personnes isolées constituent les principaux publics. À 72 %, les conseillers font état de peu de difficultés pour pouvoir répondre aux demandes des publics. |
Évaluation réalisée par le Centre de recherche ASKORIA portant sur l'impact et le déploiement des conseillers numériques France Services. Résultats intermédiaires en juin 2023 : https://labo.societenumerique.gouv.fr/fr/articles/que-nous-apprend-le-programme-national-de-recherche-portant-sur-le-d%C3%A9ploiement-des-conseillers-num%C3%A9riques/ Résultats finaux : fin 2024. |
|
Programme « Société numérique »
|
Trois rapports de recherche évaluative sont en cours. Ils sont réalisés par ASDO Études en portant sur : · l'impact de la dématérialisation des canaux d'accès aux droits et aux services publics sur les pratiques des aidants ; · l'impact des accompagnements réalisés par les médiateurs numériques sur le sentiment de compétences numériques des personnes touchées par l'illectronisme ; · l'impact des politiques nationales d'inclusion numérique sur les stratégies territoriales mises en place par les acteurs publics locaux contre l'illectronisme. Date de publication estimée : fin 2024 pour la première étude (deux à suivre). Lien : http://asdo-etudes.fr/etude/recherche-strategies-locales-inclusion-numerique/ |
|
|
Programme « Ruralité » |
Évaluation de l'agenda rural faite par l'IEGDD. Publiée en janvier 2023. Lien : https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/289181.pdf |
|
|
Programme « Territoires d'industrie » |
Trois évaluations faites par l'Observatoire des Territoires d'industrie (ANCT) : · rendue en novembre 2019 : https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/letonnante-disparite-des-territoires-industriels/ ; · rendue en octobre 2020 : https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/a-la-recherche-des-territoires-dindustrie-a-effet-local-dominant/ ; · rendue en avril 2023 : https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/refaire-de-lindustrie-un-projet-de-territoire/ ; Dans le cadre de son point d'étape à trois ans (octobre 2021), le Programme a également conduit une enquête de satisfaction auprès des territoires en situation de « chocs industriels » qui a permis d'avoir les résultats suivants : Ø 100 % ont jugé le format de l'accompagnement satisfaisant ; Ø 9 % ont jugé l'accompagnement satisfaisant. 92 % ont jugé les consultants mobilisés comme compétents. |
|
|
Programme « Emploi, formation et développement économique » · Dispositif Parrainage vers et dans l'emploi |
Évaluation réalisée par l'ANCT et la Direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle. anct_-_dgefp_parrainage_-_evaluation_rapport_final_.pdf (dreets.gouv.fr) |
|
|
Programme « Emploi, formation et développement économique » · Dispositif Cités de l'emploi |
Évaluation nationale des Cités de l'emploi réalisée par ASDO. Publiée en avril 2023. Lien : Asdo ANCT - Synthèse enseignements Cités de l'emploi VF.pdf (agence-cohesion-territoires.gouv.fr) |
|
|
Programmes « Action coeur de ville » et « Petites villes de demain » |
Réalisée par la Cour des comptes, sur la politique de l'État en faveur du commerce de proximité. Publiée en septembre 2023. Lien : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-de-letat-en-faveur-du-commerce-de-proximite |
|
|
L'APVF, l'ANCT et la Banque des Territoires ont réalisé en 2022 le 2ème baromètre des petites villes partenaires du programme « Petites villes de demain ». Ipsos a interrogé un échantillon de 1 000 jeunes, âgés de 16 à 30 ans, représentatifs des Français de cette tranche d'âge, et un échantillon de 300 jeunes représentatifs de ceux habitant dans des communes du programme « Petites villes de demain ». Quelques résultats : Ø 89 % des jeunes de 16 à 30 ans disent avoir un regard positif sur les petites villes, dont 27 % qui ont un regard très positif ; Ø 52 % des jeunes pensent que les petites villes vont connaître une dynamique positive. Selon eux, les atouts sont : - la tranquillité pour 66 % des jeunes habitant une commune « Petite ville de demain », contre 56 % de l'ensemble des jeunes Français ; - la nature pour 58 % des jeunes habitant une commune « Petite ville de demain », contre 41 % de l'ensemble des jeunes Français ; - le bien-être pour 41 % des jeunes habitant une commune « Petite ville de demain », contre 31 % de l'ensemble des jeunes Français ; - la convivialité pour 38 % des jeunes habitant une commune « Petite ville de demain », contre 30 % de l'ensemble des jeunes Français ; Ø 69 % des jeunes pensent envisageable de s'installer dans une petite ville, et 23 % le jugent probable. Les principaux freins à l'installation sont : Ø la crainte de ne pas y trouver un emploi (pour
Ø les conditions de mobilité et de déplacement (pour 38 % des jeunes) ; Ø l'accès à la santé (pour 33 % des jeunes) ; L'offre culturelle limitée (pour 20 % des jeunes). |
||
|
Programme « Action coeur de ville » |
Réalisée par la Cour des comptes. Publiée en septembre 2022. Lien : Le programme Action coeur de ville | Cour des comptes (ccomptes.fr) |
|
|
Le Programme a mis en place 2 enquêtes annuelles : un sondage IFOP Villes de France en partenariat avec l'ANCT et la Banque des Territoires porte sur le rapport des Français aux villes moyennes et un baromètre du centre-ville et des commerces par l'institut CSA pour « Centre-Ville en Mouvement » en partenariat avec l'ANCT et Clear Channel. Dans ce dernier, 40 % des Français ont déjà entendu parler du programme « Action Coeur de Ville » ce qui en fait une des politiques publiques disposant de la plus grande notoriété et 89 % de ceux en ayant déjà entendu parler le jugent utile. |
||
|
Programme « Incubateurs des territoires » |
Fin 2021, le Programme a mené une enquête ad hoc par formulaire relative au programme national d'investigation porté par l'incubateur. Quelques résultats : 86 % des agents
territoriaux associés sont satisfaits de l'accompagnement ;
|
|
|
Programme « Cités éducatives » |
Il a été demandé aux Cités éducatives d'élaborer des protocoles de suivi et d'évaluation. Il s'agit d'une auto-évaluation des projets de chaque territoire. La majorité des Cités éducatives ont fait appel à un appui extérieur pour les accompagner dans cette démarche évaluative. |
Une étude sur la gouvernance des Cités éducatives a été menée par l'Université de Bordeaux. L'enjeu est de décrypter le plus finement possible la manière dont les Cités éducatives sont « gouvernées » pour construire une cartographie dynamique des acteurs impliqués. Pour cela, la dizaine de chercheurs impliqués dans cette étude, ont réalisé des monographies de « gouvernance de Cités éducatives » et d'espaces locaux d'acteurs de Cité éducative à des fins de comparaisons. Une évaluation de trois enjeux thématiques a été menée avec l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire : 1) la mise en oeuvre et les effets de la continuité éducative sur le parcours des enfants et des jeunes ; 2) les parcours d'orientation, de formation et
d'insertion au-delà et en parallèle du champ scolaire pour les
3) les effets sur la place des familles dans les coopérations éducatives et au sein du territoire. Pour chacun des 3 axes, a été étudiée l'approche des enjeux par les Cités éducatives, les actions mises en oeuvre et des effets potentiels et ce dans 5 cités éducatives. En termes d'outils nationaux de suivi, les Cités éducatives font un bilan en fin d'année civile de la mise en oeuvre de leur plan d'actions pour l'année écoulée. Cet exercice annuel obligatoire permet une visibilité sur la consommation des crédits mais également sur les évolutions de gouvernance ou de projet. Cet outil permet d'assurer un suivi opérationnel et financier de la démarche au niveau national. Publiée en mars 2024. Lien : https://injep.fr/publication/evaluation-nationale-des-cites-educatives-2/ |
|
Programme « France Services » |
Le Programme a mesuré dans un premier temps l'appréciation de la qualité de service auprès des usagers grâce à des enquêtes mystères dans 650 France services (enquêtes ISPOS et enquêtes Services publics +). Depuis, la mesure de la satisfaction des usagers au sein de maisons France services est réalisée grâce au recueil des avis des usagers sur une borne de satisfaction disposée à l'entrée des maisons France services. Plus de 125 000 avis ont été recueillis en 2022 dans les 500 bornes de satisfaction présentes dans le réseau France services. Ø 95 % des usagers se disent satisfaits de l'accompagnement offert en France services. La mesure de la satisfaction est issue de la question :
Cet indicateur fait désormais partie de ceux retenus au titre de la mise en oeuvre du chantier PPG « Consolider le réseau des espaces France services ». |
*
1 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024
à la commission de l'aménagement du territoire et du
développement durable, disponible sur ce lien :
https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20240429/devdur.html#toc2
* 2 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024 à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
*
3 Christophe BOUILLON, directeur
général de l'ANCT, table ronde de la délégation aux
collectivités
territoriales, 23 mai 2024.
* 4 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5039991?sommaire=5040030
* 5 Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), Agence nationale de l'habitat (Anah), Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), Banque des territoires (BdT) du groupe Caisse des dépôts et consignations (Cdc).
* 6 Lien : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2024-05/240430InstructionCRTEsignee30avril2024diffusion.pdf
* 7 https://www.senat.fr/rap/r22-313/r22-313.html
* 8 Le
président de la République a annoncé, à l'occasion
de la Conférence nationale des
territoires, organisée au
Sénat le 17 juillet 2017, le principe d'une nouvelle agence pour les
collectivités territoriales. Le groupe Rassemblement démocratique
et social européen (RDSE) a déposé la proposition de loi
portant création d'une Agence nationale de la cohésion des
territoires en s'inscrivant dans la continuité du travail
sénatorial relatif aux enjeux de cohésion des territoires et dans
le droit fil de l'annonce présidentielle. La loi n° 2019-753 du 22
juillet 2019 a porté la création de cette nouvelle agence,
l'ANCT.
* 9 https://www.senat.fr/fileadmin/Seance/Controle/Renforcer_le_controle_parlementaire/Controle_LIGNES-DIRECTRICES.pdf
*
10 Rapport d'information n° 702 (2023-2024) du
25 juin 2024, « 18 mois après le rapport du
Sénat : poursuite d'un dialogue exigeant avec
l'ANCT (rapport d'étape) », de Mmes
Sonia de
LA PROVÔTÉ et Céline BRULIN.
* 11 Op. cit.
* 12 Cour des comptes, communication à la commission des finances du Sénat intitulée « L'ANCT : un outil à consolider », février 2024.
* 13
Rapport d'information intitulé « L'ANCT, une agence à
consolider au service des
territoires » déposé le
14 février 2024.
* 14 Ibid.
* 15 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024 à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, disponible sur ce lien : https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20240429/devdur.html#toc2
* 16 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.
* 17 Réponses de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.
* 18 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024 à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
* 19 « Grist » est un gestionnaire de données OpenSource. Il permet la saisie et la manipulation collaborative de données et autorise une structuration avancée des données sans recourir à la programmation (NoCode).
* 20 Circulaire N° 6420/SG du 29 septembre 2023 et instruction TRED2410587C du 30 avril 2024.
* 21 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.
* 22 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024, op. cit.
* 23 Table ronde de la délégation aux collectivités territoriales, 23 mai 2024.
* 24 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024, op. cit.
* 25 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5039991?sommaire=5040030
*
26 Rapport d'information intitulé «
L'ANCT, une agence à consolider au service des
territoires
» déposé le 14 février 2024, Bernard DELCROS.
* 27 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024, op. cit.
* 28 Ibid.
* 29 Table ronde de la délégation aux collectivités territoriales, 23 mai 2024.
* 30 Ibid.
* 31 Ibid.
* 32 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.
* 33 Réponse de la DMATES au questionnaire des rapporteures.
* 34 Auvergne-Rhône-Alpes.
* 35 Cour des comptes, communication à la commission des finances du Sénat intitulée « L'ANCT : un outil à consolider », février 2024.
* 36 Ibid.
* 37 Article L. 1231-2 du CGCT.
* 38 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.
* 39 Le sigle vient de l'anglais : « Conferences of the Parties ».
* 40 Office français de la biodiversité.
* 41 Comité national de coordination.
* 42 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.
* 43 Quartiers politiques de la ville.
* 44 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.
* 45 Lien : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2024-05/240430InstructionCRTEsignee30avril2024diffusion.pdf
* 46 Circulaire du 30 avril 2024 signée par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité.
* 47 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.
* 48 Comités de pilotage.
* 49 Il est régi par l'article 78 de la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014.
* 50 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.
* 51 Réponse de RdF au questionnaire des rapporteures.
* 52 La mesure a été annoncée le 8 février 2023 à la suite de la remise du rapport du Sénat. Elle a été mise en oeuvre le décret n° 2024-97 du 8 février 2024 relatif au rôle du délégué territorial de l'ANCT.
* 53 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024, op. cit.
* 54 Op. cit.
* 55 Ibid.
* 56 Cour des comptes, communication à la commission des finances du Sénat intitulée « L'ANCT : un outil à consolider », février 2024.
* 57 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024, op. cit.
* 58 Cour des comptes, communication à la commission des finances du Sénat intitulée « L'ANCT : un outil à consolider », février 2024.
* 59 Table ronde de la délégation aux collectivités territoriales, 23 mai 2024.
* 60 Cour des comptes, « L'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), un outil à consolider », communication à la commission des finances du Sénat, février 2024.
* 61 Ibid.