DEUXIÈME PARTIE
Mme Françoise Vergès
Mehdi Lallaoui est réalisateur et écrivain. Il a réalisé plusieurs films touchant à l'Histoire d'Algérie, notamment « Les massacres de Sétif, un certain 8 mai 1945 », qui recevait en 1995 le Grand Prix du Meilleur film documentaire au festival du film historique de Rueil-Malmaison, et le premier prix du Festival international du Scoop et du Journalisme d'Angers. Il a aussi réalisé un film sur la manifestation des Algériens à Paris le 17 octobre 1961, intitulé « Le silence du fleuve », et a réalisé la série diffusée sur France 3 « Un siècle d'émigrations en France ». Il a également contribué à l'ouvrage « Un siècle d'émigrations », en trois volumes, aux éditions Au nom de la mémoire. Il a publié en 1995 « Du bidonville aux HLM », ainsi que trois romans : « Les beurs de Seine », « La colline aux oliviers » et « Une nuit d'octobre ».
M. Mehdi
Lallaoui,
réalisateur et écrivain
Calédoune ou
l'histoire de la déportation
vers la Nouvelle-Calédonie des
insurgés Algériens de 1871
En 1986, le leader kanak Jean Marie Tjibaou effectue sa première visite en Algérie pour solliciter le soutien des Algériens à la lutte du peuple kanak. À cette occasion, les autorités algériennes découvrent avec stupéfaction qu'une communauté de descendants d'algériens, déportés et transportés au XIX e siècle, a fait souche en Nouvelle-Calédonie à 20 000 kilomètres des côtes méditerranéennes. Ainsi, quelque mois plus tard, des représentants de cette communauté oubliée sont accueillis en Algérie où ils retrouvent, plus d'un siècle plus tard, leur famille.
C'est le hasard qui me fit aborder en 1982 cette histoire qui allait m'occuper des années durant jusqu'à la publication de mon livre et de mon film éponyme « Les Kabyles du Pacifique ». Tout débute cette année-là devant la plaque commémorative des 265 communards morts en déportation à l'île des Pins. Cette île située à l'époque à huit heures de navigation de Nouméa, fut à partir de 1872 l'un des lieux de la déportation simple où furent internés près de 3 000 communards et une centaine d'algériens. Avant de quitter l'île, les communards amnistiés (en 1880) graveront sur cette plaque « À leurs frères morts en exil » deux noms pas tout à fait issus des faubourgs de Belleville ou de Ménilmontant. Il s'agit de Ali Ben Galouza et Tahar Ben Akli. C'est le départ de ma recherche. Et pour débuter mon travail, je commençais par l'ouvrage de référence publié en 1891 par le commandant Louis Rinn sur l'histoire de l'insurrection de 1871 en Algérie qui ne parle pas de ce que sont devenus les survivants de cette révolte. Rien n'avait jamais été publié sur ces Algériens du Pacifique.
Le prélude de cette histoire commence en Algérie sous le Second Empire. En 1867-1868, le pays fut l'objet d'une terrible famine faisant des centaines de milliers de victimes. En parallèle, le pays verra ses meilleures terres accaparées par la colonisation déstabilisant profondément le monde agraire.
Lorsque débute en Algérie l'insurrection de 1871, la plus grande révolte après la guerre de conquête contre l'Émir Abdelkader, la question de la terre et donc de la survie des populations indigènes est une question cruciale. Aux sources de cette révolte, plusieurs explications. D'abord, une réaction aux décrets d'Adolphe Crémieux (Ministre de la justice du gouvernement de la Défense nationale) du 24 octobre 1870. Les décrets Crémieux accordaient aux 35 000 juifs d'Algérie la citoyenneté française. Ensuite, une réaction à la pénétration de la colonisation de peuplement en Algérie, confisquant de plus en plus et de plus en plus vite les meilleures terres. Les notables et les alliés traditionnels de la France qui sont en perte d'influence ne sont pas épargnés par ce phénomène de dépossession au profit des nouveaux colons et de l'administration coloniale.
Les prémices de la révolte débutent en janvier 1871 alors qu'à Paris les Prussiens encerclent et bombardent la capitale. Les Spahis stationnés à la frontière tunisienne refusent de s'embarquer pour être envoyés en France faire la guerre à la Prusse. L'une des clauses de leur contrat d'engagement stipulait que leur territoire d'action se limitait à celui de l'Algérie. La révolte prendra de l'ampleur en mars alors qu'en France débute la Commune de Paris dont nous retrouverons plusieurs de ses figures dans cette histoire et notamment après l'épilogue de la semaine sanglante. L'insurrection algérienne qui se généralise le 8 avril 1871 entraînera plus de 250 tribus, et touchera près d'un tiers de la population algérienne d'alors.
Ses deux principaux chefs furent le Bachagha El-Hadj-Mohammed-Ben-El-Hadj-Ahmed-el-Moqrani rejoint par la puissante confrérie religieuse des Rahmanya dont le grand maître était Mohand Amezian Ben Cheikh-El-Haddad. Le premier sera tué au combat le 5 mai, laissant la direction de l'insurrection à son frère Boumezrag Mokrani. Le second octogénaire, (qui mourra en prison) confia à ses deux fils, Aziz et M'hamed Ben Cheikh-El-Haddad, la direction des combats.
Les combats s'arrêteront en janvier 1872, un an après le début de la révolte et après une répression sanglante menée par vingt colonnes punitives. La rébellion écrasée, 450 000 hectares de terre seront confisqués et distribués aux nouveaux colons. Parmi eux, les Alsaciens-Lorrains dont les territoires furent annexés par la Prusse. La Kabylie, épicentre de l'insurrection, ravagée par cette guerre, verra durant des décennies ses enfants émigrer vers la France pour survivre.
Les instigateurs réels ou supposés de l'insurrection de 1871 seront jugés dans de grands procès dont celui dit « des Grands chefs » à Constantine en mars 1873. Les procès d'assises des insurgés eurent systématiquement pour objectif de criminaliser les faits pour donner aux condamnations le caractère d'actes relevant de délits de droit commun. Les 13 accusés, dont deux figures de l'insurrection de 1871, Boumezrag Mokrani et Aziz ben Cheick El Haddad (tous les deux porteurs de la Légion d'honneur), se verront condamnés à la peine de mort. La peine de mort pour délit politique ayant été supprimée par la constitution de 1848 et remplacée depuis 1850 par la déportation en enceinte fortifiée, la peine capitale sera commuée en détention à perpétuité et à la déportation en Nouvelle-Calédonie.
Commence alors pour les condamnés un périple éprouvant qui se terminera par une traversée de cinq mois pour rejoindre ces terres redoutées du Pacifique Sud, ou pour certains, de la Guyane. Car selon le hasard et le bon vouloir des juridictions, on ne sait pas où envoyer les insurgés algériens. Il existe à l'époque une polémique entre le ministre de l'Intérieur et celui de la marine sur la destination finale des algériens condamnés. Tantôt, ils sont considérés comme des droits communs donc relevant du statut de transportés et envoyés au bagne à Cayenne, tantôt (c'est le cas des grands chefs du procès de Constantine) ils sont considérés comme des déportés et envoyés en Nouvelle-Calédonie.
Les condamnés Algériens tout comme les Communards sont classifiés selon leur condamnation. Ils seront transportés, déportés ou relégués. Les transportés étaient considérés comme des droits communs et ils se retrouveront à l'Île Nou (tel le communard Jean Allemane) ou à Cayenne. Les déportés seront considérés comme des politiques et acheminés vers l'Île des Pins (déportation simple) où à la presqu'île Ducos (déportation en enceinte fortifiée comme pour Louise Michel).
Après la défaite des deux insurrections de 1871, les convois de prisonniers allaient se succéder. La totalité des insurgés d'Algérie, relevant du statut de déporté seront transférés sur le continent. À Toulon, au Fort Lamalgue, ils rencontreront et partageront leur sort avec d'autres insurgés de la Commune. Durant des années, ceux de la Commune de Paris seront, grâce à leurs correspondances puis à leurs mémoires, les témoins de leurs exils. Ainsi Henri Rochefort, Henri Messager, Louise Michel ou Joannes Caton, communards condamnés à la déportation, témoigneront longuement de la présence et de la vie des Algériens à la citadelle de l'Île d'Oléron puis à la prison de l'île de Ré. L'administration pénitentiaire sera également riche d'informations notamment au fort de Quélern, dans la rade de Brest, lieu de départ des navires vers la déportation.
Alors que les Algériens et les communards subissent les dures conditions de l'exil calédonien, en France, dès 1876, des propositions d'amnistie sont déposées dans les deux chambres. Clemenceau défendra cette proposition devant les députés alors que c'est Victor Hugo qui défendra l'amnistie devant ses collègues sénateurs. Mais c'était encore trop tôt.
L'amnistie qui videra l'île des Pins de ses communards ne concernera pas les Algériens. Pourtant les deux lois d'amnistie de 1879 et 1880 (loi partielle du 3 mars 1879 et loi d'amnistie générale du 11 juillet 1880) mentionnaient les insurrections de 1871 au pluriel. « L'amnistie est accordée à tous les condamnés pour faits relatifs aux insurrections de 1871 et à tous les condamnés pour crimes et délits relatifs à des faits politiques... ». Les Algériens se verront graciés partiellement et sous condition de résidence obligatoire dans la colonie. C'est ainsi qu'ils rejoindront Nouméa et surtout «La vallée des Arabes» à Nessadiou près de Bourail où ils vivront de culture et d'élevage de chevaux. Cette histoire est aussi un bel exemple de fraternité entre les vaincus des deux insurrections. En effet, de retour en Europe, les communards se dépenseront sans compter pour la libération des insurgés algériens qu'ils ont laissés sur Le Caillou. En 1881, sous la responsabilité d'Olivier Pain, une brochure intitulée « L'amnistie pour les insurgés arabes » est publiée. Elle fait suite à une conférence faite à la salle Ragache, près de Vaugirard, où 1 500 communards sous la présidence de Louise Michel et de Henri Rochefort sont réunis pour réclamer l'amnistie des insurgés arabes. Face au procès intenté à l'État dès 1884 et à l'action des communards, l'administration reconnaîtra seulement en février 1887 l'illégalité de la résidence obligatoire en Nouvelle-Calédonie pour les Algériens. Ce déni de justice entraînera une longue polémique qui se conclura en 1892 par une plainte contre l'administration pénitentiaire pour détention arbitraire et dont l'auteur, Maître Le Henaff du barreau de Paris soutenu par une vingtaine de députés, démontrera de nouveau que l'amnistie de 1879 s'appliquait bien aux insurgés d'Algérie. Il faudra attendre une action en justice et une procédure de quinze années pour que la loi d'amnistie soit actée le 1 er février 1895. Ainsi, en août 1895 une poignée de survivant de la déportation regagnera l'Algérie où ils seront assignés à résidence, loin de leur terre confisquée. Car durant toutes ces années le Gouverneur de l'Algérie et les représentants des colons ont fait front commun pour s'opposer à tout retour des insurgés algériens qui bénéficiaient encore d'un prestige important dans la population pour s'être soulevés en 1871.
Azziz Ben Cheick el Haddad et Boumezrag Mokrani : deux destins de déportés.
Aziz Ben Cheik El Haddad est condamné au procès des grands chefs à Constantine en 1873. Il est interné à Quélern où il correspond avec le Gouverneur général civil de l'Algérie à propos de sa famille (il demande que quatorze d'entre eux le rejoignent et que son fils et son neveu scolarisés dans un lycée d'Alger le soient à Constantine).
On le retrouve à l'île des Pins sur la cinquième Commune appelée « Le camp des Arabes ». Là, il se lie d'amitié avec les Communards dont Eugène Mourot. Il quitte l'Île des Pins en octobre 1875, puis il est interné à la presqu'île Ducos en mars 1876 et enfin renvoyé à l'île des Pins.
Aziz s'évadera en avril 1881 et se réfugiera dans l'actuelle Arabie Saoudite. Ses déplacements, notamment à Suez, feront l'objet d'une surveillance discrète des agents français sur place qui en informent le gouverneur de l'Algérie. Aziz Ben Cheik el Haddad meurt le 22 août 1895 chez le communard et journaliste Eugène Mourot domicilié au 45 boulevard de Ménilmontant face au Père-Lachaise. Il était venu à Paris réclamer la restitution de ses biens. (Ils seront séquestrés jusqu'en 1911).
Boumezrag Mokrani fait aussi partie des condamnés du procès dit des Grands chefs et sera également déporté sur l'Île des Pins. Lorsqu'éclate l'insurrection kanak de 1878 initiée par le grand chef Ataï, Boumezrag Mokrani en permission à Nouméa propose ses services au Gouverneur Olry. Les Algériens sont des cavaliers et une trentaine d'entre eux serviront dans la répression des tribus kanak insurgées. Suite à cette implication, bénéficiant de remises de peine, une demi-douzaine d'algériens seront transférés vers les prisons de métropole en 1879. Certains seront emprisonnés à Calvi en Corse. Dix déportés algériens seront graciés sous condition de résidence obligatoire sur le territoire. Mokrani vécut maritalement à Nouméa avec une dame Noirot avec qui il tient un commerce et une affaire de transport de calèche. Exclu de l'amnistie de 1895, il regagnera l'Algérie en 1904 (Grâce présidentielle du 23 janvier 1904) près de trente ans après son exil, pour y mourir en mai 1905.
Le livre de Louis Rinn sur l'insurrection de 1871 se concluait ainsi : (Extrait)
« Nous tiendrons les indigènes tant que nous serons les plus forts, tant que nous les gouvernerons effectivement. Est-ce à dire que nous n'aurons plus d'insurrection en Algérie ? Non certes ; nous en aurons encore et pendant longtemps. Nous pourrons bien quelquefois rencontrer comme gouverneur un homme supérieur qui, par son habileté et sa vigilante sagesse, saura, (...) préserver le pays de tout soulèvement pendant neuf ou dix ans ; mais il serait imprudent de compter qu'il en sera toujours ainsi . »
Mme Françoise Vergès
Philippe Rostan est réalisateur, né au Vietnam d'un père français et d'une mère vietnamienne. Il a été l'assistant-réalisateur de Pierre Schoendoerffer et de Mathieu Kassovitz, avant de se tourner vers le documentaire, dont « Les trois guerres de Madeleine Riffaud » et « Le lotus dans tous ses états ».
Né d'un père français et d'une mère vietnamienne, Philippe Rostan, producteur et réalisateur, débute sa carrière en tant qu'assistant réalisateur de Klaus Kinski (Paganini, 1989) Pierre Schoendoerffer (Dien Bien Phu, 1991), Mathieu Kassovitz (Métisse 1994). Il a réalisé et produit une dizaine de films documentaires qui ont reçu plusieurs prix dont, le Grand prix du film documentaire au Festival d'Alger 2012 pour Les 3 guerres de Madeleine Riffaud. Il a notamment remporté Étoiles de la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), prestigieux prix qui récompense les meilleurs documentaires de l'année pour Les 3 guerres de Madeleine Riffaud en 2011 et Le Marché de l'amour en 2012.
M. Philippe
Rostan,
réalisateur
« Le Petit Vietnam »
ou le cas oublié des rapatriés d'Indochine
après la
décolonisation.
« Inconnu, présumé
français »
ou les destins brisés d'enfants
métis d'Indochine
Lorsque j'ai proposé « Le petit Vietnam » et « Inconnu, présumé Français », je me souviens d'un diffuseur qui m'a fait cette réflexion : « Vos films sont trop pointus ! ». Ce n'était pas un compliment de sa part, mais plutôt : « Vos sujets ne concernent que trop peu de gens et ils n'intéressent pas grand monde ! »
Heureusement que Pierre Watrin, directeur de programmes de France Ô, était l'un des premiers à me donner la chance de réaliser ces films sur l'histoire post coloniale indochinoise vue d'ici. L'Indochine était jusque-là fantasmée à la fois par les réalisateurs français et vietnamiens d'ici et représentée par cette image édulcorée de perle d'Asie, lointaine. Ces indochinois venus en France n'étaient pas encore représentés dans les documentaires. Ces deux films ont été les premiers à leur donner la parole. Je suis heureux que, depuis, d'autres films aient pu exister.
|
Diffusion du film Le petit Vietnam (2006) Documentaire de Philippe Rostan |
En 2004, lors du 50 e anniversaire de Dien-Bien-Phu, lorsque je me suis rendu à Noyant d'Allier, une ancienne cité minière désaffectée, où fut créé en 1954 le tout premier centre d'accueil des rapatriés d'Indochine, pour mon film, des hommes, il en restait très peu. Ils ont vécu leur retour en France douloureusement comme un deuxième exil et surtout comme un déclassement. Les survivants - majoritairement des femmes et leurs enfants eurasiens - m'ont raconté leur arrivée, les difficultés auxquelles ils ont dû faire face et le choc du déracinement, qu'il s'agisse du climat, de l'assimilation à une nouvelle culture, dans une France postcoloniale, à la fois hospitalière et remplie de préjugés.
Avec force et résignation, ces femmes se sont intégrées au point de devenir indissociables de la vie du village. Elles ont permis aux deux communautés de s'accepter et d'être curieuses l'une envers l'autre. Quand on partage une culture au quotidien, on se comprend mieux. Petit à petit, grâce à un système de relations d'amitié et de solidarité au coeur des corons, elles ont recréé un univers de là-bas : un petit Vietnam qui s'est peu à peu propagé dans tout le village, puisque certains Noyantais ont, à leur tour, épousé des femmes vietnamiennes ainsi que leur mode de vie, et parlent couramment vietnamien.
À Noyant d'Allier, la sauce de poisson, le nuoc-mâm, est devenue une spécialité locale et Le Sourire de Saigon, un bar PMU très prisé des joueurs de belote. Une pagode financée à la fois par les deux communautés fait face à une église romane du XII e siècle. Moi-même, enfant de rapatriés mais arrivé en France en 1975 après la chute de Saigon, j'ai trouvé à Noyant « le miroir de ma propre histoire ». La vie de mes parents ressemblait à celles des couples que j'ai rencontrés. Ces familles déracinées confrontées à un nouveau déchirement, les hommes partant chercher du travail à Paris et laissant femme et enfants au village. Mais, au-delà du miroir de mon enfance, c'est d'abord l'histoire d'une intégration réussie, voir à l'envers, que j'ai voulu raconter. À Noyant, j'ai rencontré des Auvergnats de souche qui parlent vietnamien mieux que moi ! Qui a intégré qui ?
Aujourd'hui, le village est fier de sa double culture, devenue même un argument touristique !
Pendant les vacances d'été, Noyant se remplit alors d'enfants et de petits-enfants qui viennent passer les fêtes en famille : le nombre d'habitants passe de 900 à plus de 2 000. Le village retrouve son ambiance animée des années 1960, et sa très forte majorité asiatique. Et pour la fête du Têt, il faut réserver sa chambre d'hôtel plus de trois mois à l'avance...
Mon film est une approche positive - sans être angélique - de la diversité, mais rappelle que le sort de ces rapatriés d'Indochine est révélateur de la manière dont le drame colonial s'est prolongé pendant un demi-siècle en plein coeur de la France.
|
Diffusion du film Inconnu, présumé Français (2009) Un film de Philippe Rostan |
Dans mon film, « Inconnu, présumé Français » tourné en 2008 sur les destins croisés entre l'histoire du Vietnam et de la France, je touchais là un sujet sensible : celui des enfants nés pendant la guerre d'Indochine d'une mère vietnamienne et d'un père français qui ne les a pas reconnus et qui les a abandonnés. Il existait des films sur les Amérasiens de la guerre du Vietnam, sur les bébés boches de la Deuxième guerre mondiale, mais aucun film sur ce sujet tabou de la société française.
Jacques, René, Maurice, Henri et Noëlle, les personnages eurasiens de mon film, ont vu leur sort scellé par le décret du 8 novembre 1928 « déterminant le statut des métis nés de parents légalement inconnus en Indochine » :
« Tout individu, né sur le territoire de l'Indochine de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, est présumé de race française, pourra obtenir, conformément aux dispositions du présent décret, la reconnaissance de la qualité de Français. »
Jacques, le personnage principal du film, est mon cousin germain. Son histoire est longtemps restée secrète au sein de ma famille. Je l'ai souvent questionné, mais il a été réticent pendant des années. C'est seulement à la soixantaine qu'il est prêt à me la livrer. Il m'a parlé de toutes les personnes dont il a été proche et m'a mis en contact avec elles. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de plusieurs de ses amis.
J'ai eu la chance de recueillir le témoignage de leurs parents. Seuls deux d'entre eux ont eu la chance de les retrouver : René a retrouvé son père, et Maurice a encore sa mère. Ils avaient respectivement 95 et 80 ans. Il y avait donc urgence à entendre leur version des faits. Il m'a semblé important de leur donner la parole. Leur histoire est méconnue, voire cachée.
Le film traite des métis d'Indochine, mais il peut aussi parler aux enfants des diverses colonies. L'Indochine a servi de laboratoire expérimental à la question métisse pour les autres parties de l'Empire. Autant cette population a été déniée de toute existence par l'État Français pendant des années, autant le revirement politique d'après 1928 l'utilise à des fins de manipulation démographique.
L'existence d'une classe hybride menaçait l'ordre colonial. Les enfants eurasiens étaient violemment rejetés par la société indigène et française. Malgré l'apparente générosité de la loi de 1928, les métis resteront toujours outremer des Français de seconde catégorie, des cadres subalternes de l'administration coloniale.
Cette loi a été pensée par des hommes, pour des hommes. La mère indigène de l'enfant métis n'ayant servi que de réceptacle provisoire, il s'agissait de ramener dans le giron français le « résultat » de cette union. Et encore, à condition que ce résultat soit de sexe masculin. On verra que lors du rapatriement de 1954, l'immense majorité des pupilles de la Fédération des oeuvres de l'enfance française et indochinoise (FOEFI) sont des garçons... Les filles restées au Vietnam avaient leur pauvre destin tout tracé.
À travers ces parcours singuliers, c'est toute une page de l'Empire colonial français qui est ici revisitée. À travers leurs histoires, nous suivons également l'évolution des lois qui ont régi la politique coloniale vis-à-vis de cette population de deuxième zone et la citoyenneté française.
Tous ces témoignages s'accordent, malgré leurs différences, sur un point : c'est leur solidarité qui les a aidés à se reconstruire et à vivre dans ce monde qui n'était pas le leur. C'est également ce destin commun qui leur permettra d'acquérir une identité qui avait été morcelée.
L'esprit de la loi
85 ans plus tard, on reste interdit devant l'esprit qui sous-tend cette loi. Elle insinue une supériorité de la race blanche sur les autres races, et une supériorité de l'homme sur la femme : en raccourci, c'est la semence de l'homme blanc qui rend Français... Convaincues de leur supériorité raciale, les associations caritatives s'emploient à faire des petits Eurasiens des « Français d'âme et de qualités ». Pour cela, elles séparent les enfants de leurs mères à un âge de plus en plus précoce « afin de privilégier le milieu sur l'hérédité ».
Certes, ces enfants recueillis en orphelinats avaient presque tous une mère bien vivante, et les arracher à elle (avec son consentement formel) était d'une violence rare, sans compter la séparation des fratries dès leur arrivée en France. Certains sont toujours à la recherche d'un frère ou d'une soeur.
Le décret méconnu va prendre toute sa valeur à la fin de la guerre d'Indochine. Les enfants eurasiens n'ont plus leur place au Vietnam. William Baze, lui-même Eurasien, qui avait créé la FOEFI en 1938, organise de toute urgence le rapatriement d'un maximum d'enfants pouvant bénéficier de la nationalité française. 4 500 enfants seront envoyés en France aux frais de la FOEFI, ce qui leur a probablement évité la misère, l'exclusion, voire la mort à court terme. Mais le jour où ils ont quitté le Vietnam, une page s'est refermée pour eux, et la douleur de cet arrachement est encore vivace aujourd'hui.
Ces enfants illégitimes, aux traits asiatiques, transplantés dans le pays de leur père qu'ils n'ont jamais connu, ont fait souche. Ils sont professeur, avocat, médecin, se sont mariés (tous avec des Françaises), ont eu des enfants, bref ont « réussi » leur vie. S'ils se retrouvent régulièrement entre « Foefiens », c'est peut-être pour entretenir, sans la gratter, la cicatrice toujours béante, autour de cette identité qu'ils ont mis un demi-siècle à comprendre, à aimer. Ce sont souvent leurs enfants qui les ont convaincus de revenir à la source de leur existence, à rechercher leurs parents, à faire un voyage au Vietnam.
Lorsque j'ai approché l'armée française, notamment le pôle archives de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), ils étaient immédiatement intéressés pour soutenir le film. Mais au dernier moment, il y a eu une volte-face : ils avaient peur de participer à un film qui permettrait aux enfants de rechercher leur père, et se sont rétractés. Cependant, mes deux films seront projetés le 5 décembre 2013 dans le cycle cinéma de l'exposition sur l'Indochine qui a lieu au Musée de l'Armée des Invalides !
Mme Françoise Vergès
Le cas des enfants métis nous renvoie à une politique coloniale très répandue. C'est l'exemple d'une politique d'État qui, au nom d'une mission de civilisation, arrache des enfants à leur famille pour les transformer en civilisés.
Mme Françoise Vergès
Lam Lê est cinéaste et directeur artistique, né au Vietnam. Il vient en France dans les années 1970 pour poursuivre des études de mathématiques supérieures et pour étudier la peinture aux Beaux-Arts. Il est d'abord scénographe au théâtre de l'Atelier de l'Épée de bois, dont il est cofondateur. Il débute au cinéma en devenant assistant sur des longs métrages, notamment avec Jean-Pierre Mocky. Il écrit et réalise un long-métrage en 1980, le premier volet d'une trilogie sur l'Indochine, « Rencontre des nuages du dragon ». Vient ensuite « Poussière d'Empires », qui sera sélectionné à Venise en 1983 et à Berlin en 1984. Il a également réalisé des films pour l'INA, FR3, ainsi que des films publicitaires. Il a adapté en scénario « La marque jaune ».
M. Lam
Lê,
cinéaste et directeur artistique
Les travailleurs
civils requis en Indochine
pour l'effort de guerre en 1939-1940 : le
sort de 20 000 jeunes Vietnamiens
Mesdames, messieurs les sénateurs, élus, amis et invités,
Les hommes dont je parle sont des hommes du présent. Morts anonymes ou disparus sans sépulture sur le sol de France et du Viêt-Nam d'où ils sont originaires, ils sont toujours vivants parmi les vivants car ils attendent qu'on leur rende justice et dignité.
Les hommes dont parle mon film n'ont pas cherché à collaborer avec la puissance coloniale qui a asservi leur peuple et réduit leur pays pendant plus d'un siècle à une poussière d'empire. Ils n'ont pas choisi d'abandonner leur famille, de quitter leurs villages et rizières pour venir en France travailler dans les usines d'armement désertées en 39-40 par les ouvriers français partis au front.
Ces hommes, aujourd'hui entrés dans l'histoire du cinéma avec mon film doublement primé aux festivals de Pessac et d'Amiens en 2012, ces hommes n'ont pas à se plaindre de l'ingratitude ou de la duplicité de la République à leur égard. Ils gardent en eux leur dignité d'hommes libres et fiers de l'être. Ils se sont toujours battus pour une noble cause, la seule digne à leurs yeux : être un jour citoyens d'une nation libre, égalitaire et indépendante. Quand il fallait se battre au côté du peuple français pour chasser l'occupant nazi, beaucoup d'entre eux n'ont pas hésité à dire « OUI ». Mais quand il s'agit de suppléer le corps expéditionnaire de la France libre pour asservir de nouveau leur pays, ils ont tous dit NON.
|
Cong Binh, la longue nui indochinoise |

(c) Lam Lê
Chaque famille indigène ayant trois enfants mâles dans l'Indochine française devait fournir un fils valide à la mère patrie. Jeune père de famille forcé d'abandonner femme et enfants en bas âge, jeune frère parti à la place de l'aîné, vieux père à la place du fils, peu importe, du moment qu'était rempli le quota de 80 000 hommes, exigé par la mère patrie devenue une marâtre, leur demandant de contribuer à l'effort d'une guerre qui pourtant ne les concernait pas.
Travailleurs requis à qui l'on n'avait donné ni contrat ni salaire, à qui l'on ne garantissait pas qu'ils pourraient revenir dans leur pays, que leurs familles auraient des indemnités s'ils venaient à mourir, travailleurs que l'on habillait en soldats et non en travailleurs civils, les faisant ainsi passer aux yeux de leurs compatriotes pour des mercenaires prêts à collaborer avec les forces coloniales.
Ils étaient 20 000 jeunes Indochinois à débarquer à Marseille, après avoir voyagé entassés avec le bétail au fond de la cale des bateaux.
Après l'armistice de juin 1940, bloqués dans la France occupée, ils étaient bafoués, enfermés dans des camps, vendus à l'armée allemande par des collaborationnistes, esclavagés et traités comme des parias dans le pays fondateur des droits de l'homme. Malgré cela, l'État français, leur unique employeur, n'a jamais reconnu leur statut de travailleurs civils au service d'une France engagée dans une guerre où elle avait aussi besoin des forces vives de ses colonies. L'administration française leur a même refusé le droit à une pension de retraite pour les années de travail fournies au service de la Main d'OEuvre Indigène, Nord-Africaine et Coloniale, la MOI dépendant du ministère du Travail de la III e République puis de la DTI, Direction des Travailleurs Indochinois après la Libération.
De ces 20 000 hommes, j'en ai retrouvé une vingtaine. Je les ai filmés et j'ai recueilli leurs témoignages en 2010 et 2011. Quatre sont décédés pendant le montage de mon film et six autres après sa sortie en salles fin janvier 2013. Les survivants, en France et au Viêt-Nam, tous nonagénaires ou centenaires, sont désormais moins d'une dizaine.
Je ne suis pas enfant de travailleur requis par les autorités coloniales, je ne suis pas historien, je suis seulement un cinéaste et un passeur de mémoires, cherchant à jeter des passerelles entre les générations et les cultures, entre la France et le Viêt-Nam. J'ai toujours placé au centre de tous mes films la question coloniale, parce qu'elle remet en cause des certitudes, comme celle de la prétendue suprématie de telle ou telle civilisation, qui ont provoqué d'irréparables ravages.
Ne faut-il pas se souvenir que récemment encore, on a pu entendre tel président de la République prétendre que « l'homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire », et prétendre cela après s'être félicité des « apports positifs » de la colonisation dans ses territoires conquis à la force du canon et du goupillon ?
Dans ses colonies, la III e République française avait imposé aux peuples asservis le même service de travail obligatoire que l'infâme STO imposé à la France par le III e Reich entre 1942 et 1945.
À la Libération, l'administration française avait tenu compte de la période de réquisition par le STO allemand dans le règlement des droits des travailleurs de la métropole. Mais les 20 000 travailleurs indochinois, eux, n'ont pas vu leurs droits reconnus, eux qui, selon Benjamin Stora, historien de l'Algérie, effectuaient de facto un STO colonial sur le sol de France.
Comment intégrer cette mémoire dans l'histoire, pour reprendre les mots de Pierre Vidal-Naquet, le sociologue de l'histoire ? Comment ne pas oublier aussi la pensée de Paul Ricoeur, pour qui l'objet de l'histoire, ce n'est pas le passé, ce n'est pas le temps, mais ce sont « les hommes dans le temps » ?
Alors, aujourd'hui en votre présence et celle des enfants et petits-enfants d'un millier de ces hommes qui ont choisi de fonder une famille en France, je crois que ma mission est de rappeler à votre mémoire l'existence de ces hommes, pour qu'ils ne soient pas les travailleurs fantômes ou les ouvriers forçats d'un pays de droits et de justice qu'est la France aux yeux du monde.
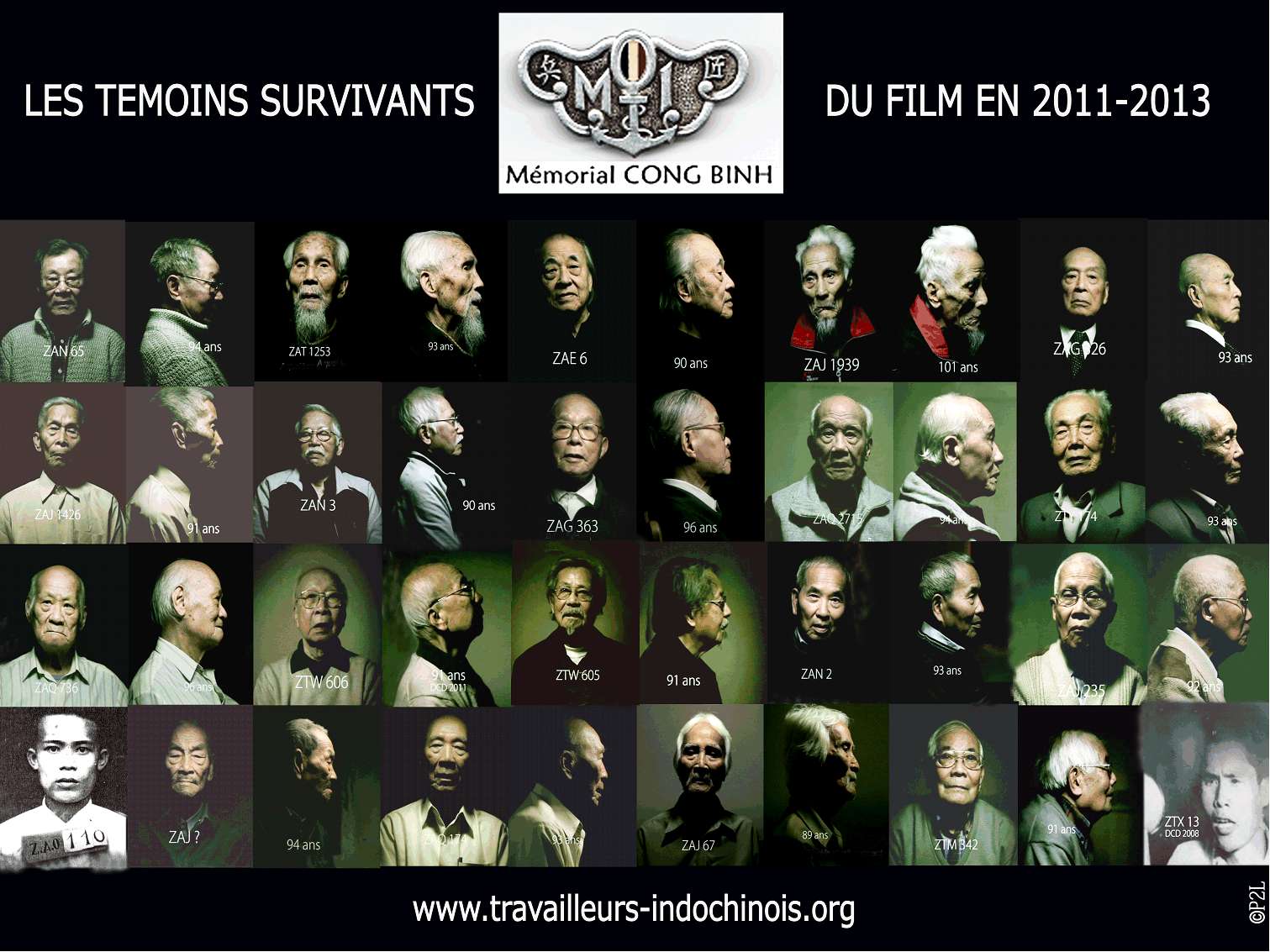
(c) Lam Lê
Ces hommes, rappelons-le, étaient les pionniers de la culture du riz comestible en Camargue. Ils ont travaillé dans les salines du Midi au bénéfice de la chimie pharmaceutique de Péchiney et Solvay. Ils ont accepté toutes sortes de besognes ingrates, au service de l'État français qui est leur employeur officiel et le garant de leurs droits de citoyens.
Depuis la sortie de mon film, Cong Binh, la longue nuit indochinoise , beaucoup de vos collègues parlementaires de toutes tendances politiques ont, lors de la 14 ème législature, posé des questions écrites aux différents ministères du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du dialogue social, de la santé et des anciens combattants.
Questions parlementaires dont je me permets de livrer ici un aperçu :
« Reconnaître leur apport à l'effort de guerre. Reconnaître qu'ils ont subi une forme de travail forcé... En vertu de l'instruction générale du 24 juillet 1934, la MOI, organisme civil du ministère chargé du travail de ces hommes, percevait bien des employeurs, auxquels elle louait cette main-d'oeuvre, des sommes au titre des assurances sociales. Il est donc demandé si le ministère concerné envisage de régulariser ce défaut d'immatriculation et de versement des cotisations, afin que le régime général puisse honorer la juste revendication portée par ces anciens travailleurs requis en permettant par toutes les mesures adaptées : levée d'éventuels délais de forclusion, attribution rétroactive d'un numéro d'immatriculation etc. Il est donc souhaitable de savoir si le gouvernement ne doit pas considérer que cette absence d'affiliation, tant à l'arrivée de ces hommes en 1939-1940, que lors de l'interminable retenue sur le sol métropolitain dont ils furent victimes du fait des atermoiements de l'État à les rapatrier, constitue une carence de sa part... »
En cette année croisée France - Vietnam en France, nous espérons avec force et conviction que ces mots prononcés le 20 décembre 2012 à Alger par M. François Hollande, président de la République Française, à savoir :
« Rien ne se construit dans la dissimulation, dans l'oubli et encore moins dans le déni.
La vérité, elle n'abîme pas : elle répare.
La vérité, elle ne divise pas : elle rassemble ».
Nous espérons ardemment que ces mots ne restent pas des mots mais se traduisent un jour en actes.
Je vous remercie de votre attention.
Mme Françoise Vergès
Bruno Barrillot a été délégué au suivi des conséquences des essais nucléaires auprès du gouvernement polynésien de 2005 à 2013.
M. Bruno
Barrillot,
ex-délégué au suivi des conséquences
des essais nucléaires
auprès du gouvernement polynésien
de 2005 à 2013
Les essais nucléaires en Polynésie
française :
193 bombes explosent entre 1966 et 1996
Deux mois après Hiroshima et Nagasaki, en octobre 1945, le général de Gaulle créait par ordonnance le Commissariat à l'Énergie atomique « pour que la France puisse tenir sa place dans le domaine des recherches concernant l'énergie atomique », civiles et militaires.
En octobre 1958, l'État français entreprend le « nettoyage » politique de la Polynésie qui s'ouvrait aux perspectives de l'indépendance comme les autres pays de l'empire colonial français : le député et leader polynésien Pouvanaa a Oopa, qui avait appelé à voter « non » au référendum du 28 septembre 1958, est arrêté, emprisonné, jugé et exilé en France au prétexte d'avoir voulu incendier Papeete .
Fin 1963, alors que la France doit quitter les sites d'essais du Sahara où elle effectuera 17 explosions nucléaires, le général de Gaulle, en personne, convoque à Paris le représentant de l'assemblée territoriale M. Jacques-Denis Drollet, et exige la cession à la France des deux atolls de Moruroa et Fangataufa pour ses expériences atomiques, menaçant, en cas de refus, d'installer un gouvernement militaire à Tahiti.
À partir de 1964, des milliers d'hommes polynésiens sont recrutés dans les îles et embauchés comme main d'oeuvre sur les atolls nucléaires sans aucune information sur les risques radioactifs. Peu à peu, leurs familles quittent les îles pour s'entasser à Tahiti. Dans le même temps, des milliers de militaires français débarquent sur Tahiti et dans quelques îles périphériques de Moruroa avec toutes les conséquences sociales que l'on imagine. La société traditionnelle polynésienne (100 000 habitants à la fin des années 1960 répartis sur 118 îles et atolls) subit une véritable implosion en l'espace de quelques années.
Dès les premiers essais aériens, la propagande officielle annonce que « nos essais sont particulièrement propres » et le Général de Gaulle rassure lui-même les Polynésiens à Papeete le 9 septembre 1966 affirmant qu'« il n'y aura aucun inconvénient d'aucune sorte pour les chères populations de la Polynésie ».
Après l'éviction du député Pouvanaa, une nouvelle classe politique polynésienne et la petite bourgeoisie « demie » et chinoise sont inondées par l'argent de la corruption et des marchés de la bombe, en contrepartie d'un soutien affiché au programme d'essais nucléaires et d'un silence imposé sur les conséquences sanitaires que beaucoup constataient : fausses couches, naissances anormales, vols de cancéreux sur Paris...
Le 2 juillet 1966 le premier essai à Moruroa provoque des retombées radioactives imprévues sur l'île de Mangareva à 400 km : c'est quasiment Tchernobyl. Les autorités présentes, dont le général Billotte, ministre de la France d'Outre-mer, et l'actuel président sénateur de la Polynésie, s'enfuient et imposent le silence sur cette première catastrophe nucléaire. Avec 46 essais aériens entre 1966 et 1974, c'est l'équivalent de 675 bombes d'Hiroshima sur la Polynésie dont on sait aujourd'hui qu'elles ont provoqué au moins 360 retombées radioactives sur les îles habitées de toute la Polynésie.
Entre 1975 et 1996, on compte 147 essais souterrains dans les sous-sols fragiles des deux atolls de Moruroa et Fangataufa. Les explosions provoquent failles et effondrements impossibles à contenir jusqu'à aujourd'hui. Alors que la propagande officielle affirmait que les essais souterrains étaient « parfaitement contenus », les documents officiels aujourd'hui déclassifiés montrent qu'un essai souterrain sur trois a provoqué des fuites radioactives. Les atolls de Moruroa et de Fangataufa sont devenus des poubelles nucléaires en plein océan, pour des millénaires.
Déni et désinformation font encore aujourd'hui partie du discours public de la France. Ainsi en septembre 2013, après une visite éclair à Moruroa, le délégué à la sûreté nucléaire de défense et le président sénateur de la Polynésie ont encore affirmé publiquement que « Tout va bien à Moruroa ».
Depuis 2008, 650 nouveaux cas de cancers sont déclarés chaque année en Polynésie. La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie a dû assurer les soins pour 5 089 polynésiens atteints de maladies reconnues comme radio induites depuis l'année 2000. Les archives médicales antérieures à l'année 2000 sont irrémédiablement perdues ou couvertes par le secret défense : en effet, jusqu'au milieu des années 1980, soit plus de 20 ans après le premier essai, la direction des hôpitaux civils et des services de santé publique de la Polynésie étaient assurées par le Service de santé des armées qui n'a laissé aucune archive.
Aujourd'hui les Polynésiens, les Algériens et les personnels français civils et militaires des essais se heurtent encore au déni et au mépris des autorités de la République. La loi du 5 janvier 2010 dite « de reconnaissance et d'indemnisation des victimes des essais » est un véritable fiasco. À ce jour, 12 personnes ont été indemnisées, dont 4 Polynésiens, et des centaines de demandeurs ont vu leur demande d'indemnisation rejetée au motif que le risque auquel ils avaient été exposés était « négligeable ». Une note optimiste cependant sur ce dossier : après le dépôt d'une proposition de loi du sénateur Richard Tuheiava, co-signée par les sénateurs du groupe socialiste de l'outre-mer, le 20 décembre 2012, une initiative de Mme Corinne Bouchoux, sénatrice écologiste, va permettre un réajustement de cette loi d'indemnisation qui a reçu l'accord du ministre de la défense. Dans quelques jours, l'Assemblée nationale devrait probablement le confirmer.
Voilà les faits, en quelques mots. De mon point de vue, s'il fallait qualifier ces 30 années d'essais nucléaires, j'affirme qu'il s'agit du fait colonial le plus violent et déstructurant qui ait affecté et affecte encore pour des générations la Polynésie tant sur le plan sanitaire et environnemental qu'aux plans économique, social, culturel et politique.
Mme Françoise Vergès
Pascal Blanchard est historien, spécialiste du « fait colonial », chercheur au Laboratoire Communication et Politique (CNRS) et membre du Groupe de recherche Achac. Il vient de codiriger les beaux-livres « La France arabo-orientale » (2013), après l'ouvrage collectif « La France noire » (2011).
M. Pascal Blanchard,
historien,
chercheur au Laboratoire Communication et Politique (CNRS)
et Groupe de
Recherche Achac
Un musée des colonisations, au carrefour des
histoires et des cultures
Ces chapitres oubliés de l'Histoire nécessitent souvent de faire appel à l'émotion pour sensibiliser une opinion qui ne s'y intéresse guère. Notre difficulté est de les faire pénétrer dans la société française afin de placer l'émotionnel au second plan et mieux fixer ces récits dans la mémoire collective. En faire patrimoine. En faire une mémoire collective.
Depuis de nombreuses années, nous prônons, dans cette perspective, le musée comme l'un de ces espaces de fixation de ces récits, non pour momifier, ni pour enfermer définitivement ni clore ces chapitres mais pour les mettre en partage.
Le musée permet de transmettre un savoir, une connaissance, difficiles à traiter ailleurs. Les professeurs et les manuels d'histoire sont souvent accusés d'être les acteurs de cette méconnaissance de l'Histoire coloniale, présupposant que la réponse aux problématiques du temps est exclusivement entre leurs mains et celle des manuels. Or, cette transmission ne repose pas que sur eux.
Il faut également disposer de relais culturels, et notamment les musées pour raconter l'Histoire coloniale en France. Mais, en France, on n'a pas trouvé un bout d'hectare pour construire un musée capable de raconter l'histoire de ces cinq siècles - depuis Jacques Cartier en 1534 au Canada -, ni l'histoire de notre relation au monde. C'est assez incroyable.
Le Guide Dexia parle à cet égard de dix mille musées en France. Si l'on compte les musées municipaux et autres musées d'arts, associés aux musées d'entreprises et ceux des régions, on parle de plus de douze à treize mille « institutions muséales », dont quelques mille « musées importants » en France. Et oui, la France est le pays des musées. On parle de dizaines de millions de visiteurs (avec nombre de scolaires) dans les trente-cinq musées nationaux sous la tutelle du ministère de la Culture auxquels on peut ajouter ceux qui dépendent des autres ministères comme le musée des Invalides, le Musée de l'Homme ou celui de la Marine... Quel curieux pays ! 12 744 musées (selon notre estimation la plus fine...), 27 musées du sabot (et il doit y en avoir d'autres...) au coeur de nos régions et aucun musée d'Histoire coloniale.
Certes nous avons un mémorial à Nantes autour de l'esclavage, un lieu sur l'Algérie française à Montpellier qui s'ouvre, et même une Maison de la négritude et des droits de l'homme à Champagney, mais rien sur l'histoire coloniale dans sa globalité, ni un grand musée national sur ce thème, c'est déjà ce que nous rappelions en juin 2000 dans une tribune pour Libération 26 ( * ) . Bien entendu il y a des lieux comme le Centre Tjibaou ou le futur Mémorial ACTe aux Antilles, mais ils ne sont pas eux aussi sur une histoire globale. Ces thèmes sont présents aussi au Musée du Quai Branly, au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) ou au futur musée des confluences, mais le thème des colonisations n'en n'est pas le centre, juste la périphérie...
Pourtant, cette Histoire fait encore sens dans le présent, et raconte un nous collectif, mais en fin de compte nous ne la connaissons pas. Certains prétendent que les générations précédentes ne la connaissaient pas non plus. Or, en moyenne, 40 % à 50 % des manuels d'histoire-géographie en 1954-1958 concernait les outremers. Les écoliers d'alors savaient ce qu'étaient l'Algérie, Antananarivo ou les Antilles ; les colonies lointaines et les vieilles colonies étaient alors proches. Cette Histoire faisait partie de la France et de ses identités. Dans le cadre d'une propagande d'État organisée, certes, mais aussi d'une éducation « nationale ». Nous sommes passés d'un extrême à l'autre.
La rupture qui s'est produite dans les savoirs et la connaissance ne nous permet plus de comprendre qui nous sommes, et qui nous avons été. La République nous explique pourtant que nous sommes les enfants de cette Histoire. Notre destin commun se serait écrit lors de la Révolution française et dans ses héritages mais aussi avec les rois de France depuis des siècles et depuis - paradoxalement - les Croisades. En son coeur, se sont également construits cinq Républiques et un Premier Empire (jusqu'en Égypte) et un Second Empire (jusqu'au Mexique) qui ont colonisé ou découvert, à l'instar de quelques rois de France avant eux et entre les deux Empires, certaines parties du monde. Tout cela constitue l'Histoire de France, sans que pourtant aujourd'hui aucun musée d'Histoire coloniale n'en soit le témoin.
Cette absence de musée, pensons-nous, est devenu un symptôme révélateur de notre incapacité à digérer cette Histoire, afin de la relater sereinement dans le présent. Ces histoires, nous ne savons pas comment en parler ; elles nous effraient, car elles persistent, malgré la fin du colonialisme comme si elles hantaient notre mémoire nationale. Nous avons le sentiment d'avoir tourné la page coloniale, d'avoir fermé la grande nuit coloniale. Mais c'est faux. Les interventions de cet après-midi nous prouvent que la page n'est pas tournée. Qu'elles sont dans le présent.
Ces histoires continuent dans le présent, et ne sont pas uniquement facteurs de violence. Elles nous parlent de littérature, de langue française aussi. Elles nous expliquent comment, dans la colonie, certains ont trouvé les armes pour abattre la colonie, les Césaire, les Senghor, les Messali Hadj et d'autres ont quelque part fondé leurs pays sur une partie des héritages de la Révolution française. C'est aussi cela qu'il faut apprendre et savoir.
Le premier nom des dizaines de coloniaux qui ont fait la France, inscrits sur le Palais des Colonies construit sous l'égide et la conduite du Maréchal Lyautey (Porte dorée lieu qui héberge actuellement la CNHI/Musée de l'histoire de l'immigration), est celui de Godefroy de Bouillon, roi de Jérusalem (1099), actant de l'ancienneté de cette Histoire qui est au coeur de l'identité française.
Une partie de notre « identité » a été coloniale (c'est un fait) et ce lieu en garde les traces 27 ( * ) , comme l'a démontré l'embarras de notre actuel Président de la République lorsqu'il s'est rendu compte -- un peu tard --, que le choix de Jules Ferry comme personnage emblématique de son quinquennat était délicat . Car, il y a aussi, nous le savons, le Jules Ferry « colonisateur ». C'est une ambiguïté française, et pourtant ce même Président de la République posera sans doute un jour la première pierre de ce musée « des » colonisations qui portera cinq siècles d'histoire.
Tous les grands chefs d'État de la V e République, excepté Nicolas Sarkozy (par manque de temps), ont bâti des lieux qui participent de la construction de la République : Beaubourg, le musée du Quai Branly, le musée d'Orsay, la pyramide du Louvre, la très grande bibliothèque. Ces lieux construisent la connaissance, ce passage entre générations et la France de demain. Ils permettent, à travers des expositions ou des projets pédagogiques d'expliquer simplement que la France est complexe, qu'elle est capable de se regarder en face, ou que notre processus « d'intégration », issu de l'assimilation, est compliqué à déchiffrer. Essayer d'expliquer à des Japonais ce qu'est l' intégration française ! Voilà une Histoire tortueuse qu'il s'agit de dénouer dans un musée un jour.
Néanmoins, raconter ces Histoires dans toutes leurs contradictions nécessite du temps. Le musée est pour cela un lieu idéal. Il ne sera pas le musée de ceux qui ont dû courber l'échine, ou uniquement de ceux qui sont les enfants de cette Histoire, mais également de ceux qui ont une histoire qui s'écrit là-bas : le lieu des rapatriés, des combattants de la guerre d'Algérie, de nous tous, dont une part de l'histoire est inscrite dans cet endroit. Les jeunes des quartiers populaires ou d'Outre-mer n'ont pas attendu que ces Histoires soient évoquées, pour « brûler des voitures ». Parler de ces Histoires ne créera pas de « fractures » nouvelles dans la société française ; les taire, oui.
Les fractures de l'Histoire rendent notre héritage colonial complexe à traiter, car il déclenche des émotions particulières. Ces histoires ne sont pas neutres, mais d'une violence incroyable. Pourtant, d'autres pays ont déjà démontré que ce regard était possible. Qui aurait cru dans l'entre-deux-guerres qu'un manuel franco-allemand puisse exister un jour ? Qui aurait cru qu'un Président allemand puisse aller à Oradour-sur-Glane ? Qui aurait cru que l'Afrique du Sud post-apartheid, encore aujourd'hui avec des difficultés, parvienne à écrire une Histoire commune ? Personne.
Ces passés sont complexes à digérer. Une vingtaine d'entre nous a écrit en mai 2012 28 ( * ) qu'il était indispensable de créer ce lieu, non pas pour raconter l'histoire des victimes, mais une Histoire qui ferait partie intégrante de notre récit commun. Il permettrait à toutes les histoires racontées ici de faire sens, et que demain, après nous, les élèves venant avec leurs professeurs puissent comprendre ce qu'était l'Algérie française, ce qu'a été l'Indochine, ce que sont les zoos humains , pourquoi le regard sur l'homme et la femme noirs s'inscrit dans une histoire particulière, pourquoi une publicité telle que Banania renvoie à des imaginaires particuliers ; pourquoi tout cela s'explique, se décode, se déconstruit, pour aller au-delà et « digérer » ce passé.
Aucune nation ne serait capable de mener un tel enjeu, d'après certains. C'est oublier que des pays l'ont fait. La marche menant Martin Luther King à son discours voilà 50 ans (1963) a aujourd'hui contribué à la construction d'un musée des Afro-américains, situé à quelques pas de la Maison Blanche. Le président Obama l'inaugurera à la fin de son second mandat (2015). Qui aurait cru, à cette époque, qu'au coeur de la capitale fédérale, un musée immense se tiendrait, avec, dans le hall d'entrée, un train reconstitué pour expliquer aux visiteurs comment les hommes et les femmes étaient alors séparés entre blancs et noirs. Si l'Amérique est capable de le faire, la France, trente ans après une célèbre « marche » de 1983, doit l'être également. Cela prend du temps. Idem en Afrique du Sud avec le musée de l'Apartheid, en Australie ou au Brésil.
Il faut une dynamique, une volonté, un désir pour bâtir de tels lieux. Le travail des historiens a été fait, celui des réalisateurs, des cinéastes, des sociologues, des anthropologues, des ethnologues également. Lorsque des hommes s'engagent pour faire entendre ces paroles, le public vient. Ces expositions sont des succès primés (voir celle que nous avons fait avec Lilian Thuram et Nanette Snoep au Musée du Quai Branly en 2012 : Exhibitions. L'invention du sauvage ). Ces histoires intéressent beaucoup de monde aujourd'hui, parce qu'elles nous permettent de parler autrement avec nos enfants et d'éviter que demain d'autres hommes ou femmes politiques soient agressés ou insultés.
Le musée permet aussi -- et surtout -- la patrimonialisation. C'est essentiel désormais. Il faut tourner la page de l'émotion et entrer dans le temps du patrimoine. Demain, nous ne regarderons pas ces lieux, ces images, ces histoires, ces territoires de la même manière que nous les regardons aujourd'hui. Ils méritent respect, et doivent entrer dans le patrimoine national. Dans la législation actuelle, la découverte de vestiges archéologiques suspend la construction de routes, d'immeubles. L'administration répond parfaitement à ce type de demandes. Le même processus devrait s'appliquer à ces récits sur les colonies, dont la patrimonialisation ne peut se faire qu'à travers un musée qui constituera la trace que laissera notre génération aux générations futures. Dans nos outremers, dans nos quartiers populaires, dans les anciens territoires ultramarins ou sur les lieux d'histoire de ces empires, comme dans le Jardin d'acclimatation de Paris ou dans le bois de Vincennes (jardin tropical de Nogent), ce travail doit désormais être engagé.
En tant qu'héritiers d'une histoire qui doit pouvoir désormais se transmettre dans une grande institution culturelle, nous pensons que ce Musée (ou une institution équivalente portant un autre nom) est notamment nécessaire pour que chacun trouve sa place dans le grand récit national. Sa juste place. Ni plus, ni moins.
Nous le savons, un musée d'histoire ce n'est pas qu'un objet froid sur des murs tout blancs... c'est aussi un des outils essentiels des politiques publiques pour redonner à la Nation la fierté de croire en ses enfants, quelles que soient leurs origines, leurs destins ou leurs mémoires encore douloureuses ou en conflit. Car l'histoire est devenue une source de légitimité (ou non) pour ceux qui vivent en France et dont les ancêtres sont venus de pays non-européens, une manière de rappeler que la Nation fut forte lorsqu'elle sut ouvrir ses frontières (en 1870, en 1914-1918, en 1943-1945), une manière aussi de poser les bases d'une politique cohérente, tout en soulignant que cette cohérence induit d'agir de concert dans des territoires qui peuvent sembler éloignés.
C'est la question nationale et l'unité de la nation qui sont ici interrogées. Ce qui est en jeu désormais dans la reconnaissance de l'Autre, c'est la préservation des valeurs nationales qui autorise, en quelque sorte, à nier celui-ci. Toute la difficulté est de faire de la différence un élément, non de délitement - ce qui est toujours possible si on en fait un objectif en soi -, mais de construction du national. La société française est aujourd'hui traversée par des processus de transformations protéiformes : postcolonial, postindustriel, flux d'immigration, échanges culturels, ouverture à l'Europe, altération des frontières... Il faut dépasser ces enjeux de l'instant pour bâtir l'avenir.
Dans la société métissée qui est la nôtre, et tout en récusant toute forme de communautarisme, cela s'apparente à un pur déni de réalité que de ne pas « intégrer » tous les récits, déni qui a toutes les apparences d'une fuite en avant, lourde de graves périls. Il est temps de décoloniser les imaginaires. De les faire entrer au musée...
Mme Françoise Vergès
Serge Romana est professeur des universités à la faculté de médecine de l'Université Paris-Descartes, et praticien à l'hôpital Necker - Enfants malades. Il est président de l'association CM98, créée en octobre 1999, dont la mission est de prendre « en charge les problématiques identitaires et mémorielles des Antillais, des Guyanais et des Réunionnais, dans le but d'améliorer leur insertion au sein de la République ». Le CM 98 organise chaque année la journée du 23 mai, dédiée aux victimes de l'esclavage, anime une université et a entrepris un travail de généalogie conséquent, qui a « pour objectif d'aider les Antillais descendant d'esclave à rechercher leur ascendance esclave ou libre de couleur ». Au-delà de l'investigation généalogique, l'atelier permet à ses membres de comprendre comment leurs familles se sont construites pendant et après l'esclavage : redonner nom pour redonner existence. C'est ce que fait le CM98, en reproduisant tous les noms de chacun des registres.
M. Serge
Romana,
président du Comité Marche du 23 mai 1998
(CM98)
Mai 1967 à la Guadeloupe : une répression
meurtrière
26 et 27 mai 1967, Guadeloupe : un crime d'État impuni
Les 26 et 27 mai 1967 ont eu lieu à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, des affrontements meurtriers entre les forces de l'ordre, des ouvriers du bâtiment en grève et des jeunes des quartiers populaires de la ville, qui firent un nombre encore indéterminé de victimes parmi les manifestants. Selon le préfet de l'époque, monsieur Bolotte, ces affrontements auraient fait 8 morts. Selon le mouvement nationaliste guadeloupéen, les victimes auraient été au nombre de 50. Le 14 mars 1983, Georges Lemoine, alors ministre des DOM, déclara qu'il y eut durant ces deux journées 87 morts. Aucune mission parlementaire n'a été dépêchée, aucune investigation officielle n'a été entreprise pour faire la lumière sur ce qui est un crime d'État sous la V e République contre des originaires d'outre-mer.
Que s'est-il passé les 26 et 27 mai 1967 ?
Parce qu'il serait insultant pour les victimes de présenter cette tuerie en 5 à 10 minutes, je me contenterai de rapporter les éléments principaux de cet événement tels que les ont écrits les rares historiens qui se sont penchés sur la question. Je me permettrai à la fin de faire une proposition à Madame Françoise Vergès et à Monsieur le président du Sénat pour que la lumière soit faite sur cet épisode qui a marqué des générations de Guadeloupéens, dont la mienne.
D'un point de vue économique et social, l'histoire commence avec le traité de Rome, instituant la Communauté économique européenne (CEE). Ce dernier signe en effet la fin de la protection du sucre des colonies françaises dont la production aurait dû, d'un point de vue purement économique, être arrêtée ou diminuée fortement après l'abolition de l'esclavage. Il s'en suivra une capitalisation accélérée de l'économie sucrière avec une diminution rapide du nombre d'usines qui fut suivie d'un chômage massif, endémique, qui perdure malgré l'émigration massive des Antillais vers la métropole dès le début des années 60. La misère va croître avec le passage de deux cyclones : Cléo en 1964 et surtout Inès en 1966.
D'un point de vue politique : la fin des années 50 et le début des années 60 sont marqués par le développement des mouvements nationalistes antillais et particulièrement celui de la Guadeloupe avec la répression qui l'accompagne. En 1961, c'est la dissolution du Front Antillo-Guyanais pour l'autodétermination par le général de Gaulle ; en 1962, c'est le procès des jeunes de l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique (OJAM) dont on vous parlera dans quelques instants. Mais surtout, en 1963, c'est la création du Groupe d'organisation national de la Guadeloupe (GONG). Son activisme va être repéré par les services de renseignements, en particulier après des incidents à caractère racistes qui avaient agité la ville de Basse-Terre le 21 mars 1967. C'est ainsi que le 17 avril 1967, le rapport envoyé au Procureur général de la République indique que le GONG « constitue bien le souci majeur des autorités locales ».
L'étincelle : une revendication d'ouvriers du bâtiment demandant 2 % d'augmentation. Dès la fin du mois de mars (23 mars 1967), les ouvriers de plusieurs entreprises enclenchent un mouvement social pour l'obtention d'une augmentation de salaire de 2 %. Après les échecs des précédentes commissions paritaires, un rendez-vous est pris le vendredi 26 mai 1967 devant la chambre de commerce de Pointe-à-Pitre où se tient une commission paritaire. Devant l'échec des négociations et une provocation raciste du chef des patrons (il aurait laissé entendre, selon un délégué syndical, que « lorsque les nègres auront faim, ils reprendront le travail »), c'est l'effervescence parmi les grévistes d'autant que des pelotons de CRS se tiennent aux abords de la chambre de commerce. Commencent alors des échauffourées et, vers 15h30, le préfet Bolotte sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, Monsieur Fouchet, et du ministre des DOM, le général Billotte, donne l'ordre de « se mettre sur le pied de guerre et de faire usage de toutes les armes ». La première victime sera Jacques Nestor, militant du GONG présent au milieu des manifestants. Durant deux jours, les « forces de l'ordre » sillonneront Pointe-à-Pitre, tueront et blesseront un nombre indéterminé de personnes. Il y eut des dizaines d'arrestations. En particulier, sur commission rogatoire du 31 mai 1967 de Monsieur Vigouroux, juge d'instruction près la Cour de sûreté de l'État, 18 personnes considérées comme leaders du GONG (12 en Guadeloupe et 6 à Paris) sont incarcérées à la santé.
Épilogue
Ces 18 personnes seront disculpées après un procès qui s'ouvre à Paris le 19 février 1969 et qui durera deux semaines.
Le 30 mai 1967, le préfet Bolotte préside une commission paritaire qui finit par accorder 25 % d'augmentation aux ouvriers du bâtiment.
Aucune plainte n'a été déposée par une famille guadeloupéenne contre l'État français.
Proposition
Parce qu'il s'agit d'un crime d'État sous la V e République,
Parce que c'est de l'honneur, de la probité et du respect de la République dont il s'agit, parce que les événements de 1967 renforcent le sentiment de défiance des Guadeloupéens vis-à-vis de la République française,
Je suggère que très rapidement se tienne au Sénat une rencontre comme celle-ci centrée exclusivement sur les événements de mai 67, avec des historiens, des victimes et des témoins de cette douloureuse période.
Cette rencontre permettrait peut-être de déclassifier des documents « secrets défense », de faire la lumière sur cette tuerie et, le cas échéant, de juger et de condamner les vrais coupables des massacres de mai 67.
Mme Françoise Vergès
Dans les dix départements d'outre-mer, de nombreuses violences d'État qui se sont déroulées dans les années 1960 et 1970 sont particulièrement inconnues du grand public. Cette politique d'État a contribué à des fraudes électorales et des emprisonnements injustes.
Mme Françoise Vergès
Rokhaya Diallo est journaliste, réalisatrice et administrative du réseau européen contre le racisme (ENAR). Diplômée d'une maîtrise de droit international européen, elle est sollicitée en 2002 pour présider le Conseil local de la jeunesse. Militante du mouvement Mixité, elle fonde en 2006 l'association « Les indivisibles » pour lutter contre le racisme, et « les préjugés ethno-raciaux, et en premier lieu, ceux qui nient l'identité française des Français non-blancs », décernant depuis 2009 les Y'a bon Awards . Elle a lancé un appel en 2010 avec Lilian Thuram, Marc Cheb Sun, François Durpaire et Pascal Blanchard pour une République multiculturelle et post-raciale. Elle a publié « Racisme, mode d'emploi » en 2011.
Mme Rokhaya
Diallo,
journaliste, réalisatrice, administratrice
de l'ENAR
(réseau européen contre le racisme)
Les marches de la
liberté, Washington 1963 - France 1983
2013 est une année de commémoration pour les Français et les Américains. Le 28 août 1963, la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté se clôture par le fameux discours de Martin Luther King. 20 ans plus tard, le 3 décembre 1983, les Marcheurs pour l'égalité et contre le racisme arrivaient à Paris, auréolés d'un succès inattendu.
J'ai voulu réaliser ce documentaire sur ces deux marches de la liberté, car la marche française de 1983 interroge notre génération. 81 % des Français de moins de 40 ans ne savent rien de cette marche. Nous avons constaté lors de ce documentaire que les Français ne connaissaient pas leur propre Histoire. Cela faisait un étrange écho à la marche cinquantenaire de commémoration de 1963 aux États-Unis, qui a réuni 100 000 personnes. Le trentenaire de la marche française ne réunira probablement pas autant de personnes. Rappelons qu'en 1983 100 000 personnes sont venues à Paris, représentant plus de personnes, proportionnellement à la population française, que les 250 000 personnes qui avaient marché aux côtés de Martin Luther King.
Ce « mai 1968 des enfants d'immigrés » a complètement été éradiqué de la mémoire collective. Elle a été rebaptisée « Marche des Beurs », de manière caricaturale.
Nous avons grandi dans le mythe de ces immigrés qui rasaient les murs et baissaient la tête, sans que l'on promeuve, à la génération issue de l'émigration postcoloniale, une image de leurs parents digne, se rebellant contre un ordre injuste pour eux.
L'intérêt de mettre ces deux marches en parallèle est non seulement d'illustrer que les marcheurs de 1983 s'étaient inspirés de Martin Luther King et de Gandhi, mais également de montrer que la mémoire n'avait pas été transmise.
L'antiracisme en France ne cesse de puiser dans la mythologie internationale, célébrant Martin Luther King, Angela Davis, Nelson Mandela, Gandhi, mais jamais de Français. Le nom de Toumi Djaidja et ceux des personnes qui ont marché à ses côtés sont inconnus de la France, et exclus de la mémoire collective. Aucun livre d'Histoire ne mentionne ces marches.
Le but de ce film est de permettre aux jeunes générations de créer leur propre mythe. Des figures de fierté ont existé en France. Si les marcheurs se sont inspirés de l'Histoire internationale, nous pouvons nous inspirer de ce qu'ils ont fait.
Chaque génération a le sentiment d'être précurseur, ce qui n'est pas le cas. Le capital de mobilisation créé par nos aînés ne se transmet pas.
En 1963, quasiment aucune femme, à l'exception de Joséphine Backer, n'était présente aux côtés de Martin Luther King. En France, de nombreuses marcheuses, dont on ne parle pas assez, avaient participé. Aujourd'hui, dans le militantisme, de nombreuses femmes marchent également mais on en parle moins.
Une autre marche importante est celle du 23 mai 1998, destinée à permettre la reconnaissance de l'esclavage. Ces marches sont héritières les unes des autres, et on ne peut séparer les beurs des descendants d'esclaves ou d'immigrés africains subsahariens. Le but est de restituer cette Histoire oubliée, de restaurer la dignité de nos aînés et d'inscrire ces Histoires dans la mémoire collective afin que ces personnes soient reconnues au même titre que Martin Luther King ou Nelson Mandela.
Mme Françoise Vergès
Cette méconnaissance de la lutte des aînés est avérée. Il est primordial de faire connaître cette lutte constante. De nombreux sites voient le jour sur la longue Histoire coloniale et postcoloniale, tel que le Mémorial Pnom Binh. L'enjeu d'un musée serait de constituer un espace où tout ce matériel déjà existant soit rassemblé.
Mme Françoise Vergès
Camille Mauduech est réalisatrice. Licenciée en cinéma, elle gère depuis 1989 la société de production martiniquaise Plein Sud. Parmi ses films, nous pouvons citer « La Martinique aux Martiniquais », « Les 16 de Basse-Pointe », « Juste un coup de peigne », « Casse-Pilote », etc. Elle termine actuellement un documentaire sur les grandes grèves de 1974 en Martinique.
Mme Camille
Mauduech,
réalisatrice
« Chalvet, la longue marche
de la dignité »
ou la dernière grande grève
ouvrière de 1974
à la Martinique violemment
réprimée
Mon travail de cinéaste s'appuie sur l'histoire contemporaine : à ce jour, trois films documentaires qui prennent leurs marques dans l'histoire politique et sociale de la Martinique. Trois films, trois « chapitres oubliés ».
|
Diffusion du film LES 16 DE BASSE-POINTE (2009) |
En Martinique, en 1948, le meurtre d'un patron béké lors d'un mouvement de grève par 36 coups de coutelas place sur le banc des accusés, à Bordeaux, 16 ouvriers agricoles nègres et indiens promis à la peine de mort. Non seulement leur silence est à l'épreuve de toutes les manigances policières (ils ne se dénoncent pas les uns les autres), mais la solidarité des ouvriers de France fait de ce procès le premier procès du colonialisme français aux Antilles. Ce procès, qui a un bel écho dans la presse nationale, rend à ces hommes leur dignité face à l'image de sauvages qu'on veut leur coller à la peau, sauvages faisant une danse de la mort autour du cadavre de Guy de Fabrique. À l'époque, cette histoire ouvre les yeux de milliers de français sur une réalité : la haine sociale et inévitablement raciale dans la société coloniale d'outremer.
L'importance historique, outre la leçon morale de dignité et de solidarité, de cette histoire, réside dans le fait que c'est un chapitre qui met un terme à l'idée du béké maître, père, dieu, immortel, invincible. Aimé Césaire, interrogé dans ce film, répond à l'une de mes questions sur la violence surprenante de l'acte meurtrier par « ce qui est surtout surprenant, c'est qu'il n'y ait jamais eu de révolte plus générale ». Dans son sous-texte, cette histoire rhabille tous les protagonistes de la société coloniale post-esclavagiste de leur costume de mortel et dans l'état d'esprit de l'époque, dans la société d'habitation, la décolonisation des esprits s'anime : exister en tant qu'homme à part entière pour nombre de nègres de ce pays. Sortir des manipulations, être capable de solidarité, ne pas baisser les yeux. En effet, l'image du « père » que la colonisation a patiemment installée dans l'image du colon est ici battue en brèche : un exutoire historique qui reste malgré tout quelque peu honteux. C'est dire la force des images.
L'histoire des 16 de Basse-Pointe est une histoire de solidarité, une solidarité qui rend digne, qu'on peut trouver immorale, injuste par rapport à un meurtre non élucidé, mais avant tout une solidarité entre des hommes que le système fait tout pour diviser, nègres et coolies (indiens), et qui rencontre une autre solidarité, celle de leurs homologues ouvriers de France. Ce n'est pas rien que cette reconnaissance de classe qui traverse l'océan. Il est possible donc d'être ensemble réunis autour d'une même idée, d'une même valeur au-delà des questions de couleur et de territoire.
|
Diffusion du film L'affaire de l'OJAM, LA MARTINIQUE AUX MARTINIQUAIS (2012) |
Dans la nuit du 23 au 24 décembre 1962, un manifeste est placardé sur tous les murs des bâtiments publics de la Martinique, qui proclame « LA MARTINIQUE AUX MARTINIQUAIS ». Il est signé d'une organisation inconnue, l'Organisation de la Jeunesse Anticolonialiste de la Martinique (OJAM). L'OJAM est porteuse des espoirs de jeunes gens qui, persuadés d'être des français à part entière, se rendent compte dès leur premier contact avec la France dans le années 50-60 qu'ils n'en sont pas. Ainsi, ils sortent de cette cécité qu'a engendrée l'assimilation. Ils regardent vers Cuba, la grande soeur, vers Frantz Fanon en Algérie, le grand frère, et ils s'engagent. Ils s'engagent vers l'idée que les martiniquais constituent un peuple à part entière. Ce sont les prémisses des volontés d'émancipation nationale aux Antilles. Ils vont agir avec naïveté, ils échouent. L'OJAM est tuée dans l'oeuf.
C'est une histoire d'engagement politique, de volonté, de maturité, de résistance. C'est l'histoire de jeunes gens qui se soulèvent contre la colonisation répressive, celle qui n'autorise pas la dissidence. C'est l'image de la volonté politique au sens fort du terme, celle qui agit pour changer les mentalités, celle qui agit pour la responsabilité. Voilà une histoire qui s'enfile dans le collier de perles des chapitres oubliés. Sortir de l'infantilisation et d'un univers de croyances post-esclavagiste pour les 16, prendre ses responsabilités et repousser les limites de l'assimilation sociale, politique et économique, pour l'OJAM. C'est une histoire à connaître qui combat les clichés sur les martiniquais phagocytés ou empêtrés dans leurs querelles d'indépendance, d'autonomie, d'autonomie de gestion etc. C'est une histoire qui permet aux Martiniquais de se comprendre et à la France hexagonale, métropolitaine de les comprendre. Quelles sont les décisions qui nous ont engagées ? Quelles en étaient les intentions ?
|
Diffusion du film Les événements de CHALVET « CHALVET, la conquête de la dignité » (sortie prévue en 2014) |
Martinique, 14 février 1974. Une centaine d'ouvriers agricoles en grève sont aspergés de gaz lacrymogènes, cloués au sol par un hélicoptère qui tire à vue, encerclés par quatorze camions de gardes mobiles à Chalvet, dans le nord de l'île. Les versions divergent et se discutent. Cette grève est soupçonnée d'être dirigée par des gauchistes qui, usurpant la place des syndicats enracinés, menacent la stabilité économique et politique du pays en manipulant la classe paysanne. Un mort et quatre blessés graves par balles, des dizaines de blessés silencieux et la découverte du corps meurtri d'un jeune ouvrier signent, sans discussion, la page d'histoire consacrée à la grève de février 1974 en Martinique.
La Martinique des années 70 est prise dans une réalité qui crie son nom « chômage, vie chère, précarité ». Ces grèves ont incontestablement constitué un grand moment de la lente et profonde transformation des données de la vie sociale. Elles ont marqué le début d'un processus de décomposition et de recomposition non seulement du paysage syndical mais du paysage politique et social martiniquais.
La question de la dignité est centrale pour les ouvriers de la banane qui vivent en 1974 dans des conditions désastreuses à tous points de vues : salaires, droit du travail, produits toxiques dont le chlordécone déjà en 1974.
Un drame donc et son « trauma ». À qui la faute ? Aux militants gauchistes qui auraient « galvanisés » des ouvriers à des fins politiques révolutionnaires ? Au colonialisme sourd qui crie son nom et sa violence ? Lutte syndicale et lutte politique sont-elles nécessairement inséparables ? Que signifie l'association lutte de classe et lutte de libération nationale : une association idéaliste et artificielle ? Des promesses contradictoires ? Le développement d'une vision manichéenne de l'histoire ?
Quelle que soit la réponse, Chalvet s'inscrira dans l'Histoire avec une répression sanglante et deux morts. Deux morts dont un, un jeune homme de 19 ans, trouvé le corps meurtri sur une plage le lendemain des événements dont le décès n'a jamais été élucidé et pour lequel aucune plainte n'a jamais été déposée ? Ainsi sont créés les icônes, même les martyrs. Georges Marie-Louise, 19 ans, rejoint André Aliker assassiné en 1936 et, ensemble, ils reviendront inévitablement comme symboles dans d'autres conflits assurément programmés compte tenu de la situation de tension, d'amertume, de désespérance qui souffle sur les Antilles aujourd'hui. Le silence est une bombe à retardement.
Il y a dans chacun de ces chapitres oubliés de l'Histoire de France outre-mer une trace indélébile d'humanisme, une résistance à graver dans la mémoire, une universalité de la vie vécue qui traverse le temps et l'espace, des histoires qu'on critiquera comme étant régionales voire régionalistes. Non, elles embrassent des émotions ou expériences humaines universelles.
La thérapie de la France entière est en jeu dans la mise en exergue de ces histoires qui paraissent circonscrites à un territoire grand comme un mouchoir de poche mais qui mettent en relief des valeurs essentielles dans la France d'aujourd'hui, solidarité, résistance, dignité.
Pourquoi c'est important : parce qu'il s'agit de faire valoir les événements, les témoignages, les processus de mémoire contre l'anecdote, l'événementiel et le silence. Il s'agit aussi de se mobiliser contre des représentations qui nous stigmatisent dans des images folkloriques ; il persiste une quantité incroyable de clichés et d'images toutes faites sur les Antilles et les antillais : des images à condamner, à combattre, à éradiquer.
Pourquoi ces histoires en même temps d'ici, en même temps d'ailleurs sont-elles importantes à connaître, diffuser, discuter, écrire, filmer ?
Pour toutes les raisons précédentes, pour enrayer la haine raciale, pour enrayer l'ignorance et pour permettre à toute une génération d'enfants métis qui arrivent en force de trouver les deux facettes de l'histoire qui les constituent dans l'union et non dans le désamour, un métissage qu'il faut absolument éviter de construire dans la déstructuration. Il faut les encourager, ces enfants métis, leur donner des repères, des clés pour tenir le rôle primordial qu'ils auront dans ces sociétés européennes aujourd'hui déclarées xénophobes et racistes, qu'on essaie depuis si longtemps de marginaliser mais qui s'imposent à nous, dans l'espoir qu'il ne s'agisse plus que d'un temps.
Je vous remercie.
Mme Françoise Vergès
Salah Amokrane travaille depuis 1980 à un point de rencontre entre action sociale, éducation populaire et culture, aux côtés du groupe Zebda. Il est également responsable de Tactikollectif basé à Toulouse, qui organise des événements autour de la mémoire culturelle de l'immigration, dont le Festival Origine Contrôlée.
M. Salah
Amokrane,
Tactikollectif
L'assassinat d'Habib Grimzy
par trois
légionnaires dans la nuit du 14 novembre 1983.
Le crime
intervient alors que des milliers de jeunes
ont rejoint la marche de
l'égalité partie de Marseille le 15 octobre 1983
Le 14 novembre 1983, Habib Grimzy, touriste algérien, monte à bord du train Bordeaux-Vintimille de 22 h 27, afin de regagner Marseille pour rentrer en Algérie, après des vacances passées dans la région bordelaise, où il avait rendu visite à une amie.
Trois prétendants légionnaires, Anselmo Elviro-Vidal, 26 ans, Marc Béani, 20 ans, et Xavier Blondel, 20 ans, prennent le même train pour Aubagne accompagné d'un caporal-chef. Vers minuit, soûls, ils visitent les différents compartiments, tombent sur Habib Grimzy, et l'agressent violemment sans raison. Ils le rouent de coups. Le contrôleur, Vincent Perez, intervient, et se porte au secours d'Habib Grimzy. Il le met à l'abri dans un autre compartiment, dans une autre voiture, fermée à clefs.
Ces trois individus continuent de le chercher, et un autre contrôleur, qui n'était pas au courant des faits précédents, leur ouvre le compartiment. Ils agressent Habib Grimzy encore plus violemment, jusqu'à lui donner des coups de couteau. Comble de l'horreur, à 00 h 20, ils ouvrent la porte du train et le jettent sur les voies.
Son corps sera retrouvé au point kilométrique 190. L'autopsie montrera qu'il était vivant au moment où ils l'ont jeté du train. Deux des prétendants légionnaires sont arrêtés en gare de Toulouse, le troisième à Montauban alors qu'il tentait de s'enfuir.
90 personnes étaient dans ce train, dans les compartiments voisins de cette agression. Elles n'ont pas osé intervenir. Au moment où les agresseurs sont arrêtés, la police ne recueille pas les témoignages des voyageurs.
Les quelques témoignages recueillis attestent que ces prétendants légionnaires « cherchaient l'arabe ». Le caporal est également arrêté. Il n'a pas participé et dira avoir dormi, ne pas s'être rendu compte de ce qui se passait.
Les trois prétendants légionnaires sont jugés en 1986 à Montauban. Deux sont condamnés à la perpétuité, et l'autre à 15 ans d'emprisonnement car il tenait la porte. Deux ans plus tard, lors d'un nouveau procès tenu en raison d'un vice de forme du précédent, la perpétuité est muée en 20 ans d'emprisonnement pour l'un des condamnées.
Cet événement survient alors que la marche d'égalité contre le racisme a démarré un mois plus tôt. Excepté l'étape de Lyon, cette marche avait été peu suivie et peu couverte. Ce meurtre constitue un tournant dans cette marche, qui se situe à ce moment-là aux alentours de Colmar, et dont on commence à faire écho dans la presse et dans la société française. En effet, il provoque un émoi considérable. La presse et la classe politique s'en emparent. Le gouvernement de l'époque et les forces de gauche s'approprient cette marche pour en faire un événement de lutte contre le racisme. Des responsables politiques vont alors rejoindre certaines étapes de la marche - Jack Lang fera quelques pas lors de l'étape de Strasbourg - et appeler à un rassemblement massif à Paris, le 3 décembre 1983.
D'autres crimes ont été commis, mais le caractère violent et évidemment raciste de celui-ci a choqué. De 1981 à 1983, une cinquantaine de crimes racistes ont été rapportés. Au cours de l'été 1983, certains crimes auraient pu émouvoir, tel que le meurtre de Taoufik Ouanès, 9 ans, à la Courneuve, la clémence du jugement était d'ailleurs scandaleuse.
On ne connaît plus ce type de crimes aujourd'hui. De 1960 à 1980, 200 crimes racistes ou sécuritaires sont estimés contre des personnes étrangères ou supposées étrangères. Il est donc important de reconnaître ces crimes. Demain, 15 novembre 2013, le ministre de la Ville, Monsieur Lamy, apposera une plaque dans la gare de Castel-Sarrazin, en mémoire d'Habib Grimzy.
D'autres initiatives de ce type voient le jour. Les endroits qui ont vu ces drames doivent être marqués, afin que l'on puisse s'en souvenir et les faire rentrer dans l'Histoire des rapports sociaux de ce pays. Comme c'est le cas à Nanterre, ou la ville a décidé qu'une voie publique en mémoire d'Abdenbi Guémiah soit baptisée du nom de ce jeune Nanterrien, mort le 6 novembre 1982 des suites de ses blessures, dans l'ancienne cité Blanche-Gutenberg.
Enfin il est essentiel de se rappeler que ces drames, ont souvent suscité la mobilisation des familles et habitants qui se sont organisés en comité « justice et vérité », ou à l'image des « folles de la place Vendôme », ce collectif des mères d'enfants assassinés qui allèrent manifester jusque sous les fenêtres du ministère pour réclamer justice.
En outre, la marche de 1983 doit entrer dans l'Histoire et trouver sa place dans les manuels scolaires.
Mme Françoise Vergès
Les réactions à ce crime sont révélatrices. On détourne le regard, on fait comme si on ne voyait rien, car on consent ou on a peur de réagir. On peut aussi participer activement à la discrimination, comme les attaques sur les magasins appartenant à des Juifs en 1940. On peut également assister à des gestes de solidarité.
À travers tous ces destins, dispersés à travers des territoires et des temps différents, se dessine une Histoire du respect de la dignité. Se souvenir ensemble de toutes ces femmes, de tous ces hommes, qui ont été victimes ou qui se sont battus pour que les choses changent, est essentiel.
* 26 Tribune du 17 juin 2000 dans Libération par Pascal Blanchard intitulée « Un musée pour la France coloniale ».
* 27 Tribune du 3 décembre 2003 dans L'Humanité par Pascal Blanchard intitulée « Musée des immigrations ou musée des colonies ? »
* 28 Manifeste pour un musée des histoires coloniales, Appel dans Libération du 8 mai 2012, et dans Terra Nova le 9 mai 2012, par Françoise Vergès, Marc Cheb Sun, Nicolas Bancel, Pascal Blanchard. Jean-Christophe Attias, Esther Benbassa, Pascale Boistard, Ahmed Boubeker, Patrick Chamoiseau, Alexis Corbière, Catherine Coquery-Vidrovitch, Didier Daeninckx, Driss el-Yazami, Benoît Falaize, Eric Fassin, Olivier Ferrand, Bariza Khiari, Jacques Martial, Fadila Mehal, Achille Mbembe, Olivier Poivre d'Arvor, Claudy Siar, Benjamin Stora, Yazid Sabeg, Christiane Taubira...







