TABLE-RONDE N° 1 - TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES ET TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES
Président : Yves Rome, sénateur de
l'Oise
Modérateur : Joseph Confavreux, Mediapart
Les espaces ruraux sont hétérogènes, par la proximité aux centres urbains ou les spécialisations productives. La déconnexion entre lieux de vie et lieux de travail, que donne à voir la progression des espaces périurbains, contribue à redessiner les cartes des frontières sociales et de la ségrégation résidentielle, ainsi que les modes d'organisation familiale.
1. Populations, conditions de vie,
économie, paysages : des campagnes françaises aux multiples
visages
Mohamed Hilal
(UMR 1041, INRA-CESAER Dijon)
Le support de la présentation est disponible à l'adresse :
www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/sites/default/files/travaux_en_l_12_22032012-1.pdf
2. Le marché foncier : une
machine à hacher la société
Jean Cavailhes
(UMR 1041, INRA-CESAER Dijon)
a) Introduction
L'armature urbaine d'un pays se déforme en permanence, sous l'effet de forces locales et globales : les coûts de transport nationaux et internationaux des biens, la taille des marchés accessibles et la concurrence qui y règne, le coût de déplacement des travailleurs, les goûts des ménages, etc., modèlent les structures urbaines en les déformant et les reformant, comme la main du potier modèle l'argile. Or, au cours des 25 dernières années, des évolutions importantes ont affecté chacune des composantes qui pétrissent ainsi la forme des villes. C'est ainsi que la mondialisation a progressé, de même que l'intégration des marchés de l'Union européenne, ce qui a réduit les coûts de transport - y compris les coûts immatériels : douane, barrières non tarifaires, coûts commerciaux, etc., ouvrant de nouveaux marchés à des produits nationaux et, en sens inverse, ouvrant la France à l'entrée de produits étrangers. Dans le même temps, l'étalement des villes a progressé avec la périurbanisation des ménages, puis celle des emplois. Ce sont les forces à l'oeuvre et leurs effets sur l'armature urbaine du territoire qui sont ici analysés et décrits.
Nous montrons, en particulier, que les dix plus grandes métropoles de province sont les gagnantes de la course aux emplois. Cette concentration est vertueuse : les économistes savent, depuis toujours pourrait-on dire, que les grandes villes sont le moteur de la croissance. Nous verrons également que cette concentration métropolitaine s'étend et s'étale dans l'espace : ce sont les banlieues et les périphéries périurbaines qui en profitent plus que les villes centres, dans les plus grandes métropoles comme dans l'ensemble du système urbain français. L'étalement des emplois est général : les emplois stratégiques de ce que l'Insee appelle les « cadres de fonctions métropolitaines » migrent vers la périphérie des grandes villes, les emplois industriels font de même, et ceux des services aux particuliers aussi. Le mouvement d'étalement se nourrit aussi du flux des ménages quittant les villes vers les espaces périurbains, qui l'emporte sur le flux de sens inverse avec une constance maintenue depuis plus de 30 ans. Cet étalement des métropoles est, lui aussi, vertueux sur le plan économique : il réduit les coûts urbains - coûts fonciers et coûts de transport. Il améliore donc la compétitivité des entreprises. Mais c'est peut être au détriment de l'environnement et de la vie sociale : d'une part, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'espaces ouverts peuvent s'en trouver accrus, quoique ce ne soit pas un résultat inéluctable ; d'autre part, la ségrégation sociale de l'espace peut également s'accentuer du fait de cet étalement.
L'analyse qui est menée dans cet article considère tout d'abord la localisation des entreprises, sur le plan théorique et sur le plan factuel, puis celle des ménages, avec également les deux volets des enseignements de la théorie et des faits.
b) Les villes moteur de la croissance
La concentration des firmes et des travailleurs dans les villes résulte d'économies d'échelle dues à des coûts fixes et à la division du travail. L'idée est très ancienne : Adam Smith vantait déjà les avantages de la division du travail à travers l'exemple resté célèbre de la coopérative d'épingles, plus productive que des artisans individuels. Les villes présentent en effet des avantages multiples. Le transport des biens coûte d'autant moins cher que les firmes sont proches. Le progrès technique se diffuse mieux à une échelle locale : « les connaissances circulent d'un étage à l'autre et traversent les rues mieux que des océans ». Sur un grand marché du travail les appariements entre offre et demande se font aisément et chaque firme trouve les spécialistes dont elle a besoin. La spécialisation des firmes accroît la productivité de chacune et de l'ensemble d'entre elles, par exemple avec le développement d'un secteur de services aux entreprises ou la présence d'infrastructures de communication et de transport qui bénéficient à toutes. Enfin, les interactions de proximité entre firmes, en particulier sous forme d'informations qui s'échangent entre elles, sont d'autant plus intenses qu'elles sont concentrées. Marshall, à la fin du XIX ème siècle, parlait déjà d'une « atmosphère » industrielle. Plus les villes sont grandes plus cette « atmosphère » est bénéfique. La densité de bureaux, de laboratoires, d'ateliers est donc recherchée par les firmes, d'autant plus que les informations dont elles ont besoin circulent mal ou pour des opérations qui supposent une relation de confiance mutuelle ou de loyauté, donc en face-à-face.
Au total, lorsque la densité urbaine double, la productivité du travail augmente de 2 % 14 ( * ) . En appliquant ce ratio à Lyon (9 900 habitants par kilomètre carré) et à Besançon (1 800 habitants par kilomètre carré), la productivité est de 10 à 12 % supérieure dans la grande métropole que dans la ville moyenne. Un travail un peu antérieur portant sur six pays européens (dont la France), a montré que lorsque le nombre des emplois offerts par une ville doublait, la productivité du travail y augmentait de 4,5 %, chiffre voisin de celui des Etats-Unis (+ 5 %) 15 ( * ) . Avec ces résultats l'écart de productivité entre Lyon et Besançon s'accroît, pour approcher 20 %. C'est une différence énorme.
Les avantages économiques des métropoles ne sont pas près de disparaître car, malgré les nouvelles technologies de l'information, les interactions directes en face-à-face restent indispensables. Les nouvelles technologies de la communication ne s'y substituent pas, mais au contraire elles en sont le complément : plus on communique par des canaux virtuels, comme internet, plus il faut se rencontrer physiquement, à un moment donné de l'échange. Il en résulte le développement de quartiers d'affaires à haute densité de bureaux, de technopoles, de zones d'affaires aéroportuaires ou de villes nouvelles, de villes satellites, ou villes lisières (il n'y a pas de bonne traduction de l'anglais edge cities ).
c) La croissance des dix plus grandes métropoles de province
Pour étudier l'évolution de la localisation des firmes, nous examinons les emplois au lieu de travail à travers les recensements de l'Insee de 1982 et 2008 - il s'agit ici du recensement permanent, effectué par tranches entre 2006 et 2010. Le découpage de l'espace utilisé est celui des aires urbaines 16 ( * ) de l'Insee de 2010, légèrement adapté de façon à distinguer l'aire urbaine de Paris, les aires urbaines de province offrant plus de 100 000 emplois dans la ville centre, celles offrant entre 10 000 et 100 000 emplois dans la ville centre, puis en reprenant la nomenclature de l'Insee 17 ( * ) . Les communes-centres offrant plus de 100 000 emplois sont les dix plus grandes métropoles de province : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Nous les avons isolées car, comme nous allons voir, elles se singularisent nettement des autres aires urbaines.
Ce qui nous importe ici est moins l'évolution en valeur absolue que l'évolution relative : où les emplois ont-ils progressé plus qu'en moyenne nationale ? Ou bien, lorsqu'il s'agira d'examiner les emplois industriels qui ont diminué, où ont-ils résisté mieux que pour l'ensemble national ? Ce sont donc des évolutions relatives que nous examinons à travers une série de figures, qui rapportent des évolutions dans un type donné d'espace à l'évolution nationale.
Evolution relative de 1982 à 2008 des emplois selon le type d'espace (figure 1)
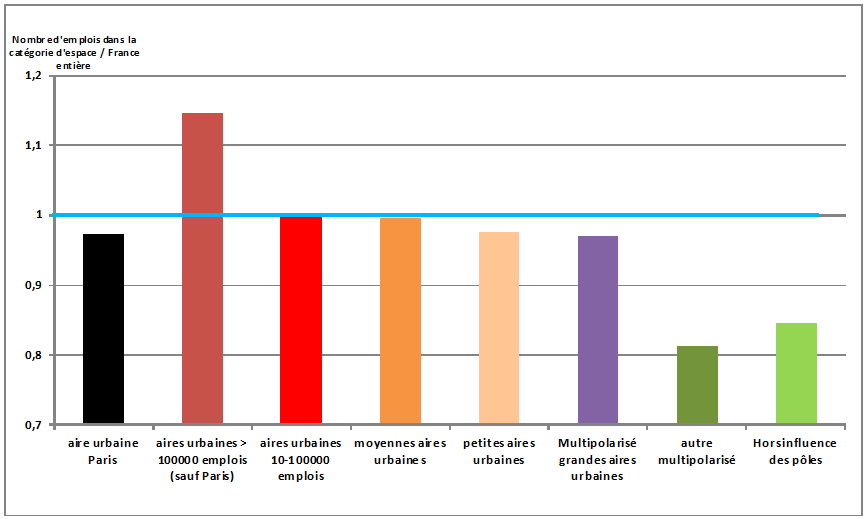 Source : recensements
de la population
Source : recensements
de la population
Examinons, tout d'abord, avec la figure 1, l'évolution de 1982 à 2008 de l'ensemble des emplois au lieu où ils sont exercés, qui correspond à l'évolution de la localisation des entreprises. En donnant la valeur de 100 à l'ensemble de la France, l'aire urbaine de Paris est passée en un quart de siècle environ à l'indice 97,3, connaissant donc un recul relatif de 2,7 %. Seules les plus grandes aires urbaines de province ont bénéficié plus que la moyenne nationale de l'accroissement des emplois : elles sont à l'indice 115 en 2008. La situation des aires urbaines de taille inférieure a évolué à un rythme proche de celui de l'ensemble du pays. C'est dans les territoires les moins denses que l'évolution a été la plus défavorable en termes relatifs : en 2008, l'indice est de 84,5 dans les communes hors influence des pôles, de 81,3 dans les communes multipolarisées par des aires urbaines moyennes ou petites.
L'allure générale de la distribution est donc celle d'un U inversé : la plus grande aire urbaine, celle de Paris et les régions rurales et peu denses ont connu un recul relatif des emplois, au bénéfice des grandes métropoles provinciales, alors que l'évolution a été assez neutre pour les aires urbaines de moyenne et petite taille.
Les cadres des fonctions métropolitaines progressent plus vite dans les grandes métropoles de province
Les fonctions métropolitaines définies par l'Insee correspondent à un ensemble composé de prestations intellectuelles, des métiers de la conception-recherche, de la gestion, du commerce inter-entreprises et de la culture. Elles se sont développées à très vive allure et représentent, en 2006, le quart des emplois en France. Parmi ces métiers, ce sont les cadres qui ont progressé le plus rapidement, passant de 1,1 million d'emploi en 1982 à 2,3 millions en 2006. Ces emplois de cadres des secteurs stratégiques pour l'économie nationale sont très concentrés : ils représentent 18 % des emplois de l'aire urbaine de Paris, 14 % dans les aires urbaines de Toulouse et Grenoble.
L'évolution relative de cette population de cadres des fonctions métropolitaines dans chaque type d'espace entre 1982 et 2009 est retracée sur la figure 2, avec le même type de représentation que dans la figure 1. Le gain relatif des dix grandes métropoles de province est plus important que pour l'ensemble des emplois : l'indice 126 est atteint en 2009. L'aire urbaine de Paris, qui concentrait déjà en 1982 un très grand nombre d'emplois de ce type, n'a pu progresser au même rythme : elle est à l'indice 96 en 2009. Les autres aires urbaines ont également progressé, mais moins rapidement que la moyenne nationale et les plus petites d'entre elles ont connu un gain relatif inférieur à celui des communes hors influence de pôles.
Evolution relative de 1982 à 2009 des cadres des
fonctions métropolitaines
(figure 2)
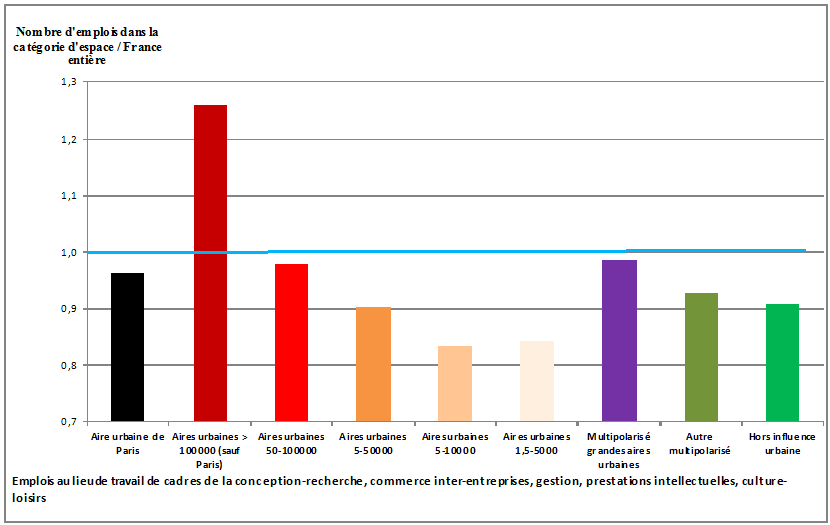
Source : recensements de la population
Pour l'économiste, cette évolution relative favorable aux dix plus grandes métropoles de province, tant celle des cadres de fonctions métropolitaines que celle de l'ensemble des emplois, est vertueuse. Les forces économiques qui poussent à cette concentration, que nous avons rapidement décrites, l'emportent sur les forces de dispersion, que nous allons examiner, ainsi que sur les forces politiques dont l'objectif déclaré, depuis des décennies, est d'équilibrer la croissance sur l'ensemble du territoire.
Une nuance doit être apportée à cette analyse d'ensemble : la situation de l'aire urbaine de Paris est singulière puisque, en termes relatifs, elle connaît un léger recul depuis 1982. Mais le poids économique de Paris, comme celui de Londres au Royaume-Uni, est une exception en Europe, au point que J.F. Gravier a pu intituler son célèbre ouvrage, paru en 1947, « Paris et le désert français ». La taille de la capitale, et l'écart important qui la sépare des autres métropoles françaises, peuvent se traduire, d'une part, par des déséconomies d'échelle qui se produisent inévitablement au-delà d'une certaine taille et, d'autre part, par un rattrapage des métropoles de province.
d) Les coûts urbains limitent la croissance métropolitaine
Les métropoles, en plus des atouts certains qui expliquent leur croissance, supportent également des handicaps, qui limitent celle-ci. Au premier chef, se trouvent les coûts urbains, coûts fonciers et coûts de déplacement 18 ( * ) . Les entreprises des grandes villes payent cher la ressource foncière qui leur est nécessaire et elles doivent consentir des salaires élevés à leurs employés pour compenser le coût foncier qu'ils subissent également, ainsi que le coût des migrations alternantes domicile travail. C'est ce que montre le tableau 1. Pour les maisons individuelles, par rapport à la référence 100 en banlieue parisienne, le prix tombe à l'indice 46 en proche banlieue des grandes aires urbaines de province et à 41 au centre des plus petites. En ce qui concerne le loyer par mètre carré des appartements, en prenant la valeur 100 dans Paris (soit, en 2008, 23 euros par mois et par mètre carré), l'indice est de 55 dans les grandes agglomérations de province (par exemple, en 2008, 11 euros le mètre carré par mois à Lyon) et de 43 dans les petites (par exemple, en 2008, 7 euros le mètre carré par mois à Rodez).
Valeur des maisons individuelles et des appartements selon la taille de la commune centre des aires urbaines (tableau 1)
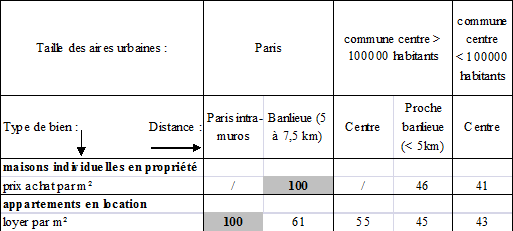
Source : enquêtes « Logement » de l'Insee.
Indice 100 : loyer par mètre carré des appartements dans Paris ou prix d'achat par mètre carré des maisons à 5 - 7,5 km de Paris (le nombre de maisons dans Paris est trop faible dans ces enquêtes pour être pris comme référence).
A ces aspects fonciers, qui constituent les « coûts urbains » s'ajoutent des coûts moins directs mais néanmoins importants : congestion, pollution de l'air, sentiment d'insécurité, bruit, qui sont un cortège de nuisances résultant de la forte densité de l'habitat et des activités productrices.
Ces coûts directs et indirects poussent les entreprises à rechercher des localisations plus économes par un arbitrage entre les avantages et les inconvénients de la concentration métropolitaine. Elles cherchent à réduire les coûts fonciers et salariaux, tout en conservant une bonne accessibilité aux services supérieurs des villes centres et en évitant ce qui leur apparaît comme des déserts économiques. Un tel arbitrage explique le développement de métropoles polycentriques, avec des centres d'emplois satellites de grandes métropoles, où les coûts urbains sont moindres, mais qui permettent de bénéficier des services métropolitains lorsque le coût de communications pour les aller quérir est supportable 19 ( * ) .
e) Une métropole plus monocentrique : exemple de la région de Toulouse
L'exemple de la région toulousaine donne une illustration de l'évolution des emplois entre la métropole régionale de Toulouse et six grandes aires urbaines sous son influence : Albi, Montauban, Castelsarrasin, Auch, Pamiers, Castres.
La métropole de Toulouse et ses satellites (figure 3)
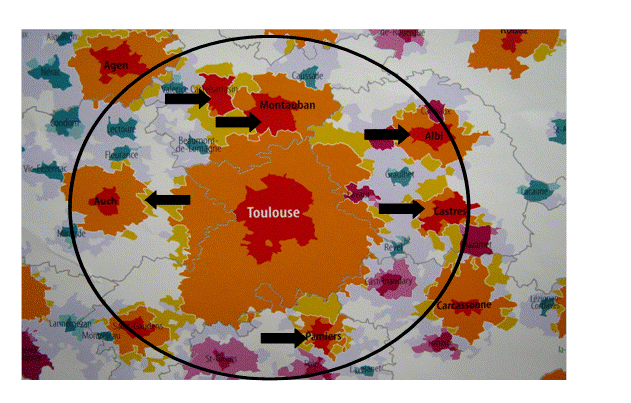
Source : zonage en aires urbaines 2010. Les communes en rouge forment les unités urbaines des `grandes aires urbaines' au sens de l'Insee (plus de 10 000 emplois), celles en orange les couronnes de ces grands pôles. Le jaune symbolise les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, le violet les `moyennes aires urbaines' et le vert les `petites aires urbaines'.
En traçant un cercle de 75 kilomètres autour du Capitole (cf. figure 3), la figure 4 permet de retracer l'évolution des emplois dans cette région en distinguant, tout d'abord, les différentes catégories d'espaces de la figure 3. De plus, nous isolons la commune centre de chaque unité urbaine de son restant, qui constitue la banlieue. Enfin, pour l'aire urbaine de Toulouse, la banlieue et la couronne périurbaine sont divisées en deux (proche, éloigné) selon la proximité de Toulouse. Les raisons de ce découpage spatial vont apparaître immédiatement.
La figure 4 montre que seules des communes appartenant à l'aire urbaine de Toulouse ont une croissance entre 1982 et 2008 supérieure à la moyenne régionale : les six aires urbaines satellites se situent, en moyenne, à l'indice 80 en 2008 pour une valeur régionale de 100. C'est donc la grande aire urbaine métropolitaine qui est clairement la gagnante, au détriment de ses satellites. L'évolution vers plus de polycentrisme, qui pourrait être bénéfique à la croissance économique du fait de la limitation des coûts urbains, ne s'est pas produite dans cette région au cours de la période étudiée.
Evolution de 1982 à 2008 des emplois selon le type d'espace rapportés à la moyenne de la région (figure 4)
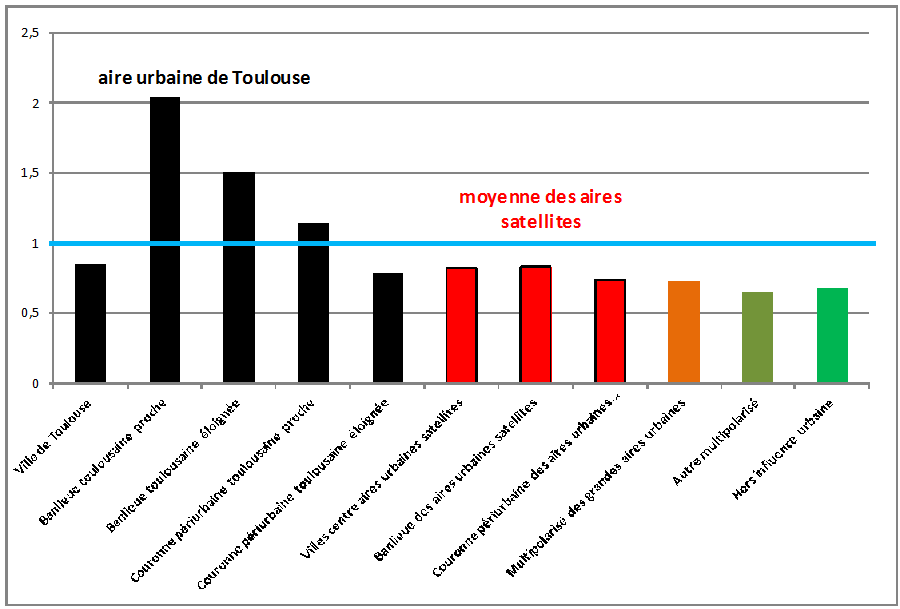
Source : recensements de la population
Pourtant, on assiste à un phénomène comparable du point de vue des mécanismes économiques, mais qui conduit à une forme urbaine qui diffère du modèle centre - satellite de la théorie. C'est le mouvement de périurbanisation des entreprises. Ce faisant, les entrepreneurs cherchent à réduire les coûts urbains, fonciers et de déplacement, comme le veut la théorie. Ils bénéficient aussi d'une bonne accessibilité aux services financiers, universitaires, aéroportuaires, etc. des métropoles. Enfin, la densité d'emplois dans des zones d'activité, des parcs technologiques ou tertiaires de banlieue ou périurbains est suffisante, ce qui est aussi une exigence de la théorie pour obtenir une bonne productivité. La périurbanisation des emplois présente donc des avantages similaires à ceux du polycentrisme urbain analysé par Cavailhès et al . 20 ( * ) .
Ce mouvement centrifuge se produit dans l'aire urbaine de Toulouse. C'est ce que montre la distinction des différentes zones de celle-ci : vite entre 1982 et 2008, les emplois augmentent moins que la moyenne régionale dans la commune de Toulouse (indice 85 en 2008), beaucoup plus rapidement dans la banlieue proche (indice 203 en 2008) et lointaine (indice 151 en 2008) et un peu plus vite dans la couronne périurbaine proche (indice 114 en 2008).
La répartition des cadres des fonctions métropolitaines montre que ces emplois se développent eux aussi plus vite en banlieue toulousaine que dans la ville de Toulouse elle-même (figure 5). Celle-ci n'est pas la commune où ils sont les plus représentés : en 2008, ils dépassent 25 % des emplois à Labège et Blagnac, pour 16 % à Toulouse. La progression depuis 1982 a été rapide partout, mais plus encore dans la plupart des communes de banlieue. En revenant à des données France entière, nous allons retrouver le même mouvement de migration des emplois vers les périphéries des métropoles.
Les cadres des fonctions métropolitaines à Toulouse et dans sa banlieue en 1982 et 2008 (figure 5)
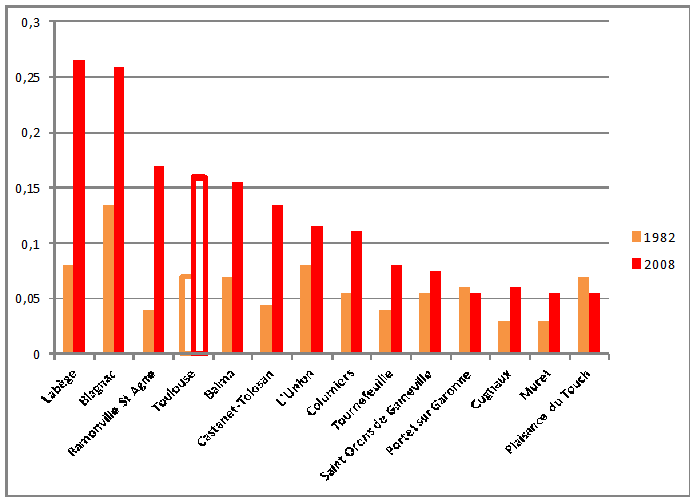
Source : « L'aire urbaine de Toulouse, un pôle d'emplois stratégiques de premier plan », Perspectives villes, n° 131, janvier 2011
f) Les emplois en France se désaxent vers la périphérie des métropoles
L'évolution des emplois dans la grande région toulousaine ne semble pas être une exception. Pour la France entière, les aires urbaines moyennes, ou celles offrant de 10 000 à 100 000 emplois dans leur ville centre, qui pourraient être peu ou prou des candidates au statut théorique de satellites des dix plus grandes métropoles de province, ont une croissance moindre que celles-ci. On assiste clairement à un mouvement de désaxage des emplois vers les périphéries des grandes villes. En gardant la même logique que précédemment d'étude des évolutions relatives des emplois par rapport à leur évolution nationale, nous décomposons, dans la figure 6, les tranches de taille des aires urbaines en fonction de la localisation plus ou moins proche du centre. Ce gradient distingue : (i) la commune centre elle-même ; (ii) les communes de banlieue 21 ( * ) qui constituent le reste du pôle urbain (ou unité urbaine centre) au sens de l'Insee et qui sont subdivisées selon leur proximité du centre (proche, éloignée) ; (iii) les communes périurbaines qui constituent la couronne des pôles au sens de l'Insee 22 ( * ) , également divisées selon qu'elles sont plus proches ou plus lointaines du centre de l'aire urbaine. La figure 6 indique l'évolution relative des emplois de ces différents types d'espace entre 1982 et 2008.
Dans les aires urbaines suffisamment grandes pour que la distinction des localisations proche ou éloignée des entreprises ait un sens, on observe des formes de la distribution en cloche : moindre croissance relative dans les villes centres, croissance relative maximum dans les banlieues éloignées et les communes périurbaines proches, croissance moindre en périphérie périurbaine. Dans les aires urbaines moins grandes, ce sont les banlieues où la croissance est maximum, les villes-centres ayant une croissance toujours inférieure à celle du pays dans son entier.
Evolution relative de 1982 à 2008 des emplois selon le gradient centre périphérie (figure 6)
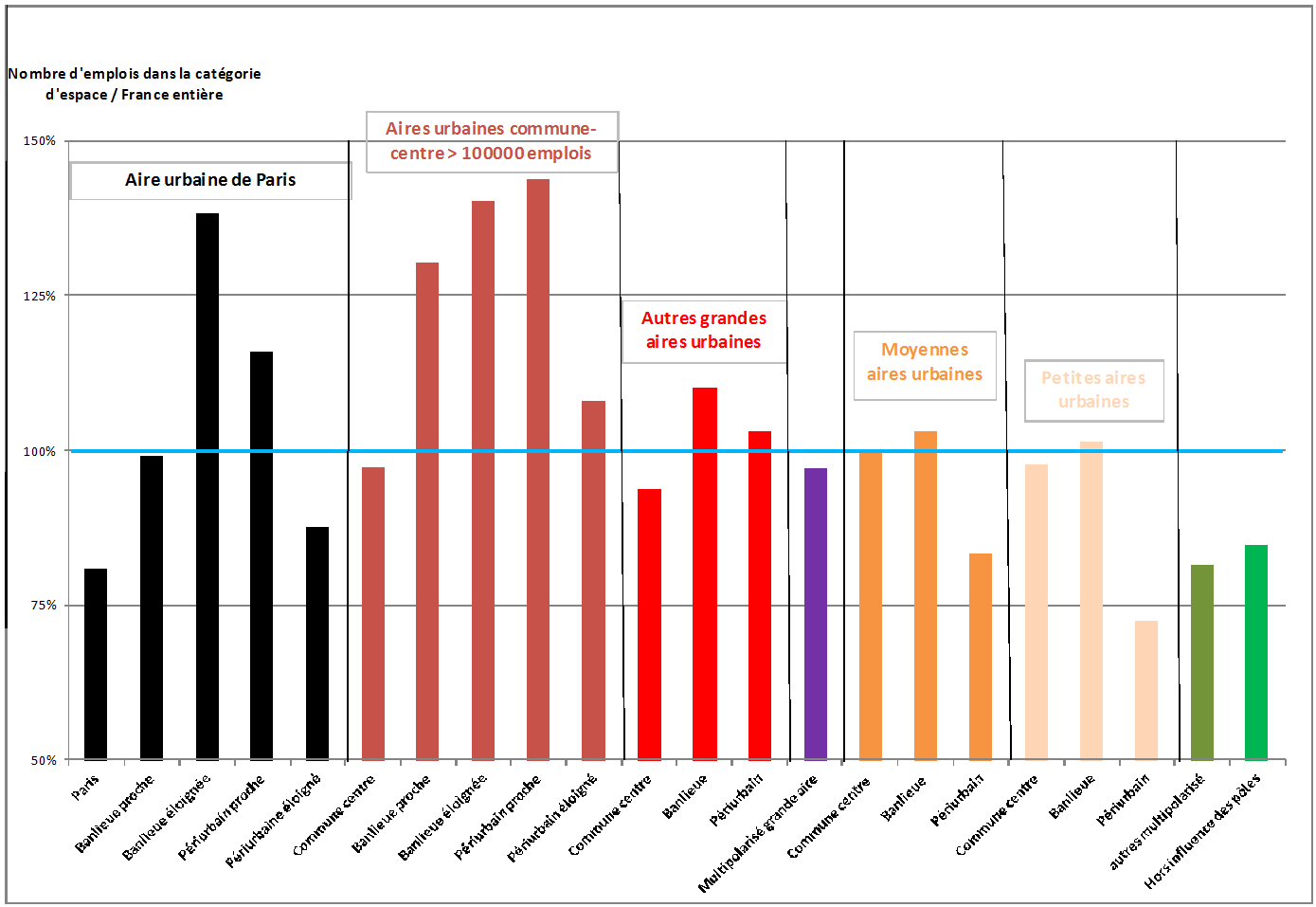
Source : recensements de la population
La croissance désaxée, au sens d'un mouvement qui sort de son axe - que nous assimilons au centre de l'aire urbaine - est donc globalement la règle. On peut dire autrement la chose : les emplois s'étalent dans l'espace - sans donner ici à ce terme de connotation négative. Un examen plus minutieux montrerait que les zones aéroportuaires, les abords de campus universitaires, la proximité de bretelles d'accès autoroutières sont privilégiés, de même que les bourgs ou petites villes périurbaines bien desservies par les transports. Le critère de l'accessibilité reste donc important, mais la recherche de coûts urbains moindres ne l'est pas moins.
Cette évolution globale de la localisation des entreprises peut cacher des comportements différents selon les secteurs d'activité. Il est normal que les emplois de service aux personnes suivent la population, qui se périurbanise comme nous allons le voir ; normal aussi que des entreprises polluantes ou qui ont besoin d'emprises foncières importantes (chimie, travaux publics, etc.) se développent surtout là où la densité de population est faible et les terrains peu chers. Pour éclairer ces mouvements sectoriels différents, nous examinons les emplois de cadres métropolitains en décomposant à nouveau la figure 2 selon le gradient de centralité (figure 7) et nous ajoutons une figure comparable pour les emplois industriels (figure 8).
La figure 7 montre que les emplois de cadres métropolitains ont connu entre 1982 et 2009 une évolution relative comparable à celle de l'ensemble des emplois : progression moindre qu'en moyenne nationale dans les communes centres des aires urbaines (sauf pour les dix plus grandes métropoles de province) et plus rapide en banlieue éloignée et dans les communes périurbaines proches. Les emplois industriels, dont il faut rappeler qu'ils ont régressé durant la période 1999-2009 étudiée dans la figure 8, se distinguent de l'évolution d'ensemble par plusieurs aspects. Globalement, c'est, une nouvelle fois, dans les dix plus grandes métropoles de province qu'ils se sont le mieux maintenus et dans l'aire urbaine de Paris que leur recul a été le plus important. Les communes hors influence de pôles, qui sont assimilées à l'espace rural « profond » (pour simplifier) ont connu une certaine résistance de ces emplois, de même que les autres communes multipolarisées (qui sont un espace rural moins « profond »). Selon le gradient de centralité, c'est dans les couronnes périurbaines que l'érosion de ces emplois industriels a été la moins forte, sauf en région parisienne.
Evolution relative de 1982 à 2009 des cadres des fonctions métropolitaines selon le gradient centre périphérie (figure 7)
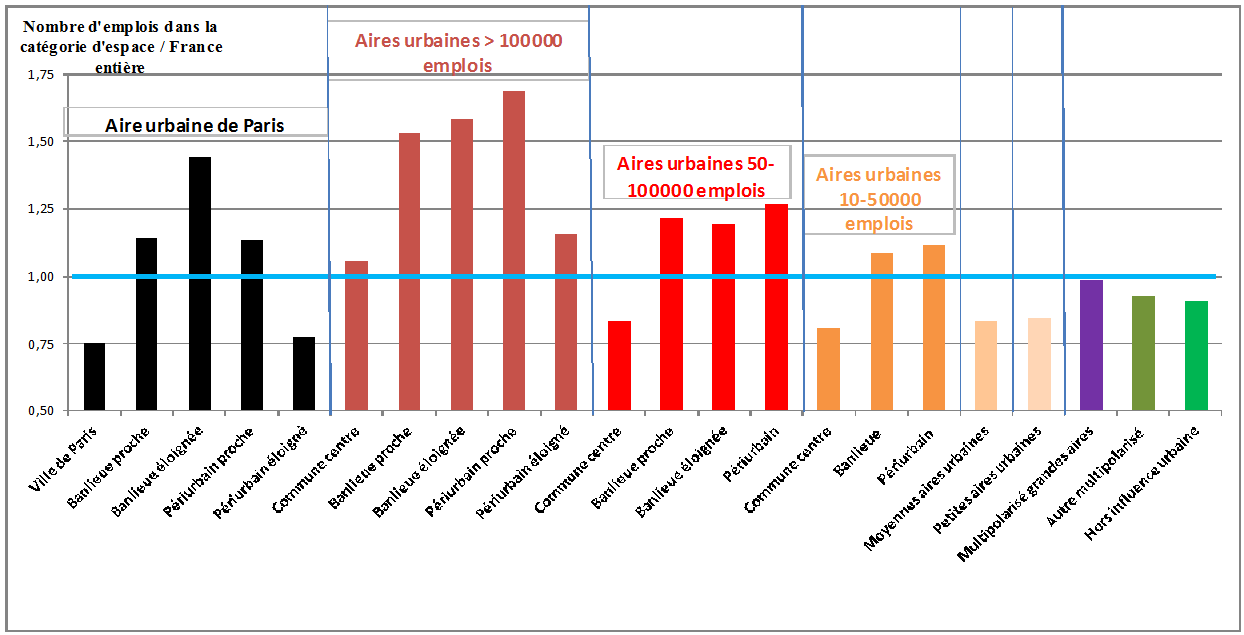 Source : recensements
de la population
Source : recensements
de la population
Evolution relative de 1999 à 2009 des emplois industriels selon le gradient centre périphérie (figure 8)
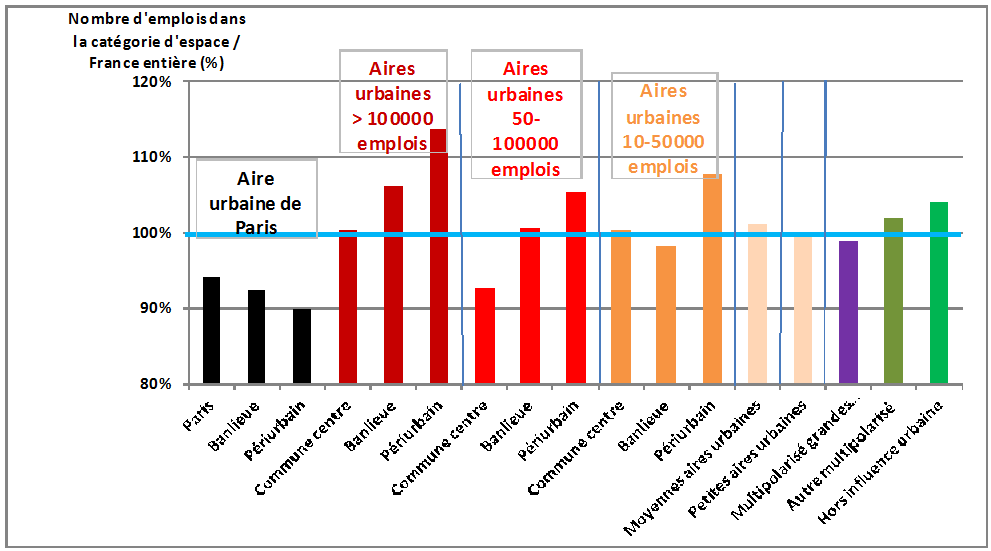
Source : recensements de la population
g) Les mécanismes fondamentaux de la localisation des ménages
Les économistes distinguent trois facteurs qui sont à la source du processus d'extension de l'habitat urbain dans l'espace : la démographie, naturellement, et deux causes proprement économiques, l'augmentation du niveau de vie qui se traduit par une demande accrue d'espace résidentiel et la diminution des coûts de transport qui permet d'habiter plus loin des villes-centres. Lorsque le niveau de vie augmente, disons de 1 %, la consommation de la plupart des biens augmente, généralement d'un peu moins de 1 % (biens normaux) et parfois de plus de 1 % (biens de luxe). Le logement étant un bien normal (+ 0,7 à 0,8 % pour + 1 % de revenu), de nouveaux terrains sont nécessaires pour satisfaire cette demande, conduisant à une expansion urbaine. La baisse des coûts de transport est aussi un facteur d'extension des villes. De nos jours, l'automobile permet d'habiter presque n'importe où, en s'affranchissant des réseaux de transports en commun. Or, le coût automobile a beaucoup baissé depuis un quart de siècle, et la vitesse de déplacement a augmenté, en particulier avec les améliorations du réseau routier, ce qui a également favorisé l'extension périurbaine des villes.
Le mécanisme sous-jacent au choix d'une localisation résidentielle est le suivant. Les ménages font un arbitrage entre le coût de leurs déplacements quotidiens (disons : les migrations alternantes domicile - travail) et le coût de leur logement, dont le renchérissement près des villes centres réduit la taille du lot résidentiel qu'ils peuvent y acquérir. La diminution des valeurs foncières lorsqu'on s'éloigne du centre-ville joue un rôle crucial dans cet arbitrage.
La manière dont s'opère l'arbitrage entre distance et valeur foncière varie selon les caractéristiques socio-démographiques des ménages (nombre d'enfants, âge, etc.) et leur revenu. Par exemple, si les ménages à haut revenu apprécient fortement la consommation d'espace résidentiel, ils choisissent d'habiter dans les banlieues ou les communes périurbaines où de faibles valeurs foncières leur permettent d'acquérir de grands lots résidentiels. On explique souvent ainsi la localisation des ménages riches dans les suburbs américains. Au contraire, les ménages aisés peuvent préférer choisir un habitat central pour éviter une perte importante en temps en transport lorsque c'est le temps qui est pour eux le plus précieux, comportement qui conduit davantage aux formes de certaines villes européennes (exemple : Paris), ainsi qu'à celles de certaines villes américaines (exemple : celles de la Nouvelle-Angleterre), où les ménages aisés habitent dans le centre des villes.
h) Le rôle des caractéristiques locales des lieux
Le cadre de vie résidentiel intervient pour compléter le raisonnement précédent. Parmi ses caractéristiques, la qualité du voisinage est l'élément le plus important. On parle souvent de « marquage social des lieux » pour désigner, à un extrême, la stigmatisation qui frappe certains d'entre eux que l'on voit comme des ghettos et, à l'autre bout, des quartiers de bonne réputation, où vit une population aisée. En effet, l'espace est socialement hétérogène. Les raisons tiennent, d'une part, au fonctionnement du marché immobilier et, d'autre part, à des mécanismes socio-économiques qui échappent au marché.
Un « tri spatial » résulte, tout d'abord, du fonctionnement spontané du marché foncier résidentiel. Les ménages qui ont les mêmes paramètres (revenu, coût du temps et goûts identiques) aboutissent à des choix identiques (aux impondérables individuels près) et ils se localisent donc spontanément à proximité les uns des autres, alors que d'autres ménages, qui ont des caractéristiques différentes, choisissent d'autres localisations. La ségrégation spatiale est le produit normal du fonctionnement du marché foncier.
Ce « tri spatial » résulte aussi de « comportements grégaires » qui opèrent indirectement sur le marché foncier. Les ménages des catégories sociales supérieures aiment vivre les uns près des autres car ils tirent bénéfice de ce voisinage. Il en résulte un effet boule de neige, qui s'accentue encore du fait de la qualité des biens et services publics qui sont offerts là où ils habitent (la qualité de l'école est particulièrement recherchée). De la même manière qu'on a pu dire que le Code civil était une machine à hacher la terre (par le jeu des divisions successorales successives), on peut dire que le marché foncier est une machine à hacher la société, en séparant les groupes sociaux et en les éloignant de plus en plus les uns des autres au fur et à mesure que l'habitat se disperse.
Enfin, des mécanismes hors marché interviennent aussi, comme les politiques volontaires de ségrégation mises en oeuvre par certaines collectivités locales : zonages urbains imposant des contraintes insupportables pour les classes laborieuses, inégalité d'implantation des logements sociaux (« trop grands » et « trop ensembles »), « clubbisation » de communes périurbaines, en empruntant ce terme à E. Charmes 23 ( * ) . En effet, la périurbanisation en France a accentué la ségrégation spatiale.
La ségrégation spatiale périurbaine s'explique par la recherche par certains ménages d'aménités rurales ou agricoles. Même si les agriculteurs sont critiqués pour les nuisances qu'engendrent leurs activités (odeurs, pollutions, bâtiments disgracieux, etc.), ils entretiennent et gèrent l'espace, qui est ouvert à la promenade, offre des paysages agréables et donne une image de nature ou de ruralité qui plaît aux Français, ce que montrent des enquêtes sur ce thème. C'est là un cadre de vie dont ils apprécient le calme, l'air pur, la vue, la proximité de champs ou de prés, etc. Lorsqu'elles ont pu se motoriser, les fractions supérieures des classes laborieuses (techniciens, ouvriers qualifiés, employés, etc.) sont allées à la recherche de ces aménités dans les couronnes périurbaines, ce qui leur a aussi permis d'assouvir le vieux désir d'accéder à la propriété. Ceux qui n'en avaient pas les moyens (chômeurs, immigrés, pauvres, etc.) sont restés sur place, comme scotchés dans ce qui était les « riantes banlieues » des années 1960 (pensons à Le Corbusier, aux villes nouvelles, etc.), qui sont devenues des « quartiers à problème » après que ce tri spatial les eut vidées de leur mixité sociale.
Le monde réel n'est donc pas la vaste plaine homogène de la théorie économique. En le revisitant on trouve, par exemple à Paris, New-York ou Boston des centres-villes avec beaucoup d'aménités, historiques (monuments, musées, etc.) ou « modernes » 24 ( * ) (restaurants, théâtres, etc.), ce qui explique la localisation centrale des riches. Par contre, dans des villes comme Atlanta, Phoenix (ou Bruxelles), il n'y a pas (ou peu) d'aménités des centres villes, d'où une localisation périphérique des riches. Ailleurs encore, les aménités forment un patchwork complexe (Londres), ou bien elles ne sont pas réparties seulement sur un gradient centre-périphérie mais aussi ouest-est (Paris).
i) La poursuite de la périurbanisation des ménages
Pour mesurer les évolutions de la population dans l'espace, le solde migratoire qui mesure l'évolution des entrées et sorties de population, est plus pertinent que le solde naturel. Car le premier résulte d'une décision, celle de migrer quelque part, alors qu'on ne décide pas de là où l'on naît et meurt.
Depuis 1968, pour chaque période inter-censitaire, l'espace périurbain enregistre le plus fort solde migratoire, comme le montre la figure 9. Ce mouvement se poursuit de nos jours : le solde migratoire annuel est de + 0,8 % entre 1999 et 2006 dans les couronnes périurbaines. Ce solde est le même pour l'espace rural, alors que l'on est à 0 % dans les pôles urbains. Cette attractivité des campagnes est partagée dans les autres pays développés. Le mouvement est né aux Etats-Unis après la Seconde guerre mondiale, il a ensuite atteint l'Europe du Nord puis s'est répandu vers le Sud. Dans le cas de la France, la région parisienne a été pionnière - dès le milieu des années 1960 - puis l'ensemble du pays a été touché à partir du milieu des années 1970.
Solde migratoire annuel intercensitaire (figure 9)
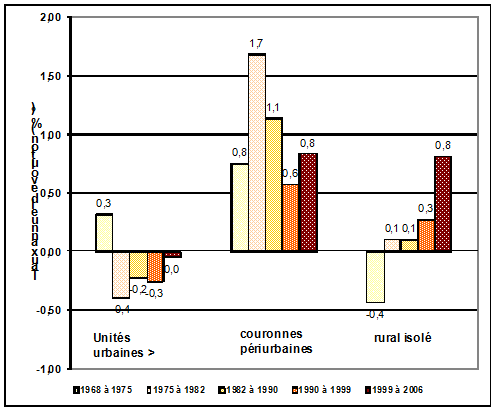
Source : recensements de la population. Découpage en aires urbaines 1996.
Les raisons de ces migrations vers la périphérie des villes sont celles que nous a indiqué la théorie : baisse des coûts de transport et progression de la motorisation des ménages, augmentation du revenu qui se traduit par une demande accrue de logement et d'espace résidentiel, recherche d'aménités du cadre de vie et rejet de nuisances urbaines, tout en ne s'éloignant pas trop des emplois, exigence d'autant mieux satisfaite que, comme nous l'avons vu, les emplois migrent eux aussi vers les banlieues et les couronnes périurbaines.
Depuis une vingtaine d'années, les migrations vers l'espace périurbain, surtout proche de villes, concernent davantage les classes moyennes ou aisées, alors que les classes populaires sont reléguées dans certaines banlieues urbaines ou dans des couronnes périurbaines éloignées, où le sol est moins cher mais qui demandent de longs trajets domicile-travail.
j) L'exemple de la métropole toulousaine : banlieue et périurbain s'enrichissent
Un nouveau zoom sur la région de Toulouse permet d'illustrer la répartition dans l'espace des groupes sociaux. Parmi les indicateurs possibles, nous privilégions celui du revenu imposable moyen des foyers fiscaux (qui sont plus petits que les ménages, grosso modo dans la proportion 1/1,2) 25 ( * ) . Nous avons calculé le revenu fiscal par tranche de distance routière entre une commune et la place du Capitole (avec un pas de 2,5 km) jusqu'à 65 km de celle-ci. La figure 10 renseigne ce revenu en 1984 et 2009 en termes relatifs, c'est-à-dire en le rapportant au revenu moyen de la région.
On note, tout d'abord, la forme en cloche de la répartition : le revenu du foyer fiscal moyen est inférieur dans la commune de Toulouse à celui du foyer fiscal moyen de la région, il est supérieur à celui-ci dans les communes de banlieue et dans les communes périurbaines proches (jusqu'à 20-25 km) et à nouveau inférieur dans celles qui sont au-delà de cette distance, tout comme dans les communes isolées se trouvant dans le cercle des 65 kilomètres de Toulouse. Remarquons, ensuite, que la situation relative de la ville de Toulouse s'est dégradée entre 1984 et 2009, alors que celle des communes périurbaines s'est améliorée, quelle que soit la tranche de distance à la métropole. Situées entre les deux, les communes de la banlieue toulousaine ont maintenu à peu près à l'identique leur position relative. Les communes rurales isolées connaissent un déficit de revenu de près de 30 % par rapport à la moyenne régionale.
Revenu fiscal par ménage en 1984 et 2009.
Région de Toulouse
(figure 10)
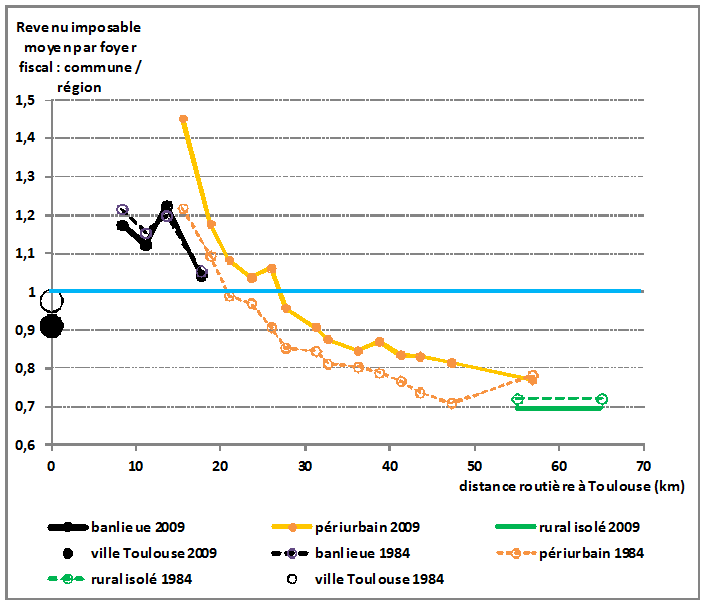
Source : Insee-DGI, Revenus fiscaux des ménages
En 2009, le revenu fiscal moyen dans Toulouse est inférieur de 9 % au revenu fiscal moyen régional. C'est un écart important compte tenu du coût de la vie élevé de la métropole, en particulier du coût du logement. De plus, Toulouse est l'une des plus grandes communes urbaines de France, qui compte des quartiers périphériques où vit une population laborieuse ou pauvre (exemple : Le Mirail). La situation des ménages dans ces quartiers est évidemment plus dégradée que ne le suggère la valeur moyenne de - 9 % 26 ( * ) . A l'inverse, les communes rurales hors influence des pôles, où le revenu est de 30 % inférieur à la moyenne régionale, bénéficient de logements peu chers, parfois d'un approvisionnement à partir d'un potager ou de l'élevage de petits animaux, ce qui vient atténuer le poids de leur pauvreté relative. Les statistiques « sèches » de la figure 9 sont donc insuffisantes pour rendre compte des difficultés (parfois des drames) des uns et des facilités (parfois de l'opulence) des autres. Elles retracent des écarts statistiques et des évolutions depuis un quart de siècle sur un gradient allant de l'urbain au rural dans une vision très stylisée, comme un squelette qui serait dépouillé de sa chair. La situation pour l'ensemble du pays va permettre de confirmer, mais aussi de nuancer, ce cas particulier de la région toulousaine.
k) En France, les couronnes périurbaines, parisienne exceptée, s'enrichissent
La figure 11 montre la situation relative du revenu des foyers fiscaux en 1984 et en 2009 dans différents types d'espaces par rapport à la moyenne nationale. Les tranches de taille d'aires urbaines sont moins détaillées que dans les figures précédentes car nous voulons mettre en relief la situation des types d'espace à l'intérieur des aires urbaines : commune centre (figurée en noir), banlieue proche ou lointaine (gris) et périurbain (orange), également selon sa proximité et enfin rural (vert). La situation en 1984 est indiquée par des bâtons évidés, cette en 2009 par des bâtons pleins, ce qui permet de voir l'évolution entre les deux dates.
Revenu relatif par foyer fiscal en 1984 et en
2009
(figure 11)
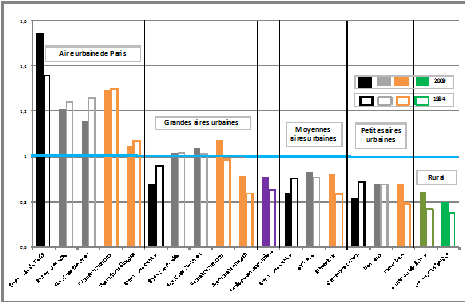
Source : Insee-DGI, Revenus fiscaux des ménages
Notons, tout d'abord, que le revenu moyen d'un foyer fiscal de l'aire urbaine de Paris est supérieur à la moyenne nationale en 1984 et 2009, pour tous les types d'espaces de cette aire urbaine. Le revenu est toujours inférieur à la valeur nationale dans les aires urbaines moyennes et petites, de même que dans les régions rurales. Clairement, le revenu relatif diminue lorsqu'on descend dans la hiérarchie urbaine. Cette allure générale de l'histogramme, descendant en allant de la gauche vers la droite de la figure, est suffisamment connue pour qu'il soit inutile d'insister davantage. La situation des différentes zones à l'intérieur d'une aire urbaine est peut-être plus riche d'enseignements nouveaux.
Dans l'aire urbaine Paris, tout d'abord, le revenu moyen des foyers fiscaux parisiens dépasse de beaucoup la valeur nationale et l'écart s'est accru depuis 25 ans : Paris était à l'indice 136 en 1984 (pour une valeur nationale de 100) et passe à l'indice 154 (la valeur nationale de 100 étant évidemment différente de la précédente). Un foyer fiscal habitant Paris avait donc un revenu d'un tiers supérieur à son homologue national en 1984 et il s'est enrichi en termes relatifs, au point d'avoir en 2009 un revenu qui dépasse de moitié celui d'un foyer fiscal du pays. Est-il plus riche pour autant ? Il faudrait pour répondre à la question tenir compte du coût de la vie dans la capitale. On sait, en particulier, que le prix d'achat des logements, déflaté par le revenu des ménages, a été multiplié par trois durant cette période 27 ( * ) . Mais, heureusement pour les locataires, les loyers ont augmenté beaucoup moins vite. Ici aussi, il faudrait enrober le squelette des chiffres secs que nous donnons par la chair qu'apporte le vécu du coût de la vie, ce qui relève d'une autre analyse.
La figure 11 montre également que les communes de la banlieue parisienne se situent nettement au dessous de la capitale, quoique restant en moyenne bien au-dessus de la valeur nationale, et qu'elles se sont appauvries en termes relatifs entre 1984 et 2009. Cette situation d'ensemble des communes de la banlieue parisienne masque, à l'évidence, d'énormes disparités entre les communes, analysées dans d'autres travaux mais qui ne sont pas le centre d'intérêt de cet article : nous cherchons ici à mettre en relief les écarts et les évolutions entre les grandes catégories d'espaces du pays, à petite échelle. Enfin, pour terminer ce rapide aperçu de la situation de l'aire urbaine parisienne, il faut également relever une légère dégradation depuis un quart de siècle du revenu relatif de l'espace périurbain.
Le tableau d'ensemble en province est très différent. Les communes centres des aires urbaines se situent au-dessous de la valeur des banlieues et des couronnes périurbaines appartenant à la même tranche de taille d'aire urbaine. De plus, la situation de ces communes centres s'est dégradée depuis 1984, alors qu'elle s'est améliorée dans les communes de banlieue, et plus encore dans les couronnes périurbaines. C'est ainsi que dans les grandes aires urbaines, les communes centres sont passées de l'indice 96 en 1984 à l'indice 88 en 2009 alors que, dans le même temps, les communes périurbaines montaient de l'indice 99 à 107 (périurbain proche) ou de 84 à 91 (périurbain lointain). Entre commune centre et couronne périurbaine, les communes de banlieue se situent à des niveaux proches de la moyenne nationale et assez stables au cours du temps.
Ce sont des évolutions comparables qui se sont produites dans les aires urbaines moyennes et petites : les communes centres ont perdu la suprématie dont elles bénéficiaient en 1984, pour se trouver en 2009 dans une position relative moins favorable que les communes de banlieue et périurbaines, qui ont progressé durant la période. Les communes centres se trouvent en 2009 à des valeurs d'indice autour de 82 alors que les banlieues et les communes périurbaines sont autour de 90. Les communes rurales isolées ou multipolarisées se situent en dessous de ces valeurs, mais leur position relative s'est améliorée depuis 1984.
En résumé, les villes centres s'appauvrissent, sauf Paris ; les couronnes périurbaines s'enrichissent, sauf dans l'aire urbaine de Paris, de même que s'enrichit l'espace rural hors influence de pôles. Les banlieues sont dans des situations intermédiaires. Il ne s'agit là que de grandes tendances qui, il faut le rappeler à nouveau, se dégagent à l'échelle du territoire national sans permettre de montrer l'hétérogénéité qui s'observerait à plus grande échelle. De plus, ces données, pour importantes qu'elles soient, ne sont qu'un constat. Elles appelleraient, d'une part, des approfondissements statistiques 28 ( * ) . Il faudrait aussi, d'autre part, aller plus loin que le simple constat en développant une analyse explicative. Mais de tels prolongements dépasseraient le cadre de cet article.
l) Conclusion
A petite échelle, c'est-à-dire à l'échelle de la France entière, retenons la cohérence entre la localisation des emplois et celle des ménages, ainsi que celle de leurs évolutions. Les dix plus grandes aires métropolitaines de province, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse, sont les gagnantes en termes d'emplois, y compris d'emplois stratégiques de cadres de fonctions métropolitaines. Les aires urbaines de province un peu moins importantes sont dans des positions moins favorables. Par exemple les villes qui entourent Toulouse comme des satellites (Albi, Montauban, Castelsarrasin, Auch, Pamiers, Castres) sont moins dynamiques en termes d'emplois que la métropole toulousaine ; il en est de même au niveau national. Cette croissance inégale est inévitable. Les rendements croissants impliquent que l'ensemble du territoire national ne participe pas de la même manière au développement économique. Le capital humain ayant une forte tendance à se concentrer spatialement, les écarts entre territoires sont inévitables.
D'un côté, cet essor des grandes métropoles est bénéfique. Les grandes métropoles sont plus productives que les villes moyennes ou petites du fait d'économies d'échelle et d'agglomération. Leur ambition `millionnaire' (en termes de population), lorsqu'elle n'est pas déjà atteinte, est légitime. Le capital humain y est plus dense, les interactions entre activités productives plus intenses, l'innovation plus développée. Elles sont le creuset de la croissance économique et de la création d'emplois. Le mouvement de concentration métropolitaine est donc bénéfique. Il doit être encouragé, car la théorie économique montre qu'il est spontanément trop faible : les entrepreneurs, dans leur choix privé de localisation, ne tiennent pas pleinement compte des bénéfices sociaux de la concentration. Pour corriger ce dysfonctionnement des marchés, les politiques publiques doivent aider davantage les métropoles qui réussissent, pour le bien du pays dans son ensemble.
D'un autre côté, la croissance des métropoles est source de handicaps, parmi lesquels des coûts urbains considérables (coûts fonciers, coûts de déplacement, nuisances urbaines). Paris, qui ne connaît pas le même dynamisme que les dix métropoles de province précédemment énumérées, est peut-être victime de ces coûts, plus difficiles à supporter eu égard à sa taille. La théorie économique enseigne qu'un remède pourrait être une structure urbaine polycentrique, dans laquelle des villes satellites profiteraient des atouts d'une métropole sans avoir à supporter des coûts urbains aussi élevés. Mais ce n'est pas dans ce sens que s'oriente l'armature urbaine française : au contraire, nous venons de le dire, elle évolue vers plus de monocentrisme, bénéficiant davantage aux `soleils' des principales métropoles qu'aux `étoiles' satellites qui les entourent.
C'est une autre voie qui est suivie par le système productif en France : la périurbanisation des emplois est le palliatif permettant d'éviter des coûts urbains qui sont des freins à la compétitivité. Les emplois dans leur ensemble, comme ceux des fonctions métropolitaines stratégiques, se développent plus dans les banlieues et les couronnes périurbaines que dans les villes centres. Ce `dynamique périphérique' tient à des migrations de firmes qui quittent les villes centres, et/ou à un meilleur dynamisme des firmes déjà présentes dans ces périphéries, et/où à une plus grande natalité, ou une moindre mortalité des firmes qui y sont présentes. Quoiqu'il en soit des mécanismes sous-jacents à cette démographie des entreprises, elles trouvent dans ces localisations périphériques un milieu économique favorable : coûts urbains moins élevés et avantages métropolitains à portée de main.
Ce mouvement de périurbanisation des entreprises accompagne le mouvement de périurbanisation de la population qui perdure depuis plus de 40 ans. Celui-ci, suffisamment connu pour qu'il soit inutile d'insister, présente des caractéristiques sociales nouvelles. Depuis 25 ans, les ménages aisés représentent une part croissance de la population des banlieues et des couronnes périurbaines proches, qui connaissent un enrichissement relatif, et où les emplois de cadres des fonctions métropolitaines augmentent plus qu'ailleurs. Inversement, les classes populaires progressent dans les villes-centres des aires urbaines, où les emplois reculent, où chômage augmente, et qui connaissent un appauvrissement relatif. A l'échelle du pays dans son entier, les dix plus grandes métropoles de province trustent les gains d'emplois, en particulier dans les professions d'importance stratégique pour la croissance économique. Les espaces périurbains profitent de flux migratoires et s'enrichissent au détriment des villes centres qui s'appauvrissent (sauf en région parisienne, où c'est l'inverse).
Cependant, il ne s'agit là que d'une vision schématique, à la petite échelle du territoire national. Elle ne tient pas compte du patchwork de la réalité géographique ni des différenciations intra-urbaines, qui se sont accentuées lorsqu'on examine le territoire à une plus grande échelle 29 ( * ) , ce qui conduit parfois à un appauvrissement absolu de certaines zones, véritables « trappes à chômage ». A l'échelle des quartiers, l'inégalité socio-spatiale a progressé plus encore, bien que nous n'ayons pas ici, faute de place, analysé ce niveau territorial. En suivant les propositions de J. Cavailhès et J.-F. Thisse 30 ( * ) , ce sont ici d'autres politiques correctrices qui sont nécessaires, favorisant la compétence et la mobilité : « la bonne politique consiste à aider les personnes avant d'aider les territoires (...) [par une] mobilité géographique ascendante, encouragée dans d'autres pays avec des résultats positifs. Au lieu de politiques, par ailleurs peu efficaces, donnant des incitations financières aux entreprises pour qu'elles s'installent dans les zones franches urbaines (ZFU), des politiques donnant des incitations financières aux chômeurs des ZFU pour qu'ils aillent vers les emplois sont nécessaires ».
L'aide à la concentration métropolitaine à une échelle macro-spatiale et l'aide à la mobilité sociale ascendante à une échelle micro-spatiale nécessitent donc un pilotage fin des politiques publiques, à l'échelle du pays et à celle des petits territoires.
3. Classes
populaires périurbaines : au-delà du déclassement,
quelles trajectoires résidentielles et
professionnelles ?
Violaine Girard
(Université de Rouen)
Les élections présidentielles de 2012 ont donné lieu à une large mobilisation, dans la presse, de la figure des habitants du périurbain. Ceux-ci y ont alors été décrits comme des ménages « modestes » qui, pour quitter la banlieue et son cortège de « difficultés » sociales, n'auraient eu d'autre choix que de s'installer à distance des centres villes. Ainsi « relégués » dans les espaces périurbains, ils seraient en proie à de nombreuses « frustrations sociales » et victimes d'un « rêve pavillonnaire » qui « tourne mal », du fait d'efforts conséquents menés pour accéder à la propriété.
C'est donc principalement au travers du schème du déclassement que sont abordés leurs parcours. Ce diagnostic est pourtant largement incomplet. Il masque bien d'autres évolutions sociales qui affectent les classes populaires installées depuis les années 1970 et 1980 dans les espaces périurbains. Il amène en particulier à oublier que certaines fractions populaires connaissent, depuis les années 1970, des perspectives d'ascension sociale, certes relativement restreintes mais bien réelles. Cette contribution propose de revenir sur les trajectoires des ouvriers et employés du périurbain, en faisant le lien avec les transformations de l'emploi industriel qui se jouent à la périphérie des grandes villes.
Loin de s'expliquer uniquement par les « choix » résidentiels des ménages fuyant les quartiers d'habitat social, la périurbanisation apparaît en effet dans bien des cas fortement déterminée par les recompositions de l'emploi industriel. Car s'il y a bien crise et restructurations des anciennes grandes régions industrielles, les espaces périurbains accueillent depuis les années 1980 de nombreuses zones d'activité en développement. Ces zones, pourvoyeuses d'emplois, favorisent l'installation des ménages ouvriers dans les territoires périurbains, un fait qui demeure pourtant largement non questionné dans les médias. Alors qu'une part croissante des salariés travaille aujourd'hui en dehors des anciens grands centres de production, et de plus en plus souvent dans le secteur des services (logistique, transport, maintenance industrielle, etc.), ces recompositions de l'emploi jouent un rôle majeur pour les trajectoires des ménages populaires du périurbain.
a) Périurbanisation des emplois et accession populaire à la propriété
Les territoires périurbains accueillent, depuis les années 1980, de nombreux emplois, et cette dynamique s'accélère depuis les années 1990 : tous secteurs d'activité confondus, ce sont près de « quatre emplois supplémentaires sur 10 [qui sont localisés] dans le périurbain entre 1999 et 2007 » 31 ( * ) . C'est en particulier dans les communes périurbaines que la progression de l'emploi industriel est la plus forte : celui-ci y croît de 5 % entre 1990 et 1999, alors qu'il connaît une chute de 16 % dans les pôles urbains. Et si les emplois industriels demeurent principalement localisés dans les pôles urbains (63 % en 1999 contre 12 % dans les espaces périurbains), ils restent moins concentrés dans les centres urbains que l'ensemble des emplois tous secteurs confondus (Gaigné et al., 2005, p. 7). Selon l'économiste Frédéric Lainé (2000), on assiste en effet à la « décentralisation à la périphérie des activités productives (IAA, industrie, transports et manutention de marchandises, commerce de gros, construction) et [dans une moindre mesure, au] développement des activités de services à la population ». Or ces moyennes, calculées à partir de la seule catégorie du périurbain, qui englobe des territoires résidentiels aussi bien qu'industriels, masquent le développement de concentrations plus marquées des emplois. La relocalisation de nombre d'activités productives ou de service se joue en effet au sein des nombreuses zones d'activité économique implantées depuis les années 1980 dans des territoires excentrés, où le foncier est moins cher que dans les agglomérations. La création de ces nouvelles zones d'activité a également été encouragée par le développement des structures intercommunales à fiscalité propre, pour lesquelles l'exercice de la compétence développement économique est une obligation statutaire.
Les politiques de développement local jouent ainsi un rôle central dans le devenir des territoires périurbains : elles contribuent en premier lieu à favoriser l'installation des ménages d'ouvriers et d'employés à proximité de ces pôles d'emploi. D'autres facteurs concourent bien sûr également à cette dynamique : la hausse des prix de l'immobilier dans les centres villes, ainsi que les politiques étatiques de soutien à l'accession à la propriété, qui ont joué leur plein effet au cours des années 1980, en permettant à de nombreux ménages ouvriers de se lancer dans l'achat d'un pavillon. L'installation de nombreux ménages populaires dans le périurbain apparaît ainsi comme le produit de ces politiques et de leurs effets conjugués. Selon les chiffres du recensement de 2008, la part des deux catégories socioprofessionnelles des ouvriers et des employés parmi les actifs s'élève à 54 % dans les communes périurbaines contre 51 % dans les pôles urbains. Près d'un quart des ouvriers (22 %) réside dans ces territoires, quant à l'inverse, seuls 15 % des cadres y vivent 32 ( * ) .
Les territoires périurbains constituent-ils encore des espaces prisés par les classes moyennes, ou bien doit-on au contraire les envisager comme les « nouveaux » espaces de relégation des classes populaires ? Ces évolutions sont sans doute plus complexes et demeurent diversifiées, comme le montre le travail statistique de Jean Rivière (2011). Ces chiffres se réfèrent en effet, là encore, à un zonage rassemblant sous la seule catégorie « du » périurbain des espaces fortement différenciés : certains territoires périurbains sont caractérisés par une prédominance beaucoup plus marquée des catégories populaires, notamment dans les franges les plus éloignées des agglomérations, où la catégorie des ouvriers qualifiés est surreprésentée (Cavaillès et Selod, 2003). La diffusion de la propriété pavillonnaire parmi de larges fractions des classes populaires ne signifie en effet pas, loin de là, la disparition des clivages sociaux et résidentiels distinguant ces ménages de ceux des classes moyennes ou supérieures : les conditions d'accession des premiers restent notamment soumises à d'importantes contraintes financières.
Pour autant, et c'est ce que nous souhaitons souligner maintenant, on ne peut conclure, sur la base de ces seuls constats, au déclassement ou à la relégation des ménages populaires dans les espaces périurbains éloignés. L'étude des formes d'emploi et des trajectoires professionnelles de ces ménages donne en effet à voir une réalité autrement plus complexe.
b) Les réorganisations de l'emploi industriel : des effets ambivalents
Si les effets de la désindustrialisation des grands centres de production ont fait et font encore l'objet d'une importante médiatisation, les transformations qui accompagnent le développement des zones d'activité périurbaines restent beaucoup moins connues. Or ces zones sont elles aussi soumises au mouvement plus général de restructuration des activités industrielles : on y assiste ainsi à « l'éclatement des formes d'organisation du monde du travail actuel autour de pôles diversifiés » (Noiriel, 2002, p. 261).
C'est en particulier le cas dans le territoire que nous avons étudié, la Riboire, situé à 40 km d'une grande agglomération régionale : depuis 1982, un parc industriel s'y développe, et rassemble aujourd'hui plus de 3 700 emplois en CDI auxquels il faut ajouter de 1 000 à 2 000 emplois temporaires selon les périodes. Ces emplois sont répartis sur une centaine d'établissements, allant des grands groupes aux PME sous-traitantes, dans des secteurs d'activité divers (production automatisée, chimie, logistique, maintenance, agro-alimentaire). Deux processus caractérisent ainsi le bassin d'emploi de la Riboire : l'éclatement des emplois au sein de très nombreuses entreprises, ainsi que la segmentation croissante des statuts d'emploi, entre CDI, CDD, intérim et temps partiels. Ces processus reflètent la tendance structurelle à la diminution de la part des gros établissements dans l'emploi industriel 33 ( * ) , une tendance qui s'accompagne d'un contrôle accru exercé par les grands groupes sur les PME sous-traitantes. Ils traduisent également la diffusion des formes d'emploi dites « atypiques » parce que liées à des contrats précaires. On est donc bien loin de l'image des mono-industries locales employant largement la population du territoire environnant.
Or ces évolutions, très souvent oubliées lorsqu'il s'agit de décrire la situation des classes populaires du périurbain, ne sont bien sûr pas sans conséquences pour les ménages qui travaillent dans ces zones d'emploi. Elles entraînent en particulier des parcours professionnels heurtés pour de nombreux ouvriers ou employés. Mais elles se caractérisent aussi par un dernier type de changement, qui concerne les qualifications des salariés. On aurait en effet tort de lire les évolutions de l'emploi industriel uniquement sous l'angle de la précarisation des statuts d'emploi. Car si ces restructurations contribuent à la déstabilisation des emplois d'exécution, elles se sont aussi accompagnées d'un mouvement de hausse des qualifications. Si l'on y regarde de plus près, c'est principalement l'effectif des ouvriers non qualifiés qui a connu un net recul en France, passant de 2,5 à 1,1 million du début des années 1980 à la fin des années 1990 (Vigna, 2012, p. 229), alors que le nombre des techniciens et des agents de maîtrise a à l'inverse progressé de façon continue, de 1,2 à 1,6 million de salariés de 1982 à 2005 (soit 4,7 puis 5,9 % des actifs occupés) (Bosc, 2008, p. 24). Dans le cas de la Riboire, les postes d'ouvriers prédominent largement : ceux-ci rassemblent pas moins de 40 % du total des emplois implantés localement, dont un peu plus de la moitié d'emplois d'ouvriers qualifiés (21 % de l'emploi total). On donnerait toutefois une vision tronquée de la structuration de ce bassin d'emploi si l'on omettait les postes de contremaîtres et de techniciens, qui représentent respectivement 12 % et 7 % des emplois 34 ( * ) . Au final, la part des emplois d'intermédiaires est donc aussi importante que celle des emplois d'ouvriers non-qualifiés (19 %).
C'est donc l'ensemble de ces recompositions de l'emploi qu'il faut prendre en compte si l'on souhaite analyser les parcours professionnels des ouvriers du périurbain : ceux qui résident dans la Riboire travaillent dans un bassin d'emploi ayant connu des réorganisations massives, mais ils bénéficient de la croissance économique locale qui leur permet d'échapper aux périodes d'inactivité, comme en témoigne le taux de chômage resté relativement faible dans le canton (8,6 % en 2009). Et parmi les plus qualifiés, la part de ceux qui voient s'ouvrir des possibilités de progression de carrière est loin d'être négligeable. De façon plus générale, « la «filière technique» de promotion (par l'accès à des postes d'ouvriers qualifiés ou de contremaîtres et techniciens) continue [en effet] d'occuper [en France] un rôle notable dans les trajectoires de mobilité masculine » (Monso, 2006).
On retrouve là encore ces évolutions de façon concrète dans le canton périurbain que nous avons étudié. La prédominance des catégories populaires y ressort de façon très marquée si l'on tient compte d'une structure d'emploi fortement clivée selon le sexe. Du côté des femmes, les employées et ouvrières représentent respectivement 44 % et 17 % des actives ayant un emploi en 2008 (contre 47,3 % et 8,9 % en France 35 ( * ) ). Mais c'est principalement la surreprésentation des ouvriers chez les hommes qui apparaît comme une caractéristique marquante du canton : 45 % des actifs sont ouvriers en 2008 (contre 34,8 % en moyenne en France). Ce poids important des ouvriers renvoie en grande partie au maintien d'un nombre élevé d'emplois qualifiés : alors que la part des ouvriers non-qualifiés est en baisse (de 23 % en 1982 à 18 % en 1999), celle des ouvriers qualifiés reste stable sur cette période (30 %). Dans le même temps, la part des techniciens et agents de maîtrise a plus que doublé, passant de 8,5 % des actifs en 1982 à près de 18 % en 1999 36 ( * ) . Or, nombre de ces salariés intermédiaires de l'industrie sont d'anciens ouvriers ayant accédé, en cours ou en fin de carrière, à des postes plus qualifiés.
Les recompositions de l'emploi industriel ont donc des conséquences foncièrement ambivalentes, dans le périurbain comme ailleurs : si les fractions peu ou pas qualifiées des classes populaires sont durement soumises à la précarisation de l'emploi, les salariés qui sont dotés de qualifications techniques parviennent, pour certains, à accéder à des emplois stables, et, pour d'autres, à se projeter dans des parcours de promotion professionnelle par l'accès à la maîtrise. Et ce sont précisément ces parcours qui autorisent de nombreux ménages ouvriers à se lancer dans l'accession à la propriété individuelle.
c) Aspirer à la promotion sociale, se distinguer des ménages précarisés : des appartenances sociales en recomposition
À l'image de bien d'autres territoires périurbains, la Riboire constitue un espace d'accession à la propriété privilégié pour certaines fractions des classes populaires : les ménages qui y font construire des pavillons sont le plus souvent composés d'ouvriers et d'employées ayant accédé à des emplois stables et disposant de revenus salariaux réguliers leur permettant de s'engager dans l'accès à la propriété. Sur le plan des statuts socioprofessionnels, ils sont, pour une large part, relativement protégés par leurs qualifications. Ils appartiennent ainsi aux fractions des classes populaires que l'on peut qualifier de « subalternes mais non démunies » (Schwartz, 1998, p. 41), une expression qui permet de souligner que s'ils occupent des positions professionnelles subordonnées, ils ne sont pas toujours soumis à la précarité et accèdent au contraire, pour certains, à des postes qualifiés au cours de leur carrière. Cette stabilité professionnelle relative se traduit par des acquis économiques et patrimoniaux, comme en atteste la propriété d'occupation du logement.
C'est le cas d'un couple auprès duquel nous avons enquêté. Après un apprentissage de métallier, Michel, né au début des années 1950, a travaillé dans de nombreuses entreprises, chez un fournisseur de matériel de peinture industrielle, dans la carrosserie des poids lourds. Il est ensuite embauché dans une société de maintenance d'ascenseur et y accède, à la cinquantaine, à un poste de responsable qualité sûreté. Michel a en effet pris les devants, comme il le dit, lorsque les entreprises où il travaillait « battaient de l'aile », pour échapper au chômage et finalement connaître une progression de carrière dans la dernière société où il travaille. Avec sa femme Valérie, ils font construire à la fin des années 1980 dans la Riboire, où un promoteur les oriente, du fait du niveau resté relativement bas des prix des terrains, par rapport à la première couronne périurbaine. Ce parcours d'accession est rendu possible par la stabilité professionnelle de Valérie, qui est secrétaire de direction dans la même entreprise depuis son entrée dans la vie active. Cet exemple illustre bien les trajectoires d'un grand nombre des ménages populaires que nous avons rencontrés : la stabilité de l'insertion professionnelle des femmes apparaît en effet déterminante pour l'obtention des prêts immobiliers. À l'inverse, lorsque les femmes sont peu qualifiées, qu'elles travaillent dans les services à la personne ou comme préparatrices de commande dans la logistique par exemple, les ménages populaires ne parviennent bien souvent pas à devenir propriétaires. Enfin, cet exemple montre également que l'installation en pavillon exige un rapport mobilisé au travail de la part des hommes, à la fois pour se maintenir dans l'emploi, au prix parfois de nombreuses reconversions, mais aussi pour faire valoir leurs qualifications et espérer accéder à des postes d'intermédiaires, plus valorisants et aux salaires plus élevés.
Il faut cependant souligner que les conditions de l'accession se sont durcies au fil des années 1980, 1990 et 2000 : les jeunes ouvriers et employés s'endettent sur de longues périodes, et doivent également s'appuyer sur le soutien de la famille élargie (pour la garde des enfants notamment). Surtout, ils n'ont accès au crédit immobilier que lorsque l'un ou l'une d'entre eux au moins dispose d'un statut professionnel stable. La proximité du parc industriel constitue alors pour ces salariés des classes populaires un important support de stabilisation sociale : comme dans bien d'autres territoires périurbains, les jeunes ouvriers trouvent à s'investir dans les entreprises industrielles ou de service implantées sur ces nouvelles zones d'activité.
On en trouve un autre signe dans le fait que les lycéens de ce territoire sont nombreux à s'orienter vers des formations en alternance : plusieurs des familles auprès desquelles nous avons enquêté privilégient ainsi des voies d'insertion professionnelle dans l'industrie pour leurs enfants. C'est le cas des Clamart, dont le père, chaudronnier soudeur dans la maintenance nucléaire, est devenu chef d'équipe puis responsable des travaux dans une entreprise de sous-traitance de la Riboire. Sa femme, Véronique, a effectué des contrats d'intérim dans le parc industriel, avant d'être embauchée par la municipalité de la commune où la famille réside, pour le service de la cantine. Le fils aîné des Clamart est devenu agent de maîtrise dans l'entreprise où il a suivi un bac pro puis un BTS de maintenance industrielle en alternance. Leur second fils, âgé de 16 ans en 2012 , s'est également engagé dans un bac pro en alternance. Il faut signaler à ce propos que l'emploi public, et notamment celui de la fonction publique d'État, est à l'inverse très peu présent dans les territoires périurbains : le bassin d'emploi de la Riboire compte ainsi le plus faible taux d'emploi public (13 %) dans l'emploi local de sa région, où se taux atteint en moyenne 20 %. Cet état de fait contribue sans nul doute à favoriser, parmi les classes populaires périurbaines, les parcours d'insertion dans l'industrie ou le secteur privé des services. Les trajectoires sociales de ces hommes sont ainsi étroitement déterminées par l'acquisition de qualifications techniques : si ceux-ci restent dépendants des débouchés offerts dans le bassin d'emploi local, ils peuvent aussi, pour les plus diplômés, se projeter dans des carrières stables et ascendantes, à proximité de leur lieu de résidence. Comme on le voit, les évolutions de l'emploi périurbain sont déterminantes pour analyser les trajectoires de ces ménages des fractions supérieures des classes populaires. Or les effets de ces évolutions ne sont ni mécaniques, ni univoques : les recompositions de l'emploi contribuent à la différenciation croissante des parcours des salariés, entre précarisation pour les moins bien dotés et ouverture de voies d'ascension « modestes » pour d'autres.
Pour terminer, il faut dire quelques mots de la manière dont se définissent les appartenances sociales de ces ménages. Leur installation dans la Riboire est tout d'abord bien loin d'être vécue comme une relégation. Elle constitue au contraire un signe de promotion sociale, surtout pour ceux qui ont quitté les quartiers de la banlieue voisine : ces derniers mettent en avant leur installation dans un espace résidentiel pavillonnaire, par opposition à la dévalorisation qui pèse sur le logement social. S'il y a donc une transformation à rechercher dans la façon dont ces ménages se situent socialement, elle ne réside pas dans une dévalorisation univoque de leurs positions. Disposant d'acquis économiques leur permettant de devenir propriétaires, ces ménages sont au contraire porteurs d'aspirations à la promotion sociale : ils sont très souvent engagés dans des efforts de distinction vis-à-vis des fractions précarisées des classes populaires, efforts qu'encourage la généralisation des discours politiques stigmatisant les précaires, les chômeurs ou encore les locataires du parc HLM.
Ces ménages occupent ainsi une position d'entre deux : s'ils échappent aux formes les plus dures de précarité, leurs conditions de vie sont toutefois loin de se confondre avec celles des classes moyennes ou supérieures. Leurs trajectoires demeurent le plus souvent éloignées des formes d'ascension sociale, plus valorisées socialement et plus stables à bien des égards, que représentent la poursuite d'études longues, l'entrée dans la fonction publique ou l'accès aux emplois de cadres. Leurs statuts sociaux et professionnels restent en particulier étroitement liés au devenir de l'emploi local. Ancrés du côté du privé et du secteur industriel, ces salariés se sont cependant éloignés de la figure des groupes ouvriers de la grande industrie, soudés autour de la revendication de formes de fierté sociale. Nombre des salariés que nous avons rencontrés aspirent ainsi à sortir « par le haut » de la condition ouvrière. À l'heure où le statut d'ouvrier fait l'objet de disqualifications sociales et politiques récurrentes (Mauger, 2006), les parcours résidentiels jouent alors un rôle croissant pour ces ménages des fractions supérieures des classes populaires : ils constituent un important support de définition de leur appartenance sociale, à distance de l'image dévalorisée des cités.
d) Conclusion
Les trajectoires des classes populaires du périurbain sont donc travaillées par des évolutions bien plus complexes que celles qui nous sont données à voir dans la presse. Des évolutions qu'il faut relier à des processus sociaux plus vastes : restructurations de l'emploi industriel mais aussi politiques du logement et dévalorisation du logement social. Car ce que l'on saisit à partir du cas de la Riboire, semblable à beaucoup d'autres territoires périurbains, ce sont les effets sur le long terme des réorganisations de l'emploi : segmentation des statuts et déstructuration des collectifs de travail conduisent à un affaiblissement des formes d'identification aux lieux de travail, au profit d'un investissement sur la scène résidentielle, où nombre de ménages populaires construisent les signes de leur respectabilité sociale, à distance des quartiers populaires de banlieue.
|
Bibliographie Beaucire F. et Chalonge L. , « L'emploi dans les couronnes périurbaines, de la dépendance à l'interdépendance », in Pumain (D.) et Mattéi (M.-F.) (dir), Données urbaines 6 , Paris, Anthropos, 2011. Bosc S ., Sociologie des classes moyennes , Paris, La Découverte, 2008. Brutel C. et Levy D ., « Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010. 95 % de la population vit sous l'influence des villes », Insee première , n°1374, 2011. Cavaillès J., Selod H ., « Ségrégation sociale et périurbanisation », Recherches en économie et sociologie rurales. INRA Sciences sociales , 1-2 (03), 2003. Gaigné C., Piguet V., Schmitt B ., « Évolution récente de l'emploi industriel dans les territoires ruraux et urbains : une analyse structurelle-géographique sur données françaises », Revue d'Économie Régionale et Urbaine , 1, 2005. Lainé F. , « Péri-urbanisation des activités économiques et mouvements d'emploi des établissements » in Pumain (D.) et Mattéi (M.-F.) (dir), Données urbaines 3 , Paris, Économica, 2000. Mauger G ., « Les transformations des classes populaires en France depuis trente ans », in Lojkine J., Cours-Salies (P.), Vakaloulis (M.), dir., Nouvelles luttes de classes , Paris, Presses Universitaires de France, 2006. Monso O. , « Changer de groupe social en cours de carrière. Davantage de mobilité depuis les années quatre-vingt », INSEE première , 1112, 2006. Noiriel G. , Les Ouvriers dans la société française XIX e -XX e siècle , Paris, Seuil, 1986. Renahy N. , « Les transformations récentes du monde ouvrier », Écoflash , 168, 2002. Rivière J. , « La division sociale des espaces périurbains français et ses effets électoraux », in Pumain D. et Mattéi M.-F. (dir), Données urbaines 6 , Paris, Anthropos, 2011. Vigna X. , Histoire des ouvriers en France au XX e siècle , Paris, Perrin, 2012. |
4. Arrangements de famille en
agriculture : la relative séparation des espaces temps conjugaux et
professionnels37
(
*
)
Céline
Bessière
(Université de Paris Dauphine)
Depuis trente ans, le secteur agricole en France a connu une transformation majeure qui est passée relativement inaperçue : les compagnes d'agriculteurs occupent de plus en plus souvent un emploi salarié en dehors de l'exploitation. En 1970, seulement 7 % des épouses actives déclaraient exercer une activité professionnelle non-agricole ; en 2000, c'était le cas dans 40 % des ménages tous âges confondus et deux tiers des ménages de moins de 35 ans 38 ( * ) . Dans les exploitations professionnelles 39 ( * ) , la tendance est encore plus forte : en 2007, plus d'une conjointe d'exploitant sur deux et trois conjointes de moins de 30 ans sur quatre déclarent une activité en dehors de l'agriculture 40 ( * ) . Cette augmentation s'inscrit dans le cadre plus large du développement du salariat féminin dans les secteurs du tertiaire. De moins en moins souvent issues de familles agricoles 41 ( * ) , les compagnes d'agriculteurs conservent la profession qu'elles exerçaient avant leur mise en couple. De plus, la mécanisation et l'informatisation, l'agrandissement des structures, le développement des formes sociétaire ont permis - du moins dans les secteurs les plus spécialisés de l'agriculture - de se passer de la main d'oeuvre féminine. Le secteur viticole est ainsi l'un des secteurs (avec le maraîchage et la céréaliculture) où l'augmentation de l'emploi des femmes à l'extérieur de l'exploitation a été la plus forte 42 ( * ) .
Dans la région de Cognac, les compagnes des jeunes viticulteurs sont la plupart du temps des employées peu qualifiées (caissières, aides-soignantes, aides à domicile, etc.). Pour les plus diplômées d'entre elles, elles exercent une profession intermédiaire (infirmières, institutrices, etc.) 43 ( * ) . Souvent, elles cumulent des salaires faibles, des conditions d'emploi et des progressions de carrière peu favorables -- contrats à durée déterminée, temps partiel, chômage, alternance entre périodes d'emploi, congés maternité ou parentaux 44 ( * ) . Malgré ces situations professionnelles peu enviables, les jeunes viticulteurs et leurs compagnes promeuvent le « travail à l'extérieur ». Les implications sont profondes.
Le développement du « travail à l'extérieur » reconfigure les rapports entre les hommes et les femmes en couple ainsi que dans la maisonnée exploitante . Le terme maisonnée est emprunté à Florence Weber et Sibylle Gollac. Il désigne une unité de coopération productive réunissant plusieurs personnes plus ou moins apparentées et éventuellement co-résidentes 45 ( * ) . Les maisonnées sont, par définition, des groupes instables dans le temps : ce sont des moments d'organisation pratique de la parenté autour de causes communes 46 ( * ) . Dans le cas des maisonnées exploitantes, la cause commune en question est le maintien de l'exploitation familiale, tout à la fois sur le plan domestique et professionnel. On verra qu'au nom de leur emploi salarié, les compagnes de viticulteurs revendiquent un foyer conjugal plus autonome par rapport à la maisonnée exploitante, et qu'elles y parviennent en partie. A plus long terme, la généralisation du « travail à l'extérieur » rend possible et accompagne le développement de pratiques conjugales inédites dans les familles agricoles : les séparations conjugales. Les tensions entre les aspirations parfois divergentes des hommes et des femmes en couple, et les intérêts de la maisonnée exploitante seront donc au centre de ce texte.
a) La génération des belles-mères : « cent professions » et « femme de »
Dans les années 1960-70, l'idéal modernisateur dominait la politique agricole de la France. Les instances professionnelles agricoles ont cherché à favoriser un renouvellement générationnel sur les exploitations - en favorisant les départs à la retraite des vieux paysans et l'installation des jeunes agriculteurs sur des exploitations qui remplissaient des critères de viabilité économique, définis par la profession 47 ( * ) . La loi d'orientation agricole de 1960 a promu ainsi une structure d'exploitation familiale, en rupture par rapport au modèle pluri-générationnel : « l'exploitation à 2 UTH » (deux unités travail homme), c'est-à-dire le couple. Ce modèle d'exploitation devait permettre aux ménages d'agriculteurs et d'agricultrices d'atteindre la parité sociale et économique avec les autres milieux sociaux (notamment urbains et salariés) sans recours au travail à l'extérieur de l'exploitation. A l'époque, ce qui était visé était moins le travail salarié des femmes - qui demeurait marginal - que la pluriactivité des petits agriculteurs (ouvriers-paysans notamment), considérée alors comme un obstacle à la professionnalisation et la modernisation de l'agriculture 48 ( * ) . Dans cette perspective, le « travail à l'extérieur » des compagnes d'agriculteurs, assimilé à la pluriactivité, était bien peu légitime dans la profession. Synonyme de l'impossibilité de l'activité agricole à faire vivre un ménage, il devait progressivement disparaître.
Cependant, la reconnaissance sociale et juridique du travail des femmes en agriculture est restée au point mort dans les années 1960-1980, ce qui a eu des conséquences variables selon la position sociale des familles exploitantes. La plupart des compagnes de viticulteurs n'avaient pas d'autre choix que de travailler dans l'exploitation, en tant qu'aide familiale. Lors d'un entretien enregistré, Stéphane Dumont, un jeune viticulteur, a décrit à ma demande, la répartition des travaux dans l'exploitation familiale, en présentant d'abord les tâches effectuées par son père et lui-même. J'ai fini par demander ce que faisait sa mère, qui a été longtemps aide familiale sur l'exploitation (depuis son mariage en 1976), jusqu'à la création d'une EARL où elle est devenue co-exploitante, en 1994. La réponse de Stéphane fut éloquente : « Ma mère, elle fait tout ». L'enquêtrice, surprise, a souri. Stéphane a ajouté : « dans tous les domaines. Elle va dans la vigne tirer les bois, relever. Cette année, elle avait commencé à tailler, mais elle ne taille pas beaucoup. Mon père fait les traitements, forcément... Tout ce qui est tracteur, c'est mon père ! Les vendanges, ma mère suivait la machine pour ramasser les raisins qui restaient, signaler s'il y avait un problème à la machine, parce que quand les tapis bloquent, mon père ne l'entend pas devant ». Cet extrait d'entretien montre bien le caractère auxiliaire du travail de Guislaine Dumont et la difficulté de décrire autrement ses activités que par rapport à celles de son mari, auxquelles Stéphane revient toujours. « Cent professions ! » a déclaré devant moi une viticultrice d'une soixantaine d'années pour dire son absence de statut professionnel sur l'exploitation familiale. On ne peut mieux décrire qu'à travers ce jeu de mot le travail polyvalent (« cent professions »), non reconnu statutairement (« sans profession »), qui caractérise la majorité des femmes de cette génération.
Beaucoup plus rares, celles qui travaillaient « à l'extérieur » le faisaient principalement pour des raisons économiques : parce qu'il n'y avait pas assez de travail pour elles sur une exploitation trop petite, ou bien parce que l'exploitation rapportait trop peu. Ni ces femmes, ni leurs époux ne se vantaient de cette situation : « c'était mal vu » disent-ils et disent-elles aujourd'hui. Dans la bourgeoisie viticole, en revanche, c'est le repli sur la scène domestique conjugale qui dominait. En effet, dans les grandes entreprises viticoles qui emploient des salariés, le travail de ces femmes n'était pas aussi indispensable que chez les petits producteurs. La sphère domestique - à condition qu'elle fût soustraite au régime de la maisonnée exploitante et particulièrement au gouvernement des beaux-parents - pouvait constituer un lieu de réalisation de soi pour des femmes qui n'étaient pas reconnues professionnellement ni sur l'exploitation, ni en dehors.
C'est le cas par exemple de Nadine Lacheux que j'ai rencontrée à son domicile : une bâtisse imposante, posée au milieu des vignes. Nadine est une femme âgée d'environ 55 ans, à la silhouette élancée, et qui prend visiblement soin de son apparence. Elle porte les signes discrets de l'habit bourgeois 49 ( * ) : un pantalon cigarette, des mocassins, des bijoux dorés, un visage hâlé et légèrement maquillé, des cheveux mi-longs colorés blond et mis en plis. Dans un long entretien enregistré, Nadine a fait le récit de son entrée dans la famille Lacheux, lorsqu'elle a épousé Bernard, le fils aîné, en 1967. Issue d'une famille d'artistes locaux sans capitaux économiques et diplômée de la Chambre de commerce britannique, on peut dire qu'elle a fait un « beau mariage ». La famille Lacheux possède aujourd'hui un domaine de plus de 70 hectares de vignes, mais est surtout connue pour son activité de bouilleur de profession pour une grande maison de cognac. Au début des années 2000, treize personnes sont employées à temps plein par la société qui est dirigée par Bernard et son frère qui ont pris la suite de leur père, « le patriarche » pour reprendre l'expression de Nadine. Cette dernière affirme n'être jamais parvenue à imposer son envie de travailler, que ce soit à l'intérieur ou en dehors de l'entreprise familiale 50 ( * ) .
Peu après son mariage, elle aurait pu donner des cours d'anglais dans un institut privé de formation professionnelle : « ça a été très mal perçu, j'ai dû dire non » explique-t-elle. Nadine désigne ici l'opposition explicite de son beau-père : « votre mari ne gagnerait pas assez pour vous ! » lui a-t-il dit. Nadine n'avait pas les ressources pour contourner l'avis défavorable de son beau-père, et encore moins pour se passer de l'absence de soutien de son mari (« Je pense que mon mari ne m'a pas assez poussée, il fallait qu'on me pousse un peu ; mais à la campagne, on ne travaillait pas, ça ne se faisait pas »).
Nadine a cherché aussi, en vain, une forme de reconnaissance professionnelle dans l'entreprise familiale. Elle regrette que sa belle-famille - incarnée surtout par le « patriarche » - n'ait pas reconnu, ni utilisé ses compétences (« je parlais couramment anglais à l'époque, j'aurais aimé faire quelque chose, j'aimais bien les relations publiques, j'aimais bien voir les gens »). Au début de son mariage, elle n'était pas à l'aise à la distillerie où elle venait donner des coups de main et se sentait surtout « inutile » : « je sentais au regard de mon cher et tendre que je n'étais pas la bienvenue ». Au fil des années, elle a complètement cessé de s'y rendre : « on ne le souhaitait pas, je n'étais pas souhaitée. Je n'y vais jamais, très rarement. Parce que là, je viens, je me sens comme un cheveu sur la soupe ». Aujourd'hui, elle dit avoir cessé de « faire la guerre » pour imposer ses compétences dans l'entreprise. Elle prend désormais acte de sa dépendance matérielle vis-à-vis de ce qu'elle nomme « les Lacheux » et pour ne pas perdre la face, elle entérine son exclusion des affaires de l'entreprise en s'impliquant le moins possible (« je m'en suis exclue moi-même de ce clan »). Partagée entre révolte et résignation, Nadine décrit de façon amère le décalage entre ses aspirations à être reconnue pour elle-même et la place de « femme de » qui lui est imposée dans la famille Lacheux.
Faute de reconnaissance sur la scène professionnelle, elle en vient à investir pour elle-même, comme lieu de réalisation de soi, la scène domestique qu'on lui a assignée : « [Pour] le grand-père, une femme, c'est à ses casseroles ! Odieux, épouvantable, horrible ! », dit-elle. Dans la famille Lacheux, qui possède un important patrimoine immobilier, les couples mariés vivent dans des résidences séparées : le « patriarche » et sa femme sur le siège de l'exploitation ; leurs descendants dans un rayon de cinq kilomètres autour de la « maison-mère ». Certes, Nadine n'a jamais vécu sous le même toit que les parents de Bernard, mais sa conquête d'autonomie sur la scène résidentielle n'a pas été évidente à imposer pour autant. La grande maison où elle vit appartient « aux Lacheux ». Pendant longtemps, son beau-père y entrait sans prévenir, ni frapper : « grand-père venait, rentrait facilement comme dans un moulin. Après on lui a montré qu'on avait une sonnette à la porte » raconte-t-elle. Mais Nadine n'avait pas non plus d'autonomie financière par rapport à son mari pour aménager sa résidence à sa guise : « J'ai bien mis 15 ans, oui... 12, 14 ans à pouvoir commencer à démarrer, modestement les travaux dans la maison et imposer ma patte un peu ». Cette conquête d'un territoire conjugal et personnel ne s'est pas déroulée sans heurts, ni désillusions. L'appropriation de l'espace domestique comme territoire de soi est pour elle une appropriation « faute de mieux », notamment faute d'une reconnaissance personnelle satisfaisante sur une scène professionnelle.
Ces différents destins de conjointes de viticulteurs - d'aide familiale « cent professions » à « femme de » cantonnée à la sphère domestique - constituent aujourd'hui un modèle repoussoir à la fois pour les jeunes femmes et les jeunes hommes, dans toutes les exploitations familiales.
b) « Vaut mieux qu'elle travaille à l'extérieur ! »
Désormais, le travail salarié des conjointes d'agriculteurs concerne l'ensemble de l'espace social de la viticulture charentaise, depuis la bourgeoisie viticole jusqu'aux petits livreurs de vin. Cette généralisation s'est accompagnée d'une revalorisation sociale 51 ( * ) . Issues de plus en plus de familles non-agricoles et ayant intériorisé la norme dominante du travail salarié féminin, les compagnes des jeunes viticulteurs ne veulent pas subir le même sort que leurs belles-mères qui ont « trimé toute leur vie », « travaillé gratuitement » sur l'exploitation, « pour une retraite de misère ». Le travail salarié en dehors de l'exploitation apparaît ainsi comme l'instrument de leur émancipation. Comparant leur situation à celle de leur belle-mère, les jeunes compagnes de viticulteurs mettent l'accent sur deux avancées. D'une part, elles insistent sur leur émancipation financière par rapport à leur conjoint puisqu'elles disposent d'un salaire individualisé, versé sur un compte personnel. Alors que la génération des parents ne faisait pas de distinction entre les comptes individuels, conjugaux et professionnels, la génération des jeunes viticulteurs pratique davantage la séparation des comptes et des budgets, comme les couples dans les catégories moyennes et supérieures urbaines et salariées 52 ( * ) . D'autre part, elles apprécient l'autonomisation de leurs activités par rapport à leur compagnon, leurs beaux-parents, et plus généralement la maisonnée exploitante (« ça me sort », « ça me change » disent-elles souvent).
De leur côté, les jeunes viticulteurs sont les premiers à encourager leur compagne à « travailler à l'extérieur », souvent pour des raisons financières liées à l'exploitation viticole. Des revenus salariés permettent de « tenir » les mauvaises années sur le marché du cognac, afin de payer les factures ou les courses du ménage, sans prélèvement dans la trésorerie de l'exploitation. Ils permettent aussi à des jeunes viticulteurs de réinvestir à certains moments tout leur chiffre d'affaires dans l'entreprise, pour s'agrandir, acheter du matériel d'exploitation, développer l'entreprise, etc. Certaines compagnes salariées sont également sollicitées comme co-empruntrice ou caution bancaire de leur conjoint lors de la mise en place d'emprunts professionnels. Un salaire mensuel régulier, même modeste, est donc loin d'être négligeable pour le maintien économique de l'exploitation viticole.
Ainsi, Eric Roynaud s'est installé à la suite de ses parents comme exploitant individuel en 1998, à l'âge de 27 ans, sur une petite exploitation en polyculture (40 hectares de terres ; 6 hectares de vignes dont la production est vendue en vin à un négociant ; une dizaine de vaches allaitantes et huit laitières) ; sa compagne, Patricia, exerce une activité à mi-temps de portage de repas à domicile pour des personnes âgées depuis 1994 et gagne environ 450 €/mois. Alors que Patricia est surtout sensible à l'indépendance financière que lui procure son travail (« Je m'assume toute seule et même si c'est pas beaucoup, ça me fait un petit pécule » me dit-elle), pour Eric, cet emploi salarié s'inscrit avant tout dans la stratégie d'ensemble de l'exploitation familiale, dans un contexte économique peu favorable :
- Eric Roynaud : Vaut mieux qu'elle continue de travailler à l'extérieur ! Elle est sûre d'avoir un revenu. Parce que, il y en a beaucoup [d'agriculteurs] leur femme travaille à l'extérieur, et c'est elle qui fait marcher la maison. Je sais que moi, je l'incite à travailler ailleurs. Pas rester là. Je préfère embaucher un mi-temps, des saisonniers s'il faut, si j'ai besoin de bras, ou faire appel à des banques de travail, ou demander à des voisins.
Patricia est bien consciente de l'enjeu de son petit revenu pour l'exploitation : « sans mon salaire, ça serait sans doute plus difficile » reconnaît-elle. Son salaire, même s'il lui est versé directement sur un compte personnel, n'est pas sans conséquences sur le budget de l'exploitation : « c'est toujours ça en moins à verser du compte professionnel au compte personnel » remarque Eric.
Ma position sur le terrain - en tant que compagne de viticulteur qui elle-même occupait un emploi salarié régulier en dehors de l'exploitation - était particulièrement propice pour recueillir ce type de discours. J'ai souvent entendu des jeunes viticulteurs reconnaître en souriant que leur exploitation était financée par leur compagne ou plaisanter sur les femmes qui sont les meilleurs « sponsors » de l'agriculture. J'ai retrouvé cette expression dans la presse viticole locale : « Les exploitations ouvertement reconnues en difficultés ne seraient-elles pas plus nombreuses, si le salaire de l'épouse ne servait pas à faire «bouillir la marmite», selon l'expression consacrée ? La femme est la plus fidèle «sponsor» de son mari, et du cognac par extension » 53 ( * ) . En occupant un emploi salarié à l'extérieur de l'exploitation, les compagnes de viticulteurs ne se désengagent donc pas complètement de la maisonnée exploitante. Elles participent plutôt, d'une autre façon, au maintien économique de l'exploitation familiale 54 ( * ) .
c) Un logement dans la propriété familiale
L'emprise de la maisonnée exploitante sur les conditions de vie des compagnes de viticulteurs - malgré leur emploi salarié - est renforcée par leur installation à proximité de la propriété familiale. Si occuper un emploi salarié à l'extérieur permet une certaine émancipation financière des jeunes femmes de viticulteurs, l'inégalité patrimoniale entre conjoints demeure, particulièrement dans le domaine de l'immobilier. En effet, je n'ai rencontré aucune compagne de jeune viticulteur propriétaire de son logement (ou accédante à la propriété), dans un univers social où la location de la résidence principale est rarissime. Que les couples soient mariés ou non, les maisons d'habitation appartiennent à l'entreprise familiale, ou bien font partie des biens propres du jeune viticulteur acquis par donation ou par héritage. Les jeunes viticulteurs ou leurs parents possèdent souvent un patrimoine immobilier, mais aussi des outils, du matériel, et un ensemble de savoir-faire qui permettent de faire soi-même des travaux à un moindre coût pour réhabiliter des bâtiments d'exploitation disponibles. Cela permet aux jeunes couples d'occuper un logement à titre gratuit, une fois les travaux effectués. Etant donné leurs conditions d'emploi, la plupart des femmes ne disposent pas des ressources économiques suffisantes qui leur permettraient d'imposer la location d'un appartement à distance de l'exploitation 55 ( * ) , encore moins d'envisager une accession à la propriété ; surtout lorsque l'entreprise familiale permet de se loger à un moindre coût. Il en résulte que les compagnes de viticulteurs ne sont pas propriétaires de leur logement. Sur ce plan, les compagnes salariées des jeunes viticulteurs ne sont guères mieux loties que leurs belles-mères, qui venaient vivre et travailler sur l'exploitation de leur époux. Certes, elles ont pérennisé l'acquis d'un logement conjugal distinct de celui des beaux-parents, mais ce dernier appartient toujours à leur compagnon ou à l'entreprise familiale, et elles n'ont de ce fait guère le choix de leur lieu de résidence, souvent situé à proximité de l'exploitation.
Pourtant, malgré cette proximité résidentielle, les compagnes de viticulteurs qui occupent un emploi salarié aspirent à constituer un foyer conjugal autonome de la maisonnée exploitante. Elles prennent appui sur leur condition salariale pour remettre en question le fonctionnement de l'entreprise familiale.
d) Au quotidien, la référence au salariat
Il y a cinquante ans, lorsque plusieurs générations vivaient et travaillaient ensemble sur l'exploitation, préparer le repas, faire la lessive ou du bricolage, tailler dans les vignes ou vinifier dans les chais concourait d'une manière ou d'une autre au fonctionnement de l'exploitation qui était indissociablement une famille et une entreprise. Il n'y avait pas de moments familiaux en dehors de l'exploitation, ni de travail en dehors des rapports familiaux. Cette superposition des scènes domestiques et professionnelles s'est maintenue jusqu'à la génération des parents des jeunes viticulteurs de l'enquête, qui, certes, ont entamé un processus de décohabitation intergénérationnelle, mais ont continué à travailler en famille sur l'exploitation.
Les jeunes femmes qui occupent un emploi salarié « à l'extérieur » aspirent au contraire à une séparation plus grande entre espaces et moments conjugaux et espaces et moments professionnels. Elles exigent de leur conjoint, par exemple, des fins de semaine libres, quelques jours ou quelques semaines de vacances en même temps que les leurs. Leurs revendications, issues du mode de vie salarial, bouleversent ainsi le fonctionnement interne des maisonnées exploitantes, comme le montre l'exemple de Séverine Houdin et Guillaume Portal. Pour rappel, Séverine Houdin est âgée d'une trentaine d'années, elle est aide soignante et elle vit en concubinage avec Guillaume Portal, un jeune viticulteur, co-exploitant dans le GAEC familial. Au moment de l'enquête, le couple a deux jeunes enfants, Kévin et Quentin. Ils vivent dans un logement indépendant, juste en face du portail d'entrée de la cour des parents Portal, dans une vieille bâtisse qu'ils aménagent peu à peu, au gré de la naissance des enfants et de l'état de leurs finances. Séverine, comme la plupart des compagnes de viticulteurs que j'ai rencontrées, déplore la proximité et le vis-à-vis entre son domicile et celui de ces derniers : « je vois tout chez ma belle mère et dans la cour : ça ne me plaît pas tellement, mais c'est pas grave, je ne serai pas beaucoup dans cette pièce » me dit-elle au moment où son compagnon est en train de percer une fenêtre dans la cuisine de leur logement. Elle tente, en particulier, de soustraire son domicile à l'activité de l'exploitation. Séverine reproche ainsi à Guillaume de ne jamais « couper » avec son travail. Dans cette perspective, elle dénonce systématiquement les irruptions chez elle de Liliane Portal, sa belle-mère qui est aussi co-exploitante du GAEC. Les deux anecdotes suivantes illustrent bien les difficultés rencontrées par Séverine sur ce terrain :
Extrait du journal de terrain (février 2003) :
Séverine « en a assez » que Liliane vienne chez elle pour « engueuler » Guillaume au sujet de l'avancée des travaux de taille dans les vignes. Elle comprend pourtant la position de sa belle-mère. Elle trouve anormal que son compagnon privilégie en ce moment les travaux dans la maison par rapport aux vignes : « il exagère, c'est pas parce qu'il n'a pas de patron, qu'il ne doit rien faire ! », ou encore « j'essaye de lui dire que c'était quand même mieux avant, quand il avait fini de tailler en mars ». Cependant, elle est surtout exaspérée par le fait que les conflits entre Guillaume et sa mère se déroulent dans sa cuisine : « parce que moi, j'ai mon boulot à côté et j'ai pas envie d'entendre ça chez moi ; qu'ils se démerdent entre eux ! »
Extrait du journal de terrain (août 2004)
Séverine me rapporte une anecdote récente qui en dit long sur les inconvénients d'habiter sur le site de l'exploitation. Alors qu'elle rentrait du travail un vendredi soir à 21 heures 30, la mère de Guillaume est arrivée dans la cuisine, pour signaler à son fils qu'il y avait de la maladie dans les vignes. Séverine s'est retenue, sur le moment, de dire quoi que ce soit : « je crois qu'elle n'a même pas vu que j'étais là ». Cependant elle n'en pense pas moins et me rapporte ce qu'elle aurait aimé exprimer sur le coup : « il est 9h30, demain c'est le week-end, vous attendez lundi à 8h pour lui en parler ! »
Elle ajoute que sa belle-mère pourrait venir lui parler « de la famille », « de ses enfants », de quoi que ce soit, elle accepterait, « mais pas du travail, à ce moment-là ».
C'est au nom de son emploi salarié que Séverine construit son domicile comme un espace de repos qui doit être soustrait aux relations professionnelles et qu'elle précise les moments qui lui paraissent légitimes pour aborder ou ne pas aborder les questions qui concernent l'exploitation (pas le soir, pas le weekend). Par principe, elle ne souhaite pas participer aux discussions entre Guillaume et sa mère au sujet de l'exploitation (« qu'ils se démerdent entre eux »). En pratique, cette position est tout de même difficile à tenir. Séverine ne peut s'empêcher d'avoir un avis - et souvent de le donner - sur la conduite de l'exploitation (la tenue des vignes, le calendrier des travaux, etc.). On retrouve la même ambiguïté sur la tenue des comptes professionnels et conjugaux. La position de principe de Séverine est ferme : elle condamne le renflouage systématique des comptes de Guillaume par sa belle-mère et n'accepte pas que cette dernière prenne connaissance régulièrement du relevé de compte joint du jeune couple (« j 'ai 30 ans, c'est pas pour être dépendante de quelqu'un »). Cependant, il lui est fort difficile de refuser les avances financières de sa belle-mère dans les périodes de vaches maigres : « Guillaume, il a toujours été renfloué par sa mère. Et maintenant c'est nous... » (février 2003).
Séverine est donc souvent dans une position ambivalente entre ses aspirations, ses principes et ses pratiques. Certes, l'objectif de la séparation des espaces et des temps domestiques et professionnels est souvent concurrencé, en pratique, par les avantages matériels que procure une intégration dans le collectif de production et de consommation que constitue la maisonnée exploitante. Il faut souligner aussi combien Séverine Houdin et Liliane Portal ont noué dans leur fréquentation quotidienne une relation singulière, sur la base d'une complicité féminine, qui repose sur une trajectoire résidentielle commune (à 20 ans d'intervalle, toutes deux ont quitté la ville pour un petit village isolé en Charente). L'ensemble de ces gains matériels et affectifs ont conduit Séverine à ne pas dédaigner les avantages de la proximité physique de l'exploitation familiale, et à relativiser ses velléités d'institution d'un foyer conjugal autonome par rapport à la maisonnée exploitante.
Extrait de l'entretien enregistré (août 2000) :
- Séverine Houdin : C'est vrai que Liliane, au début, je la trouvais envahissante, mais si elle m'envahissait comme ça, je l'ai compris par la suite, c'est parce qu'elle voulait m'aider, moi, au maximum à me sentir bien ici. Parce qu'elle, c'est pareil, la mère de Guillaume a vécu, des années bien avant, la même chose que moi. Elle venait de Bordeaux, elle. Elle avait fait des études, elle aurait dû travailler à la Poste, quelque chose comme ça. Elle s'est retrouvée en pleine campagne, avec personne, personne, personne autour. Donc c'est pour ça qu'elle a été autant près de moi. Elle me notait quand est-ce que passait le boulanger, elle me notait tout, pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi. C'était pas facile ! En même temps, je n'avais pas envie non plus qu'elle vienne me dire tout ça. J'appréciais, mais en même temps ça me faisait chier parce que je crois qu'au fond de moi ça me faisait chier qu'il n'y ait qu'elle autour de moi. Grosso modo, à un moment donné ça a même été ma confidente. Et c'est vachement dur, parce que c'est ma belle-mère (...) Bon maintenant, c'est vrai, elle est envahissante, dans le sens où elle est couveuse...
- C. B. : De Guillaume ou de vous deux ?
- De nous deux. Donc c'est pas évident. Moi, y a des trucs qui m'énervent encore. Elle continue d'acheter des trucs à son fils, style les slips, et ça, je [ne] peux pas [supporter] ! Mais tant pis, je fais avec, je suis obligée de faire avec. Avant, j'aurais fait la gueule, mais maintenant qu'il y a Kévin, c'est plus pareil (...) Je l'envahis maintenant peut-être autant qu'elle, elle a pu m'envahir, parce que maintenant j'ai pris le pli. Bon elle vient, j'y vais, point. Surtout qu'elle est comme ça, bon ben tu rentres, tu as les clés si on est là, si on n'est pas là, enfin. Bon, c'est pour ça qu'on a une relation qui est beaucoup mieux. Elle le dit même des fois en rigolant, entre nous, ça va mieux.
Séverine m'a souvent fait remarquer combien l'arrivée des enfants a constitué un moment de rupture dans les rapports avec sa belle-mère, dans le sens d'une pacification de leur relation et d'une intensification des échanges de biens et de services entre elles 56 ( * ) . Nombreuses sont les jeunes femmes de viticulteurs qui confient ainsi leurs enfants à leur belle-mère aide familiale pour pouvoir travailler à l'extérieur 57 ( * ) . Il faut dire que les modes de garde collectifs sont inexistants hors des villes et que le recours à une assistante maternelle est coûteux. Relevons le paradoxe : les compagnes de viticulteurs présentent leur travail à l'extérieur comme une émancipation de la maisonnée exploitante, mais font appel à la disponibilité de leurs belles-mères (c'est-à-dire l'une des ressources de cette même maisonnée) pour la garde des enfants. Les jeunes femmes sont souvent conscientes de ces contradictions. Lorsque Séverine Houdin a repris son travail d'aide soignante après plusieurs mois de congé parental, elle a cherché à ce que son compagnon prenne en charge davantage les enfants (le week-end lorsqu'elle est de garde, le matin et le soir avant et après l'école, etc.). Guillaume, de son côté, trouve souvent des excuses pour se décharger de cette tâche auprès de sa propre mère, ce qui irrite souvent Séverine.
Comme Séverine Houdin, les compagnes de viticulteurs qui occupent un emploi salarié à l'extérieur tentent d'imposer, avec plus ou moins de réussite, un foyer conjugal plus autonome par rapport à l'entreprise familiale. Mais elles doivent aussi composer avec les difficultés matérielles de la vie quotidienne qui obligent à s'appuyer sur les ressources de la maisonnée exploitante (pour le logement, pour la garde des enfants, etc.), les relations avec des parents ou des beaux-parents un peu trop « envahissants » dans leur vie privée ou « directifs » sur l'exploitation. La généralisation du travail salarié des compagnes d'agriculteurs remet néanmoins en cause la superposition jusque-là évidente entre famille et entreprise, entre scène résidentielle et scène professionnelle, au prix parfois de heurts avec les (beaux)-parents exploitants, ainsi qu'à l'intérieur des jeunes couples. Les jeunes femmes salariées arrivent plus ou moins à leurs fins, selon leur emploi, leur trajectoire sociale, la position socio-économique de leur compagnon et de l'entreprise familiale. En effet, elles ne sont pas toutes égales dans leur quête d'autonomie individuelle et conjugale face à la maisonnée exploitante.
e) Un désengagement variable des travaux de l'exploitation
Ainsi, les jeunes femmes salariées sont plus ou moins épargnées par les charges de travail, sur l'exploitation. Les plus fragiles d'entre elles sur le marché du travail salarié -- celles qui ont des emplois peu qualifiés, peu rémunérateurs et surtout avec des contrats de travail à temps partiel et/ou des horaires décalés -- sont en effet contraintes (par leur conjoint, leurs beaux-parents) à participer à certains travaux sur l'exploitation, en sus de leur activité salariée.
Patricia Roynaud, par exemple, occupe un emploi à mi-temps de portage de repas à domicile. Ses horaires de travail, liés à l'ouverture des cuisines d'une résidence pour personnes âgées sont, selon elle, « très peu pratiques ». Elle travaille de 10 à 13 heures le matin pour préparer et transporter les repas, et de 15 à 17 heures l'après-midi pour nettoyer les plateaux et la cuisine 58 ( * ) . Le matin, elle s'occupe de son fils et de l'entretien domestique de la maison. Le soir, elle aide à l'étable, en donnant de la farine et en faisant boire les veaux (environ une heure tous les soirs). Lors de ses congés ou ses journées de récupération en semaine, elle accompagne sa belle-mère dans les vignes : « Je sais qu'il faut que j'aille aider à attacher 59 ( * ) en ce moment, ma belle-mère me le reprocherait si je ne venais pas ». Si du fait de son emploi salarié, elle est moins « investie » que ses beaux-parents (et surtout sa belle-mère) ne le souhaiteraient dans l'activité de l'exploitation, elle ne peut pas s'y soustraire totalement et doit faire preuve, par des aides régulières et répétées, de sa bonne volonté.
Pour que les jeunes femmes soient complètement dégagées d'obligations de travail dans l'entreprise familiale, il faut donc des ressources culturelles et économiques importantes -- de la part de ces dernières, mais aussi de leur conjoint exploitant. Le relatif désengagement de l'exploitation des compagnes de viticulteurs conduit, en effet, à une adaptation du collectif de production : une sollicitation plus durable de la génération des parents bien au-delà de l'âge légal de la retraite ; l'embauche éventuelle de stagiaires ou de salariés agricoles pour les exploitations qui ont les plus gros chiffres d'affaire ; ou encore la mise en oeuvre de nouvelles stratégies de production, moins intensives en main-d'oeuvre (l'accroissement de la mécanisation, la réorientation des ateliers de production en faveur de la mono-viticulture intensive). Ce sont dans les petites exploitations en polyculture qui exigent une importante main-d'oeuvre familiale, comme chez les Roynaud, que l'incertitude est maximale. Se pose, en effet, à moyen terme, la question du remplacement du travail des parents-exploitants, par celui de leur belle-fille. Cette incertitude est moins prégnante dans les grandes entreprises viticoles qui emploient une main d'oeuvre salariée.
f) La séparation comme horizon des couples viticulteur/salariée
Une autre incertitude, liée aux transformations des rapports conjugaux, pèse à plus long terme sur le maintien des exploitations familiales viticoles : l'accroissement des séparations conjugales. On sait que les hommes agriculteurs en France, lorsqu'ils se mettent en couple, se séparent moins, se marient davantage et divorcent moins que les hommes de leur âge, appartenant à toutes les autres catégories socio-professionnelles 60 ( * ) . Cependant l'enquête a permis l'observation de pratiques conjugales inédites dans les familles agricoles : la généralisation de l'union libre en début de vie commune, la fin du recours systématique au mariage, mais aussi l'apparition des divorces et plus généralement la possibilité, toujours présente dans la vie de couple, de la séparation.
Ce qui distingue la génération des jeunes viticulteurs et de leurs compagnes de celle de leurs aîné-e-s, c'est que la séparation ne constitue pas pour eux une situation improbable ou exceptionnelle. Nombreux sont celles et ceux qui ont connu des ruptures, que ce soit des séparations ou des divorces dans leur entourage amical (ami-e-s d'enfance, voisinage, collègues de travail) et/ou familial. Le mensuel professionnel local, Le paysan vigneron, Revue régionale viti-vinicole des Charentes et du Bordelais , dont l'essentiel des articles concerne les techniques viticoles et la vie économique locale, a consacré un dossier de six pages sur les séparations conjugales dans son numéro d'octobre 2002. Les différentes rubriques informaient les viticulteurs sur les modalités pratiques de règlement des divorces : « Rupture du lien conjugal : les conséquences patrimoniales du divorce ; les différentes formes de divorce ; la place de l'enfant, etc. ». Les jeunes viticulteurs et leurs compagnes salariées semblent donc tout autant acculturés que les autres groupes sociaux au droit qui encadre les pratiques conjugales contemporaines 61 ( * ) . Ils intègrent ainsi dans leurs rapports conjugaux la possibilité de se séparer, ce qui change la teneur et la régulation du système d'échange que constitue le couple 62 ( * ) . Selon les couples et le moment de leur histoire, cette anticipation d'une rupture éventuelle peut prendre des modalités différentes : de la conscience diffuse d'une possible séparation, à la menace permanente de la rupture dans les rapports conjugaux.
Prenons à nouveau l'exemple de Guillaume Portal (viticulteur) et Séverine Houdin (aide-soignante) et revenons brièvement sur les conditions de ma rencontre avec ce jeune couple. J'ai pris contact avec Guillaume en 2000 lors de mon installation en Charente et rencontré peu après sa compagne, lors d'un dîner entre amis. La jeune femme, qui avait aménagé deux années plus tôt sur l'exploitation de Guillaume, se sentait isolée et ne pouvait accueillir qu'avec enthousiasme mon arrivée dans le voisinage. Elle a accepté d'emblée le principe d'un (long) entretien enregistré et nous nous sommes vues très régulièrement par la suite. Séverine est souvent venue se confier à moi entre 2000 et 2005. Cette situation de recueil des données (qui n'était pas explicitée entre nous en tant que telle) minimisait les périodes d'apaisement dans ses relations avec Guillaume au profit de l'exposé des situations de désaccord ou du récit des conflits dans le couple.
La perspective de la séparation n'est pas du tout abstraite ni pour Guillaume ni pour Séverine. Ils ont plusieurs exemples concrets de rupture dans leur entourage proche, au premier chef leurs parents qui ont divorcé. Guillaume est né du second mariage de son père (viticulteur), tandis que les parents de Séverine (éducateur spécialisé et employée de mairie) ont divorcé alors qu'elle avait sept ans. L'un et l'autre ayant déjà eu une première expérience de vie en couple de quelques années, ils ont conscience à tout instant qu'ils peuvent eux-mêmes se séparer.
A plusieurs reprises, Séverine a dénoncé devant moi le chantage à la rupture que lui faisait subir Guillaume en cas de désaccord : « il en a abusé des «c'est ça, ou tu t'en vas !» » ; « je lui ai dit de bien réfléchir lorsqu'il emploierait désormais ce terme » (février 2003). Mais elle reconnaît avoir recours elle-même à ce genre d'avertissement. Comme l'a bien résumé la jeune femme, dans l'entretien enregistré que j'ai réalisé avec elle en août 2000 : « On a des hauts des bas et à chaque fois on a une crainte c'est que l'autre se tire : que moi je m'en aille ou que lui me dise, «tu prends la porte» ! ». A plusieurs reprises, dans ces moments de crise conjugale où la menace de la séparation se faisait plus précise, Séverine a fait devant moi « ses calculs », en cas de séparation. Elle dressait par exemple l'inventaire des meubles qu'elle exigerait de récupérer en cas de rupture : les meubles qu'elle avait achetés elle-même (lit, commode, chambre des enfants, poufs) et ceux qu'elle avait apportés à son arrivée (lave-linge, frigidaire) et avec lesquels elle estimait légitime de repartir. « Il aura une maison, mais elle sera bien vide dedans » concluait-elle en avril 2003. Elle a pris aussi régulièrement des renseignements auprès de la Caisse d'Allocations Familiales par l'intermédiaire d'une amie qui y travaillait et qui l'informait régulièrement sur ses droits en cas de séparation.
Séverine manifeste souvent ses hésitations sur sa vie affective avec Guillaume auprès d'un ensemble de confidentes (toutes de sexe féminin) : sa mère, sa belle-mère, ses collègues de travail, ses amies (dont moi). A l'automne 2004, elle a annoncé à tout son entourage qu'elle était « en voie de séparation » avec Guillaume. Souvent, elle m'a présenté la rupture comme un horizon inéluctable de sa vie en couple : « peut-être que je sais au fond de moi qu'un jour ou l'autre ça va péter, que ça finira comme ça, avec 2, 3 ou 4 enfants » (février 2003), « de toutes façons, je sais que je vais le quitter un jour. J'aurais déjà dû le faire à la naissance de Quentin, si je ne le fais pas maintenant, ça sera peut-être plus tard dans un an ou deux ans ou cinq ans, mais je vais le quitter un jour » (avril 2003). De tels propos ont provoqué dans son entourage des réactions d'incompréhension -- « tout le monde me dit arrête, t'es toujours en train de dire et si on se sépare et si et si... » (août 2000) - voire d'indignation - « je le dis à la mère de Guillaume, elle est affolée, elle me dit, mais pourquoi tu parles tout le temps de ça, ça va s'arranger ! » (février 2003) - ou bien de résignation - « la soeur de Guillaume me dit que de toutes façons, elle ne s'inquiète pas, on a toujours été comme ça et on le sera toujours, mais on ne peut pas se quitter ! » (février 2003).
Si Séverine extériorise souvent la fragilité de sa vie de couple auprès de plusieurs confidentes, Guillaume au contraire est beaucoup plus réservé. A ma connaissance, cela ne fait pas partie des sujets de conversation qu'il peut avoir dans son groupe de copains, ou avec sa famille. Il tend même au contraire à donner, à l'extérieur, une image pacifiée de sa vie en couple. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'envisage pas lui-même la possibilité d'une rupture. La prise en compte de l'instabilité de la vie conjugale s'exprime surtout chez lui par le refus de l'engagement dans le mariage, malgré les pressions régulières de sa compagne en ce sens.
g) Les coûts d'une éventuelle rupture
Comme Séverine Houdin et Guillaume Portal, les jeunes viticulteurs rencontrés et leurs compagnes salariées, ont intégré la séparation comme une issue possible à leur histoire conjugale. En cela, les jeunes agriculteurs ne sont pas isolés des préoccupations conjugales de leurs contemporains appartenant aux catégories sociales urbaines, salariées et indépendantes : ils sont conscients des risques de séparation, et sont informés des formes concrètes de leur mise en oeuvre. Mais ils savent aussi que les ruptures conjugales peuvent s'avérer coûteuses en présence d'une entreprise familiale 63 ( * ) .
Certes, du fait de la généralisation de l'emploi salarié des compagnes, les ruptures d'union ne sont plus systématiquement synonymes de bouleversement de l'organisation de la production de l'exploitation, ni de la situation professionnelle des deux conjoints. Mais la causalité est également inverse. Certains couples refusent d'autant plus obstinément de travailler ensemble qu'ils anticipent les risques de séparation et qu'ils savent combien « les divorces chez les viticulteurs qui travaillent ensemble, ça produit des catastrophes sur tous les plans » (Marc Marchand). Même lorsque les conjoints ne travaillent pas ensemble dans l'exploitation, les ruptures conjugales comportent des risques financiers importants de part et d'autre. Les femmes courent un risque d'appauvrissement au moment de la séparation, du fait des inégalités de revenus et des inégalités patrimoniales entre conjoints : elles doivent notamment trouver un nouveau logement 64 ( * ) . Les hommes risquent également de perdre financièrement lors d'une rupture du fait de l'importante coopération financière entre les viticulteurs et leurs compagnes salariées. Le régime matrimonial de la séparation de biens est ainsi vivement recommandé par les conseillers juridiques (les notaires notamment) aux indépendants dont le conjoint ne participe pas à l'entreprise familiale. Les risques financiers en cas de séparation sont davantage pris en compte par les jeunes générations d'agriculteurs que par les générations précédentes. En atteste, l'accroissement de l'union libre et des régimes matrimoniaux séparatistes : deux formes équivalentes sur le plan patrimonial en cas de divorce ou de décès, les conjoints n'ayant pas de biens communs. En 2004, selon l'enquête Patrimoine de l'Insee, près d'un tiers des couples dont le chef d'exploitation est âgé de moins de 50 ans pratique une séparation de leurs biens (19 % sont mariés selon un régime de séparation de biens et 11 % sont en union libre) 65 ( * ) .
Lorsqu'elles mettent en jeu une entreprise familiale, les séparations conjugales induisent des coûts et des difficultés économiques supplémentaires pour les deux conjoints, notamment lorsque règne entre eux une coopération productive et/ou financière. Mais, il y a plus. Les viticulteurs sont, on l'a vu, très attachés à la transmission familiale de leur exploitation. En cas de séparation conjugale, ils craignent par dessus tout l'éloignement physique de leurs enfants et la mise à mal de leurs stratégies de transmission de l'exploitation dans la lignée. On peut étayer cette hypothèse à partir de l'analyse du divorce de Samuel et Sophie Aisard, un couple composé d'un jeune viticulteur (né en 1972), et d'une aide-soignante, que j'ai rencontré par l'intermédiaire de Guillaume Portal et Séverine Houdin 66 ( * ) .
Il est inutile ici de rentrer dans les détails de la procédure judiciaire qui a abouti - chose relativement rare - à ce que la résidence de la petite Gaëlle, âgée de deux ans, soit fixée au domicile de son père. Il suffit de savoir qu'après la signature d'une première convention entre les conjoints en août 2002, qui fixait la résidence habituelle de Gaëlle sur l'exploitation familiale (chez son père) et organisait une garde alternée, Sophie Aisard a demandé un changement de résidence de l'enfant en sa faveur. Elle a avancé comme argument qu'elle souhaitait retourner habiter en Charente-Maritime, d'où elle est originaire. La procédure de divorce est devenue conflictuelle, chacun des ex-conjoints réclamant la « garde » de l'enfant ; le juge aux affaires familiales donnant finalement raison au père, après enquête sociale, en juin 2003.
On ne peut que constater l'intérêt considérable de Samuel Aisard pour la garde de sa fille. Lorsque je l'ai rencontré chez Guillaume et Séverine en août 2002, au tout début de la procédure de divorce, il clamait haut et fort devant ses amis qu'il exigeait qu'elle vive chez lui, au nom de la chanson de Daniel Balavoine, qu'il convoquait à plusieurs reprises dans son propos - « c'est ma fille, ma bataille, sinon on ira au divorce au charbon ! ». Ce qui importait, avant tout, pour Samuel, c'est que revienne à sa fille la maison qui provient de l'héritage de son père, qu'il a rendue habitable en effectuant lui-même des travaux et qui est inscrite physiquement dans la « propriété familiale », puisqu'elle jouxte les bâtiments d'exploitation. Il n'entendait pas seulement transmettre cette maison à Gaëlle comme un patrimoine immobilier, mais que celle-ci soit « sa maison » - au sens que sa fille puisse y développer un attachement au lieu - d'où son souci dès le début de la procédure de divorce d'y établir sa résidence. Même s'il n'est pas question ici de la transmission de l'exploitation familiale en tant que telle (mais seulement de la maison imbriquée dans la propriété), Samuel Aisard a cherché à pérenniser, à travers la garde de sa fille, sa lignée : « si je fais quelque chose, c'est pour le passé » m'a-t-il dit.
Guillaume Portal a accepté de témoigner en faveur de Samuel Aisard, au cours de la procédure de divorce. Samuel est, en effet, un ami de longue date de Guillaume, mais surtout, ce dernier ne pouvait qu'acquiescer à sa volonté d'obtenir la garde de sa fille. Guillaume a signifié à plusieurs reprises à Séverine qu'en cas de rupture, il exigerait, lui aussi, la garde des enfants et surtout celle de son fils aîné, Kévin (né en 1999), qui a été très tôt le repreneur pressenti de l'exploitation. A plusieurs reprises, Séverine m'a rapporté les propos de son compagnon à ce sujet : Guillaume gardera Kevin « coûte que coûte » (avril 2003) ; « tu prends Quentin et je garde Kevin » (août 2004). Une séparation conjugale présente donc un risque majeur pour les viticulteurs : l'éloignement physique des enfants, synonyme quasi-certain de l'impossibilité de transmettre son attachement à la « propriété », ses savoir-faire de viticulteur et son goût pour la reprise de l'exploitation.
L'affaire du divorce de Samuel et Sophie Aisard a suscité chez Séverine Houdin la crainte de ne pas obtenir à coup sûr la garde de ses fils, en cas de rupture avec Guillaume. Sa connaissance pratique des modalités de règlement de séparation la conduit cependant à relativiser cette angoisse. Elle sait que ce sont les mères qui obtiennent le plus souvent la garde des enfants, et d'autant plus quand le couple n'est pas marié, comme c'est son cas. Finalement, Séverine a bien conscience que sa plus grande source de pouvoir dans le couple est liée à la présence de ses enfants. Même si Guillaume refuse toujours le mariage, il ne peut pas la quitter « sur un coup de tête » (comme sa première compagne avec qui il était resté deux ans), pour cette raison-là : « il aurait beaucoup plus à perdre » me dit-elle en février 2003. Elle sait combien une « bonne séparation » du point de vue de Guillaume, consisterait à ce qu'elle s'installe dans les environs, pour qu'il puisse continuer à voir ses enfants. Dans les nombreux scenarii de rupture qu'elle a élaborés au fil du temps, Séverine oscille donc entre rester en Charente pour « ne pas priver les enfants de leur père », et une logique d'autonomie individuelle -- « tant qu'à le quitter, autant quitter la région, retourner dans le Sud-Ouest et refaire sa vie » (extrait du journal de terrain en août 2004).
La norme de l'indissolubilité du couple parental considéré comme seul conforme au bien-être de l'enfant s'est imposée progressivement dans les règlements des divorces ces trente dernières années 67 ( * ) . La mise en oeuvre pratique de cette norme suppose une proximité géographique entre les ex-conjoints. En situation de virilocalité (c'est-à-dire où ce sont les femmes qui viennent habiter chez leur conjoint, et non l'inverse) cette question de la proximité géographique est moins problématique pour les hommes (qui ne bougent pas de l'exploitation) que pour les femmes qui partent au moment de la séparation parce que ce sont elles qui sont arrivées au moment de la mise en couple. On peut comprendre ainsi le conflit sur la garde des enfants de Samuel et Sophie Aisard, lié au déménagement de Sophie dans sa ville natale, en Charente-Maritime. Qu'elle ait déménagé pour des raisons professionnelles (retrouver un emploi d'aide soignante plus facilement), des raisons familiales (se rapprocher de sa mère) ou refaire sa vie conjugale, peu importe pour l'analyse. Le modèle de l'indissolubilité du couple parental constitue une lourde contrainte pour les ex-compagnes d'agriculteurs puisqu'elle signifie, pour elles, vivre à proximité de l'exploitation de leur ex-conjoint : en milieu rural, pas forcément dans leur localité d'origine, loin des bassins d'emploi, etc. A l'inverse, les normes juridiques actuelles sur le maintien du couple parental viennent étayer les revendications des agriculteurs qui craignent avant tout l'éloignement physique de leurs enfants, au nom du maintien de la lignée et de la continuité de l'entreprise familiale. On peut voir ainsi des jeunes viticulteurs, comme Samuel Aisard, prêts à se saisir des nouveaux dispositifs juridiques en faveur des droits des pères en cas de séparation (résidence alternée, voire résidence principale des enfants au domicile du père), même si c'est au prix d'un alourdissement de leur temps de prise en charge des enfants.
h) Conclusion
Les ruptures d'union font désormais partie de l'univers des jeunes couples de viticulteurs et salariées. La causalité est à double sens : c'est parce que les conjoints ont des professions séparées qu'ils peuvent envisager une séparation, mais c'est aussi parce que les jeunes couples anticipent les risques d'une rupture conjugale qu'ils plébiscitent le travail à l'extérieur. Les ruptures d'union présentent néanmoins pour les viticulteurs et leurs conjointes des enjeux spécifiques, qui les rendent plus coûteuses et/ou plus douloureuses que dans d'autres groupes sociaux salariés et indépendants. Il faut ici distinguer la position des femmes et des hommes. Les compagnes des viticulteurs, comme beaucoup d'autres femmes, courent le risque d'un appauvrissement lors de la séparation et font face à un dilemme : favoriser le maintien du couple parental, au nom de l'intérêt de l'enfant, en déménageant à proximité de l'exploitation de leur ex-conjoint ou bien s'éloigner de l'exploitation au nom de leurs aspirations à une plus grande autonomie individuelle (dans leur vie privée et professionnelle). Les viticulteurs, au contraire, ont tendance à mettre en avant l'intérêt de l'enfant, en vue d'assurer la transmission de l'exploitation dans la lignée. L'impératif de transmission de la lignée -- dont on sait grâce aux travaux d'anthropologie historique qu'il a marqué durablement un grand nombre de paysanneries européennes 68 ( * ) -- constitue donc un enjeu crucial des ruptures (et de l'absence de rupture) d'union des agriculteurs contemporains. Ce qui change ce sont les modalités par lesquelles s'expriment désormais cette conception (certains jeunes agriculteurs sont prêts à ce titre à se saisir des nouveaux dispositifs juridiques en faveur du droit des pères) et le fait qu'elle n'est plus partagée par bon nombre de femmes, qui de fait, ne sont plus agricultrices.
* 14 Combes P.P. et M. Lafourcade (2012). Revue de la littérature académique quantifiant les effets d'agglomération sur la productivité et l'emploi . Rapport préparé pour la Société du Grand Paris.
* 15 Ciccone, A. (2002). Agglomeration effects in Europe. European Economic Review , 46: 213-227.
* 16 Une aire urbaine comporte une unité urbaine centre et une couronne. Une unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. Une « grande aire urbaine » est un ensemble de communes , d'un seul tenant et sans enclave, constitué par une unité urbaine offrant plus de 10 000 emplois et par une couronne périurbaine constituée de communes contigües dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans l'aire urbaine.
* 17 A savoir : moyennes aires urbaines (entre 5000 et 10000 emplois dans l'unité urbaine centre), petites aires urbaines (entre 1500 et 5000 emplois dans l'unité urbaine centre), communes multipolarisées par plusieurs grandes aires urbaines, autres communes multipolarisées et, enfin, communes hors influence de pôles qui sont ce qu'on désigne parfois comme l'espace rural.
* 18 Ces deux postes de dépenses représentent approximativement 40 % de la consommation des ménages.
* 19 Cavailhès J., Gaigné C., Tabuchi T. et Thisse J.F. (2007). Trade and the structure of cities, Journal of Urban Economics , 62 (3): 383-404.
* 20 Cavailhès J., Gaigné C., Tabuchi T. et Thisse J.F. (2007), op. cit .
* 21 La définition statistique des communes de banlieue ne correspond pas au sens que les journalistes donnent généralement à ce terme. Par exemple Neuilly-sur-Seine, la commune française fiscalement la plus riche de France, est une commune de banlieue.
* 22 Le terme de couronne périurbaine ne correspond pas à l'image d'une mince frange entourant les villes. D'une part, la majorité des communes périurbaines sont rurales (elles comptent moins de 2000 habitants agglomérés). D'autre part, en 2010, les couronnes des grandes aires urbaines (plus de 10000 emplois dans l'unité urbaine centre) couvrent plus du quart du territoire national (28,4%).
* 23 Eric Charmes (2011), La ville émiettée. Essai sur la clubbisation de la vie urbaine, PUF, coll. « La ville en débat », 288 p.
* 24 Brueckner J. K., Thisse J. F., Zenou Y. (1999). Why is central Paris rich and downtown Detroit poor? An amenity-based theory, European Economic Review , 43: 91-107.
* 25 L'Insee publie des résultats de revenu médian par ménage, mais il n'est pas possible d'effectuer des calculs sur des médianes, ce qui nous conduit à privilégier le revenu moyen par foyer fiscal.
* 26 Dans la commune de Toulouse, le revenu médian par ménage varie presque de 1 à 4 : de 11 279 € dans l'IRIS « Loire » à 42 998 € dans l'IRIS « Deltour » (source : Insee, données 2009).
* 27 Friggit J., Prix de l'immobilier d'habitation sur le long terme, CGEDD.
* 28 Par exemple : la population étudiante a augmenté depuis 1984 ; or, elle réside principalement dans les villes universitaires centres et les foyers fiscaux d'étudiants ont de bas revenus, ce qui peut expliquer en partie la dégradation de la situation de ces villes.
* 29 Le dernier rapport de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles (ZUS) confirme à la fois l'importance et l'accroissement des écarts entre les ZUS et les unités urbaines qui les contiennent. Par exemple, les écarts entre taux de chômage dans les ZUS et hors de ces zones sont considérables et continuent de croître : ils étaient respectivement de 17% et 9% en 2003, ils sont de 22,7% et 9,4% en 2011.
* 30 J. Cavailhès, J-F. Thisse. « Faut-il choisir entre égalité des territoires et développement économique ? ». In : Eloi Laurent (dir.) (2013), Vers l'égalité des territoires. Dynamiques, mesures, politiques , La Documentation Française, pp. 364-380.
* 31 Données concernant 37 aires urbaines de plus de 80 000 emplois en 1999, hors Paris, ces aires rassemblant 53 % de l'ensemble des emplois en France. (Beaucire et Chalonge 2011, p. 61)
* 32 INSEE, RP 2008, calcul de l'auteure à partir du zonage en aires urbaines de 1999. Le zonage 1999 a été retenu au détriment de celui de 2010, dans lequel la catégorie des espaces ruraux disparaît au profit de celle des communes isolées hors influence des pôles, qui ne rassemble plus que 5 % de la population française (Brutel, Levy, 2011). L'enquête emploi 2010 de l'Insee montre également que la moitié des ouvriers réside dans des communes rurales ou périurbaines de moins de 2 000 habitants ou dans des agglomérations de moins de 20 000 habitants.
* 33 « Entre 1975 et 1996, la part des établissements du secteur industriel de plus de 200 salariés est passée de 54,4 % à 39,7 % » (Renahy, 2002, p. 3). Dans le parc de la Riboire, en 2007, on compte ainsi 80 établissements de moins de 200 salariés sur 91 établissements.
* 34 Emplois au lieu de travail à l'échelle d'un canton périurbain dans lequel est implanté le parc industriel de la Riboire, Insee, RP 1999.
* 35 Insee, enquête emploi 2008.
* 36 Bases de données communales du recensement de la population (BDCOM) 1982, 1990, 1999, INSEE [producteur], Centre Maurice Halbwachs [diffuseur].
* 37 Texte support extrait de Céline Bessière, De génération en génération, Arrangements de famille dans les entreprises viticoles de Cognac , Paris, Raisons d'Agir, 2010, Chapitre 7.
* 38 S. Rattin, « Deux jeunes ménages d'agriculteurs sur cinq ont des ressources non agricoles », Données sociales, Paris, Insee, 2002, p. 439-446.
* 39 Depuis les années 1950, le Ministère de l'agriculture distingue les exploitations professionnelles parmi l'ensemble des exploitations agricoles françaises. Pour entrer dans cette catégorie, les exploitations doivent remplir simultanément deux critères : une surface de production supérieure à 12 hectares équivalent-blé et l'occupation d'au moins une personne à trois quart de temps pendant l'année.
* 40 Laurent Bisault, « Agricultrice : un métier qui s'impose à tout petits pas ». Agreste Primeur n° 223, mars 2009 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur22, p. 2.
* 41 Cf. C. Giraud, J. Rémy, « Le choix des conjoints en agriculture », Revue d'Etudes en Agriculture et Environnement , 3 (88), p. 25. Selon l'enquête Emploi de l'INSEE, en 1990, 70% des agriculteurs avaient une conjointe d'origine agricole ; en 2000, seulement 55% des conjointes d'agriculteurs et 39% des conjointes de jeunes agriculteurs (âgés de 25 à 35 ans) étaient d'origine agricole. En tenant compte de la part des conjointes d'origine agricole dans l'ensemble de la population, on aboutit à une baisse de l'indice d'homogamie.
* 42 Ibid. p. 34. Dans les secteurs de la polyculture et de l'élevage laitier, la part des conjointes co-exploitantes est plus importante.
* 43 A l'échelle nationale, selon l'enquête Structure des exploitations 2007 , 30% des conjointes d'exploitants professionnels sont employées, 10% sont des professions intermédiaires, moins de 5% sont cadres. Cf. L. Bisault, « Agricultrice... », art. cit ., p. 4.
* 44 Sur les caractéristiques de l'emploi salarié féminin : M. Maruani (dir.), Les nouvelles frontières de l'inégalité. Hommes et femmes sur le marché du travail , Paris, Syros, 1998.
* 45 F. Weber, « Pour penser la parenté contemporaine. Maisonnée et parentèle, des outils de l'anthropologie », in D. Debordeaux et P. Strobel, Les solidarités familiales en questions. Entraide et transmission , Paris, LGDJ/ MSH, 2002, p. 73-116.
* 46 S. Gollac, « Maisonnée et cause commune : une prise en charge familiale », in F. Weber, S. Gojard et A. Gramain (dir.), Charges de famille, op. cit. , p. 274-311.
* 47 P. Champagne, L'héritage refusé, La crise de la reproduction sociale de la paysannerie française 1950-2000 , Seuil, 2002, p. 121-199 ; A. Barthez, Famille, travail, agriculture, Paris, Economica, 1982, p. 59-73.
* 48 J. Rémy, « La crise de professionnalisation en agriculture : les enjeux de la lutte pour le contrôle du titre d'agriculteur », Sociologie du travail , n°4, 1987, p. 415-441.
* 49 B. le Wita, Ni vue, ni connue. Approche ethnographique de la culture bourgeoise, éditions de la MSH, Paris, 1988.
* 50 Nadine Lacheux représente un cas typique de ce qui est prédit par les statistiques : « Le taux d'activité des femmes bien mariées est plus faible, la dépendance objective vis-à-vis du mari augmente (...). Ce mouvement ascensionnel exige la sujétion. Les femmes bien mariées pensent avoir moins de pouvoir au sein de leur ménage, la dépendance subjective vis-à-vis du mari augmente », cf. F. de Singly, Fortune et infortune de la femme mariée. Sociologie des effets de la vie conjugale , Paris, PUF, 2004 (1 ère ed. 1987), p. 152.
* 51 Le travail salarié des compagnes d'agriculteurs est même devenu légitime pour la profession agricole, dans le cadre d'une meilleure reconnaissance des fonctions non-productives de l'agriculture, notamment le maintien du tissu économique et social rural. Cf. C. Laurent, J. Rémy, « Multifonctionnalité des activités, pluralité des identités », Les cahiers de la multifonctionnalité , n°7, 2004, p. 11.
* 52 Sur l'argent dans les rapports conjugaux, Cf. D. Roy, « Tout ce qui est à moi est à toi ? Mise en commun des revenus et transferts d'argent dans le couple », Terrain, n°45, 2005, p. 41-52 ; H. Belleau et C. Henchoz (dir.), L'usage de l'argent dans le couple : pratiques et perceptions des comptes amoureux, perspective internationale, Paris, L'Harmattan, 2008 ; A. Martial, La valeur des liens, Hommes, femmes et transactions familiales, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2009.
* 53 « Les femmes parlent de la crise », Le Paysan Français , Revue régionale viti-vinicole des Charentes et du Bordelais, n°967, septembre 1998. L'article reprend plusieurs témoignages de femmes de viticulteurs, dont le salaire constitue quasiment le seul revenu familial. « A l'heure actuelle, mon salaire constitue le seul revenu de la famille : il sert à payer la voiture, les travaux de la maison, les frais courants. A noter qu'en 17 ans de mariage, ce fut toujours le cas » (Marie-Claire, 40 ans, enseignante, mariée à un viticulteur de Grande Champagne) ; « On savait dès le départ que sans mon salaire on n'y arriverait pas. Mon salaire sert aux charges familiales ainsi qu'aux dépenses autour de la maison » (Marie-Christine, 50 ans, cadre, mariée à un viticulteur de Petite Champagne).
* 54 En reprenant les termes de Joan Scott et Louise Tilly, on peut qualifier ce recours au marché salarié du travail d' économie de salaire familiale . Ces deux historiennes étudient en France et en Angleterre le processus d'industrialisation au XIX e siècle. Leurs conclusions se veulent beaucoup plus nuancées que le constat d'une « émancipation » des femmes dans le travail salarié : « L'entrée des femmes sur le marché du travail n'était souvent qu'une stratégie familiale, une manière pour elles d'assurer leur part habituelle de responsabilités familiales », Cf. J. Scott, L. Tilly, Les femmes, le travail et la famille , Paris, éditions Rivages, 1987 (1 ère éd. 1978), p. 13.
* 55 J'ai rencontré un seul exemple d'une jeune femme, diplômée d'une petite école de commerce et directrice d'une association d'aides à domicile, qui a imposé la location d'un appartement en ville à proximité de son lieu de travail et à environ 30 km de l'exploitation de son conjoint.
* 56 Sur les relations entre belle-fille et belle-mère, dans différents groupes sociaux, y compris agricoles, Cf. C. Lemarchant, Belles filles. Avec les beaux-parents, trouver la bonne distance, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1999.
* 57 Le recours aux grands-parents comme mode de garde des enfants en bas âge n'est pas spécifique aux familles agricoles. Une enquête de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse auprès de personnes de la génération pivot âgées de 49 ans à 53 ans, montre que 85% des grands-mères et 75% des grands-pères gardent au moins occasionnellement leurs petits-enfants en bas âge. Lorsque les deux membres du jeune couple travaillent, les enfants bénéficient d'autant plus d'une garde régulière (toutes les semaines), que leurs revenus sont faibles. Cf. C. Attias-Donfut, M. Ségalen, Grands-parents : la famille à travers les générations , Paris, Odile Jacob, 1998.
* 58 Sur le temps partiel subi, très fréquent dans les emplois féminisés du tertiaire, voir T. Angeloff, Le temps partiel, un marché de dupes ? , Paris, Syros, 2000.
* 59 Dans les vignes, tâche manuelle exécutée entre mars et avril qui consiste à attacher les rameaux sur le palissage.
* 60 A partir des données de l'enquête Etude de l'histoire familiale de 1999, Mélanie Vanderschelden établit que le risque annuel de rupture des hommes agriculteurs est de 37 % inférieur à celui des hommes employés ayant les mêmes caractéristiques qu'eux (année de mise en couple, âge à la mise en couple, âge relatif de fin d'études, nombre d'enfants, etc.). Le groupe des agriculteurs est la catégorie socio-professionnelle masculine qui a le plus faible risque de rupture, toutes choses égales par ailleurs. Cf. M. Vanderschelden, « Les ruptures d'unions : plus fréquentes, mais pas plus précoces », INSEE Première, n°1107, 2006, p. 1-4.
* 61 O. Schwartz, La notion de « classes populaires », Habilitation à diriger des recherches, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 1998, p. 127, sur le cas des chauffeurs de bus à la RATP.
* 62 J. Kellerhals, J.-F. Perrin, G. Steinauer-Cresson, L. Voneche, G. Wirth, Mariages au quotidien. Inégalités sociales, tensions culturelles et organisation familiale, Lausanne, Pierre-Marcel Favre, 1982.
* 63 A. Boigeol, J. Commaille, B. Munoz-Perez « Le divorce », Données sociales, Paris, Insee, 1984, p. 428-446.
* 64 L'appauvrissement des femmes lors des séparations conjugales n'est pas spécifique aux familles agricoles : cf. L. Cardia-Vonèche, B. Bastard, Les femmes, le divorce et l'argent , Genève, Labor et Fides, 1991.
* 65 Dans l' Enquête Foncière de 1992, seulement 6% des couples mariés comprenant au moins un agriculteur avaient opté pour un contrat de séparation des biens, mais c'était le cas en revanche de 14% des couples dont le chef d'exploitation était âgé de moins de 36 ans, cf. A. Barthez, « Le patrimoine foncier des agriculteurs vivant en couple », Agreste Cahier n°17-18, 1994, p. 23-36.
* 66 Samuel Aisard est chef d'exploitation depuis 1999. L'exploitation comporte une vingtaine d'hectares de vignes (dont la production est commercialisée en eau-de-vie à de grandes maisons de négoce), 70 hectares de terres cultivées en céréales et en prairie et un troupeau d'une quinzaine de vaches allaitantes. L'exploitation est en agriculture biologique depuis 2001. Elle emploie deux ouvriers agricoles. Sophie Aisard a interrompu son activité d'aide-soignante en 2000-2001 pour travailler à mi-temps en tant que conjointe-collaboratrice sur l'exploitation de son compagnon, peu avant leur séparation.
* 67 I. Théry, Le démariage. Justice et vie privée , Paris, Odile Jacob, 1993 ; B. Bastard, Les démarieurs. Enquête sur les nouvelles pratiques de divorce , Paris, La Découverte, 2002. Les grandes étapes juridiques sont : la mise en place des premières gardes conjointes dans les années 1980 ; l'attribution de l'autorité parentale conjointe de principe (loi du 8 janvier 1993) qui permet, de fait, l'augmentation du nombre des « résidences en alternance » comme modalité pratique de cet exercice conjoint de l'autorité parentale ; l'entrée de cette modalité dans le Code Civil (loi du 4 mars 2002) qui donne le pouvoir au juge d'imposer une « résidence en alternance » en cas de désaccord entre parents.
* 68 G. Augustins, Comment se perpétuer ? Devenir des lignées et destins des patrimoines dans les paysanneries européennes , Nanterre, Société d'ethnologie, 1989.







