Rapport d'information n° 257 (2012-2013) de M. Raymond VALL et Mme Laurence ROSSIGNOL , fait au nom de la commission du développement durable, déposé le 20 décembre 2012
Disponible au format PDF (3,4 Moctets)
-
AVANT-PROPOS
-
PROPOS INTRODUCTIFS DE LAURENCE ROSSIGNOL
-
INTRODUCTION
-
TABLE-RONDE N° 1 - TRAJECTOIRES
RÉSIDENTIELLES ET TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES
-
1. Populations, conditions de vie, économie,
paysages : des campagnes françaises aux multiples
visages
Mohamed Hilal
-
2. Le marché foncier : une machine
à hacher la société
Jean Cavailhes
-
a) Introduction
-
b) Les villes moteur de la croissance
-
c) La croissance des dix plus grandes
métropoles de province
-
d) Les coûts urbains limitent la croissance
métropolitaine
-
e) Une métropole plus monocentrique :
exemple de la région de Toulouse
-
f) Les emplois en France se désaxent vers la
périphérie des métropoles
-
g) Les mécanismes fondamentaux de la
localisation des ménages
-
h) Le rôle des caractéristiques
locales des lieux
-
i) La poursuite de la périurbanisation des
ménages
-
j) L'exemple de la métropole
toulousaine : banlieue et périurbain s'enrichissent
-
k) En France, les couronnes périurbaines,
parisienne exceptée, s'enrichissent
-
l) Conclusion
-
a) Introduction
-
3. Classes populaires périurbaines :
au-delà du déclassement, quelles trajectoires
résidentielles et professionnelles ?
Violaine Girard
-
4. Arrangements de famille en agriculture :
la relative séparation des espaces temps conjugaux et
professionnels
Céline Bessière
-
a) La génération des
belles-mères : « cent professions » et
« femme de »
-
b) « Vaut mieux qu'elle travaille
à l'extérieur ! »
-
c) Un logement dans la propriété
familiale
-
d) Au quotidien, la référence au
salariat
-
e) Un désengagement variable des travaux de
l'exploitation
-
f) La séparation comme horizon des couples
viticulteur/salariée
-
g) Les coûts d'une éventuelle
rupture
-
h) Conclusion
-
a) La génération des
belles-mères : « cent professions » et
« femme de »
-
1. Populations, conditions de vie, économie,
paysages : des campagnes françaises aux multiples
visages
-
TABLE-RONDE N° 2 - APPARTENANCES
SOCIALES ET SOCIABILITÉS
-
1. Que deviennent les enfants
d'agriculteurs ?
Christophe Giraud - Jacques Rémy
-
2. Les bouleversements des formes d'appartenance
au monde ouvrier vu du monde rural
Nicolas Renahy
-
3. Les effets politiques d'accession à la
propriété sur les territoires périurbains :
mixité sociale et racialisation des rapports de voisinage
Anne Lambert
-
1. Que deviennent les enfants
d'agriculteurs ?
-
TABLE-RONDE N° 3 - INSTITUTIONS ET
PARTICIPATIONS POLITIQUES ET CITOYENNES
-
1. La montée en puissance de
l'intercommunalité, entre gestion rationnelle et renforcement des
identités
Francis Aubert, Quentin Frère
-
a) La question intercommunale, un paradoxe de la
décentralisation à la française
-
(1) Un découpage communal
hérité
-
(2) La coopération intercommunale
volontaire comme compromis
-
(3) La coopération intercommunale dans les
autres pays européens
-
b) La coopération intercommunale ou la
quête du design institutionnel optimal
-
(1) La taille optimale des unités de
gouvernements locaux, un arbitrage délicat entre avantages et
inconvénients d'agglomération
-
(2) Pour une construction pertinente de la carte
intercommunale
-
(3) Principe de volontariat et comportements
stratégiques
-
c) Conclusion
-
a) La question intercommunale, un paradoxe de la
décentralisation à la française
-
2. De la mairie à la communauté de
communes : renouvellement des formes traditionnelles d'action publique et
transformation du personnel politique local dans les mondes
ruraux
Sébastien Vignon
-
a) Évolutions du profil socio-professionnel
des maires et des registres de légitimité
électorale
-
b) Déclin numérique des agriculteurs
et essor des couches moyennes et supérieures
-
c) Un glissement progressif de la
légitimité mayorale
-
d) Intercommunalité et redéfinition
des normes d'éligibilité locale
-
e) La professionnalisation des savoir-faire
politiques intercommunaux.
-
f) La sur-sélection sociale des dirigeants
intercommunaux
-
a) Évolutions du profil socio-professionnel
des maires et des registres de légitimité
électorale
-
3. La prise en charge de la vieillesse depuis
1970 : entre solidarités familiales et solidarités
publiques
Christophe Capuano
-
1. La montée en puissance de
l'intercommunalité, entre gestion rationnelle et renforcement des
identités
-
CONCLUSION
N° 257
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
|
Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 décembre 2012 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire (1) sur les représentations et les transformations sociales des mondes ruraux et périurbains : actes du colloque du mercredi 19 décembre 2012 ,
Par M. Raymond VALL et Mme Laurence ROSSIGNOL,
Sénateurs.
|
(1) Cette commission est composée de : M. Raymond Vall , président ; MM. Gérard Cornu, Ronan Dantec, Mme Évelyne Didier, MM. Philippe Esnol, Alain Houpert, Hervé Maurey, Rémy Pointereau, Mmes Laurence Rossignol, Esther Sittler, M. Michel Teston , vice-présidents ; MM. Pierre Camani, Jacques Cornano, Louis Nègre , secrétaires ; MM. Joël Billard, Jean Bizet, Vincent Capo-Canellas, Yves Chastan, Philippe Darniche, Marcel Deneux, Michel Doublet, Jean-Luc Fichet, Jean-Jacques Filleul, Alain Fouché, Francis Grignon, Mme Odette Herviaux, MM. Benoît Huré, Daniel Laurent, Alain Le Vern, Jean-François Mayet, Stéphane Mazars, Robert Navarro, Charles Revet, Roland Ries, Yves Rome, Henri Tandonnet, André Vairetto, Paul Vergès, René Vestri. |
AVANT-PROPOS
La commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire du Sénat, créée par une résolution du Sénat du 19 décembre 2011, est née de la volonté de la nouvelle majorité du Sénat et de son président Jean-Pierre Bel de consacrer une place plus importante aux questions liées à l'aménagement durable du territoire, à la transition écologique, à la mobilité et ainsi de mettre l'accent sur des sujets essentiels pour l'avenir de notre pays et de ses territoires.
En organisant ce premier colloque, dont l'initiative revient à sa vice-présidente Laurence Rossignol, la commission a voulu apporter un éclairage scientifique à la connaissance des territoires. Les sénateurs qui représentent les collectivités territoriales sont en effet au coeur des évolutions économiques et sociales quotidiennes des territoires. Leur permettre de bénéficier d'un regard extérieur et distancié pour mieux comprendre les évolutions de fond qui les traversent est une vraie nécessité.
Les compétences réunies autour des chercheurs du Centre Maurice Halbwachs de l'Ecole normale supérieure et du Centre d'économie et de sociologie appliquée à l'agriculture et aux espaces ruraux de l'Institut national de la recherche agronomique, principales parties prenantes à ce colloque, ont alimenté une réflexion approfondie et des échanges d'une grande richesse.
Reconnaissante pour cet apport à ses propres travaux, la commission souhaite que les actes de ce colloque soient également une source d'inspiration et d'intérêt pour tous les lecteurs de ces diverses contributions.
PROPOS INTRODUCTIFS DE LAURENCE ROSSIGNOL
L'histoire de ce colloque est à la fois récente, en lien avec les résultats du Front national au premier tour de l'élection présidentielle de 2012 dans l'Oise, et plus ancienne, du fait de l'enracinement de ce vote dans nombre de communes de ce département. Or, les habitants de l'Oise ne sont pas particulièrement différents de ceux des autres départements, mais néanmoins révélateurs de l'évolution de la sociologie politique française.
Une tribune rédigée sur le site Rue89 1 ( * ) , au lendemain du 22 avril, a fait valoir que si l'on n'ignore rien de la sociologie des banlieues, du taux de chômage qu'elles connaissent, de l'absence de services publics, de la désertification médicale qu'on y observe, de son tissu associatif, des problèmes de sécurité, de l'insuffisance des forces de police, on connait bien peu de choses des autres territoires, que l'on ne sait d'ailleurs même pas comment qualifier. On les appelle territoires ruraux, mais ils ne le sont plus vraiment car nombre de gens qui y vivent sont déconnectés de toute activité agricole. On les appelle territoires périurbains, mais ils sont périurbains autour de centres urbains qui ne sont pas très grands. Dans l'Oise, par exemple, on n'est pas dans la banlieue parisienne même si on est proche de l'Ile-de-France. Il y a à la fois un effet d'attraction vers l'Ile-de-France et un rejet de cette région par des populations qui ne veulent ou ne peuvent plus y vivre. Or, il faut s'intéresser à ces territoires qui sont un angle mort de la sociologie française, il faut chercher à mieux les comprendre, à voir ce que leurs habitants ont de spécifique et de révélateur.
Les comprendre est une nécessité pour pouvoir adapter discours et politiques. La transition écologique de notre économie, par exemple, ne pourra se faire contre les gens, mais avec un élan et une adhésion démocratiques. Or, la mention de l'écologie heurte profondément les modes de vie des habitants de ces territoires. Par exemple, combien de rapports, colloques, discours dénoncent l'artificialisation des sols, le mitage des territoires, l'habitat horizontal, le pavillonnaire, etc. Mais ce pavillonnaire est le lieu de vie de nombreuses personnes. C'est aussi souvent leur patrimoine - un toit pour la vieillesse et un patrimoine à transmettre aux enfants. Par des discours inadaptés, ces personnes se sentent donc mises à l'écart et elles le rendent bien aux politiques ! De la même façon tout ce que l'on dit sur le CO2 ou la mobilité et les transports s'oppose au fait que, dans ces territoires, pouvoir disposer de plusieurs voitures est une absolue nécessité pour aller travailler ou poursuivre des études car il y a évidemment une limite au maillage de l'ensemble du territoire avec des transports collectifs !
Il faut donc arriver à faire la jonction avec ces populations, dont le mode de vie ne correspond plus aux standards que nous proposons pour demain et qui se sentent de plus en plus exclues. S'y ajoute un aspect qui me parait important : l'ennui, notamment des jeunes. Il y a dans le rurbain ou le rural une frustration liée à une promesse non tenue. Au-delà de la pression du foncier, il y a souvent le souhait de revenir à un habitat et un environnement à taille humaine - le village, la nostalgie d'une France rurale et solidaire du voisinage, le désir de retour aux activités personnelles autour de sa maison et son jardin. Mais, les maisons individuelles deviennnent vite une « punition », après les semaines de travail et de transports longs ; la solidarité humaine du voisinage n'est pas si évidente lorsque les gens travaillent à l'extérieur et sont peu impliqués dans la vie locale ; les centres d'attraction, notamment pour les jeunes qui s'ennuient, restent les centres urbains ; les personnes qui vieillissent dans des pavillons vieillissants ne trouvent plus les solidarités et les services publics qu'ils pouvaient attendre. La question des services publics est d'ailleurs essentielle, il nous faut inventer de nouvelles formes de services publics et trouver celles qui seront adaptées aux besoins nouveaux du XXIème siècle.
Lorsque j'ai évoqué ces sujets, Stéphane Beaud m'a signalé que plusieurs équipes de chercheurs et de sociologues s'intéressent activement à ces questions. Nous avons décidé d'organiser ce colloque pour les entendre car, même si l'actualité chasse les sujets les uns après les autres, la question des territoires ruraux et périurbains demeure. Si nous ne sommes pas en mesure de les penser, les observer, les analyser, nous nous exposons à de graves déconvenues démocratiques et collectives.
Ce colloque vise donc à mieux percevoir les transformations de ces territoires mais aussi leurs représentations. Car le regard porté sur ces territoires par ceux qui n'y vivent pas ou n'y sont pas élus fait souvent apparaitre incompréhension, méconnaissance, voire absence de curiosité méprisante. A l'issue de ce colloque, il reviendra, notamment aux parlementaires, de tirer les enseignements des diverses contributions et débats et de transformer la réflexion en actions collectives et politiques.
INTRODUCTION
1. Ethnographie et
« angles morts » de la sociologie française
Stéphane Beaud
(Ecole normale supérieure)
Commençons par dire qu'il est prématuré, voire présomptueux, de prétendre livrer en quelques pages un diagnostic empiriquement fondé sur cette vaste question : quels sont aujourd'hui les domaines non traités, négligés ou sous étudiés, par la « sociologie française » ? Quels sont les angles morts de cette discipline ? Ce thème mériterait une enquête approfondie. Faute de celle-ci, nous nous contenterons ici, en partant à la fois de nos lectures et de notre expérience d'enseignant-chercheur, de suggérer des hypothèses et de proposer quelques pistes d'analyse et d'enquêtes qui pourraient valider celles-ci ou les infirmer. Tout d'abord, si la sociologie comme discipline reste aujourd'hui fortement marquée par un ancrage national 2 ( * ) , il n'en reste pas moins qu'on peut se demander s'il y a un sens à parler d'une « sociologie française ». En effet son unité est toute relative : certes une large association professionnelle a vu le jour en 2003 ( l'Association française de sociologie , dite AFS) mais elle ne peut masquer le fait que cette discipline reste fondamentalement divisée, marquée par des approches et des méthodes très différentes et parfois foncièrement antagonistes. Un des points qui continuent de faire débat dans la discipline concerne le statut à accorder à la théorie et à l'enquête empirique : même si un plus grand consensus existe dans la nouvelle génération de sociologues pour accorder un net primat à l'enquête comme condition nécessaire d'appartenance à la discipline, des travaux sans aucune base empirique peuvent encore recevoir la légitimation d'un certain nombre de sociologues attachés au caractère très hospitalier de leur discipline 3 ( * ) . Acceptons dans un premier temps cette fiction d'une « sociologie française » et tentons de voir comment elle travaille, ce à quoi elle s'intéresse et ce qu'elle oublie, quel type d'objets elle traite et comment. Pour ce faire, il faut commencer par effectuer un détour qui passe par la compréhension du mode de constitution de la sociologie en France.
a) La pression de la demande sociale sur les objets traités par la sociologie
Pour étudier l'évolution des domaines traités par la sociologie française, on peut utiliser divers critères : en premier lieu, les publications de la discipline - les livres comptes rendus d'enquête et les manuels spécialisés (par exemple, les livres de la Collection U d'Armand Colin, Repères de la Découverte ou 128 chez Nathan), les articles dans les revues de sociologie (qui se sont multipliées et régionalisées), les thèses de doctorat soutenues dans la période récente et les sujets de maîtrise et de master ; en second lieu, on peut s'intéresser aux appels d'offres des administrations publiques ou territoriales, aux axes de recherche des laboratoires de sociologie, aux libellés des Masters de sociologie. Autant d'indices, souvent convergents, qui offrent une sorte de photographie des sujets dont traite à gros traits la discipline. En attendant une enquête exhaustive sur ce thème, on peut dire que les travaux en sociologie couvrent bien les domaines qui sont présentés comme les problèmes sociaux du moment, construits comme tels par l'agenda médiatique et politique, tels que l'exclusion, l'immigration, les quartiers défavorisés, la délinquance juvénile, la déscolarisation, les familles monoparentales, la prise en charge des personnes dépendantes, l'intégrisme religieux, etc. Sur ces sujets, il existe une forte « demande sociale » qui va souvent de pair avec une offre de financement attractive à la fois pour les laboratoires et les chercheurs ou doctorants.
On peut aussi distinguer un autre groupe d'enquêtes sociologiques étroitement liées à la commande publique, et plus particulièrement aux services des études de grands ministères (MEN, Equipement, Culture) : enquêtes à la fois quantitatives et qualitatives qui se répètent dans le temps et qui forment un corpus homogène de données (pensons aux enquêtes des pratiques culturelles du ministère de la Culture, initiées depuis 1973). Dans ce groupe, il faut ajouter les enquêtes liées aux institutions, autrefois secrètes et rétives à l'enquête sociologique, qui se sont ouvertes au regard des sciences sociales, notamment grâce à un travail de persuasion de sociologues qui sont parvenus à convaincre les tenants de l'institution du bien fondé d'une enquête sociologique : on peut ici penser aux travaux sur la police (cf. l'oeuvre de Dominique Monjardet au Ministère de l'intérieur) et la gendarmerie, ainsi qu'aux enquêtes réalisées par le GIP Droit et justice (Ministère de la Justice). Il existe un troisième domaine privilégié d'études lié à de nouvelles thématiques qui, participant à de nouveaux fronts de la recherche, se trouvent en voie de légitimation dans la discipline : c'est le cas, par exemple, des « rapports de genre », des « relations interethniques », de la sociologie des professions, de la sociologie de la sexualité, etc. Ces sous-disciplines se constituent et s'institutionnalisent progressivement, défrichent des terrains vierges et font accomplir des avancées à la discipline. Elles peuvent bénéficier d'un appui de financement public si la nouveauté de l'approche séduit les gestionnaires de programme de recherche. Enfin, il y a des thèmes qui expriment les choix des chercheurs pour un thème donné. Pour les doctorants, la coutume des sociologues universitaires, qui contraste grandement avec celle des historiens ou des juristes par exemple, est celle de laisser aux étudiants une quasi-totale liberté de choix. Les sujets traités depuis une quinzaine d'années par les jeunes docteurs en sociologie renvoient, d'une part, à leurs trajectoires sociales et politiques - à leur « histoire » pour le dire dans un autre langage - et, d'autre part, à leur mode de socialisation universitaire et professionnelle dans la recherche.
b) Les classes sociales et leur mode d'inscription spatiale
Du fait, d'une part, de l'organisation institutionnelle de la sociologie - notamment de la propension qu'ont certains départements de sociologie à ne pas étudier empiriquement leur environnement local -, et, d'autre part, de la tendance des étudiants avancés en sociologie (master, thèse), appartenant souvent à une première génération d'intellectuels dans leur famille, à mettre à distance leur milieu social d'origine, un certain nombre d'objets de recherche manquent à l'appel pour mieux comprendre les transformations de la société française. C'est peut-être dans le domaine de l'analyse des classes sociales et de la stratification sociale que les données sont les plus manquantes. Domaine autrefois florissant de la sociologie française, il est devenu un de ses parents pauvres. Pourquoi ? Pour au moins deux raisons : la première tient au nécessaire appareillage statistique de nombre de ces enquêtes. Or l'INSEE, depuis la refonte des PCS et l'harmonisation des classifications européennes, n'en fait pas un axe prioritaire - pour le dire de manière euphémisée - du développement des statistiques sociales 4 ( * ) . En outre, de moins en moins d'étudiants de sociologie se risquent à entreprendre des enquêtes quantitatives. La deuxième renvoie à la sociologie des étudiants de sociologie. Pour s'intéresser à ces questions de classes sociales, il faut considérer que les rapports de classe importent pour comprendre un certain nombre de mécanismes sociaux. Or les étudiants des dernières décennies ont été socialisés dans un contexte sociopolitique marqué par un effondrement des références au marxisme, par une disqualification des analyses en termes de classes et par une réévaluation de la place de l'individu dans l'analyse sociologique 5 ( * ) . Dans ce mouvement légitime, il semble bien qu'on ait tordu le bâton dans l'autre sens ou, en tout cas, que l'eau du bain - l'analyse des structures sociales, des rapports de force et de sens dans une société - ait été jetée avec le bébé - un certain économisme marxien. L'heure est aujourd'hui à la « sociologie compréhensive ». Mais il faut bien voir que ce terme recouvre, pour les étudiants, bien des ambiguïtés car, aux yeux de beaucoup d'entre eux, il équivaut à celui d'approche « non déterministe », le déterminisme figurant comme le repoussoir absolu...
Ce qui disparaît ainsi avec la prise en compte des rapports de classe, c'est l'analyse attentive des conditions sociales d'existence des individus et des groupes sociaux. On en veut pour preuve le très faible nombre d'enquêtes en sociologie du logement : l'étude des zones périurbaines est notamment trop souvent laissée aux géographes. Pour le dire vite, dans les travaux des jeunes chercheurs, les « cités » ou ZUS sont sur-enquêtées et les zones pavillonnaires sous-enquêtées. Alors qu'on voit immédiatement l'intérêt qu'il y aurait à étudier les trajectoires résidentielles faisant passer les habitants des premières aux secondes. Les travaux de Violaine Girard et d'Anne Lambert, présentés aujourd'hui, font partie de ces rares enquêtes qui s'intéressent non seulement à la manière dont les populations se répartissent dans l'espace périurbain, mais aussi à ce que signifie pour elles l'accès à la propriété, la découverte d'un nouveau voisinage ou la distance prise avec les lieux urbains qui concentrent les emplois 6 ( * ) . On pourrait évoquer de la même manière la très faible place qu'occupe la sociologie de la consommation alors que celle-ci est au coeur de la vie sociale, à la fois par les sommes qui y sont investies et par les logiques de prestige social qui la sous-tendent. De la même manière, le monde rural, pourtant en pleine mutation, souffre cruellement d'un manque de travaux permettant d'en analyser les ressorts. Fort heureusement, des jeunes chercheurs de l'INRA sont parvenus à maintenir le flambeau d'une « sociologie rurale » prêtant finement attention aux très fortes transformations qui bouleversent aujourd'hui le paysage des mondes ruraux (le pluriel est ici plus que jamais nécessaire).
Bref, si l'on faisait un plus long inventaire, on serait tenté de dire qu'une large fraction de la sociologie française fait aujourd'hui l'impasse sur ce qu'on pourrait appeler les « fondamentaux » de la vie sociale : le travail réel, la consommation, le niveau de vie et le mode de vie, le logement, les vacances, etc. Pour le dire dans le langage de l'époque, ces sujets ne sont pas perçus comme « sexy », apparaissent comme triviaux, pas assez nobles et recherchés. Ceci doit être mis en relation avec ce que les fondateurs de la discipline ont toujours dit : les étudiants qui prennent le risque de pousser la porte des facultés de sociologie sont, sans le savoir, attirés par la compréhension des écarts à la norme, de la déviance, des cas bizarres et exceptionnels, bref par le non-banal. Or l'essence même du projet de la sociologie consiste justement de traiter de la norme, du routinier, du quotidien.
Comment éclairer ce constat ? Il nous semble que les causes de ce processus sont à chercher à la fois dans la sociologie des nouveaux entrants dans le métier de sociologue et dans l'organisation de la recherche, notamment à l'université. Du côté des étudiants en sociologie, on retrouve de manière classique, peut-être accentuée par un lien plus distendu avec la politique, une sorte de fascination pour des objets déviants, un attrait de l'exotisme et une mise à distance critique et/ou ironique de la figure repoussoir que constituent, par exemple, les pavillonnaires du périurbain. La formation des sociologues pourrait aussi être interrogée : d'une part, la coupure avec l'économie est aujourd'hui telle que la dimension économique de maints phénomènes sociaux est trop souvent éludée ; d'autre part, le développement de l'ethnographie (ou enquête de terrain) comme méthode principale, couplé avec la phobie a priori de la quantification en sciences sociales, a pour effet pervers de potentiellement oublier les structures sociales. Il faudrait aussi ajouter à cela que l'élargissement de l'horizon géographique et social des étudiants d'aujourd'hui (Erasmus et le goût des voyages, permis par le low cost ) a un double effet : un effet heureux avec ce qu'on pourrait appeler la « dé-provincialisation » de nos étudiants qui se mettent eux aussi à « penser global », et un effet moins heureux, avec une réticence à se rapprocher du « local », perçu souvent comme peu éloigné de l'archaïque.
Il y a aussi peut-être - c'est ici un point de vue très personnel et contestable - une responsabilité des enseignants et du système des études. Un des grands problèmes que rencontre la sociologie universitaire (je me limite ici à ce champ) est, entre autres exemples, la grande difficulté ou réticence à mobiliser les étudiants pour effectuer de véritables enquêtes collectives. Ce, d'abord, pour des raisons objectives d'organisation universitaire : la semestrialisation des enseignements a conduit à un émiettement des savoirs enseignés, à une impossibilité d'inscrire dans la durée un cours ou, plus encore, une enquête. Ensuite, la difficulté de donner des « sujets imposés » aux étudiants en master alors que nos collègues historiens le font depuis des lustres. Or, tout tend à montrer que cette « liberté » de choix n'est qu'une fausse liberté qu'on leur donne : seuls peuvent en profiter ceux qui sont habités par une passion pour la recherche sous-tendue par un bon bagage scolaire. Les autres, une majorité, ne peuvent pas s'en saisir et ont surtout besoin d'être guidés de près, tant dans le choix du sujet que dans la conduite du travail de recherche. Une telle forme d'encadrement exige beaucoup de temps, d'attention et de patience de la part de l'enseignant... Pour un résultat extrêmement aléatoire.
c) Conclusion
Pour conclure, précisons que le problème évoqué ici est loin d'être un problème spécifique à la France. Il renvoie, plus centralement, aux contradictions posées par l'institutionnalisation de la discipline dans les pays développées après l'ère des grands fondateurs. Ainsi Peter Berger, sociologue américain original, fait-il le constat suivant : « Dans sa période classique - disons entre 1890 et 1930 - la sociologie abordait les `grandes questions' qui se posaient à l'époque [...]. Aujourd'hui, dans l'ensemble, elle les évite et, quand elle ne les fuit pas, elle les traite d'une manière excessivement abstraite 7 ( * ) ». Pour traiter de ces « grandes questions », les sociologues ont besoin d'autonomie tout autant que de considération pour les travaux qu'ils mènent : c'est une grande joie que d'entendre aujourd'hui au Sénat la présentation d'enquêtes qui éclairent empiriquement les conditions d'existence de populations usuellement déconsidérées dans l'espace public.
2. Mondes ruraux et
périurbains : quelles représentations, quelles
réalités ?
Gilles Laferté, Nicolas Renahy, Abdoul
Diallo
(UMR 1041, INRA-CESAER Dijon)
Pour introduire ce colloque sur les représentations et les transformations sociales des mondes ruraux et périurbains, nous avons souhaité faire une mise au point des évolutions de la répartition de la population active sur le territoire depuis une quarantaine d'années. Cette mise au point nous apparaît en effet essentielle, tant l'adjectif « rural » est encore aujourd'hui souvent synonyme d'« agricole », et tant les représentations traditionnalistes et disqualifiantes ont toujours cours à propos de « la » campagne. La réalité est fort heureusement plus complexe. Ni réservoir de « traditions », ni isolats archaïsants, les espaces ruraux et périurbains français sont socialement très différenciés : c'est ce que montrent les sciences sociales qui s'y intéressent de nouveau, après une longue éclipse débutée au début des années 1980 8 ( * ) . Certaines évolutions sont nettes, d'autres beaucoup plus fines, les différenciations locales nombreuses. Les données harmonisées des recensements de la population française métropolitaine fournies par l'INSEE permettent cependant d'avoir une vue globale assez précise des bouleversements en matière de répartition spatiale des actifs entre 1968 et 2008. La chute numérique bien connue du monde agricole est-elle uniforme ? Quels groupes sociaux cette baisse met-elle en avant ? Les cartes que nous allons présenter permettent de répondre à ces questions de manière fine et différenciée, puisqu'elles sont bâties sur la part qu'occupe chaque catégorie socioprofessionnelle (PCS) dans les cantons français 9 ( * ) . Nous soulignerons ensuite rapidement les limites d'une approche uniquement basée sur une observation statistique et surplombante de la stratification sociale, afin d'introduire les enjeux scientifiques, politiques et sociaux que nous avons voulu soulever en organisant cette journée.
a) La baisse du nombre d'agriculteurs en France
Alors que près d'un actif sur deux travaillait dans le secteur agricole dans la France de l'après-guerre, ce n'est plus aujourd'hui le cas que de 7 % des actifs de « l'espace à dominante rurale », qui regroupe l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants qui offrent moins de 5 000 emplois. Massive, l'évolution est cependant contrastée sur le territoire national : c'est ce que montrent les cartes successives de la proportion d'actifs agricoles par cantons lors des recensements de la population de 1968, 1975, 1982, 1990, 1999 et 2008. Ainsi, nombre de cantons de Bretagne, du Massif Central ou du Sud-Ouest étaient peuplés à plus de 60 % d'agriculteurs exploitants en 1968. Cette proportion ne dépasse plus en 2008 que 30 % des actifs pour quelques cantons du Massif Central. Une telle évolution interroge le devenir des enfants d'agriculteurs, que Christophe Giraud abordera dans son intervention à travers la question scolaire.
Evolution de la proportion d'agriculteurs exploitants par canton de 1968 à 2008
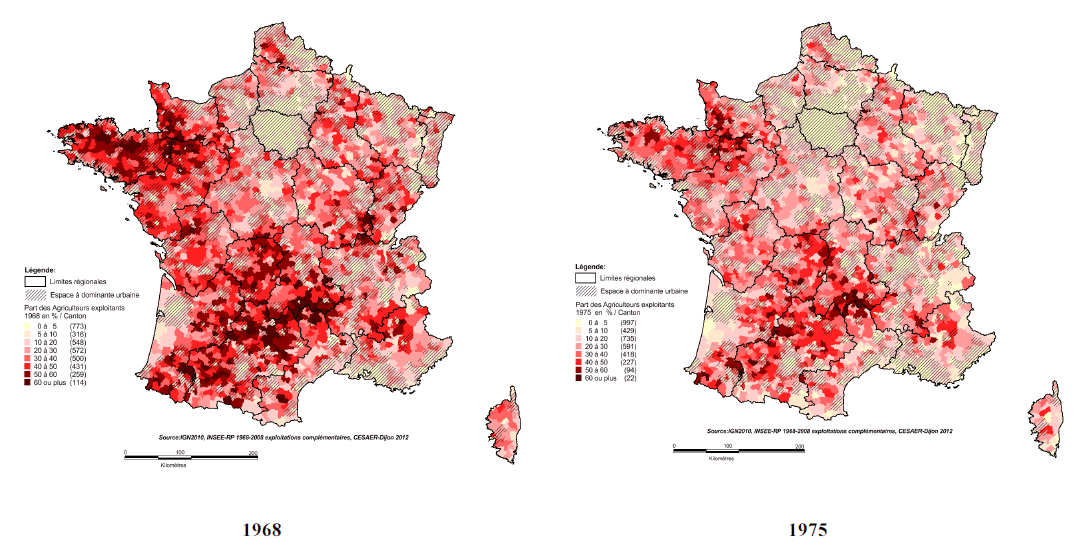
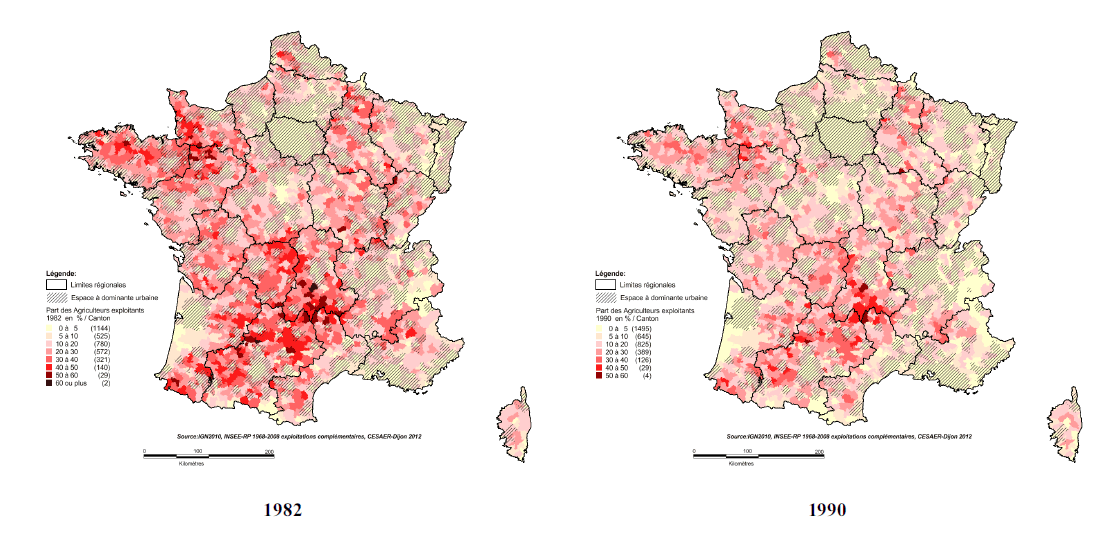
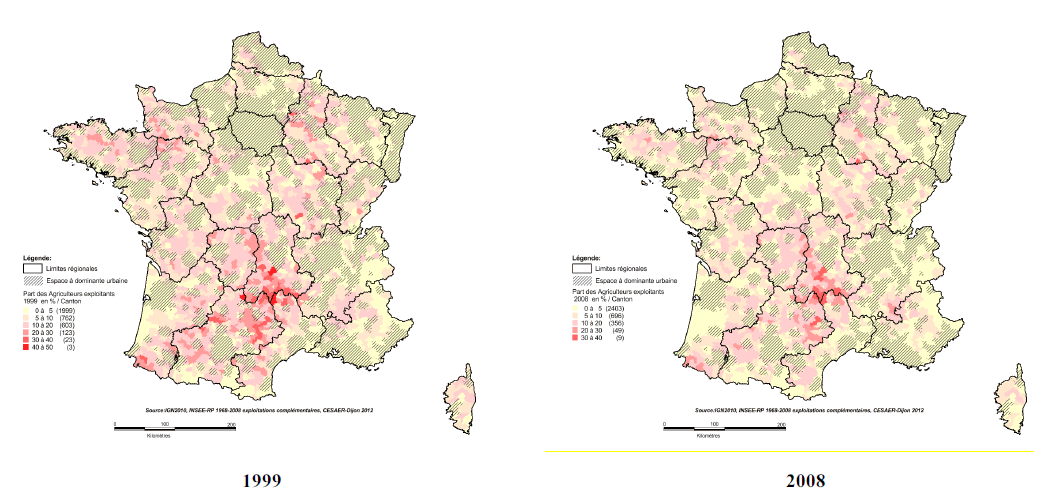
Source : IGN 2010, INSEE 1968-2008, CESAER Dijon 2012
b) Les classes populaires, une autre population très rurale
Même si depuis la seconde moitié des années 1970 les restructurations industrielles n'on eu de cesse de déstructurer le monde ouvrier français, la condition ouvrière est toujours une réalité massive pour nombre d'actifs 10 ( * ) . Les actifs ouvriers étaient 7 millions en 1982, ils sont 5,8 millions aujourd'hui (et 81,5 % d'entre eux sont des hommes). Si la baisse est donc bien réelle, la PCS réunit toujours un quart des actifs français. Pour ce qui concerne le monde rural, l'emploi ouvrier est essentiellement structuré par les PME, l'artisanat et le bâtiment.
Si la désindustrialisation a donc des effets importants, ce sont surtout les espaces urbains qui se sont vidés de leurs ouvriers, sous l'effet de processus conjoints : reconfiguration de l'industrie autour de petites structures de production 11 ( * ) et essor de la ségrégation spatiale sous l'effet de la hausse des prix du foncier qui éloigne les classes populaires des centres urbains. De fait, les cartes de la proportion d'ouvriers par cantons en 1968 et 2008 indiquent que certaines campagnes ont encore une proportion d'ouvriers importante : Doubs, Somme, zones centrales des régions Bretagne ou Pays de la Loire par exemple. Alors que dans nombre de cantons du quart Nord-Est, les ouvriers représentaient plus de 60 % des actifs, une telle proportion majoritaire est rare aujourd'hui. Néanmoins, l'attention précise aux situations micro-régionales indique que c'est en marge des villes que les ouvriers représentent entre 20 % et 50 % des actifs. À une échelle encore plus fine, Nicolas Renahy analysera la crise de reproduction du monde ouvrier dans une petite commune de Bourgogne.
Proportion d'ouvriers par canton en 1968 et 2008
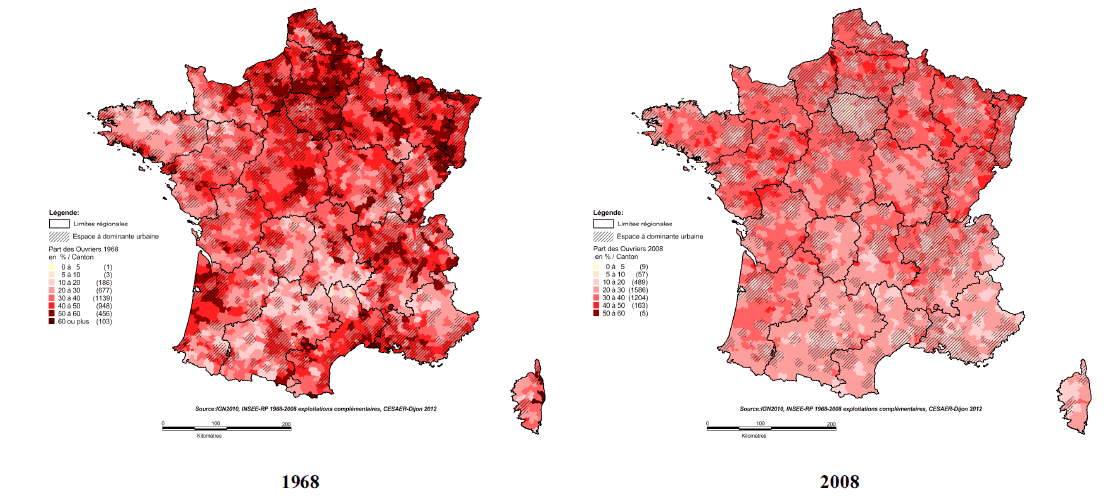
Source : IGN 2010, INSEE 1968-2008, CESAER Dijon 2012
Les employés sont aujourd'hui une composante centrale des classes populaires. Ils partagent avec les ouvriers une position subalterne dans l'emploi, mais également une proximité de condition de vie. La PCS étant féminisée à 77 %, les couples formés d'une employée et d'un ouvrier représentent en effet 18,4 % des unions (un tel taux n'a pas d'équivalent). Un ouvrier sur deux est en couple avec une employée, et 40 % des employées le sont avec un ouvrier. Au total, près de 43 % des couples sont des ménages composés d'ouvrier-e-s et/ou d'employé-e-s et/ou d'inactif-ve-s 12 ( * ) . Une telle réalité structure profondément la sociologie des campagnes.
Cette centralité de la PCS employé-e-s parmi les classes populaires contemporaines est d'autant plus vraie que, à l'inverse de ceux des ouvriers, ses effectifs ont fortement augmenté depuis le début des années 1980. Ils étaient de 5,5 millions en 1982, et de 8,3 millions en 2009. De fait, les cartes qui suivent indiquent que la PCS ne représentait que rarement plus de 40 % des actifs des cantons en 1968 en dehors de la région parisienne et de certaines zones urbaines, tandis que rares sont les zones qui en 2008 en comptent moins de 20 %, et que c'est principalement dans les espaces périurbains et ruraux qu'on retrouve ses membres.
Proportion d'employés par canton en 1968 et 2008
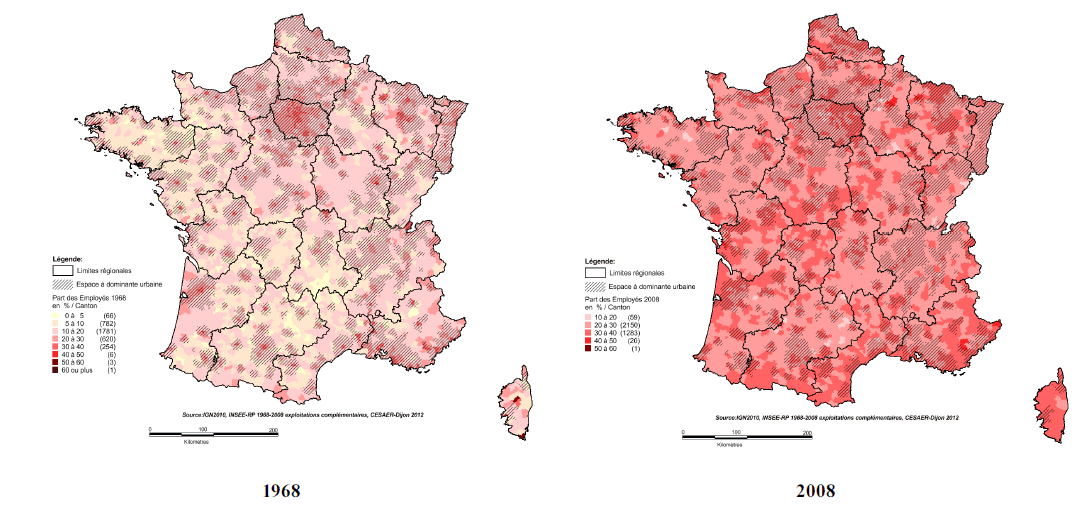
Source : IGN 2010, INSEE 1968-2008, CESAER Dijon 2012
c) Classes moyennes et supérieures
Du côté des classes moyennes et supérieures, nous voyons que les cadres sont surtout présents dans les espaces urbains, tandis que les professions intermédiaires sont très représentées dans les zones périurbaines (inclues dans « l'espace à dominante urbaine » grisé sur chaque carte). En près de 50 ans, les cadres constituent une PCS dont la proportion d'ensemble parmi les actifs français a triplé (15 % des actifs, 5 % en 1962). Aujourd'hui, les trois quarts d'entre eux résident dans les grands pôles urbains tandis qu'ils ne représentent que 6 % des actifs des communes isolées. Les professions intermédiaires constituent également un groupe devenu important (24 % des actifs contre 11 % en 1962), à la présence urbaine marquée, mais surtout très important dans la structure sociale du périurbain. Notons que les zones périurbaines sont définies par l'INSEE comme celles où 40 % ou plus des actifs travaillent dans l'espace urbain proche, mais leur physionomie et l'organisation administrative et sociale est souvent proche des bourgs ruraux classiques, importance des zones pavillonnaires en plus - comme l'analyseront Violaine Girard et Anne Lambert dans leurs exposés respectifs.
Proportion de cadres et professions intellectuelles supérieures par canton en 1968 et 2008
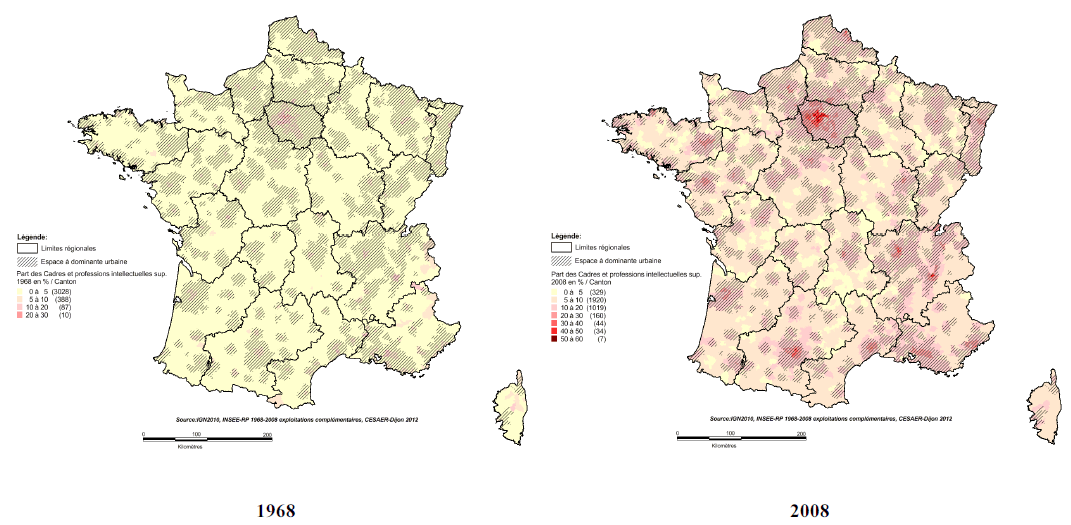
Source : IGN 2010, INSEE 1968-2008, CESAER Dijon 2012
Proportion de professions intermédiaires par canton en 1968 et 2008
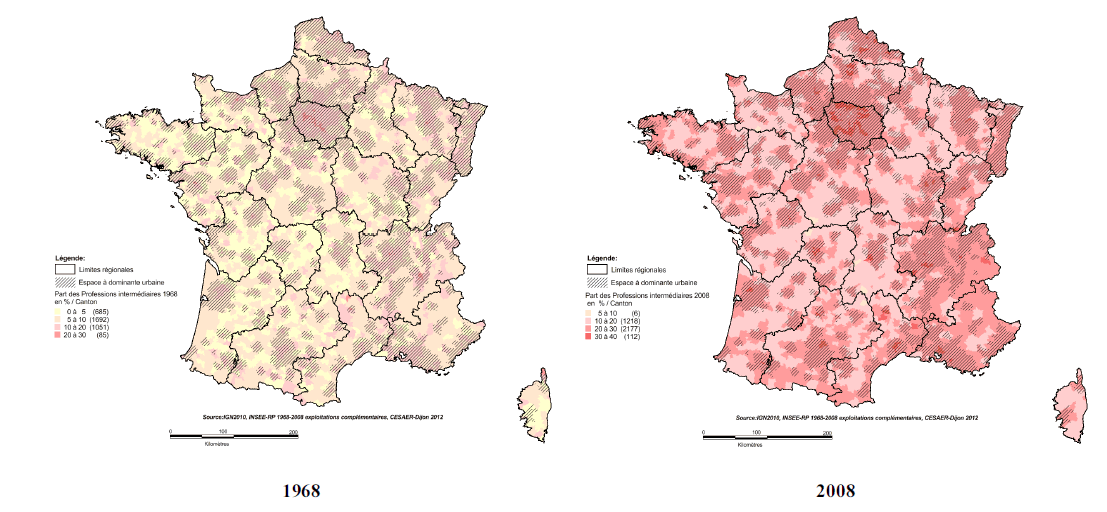
Source : IGN 2010, INSEE 1968-2008, CESAER Dijon 2012
d) Critique des visions statistiques stratificationnistes
Les enseignements de ces cartes sont multiples. Retenons deux résultats principaux : d'une part, numériquement, l'espace rural n'est plus un espace dominé par les mondes agricoles, et ce même dans les zones du territoire les plus à distance des centres urbains ; d'autre part, l'espace urbain apparaît socialement sélectif avec une surreprésentation des catégories sociales supérieures qui se renforce, quand, symétriquement, l'espace rural est de plus en plus populaire. Faut-il en conclure à une coupure - voire une « fracture » - grandissante entre deux mondes, entre une France urbaine, décisionnaire et mondialisée et une France rurale, périphérique et d'exécution, comme on peut souvent le retrouver sous la plume de journalistes et chroniqueurs ?
On peut en douter, et ce colloque va surtout tenter de complexifier le tableau.
Il convient en effet de se méfier des représentations misérabilistes des campagnes françaises. Celles-ci ont une très longue histoire. Au XIX ème siècle, les espaces ruraux étaient prioritairement des zones productives, à la fois agricoles et industrielles au moment de la première révolution industrielle, mais aussi lors de la seconde avec le développement de bourgs autour d'usines, jusqu'aux années 1960 où la décentralisation économique dynamise l'emploi dans ces espaces. Mais le regard posé par les élites sur les campagnes de la fin du XIX ème siècle à nos jours en a très rapidement fait un lieu « autre », en « retard », voire préservé de l'industrialisation des villes (la mise en usine des ouvriers a produit la concentration urbaine) et de la sophistication culturelle et artistique des villes. Le développement du tourisme et de l'agroalimentaire de luxe a eu besoin de créer une esthétique du sauvage, du reculé, de l'authentique des campagnes françaises. S'est développé un goût bourgeois pour un populaire paysan toujours remis en scène, des films de Depardon (les documentaires « La vie moderne » 13 ( * ) ) à la belle maison de campagne patrimonialisée contemporaine, de la littérature régionaliste aux émissions de téléréalité. De telles représentations sociales des campagnes ont eu des traductions savantes, avec le courant folkloriste qui jusqu'aux années 1940 cherchait à la campagne les traditions nationales et régionales - traditions supposées d'avant une « modernisation » aux seuils historiques mouvants. Leur emboîtant le pas, les ethnologues ont voulu étudier ce qu'ils pensaient être une société coupée, autonomisée, en train de disparaître. Les sociologues des années 1950 aux années 1980 ont repris en partie cette dichotomie, observant la crise de reproduction de la paysannerie. D'autres mouvements ont été peu étudiés : embourgeoisement de fractions d'agriculteurs, développement du productivisme, spécialisation sur les marchés du luxe alimentaire et artisanal. Or aujourd'hui, on voit bien que l'excellence économique et culturelle française est loin d'être le monopole d'une production urbaine. Par contre, comme nous le montrera Jean Rivière, les représentations misérabilistes perdurent, présentant toujours la campagne comme une zone politiquement déviante du point de vue de la culture légitime.
Par ailleurs, les historiens ont multiplié les travaux démontrant l'ancienneté des échanges entre les villes et les campagnes dès le XIX ème siècle, avec le développement des transports (train, routes, réseaux de communication), un contrôle des institutions (école, mairie, préfecture, armée) et des marchés (nationalisation et internationalisation des marchés, industrie agroalimentaire française, rôle des banques, du Crédit Agricole notamment). Même si la richesse continue de se concentrer dans les grandes métropoles, comme l'analyse Jean Cavailhès, les territoires ruraux sont depuis longtemps intégrés dans le processus de nationalisation de la société et ne forment pas des sociétés à l'écart des innovations sociales majeures de leur temps.
Aujourd'hui, comme nous le rappellera Mohamed Hilal, les mobilités entre la ville et la campagne sont comme hier nombreuses. Mais leur nature s'est modifiée. Ce sont pour beaucoup des mobilités quotidiennes, liées au poids d'un marché immobilier producteur d'inégalités territoriales, et à la déconnexion entre scènes résidentielles et scènes professionnelles -déconnexion qui touche aussi les formes de conjugalité dans le monde agricole, comme le montrera Céline Bessière. Nombre de résidents des campagnes travaillent dans les espaces urbains, quand inversement une part non négligeable des actifs des espaces ruraux parmi les plus qualifiés habite en ville. De même, l'accès aux services, aux commerces, à la santé et à l'éducation nécessite de plus en plus de temps de transport : l'époque n'est plus à la diffusion républicaine des services publics sur l'ensemble du territoire, mais à leur « restructuration ». Les effets de cette évolution des politiques publiques ont des effets contrastés, comme le montreront Francis Aubert et Quentin Frère dans le cas de l'intercommunalité, et Christophe Capuano sur la question de la prise en charge du vieillissement et de la dépendance. Les données cartographiques présentées ici étant principalement fondées sur le lieu de résidence, elles ne tiennent pas compte des mobilités croisées entre les villes et les campagnes. En quelque sorte, ces données statistiques figent les populations et ouvrent à toutes les interprétations possibles. Il importe donc de les coupler à des données issues d'enquêtes de terrain plus fouillées pour nuancer les images simplificatrices, et surtout rendre compte du fait que la réalité sociale est d'abord une réalité vécue, faite de rapports sociaux quotidiens. Les mécanismes sociaux ne sont pas de vastes mouvements désincarnés, ils sont produits et éprouvés dans l'expérience de chacun, dans les relations et appartenances (professionnelles, familiales, affinitaires), modes de vies, aspirations, ou tout simplement dans les pratiques d'approvisionnement alimentaire comme l'analyse Jean-Baptiste Parenthoën.
e) Conclusion
Aujourd'hui, la composition sociale des espaces ruraux a donc été profondément bouleversée : déclin majeur de la population agricole mais maintien de sa hiérarchisation interne (cf. l'intervention de Gilles Laferté), vieillissement de la population et dans le même temps renouvellement de migrations résidentielles d'urbains dans certaines zones, visibilité de classes populaires elles-mêmes diverses (avec des groupes encore intégrés à la société salariale et des groupes beaucoup plus précaires, dans les secteurs industriels, de service et dans les activités artisanales et agricoles), moindre présence de classes dominantes qui monopolisent pourtant les instances intercommunales (cf. la présentation de Sébastien Vignon).
Cependant, ces évolutions statistiques ne disent rien des rapports sociaux qui articulent les alliances ou les concurrences entre ces groupes. La différenciation sociale entre ces groupes est d'abord inscrite dans des rapports sociaux : dans l'occupation des postes politiques locaux par exemple, dans les stratégies scolaires, les alliances matrimoniales, les stratégies de distinction sociale par la résidence notamment, les manières d'être et les sociabilités de loisirs... Comment les différents groupes résidants dans les espaces ruraux cohabitent-ils ? Quels groupes sociaux dominent ces espaces sociaux profondément renouvelés ? Y a-t-il une homogénéité des espaces ruraux sur le territoire français ? Quels sont les déterminants de la différenciation de la répartition des groupes sociaux sur le territoire national ? Comment les logiques économiques et institutionnelles jouent-elles sur cette différenciation ?
Pour donner des éléments de réponses à ces questions, les exposés ont été regroupés autour de trois thèmes. Le premier reviendra sur la diversité des trajectoires pour mieux saisir l'hétérogénéité des territoires ruraux, comme conséquence de la ségrégation sociale et résidentielle, mais aussi de la déconnexion entre lieux de résidence et lieux de travail. Le second thème sur les appartenances reviendra sur l'hétérogénéité sociale des espaces ruraux en ciblant divers groupes sociaux pour comprendre la forte évolution de la composition sociologique de ces espaces. Enfin, en lien avec les reconfigurations institutionnelles des dernières décennies, nous saisirons les conséquences de ces évolutions sur la sociologie des élus et la permanence ou le renouvellement des représentations sociales de ces espaces ruraux.
TABLE-RONDE N° 1 - TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES ET TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES
Président : Yves Rome, sénateur de
l'Oise
Modérateur : Joseph Confavreux, Mediapart
Les espaces ruraux sont hétérogènes, par la proximité aux centres urbains ou les spécialisations productives. La déconnexion entre lieux de vie et lieux de travail, que donne à voir la progression des espaces périurbains, contribue à redessiner les cartes des frontières sociales et de la ségrégation résidentielle, ainsi que les modes d'organisation familiale.
1. Populations, conditions de vie,
économie, paysages : des campagnes françaises aux multiples
visages
Mohamed Hilal
(UMR 1041, INRA-CESAER Dijon)
Le support de la présentation est disponible à l'adresse :
www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/sites/default/files/travaux_en_l_12_22032012-1.pdf
2. Le marché foncier : une
machine à hacher la société
Jean Cavailhes
(UMR 1041, INRA-CESAER Dijon)
a) Introduction
L'armature urbaine d'un pays se déforme en permanence, sous l'effet de forces locales et globales : les coûts de transport nationaux et internationaux des biens, la taille des marchés accessibles et la concurrence qui y règne, le coût de déplacement des travailleurs, les goûts des ménages, etc., modèlent les structures urbaines en les déformant et les reformant, comme la main du potier modèle l'argile. Or, au cours des 25 dernières années, des évolutions importantes ont affecté chacune des composantes qui pétrissent ainsi la forme des villes. C'est ainsi que la mondialisation a progressé, de même que l'intégration des marchés de l'Union européenne, ce qui a réduit les coûts de transport - y compris les coûts immatériels : douane, barrières non tarifaires, coûts commerciaux, etc., ouvrant de nouveaux marchés à des produits nationaux et, en sens inverse, ouvrant la France à l'entrée de produits étrangers. Dans le même temps, l'étalement des villes a progressé avec la périurbanisation des ménages, puis celle des emplois. Ce sont les forces à l'oeuvre et leurs effets sur l'armature urbaine du territoire qui sont ici analysés et décrits.
Nous montrons, en particulier, que les dix plus grandes métropoles de province sont les gagnantes de la course aux emplois. Cette concentration est vertueuse : les économistes savent, depuis toujours pourrait-on dire, que les grandes villes sont le moteur de la croissance. Nous verrons également que cette concentration métropolitaine s'étend et s'étale dans l'espace : ce sont les banlieues et les périphéries périurbaines qui en profitent plus que les villes centres, dans les plus grandes métropoles comme dans l'ensemble du système urbain français. L'étalement des emplois est général : les emplois stratégiques de ce que l'Insee appelle les « cadres de fonctions métropolitaines » migrent vers la périphérie des grandes villes, les emplois industriels font de même, et ceux des services aux particuliers aussi. Le mouvement d'étalement se nourrit aussi du flux des ménages quittant les villes vers les espaces périurbains, qui l'emporte sur le flux de sens inverse avec une constance maintenue depuis plus de 30 ans. Cet étalement des métropoles est, lui aussi, vertueux sur le plan économique : il réduit les coûts urbains - coûts fonciers et coûts de transport. Il améliore donc la compétitivité des entreprises. Mais c'est peut être au détriment de l'environnement et de la vie sociale : d'une part, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'espaces ouverts peuvent s'en trouver accrus, quoique ce ne soit pas un résultat inéluctable ; d'autre part, la ségrégation sociale de l'espace peut également s'accentuer du fait de cet étalement.
L'analyse qui est menée dans cet article considère tout d'abord la localisation des entreprises, sur le plan théorique et sur le plan factuel, puis celle des ménages, avec également les deux volets des enseignements de la théorie et des faits.
b) Les villes moteur de la croissance
La concentration des firmes et des travailleurs dans les villes résulte d'économies d'échelle dues à des coûts fixes et à la division du travail. L'idée est très ancienne : Adam Smith vantait déjà les avantages de la division du travail à travers l'exemple resté célèbre de la coopérative d'épingles, plus productive que des artisans individuels. Les villes présentent en effet des avantages multiples. Le transport des biens coûte d'autant moins cher que les firmes sont proches. Le progrès technique se diffuse mieux à une échelle locale : « les connaissances circulent d'un étage à l'autre et traversent les rues mieux que des océans ». Sur un grand marché du travail les appariements entre offre et demande se font aisément et chaque firme trouve les spécialistes dont elle a besoin. La spécialisation des firmes accroît la productivité de chacune et de l'ensemble d'entre elles, par exemple avec le développement d'un secteur de services aux entreprises ou la présence d'infrastructures de communication et de transport qui bénéficient à toutes. Enfin, les interactions de proximité entre firmes, en particulier sous forme d'informations qui s'échangent entre elles, sont d'autant plus intenses qu'elles sont concentrées. Marshall, à la fin du XIX ème siècle, parlait déjà d'une « atmosphère » industrielle. Plus les villes sont grandes plus cette « atmosphère » est bénéfique. La densité de bureaux, de laboratoires, d'ateliers est donc recherchée par les firmes, d'autant plus que les informations dont elles ont besoin circulent mal ou pour des opérations qui supposent une relation de confiance mutuelle ou de loyauté, donc en face-à-face.
Au total, lorsque la densité urbaine double, la productivité du travail augmente de 2 % 14 ( * ) . En appliquant ce ratio à Lyon (9 900 habitants par kilomètre carré) et à Besançon (1 800 habitants par kilomètre carré), la productivité est de 10 à 12 % supérieure dans la grande métropole que dans la ville moyenne. Un travail un peu antérieur portant sur six pays européens (dont la France), a montré que lorsque le nombre des emplois offerts par une ville doublait, la productivité du travail y augmentait de 4,5 %, chiffre voisin de celui des Etats-Unis (+ 5 %) 15 ( * ) . Avec ces résultats l'écart de productivité entre Lyon et Besançon s'accroît, pour approcher 20 %. C'est une différence énorme.
Les avantages économiques des métropoles ne sont pas près de disparaître car, malgré les nouvelles technologies de l'information, les interactions directes en face-à-face restent indispensables. Les nouvelles technologies de la communication ne s'y substituent pas, mais au contraire elles en sont le complément : plus on communique par des canaux virtuels, comme internet, plus il faut se rencontrer physiquement, à un moment donné de l'échange. Il en résulte le développement de quartiers d'affaires à haute densité de bureaux, de technopoles, de zones d'affaires aéroportuaires ou de villes nouvelles, de villes satellites, ou villes lisières (il n'y a pas de bonne traduction de l'anglais edge cities ).
c) La croissance des dix plus grandes métropoles de province
Pour étudier l'évolution de la localisation des firmes, nous examinons les emplois au lieu de travail à travers les recensements de l'Insee de 1982 et 2008 - il s'agit ici du recensement permanent, effectué par tranches entre 2006 et 2010. Le découpage de l'espace utilisé est celui des aires urbaines 16 ( * ) de l'Insee de 2010, légèrement adapté de façon à distinguer l'aire urbaine de Paris, les aires urbaines de province offrant plus de 100 000 emplois dans la ville centre, celles offrant entre 10 000 et 100 000 emplois dans la ville centre, puis en reprenant la nomenclature de l'Insee 17 ( * ) . Les communes-centres offrant plus de 100 000 emplois sont les dix plus grandes métropoles de province : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Nous les avons isolées car, comme nous allons voir, elles se singularisent nettement des autres aires urbaines.
Ce qui nous importe ici est moins l'évolution en valeur absolue que l'évolution relative : où les emplois ont-ils progressé plus qu'en moyenne nationale ? Ou bien, lorsqu'il s'agira d'examiner les emplois industriels qui ont diminué, où ont-ils résisté mieux que pour l'ensemble national ? Ce sont donc des évolutions relatives que nous examinons à travers une série de figures, qui rapportent des évolutions dans un type donné d'espace à l'évolution nationale.
Evolution relative de 1982 à 2008 des emplois selon le type d'espace (figure 1)
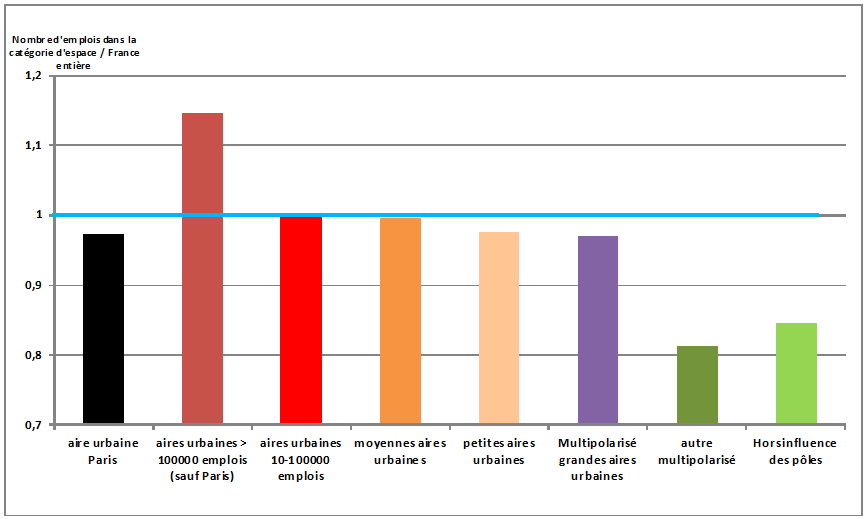 Source : recensements
de la population
Source : recensements
de la population
Examinons, tout d'abord, avec la figure 1, l'évolution de 1982 à 2008 de l'ensemble des emplois au lieu où ils sont exercés, qui correspond à l'évolution de la localisation des entreprises. En donnant la valeur de 100 à l'ensemble de la France, l'aire urbaine de Paris est passée en un quart de siècle environ à l'indice 97,3, connaissant donc un recul relatif de 2,7 %. Seules les plus grandes aires urbaines de province ont bénéficié plus que la moyenne nationale de l'accroissement des emplois : elles sont à l'indice 115 en 2008. La situation des aires urbaines de taille inférieure a évolué à un rythme proche de celui de l'ensemble du pays. C'est dans les territoires les moins denses que l'évolution a été la plus défavorable en termes relatifs : en 2008, l'indice est de 84,5 dans les communes hors influence des pôles, de 81,3 dans les communes multipolarisées par des aires urbaines moyennes ou petites.
L'allure générale de la distribution est donc celle d'un U inversé : la plus grande aire urbaine, celle de Paris et les régions rurales et peu denses ont connu un recul relatif des emplois, au bénéfice des grandes métropoles provinciales, alors que l'évolution a été assez neutre pour les aires urbaines de moyenne et petite taille.
Les cadres des fonctions métropolitaines progressent plus vite dans les grandes métropoles de province
Les fonctions métropolitaines définies par l'Insee correspondent à un ensemble composé de prestations intellectuelles, des métiers de la conception-recherche, de la gestion, du commerce inter-entreprises et de la culture. Elles se sont développées à très vive allure et représentent, en 2006, le quart des emplois en France. Parmi ces métiers, ce sont les cadres qui ont progressé le plus rapidement, passant de 1,1 million d'emploi en 1982 à 2,3 millions en 2006. Ces emplois de cadres des secteurs stratégiques pour l'économie nationale sont très concentrés : ils représentent 18 % des emplois de l'aire urbaine de Paris, 14 % dans les aires urbaines de Toulouse et Grenoble.
L'évolution relative de cette population de cadres des fonctions métropolitaines dans chaque type d'espace entre 1982 et 2009 est retracée sur la figure 2, avec le même type de représentation que dans la figure 1. Le gain relatif des dix grandes métropoles de province est plus important que pour l'ensemble des emplois : l'indice 126 est atteint en 2009. L'aire urbaine de Paris, qui concentrait déjà en 1982 un très grand nombre d'emplois de ce type, n'a pu progresser au même rythme : elle est à l'indice 96 en 2009. Les autres aires urbaines ont également progressé, mais moins rapidement que la moyenne nationale et les plus petites d'entre elles ont connu un gain relatif inférieur à celui des communes hors influence de pôles.
Evolution relative de 1982 à 2009 des cadres des
fonctions métropolitaines
(figure 2)
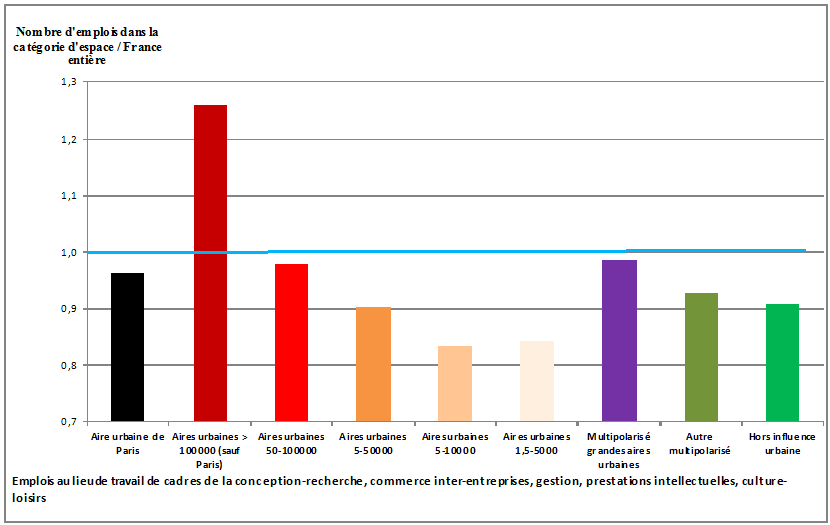
Source : recensements de la population
Pour l'économiste, cette évolution relative favorable aux dix plus grandes métropoles de province, tant celle des cadres de fonctions métropolitaines que celle de l'ensemble des emplois, est vertueuse. Les forces économiques qui poussent à cette concentration, que nous avons rapidement décrites, l'emportent sur les forces de dispersion, que nous allons examiner, ainsi que sur les forces politiques dont l'objectif déclaré, depuis des décennies, est d'équilibrer la croissance sur l'ensemble du territoire.
Une nuance doit être apportée à cette analyse d'ensemble : la situation de l'aire urbaine de Paris est singulière puisque, en termes relatifs, elle connaît un léger recul depuis 1982. Mais le poids économique de Paris, comme celui de Londres au Royaume-Uni, est une exception en Europe, au point que J.F. Gravier a pu intituler son célèbre ouvrage, paru en 1947, « Paris et le désert français ». La taille de la capitale, et l'écart important qui la sépare des autres métropoles françaises, peuvent se traduire, d'une part, par des déséconomies d'échelle qui se produisent inévitablement au-delà d'une certaine taille et, d'autre part, par un rattrapage des métropoles de province.
d) Les coûts urbains limitent la croissance métropolitaine
Les métropoles, en plus des atouts certains qui expliquent leur croissance, supportent également des handicaps, qui limitent celle-ci. Au premier chef, se trouvent les coûts urbains, coûts fonciers et coûts de déplacement 18 ( * ) . Les entreprises des grandes villes payent cher la ressource foncière qui leur est nécessaire et elles doivent consentir des salaires élevés à leurs employés pour compenser le coût foncier qu'ils subissent également, ainsi que le coût des migrations alternantes domicile travail. C'est ce que montre le tableau 1. Pour les maisons individuelles, par rapport à la référence 100 en banlieue parisienne, le prix tombe à l'indice 46 en proche banlieue des grandes aires urbaines de province et à 41 au centre des plus petites. En ce qui concerne le loyer par mètre carré des appartements, en prenant la valeur 100 dans Paris (soit, en 2008, 23 euros par mois et par mètre carré), l'indice est de 55 dans les grandes agglomérations de province (par exemple, en 2008, 11 euros le mètre carré par mois à Lyon) et de 43 dans les petites (par exemple, en 2008, 7 euros le mètre carré par mois à Rodez).
Valeur des maisons individuelles et des appartements selon la taille de la commune centre des aires urbaines (tableau 1)
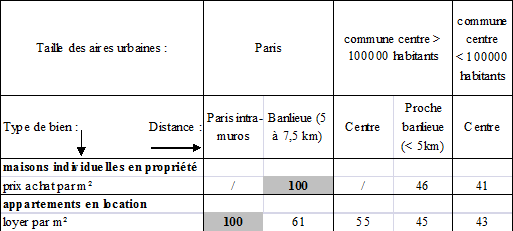
Source : enquêtes « Logement » de l'Insee.
Indice 100 : loyer par mètre carré des appartements dans Paris ou prix d'achat par mètre carré des maisons à 5 - 7,5 km de Paris (le nombre de maisons dans Paris est trop faible dans ces enquêtes pour être pris comme référence).
A ces aspects fonciers, qui constituent les « coûts urbains » s'ajoutent des coûts moins directs mais néanmoins importants : congestion, pollution de l'air, sentiment d'insécurité, bruit, qui sont un cortège de nuisances résultant de la forte densité de l'habitat et des activités productrices.
Ces coûts directs et indirects poussent les entreprises à rechercher des localisations plus économes par un arbitrage entre les avantages et les inconvénients de la concentration métropolitaine. Elles cherchent à réduire les coûts fonciers et salariaux, tout en conservant une bonne accessibilité aux services supérieurs des villes centres et en évitant ce qui leur apparaît comme des déserts économiques. Un tel arbitrage explique le développement de métropoles polycentriques, avec des centres d'emplois satellites de grandes métropoles, où les coûts urbains sont moindres, mais qui permettent de bénéficier des services métropolitains lorsque le coût de communications pour les aller quérir est supportable 19 ( * ) .
e) Une métropole plus monocentrique : exemple de la région de Toulouse
L'exemple de la région toulousaine donne une illustration de l'évolution des emplois entre la métropole régionale de Toulouse et six grandes aires urbaines sous son influence : Albi, Montauban, Castelsarrasin, Auch, Pamiers, Castres.
La métropole de Toulouse et ses satellites (figure 3)
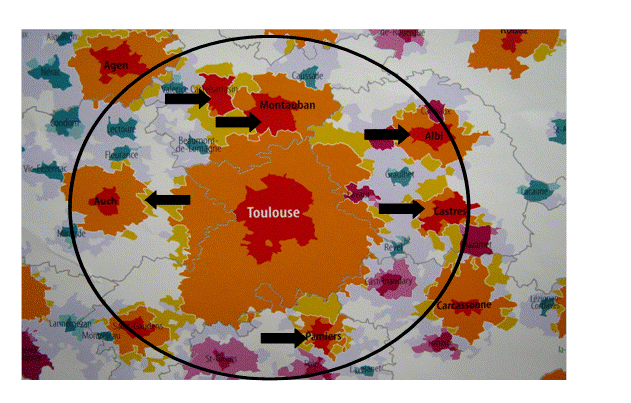
Source : zonage en aires urbaines 2010. Les communes en rouge forment les unités urbaines des `grandes aires urbaines' au sens de l'Insee (plus de 10 000 emplois), celles en orange les couronnes de ces grands pôles. Le jaune symbolise les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, le violet les `moyennes aires urbaines' et le vert les `petites aires urbaines'.
En traçant un cercle de 75 kilomètres autour du Capitole (cf. figure 3), la figure 4 permet de retracer l'évolution des emplois dans cette région en distinguant, tout d'abord, les différentes catégories d'espaces de la figure 3. De plus, nous isolons la commune centre de chaque unité urbaine de son restant, qui constitue la banlieue. Enfin, pour l'aire urbaine de Toulouse, la banlieue et la couronne périurbaine sont divisées en deux (proche, éloigné) selon la proximité de Toulouse. Les raisons de ce découpage spatial vont apparaître immédiatement.
La figure 4 montre que seules des communes appartenant à l'aire urbaine de Toulouse ont une croissance entre 1982 et 2008 supérieure à la moyenne régionale : les six aires urbaines satellites se situent, en moyenne, à l'indice 80 en 2008 pour une valeur régionale de 100. C'est donc la grande aire urbaine métropolitaine qui est clairement la gagnante, au détriment de ses satellites. L'évolution vers plus de polycentrisme, qui pourrait être bénéfique à la croissance économique du fait de la limitation des coûts urbains, ne s'est pas produite dans cette région au cours de la période étudiée.
Evolution de 1982 à 2008 des emplois selon le type d'espace rapportés à la moyenne de la région (figure 4)
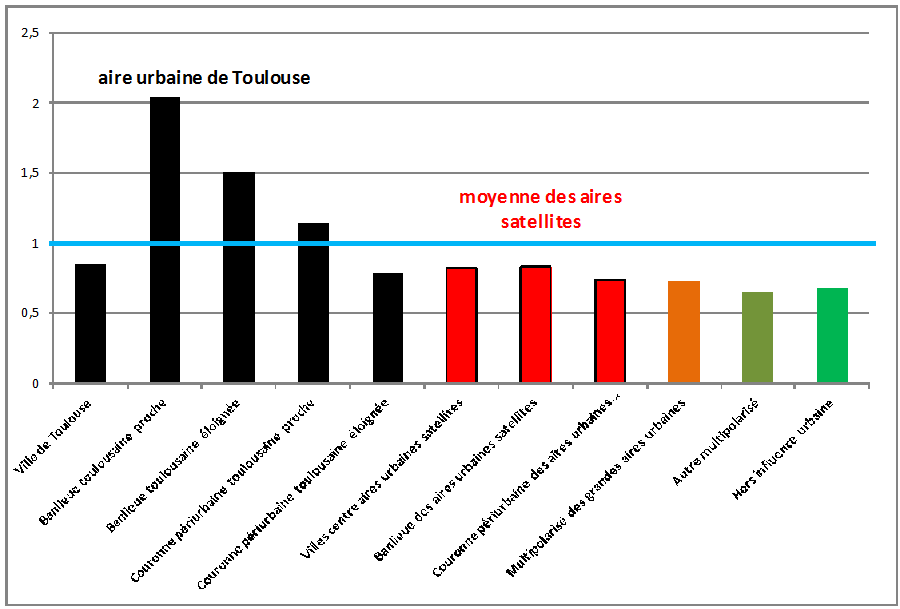
Source : recensements de la population
Pourtant, on assiste à un phénomène comparable du point de vue des mécanismes économiques, mais qui conduit à une forme urbaine qui diffère du modèle centre - satellite de la théorie. C'est le mouvement de périurbanisation des entreprises. Ce faisant, les entrepreneurs cherchent à réduire les coûts urbains, fonciers et de déplacement, comme le veut la théorie. Ils bénéficient aussi d'une bonne accessibilité aux services financiers, universitaires, aéroportuaires, etc. des métropoles. Enfin, la densité d'emplois dans des zones d'activité, des parcs technologiques ou tertiaires de banlieue ou périurbains est suffisante, ce qui est aussi une exigence de la théorie pour obtenir une bonne productivité. La périurbanisation des emplois présente donc des avantages similaires à ceux du polycentrisme urbain analysé par Cavailhès et al . 20 ( * ) .
Ce mouvement centrifuge se produit dans l'aire urbaine de Toulouse. C'est ce que montre la distinction des différentes zones de celle-ci : vite entre 1982 et 2008, les emplois augmentent moins que la moyenne régionale dans la commune de Toulouse (indice 85 en 2008), beaucoup plus rapidement dans la banlieue proche (indice 203 en 2008) et lointaine (indice 151 en 2008) et un peu plus vite dans la couronne périurbaine proche (indice 114 en 2008).
La répartition des cadres des fonctions métropolitaines montre que ces emplois se développent eux aussi plus vite en banlieue toulousaine que dans la ville de Toulouse elle-même (figure 5). Celle-ci n'est pas la commune où ils sont les plus représentés : en 2008, ils dépassent 25 % des emplois à Labège et Blagnac, pour 16 % à Toulouse. La progression depuis 1982 a été rapide partout, mais plus encore dans la plupart des communes de banlieue. En revenant à des données France entière, nous allons retrouver le même mouvement de migration des emplois vers les périphéries des métropoles.
Les cadres des fonctions métropolitaines à Toulouse et dans sa banlieue en 1982 et 2008 (figure 5)
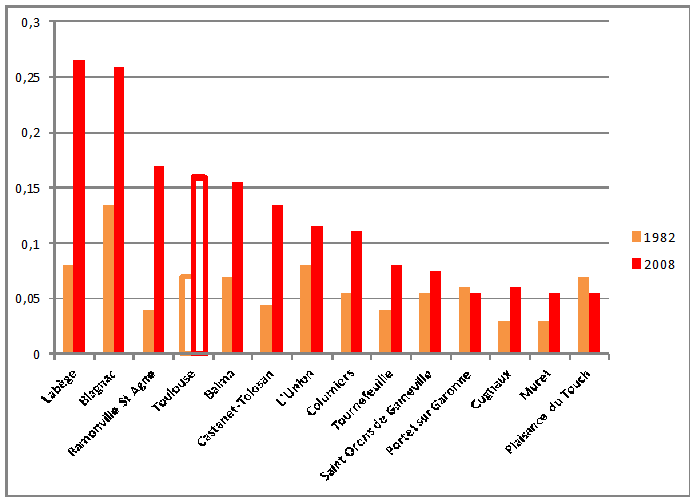
Source : « L'aire urbaine de Toulouse, un pôle d'emplois stratégiques de premier plan », Perspectives villes, n° 131, janvier 2011
f) Les emplois en France se désaxent vers la périphérie des métropoles
L'évolution des emplois dans la grande région toulousaine ne semble pas être une exception. Pour la France entière, les aires urbaines moyennes, ou celles offrant de 10 000 à 100 000 emplois dans leur ville centre, qui pourraient être peu ou prou des candidates au statut théorique de satellites des dix plus grandes métropoles de province, ont une croissance moindre que celles-ci. On assiste clairement à un mouvement de désaxage des emplois vers les périphéries des grandes villes. En gardant la même logique que précédemment d'étude des évolutions relatives des emplois par rapport à leur évolution nationale, nous décomposons, dans la figure 6, les tranches de taille des aires urbaines en fonction de la localisation plus ou moins proche du centre. Ce gradient distingue : (i) la commune centre elle-même ; (ii) les communes de banlieue 21 ( * ) qui constituent le reste du pôle urbain (ou unité urbaine centre) au sens de l'Insee et qui sont subdivisées selon leur proximité du centre (proche, éloignée) ; (iii) les communes périurbaines qui constituent la couronne des pôles au sens de l'Insee 22 ( * ) , également divisées selon qu'elles sont plus proches ou plus lointaines du centre de l'aire urbaine. La figure 6 indique l'évolution relative des emplois de ces différents types d'espace entre 1982 et 2008.
Dans les aires urbaines suffisamment grandes pour que la distinction des localisations proche ou éloignée des entreprises ait un sens, on observe des formes de la distribution en cloche : moindre croissance relative dans les villes centres, croissance relative maximum dans les banlieues éloignées et les communes périurbaines proches, croissance moindre en périphérie périurbaine. Dans les aires urbaines moins grandes, ce sont les banlieues où la croissance est maximum, les villes-centres ayant une croissance toujours inférieure à celle du pays dans son entier.
Evolution relative de 1982 à 2008 des emplois selon le gradient centre périphérie (figure 6)
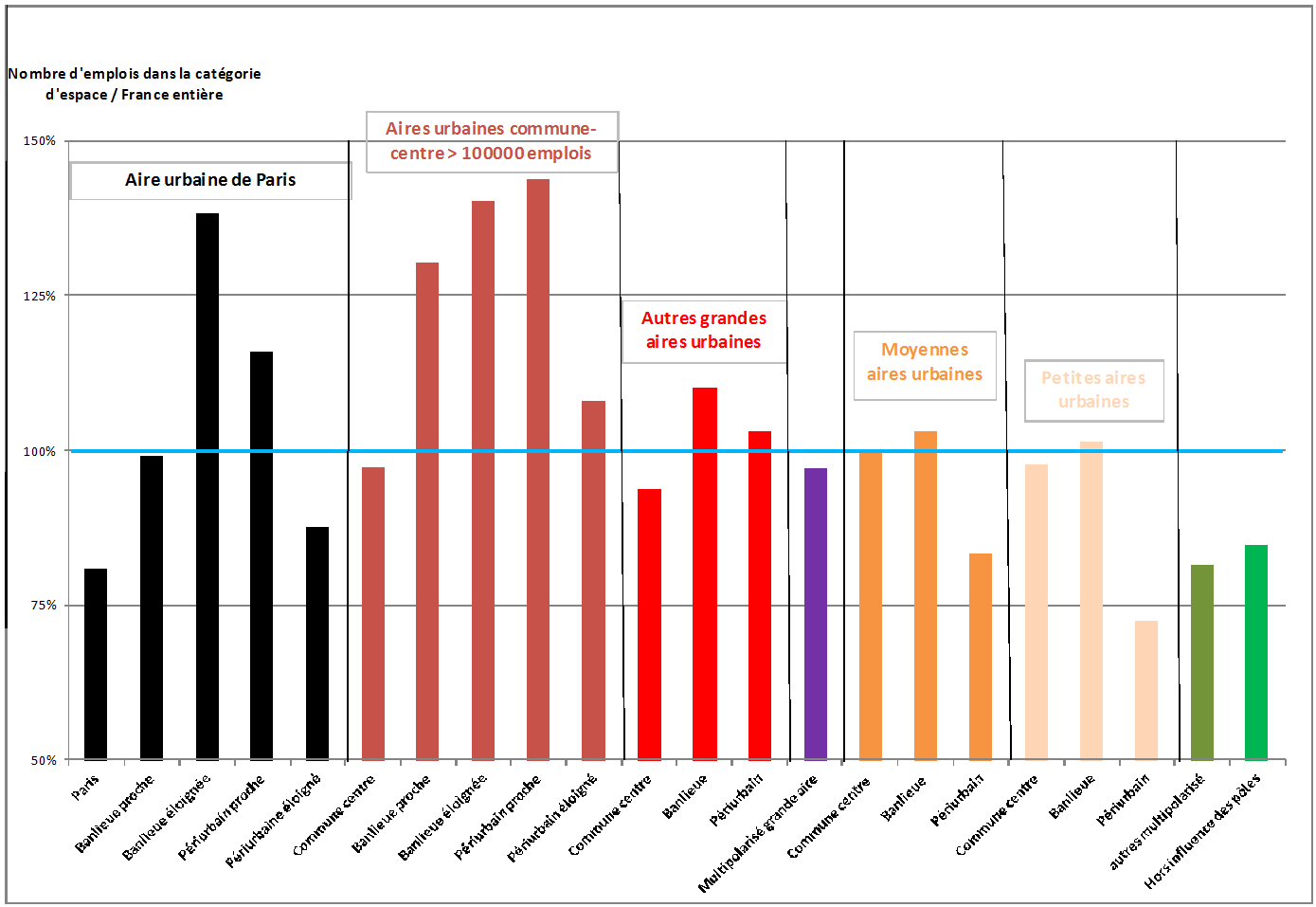
Source : recensements de la population
La croissance désaxée, au sens d'un mouvement qui sort de son axe - que nous assimilons au centre de l'aire urbaine - est donc globalement la règle. On peut dire autrement la chose : les emplois s'étalent dans l'espace - sans donner ici à ce terme de connotation négative. Un examen plus minutieux montrerait que les zones aéroportuaires, les abords de campus universitaires, la proximité de bretelles d'accès autoroutières sont privilégiés, de même que les bourgs ou petites villes périurbaines bien desservies par les transports. Le critère de l'accessibilité reste donc important, mais la recherche de coûts urbains moindres ne l'est pas moins.
Cette évolution globale de la localisation des entreprises peut cacher des comportements différents selon les secteurs d'activité. Il est normal que les emplois de service aux personnes suivent la population, qui se périurbanise comme nous allons le voir ; normal aussi que des entreprises polluantes ou qui ont besoin d'emprises foncières importantes (chimie, travaux publics, etc.) se développent surtout là où la densité de population est faible et les terrains peu chers. Pour éclairer ces mouvements sectoriels différents, nous examinons les emplois de cadres métropolitains en décomposant à nouveau la figure 2 selon le gradient de centralité (figure 7) et nous ajoutons une figure comparable pour les emplois industriels (figure 8).
La figure 7 montre que les emplois de cadres métropolitains ont connu entre 1982 et 2009 une évolution relative comparable à celle de l'ensemble des emplois : progression moindre qu'en moyenne nationale dans les communes centres des aires urbaines (sauf pour les dix plus grandes métropoles de province) et plus rapide en banlieue éloignée et dans les communes périurbaines proches. Les emplois industriels, dont il faut rappeler qu'ils ont régressé durant la période 1999-2009 étudiée dans la figure 8, se distinguent de l'évolution d'ensemble par plusieurs aspects. Globalement, c'est, une nouvelle fois, dans les dix plus grandes métropoles de province qu'ils se sont le mieux maintenus et dans l'aire urbaine de Paris que leur recul a été le plus important. Les communes hors influence de pôles, qui sont assimilées à l'espace rural « profond » (pour simplifier) ont connu une certaine résistance de ces emplois, de même que les autres communes multipolarisées (qui sont un espace rural moins « profond »). Selon le gradient de centralité, c'est dans les couronnes périurbaines que l'érosion de ces emplois industriels a été la moins forte, sauf en région parisienne.
Evolution relative de 1982 à 2009 des cadres des fonctions métropolitaines selon le gradient centre périphérie (figure 7)
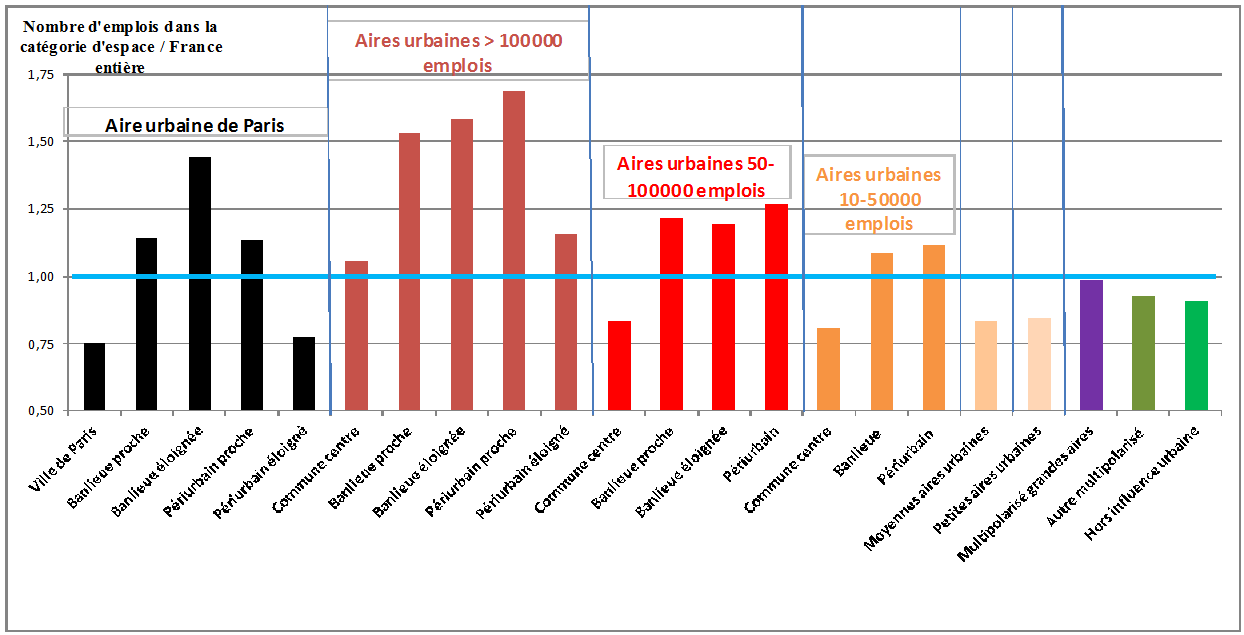 Source : recensements
de la population
Source : recensements
de la population
Evolution relative de 1999 à 2009 des emplois industriels selon le gradient centre périphérie (figure 8)
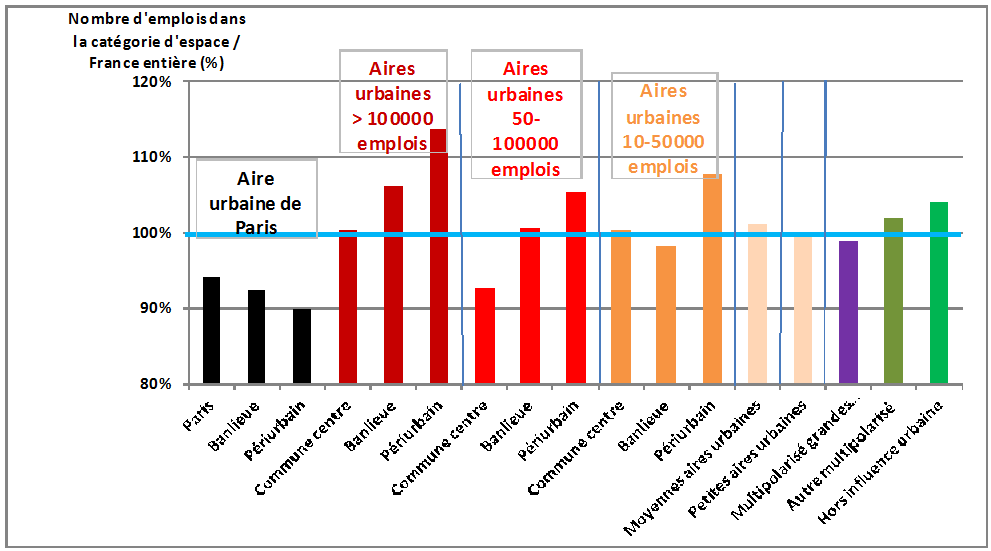
Source : recensements de la population
g) Les mécanismes fondamentaux de la localisation des ménages
Les économistes distinguent trois facteurs qui sont à la source du processus d'extension de l'habitat urbain dans l'espace : la démographie, naturellement, et deux causes proprement économiques, l'augmentation du niveau de vie qui se traduit par une demande accrue d'espace résidentiel et la diminution des coûts de transport qui permet d'habiter plus loin des villes-centres. Lorsque le niveau de vie augmente, disons de 1 %, la consommation de la plupart des biens augmente, généralement d'un peu moins de 1 % (biens normaux) et parfois de plus de 1 % (biens de luxe). Le logement étant un bien normal (+ 0,7 à 0,8 % pour + 1 % de revenu), de nouveaux terrains sont nécessaires pour satisfaire cette demande, conduisant à une expansion urbaine. La baisse des coûts de transport est aussi un facteur d'extension des villes. De nos jours, l'automobile permet d'habiter presque n'importe où, en s'affranchissant des réseaux de transports en commun. Or, le coût automobile a beaucoup baissé depuis un quart de siècle, et la vitesse de déplacement a augmenté, en particulier avec les améliorations du réseau routier, ce qui a également favorisé l'extension périurbaine des villes.
Le mécanisme sous-jacent au choix d'une localisation résidentielle est le suivant. Les ménages font un arbitrage entre le coût de leurs déplacements quotidiens (disons : les migrations alternantes domicile - travail) et le coût de leur logement, dont le renchérissement près des villes centres réduit la taille du lot résidentiel qu'ils peuvent y acquérir. La diminution des valeurs foncières lorsqu'on s'éloigne du centre-ville joue un rôle crucial dans cet arbitrage.
La manière dont s'opère l'arbitrage entre distance et valeur foncière varie selon les caractéristiques socio-démographiques des ménages (nombre d'enfants, âge, etc.) et leur revenu. Par exemple, si les ménages à haut revenu apprécient fortement la consommation d'espace résidentiel, ils choisissent d'habiter dans les banlieues ou les communes périurbaines où de faibles valeurs foncières leur permettent d'acquérir de grands lots résidentiels. On explique souvent ainsi la localisation des ménages riches dans les suburbs américains. Au contraire, les ménages aisés peuvent préférer choisir un habitat central pour éviter une perte importante en temps en transport lorsque c'est le temps qui est pour eux le plus précieux, comportement qui conduit davantage aux formes de certaines villes européennes (exemple : Paris), ainsi qu'à celles de certaines villes américaines (exemple : celles de la Nouvelle-Angleterre), où les ménages aisés habitent dans le centre des villes.
h) Le rôle des caractéristiques locales des lieux
Le cadre de vie résidentiel intervient pour compléter le raisonnement précédent. Parmi ses caractéristiques, la qualité du voisinage est l'élément le plus important. On parle souvent de « marquage social des lieux » pour désigner, à un extrême, la stigmatisation qui frappe certains d'entre eux que l'on voit comme des ghettos et, à l'autre bout, des quartiers de bonne réputation, où vit une population aisée. En effet, l'espace est socialement hétérogène. Les raisons tiennent, d'une part, au fonctionnement du marché immobilier et, d'autre part, à des mécanismes socio-économiques qui échappent au marché.
Un « tri spatial » résulte, tout d'abord, du fonctionnement spontané du marché foncier résidentiel. Les ménages qui ont les mêmes paramètres (revenu, coût du temps et goûts identiques) aboutissent à des choix identiques (aux impondérables individuels près) et ils se localisent donc spontanément à proximité les uns des autres, alors que d'autres ménages, qui ont des caractéristiques différentes, choisissent d'autres localisations. La ségrégation spatiale est le produit normal du fonctionnement du marché foncier.
Ce « tri spatial » résulte aussi de « comportements grégaires » qui opèrent indirectement sur le marché foncier. Les ménages des catégories sociales supérieures aiment vivre les uns près des autres car ils tirent bénéfice de ce voisinage. Il en résulte un effet boule de neige, qui s'accentue encore du fait de la qualité des biens et services publics qui sont offerts là où ils habitent (la qualité de l'école est particulièrement recherchée). De la même manière qu'on a pu dire que le Code civil était une machine à hacher la terre (par le jeu des divisions successorales successives), on peut dire que le marché foncier est une machine à hacher la société, en séparant les groupes sociaux et en les éloignant de plus en plus les uns des autres au fur et à mesure que l'habitat se disperse.
Enfin, des mécanismes hors marché interviennent aussi, comme les politiques volontaires de ségrégation mises en oeuvre par certaines collectivités locales : zonages urbains imposant des contraintes insupportables pour les classes laborieuses, inégalité d'implantation des logements sociaux (« trop grands » et « trop ensembles »), « clubbisation » de communes périurbaines, en empruntant ce terme à E. Charmes 23 ( * ) . En effet, la périurbanisation en France a accentué la ségrégation spatiale.
La ségrégation spatiale périurbaine s'explique par la recherche par certains ménages d'aménités rurales ou agricoles. Même si les agriculteurs sont critiqués pour les nuisances qu'engendrent leurs activités (odeurs, pollutions, bâtiments disgracieux, etc.), ils entretiennent et gèrent l'espace, qui est ouvert à la promenade, offre des paysages agréables et donne une image de nature ou de ruralité qui plaît aux Français, ce que montrent des enquêtes sur ce thème. C'est là un cadre de vie dont ils apprécient le calme, l'air pur, la vue, la proximité de champs ou de prés, etc. Lorsqu'elles ont pu se motoriser, les fractions supérieures des classes laborieuses (techniciens, ouvriers qualifiés, employés, etc.) sont allées à la recherche de ces aménités dans les couronnes périurbaines, ce qui leur a aussi permis d'assouvir le vieux désir d'accéder à la propriété. Ceux qui n'en avaient pas les moyens (chômeurs, immigrés, pauvres, etc.) sont restés sur place, comme scotchés dans ce qui était les « riantes banlieues » des années 1960 (pensons à Le Corbusier, aux villes nouvelles, etc.), qui sont devenues des « quartiers à problème » après que ce tri spatial les eut vidées de leur mixité sociale.
Le monde réel n'est donc pas la vaste plaine homogène de la théorie économique. En le revisitant on trouve, par exemple à Paris, New-York ou Boston des centres-villes avec beaucoup d'aménités, historiques (monuments, musées, etc.) ou « modernes » 24 ( * ) (restaurants, théâtres, etc.), ce qui explique la localisation centrale des riches. Par contre, dans des villes comme Atlanta, Phoenix (ou Bruxelles), il n'y a pas (ou peu) d'aménités des centres villes, d'où une localisation périphérique des riches. Ailleurs encore, les aménités forment un patchwork complexe (Londres), ou bien elles ne sont pas réparties seulement sur un gradient centre-périphérie mais aussi ouest-est (Paris).
i) La poursuite de la périurbanisation des ménages
Pour mesurer les évolutions de la population dans l'espace, le solde migratoire qui mesure l'évolution des entrées et sorties de population, est plus pertinent que le solde naturel. Car le premier résulte d'une décision, celle de migrer quelque part, alors qu'on ne décide pas de là où l'on naît et meurt.
Depuis 1968, pour chaque période inter-censitaire, l'espace périurbain enregistre le plus fort solde migratoire, comme le montre la figure 9. Ce mouvement se poursuit de nos jours : le solde migratoire annuel est de + 0,8 % entre 1999 et 2006 dans les couronnes périurbaines. Ce solde est le même pour l'espace rural, alors que l'on est à 0 % dans les pôles urbains. Cette attractivité des campagnes est partagée dans les autres pays développés. Le mouvement est né aux Etats-Unis après la Seconde guerre mondiale, il a ensuite atteint l'Europe du Nord puis s'est répandu vers le Sud. Dans le cas de la France, la région parisienne a été pionnière - dès le milieu des années 1960 - puis l'ensemble du pays a été touché à partir du milieu des années 1970.
Solde migratoire annuel intercensitaire (figure 9)
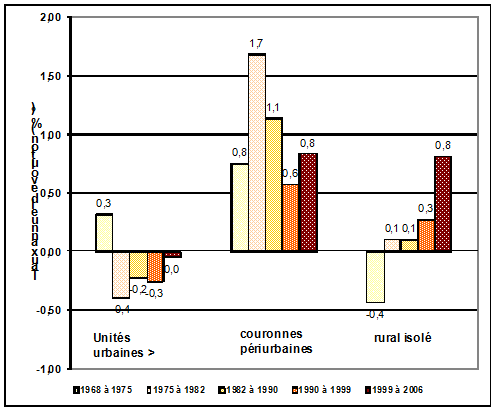
Source : recensements de la population. Découpage en aires urbaines 1996.
Les raisons de ces migrations vers la périphérie des villes sont celles que nous a indiqué la théorie : baisse des coûts de transport et progression de la motorisation des ménages, augmentation du revenu qui se traduit par une demande accrue de logement et d'espace résidentiel, recherche d'aménités du cadre de vie et rejet de nuisances urbaines, tout en ne s'éloignant pas trop des emplois, exigence d'autant mieux satisfaite que, comme nous l'avons vu, les emplois migrent eux aussi vers les banlieues et les couronnes périurbaines.
Depuis une vingtaine d'années, les migrations vers l'espace périurbain, surtout proche de villes, concernent davantage les classes moyennes ou aisées, alors que les classes populaires sont reléguées dans certaines banlieues urbaines ou dans des couronnes périurbaines éloignées, où le sol est moins cher mais qui demandent de longs trajets domicile-travail.
j) L'exemple de la métropole toulousaine : banlieue et périurbain s'enrichissent
Un nouveau zoom sur la région de Toulouse permet d'illustrer la répartition dans l'espace des groupes sociaux. Parmi les indicateurs possibles, nous privilégions celui du revenu imposable moyen des foyers fiscaux (qui sont plus petits que les ménages, grosso modo dans la proportion 1/1,2) 25 ( * ) . Nous avons calculé le revenu fiscal par tranche de distance routière entre une commune et la place du Capitole (avec un pas de 2,5 km) jusqu'à 65 km de celle-ci. La figure 10 renseigne ce revenu en 1984 et 2009 en termes relatifs, c'est-à-dire en le rapportant au revenu moyen de la région.
On note, tout d'abord, la forme en cloche de la répartition : le revenu du foyer fiscal moyen est inférieur dans la commune de Toulouse à celui du foyer fiscal moyen de la région, il est supérieur à celui-ci dans les communes de banlieue et dans les communes périurbaines proches (jusqu'à 20-25 km) et à nouveau inférieur dans celles qui sont au-delà de cette distance, tout comme dans les communes isolées se trouvant dans le cercle des 65 kilomètres de Toulouse. Remarquons, ensuite, que la situation relative de la ville de Toulouse s'est dégradée entre 1984 et 2009, alors que celle des communes périurbaines s'est améliorée, quelle que soit la tranche de distance à la métropole. Situées entre les deux, les communes de la banlieue toulousaine ont maintenu à peu près à l'identique leur position relative. Les communes rurales isolées connaissent un déficit de revenu de près de 30 % par rapport à la moyenne régionale.
Revenu fiscal par ménage en 1984 et 2009.
Région de Toulouse
(figure 10)
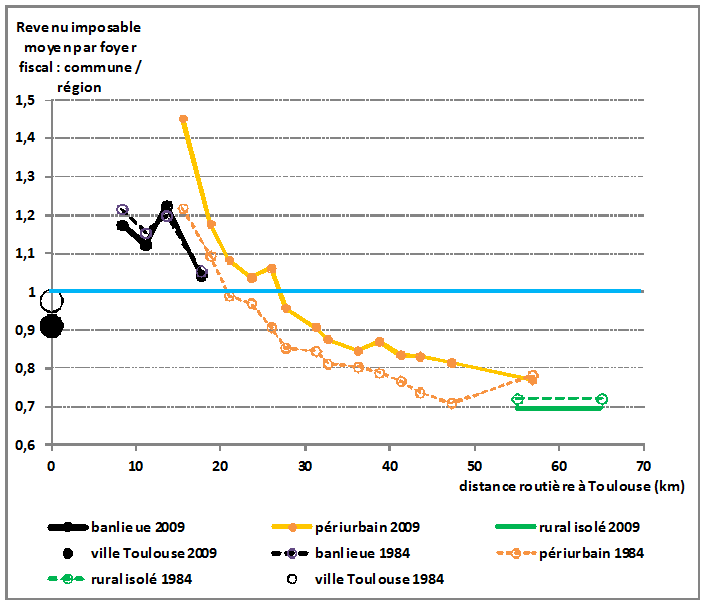
Source : Insee-DGI, Revenus fiscaux des ménages
En 2009, le revenu fiscal moyen dans Toulouse est inférieur de 9 % au revenu fiscal moyen régional. C'est un écart important compte tenu du coût de la vie élevé de la métropole, en particulier du coût du logement. De plus, Toulouse est l'une des plus grandes communes urbaines de France, qui compte des quartiers périphériques où vit une population laborieuse ou pauvre (exemple : Le Mirail). La situation des ménages dans ces quartiers est évidemment plus dégradée que ne le suggère la valeur moyenne de - 9 % 26 ( * ) . A l'inverse, les communes rurales hors influence des pôles, où le revenu est de 30 % inférieur à la moyenne régionale, bénéficient de logements peu chers, parfois d'un approvisionnement à partir d'un potager ou de l'élevage de petits animaux, ce qui vient atténuer le poids de leur pauvreté relative. Les statistiques « sèches » de la figure 9 sont donc insuffisantes pour rendre compte des difficultés (parfois des drames) des uns et des facilités (parfois de l'opulence) des autres. Elles retracent des écarts statistiques et des évolutions depuis un quart de siècle sur un gradient allant de l'urbain au rural dans une vision très stylisée, comme un squelette qui serait dépouillé de sa chair. La situation pour l'ensemble du pays va permettre de confirmer, mais aussi de nuancer, ce cas particulier de la région toulousaine.
k) En France, les couronnes périurbaines, parisienne exceptée, s'enrichissent
La figure 11 montre la situation relative du revenu des foyers fiscaux en 1984 et en 2009 dans différents types d'espaces par rapport à la moyenne nationale. Les tranches de taille d'aires urbaines sont moins détaillées que dans les figures précédentes car nous voulons mettre en relief la situation des types d'espace à l'intérieur des aires urbaines : commune centre (figurée en noir), banlieue proche ou lointaine (gris) et périurbain (orange), également selon sa proximité et enfin rural (vert). La situation en 1984 est indiquée par des bâtons évidés, cette en 2009 par des bâtons pleins, ce qui permet de voir l'évolution entre les deux dates.
Revenu relatif par foyer fiscal en 1984 et en
2009
(figure 11)
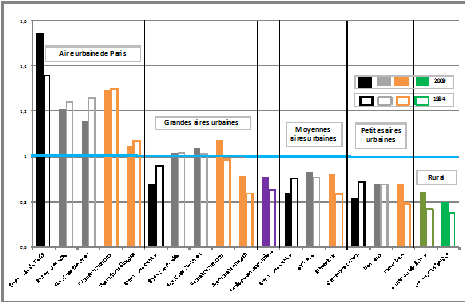
Source : Insee-DGI, Revenus fiscaux des ménages
Notons, tout d'abord, que le revenu moyen d'un foyer fiscal de l'aire urbaine de Paris est supérieur à la moyenne nationale en 1984 et 2009, pour tous les types d'espaces de cette aire urbaine. Le revenu est toujours inférieur à la valeur nationale dans les aires urbaines moyennes et petites, de même que dans les régions rurales. Clairement, le revenu relatif diminue lorsqu'on descend dans la hiérarchie urbaine. Cette allure générale de l'histogramme, descendant en allant de la gauche vers la droite de la figure, est suffisamment connue pour qu'il soit inutile d'insister davantage. La situation des différentes zones à l'intérieur d'une aire urbaine est peut-être plus riche d'enseignements nouveaux.
Dans l'aire urbaine Paris, tout d'abord, le revenu moyen des foyers fiscaux parisiens dépasse de beaucoup la valeur nationale et l'écart s'est accru depuis 25 ans : Paris était à l'indice 136 en 1984 (pour une valeur nationale de 100) et passe à l'indice 154 (la valeur nationale de 100 étant évidemment différente de la précédente). Un foyer fiscal habitant Paris avait donc un revenu d'un tiers supérieur à son homologue national en 1984 et il s'est enrichi en termes relatifs, au point d'avoir en 2009 un revenu qui dépasse de moitié celui d'un foyer fiscal du pays. Est-il plus riche pour autant ? Il faudrait pour répondre à la question tenir compte du coût de la vie dans la capitale. On sait, en particulier, que le prix d'achat des logements, déflaté par le revenu des ménages, a été multiplié par trois durant cette période 27 ( * ) . Mais, heureusement pour les locataires, les loyers ont augmenté beaucoup moins vite. Ici aussi, il faudrait enrober le squelette des chiffres secs que nous donnons par la chair qu'apporte le vécu du coût de la vie, ce qui relève d'une autre analyse.
La figure 11 montre également que les communes de la banlieue parisienne se situent nettement au dessous de la capitale, quoique restant en moyenne bien au-dessus de la valeur nationale, et qu'elles se sont appauvries en termes relatifs entre 1984 et 2009. Cette situation d'ensemble des communes de la banlieue parisienne masque, à l'évidence, d'énormes disparités entre les communes, analysées dans d'autres travaux mais qui ne sont pas le centre d'intérêt de cet article : nous cherchons ici à mettre en relief les écarts et les évolutions entre les grandes catégories d'espaces du pays, à petite échelle. Enfin, pour terminer ce rapide aperçu de la situation de l'aire urbaine parisienne, il faut également relever une légère dégradation depuis un quart de siècle du revenu relatif de l'espace périurbain.
Le tableau d'ensemble en province est très différent. Les communes centres des aires urbaines se situent au-dessous de la valeur des banlieues et des couronnes périurbaines appartenant à la même tranche de taille d'aire urbaine. De plus, la situation de ces communes centres s'est dégradée depuis 1984, alors qu'elle s'est améliorée dans les communes de banlieue, et plus encore dans les couronnes périurbaines. C'est ainsi que dans les grandes aires urbaines, les communes centres sont passées de l'indice 96 en 1984 à l'indice 88 en 2009 alors que, dans le même temps, les communes périurbaines montaient de l'indice 99 à 107 (périurbain proche) ou de 84 à 91 (périurbain lointain). Entre commune centre et couronne périurbaine, les communes de banlieue se situent à des niveaux proches de la moyenne nationale et assez stables au cours du temps.
Ce sont des évolutions comparables qui se sont produites dans les aires urbaines moyennes et petites : les communes centres ont perdu la suprématie dont elles bénéficiaient en 1984, pour se trouver en 2009 dans une position relative moins favorable que les communes de banlieue et périurbaines, qui ont progressé durant la période. Les communes centres se trouvent en 2009 à des valeurs d'indice autour de 82 alors que les banlieues et les communes périurbaines sont autour de 90. Les communes rurales isolées ou multipolarisées se situent en dessous de ces valeurs, mais leur position relative s'est améliorée depuis 1984.
En résumé, les villes centres s'appauvrissent, sauf Paris ; les couronnes périurbaines s'enrichissent, sauf dans l'aire urbaine de Paris, de même que s'enrichit l'espace rural hors influence de pôles. Les banlieues sont dans des situations intermédiaires. Il ne s'agit là que de grandes tendances qui, il faut le rappeler à nouveau, se dégagent à l'échelle du territoire national sans permettre de montrer l'hétérogénéité qui s'observerait à plus grande échelle. De plus, ces données, pour importantes qu'elles soient, ne sont qu'un constat. Elles appelleraient, d'une part, des approfondissements statistiques 28 ( * ) . Il faudrait aussi, d'autre part, aller plus loin que le simple constat en développant une analyse explicative. Mais de tels prolongements dépasseraient le cadre de cet article.
l) Conclusion
A petite échelle, c'est-à-dire à l'échelle de la France entière, retenons la cohérence entre la localisation des emplois et celle des ménages, ainsi que celle de leurs évolutions. Les dix plus grandes aires métropolitaines de province, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse, sont les gagnantes en termes d'emplois, y compris d'emplois stratégiques de cadres de fonctions métropolitaines. Les aires urbaines de province un peu moins importantes sont dans des positions moins favorables. Par exemple les villes qui entourent Toulouse comme des satellites (Albi, Montauban, Castelsarrasin, Auch, Pamiers, Castres) sont moins dynamiques en termes d'emplois que la métropole toulousaine ; il en est de même au niveau national. Cette croissance inégale est inévitable. Les rendements croissants impliquent que l'ensemble du territoire national ne participe pas de la même manière au développement économique. Le capital humain ayant une forte tendance à se concentrer spatialement, les écarts entre territoires sont inévitables.
D'un côté, cet essor des grandes métropoles est bénéfique. Les grandes métropoles sont plus productives que les villes moyennes ou petites du fait d'économies d'échelle et d'agglomération. Leur ambition `millionnaire' (en termes de population), lorsqu'elle n'est pas déjà atteinte, est légitime. Le capital humain y est plus dense, les interactions entre activités productives plus intenses, l'innovation plus développée. Elles sont le creuset de la croissance économique et de la création d'emplois. Le mouvement de concentration métropolitaine est donc bénéfique. Il doit être encouragé, car la théorie économique montre qu'il est spontanément trop faible : les entrepreneurs, dans leur choix privé de localisation, ne tiennent pas pleinement compte des bénéfices sociaux de la concentration. Pour corriger ce dysfonctionnement des marchés, les politiques publiques doivent aider davantage les métropoles qui réussissent, pour le bien du pays dans son ensemble.
D'un autre côté, la croissance des métropoles est source de handicaps, parmi lesquels des coûts urbains considérables (coûts fonciers, coûts de déplacement, nuisances urbaines). Paris, qui ne connaît pas le même dynamisme que les dix métropoles de province précédemment énumérées, est peut-être victime de ces coûts, plus difficiles à supporter eu égard à sa taille. La théorie économique enseigne qu'un remède pourrait être une structure urbaine polycentrique, dans laquelle des villes satellites profiteraient des atouts d'une métropole sans avoir à supporter des coûts urbains aussi élevés. Mais ce n'est pas dans ce sens que s'oriente l'armature urbaine française : au contraire, nous venons de le dire, elle évolue vers plus de monocentrisme, bénéficiant davantage aux `soleils' des principales métropoles qu'aux `étoiles' satellites qui les entourent.
C'est une autre voie qui est suivie par le système productif en France : la périurbanisation des emplois est le palliatif permettant d'éviter des coûts urbains qui sont des freins à la compétitivité. Les emplois dans leur ensemble, comme ceux des fonctions métropolitaines stratégiques, se développent plus dans les banlieues et les couronnes périurbaines que dans les villes centres. Ce `dynamique périphérique' tient à des migrations de firmes qui quittent les villes centres, et/ou à un meilleur dynamisme des firmes déjà présentes dans ces périphéries, et/où à une plus grande natalité, ou une moindre mortalité des firmes qui y sont présentes. Quoiqu'il en soit des mécanismes sous-jacents à cette démographie des entreprises, elles trouvent dans ces localisations périphériques un milieu économique favorable : coûts urbains moins élevés et avantages métropolitains à portée de main.
Ce mouvement de périurbanisation des entreprises accompagne le mouvement de périurbanisation de la population qui perdure depuis plus de 40 ans. Celui-ci, suffisamment connu pour qu'il soit inutile d'insister, présente des caractéristiques sociales nouvelles. Depuis 25 ans, les ménages aisés représentent une part croissance de la population des banlieues et des couronnes périurbaines proches, qui connaissent un enrichissement relatif, et où les emplois de cadres des fonctions métropolitaines augmentent plus qu'ailleurs. Inversement, les classes populaires progressent dans les villes-centres des aires urbaines, où les emplois reculent, où chômage augmente, et qui connaissent un appauvrissement relatif. A l'échelle du pays dans son entier, les dix plus grandes métropoles de province trustent les gains d'emplois, en particulier dans les professions d'importance stratégique pour la croissance économique. Les espaces périurbains profitent de flux migratoires et s'enrichissent au détriment des villes centres qui s'appauvrissent (sauf en région parisienne, où c'est l'inverse).
Cependant, il ne s'agit là que d'une vision schématique, à la petite échelle du territoire national. Elle ne tient pas compte du patchwork de la réalité géographique ni des différenciations intra-urbaines, qui se sont accentuées lorsqu'on examine le territoire à une plus grande échelle 29 ( * ) , ce qui conduit parfois à un appauvrissement absolu de certaines zones, véritables « trappes à chômage ». A l'échelle des quartiers, l'inégalité socio-spatiale a progressé plus encore, bien que nous n'ayons pas ici, faute de place, analysé ce niveau territorial. En suivant les propositions de J. Cavailhès et J.-F. Thisse 30 ( * ) , ce sont ici d'autres politiques correctrices qui sont nécessaires, favorisant la compétence et la mobilité : « la bonne politique consiste à aider les personnes avant d'aider les territoires (...) [par une] mobilité géographique ascendante, encouragée dans d'autres pays avec des résultats positifs. Au lieu de politiques, par ailleurs peu efficaces, donnant des incitations financières aux entreprises pour qu'elles s'installent dans les zones franches urbaines (ZFU), des politiques donnant des incitations financières aux chômeurs des ZFU pour qu'ils aillent vers les emplois sont nécessaires ».
L'aide à la concentration métropolitaine à une échelle macro-spatiale et l'aide à la mobilité sociale ascendante à une échelle micro-spatiale nécessitent donc un pilotage fin des politiques publiques, à l'échelle du pays et à celle des petits territoires.
3. Classes
populaires périurbaines : au-delà du déclassement,
quelles trajectoires résidentielles et
professionnelles ?
Violaine Girard
(Université de Rouen)
Les élections présidentielles de 2012 ont donné lieu à une large mobilisation, dans la presse, de la figure des habitants du périurbain. Ceux-ci y ont alors été décrits comme des ménages « modestes » qui, pour quitter la banlieue et son cortège de « difficultés » sociales, n'auraient eu d'autre choix que de s'installer à distance des centres villes. Ainsi « relégués » dans les espaces périurbains, ils seraient en proie à de nombreuses « frustrations sociales » et victimes d'un « rêve pavillonnaire » qui « tourne mal », du fait d'efforts conséquents menés pour accéder à la propriété.
C'est donc principalement au travers du schème du déclassement que sont abordés leurs parcours. Ce diagnostic est pourtant largement incomplet. Il masque bien d'autres évolutions sociales qui affectent les classes populaires installées depuis les années 1970 et 1980 dans les espaces périurbains. Il amène en particulier à oublier que certaines fractions populaires connaissent, depuis les années 1970, des perspectives d'ascension sociale, certes relativement restreintes mais bien réelles. Cette contribution propose de revenir sur les trajectoires des ouvriers et employés du périurbain, en faisant le lien avec les transformations de l'emploi industriel qui se jouent à la périphérie des grandes villes.
Loin de s'expliquer uniquement par les « choix » résidentiels des ménages fuyant les quartiers d'habitat social, la périurbanisation apparaît en effet dans bien des cas fortement déterminée par les recompositions de l'emploi industriel. Car s'il y a bien crise et restructurations des anciennes grandes régions industrielles, les espaces périurbains accueillent depuis les années 1980 de nombreuses zones d'activité en développement. Ces zones, pourvoyeuses d'emplois, favorisent l'installation des ménages ouvriers dans les territoires périurbains, un fait qui demeure pourtant largement non questionné dans les médias. Alors qu'une part croissante des salariés travaille aujourd'hui en dehors des anciens grands centres de production, et de plus en plus souvent dans le secteur des services (logistique, transport, maintenance industrielle, etc.), ces recompositions de l'emploi jouent un rôle majeur pour les trajectoires des ménages populaires du périurbain.
a) Périurbanisation des emplois et accession populaire à la propriété
Les territoires périurbains accueillent, depuis les années 1980, de nombreux emplois, et cette dynamique s'accélère depuis les années 1990 : tous secteurs d'activité confondus, ce sont près de « quatre emplois supplémentaires sur 10 [qui sont localisés] dans le périurbain entre 1999 et 2007 » 31 ( * ) . C'est en particulier dans les communes périurbaines que la progression de l'emploi industriel est la plus forte : celui-ci y croît de 5 % entre 1990 et 1999, alors qu'il connaît une chute de 16 % dans les pôles urbains. Et si les emplois industriels demeurent principalement localisés dans les pôles urbains (63 % en 1999 contre 12 % dans les espaces périurbains), ils restent moins concentrés dans les centres urbains que l'ensemble des emplois tous secteurs confondus (Gaigné et al., 2005, p. 7). Selon l'économiste Frédéric Lainé (2000), on assiste en effet à la « décentralisation à la périphérie des activités productives (IAA, industrie, transports et manutention de marchandises, commerce de gros, construction) et [dans une moindre mesure, au] développement des activités de services à la population ». Or ces moyennes, calculées à partir de la seule catégorie du périurbain, qui englobe des territoires résidentiels aussi bien qu'industriels, masquent le développement de concentrations plus marquées des emplois. La relocalisation de nombre d'activités productives ou de service se joue en effet au sein des nombreuses zones d'activité économique implantées depuis les années 1980 dans des territoires excentrés, où le foncier est moins cher que dans les agglomérations. La création de ces nouvelles zones d'activité a également été encouragée par le développement des structures intercommunales à fiscalité propre, pour lesquelles l'exercice de la compétence développement économique est une obligation statutaire.
Les politiques de développement local jouent ainsi un rôle central dans le devenir des territoires périurbains : elles contribuent en premier lieu à favoriser l'installation des ménages d'ouvriers et d'employés à proximité de ces pôles d'emploi. D'autres facteurs concourent bien sûr également à cette dynamique : la hausse des prix de l'immobilier dans les centres villes, ainsi que les politiques étatiques de soutien à l'accession à la propriété, qui ont joué leur plein effet au cours des années 1980, en permettant à de nombreux ménages ouvriers de se lancer dans l'achat d'un pavillon. L'installation de nombreux ménages populaires dans le périurbain apparaît ainsi comme le produit de ces politiques et de leurs effets conjugués. Selon les chiffres du recensement de 2008, la part des deux catégories socioprofessionnelles des ouvriers et des employés parmi les actifs s'élève à 54 % dans les communes périurbaines contre 51 % dans les pôles urbains. Près d'un quart des ouvriers (22 %) réside dans ces territoires, quant à l'inverse, seuls 15 % des cadres y vivent 32 ( * ) .
Les territoires périurbains constituent-ils encore des espaces prisés par les classes moyennes, ou bien doit-on au contraire les envisager comme les « nouveaux » espaces de relégation des classes populaires ? Ces évolutions sont sans doute plus complexes et demeurent diversifiées, comme le montre le travail statistique de Jean Rivière (2011). Ces chiffres se réfèrent en effet, là encore, à un zonage rassemblant sous la seule catégorie « du » périurbain des espaces fortement différenciés : certains territoires périurbains sont caractérisés par une prédominance beaucoup plus marquée des catégories populaires, notamment dans les franges les plus éloignées des agglomérations, où la catégorie des ouvriers qualifiés est surreprésentée (Cavaillès et Selod, 2003). La diffusion de la propriété pavillonnaire parmi de larges fractions des classes populaires ne signifie en effet pas, loin de là, la disparition des clivages sociaux et résidentiels distinguant ces ménages de ceux des classes moyennes ou supérieures : les conditions d'accession des premiers restent notamment soumises à d'importantes contraintes financières.
Pour autant, et c'est ce que nous souhaitons souligner maintenant, on ne peut conclure, sur la base de ces seuls constats, au déclassement ou à la relégation des ménages populaires dans les espaces périurbains éloignés. L'étude des formes d'emploi et des trajectoires professionnelles de ces ménages donne en effet à voir une réalité autrement plus complexe.
b) Les réorganisations de l'emploi industriel : des effets ambivalents
Si les effets de la désindustrialisation des grands centres de production ont fait et font encore l'objet d'une importante médiatisation, les transformations qui accompagnent le développement des zones d'activité périurbaines restent beaucoup moins connues. Or ces zones sont elles aussi soumises au mouvement plus général de restructuration des activités industrielles : on y assiste ainsi à « l'éclatement des formes d'organisation du monde du travail actuel autour de pôles diversifiés » (Noiriel, 2002, p. 261).
C'est en particulier le cas dans le territoire que nous avons étudié, la Riboire, situé à 40 km d'une grande agglomération régionale : depuis 1982, un parc industriel s'y développe, et rassemble aujourd'hui plus de 3 700 emplois en CDI auxquels il faut ajouter de 1 000 à 2 000 emplois temporaires selon les périodes. Ces emplois sont répartis sur une centaine d'établissements, allant des grands groupes aux PME sous-traitantes, dans des secteurs d'activité divers (production automatisée, chimie, logistique, maintenance, agro-alimentaire). Deux processus caractérisent ainsi le bassin d'emploi de la Riboire : l'éclatement des emplois au sein de très nombreuses entreprises, ainsi que la segmentation croissante des statuts d'emploi, entre CDI, CDD, intérim et temps partiels. Ces processus reflètent la tendance structurelle à la diminution de la part des gros établissements dans l'emploi industriel 33 ( * ) , une tendance qui s'accompagne d'un contrôle accru exercé par les grands groupes sur les PME sous-traitantes. Ils traduisent également la diffusion des formes d'emploi dites « atypiques » parce que liées à des contrats précaires. On est donc bien loin de l'image des mono-industries locales employant largement la population du territoire environnant.
Or ces évolutions, très souvent oubliées lorsqu'il s'agit de décrire la situation des classes populaires du périurbain, ne sont bien sûr pas sans conséquences pour les ménages qui travaillent dans ces zones d'emploi. Elles entraînent en particulier des parcours professionnels heurtés pour de nombreux ouvriers ou employés. Mais elles se caractérisent aussi par un dernier type de changement, qui concerne les qualifications des salariés. On aurait en effet tort de lire les évolutions de l'emploi industriel uniquement sous l'angle de la précarisation des statuts d'emploi. Car si ces restructurations contribuent à la déstabilisation des emplois d'exécution, elles se sont aussi accompagnées d'un mouvement de hausse des qualifications. Si l'on y regarde de plus près, c'est principalement l'effectif des ouvriers non qualifiés qui a connu un net recul en France, passant de 2,5 à 1,1 million du début des années 1980 à la fin des années 1990 (Vigna, 2012, p. 229), alors que le nombre des techniciens et des agents de maîtrise a à l'inverse progressé de façon continue, de 1,2 à 1,6 million de salariés de 1982 à 2005 (soit 4,7 puis 5,9 % des actifs occupés) (Bosc, 2008, p. 24). Dans le cas de la Riboire, les postes d'ouvriers prédominent largement : ceux-ci rassemblent pas moins de 40 % du total des emplois implantés localement, dont un peu plus de la moitié d'emplois d'ouvriers qualifiés (21 % de l'emploi total). On donnerait toutefois une vision tronquée de la structuration de ce bassin d'emploi si l'on omettait les postes de contremaîtres et de techniciens, qui représentent respectivement 12 % et 7 % des emplois 34 ( * ) . Au final, la part des emplois d'intermédiaires est donc aussi importante que celle des emplois d'ouvriers non-qualifiés (19 %).
C'est donc l'ensemble de ces recompositions de l'emploi qu'il faut prendre en compte si l'on souhaite analyser les parcours professionnels des ouvriers du périurbain : ceux qui résident dans la Riboire travaillent dans un bassin d'emploi ayant connu des réorganisations massives, mais ils bénéficient de la croissance économique locale qui leur permet d'échapper aux périodes d'inactivité, comme en témoigne le taux de chômage resté relativement faible dans le canton (8,6 % en 2009). Et parmi les plus qualifiés, la part de ceux qui voient s'ouvrir des possibilités de progression de carrière est loin d'être négligeable. De façon plus générale, « la «filière technique» de promotion (par l'accès à des postes d'ouvriers qualifiés ou de contremaîtres et techniciens) continue [en effet] d'occuper [en France] un rôle notable dans les trajectoires de mobilité masculine » (Monso, 2006).
On retrouve là encore ces évolutions de façon concrète dans le canton périurbain que nous avons étudié. La prédominance des catégories populaires y ressort de façon très marquée si l'on tient compte d'une structure d'emploi fortement clivée selon le sexe. Du côté des femmes, les employées et ouvrières représentent respectivement 44 % et 17 % des actives ayant un emploi en 2008 (contre 47,3 % et 8,9 % en France 35 ( * ) ). Mais c'est principalement la surreprésentation des ouvriers chez les hommes qui apparaît comme une caractéristique marquante du canton : 45 % des actifs sont ouvriers en 2008 (contre 34,8 % en moyenne en France). Ce poids important des ouvriers renvoie en grande partie au maintien d'un nombre élevé d'emplois qualifiés : alors que la part des ouvriers non-qualifiés est en baisse (de 23 % en 1982 à 18 % en 1999), celle des ouvriers qualifiés reste stable sur cette période (30 %). Dans le même temps, la part des techniciens et agents de maîtrise a plus que doublé, passant de 8,5 % des actifs en 1982 à près de 18 % en 1999 36 ( * ) . Or, nombre de ces salariés intermédiaires de l'industrie sont d'anciens ouvriers ayant accédé, en cours ou en fin de carrière, à des postes plus qualifiés.
Les recompositions de l'emploi industriel ont donc des conséquences foncièrement ambivalentes, dans le périurbain comme ailleurs : si les fractions peu ou pas qualifiées des classes populaires sont durement soumises à la précarisation de l'emploi, les salariés qui sont dotés de qualifications techniques parviennent, pour certains, à accéder à des emplois stables, et, pour d'autres, à se projeter dans des parcours de promotion professionnelle par l'accès à la maîtrise. Et ce sont précisément ces parcours qui autorisent de nombreux ménages ouvriers à se lancer dans l'accession à la propriété individuelle.
c) Aspirer à la promotion sociale, se distinguer des ménages précarisés : des appartenances sociales en recomposition
À l'image de bien d'autres territoires périurbains, la Riboire constitue un espace d'accession à la propriété privilégié pour certaines fractions des classes populaires : les ménages qui y font construire des pavillons sont le plus souvent composés d'ouvriers et d'employées ayant accédé à des emplois stables et disposant de revenus salariaux réguliers leur permettant de s'engager dans l'accès à la propriété. Sur le plan des statuts socioprofessionnels, ils sont, pour une large part, relativement protégés par leurs qualifications. Ils appartiennent ainsi aux fractions des classes populaires que l'on peut qualifier de « subalternes mais non démunies » (Schwartz, 1998, p. 41), une expression qui permet de souligner que s'ils occupent des positions professionnelles subordonnées, ils ne sont pas toujours soumis à la précarité et accèdent au contraire, pour certains, à des postes qualifiés au cours de leur carrière. Cette stabilité professionnelle relative se traduit par des acquis économiques et patrimoniaux, comme en atteste la propriété d'occupation du logement.
C'est le cas d'un couple auprès duquel nous avons enquêté. Après un apprentissage de métallier, Michel, né au début des années 1950, a travaillé dans de nombreuses entreprises, chez un fournisseur de matériel de peinture industrielle, dans la carrosserie des poids lourds. Il est ensuite embauché dans une société de maintenance d'ascenseur et y accède, à la cinquantaine, à un poste de responsable qualité sûreté. Michel a en effet pris les devants, comme il le dit, lorsque les entreprises où il travaillait « battaient de l'aile », pour échapper au chômage et finalement connaître une progression de carrière dans la dernière société où il travaille. Avec sa femme Valérie, ils font construire à la fin des années 1980 dans la Riboire, où un promoteur les oriente, du fait du niveau resté relativement bas des prix des terrains, par rapport à la première couronne périurbaine. Ce parcours d'accession est rendu possible par la stabilité professionnelle de Valérie, qui est secrétaire de direction dans la même entreprise depuis son entrée dans la vie active. Cet exemple illustre bien les trajectoires d'un grand nombre des ménages populaires que nous avons rencontrés : la stabilité de l'insertion professionnelle des femmes apparaît en effet déterminante pour l'obtention des prêts immobiliers. À l'inverse, lorsque les femmes sont peu qualifiées, qu'elles travaillent dans les services à la personne ou comme préparatrices de commande dans la logistique par exemple, les ménages populaires ne parviennent bien souvent pas à devenir propriétaires. Enfin, cet exemple montre également que l'installation en pavillon exige un rapport mobilisé au travail de la part des hommes, à la fois pour se maintenir dans l'emploi, au prix parfois de nombreuses reconversions, mais aussi pour faire valoir leurs qualifications et espérer accéder à des postes d'intermédiaires, plus valorisants et aux salaires plus élevés.
Il faut cependant souligner que les conditions de l'accession se sont durcies au fil des années 1980, 1990 et 2000 : les jeunes ouvriers et employés s'endettent sur de longues périodes, et doivent également s'appuyer sur le soutien de la famille élargie (pour la garde des enfants notamment). Surtout, ils n'ont accès au crédit immobilier que lorsque l'un ou l'une d'entre eux au moins dispose d'un statut professionnel stable. La proximité du parc industriel constitue alors pour ces salariés des classes populaires un important support de stabilisation sociale : comme dans bien d'autres territoires périurbains, les jeunes ouvriers trouvent à s'investir dans les entreprises industrielles ou de service implantées sur ces nouvelles zones d'activité.
On en trouve un autre signe dans le fait que les lycéens de ce territoire sont nombreux à s'orienter vers des formations en alternance : plusieurs des familles auprès desquelles nous avons enquêté privilégient ainsi des voies d'insertion professionnelle dans l'industrie pour leurs enfants. C'est le cas des Clamart, dont le père, chaudronnier soudeur dans la maintenance nucléaire, est devenu chef d'équipe puis responsable des travaux dans une entreprise de sous-traitance de la Riboire. Sa femme, Véronique, a effectué des contrats d'intérim dans le parc industriel, avant d'être embauchée par la municipalité de la commune où la famille réside, pour le service de la cantine. Le fils aîné des Clamart est devenu agent de maîtrise dans l'entreprise où il a suivi un bac pro puis un BTS de maintenance industrielle en alternance. Leur second fils, âgé de 16 ans en 2012 , s'est également engagé dans un bac pro en alternance. Il faut signaler à ce propos que l'emploi public, et notamment celui de la fonction publique d'État, est à l'inverse très peu présent dans les territoires périurbains : le bassin d'emploi de la Riboire compte ainsi le plus faible taux d'emploi public (13 %) dans l'emploi local de sa région, où se taux atteint en moyenne 20 %. Cet état de fait contribue sans nul doute à favoriser, parmi les classes populaires périurbaines, les parcours d'insertion dans l'industrie ou le secteur privé des services. Les trajectoires sociales de ces hommes sont ainsi étroitement déterminées par l'acquisition de qualifications techniques : si ceux-ci restent dépendants des débouchés offerts dans le bassin d'emploi local, ils peuvent aussi, pour les plus diplômés, se projeter dans des carrières stables et ascendantes, à proximité de leur lieu de résidence. Comme on le voit, les évolutions de l'emploi périurbain sont déterminantes pour analyser les trajectoires de ces ménages des fractions supérieures des classes populaires. Or les effets de ces évolutions ne sont ni mécaniques, ni univoques : les recompositions de l'emploi contribuent à la différenciation croissante des parcours des salariés, entre précarisation pour les moins bien dotés et ouverture de voies d'ascension « modestes » pour d'autres.
Pour terminer, il faut dire quelques mots de la manière dont se définissent les appartenances sociales de ces ménages. Leur installation dans la Riboire est tout d'abord bien loin d'être vécue comme une relégation. Elle constitue au contraire un signe de promotion sociale, surtout pour ceux qui ont quitté les quartiers de la banlieue voisine : ces derniers mettent en avant leur installation dans un espace résidentiel pavillonnaire, par opposition à la dévalorisation qui pèse sur le logement social. S'il y a donc une transformation à rechercher dans la façon dont ces ménages se situent socialement, elle ne réside pas dans une dévalorisation univoque de leurs positions. Disposant d'acquis économiques leur permettant de devenir propriétaires, ces ménages sont au contraire porteurs d'aspirations à la promotion sociale : ils sont très souvent engagés dans des efforts de distinction vis-à-vis des fractions précarisées des classes populaires, efforts qu'encourage la généralisation des discours politiques stigmatisant les précaires, les chômeurs ou encore les locataires du parc HLM.
Ces ménages occupent ainsi une position d'entre deux : s'ils échappent aux formes les plus dures de précarité, leurs conditions de vie sont toutefois loin de se confondre avec celles des classes moyennes ou supérieures. Leurs trajectoires demeurent le plus souvent éloignées des formes d'ascension sociale, plus valorisées socialement et plus stables à bien des égards, que représentent la poursuite d'études longues, l'entrée dans la fonction publique ou l'accès aux emplois de cadres. Leurs statuts sociaux et professionnels restent en particulier étroitement liés au devenir de l'emploi local. Ancrés du côté du privé et du secteur industriel, ces salariés se sont cependant éloignés de la figure des groupes ouvriers de la grande industrie, soudés autour de la revendication de formes de fierté sociale. Nombre des salariés que nous avons rencontrés aspirent ainsi à sortir « par le haut » de la condition ouvrière. À l'heure où le statut d'ouvrier fait l'objet de disqualifications sociales et politiques récurrentes (Mauger, 2006), les parcours résidentiels jouent alors un rôle croissant pour ces ménages des fractions supérieures des classes populaires : ils constituent un important support de définition de leur appartenance sociale, à distance de l'image dévalorisée des cités.
d) Conclusion
Les trajectoires des classes populaires du périurbain sont donc travaillées par des évolutions bien plus complexes que celles qui nous sont données à voir dans la presse. Des évolutions qu'il faut relier à des processus sociaux plus vastes : restructurations de l'emploi industriel mais aussi politiques du logement et dévalorisation du logement social. Car ce que l'on saisit à partir du cas de la Riboire, semblable à beaucoup d'autres territoires périurbains, ce sont les effets sur le long terme des réorganisations de l'emploi : segmentation des statuts et déstructuration des collectifs de travail conduisent à un affaiblissement des formes d'identification aux lieux de travail, au profit d'un investissement sur la scène résidentielle, où nombre de ménages populaires construisent les signes de leur respectabilité sociale, à distance des quartiers populaires de banlieue.
|
Bibliographie Beaucire F. et Chalonge L. , « L'emploi dans les couronnes périurbaines, de la dépendance à l'interdépendance », in Pumain (D.) et Mattéi (M.-F.) (dir), Données urbaines 6 , Paris, Anthropos, 2011. Bosc S ., Sociologie des classes moyennes , Paris, La Découverte, 2008. Brutel C. et Levy D ., « Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010. 95 % de la population vit sous l'influence des villes », Insee première , n°1374, 2011. Cavaillès J., Selod H ., « Ségrégation sociale et périurbanisation », Recherches en économie et sociologie rurales. INRA Sciences sociales , 1-2 (03), 2003. Gaigné C., Piguet V., Schmitt B ., « Évolution récente de l'emploi industriel dans les territoires ruraux et urbains : une analyse structurelle-géographique sur données françaises », Revue d'Économie Régionale et Urbaine , 1, 2005. Lainé F. , « Péri-urbanisation des activités économiques et mouvements d'emploi des établissements » in Pumain (D.) et Mattéi (M.-F.) (dir), Données urbaines 3 , Paris, Économica, 2000. Mauger G ., « Les transformations des classes populaires en France depuis trente ans », in Lojkine J., Cours-Salies (P.), Vakaloulis (M.), dir., Nouvelles luttes de classes , Paris, Presses Universitaires de France, 2006. Monso O. , « Changer de groupe social en cours de carrière. Davantage de mobilité depuis les années quatre-vingt », INSEE première , 1112, 2006. Noiriel G. , Les Ouvriers dans la société française XIX e -XX e siècle , Paris, Seuil, 1986. Renahy N. , « Les transformations récentes du monde ouvrier », Écoflash , 168, 2002. Rivière J. , « La division sociale des espaces périurbains français et ses effets électoraux », in Pumain D. et Mattéi M.-F. (dir), Données urbaines 6 , Paris, Anthropos, 2011. Vigna X. , Histoire des ouvriers en France au XX e siècle , Paris, Perrin, 2012. |
4. Arrangements de famille en
agriculture : la relative séparation des espaces temps conjugaux et
professionnels37
(
*
)
Céline
Bessière
(Université de Paris Dauphine)
Depuis trente ans, le secteur agricole en France a connu une transformation majeure qui est passée relativement inaperçue : les compagnes d'agriculteurs occupent de plus en plus souvent un emploi salarié en dehors de l'exploitation. En 1970, seulement 7 % des épouses actives déclaraient exercer une activité professionnelle non-agricole ; en 2000, c'était le cas dans 40 % des ménages tous âges confondus et deux tiers des ménages de moins de 35 ans 38 ( * ) . Dans les exploitations professionnelles 39 ( * ) , la tendance est encore plus forte : en 2007, plus d'une conjointe d'exploitant sur deux et trois conjointes de moins de 30 ans sur quatre déclarent une activité en dehors de l'agriculture 40 ( * ) . Cette augmentation s'inscrit dans le cadre plus large du développement du salariat féminin dans les secteurs du tertiaire. De moins en moins souvent issues de familles agricoles 41 ( * ) , les compagnes d'agriculteurs conservent la profession qu'elles exerçaient avant leur mise en couple. De plus, la mécanisation et l'informatisation, l'agrandissement des structures, le développement des formes sociétaire ont permis - du moins dans les secteurs les plus spécialisés de l'agriculture - de se passer de la main d'oeuvre féminine. Le secteur viticole est ainsi l'un des secteurs (avec le maraîchage et la céréaliculture) où l'augmentation de l'emploi des femmes à l'extérieur de l'exploitation a été la plus forte 42 ( * ) .
Dans la région de Cognac, les compagnes des jeunes viticulteurs sont la plupart du temps des employées peu qualifiées (caissières, aides-soignantes, aides à domicile, etc.). Pour les plus diplômées d'entre elles, elles exercent une profession intermédiaire (infirmières, institutrices, etc.) 43 ( * ) . Souvent, elles cumulent des salaires faibles, des conditions d'emploi et des progressions de carrière peu favorables -- contrats à durée déterminée, temps partiel, chômage, alternance entre périodes d'emploi, congés maternité ou parentaux 44 ( * ) . Malgré ces situations professionnelles peu enviables, les jeunes viticulteurs et leurs compagnes promeuvent le « travail à l'extérieur ». Les implications sont profondes.
Le développement du « travail à l'extérieur » reconfigure les rapports entre les hommes et les femmes en couple ainsi que dans la maisonnée exploitante . Le terme maisonnée est emprunté à Florence Weber et Sibylle Gollac. Il désigne une unité de coopération productive réunissant plusieurs personnes plus ou moins apparentées et éventuellement co-résidentes 45 ( * ) . Les maisonnées sont, par définition, des groupes instables dans le temps : ce sont des moments d'organisation pratique de la parenté autour de causes communes 46 ( * ) . Dans le cas des maisonnées exploitantes, la cause commune en question est le maintien de l'exploitation familiale, tout à la fois sur le plan domestique et professionnel. On verra qu'au nom de leur emploi salarié, les compagnes de viticulteurs revendiquent un foyer conjugal plus autonome par rapport à la maisonnée exploitante, et qu'elles y parviennent en partie. A plus long terme, la généralisation du « travail à l'extérieur » rend possible et accompagne le développement de pratiques conjugales inédites dans les familles agricoles : les séparations conjugales. Les tensions entre les aspirations parfois divergentes des hommes et des femmes en couple, et les intérêts de la maisonnée exploitante seront donc au centre de ce texte.
a) La génération des belles-mères : « cent professions » et « femme de »
Dans les années 1960-70, l'idéal modernisateur dominait la politique agricole de la France. Les instances professionnelles agricoles ont cherché à favoriser un renouvellement générationnel sur les exploitations - en favorisant les départs à la retraite des vieux paysans et l'installation des jeunes agriculteurs sur des exploitations qui remplissaient des critères de viabilité économique, définis par la profession 47 ( * ) . La loi d'orientation agricole de 1960 a promu ainsi une structure d'exploitation familiale, en rupture par rapport au modèle pluri-générationnel : « l'exploitation à 2 UTH » (deux unités travail homme), c'est-à-dire le couple. Ce modèle d'exploitation devait permettre aux ménages d'agriculteurs et d'agricultrices d'atteindre la parité sociale et économique avec les autres milieux sociaux (notamment urbains et salariés) sans recours au travail à l'extérieur de l'exploitation. A l'époque, ce qui était visé était moins le travail salarié des femmes - qui demeurait marginal - que la pluriactivité des petits agriculteurs (ouvriers-paysans notamment), considérée alors comme un obstacle à la professionnalisation et la modernisation de l'agriculture 48 ( * ) . Dans cette perspective, le « travail à l'extérieur » des compagnes d'agriculteurs, assimilé à la pluriactivité, était bien peu légitime dans la profession. Synonyme de l'impossibilité de l'activité agricole à faire vivre un ménage, il devait progressivement disparaître.
Cependant, la reconnaissance sociale et juridique du travail des femmes en agriculture est restée au point mort dans les années 1960-1980, ce qui a eu des conséquences variables selon la position sociale des familles exploitantes. La plupart des compagnes de viticulteurs n'avaient pas d'autre choix que de travailler dans l'exploitation, en tant qu'aide familiale. Lors d'un entretien enregistré, Stéphane Dumont, un jeune viticulteur, a décrit à ma demande, la répartition des travaux dans l'exploitation familiale, en présentant d'abord les tâches effectuées par son père et lui-même. J'ai fini par demander ce que faisait sa mère, qui a été longtemps aide familiale sur l'exploitation (depuis son mariage en 1976), jusqu'à la création d'une EARL où elle est devenue co-exploitante, en 1994. La réponse de Stéphane fut éloquente : « Ma mère, elle fait tout ». L'enquêtrice, surprise, a souri. Stéphane a ajouté : « dans tous les domaines. Elle va dans la vigne tirer les bois, relever. Cette année, elle avait commencé à tailler, mais elle ne taille pas beaucoup. Mon père fait les traitements, forcément... Tout ce qui est tracteur, c'est mon père ! Les vendanges, ma mère suivait la machine pour ramasser les raisins qui restaient, signaler s'il y avait un problème à la machine, parce que quand les tapis bloquent, mon père ne l'entend pas devant ». Cet extrait d'entretien montre bien le caractère auxiliaire du travail de Guislaine Dumont et la difficulté de décrire autrement ses activités que par rapport à celles de son mari, auxquelles Stéphane revient toujours. « Cent professions ! » a déclaré devant moi une viticultrice d'une soixantaine d'années pour dire son absence de statut professionnel sur l'exploitation familiale. On ne peut mieux décrire qu'à travers ce jeu de mot le travail polyvalent (« cent professions »), non reconnu statutairement (« sans profession »), qui caractérise la majorité des femmes de cette génération.
Beaucoup plus rares, celles qui travaillaient « à l'extérieur » le faisaient principalement pour des raisons économiques : parce qu'il n'y avait pas assez de travail pour elles sur une exploitation trop petite, ou bien parce que l'exploitation rapportait trop peu. Ni ces femmes, ni leurs époux ne se vantaient de cette situation : « c'était mal vu » disent-ils et disent-elles aujourd'hui. Dans la bourgeoisie viticole, en revanche, c'est le repli sur la scène domestique conjugale qui dominait. En effet, dans les grandes entreprises viticoles qui emploient des salariés, le travail de ces femmes n'était pas aussi indispensable que chez les petits producteurs. La sphère domestique - à condition qu'elle fût soustraite au régime de la maisonnée exploitante et particulièrement au gouvernement des beaux-parents - pouvait constituer un lieu de réalisation de soi pour des femmes qui n'étaient pas reconnues professionnellement ni sur l'exploitation, ni en dehors.
C'est le cas par exemple de Nadine Lacheux que j'ai rencontrée à son domicile : une bâtisse imposante, posée au milieu des vignes. Nadine est une femme âgée d'environ 55 ans, à la silhouette élancée, et qui prend visiblement soin de son apparence. Elle porte les signes discrets de l'habit bourgeois 49 ( * ) : un pantalon cigarette, des mocassins, des bijoux dorés, un visage hâlé et légèrement maquillé, des cheveux mi-longs colorés blond et mis en plis. Dans un long entretien enregistré, Nadine a fait le récit de son entrée dans la famille Lacheux, lorsqu'elle a épousé Bernard, le fils aîné, en 1967. Issue d'une famille d'artistes locaux sans capitaux économiques et diplômée de la Chambre de commerce britannique, on peut dire qu'elle a fait un « beau mariage ». La famille Lacheux possède aujourd'hui un domaine de plus de 70 hectares de vignes, mais est surtout connue pour son activité de bouilleur de profession pour une grande maison de cognac. Au début des années 2000, treize personnes sont employées à temps plein par la société qui est dirigée par Bernard et son frère qui ont pris la suite de leur père, « le patriarche » pour reprendre l'expression de Nadine. Cette dernière affirme n'être jamais parvenue à imposer son envie de travailler, que ce soit à l'intérieur ou en dehors de l'entreprise familiale 50 ( * ) .
Peu après son mariage, elle aurait pu donner des cours d'anglais dans un institut privé de formation professionnelle : « ça a été très mal perçu, j'ai dû dire non » explique-t-elle. Nadine désigne ici l'opposition explicite de son beau-père : « votre mari ne gagnerait pas assez pour vous ! » lui a-t-il dit. Nadine n'avait pas les ressources pour contourner l'avis défavorable de son beau-père, et encore moins pour se passer de l'absence de soutien de son mari (« Je pense que mon mari ne m'a pas assez poussée, il fallait qu'on me pousse un peu ; mais à la campagne, on ne travaillait pas, ça ne se faisait pas »).
Nadine a cherché aussi, en vain, une forme de reconnaissance professionnelle dans l'entreprise familiale. Elle regrette que sa belle-famille - incarnée surtout par le « patriarche » - n'ait pas reconnu, ni utilisé ses compétences (« je parlais couramment anglais à l'époque, j'aurais aimé faire quelque chose, j'aimais bien les relations publiques, j'aimais bien voir les gens »). Au début de son mariage, elle n'était pas à l'aise à la distillerie où elle venait donner des coups de main et se sentait surtout « inutile » : « je sentais au regard de mon cher et tendre que je n'étais pas la bienvenue ». Au fil des années, elle a complètement cessé de s'y rendre : « on ne le souhaitait pas, je n'étais pas souhaitée. Je n'y vais jamais, très rarement. Parce que là, je viens, je me sens comme un cheveu sur la soupe ». Aujourd'hui, elle dit avoir cessé de « faire la guerre » pour imposer ses compétences dans l'entreprise. Elle prend désormais acte de sa dépendance matérielle vis-à-vis de ce qu'elle nomme « les Lacheux » et pour ne pas perdre la face, elle entérine son exclusion des affaires de l'entreprise en s'impliquant le moins possible (« je m'en suis exclue moi-même de ce clan »). Partagée entre révolte et résignation, Nadine décrit de façon amère le décalage entre ses aspirations à être reconnue pour elle-même et la place de « femme de » qui lui est imposée dans la famille Lacheux.
Faute de reconnaissance sur la scène professionnelle, elle en vient à investir pour elle-même, comme lieu de réalisation de soi, la scène domestique qu'on lui a assignée : « [Pour] le grand-père, une femme, c'est à ses casseroles ! Odieux, épouvantable, horrible ! », dit-elle. Dans la famille Lacheux, qui possède un important patrimoine immobilier, les couples mariés vivent dans des résidences séparées : le « patriarche » et sa femme sur le siège de l'exploitation ; leurs descendants dans un rayon de cinq kilomètres autour de la « maison-mère ». Certes, Nadine n'a jamais vécu sous le même toit que les parents de Bernard, mais sa conquête d'autonomie sur la scène résidentielle n'a pas été évidente à imposer pour autant. La grande maison où elle vit appartient « aux Lacheux ». Pendant longtemps, son beau-père y entrait sans prévenir, ni frapper : « grand-père venait, rentrait facilement comme dans un moulin. Après on lui a montré qu'on avait une sonnette à la porte » raconte-t-elle. Mais Nadine n'avait pas non plus d'autonomie financière par rapport à son mari pour aménager sa résidence à sa guise : « J'ai bien mis 15 ans, oui... 12, 14 ans à pouvoir commencer à démarrer, modestement les travaux dans la maison et imposer ma patte un peu ». Cette conquête d'un territoire conjugal et personnel ne s'est pas déroulée sans heurts, ni désillusions. L'appropriation de l'espace domestique comme territoire de soi est pour elle une appropriation « faute de mieux », notamment faute d'une reconnaissance personnelle satisfaisante sur une scène professionnelle.
Ces différents destins de conjointes de viticulteurs - d'aide familiale « cent professions » à « femme de » cantonnée à la sphère domestique - constituent aujourd'hui un modèle repoussoir à la fois pour les jeunes femmes et les jeunes hommes, dans toutes les exploitations familiales.
b) « Vaut mieux qu'elle travaille à l'extérieur ! »
Désormais, le travail salarié des conjointes d'agriculteurs concerne l'ensemble de l'espace social de la viticulture charentaise, depuis la bourgeoisie viticole jusqu'aux petits livreurs de vin. Cette généralisation s'est accompagnée d'une revalorisation sociale 51 ( * ) . Issues de plus en plus de familles non-agricoles et ayant intériorisé la norme dominante du travail salarié féminin, les compagnes des jeunes viticulteurs ne veulent pas subir le même sort que leurs belles-mères qui ont « trimé toute leur vie », « travaillé gratuitement » sur l'exploitation, « pour une retraite de misère ». Le travail salarié en dehors de l'exploitation apparaît ainsi comme l'instrument de leur émancipation. Comparant leur situation à celle de leur belle-mère, les jeunes compagnes de viticulteurs mettent l'accent sur deux avancées. D'une part, elles insistent sur leur émancipation financière par rapport à leur conjoint puisqu'elles disposent d'un salaire individualisé, versé sur un compte personnel. Alors que la génération des parents ne faisait pas de distinction entre les comptes individuels, conjugaux et professionnels, la génération des jeunes viticulteurs pratique davantage la séparation des comptes et des budgets, comme les couples dans les catégories moyennes et supérieures urbaines et salariées 52 ( * ) . D'autre part, elles apprécient l'autonomisation de leurs activités par rapport à leur compagnon, leurs beaux-parents, et plus généralement la maisonnée exploitante (« ça me sort », « ça me change » disent-elles souvent).
De leur côté, les jeunes viticulteurs sont les premiers à encourager leur compagne à « travailler à l'extérieur », souvent pour des raisons financières liées à l'exploitation viticole. Des revenus salariés permettent de « tenir » les mauvaises années sur le marché du cognac, afin de payer les factures ou les courses du ménage, sans prélèvement dans la trésorerie de l'exploitation. Ils permettent aussi à des jeunes viticulteurs de réinvestir à certains moments tout leur chiffre d'affaires dans l'entreprise, pour s'agrandir, acheter du matériel d'exploitation, développer l'entreprise, etc. Certaines compagnes salariées sont également sollicitées comme co-empruntrice ou caution bancaire de leur conjoint lors de la mise en place d'emprunts professionnels. Un salaire mensuel régulier, même modeste, est donc loin d'être négligeable pour le maintien économique de l'exploitation viticole.
Ainsi, Eric Roynaud s'est installé à la suite de ses parents comme exploitant individuel en 1998, à l'âge de 27 ans, sur une petite exploitation en polyculture (40 hectares de terres ; 6 hectares de vignes dont la production est vendue en vin à un négociant ; une dizaine de vaches allaitantes et huit laitières) ; sa compagne, Patricia, exerce une activité à mi-temps de portage de repas à domicile pour des personnes âgées depuis 1994 et gagne environ 450 €/mois. Alors que Patricia est surtout sensible à l'indépendance financière que lui procure son travail (« Je m'assume toute seule et même si c'est pas beaucoup, ça me fait un petit pécule » me dit-elle), pour Eric, cet emploi salarié s'inscrit avant tout dans la stratégie d'ensemble de l'exploitation familiale, dans un contexte économique peu favorable :
- Eric Roynaud : Vaut mieux qu'elle continue de travailler à l'extérieur ! Elle est sûre d'avoir un revenu. Parce que, il y en a beaucoup [d'agriculteurs] leur femme travaille à l'extérieur, et c'est elle qui fait marcher la maison. Je sais que moi, je l'incite à travailler ailleurs. Pas rester là. Je préfère embaucher un mi-temps, des saisonniers s'il faut, si j'ai besoin de bras, ou faire appel à des banques de travail, ou demander à des voisins.
Patricia est bien consciente de l'enjeu de son petit revenu pour l'exploitation : « sans mon salaire, ça serait sans doute plus difficile » reconnaît-elle. Son salaire, même s'il lui est versé directement sur un compte personnel, n'est pas sans conséquences sur le budget de l'exploitation : « c'est toujours ça en moins à verser du compte professionnel au compte personnel » remarque Eric.
Ma position sur le terrain - en tant que compagne de viticulteur qui elle-même occupait un emploi salarié régulier en dehors de l'exploitation - était particulièrement propice pour recueillir ce type de discours. J'ai souvent entendu des jeunes viticulteurs reconnaître en souriant que leur exploitation était financée par leur compagne ou plaisanter sur les femmes qui sont les meilleurs « sponsors » de l'agriculture. J'ai retrouvé cette expression dans la presse viticole locale : « Les exploitations ouvertement reconnues en difficultés ne seraient-elles pas plus nombreuses, si le salaire de l'épouse ne servait pas à faire «bouillir la marmite», selon l'expression consacrée ? La femme est la plus fidèle «sponsor» de son mari, et du cognac par extension » 53 ( * ) . En occupant un emploi salarié à l'extérieur de l'exploitation, les compagnes de viticulteurs ne se désengagent donc pas complètement de la maisonnée exploitante. Elles participent plutôt, d'une autre façon, au maintien économique de l'exploitation familiale 54 ( * ) .
c) Un logement dans la propriété familiale
L'emprise de la maisonnée exploitante sur les conditions de vie des compagnes de viticulteurs - malgré leur emploi salarié - est renforcée par leur installation à proximité de la propriété familiale. Si occuper un emploi salarié à l'extérieur permet une certaine émancipation financière des jeunes femmes de viticulteurs, l'inégalité patrimoniale entre conjoints demeure, particulièrement dans le domaine de l'immobilier. En effet, je n'ai rencontré aucune compagne de jeune viticulteur propriétaire de son logement (ou accédante à la propriété), dans un univers social où la location de la résidence principale est rarissime. Que les couples soient mariés ou non, les maisons d'habitation appartiennent à l'entreprise familiale, ou bien font partie des biens propres du jeune viticulteur acquis par donation ou par héritage. Les jeunes viticulteurs ou leurs parents possèdent souvent un patrimoine immobilier, mais aussi des outils, du matériel, et un ensemble de savoir-faire qui permettent de faire soi-même des travaux à un moindre coût pour réhabiliter des bâtiments d'exploitation disponibles. Cela permet aux jeunes couples d'occuper un logement à titre gratuit, une fois les travaux effectués. Etant donné leurs conditions d'emploi, la plupart des femmes ne disposent pas des ressources économiques suffisantes qui leur permettraient d'imposer la location d'un appartement à distance de l'exploitation 55 ( * ) , encore moins d'envisager une accession à la propriété ; surtout lorsque l'entreprise familiale permet de se loger à un moindre coût. Il en résulte que les compagnes de viticulteurs ne sont pas propriétaires de leur logement. Sur ce plan, les compagnes salariées des jeunes viticulteurs ne sont guères mieux loties que leurs belles-mères, qui venaient vivre et travailler sur l'exploitation de leur époux. Certes, elles ont pérennisé l'acquis d'un logement conjugal distinct de celui des beaux-parents, mais ce dernier appartient toujours à leur compagnon ou à l'entreprise familiale, et elles n'ont de ce fait guère le choix de leur lieu de résidence, souvent situé à proximité de l'exploitation.
Pourtant, malgré cette proximité résidentielle, les compagnes de viticulteurs qui occupent un emploi salarié aspirent à constituer un foyer conjugal autonome de la maisonnée exploitante. Elles prennent appui sur leur condition salariale pour remettre en question le fonctionnement de l'entreprise familiale.
d) Au quotidien, la référence au salariat
Il y a cinquante ans, lorsque plusieurs générations vivaient et travaillaient ensemble sur l'exploitation, préparer le repas, faire la lessive ou du bricolage, tailler dans les vignes ou vinifier dans les chais concourait d'une manière ou d'une autre au fonctionnement de l'exploitation qui était indissociablement une famille et une entreprise. Il n'y avait pas de moments familiaux en dehors de l'exploitation, ni de travail en dehors des rapports familiaux. Cette superposition des scènes domestiques et professionnelles s'est maintenue jusqu'à la génération des parents des jeunes viticulteurs de l'enquête, qui, certes, ont entamé un processus de décohabitation intergénérationnelle, mais ont continué à travailler en famille sur l'exploitation.
Les jeunes femmes qui occupent un emploi salarié « à l'extérieur » aspirent au contraire à une séparation plus grande entre espaces et moments conjugaux et espaces et moments professionnels. Elles exigent de leur conjoint, par exemple, des fins de semaine libres, quelques jours ou quelques semaines de vacances en même temps que les leurs. Leurs revendications, issues du mode de vie salarial, bouleversent ainsi le fonctionnement interne des maisonnées exploitantes, comme le montre l'exemple de Séverine Houdin et Guillaume Portal. Pour rappel, Séverine Houdin est âgée d'une trentaine d'années, elle est aide soignante et elle vit en concubinage avec Guillaume Portal, un jeune viticulteur, co-exploitant dans le GAEC familial. Au moment de l'enquête, le couple a deux jeunes enfants, Kévin et Quentin. Ils vivent dans un logement indépendant, juste en face du portail d'entrée de la cour des parents Portal, dans une vieille bâtisse qu'ils aménagent peu à peu, au gré de la naissance des enfants et de l'état de leurs finances. Séverine, comme la plupart des compagnes de viticulteurs que j'ai rencontrées, déplore la proximité et le vis-à-vis entre son domicile et celui de ces derniers : « je vois tout chez ma belle mère et dans la cour : ça ne me plaît pas tellement, mais c'est pas grave, je ne serai pas beaucoup dans cette pièce » me dit-elle au moment où son compagnon est en train de percer une fenêtre dans la cuisine de leur logement. Elle tente, en particulier, de soustraire son domicile à l'activité de l'exploitation. Séverine reproche ainsi à Guillaume de ne jamais « couper » avec son travail. Dans cette perspective, elle dénonce systématiquement les irruptions chez elle de Liliane Portal, sa belle-mère qui est aussi co-exploitante du GAEC. Les deux anecdotes suivantes illustrent bien les difficultés rencontrées par Séverine sur ce terrain :
Extrait du journal de terrain (février 2003) :
Séverine « en a assez » que Liliane vienne chez elle pour « engueuler » Guillaume au sujet de l'avancée des travaux de taille dans les vignes. Elle comprend pourtant la position de sa belle-mère. Elle trouve anormal que son compagnon privilégie en ce moment les travaux dans la maison par rapport aux vignes : « il exagère, c'est pas parce qu'il n'a pas de patron, qu'il ne doit rien faire ! », ou encore « j'essaye de lui dire que c'était quand même mieux avant, quand il avait fini de tailler en mars ». Cependant, elle est surtout exaspérée par le fait que les conflits entre Guillaume et sa mère se déroulent dans sa cuisine : « parce que moi, j'ai mon boulot à côté et j'ai pas envie d'entendre ça chez moi ; qu'ils se démerdent entre eux ! »
Extrait du journal de terrain (août 2004)
Séverine me rapporte une anecdote récente qui en dit long sur les inconvénients d'habiter sur le site de l'exploitation. Alors qu'elle rentrait du travail un vendredi soir à 21 heures 30, la mère de Guillaume est arrivée dans la cuisine, pour signaler à son fils qu'il y avait de la maladie dans les vignes. Séverine s'est retenue, sur le moment, de dire quoi que ce soit : « je crois qu'elle n'a même pas vu que j'étais là ». Cependant elle n'en pense pas moins et me rapporte ce qu'elle aurait aimé exprimer sur le coup : « il est 9h30, demain c'est le week-end, vous attendez lundi à 8h pour lui en parler ! »
Elle ajoute que sa belle-mère pourrait venir lui parler « de la famille », « de ses enfants », de quoi que ce soit, elle accepterait, « mais pas du travail, à ce moment-là ».
C'est au nom de son emploi salarié que Séverine construit son domicile comme un espace de repos qui doit être soustrait aux relations professionnelles et qu'elle précise les moments qui lui paraissent légitimes pour aborder ou ne pas aborder les questions qui concernent l'exploitation (pas le soir, pas le weekend). Par principe, elle ne souhaite pas participer aux discussions entre Guillaume et sa mère au sujet de l'exploitation (« qu'ils se démerdent entre eux »). En pratique, cette position est tout de même difficile à tenir. Séverine ne peut s'empêcher d'avoir un avis - et souvent de le donner - sur la conduite de l'exploitation (la tenue des vignes, le calendrier des travaux, etc.). On retrouve la même ambiguïté sur la tenue des comptes professionnels et conjugaux. La position de principe de Séverine est ferme : elle condamne le renflouage systématique des comptes de Guillaume par sa belle-mère et n'accepte pas que cette dernière prenne connaissance régulièrement du relevé de compte joint du jeune couple (« j 'ai 30 ans, c'est pas pour être dépendante de quelqu'un »). Cependant, il lui est fort difficile de refuser les avances financières de sa belle-mère dans les périodes de vaches maigres : « Guillaume, il a toujours été renfloué par sa mère. Et maintenant c'est nous... » (février 2003).
Séverine est donc souvent dans une position ambivalente entre ses aspirations, ses principes et ses pratiques. Certes, l'objectif de la séparation des espaces et des temps domestiques et professionnels est souvent concurrencé, en pratique, par les avantages matériels que procure une intégration dans le collectif de production et de consommation que constitue la maisonnée exploitante. Il faut souligner aussi combien Séverine Houdin et Liliane Portal ont noué dans leur fréquentation quotidienne une relation singulière, sur la base d'une complicité féminine, qui repose sur une trajectoire résidentielle commune (à 20 ans d'intervalle, toutes deux ont quitté la ville pour un petit village isolé en Charente). L'ensemble de ces gains matériels et affectifs ont conduit Séverine à ne pas dédaigner les avantages de la proximité physique de l'exploitation familiale, et à relativiser ses velléités d'institution d'un foyer conjugal autonome par rapport à la maisonnée exploitante.
Extrait de l'entretien enregistré (août 2000) :
- Séverine Houdin : C'est vrai que Liliane, au début, je la trouvais envahissante, mais si elle m'envahissait comme ça, je l'ai compris par la suite, c'est parce qu'elle voulait m'aider, moi, au maximum à me sentir bien ici. Parce qu'elle, c'est pareil, la mère de Guillaume a vécu, des années bien avant, la même chose que moi. Elle venait de Bordeaux, elle. Elle avait fait des études, elle aurait dû travailler à la Poste, quelque chose comme ça. Elle s'est retrouvée en pleine campagne, avec personne, personne, personne autour. Donc c'est pour ça qu'elle a été autant près de moi. Elle me notait quand est-ce que passait le boulanger, elle me notait tout, pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi. C'était pas facile ! En même temps, je n'avais pas envie non plus qu'elle vienne me dire tout ça. J'appréciais, mais en même temps ça me faisait chier parce que je crois qu'au fond de moi ça me faisait chier qu'il n'y ait qu'elle autour de moi. Grosso modo, à un moment donné ça a même été ma confidente. Et c'est vachement dur, parce que c'est ma belle-mère (...) Bon maintenant, c'est vrai, elle est envahissante, dans le sens où elle est couveuse...
- C. B. : De Guillaume ou de vous deux ?
- De nous deux. Donc c'est pas évident. Moi, y a des trucs qui m'énervent encore. Elle continue d'acheter des trucs à son fils, style les slips, et ça, je [ne] peux pas [supporter] ! Mais tant pis, je fais avec, je suis obligée de faire avec. Avant, j'aurais fait la gueule, mais maintenant qu'il y a Kévin, c'est plus pareil (...) Je l'envahis maintenant peut-être autant qu'elle, elle a pu m'envahir, parce que maintenant j'ai pris le pli. Bon elle vient, j'y vais, point. Surtout qu'elle est comme ça, bon ben tu rentres, tu as les clés si on est là, si on n'est pas là, enfin. Bon, c'est pour ça qu'on a une relation qui est beaucoup mieux. Elle le dit même des fois en rigolant, entre nous, ça va mieux.
Séverine m'a souvent fait remarquer combien l'arrivée des enfants a constitué un moment de rupture dans les rapports avec sa belle-mère, dans le sens d'une pacification de leur relation et d'une intensification des échanges de biens et de services entre elles 56 ( * ) . Nombreuses sont les jeunes femmes de viticulteurs qui confient ainsi leurs enfants à leur belle-mère aide familiale pour pouvoir travailler à l'extérieur 57 ( * ) . Il faut dire que les modes de garde collectifs sont inexistants hors des villes et que le recours à une assistante maternelle est coûteux. Relevons le paradoxe : les compagnes de viticulteurs présentent leur travail à l'extérieur comme une émancipation de la maisonnée exploitante, mais font appel à la disponibilité de leurs belles-mères (c'est-à-dire l'une des ressources de cette même maisonnée) pour la garde des enfants. Les jeunes femmes sont souvent conscientes de ces contradictions. Lorsque Séverine Houdin a repris son travail d'aide soignante après plusieurs mois de congé parental, elle a cherché à ce que son compagnon prenne en charge davantage les enfants (le week-end lorsqu'elle est de garde, le matin et le soir avant et après l'école, etc.). Guillaume, de son côté, trouve souvent des excuses pour se décharger de cette tâche auprès de sa propre mère, ce qui irrite souvent Séverine.
Comme Séverine Houdin, les compagnes de viticulteurs qui occupent un emploi salarié à l'extérieur tentent d'imposer, avec plus ou moins de réussite, un foyer conjugal plus autonome par rapport à l'entreprise familiale. Mais elles doivent aussi composer avec les difficultés matérielles de la vie quotidienne qui obligent à s'appuyer sur les ressources de la maisonnée exploitante (pour le logement, pour la garde des enfants, etc.), les relations avec des parents ou des beaux-parents un peu trop « envahissants » dans leur vie privée ou « directifs » sur l'exploitation. La généralisation du travail salarié des compagnes d'agriculteurs remet néanmoins en cause la superposition jusque-là évidente entre famille et entreprise, entre scène résidentielle et scène professionnelle, au prix parfois de heurts avec les (beaux)-parents exploitants, ainsi qu'à l'intérieur des jeunes couples. Les jeunes femmes salariées arrivent plus ou moins à leurs fins, selon leur emploi, leur trajectoire sociale, la position socio-économique de leur compagnon et de l'entreprise familiale. En effet, elles ne sont pas toutes égales dans leur quête d'autonomie individuelle et conjugale face à la maisonnée exploitante.
e) Un désengagement variable des travaux de l'exploitation
Ainsi, les jeunes femmes salariées sont plus ou moins épargnées par les charges de travail, sur l'exploitation. Les plus fragiles d'entre elles sur le marché du travail salarié -- celles qui ont des emplois peu qualifiés, peu rémunérateurs et surtout avec des contrats de travail à temps partiel et/ou des horaires décalés -- sont en effet contraintes (par leur conjoint, leurs beaux-parents) à participer à certains travaux sur l'exploitation, en sus de leur activité salariée.
Patricia Roynaud, par exemple, occupe un emploi à mi-temps de portage de repas à domicile. Ses horaires de travail, liés à l'ouverture des cuisines d'une résidence pour personnes âgées sont, selon elle, « très peu pratiques ». Elle travaille de 10 à 13 heures le matin pour préparer et transporter les repas, et de 15 à 17 heures l'après-midi pour nettoyer les plateaux et la cuisine 58 ( * ) . Le matin, elle s'occupe de son fils et de l'entretien domestique de la maison. Le soir, elle aide à l'étable, en donnant de la farine et en faisant boire les veaux (environ une heure tous les soirs). Lors de ses congés ou ses journées de récupération en semaine, elle accompagne sa belle-mère dans les vignes : « Je sais qu'il faut que j'aille aider à attacher 59 ( * ) en ce moment, ma belle-mère me le reprocherait si je ne venais pas ». Si du fait de son emploi salarié, elle est moins « investie » que ses beaux-parents (et surtout sa belle-mère) ne le souhaiteraient dans l'activité de l'exploitation, elle ne peut pas s'y soustraire totalement et doit faire preuve, par des aides régulières et répétées, de sa bonne volonté.
Pour que les jeunes femmes soient complètement dégagées d'obligations de travail dans l'entreprise familiale, il faut donc des ressources culturelles et économiques importantes -- de la part de ces dernières, mais aussi de leur conjoint exploitant. Le relatif désengagement de l'exploitation des compagnes de viticulteurs conduit, en effet, à une adaptation du collectif de production : une sollicitation plus durable de la génération des parents bien au-delà de l'âge légal de la retraite ; l'embauche éventuelle de stagiaires ou de salariés agricoles pour les exploitations qui ont les plus gros chiffres d'affaire ; ou encore la mise en oeuvre de nouvelles stratégies de production, moins intensives en main-d'oeuvre (l'accroissement de la mécanisation, la réorientation des ateliers de production en faveur de la mono-viticulture intensive). Ce sont dans les petites exploitations en polyculture qui exigent une importante main-d'oeuvre familiale, comme chez les Roynaud, que l'incertitude est maximale. Se pose, en effet, à moyen terme, la question du remplacement du travail des parents-exploitants, par celui de leur belle-fille. Cette incertitude est moins prégnante dans les grandes entreprises viticoles qui emploient une main d'oeuvre salariée.
f) La séparation comme horizon des couples viticulteur/salariée
Une autre incertitude, liée aux transformations des rapports conjugaux, pèse à plus long terme sur le maintien des exploitations familiales viticoles : l'accroissement des séparations conjugales. On sait que les hommes agriculteurs en France, lorsqu'ils se mettent en couple, se séparent moins, se marient davantage et divorcent moins que les hommes de leur âge, appartenant à toutes les autres catégories socio-professionnelles 60 ( * ) . Cependant l'enquête a permis l'observation de pratiques conjugales inédites dans les familles agricoles : la généralisation de l'union libre en début de vie commune, la fin du recours systématique au mariage, mais aussi l'apparition des divorces et plus généralement la possibilité, toujours présente dans la vie de couple, de la séparation.
Ce qui distingue la génération des jeunes viticulteurs et de leurs compagnes de celle de leurs aîné-e-s, c'est que la séparation ne constitue pas pour eux une situation improbable ou exceptionnelle. Nombreux sont celles et ceux qui ont connu des ruptures, que ce soit des séparations ou des divorces dans leur entourage amical (ami-e-s d'enfance, voisinage, collègues de travail) et/ou familial. Le mensuel professionnel local, Le paysan vigneron, Revue régionale viti-vinicole des Charentes et du Bordelais , dont l'essentiel des articles concerne les techniques viticoles et la vie économique locale, a consacré un dossier de six pages sur les séparations conjugales dans son numéro d'octobre 2002. Les différentes rubriques informaient les viticulteurs sur les modalités pratiques de règlement des divorces : « Rupture du lien conjugal : les conséquences patrimoniales du divorce ; les différentes formes de divorce ; la place de l'enfant, etc. ». Les jeunes viticulteurs et leurs compagnes salariées semblent donc tout autant acculturés que les autres groupes sociaux au droit qui encadre les pratiques conjugales contemporaines 61 ( * ) . Ils intègrent ainsi dans leurs rapports conjugaux la possibilité de se séparer, ce qui change la teneur et la régulation du système d'échange que constitue le couple 62 ( * ) . Selon les couples et le moment de leur histoire, cette anticipation d'une rupture éventuelle peut prendre des modalités différentes : de la conscience diffuse d'une possible séparation, à la menace permanente de la rupture dans les rapports conjugaux.
Prenons à nouveau l'exemple de Guillaume Portal (viticulteur) et Séverine Houdin (aide-soignante) et revenons brièvement sur les conditions de ma rencontre avec ce jeune couple. J'ai pris contact avec Guillaume en 2000 lors de mon installation en Charente et rencontré peu après sa compagne, lors d'un dîner entre amis. La jeune femme, qui avait aménagé deux années plus tôt sur l'exploitation de Guillaume, se sentait isolée et ne pouvait accueillir qu'avec enthousiasme mon arrivée dans le voisinage. Elle a accepté d'emblée le principe d'un (long) entretien enregistré et nous nous sommes vues très régulièrement par la suite. Séverine est souvent venue se confier à moi entre 2000 et 2005. Cette situation de recueil des données (qui n'était pas explicitée entre nous en tant que telle) minimisait les périodes d'apaisement dans ses relations avec Guillaume au profit de l'exposé des situations de désaccord ou du récit des conflits dans le couple.
La perspective de la séparation n'est pas du tout abstraite ni pour Guillaume ni pour Séverine. Ils ont plusieurs exemples concrets de rupture dans leur entourage proche, au premier chef leurs parents qui ont divorcé. Guillaume est né du second mariage de son père (viticulteur), tandis que les parents de Séverine (éducateur spécialisé et employée de mairie) ont divorcé alors qu'elle avait sept ans. L'un et l'autre ayant déjà eu une première expérience de vie en couple de quelques années, ils ont conscience à tout instant qu'ils peuvent eux-mêmes se séparer.
A plusieurs reprises, Séverine a dénoncé devant moi le chantage à la rupture que lui faisait subir Guillaume en cas de désaccord : « il en a abusé des «c'est ça, ou tu t'en vas !» » ; « je lui ai dit de bien réfléchir lorsqu'il emploierait désormais ce terme » (février 2003). Mais elle reconnaît avoir recours elle-même à ce genre d'avertissement. Comme l'a bien résumé la jeune femme, dans l'entretien enregistré que j'ai réalisé avec elle en août 2000 : « On a des hauts des bas et à chaque fois on a une crainte c'est que l'autre se tire : que moi je m'en aille ou que lui me dise, «tu prends la porte» ! ». A plusieurs reprises, dans ces moments de crise conjugale où la menace de la séparation se faisait plus précise, Séverine a fait devant moi « ses calculs », en cas de séparation. Elle dressait par exemple l'inventaire des meubles qu'elle exigerait de récupérer en cas de rupture : les meubles qu'elle avait achetés elle-même (lit, commode, chambre des enfants, poufs) et ceux qu'elle avait apportés à son arrivée (lave-linge, frigidaire) et avec lesquels elle estimait légitime de repartir. « Il aura une maison, mais elle sera bien vide dedans » concluait-elle en avril 2003. Elle a pris aussi régulièrement des renseignements auprès de la Caisse d'Allocations Familiales par l'intermédiaire d'une amie qui y travaillait et qui l'informait régulièrement sur ses droits en cas de séparation.
Séverine manifeste souvent ses hésitations sur sa vie affective avec Guillaume auprès d'un ensemble de confidentes (toutes de sexe féminin) : sa mère, sa belle-mère, ses collègues de travail, ses amies (dont moi). A l'automne 2004, elle a annoncé à tout son entourage qu'elle était « en voie de séparation » avec Guillaume. Souvent, elle m'a présenté la rupture comme un horizon inéluctable de sa vie en couple : « peut-être que je sais au fond de moi qu'un jour ou l'autre ça va péter, que ça finira comme ça, avec 2, 3 ou 4 enfants » (février 2003), « de toutes façons, je sais que je vais le quitter un jour. J'aurais déjà dû le faire à la naissance de Quentin, si je ne le fais pas maintenant, ça sera peut-être plus tard dans un an ou deux ans ou cinq ans, mais je vais le quitter un jour » (avril 2003). De tels propos ont provoqué dans son entourage des réactions d'incompréhension -- « tout le monde me dit arrête, t'es toujours en train de dire et si on se sépare et si et si... » (août 2000) - voire d'indignation - « je le dis à la mère de Guillaume, elle est affolée, elle me dit, mais pourquoi tu parles tout le temps de ça, ça va s'arranger ! » (février 2003) - ou bien de résignation - « la soeur de Guillaume me dit que de toutes façons, elle ne s'inquiète pas, on a toujours été comme ça et on le sera toujours, mais on ne peut pas se quitter ! » (février 2003).
Si Séverine extériorise souvent la fragilité de sa vie de couple auprès de plusieurs confidentes, Guillaume au contraire est beaucoup plus réservé. A ma connaissance, cela ne fait pas partie des sujets de conversation qu'il peut avoir dans son groupe de copains, ou avec sa famille. Il tend même au contraire à donner, à l'extérieur, une image pacifiée de sa vie en couple. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'envisage pas lui-même la possibilité d'une rupture. La prise en compte de l'instabilité de la vie conjugale s'exprime surtout chez lui par le refus de l'engagement dans le mariage, malgré les pressions régulières de sa compagne en ce sens.
g) Les coûts d'une éventuelle rupture
Comme Séverine Houdin et Guillaume Portal, les jeunes viticulteurs rencontrés et leurs compagnes salariées, ont intégré la séparation comme une issue possible à leur histoire conjugale. En cela, les jeunes agriculteurs ne sont pas isolés des préoccupations conjugales de leurs contemporains appartenant aux catégories sociales urbaines, salariées et indépendantes : ils sont conscients des risques de séparation, et sont informés des formes concrètes de leur mise en oeuvre. Mais ils savent aussi que les ruptures conjugales peuvent s'avérer coûteuses en présence d'une entreprise familiale 63 ( * ) .
Certes, du fait de la généralisation de l'emploi salarié des compagnes, les ruptures d'union ne sont plus systématiquement synonymes de bouleversement de l'organisation de la production de l'exploitation, ni de la situation professionnelle des deux conjoints. Mais la causalité est également inverse. Certains couples refusent d'autant plus obstinément de travailler ensemble qu'ils anticipent les risques de séparation et qu'ils savent combien « les divorces chez les viticulteurs qui travaillent ensemble, ça produit des catastrophes sur tous les plans » (Marc Marchand). Même lorsque les conjoints ne travaillent pas ensemble dans l'exploitation, les ruptures conjugales comportent des risques financiers importants de part et d'autre. Les femmes courent un risque d'appauvrissement au moment de la séparation, du fait des inégalités de revenus et des inégalités patrimoniales entre conjoints : elles doivent notamment trouver un nouveau logement 64 ( * ) . Les hommes risquent également de perdre financièrement lors d'une rupture du fait de l'importante coopération financière entre les viticulteurs et leurs compagnes salariées. Le régime matrimonial de la séparation de biens est ainsi vivement recommandé par les conseillers juridiques (les notaires notamment) aux indépendants dont le conjoint ne participe pas à l'entreprise familiale. Les risques financiers en cas de séparation sont davantage pris en compte par les jeunes générations d'agriculteurs que par les générations précédentes. En atteste, l'accroissement de l'union libre et des régimes matrimoniaux séparatistes : deux formes équivalentes sur le plan patrimonial en cas de divorce ou de décès, les conjoints n'ayant pas de biens communs. En 2004, selon l'enquête Patrimoine de l'Insee, près d'un tiers des couples dont le chef d'exploitation est âgé de moins de 50 ans pratique une séparation de leurs biens (19 % sont mariés selon un régime de séparation de biens et 11 % sont en union libre) 65 ( * ) .
Lorsqu'elles mettent en jeu une entreprise familiale, les séparations conjugales induisent des coûts et des difficultés économiques supplémentaires pour les deux conjoints, notamment lorsque règne entre eux une coopération productive et/ou financière. Mais, il y a plus. Les viticulteurs sont, on l'a vu, très attachés à la transmission familiale de leur exploitation. En cas de séparation conjugale, ils craignent par dessus tout l'éloignement physique de leurs enfants et la mise à mal de leurs stratégies de transmission de l'exploitation dans la lignée. On peut étayer cette hypothèse à partir de l'analyse du divorce de Samuel et Sophie Aisard, un couple composé d'un jeune viticulteur (né en 1972), et d'une aide-soignante, que j'ai rencontré par l'intermédiaire de Guillaume Portal et Séverine Houdin 66 ( * ) .
Il est inutile ici de rentrer dans les détails de la procédure judiciaire qui a abouti - chose relativement rare - à ce que la résidence de la petite Gaëlle, âgée de deux ans, soit fixée au domicile de son père. Il suffit de savoir qu'après la signature d'une première convention entre les conjoints en août 2002, qui fixait la résidence habituelle de Gaëlle sur l'exploitation familiale (chez son père) et organisait une garde alternée, Sophie Aisard a demandé un changement de résidence de l'enfant en sa faveur. Elle a avancé comme argument qu'elle souhaitait retourner habiter en Charente-Maritime, d'où elle est originaire. La procédure de divorce est devenue conflictuelle, chacun des ex-conjoints réclamant la « garde » de l'enfant ; le juge aux affaires familiales donnant finalement raison au père, après enquête sociale, en juin 2003.
On ne peut que constater l'intérêt considérable de Samuel Aisard pour la garde de sa fille. Lorsque je l'ai rencontré chez Guillaume et Séverine en août 2002, au tout début de la procédure de divorce, il clamait haut et fort devant ses amis qu'il exigeait qu'elle vive chez lui, au nom de la chanson de Daniel Balavoine, qu'il convoquait à plusieurs reprises dans son propos - « c'est ma fille, ma bataille, sinon on ira au divorce au charbon ! ». Ce qui importait, avant tout, pour Samuel, c'est que revienne à sa fille la maison qui provient de l'héritage de son père, qu'il a rendue habitable en effectuant lui-même des travaux et qui est inscrite physiquement dans la « propriété familiale », puisqu'elle jouxte les bâtiments d'exploitation. Il n'entendait pas seulement transmettre cette maison à Gaëlle comme un patrimoine immobilier, mais que celle-ci soit « sa maison » - au sens que sa fille puisse y développer un attachement au lieu - d'où son souci dès le début de la procédure de divorce d'y établir sa résidence. Même s'il n'est pas question ici de la transmission de l'exploitation familiale en tant que telle (mais seulement de la maison imbriquée dans la propriété), Samuel Aisard a cherché à pérenniser, à travers la garde de sa fille, sa lignée : « si je fais quelque chose, c'est pour le passé » m'a-t-il dit.
Guillaume Portal a accepté de témoigner en faveur de Samuel Aisard, au cours de la procédure de divorce. Samuel est, en effet, un ami de longue date de Guillaume, mais surtout, ce dernier ne pouvait qu'acquiescer à sa volonté d'obtenir la garde de sa fille. Guillaume a signifié à plusieurs reprises à Séverine qu'en cas de rupture, il exigerait, lui aussi, la garde des enfants et surtout celle de son fils aîné, Kévin (né en 1999), qui a été très tôt le repreneur pressenti de l'exploitation. A plusieurs reprises, Séverine m'a rapporté les propos de son compagnon à ce sujet : Guillaume gardera Kevin « coûte que coûte » (avril 2003) ; « tu prends Quentin et je garde Kevin » (août 2004). Une séparation conjugale présente donc un risque majeur pour les viticulteurs : l'éloignement physique des enfants, synonyme quasi-certain de l'impossibilité de transmettre son attachement à la « propriété », ses savoir-faire de viticulteur et son goût pour la reprise de l'exploitation.
L'affaire du divorce de Samuel et Sophie Aisard a suscité chez Séverine Houdin la crainte de ne pas obtenir à coup sûr la garde de ses fils, en cas de rupture avec Guillaume. Sa connaissance pratique des modalités de règlement de séparation la conduit cependant à relativiser cette angoisse. Elle sait que ce sont les mères qui obtiennent le plus souvent la garde des enfants, et d'autant plus quand le couple n'est pas marié, comme c'est son cas. Finalement, Séverine a bien conscience que sa plus grande source de pouvoir dans le couple est liée à la présence de ses enfants. Même si Guillaume refuse toujours le mariage, il ne peut pas la quitter « sur un coup de tête » (comme sa première compagne avec qui il était resté deux ans), pour cette raison-là : « il aurait beaucoup plus à perdre » me dit-elle en février 2003. Elle sait combien une « bonne séparation » du point de vue de Guillaume, consisterait à ce qu'elle s'installe dans les environs, pour qu'il puisse continuer à voir ses enfants. Dans les nombreux scenarii de rupture qu'elle a élaborés au fil du temps, Séverine oscille donc entre rester en Charente pour « ne pas priver les enfants de leur père », et une logique d'autonomie individuelle -- « tant qu'à le quitter, autant quitter la région, retourner dans le Sud-Ouest et refaire sa vie » (extrait du journal de terrain en août 2004).
La norme de l'indissolubilité du couple parental considéré comme seul conforme au bien-être de l'enfant s'est imposée progressivement dans les règlements des divorces ces trente dernières années 67 ( * ) . La mise en oeuvre pratique de cette norme suppose une proximité géographique entre les ex-conjoints. En situation de virilocalité (c'est-à-dire où ce sont les femmes qui viennent habiter chez leur conjoint, et non l'inverse) cette question de la proximité géographique est moins problématique pour les hommes (qui ne bougent pas de l'exploitation) que pour les femmes qui partent au moment de la séparation parce que ce sont elles qui sont arrivées au moment de la mise en couple. On peut comprendre ainsi le conflit sur la garde des enfants de Samuel et Sophie Aisard, lié au déménagement de Sophie dans sa ville natale, en Charente-Maritime. Qu'elle ait déménagé pour des raisons professionnelles (retrouver un emploi d'aide soignante plus facilement), des raisons familiales (se rapprocher de sa mère) ou refaire sa vie conjugale, peu importe pour l'analyse. Le modèle de l'indissolubilité du couple parental constitue une lourde contrainte pour les ex-compagnes d'agriculteurs puisqu'elle signifie, pour elles, vivre à proximité de l'exploitation de leur ex-conjoint : en milieu rural, pas forcément dans leur localité d'origine, loin des bassins d'emploi, etc. A l'inverse, les normes juridiques actuelles sur le maintien du couple parental viennent étayer les revendications des agriculteurs qui craignent avant tout l'éloignement physique de leurs enfants, au nom du maintien de la lignée et de la continuité de l'entreprise familiale. On peut voir ainsi des jeunes viticulteurs, comme Samuel Aisard, prêts à se saisir des nouveaux dispositifs juridiques en faveur des droits des pères en cas de séparation (résidence alternée, voire résidence principale des enfants au domicile du père), même si c'est au prix d'un alourdissement de leur temps de prise en charge des enfants.
h) Conclusion
Les ruptures d'union font désormais partie de l'univers des jeunes couples de viticulteurs et salariées. La causalité est à double sens : c'est parce que les conjoints ont des professions séparées qu'ils peuvent envisager une séparation, mais c'est aussi parce que les jeunes couples anticipent les risques d'une rupture conjugale qu'ils plébiscitent le travail à l'extérieur. Les ruptures d'union présentent néanmoins pour les viticulteurs et leurs conjointes des enjeux spécifiques, qui les rendent plus coûteuses et/ou plus douloureuses que dans d'autres groupes sociaux salariés et indépendants. Il faut ici distinguer la position des femmes et des hommes. Les compagnes des viticulteurs, comme beaucoup d'autres femmes, courent le risque d'un appauvrissement lors de la séparation et font face à un dilemme : favoriser le maintien du couple parental, au nom de l'intérêt de l'enfant, en déménageant à proximité de l'exploitation de leur ex-conjoint ou bien s'éloigner de l'exploitation au nom de leurs aspirations à une plus grande autonomie individuelle (dans leur vie privée et professionnelle). Les viticulteurs, au contraire, ont tendance à mettre en avant l'intérêt de l'enfant, en vue d'assurer la transmission de l'exploitation dans la lignée. L'impératif de transmission de la lignée -- dont on sait grâce aux travaux d'anthropologie historique qu'il a marqué durablement un grand nombre de paysanneries européennes 68 ( * ) -- constitue donc un enjeu crucial des ruptures (et de l'absence de rupture) d'union des agriculteurs contemporains. Ce qui change ce sont les modalités par lesquelles s'expriment désormais cette conception (certains jeunes agriculteurs sont prêts à ce titre à se saisir des nouveaux dispositifs juridiques en faveur du droit des pères) et le fait qu'elle n'est plus partagée par bon nombre de femmes, qui de fait, ne sont plus agricultrices.
TABLE-RONDE N° 2 - APPARTENANCES SOCIALES ET SOCIABILITÉS
Présidente : Renée Nicoux, sénatrice de la Creuse
Modératrice : Nadia Belrhomari, Public Sénat
Les mondes ruraux contemporains apparaissent socialement très diversifiés, l'activité agricole n'occupant qu'une minorité d'actifs. Aperçus de cette diversité sociale, au sein du monde agricole et en dehors.
1. Que deviennent les enfants
d'agriculteurs ?
Christophe Giraud - Jacques Rémy
(Université Paris 5) - (INRA)
Depuis le début des années 1960, le niveau scolaire des fils et des filles d'agriculteurs n'a cessé de progresser. Les enfants d'agriculteurs ont été la population qui a le plus modifié son comportement par rapport à l'école. Le niveau de formation des fils d'agriculteurs s'est accru plus vite et est devenu plus élevé que celui des enfants d'ouvrier ou d'employé 69 ( * ) . Mais les enfants d'agriculteurs ont adopté des stratégies tournées vers les formations techniques, jugées plus efficaces ou plus opérationnelles que les formations générales longues (Davaillon, 1998) 70 ( * ) .
Mais ce qui s'est le plus transformé c'est le rapport subjectif des familles et des individus à l'école :
Témoignage d'un petit agriculteur de Mayenne en 1975 sur la formation agricole de ses enfants : « C'est peut-être pas mauvais quoi, mais enfin c'est pas ça qui... Je crois qu'ils apprennent encore davantage chez eux »
(Champagne, 2002).
Témoignage à trente ans de distance d'un agriculteur de Vendée en GAEC (2007) : « Ce qui est bien c'est de passer par un bac pro, puis après de faire un BTS gestion par exemple. Gestion d'entreprise, c'est bien parce qu'après ça aide à regarder les cahiers, à lire un bilan... Parce que si le comptable vous dit : « Ah bah, ça va bien... », bah oui mais si vous savez pas lire votre bilan... »
(Alarcon, 2008)
Trois facteurs expliquent ces transformations dans les pratiques et les mentalités :
- la scolarisation prolongée des jeunes (passage de 14 à 16 ans depuis 1959) ;
- le renforcement dans les années 60 et 70 d'un système de formation agricole qui s'est aligné sur les diplômes de l'enseignement scolaire de l'éducation nationale (avec la création de diplômes comme le CAPA ou le BEPA, les brevets agricoles, BTSA...) ;
- une politique qui, à partir de 1974, a conditionné l'obtention des aides à l'installation (DJA, prêts bonifiés) à la détention d'un niveau de diplôme minimal 71 ( * ) .
L'école a aujourd'hui une double action sur les enfants d'agriculteurs : elle « acculture », c'est-à-dire apporte des connaissances générales qui rompent avec la clôture d'une certaine culture locale et professionnelle (elle « dépaysannise »), ce qui peut conduire les enfants « cultivés » à quitter le milieu agricole, le milieu rural ; en même temps elle « professionnalise » puisqu'elle est un instrument indispensable pour l'installation en agriculture.
Nous allons voir quelles ont été les conséquences de cette culture scolaire spécifique sur les trajectoires sociales des enfants d'agriculteurs (les positions) mais aussi sur l'appartenance sociale et culturelle de ceux-ci (la sociabilité et leur mode de vie). Nous traiterons en détail des trajectoires des fils (1 et 2) avant de passer plus rapidement à celles des filles (3) en nous concentrant notre attention pour chaque sexe sur la génération des personnes âgées de 40 à 49 ans, classe d'âge où l'appartenance professionnelle est relativement stabilisée.
a) L'école, créatrice de clivages à l'intérieur de l'agriculture
Indispensable à l'installation aidée de nouveaux agriculteurs, le diplôme est à la source de clivages profonds parmi les nouveaux installés. Il donne accès à certaines positions au sein du milieu agricole (a), de même qu'il donne accès à des univers sociaux et culturels très contrastés (b).
a) Le diplôme, en donnant accès aux aides à l'installation, apporte une dynamique très différente aux exploitations tenues par les diplômés et par les non-diplômés. Des données de 2003 72 ( * ) montrent que les premiers ont ainsi eu plus tendance que les seconds à se retrouver entre 30 et 50 ans à la tête d'exploitations de taille économique importante.
« En 2003, pour les agriculteurs fils d'exploitants sur petite et moyenne exploitation, âgés de 30 à 49 ans, les chances de devenir eux-mêmes exploitants sur grande exploitation passent de 51,2 % pour les fils pourvus au mieux d'un BEPC à 67,1 % pour ceux qui possèdent un diplôme supérieur ».
Ces perspectives économiques différentes basées sur la reconnaissance et l'adoubement de la profession et l'octroi d'aides financières expliquent pour partie les chances différenciées des fils d'agriculteurs de choisir la profession d'agriculteur selon leur niveau de diplôme 73 ( * ) . Les détenteurs d'un diplôme technique qui donne l'accès aux aides à l'installation sont plus enclins à choisir l'agriculture que les fils sans diplôme (ou peu diplômés) qui seront exclus de ces aides.
Choix de la profession d'agriculteur selon le niveau de diplôme des fils et des filles âgés de 40 à 49 ans ayant un parent agriculteur
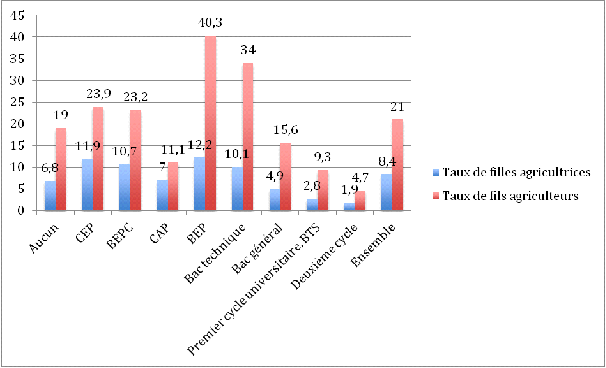
Source : EHF1999
Champ : Hommes et femmes âgés de 40 à 49 ans dont l'un des deux parents est agriculteur (ou ex-agriculteur).
Lecture : 19% des fils d'agriculteur âgés de 40 à 49 ans n'ayant aucun diplôme ont choisi la profession d'agriculteur.
Au fil des générations, le cas de fils d'agriculteurs qui ne réussissaient pas à l'école et devenaient agriculteurs « à défaut de mieux » apparaît de moins en moins fréquent. Les fils qui choisissent le plus souvent l'agriculture sont ceux qui « sont choisis » par l'agriculture, et ce choix est conditionné pour partie par la formation.
Le diplôme est donc central dans l'accès à l'agriculture et aux positions élevées dans la hiérarchie des exploitations agricoles.
Avec le contrôle de l'installation par la profession (Rémy, 1987) et le conditionnement des aides économiques de toutes sortes par le niveau de diplôme, il est possible d'évoquer la coexistence de deux « modes de reproduction » distincts en agriculture :
- un mode de reproduction familial, où la famille est au coeur de l'exploitation : on y travaille ensemble ; on transmet les connaissances, le métier en travaillant en famille ; on hérite surtout des biens familiaux... On reste dans une forte dépendance par rapport aux parents qui doivent décider à quel moment et dans quelles conditions ils transmettent leur patrimoine ;
- un mode de reproduction à composante scolaire : la famille a toujours un rôle important, mais l'école devient l'institution centrale qui donne, valide, certifie ces connaissances, ce qui d'une certaine façon relativise celles apportées par la famille, ainsi que l'autorité des ascendants. Dans ce mode de reproduction, on hérite certes des biens familiaux mais surtout on investit pour acquérir de nouvelles superficies, pour créer tel ou tel atelier sur les exploitations, en rapport au projet formulé lors de la préparation à l'installation. On s'endette auprès de la banque et on gagne ce faisant en indépendance vis-à-vis de ses parents (qui peuvent cependant se porter caution). Les individus sont moins étroitement définis par leur appartenance agricole et les conjointes choisies sont plus souvent éloignées socialement du milieu agricole que dans le mode de reproduction strictement familial.
b) D'un point de vue culturel, les agriculteurs « diplômés » disposent d'une socialisation et d'une expérience des contacts avec d'autres groupes sociaux, notamment lors des études agricoles (où une majorité d'enfants désormais n'est pas de milieu agricole), qui les rendent aptes à une sociabilité diversifiée. Témoin de cette nouvelle capacité à gérer les interactions avec des personnes venant d'autres groupes sociaux, les agriculteurs diplômés (et leur famille) ont plus tendance à développer sur leur exploitation des activités de diversification tournées vers les clients urbains (tourisme à la ferme, activité de vente directe).
D'un point de vue social, enfin les contacts des diplômés sont aussi plus diversifiés et moins limités à l'agriculture ou aux mondes populaires que ceux des non diplômés. Indicateur de ces nouvelles « aires de sociabilité », mais aussi de la valeur sociale des agriculteurs, les conjointes des diplômés font plus souvent partie des classes moyennes que les conjointes des non diplômés (qui appartiennent plus souvent aux mondes populaires des ouvriers ou employés, si elles n'ont pas suivi leur mari dans l'agriculture).
Deux fractions de l'agriculture se dessinent :
- celle des « diplômés » de l'agriculture qui possèdent une formation technique (agricole) élevée (Bac Pro, BTSA). C'est ce profil « formé » de fils d'agriculteurs qui a le plus tendance à choisir l'agriculture comme profession. Ils sont proches culturellement et socialement des milieux moyens salariés, mais ils ont une position sociale caractérisée par l'indépendance professionnelle et des capitaux économiques très élevés ;
- celle des « non diplômés » qui, encore nombreux, sortent du système scolaire avec un niveau de diplôme relativement faible. Ils choisissent moins souvent que les premiers l'agriculture mais constituent cependant une frange non négligeable des agriculteurs aujourd'hui. Pour eux, l'école n'était qu'un passage obligé, souvent mal vécu. Ils ont le sentiment assez net qu'« on apprend tout de même mieux en famille » 74 ( * ) , et sur le terrain (pendant les stages de formation) 75 ( * ) . Ces agriculteurs « peu formés » sont proches culturellement des milieux populaires et du milieu local dans lequel ils vivent. Leur position économique les situe plutôt à la tête de petites exploitations 76 ( * ) . On voit combien les deux modes de reproduction de l'agriculture sont aussi liés à une ouverture plus ou moins orientée vers les autres milieux sociaux de la société.
b) L'école, créatrice de clivages hors de l'agriculture
L'école génère également des clivages importants parmi les enfants qui ne choisissent pas professionnellement l'agriculture. L'école et ses titres scolaires conditionnent fortement les positions sociales des individus (a) mais aussi le milieu culturel dans lequel ils évoluent (b). Prenons ces deux caractéristiques tour à tour :
a) Du point de vue des positions occupées, l'école clive considérablement les trajectoires des enfants d'agriculteur. Deux populations se distinguent là encore : celle des enfants qui sont sortis sans diplôme ou avec un faible niveau scolaire et qui vont alors souvent rejoindre le monde ouvrier 77 ( * ) . Celle des enfants qui disposent d'un certain niveau de diplôme technique ou général (le niveau d'un bac technique) qui va leur permettre d'occuper des professions intermédiaires (parfois dans l'encadrement de l'agriculture : ils seront plus souvent que les autres techniciens ou agents de maîtrise) 78 ( * ) .
b) Du point de vue de l'univers culturel, les premiers restent proches du milieu agricole (et en tout cas des milieux populaires) : ils vivent plus souvent dans leur région d'enfance que les précédents et continuent à donner des coups de main dans le milieu agricole, voire à maintenir une double activité 79 ( * ) . Ils conservent plus facilement un ancrage fort dans une culture locale, paysanne ou populaire. Pour les seconds, la prise de distance par rapport au milieu agricole est plus nette : ils ont connu plus souvent une mobilité géographique. Cela ne conduit pas forcément à une rupture des liens avec l'agriculture. Des participations dans des sociétés agricoles peuvent perdurer en dépit de professions assez différentes.
c) Du côté des filles
Elles sont moins souvent agricultrices que les garçons 80 ( * ) car elles sont moins souvent construites comme des « successeures » (Barthez, 1982 ; Bessière, 2008). Les jeunes femmes ont également plus de mal à s'installer car elles héritent moins souvent que les garçons du capital productif professionnel (Barthez, 1994).
Cependant le profil scolaire des filles agricultrices quarantenaires diffère de celui des fils agriculteurs du même âge (cf. graphique ci-dessus) : pour ces filles, avoir un diplôme technique (comme le BEP) n'a pas plus favorisé le choix de l'agriculture qu'un diplôme de l'enseignement général court (CEP, BEPC).
Si l'impact du diplôme est moins net pour les filles de cette génération, c'est surtout parce qu'à la différence des fils, celles-ci entrent surtout dans le métier d'agricultrice par le mariage : en 2003, 46,5 % des filles d'agriculteur en couple avec un agriculteur se déclarent agricultrices contre 1,8 % des filles d'agriculteur en couple avec un homme qui n'est pas agriculteur. La composition du couple parental pèse également sur les choix des enfants : avoir deux parents agriculteurs prédispose plus fortement à une union avec un homme agriculteur qu'avoir un seul parent agriculteur. Avoir baigné dans une culture familiale pleinement agricole renforce donc le goût conjugal féminin pour ce milieu (Giraud, 2013).
Si les filles d'agriculteur continuent d'entrer dans la profession agricole par le mariage, le sens du travail conjugal sur les exploitations change cependant avec le développement de nouveaux statuts professionnels qui protègent mieux les conjointes (comme celui de « conjoint collaborateur ») ou avec les formes sociétaires d'exploitations agricoles qui permettent de donner à l'épouse un statut égal à celui d'un mari agriculteur. Toutefois, la majorité des jeunes compagnes choisissent de travailler en dehors de l'exploitation agricole du conjoint. Pour une conjointe d'agriculteur la pression normative pour épouser également le métier est moins pressante qu'il y a cinquante ans (Bessière, 2010). Devenir agricultrice aux côtés de son mari peut alors être vécu aujourd'hui davantage comme un choix que comme un destin 81 ( * ) .
Du côté des filles d'agriculteurs qui sortent de l'agriculture, le diplôme joue un rôle très important (comme pour les filles issues d'autres milieux sociaux). Le faible niveau de diplôme conduit à des positions peu élevées dans l'échelle sociale (employées de commerce, ouvrières, ouvrières agricoles, ou inactives qui représentent 77,3 % des filles d'agriculteurs sans diplôme âgées de 40 à 49 ans en 1999). Les diplômes courts de l'enseignement général ou technique (BEPC, CAP) favorisent plus que les autres diplômes des emplois dans le monde indépendant de l'artisanat, le commerce ou l'entreprise ou des employées de la fonction publique. Les diplômes plus élevés permettent l'accès à des emplois plus élevés (le niveau bac donne accès plus souvent aux professions intermédiaires administratives ou au monde des employées administratives ; le niveau université aux emplois les plus valorisés de cadres ou des professions intermédiaires de la fonction publique ou de la santé ou des techniciennes).
d) Conclusion
L'agriculture qui se dessine dans cette période de scolarisation prolongée est une agriculture particulièrement hétérogène socialement et culturellement :
- la première fraction, celle des diplômés, se trouve dans des conditions et avec des niveaux culturels qui la rapprochent des classes moyennes salariées : les diplômés ont suivi une formation longue à l'école qui les a mis en contact avec des enfants de milieux sociaux très variés. Ils sont donc plus facilement prêts à gérer des interactions avec des personnes des classes moyennes avec lesquelles ils partagent certains codes culturels ;
- la fraction des non-diplômés reste, elle, proche des milieux populaires. Peu scolarisée, porteuse d'une éducation essentiellement familiale portée par des familles avec deux parents agriculteurs, elle demeure aussi plus étroitement attachée à une culture populaire, agricole et locale qui tranche avec le groupe précédent 82 ( * ) . Du côté des fils qui ne choisissent pas l'agriculture, il y a aussi cette même opposition entre diplômés et peu diplômés. Enfin des circulations persistent entre ces petits agriculteurs et les fils qui ont choisi le monde ouvrier. Ces derniers peuvent conserver un « travail à côté » agricole ou prêter main-forte occasionnellement dans l'exploitation familiale.
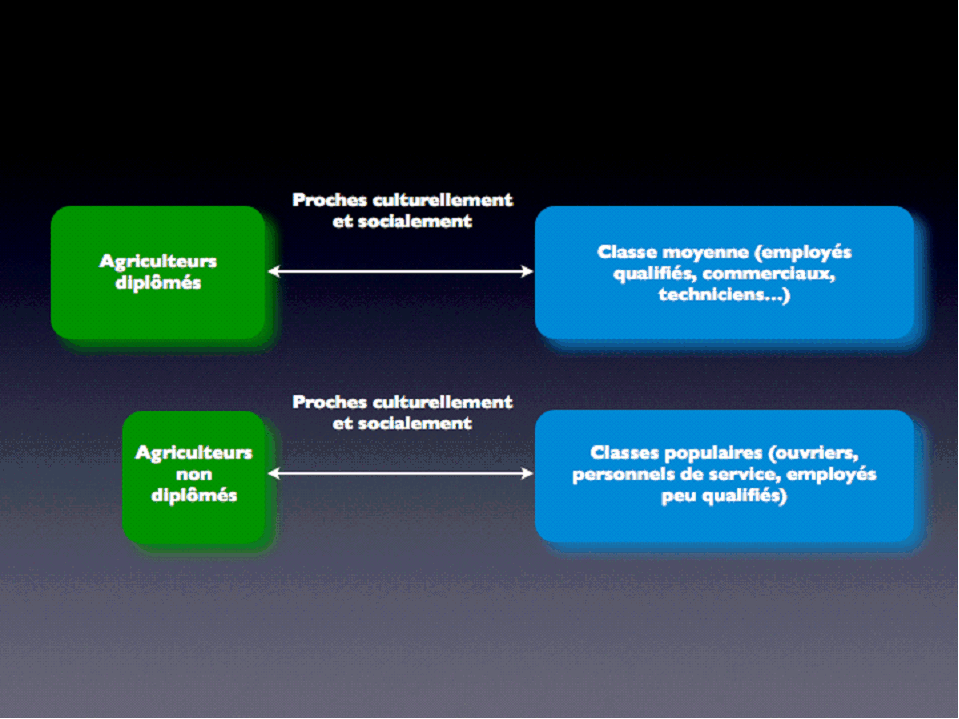
Cette présentation s'attache à exposer combien l'agriculture constitue un univers hétérogène dont les acteurs s'intègrent de manière très contrastée au reste de la société : la fraction des agriculteurs diplômés est proche des classes moyennes, et tire le meilleur parti des systèmes d'aide dans le cadre de la politique agricole commune, tandis que la fraction des agriculteurs peu diplômés s'inscrit dans un milieu local plus populaire et souffre d'un manque de reconnaissance des mêmes politiques agricoles.
Du côté des filles d'agriculteur, si les dernières études montrent que leur situation évolue fortement puisqu'elles accèdent plus souvent au monde agricole, comme les jeunes hommes, par la formation et l'installation professionnelle, indépendamment de tout projet conjugal (Dahache, 2012), si l'on considère l'ensemble de la population des filles (et plus particulièrement les quarantenaires), cette voie d'entrée dans la profession se révèle peu fréquentée et l'entrée par le mariage apparaît encore dominante.
|
Bibliographie : Alarcon L ., 2008, « `Maintenant, faut presque être ingénieur pour être agriculteur', Choix et usages des formations professionnelles agricoles dans deux familles d'agriculteurs », Revue d'études en agriculture et environnement , vol. 88, n°3, pp. 95-118. Barthez A ., 1982, Travail, Famille et agriculture , Paris, Economica. Barthez A ., 1994, « Le patrimoine foncier des agriculteurs vivant en couple », Agreste Analyses et Études Cahiers , n°17-18, mars, pp. 23-36. Bessière C. , 2010 , De génération en génération. Arrangement de famille dans les entreprises viticoles de Cognac , Paris, Raisons d'Agir, 215 p. Champagne P. , 2002, L'héritage refusé. La crise de la reproduction sociale de la paysannerie française 1950-2000 , Paris, Seuil, Points. Dahache S. , 2012, La féminisation de l'enseignement agricole , Paris, L'harmattan. Davaillon A. , 1998, « Parcours scolaires des élèves ruraux et des enfants d'agriculteurs : spécificités et évolutions », Education et formations , n°54, déc., pp. 97-107. Dufour A., Giraud C. , 2012, « Le travail dans les exploitations d'élevage bovin laitier est-il toujours conjugal ? », in Hostiou N., Dedieu B., Baumont R. (eds.), numéro « Travail en élevage », INRA-Productions animales , vol. 25, n°2, juin, pp. 169-180. Giraud C. , 2013, « Une distance sociale intime », in Boudjaaba F. (dir.), Au-delà de la terre. Famille, travail, formation et mobilités sociales en milieu rural (16ème-21ème siècles) , Rennes, PUR, à paraître. Laisney C. , 2012, « Les femmes dans le monde agricole », Analyse , Centre d'études et de prospective, n°38, mars, 4 p. Rémy J. , 1987, « La crise de la professionnalisation en agriculture : les enjeux de la lutte pour le contrôle du titre d'agriculteur », Sociologie du Travail , vol. 39, n°4, pp. 415-441. |
2. Les bouleversements des formes
d'appartenance au monde ouvrier vu du monde rural83
(
*
)
Nicolas Renahy
(INRA)
Les thèses de l'individualisation des sociétés occidentales, ou de l'exclusion de ceux qui resteraient en marge d'une vaste classe moyenne aux modes de vie homogénéisés, ont sans doute permis de sortir d'une grille de lecture rigide héritée du marxisme. Mais elles résistent aujourd'hui mal aux faits et sont vivement contredites par le renouvellement des études sur les inégalités sociales pensées en termes de stratification. Enquêtant la population ouvrière d'un village industriel de Bourgogne au cours des années 1990, l'auteur a pu mesurer tout autant la force socialisatrice continue du groupe ouvrier sur sa jeunesse que le lent processus de délitement de ses cadres de références, longtemps stabilisés autour d'une mono-industrie métallurgique, provoquant une crise dans la reproduction de ce monde ouvrier. C'est cette crise de reproduction qui est évoquée ici. Dans un premier temps sont explicitées les formes passées de la présence industrielle au village, qui n'a jamais été celle d'un bastion de la grande industrie - la population locale n'est pas structurellement différenciée de celle de son environnement rural immédiat. L'exemple d'une lignée familiale d'artisans montre pour finir l'étroit maillage entre usine et structures sociales plus classiquement rurales, favorisant la constitution d'un capital d'autochtonie, déclinaison populaire du capital social.
a) Introduction
Il n'est pas anodin que la sociologie repose aujourd'hui la question des frontières sociales, après avoir, au moins dans le champ académique français des années 1980 et 1990, été dominée par l'idée d'une « moyennisation » de la société. Les thèses de l'individualisation des sociétés occidentales, ou de l'exclusion de ceux qui resteraient en marge d'une vaste classe moyenne aux modes de vie homogénéisés, ont sans doute permis de sortir d'une grille de lecture rigide héritée du marxisme. Mais elles résistent aujourd'hui mal aux faits, et sont vivement contredites par le renouvellement des études sur les inégalités sociales pensées en terme de stratification (cf. par exemple Chauvel, 2001 ; Bouffartigue, 2004). De nombreuses recherches indiquent au contraire la recomposition de groupes sociaux relativement homogènes, et donc la persistance de frontières entre groupes, frontières sociales mais aussi spatiales (Beaud et Pialoux, 1999 ; Oberti et Préteceille, 2004 ; Pinçon et Pinçon-Charlot, 2007).
Enquêtant la population ouvrière d'un village industriel de Bourgogne au cours des années 1990, nous avons pu mesurer tout autant la force socialisatrice continue du groupe ouvrier (qui est aussi en l'espèce groupe résidentiel) sur sa jeunesse que le lent processus de délitement de ses cadres de références, longtemps stabilisés autour d'une mono-industrie métallurgique (Renahy, 2005). Depuis la fin des années 1970, avec la « restructuration » de l'industrie, le village de Foulange 84 ( * ) a non seulement perdu plus d'un tiers de ses habitants (de près de 1000 à un peu plus de 600), mais également sa singularité. Dans l'espace rural avoisinant, les Foulangeois se distinguaient en effet fortement de par « leur » usine de cuisinières, leur club de football prestigieux, leurs ouvriers politisés autour du Parti Communiste Français (PCF) et du syndicat CGT, mais aussi réunis par le paternalisme de « leur » famille patronale, dirigeant depuis sa maison bourgeoise entreprise et municipalité pendant plus d'un siècle (Renahy, 2008). Jusque dans l'habitat, avec trois cités ouvrières côtoyant les fermes (mais relativement distantes du « château » patronal...), et ces étonnants baraquements construits rapidement pour loger la dernière vague de travailleurs immigrés célibataires à la fin des années 1960. La fermeture de l'usine en 1981 a bien ensuite été compensée par l'arrivée de petites entreprises, dont l'une reprenant la production de cuisinières. Mais le faible volume de personnel réembauché et l'évolution du mode de gestion de la main d'oeuvre (disqualification de la « formation maison », élargissement du bassin de recrutement, besoin de nouvelles compétences) ont provoqué une crise dans la reproduction de ce monde ouvrier.
C'est de cette crise de reproduction que nous voudrions évoquer ici, ce qui nécessite dans un premier temps d'expliciter les formes passées de la présence industrielle au village. En regard de la majorité des enquêtes réalisées sur le monde ouvrier, celle que nous avons menée pendant une dizaine d'années n'a pas rencontré la population d'un grand « bastion », ou d'un « fief » de la grande industrie 85 ( * ) . L'usine de Foulange n'a jamais embauché plus de 400 salariés. Ce maximum, atteint entre la fin des années 1960 et le début des années 1970, a aussi correspondu au moment durant lequel les ouvriers ont sans doute été les plus politisés (sans que la commune n'apparaisse cependant comme un « bastion rouge » 86 ( * ) ). Mais la population locale n'est pour autant pas structurellement si différenciée de celle de son environnement rural immédiat. Certes les ouvriers constituent longtemps la majorité de la population, mais ils se trouvent mêlés aux agriculteurs et artisans. L'exemple d'une lignée familiale d'artisans nous montrera cet étroit maillage entre usine et structures sociales plus classiquement rurales, maillage donnant d'autant plus de poids à l'entreprise de cuisinières que celle-ci permettait l'intégration professionnelle de la plupart des enfants du village. Cette caractéristique d'une population à la fois ouvrière et rurale favorisa la constitution d'un capital d'autochtonie, déclinaison populaire du capital social (Retière, 2003) où l'appartenance locale devient une ressource, tant symbolique (le poids du patronyme qui, comme dans la paysannerie, donne une réputation) que pratique (notamment quand il s'agit de « trouver une place » honorable sur le marché du travail à un jeune de la famille).
Avec la crise industrielle qui débute à la fin des années 1970, ce capital d'autochtonie se trouve brutalement démonétisé. Et ce, de manière pérenne. Car malgré la relative reprise du marché de l'emploi industriel à Foulange au cours de la décennie 1990, la métallurgie ne permet plus l'intégration professionnelle que d'une minorité, qui a par ailleurs de plus en plus tendance à être recrutée à l'extérieur du village. Entre l'espace professionnel et l'espace résidentiel s'est opérée une disjonction, et la plupart des jeunes garçons du village - qui auparavant constituaient la force vive de l'usine - se sont détournés d'une industrie qui ne garantissait plus l'avenir. Tel Didier, dont nous étudierons le parcours professionnel haché, et pour qui le capital d'autochtonie constitue aujourd'hui plus un dernier recours d'accès à une honorabilité minimale qu'une réelle ressource.
b) Usine et village : un long maillage social
Les jeunes enquêtés de Foulange, qui sont nés dans les années 1970 (l'enquête se déroule principalement pendant la décennie 1990), sont issus d'une stabilisation relative des itinéraires des membres de la génération précédente. Leurs parents, peu qualifiés, sont entrés tôt dans la vie active du fait de la présence d'une usine paternaliste susceptible de les embaucher dès leur sortie de l'école au niveau du certificat d'études primaires, ils se sont mariés et ont eu leurs premiers enfants jeunes, souvent autour de 18-22 ans. Dans le même ordre d'idées, on remarque que c'est dans les années 1960 et 1970 qu'existent des fratries nombreuses ; les familles de cinq ou six enfants ou plus étant courantes. Ainsi, en période de stabilité économique, se projeter dans l'avenir, s'installer et procréer se fait plus aisément. Il se trouve par ailleurs que les années 1970 correspondent à une forme d'apogée de l'Etat social bâti dans l'après-guerre. Les familles ouvrières de Foulange sont par exemple assistées par la création d'un centre social dans le chef-lieu de canton en 1971. Le patronat local, qui avait précédé l'Etat dans ces pratiques d'assistance aux classes populaires, les prolongeait encore à cette période (l'usine installa par exemple un médecin de village à la fin des années 1960). La municipalité n'était pas en reste, puisque des années 1950 aux années 1970, elle fit venir l'Office Public départemental HLM dans la commune et lui fournit des terrains pour construire des pavillons locatifs, ou bien viabilisa des zones d'accession à la propriété individuelle. Bref, à tous points de vue (y compris en termes de politisation et d'accès à une conscience de classe), les années 1970 marquent une apogée pour ce « petit » monde ouvrier. Apogée qu'il faut situer de manière générationnelle : « toutes choses égales par ailleurs » et comme l'ensemble des français membres de leurs cohortes de naissance, les Foulangeois qui entrent sur le marché du travail dans les années 1960 et au début des années 1970 ont rencontré « un destin social inespéré » (Chauvel, 1998). A Foulange, ces destinées ont été régulées par la présence de l'usine Ribot, dans un contexte rural qui ne fut pas anodin.
L'analyse de la lignée familiale Doret permet d'illustrer de manière exemplaire cette singularité : le patronyme est présent et transmis au village depuis la fin du XVIII° siècle. Au début des années 1820, le fils d'un charpentier devient bourrelier 87 ( * ) . Les forges de Foulange n'embauchent alors que quelques dizaines d'ouvriers, et sont mêlées aux autres activités industrielles, artisanales ou commerciales. Au recensement de 1851, c'est ainsi toujours l'agriculture qui fait vivre la moitié des individus de la commune déclarant une profession, quand l'industrie et le commerce en concernent 35 %. Le bourrelier Doret forme son fils et lui transmet l'affaire en 1860, comme le fait celui-ci à destination de ses deux fils en 1890. L'aîné étant resté célibataire, c'est par le second que la transmission familiale s'effectue à sa mort en 1929, à destination de Pierre, l'aîné de ses deux fils. Au cours de l'entre-deux-guerres, les anciennes forges - elles aussi léguées de pères en fils au sein de la grande bourgeoisie Ribot (Renahy, 2008) - sont devenues une entreprise de cuisinières et de fourneaux relativement prospère, constituée en société anonyme en 1923, et qui centralise autour d'elle l'essentiel des activités de la commune. Pour la parentèle Doret, « faire ses partages » (Gollac, 2005) en famille ne semble dès lors pas poser de problèmes de transmission, puisque l'usine Ribot constitue une alternative professionnelle intéressante pour les enfants de la famille. Ainsi, Maurice Doret, le frère cadet de Pierre, est formé par l'usine Ribot. Il devient ajusteur et intègre la prestigieuse équipe d'entretien (qui s'occupe des machines de tous les ateliers, mais qui entretient également l'ensemble du parc de logements ouvriers que construit l'entreprise à cette période). De même, alors que jusqu'à présent l'ensemble des alliances matrimoniales contractées par la lignée Doret se faisait en direction de l'artisanat, l'usine apparaît à présent comme porteuse d'un marché matrimonial suffisamment honorable pour une parentèle d'artisans installée de longue date au village, et dont les chefs de famille se succèdent au conseil municipal depuis près d'un siècle. Ainsi, parmi les quatre soeurs de Pierre et Maurice, toutes mariées à Foulange entre 1919 et 1937, seule l'aînée épouse un artisan, l'un des maréchaux-ferrants du village. Les trois autres gendres sont tous salariés de l'industrie Ribot, mouleur, tôlier et ajusteur qui connaîtront par la suite une promotion professionnelle interne (l'un d'eux devenant contremaître). A la génération suivante, cette emprise de l'usine se prolonge, plutôt en direction de l'insertion professionnelle des jeunes cousins (majoritairement natifs des années 1930-40) : si seuls deux hommes feront toute leur carrière dans l'industrie locale, dix des quinze cousins commencent leur carrière en travaillant quelques temps à l'usine à la sortie de l'école, et quatre des onze cousines y sont sténodactylographes en début de vie active. Ensuite, les itinéraires se diversifient, mais nombre d'apparentés Doret migrent vers les villes de la région et leurs emplois dans le commerce, les services, et surtout la fonction publique (aide-soignante, gendarme, enseignants, employés de la sécurité sociale ou de mairie, etc.). Alors que la transmission de l'activité de bourrelier s'arrête avec Pierre - qui, à plus de 70 ans, a arrêté depuis longtemps la fabrication de harnais mais confectionne toujours quelques matelas jusqu'à sa mort en 1977 -, on perçoit que dans les années 1960, pour ses enfants comme pour toute une frange de la jeunesse villageoise, l'usine met le « pied à l'étrier » (Chauvel, 1998) et prépare une mobilité sociale bien souvent ascendante.
c) Paternalisme industriel et condition ouvrière
Du point de vue du système d'emploi local, ce phénomène correspond à une sortie intergénérationnelle progressive du paternalisme industriel. Si l'on décentre le regard des héritiers d'un petit artisanat pour observer les nombreux travailleurs arrivés comme manoeuvres à l'usine dans l'entre-deux-guerres (de Pologne ou d'Italie, mais aussi du monde rural environnant), on s'aperçoit que pour ceux qui sont restés au village et s'y sont mariés, l'entrée au bas de l'échelle professionnelle de l'usine Ribot (au moulage ou en fonderie) a pu signifier une accession des enfants aux emplois qualifiés de l'entreprise, puis une sortie du système usinier pour les petits-enfants. Ce processus inhérent à la manière dont les salariés d'une industrie paternaliste investissent les opportunités d'ascension sociale que celle-ci offre est aujourd'hui bien connu, il a été résumé par Jean-Pierre Terrail (1990) dans la formule « le paternalisme : le servir, s'en servir, s'en sortir », qui synthétise le rapport de trois générations successives.
Mais ce processus n'est pas atemporel. Ce que montre le cas de Foulange est qu'il correspond bien à des contextes historiques précis : l'entre-deux-guerres, les années d'après-guerre, puis les années 1960-1975 de pleine croissance et de finalisation de l'Etat social. Il est donc porté par des contextes nationaux successifs qui le favorisent, comme il sera clos par la crise économique prolongée. Il n'est par ailleurs pas généralisé, mais massif. S'il concerne une frange non négligeable de la population locale, des déclassements sociaux ont bien sûr pu être observés dans ces périodes. Son importance indique cependant une voie d'ascension sociale possible, que beaucoup vont emprunter quand d'autres s'éteignent, comme le vieil artisanat (tel qu'illustré par la lignée Doret), mais aussi bien sûr l'agriculture.
Au final, l'avènement de la « société salariale », que Robert Castel (1995) situe au milieu des années 1970, constitue également pour la population du village une forme d'apogée d'une condition ouvrière intégrée : un milieu social que l'on peut aisément intégrer mais dont on peut aussi sortir « par le haut », au sein duquel il est possible d'accéder à une forme d'indépendance à travers le logement individuel en pavillon (locatif ou en accession à la propriété), mais dont les schèmes de socialisation restent puissants, et s'expriment à travers de nombreux échanges (matrimoniaux bien sûr, mais aussi autour des sociabilités festives, d'un club de football, du « coup de main » donné lors de l'auto-construction, ou des cycles de dons et contre-dons que permettent la tenue de jardins potagers : Weber, 1989). En regard de cette réalité passée qui constitue le modèle dans lequel les vingtenaires des années 1990 ont été socialisés, ce qui frappe est l'immense difficulté, voire l'impossibilité à en reproduire les caractéristiques relevant d'un accès précoce à une situation honorable (salarié, parent, accédant à la propriété). Ce n'est qu'aujourd'hui, à l'âge de 30, 35 ans, que beaucoup finissent par stabiliser leur vie matrimoniale, par s'installer de manière réellement indépendante, et par procréer. Quand ils avaient entre 18 et 25 ans, ils étaient bien en situation de crise de reproduction sociale, incapables, parce que trop fragiles, de se projeter dans l'avenir sereinement, et ne pouvant que différer leur accès à l'indépendance face à un espace des possibles très restreint.
d) Didier Doret, l'instabilité malgré l'acquisition de « capacités »
Cette évolution ne rend pas seulement compte d'une simple diffusion de l'extension de l'âge de la jeunesse aux membres des classes populaires. Si l'on porte attention aux origines sociales, aux schèmes de socialisation et aux formes d'intégrations sociale et professionnelle de ces jeunes, on se rend compte qu'il s'agit plus profondément de bouleversements des modalités d'appartenance au groupe ouvrier, à la manière dont chacun s'y rattache et le reproduit.
Ainsi, l'un des points communs de ces enfants d'ouvriers qui restent au village 88 ( * ) après la sortie du système scolaire (ou revenus chez leurs parents après une première expérience professionnelle) est que leurs parents ont presque tous rencontrés une situation de chômage prolongé lorsque la vieille industrie a fermé ses portes en 1981. Cette perte d'emploi, si elle fut une « perte de soi » (Linhart et al, 2002) pour les licenciés, marqua aussi durablement leurs enfants. Dans un univers social où la légitimité et l'honneur découlent du « coup de main », de la manière avec laquelle on sait modifier une matière (à la fois savoir-faire acquis en apprentissage, peaufiné à l'usine, et don potentiel dans les interactions familiales et de voisinage), un licenciement signifie concrètement l'inaction. Pour les enfants qui ont connu leur père chômeur, c'est sans doute dans cette perte de sens initiale qu'il faut rechercher à la fois une profonde distanciation avec le monde de l'usine lorsqu'ils sont en âge d'y entrer, et en même temps une forme de nostalgie, rencontrée chez beaucoup de jeunes hommes, à l'égard de ces savoir-faire perdus.
L'expérience scolaire et professionnelle de Didier Doret illustre bien cette nostalgie, qui s'est exprimée pour lui par une volonté d'accumuler différentes expériences, de réaliser différents apprentissages (scolaires et « sur le tas »), et aussi de se raccrocher à une histoire familiale honorable, qui lui permette de donner du sens à son parcours. Didier est né en 1970, il est le premier des petits-enfants de Pierre Doret. Quand je réalise un entretien avec lui en novembre 2003, il habite seul dans la maison de son grand-père. Celle-ci appartient à l'une de ses tantes, une informaticienne urbaine qui le laisse y habiter car elle revient aujourd'hui rarement dans son village natal. Rencontré chez l'un des informateurs privilégiés de l'enquête, c'est en commençant à discuter de l'histoire de sa famille que je lui ai proposé de réaliser un entretien. Didier m'accueille volontiers sur cette base, car il a réalisé un arbre généalogique de son ascendance paternelle en questionnant ses aînés et à partir d'archives retrouvées dans le grenier de la maison, arbre que je peux l'aider à compléter grâce aux données recueillies en mairie. Il voue une admiration sans borne à ses aïeuls, détenteurs d'un savoir-faire aujourd'hui disparu, mais transmis sur quatre générations. Ainsi apparaît-il fasciné lorsqu'il découvre que le maréchal ferrant qui habitait en face de la maison était témoin au mariage de l'une de ses grandes tantes en 1927, et nostalgique lorsqu'il évoque la fin de vie de son grand-père (« jusqu'au bout, il a fait des matelas. Il ne faisait plus que ça, d'ailleurs, il vivotait ») par rapport à la période de l'entre-deux-guerres, où l'activité était intense (« le grand-père fournissait aussi l'usine en courroies »). Ainsi Didier se considère-t-il comme porteur d'un héritage familial :
« Mon grand-père, il avait fait comprendre à [ma tante] Françoise qu'il ne voulait pas que sa maison ait un autre nom. Parce que lui, il était déjà la quatrième génération de bourreliers. Donc ma tante, jusque là, respecte le vouloir de son père qui ne voulait pas qu'elle porte un autre nom. »
Cet attachement au nom a pour fondement l'expérience enfantine d'une proximité forte avec ses grands-parents paternels, proximité qui découle des difficultés à s'installer rencontrées par le couple de ses parents, de la « mauvaise ambiance » entre eux.
« Quand je suis né, mes parents n'avaient pas de maison. Ma première maison, c'est ici. Mes parents ont dû rester là deux ans avant de trouver une maison. Après j'étais avec mes parents à l'HLM. Mais bon, je sentais que ça n'allait pas, tu vois ? J'ai senti la mauvaise ambiance, j'ai voulu revenir vers mes grands parents. Et je suis revenu à l'âge de cinq ans. J'ai dû y être trois ans chez les parents. Je me rappelle, gamin, du fameux été 76, je me rappelle qu'il faisait super bon. Je dormais là avec mes grands parents, dans mon petit lit, et mon grand père qui faisait le matelas à côté. »
Les ressorts des difficultés parentales proviennent de l'instabilité professionnelle de son père, Jean-Paul - et aussi, sans doute, des naissances nombreuses et rapprochées, puisque Didier a quatre frères et soeurs, et que tous sont nés au rythme d'un enfant par an. Jean-Paul Doret, plombier, a débuté sa vie professionnelle au service d'entretien de l'usine de Foulange. Anticipant la fermeture de l'usine, il trouve un emploi chez un artisan des environs, qui lui-même finit par fermer sa petite entreprise. Jean-Paul accumule alors différents petits emplois (contrat aidé comme ouvrier d'entretien à la commune, intérim, etc.) et périodes de chômage. Avec trois années de « retard » à l'école, Didier quitte quant à lui le collège en sortie de classe de cinquième et entre en lycée technique pour recevoir une formation de fraiseur. Mais le travail du métal ne lui plaît pas, il apprend ensuite le métier de charpentier.
« Au départ, je suis mécanicien, mécanique générale. CAP de mécanique, fraiseur. Après j'ai fait une formation avec l'AFPA 89 ( * ) , ça fait un niveau 5, je suis charpentier. Comme un CAP-BEP de charpentier.
Le fraisage, ça ne m'a jamais plu. J'ai été balancé là-dedans. Par contre, après, j'ai trouvé que j'avais quelque chose avec le bois. Dans le fraisage, j'ai dû exercer trois mois, en intérim (...). Après l'armée, j'ai fait mon stage AFPA pendant huit mois. Pas de problèmes, j'ai eu mon diplôme. Et de là, je suis rentré en charpente. J'ai bossé en ville, à C..., pendant deux ans et demi. Après, j'ai eu un petit conflit avec la copine, donc j'ai quitté C... Bon, la charpente, c'est chouette, c'est un beau métier. Mais après, t'es exploité, quoi. T'es pas payé. Avant de faire un beau salaire, il t'en faut faire, des heures. »
« Mal payé », en conflit avec sa copine, Didier quitte donc rapidement le métier de charpentier, pour lequel il vient de se former. « Revenant à la maison », il trouve à 23 ans à travailler comme ouvrier dans la construction de centres équestres. Ce travail ne le satisfait pas, il continue à chercher un autre emploi. Au bout de dix-huit mois, il trouve ce qu'il appelle « la bonne boutique » : ouvrier dans l'horlogerie d'édifice (installation et entretien des horloges d'églises ou de salles de sport).
« J'étais comme un petit artisan. Simplement, je dépendais d'une grosse boutique. J'avais tout qui m'était fourni. Tu partais le lundi avec ton planning, démerdes-toi. T'avais tant d'entretiens à faire, t'avais des dépannages... A la fin, j'étais SAV 90 ( * ) , donc tu vois, pas une mauvaise place. Mais bon, onze départements, 1600 km en moyenne par semaine, tu ne vois pas le soleil, quoi ! Toute la semaine, t'es barré. C'est hôtel-restau, hôtel-restau... Alors au bout de sept ans, j'en avais marre. J'en avais marre ! C'est ça qui m'a fait arrêter. Parce que c'est vrai, je peux dire qu'au niveau salaire, je n'avais pas à me plaindre. J'étais pas loin des 10 000, ouais, ouais 91 ( * ) ! Avec véhicule fourni, pas de frais de gasoil, la bouffe pareil, tout m'était défrayé. Une bonne boutique. J'ai regretté un petit peu... Parce que pour retrouver ça, de nos jours... Il faudrait que je retourne les voir eux, mais je retrouverai pas des boîtes comme ça. Parce que maintenant... Ils vont embaucher des mecs qu'ont bac + 4, mais qui savent même pas tenir un marteau ! Non, mais ! Ils veulent des diplômes, des diplômes... Ca ne les intéresse plus des manoeuvres, des gens qu'ont appris par expérience. »
De ces extraits d'entretien ressortent un ensemble d'insatisfactions, mais aussi d'attachements. Afin de les décrypter, et en mettant l'itinéraire de Didier en perspective avec ceux d'autres jeunes hommes du village, analysons les différents bouleversements dans les appartenances sociales de ces jeunes ouvriers ruraux, bouleversements auxquels Didier fait référence.
e) Les bouleversements des formes de l'appartenance ouvrière
La première des appartenances qui a été profondément modifiée au cours des années 1980 et 1990 est celle professionnelle . Au moment où je le rencontre, Didier est sans activité stable depuis un an. A 33 ans, ayant quitté une « bonne place », il retrouve une insécurité qu'il n'avait pas connue depuis un moment. Il vient de terminer un contrat d'intérim dans une grande entreprise (Vivendi), en tant qu'électricien (« Tu sais, je suis électro sur le tas, sans diplôme »), et vit aussi du « black » (travail au noir). A travers son discours et l'expérience qu'il relate, on perçoit bien que Didier est quelqu'un qui sait faire valoir des compétences diverses d'ouvrier. Avoir « des capacités » est même justement pour lui un critère de distinction, qui devrait être mieux reconnu par les employeurs : « Etre payé à 7 000 francs ? Non, je préfère faire pour moi [c'est-à-dire : travailler au noir]. Et je crois que je suis pas le seul, aujourd'hui, à raisonner comme ça. Pour ceux qui ont des capacités ». Au cours de son parcours, Didier a appris à travailler le bois, le métal, la mécanique fine, l'électricité. Il est fier de ses savoir-faire, qu'il monnaye sur le marché du travail illégal, à défaut d'être reconnu sans avoir à « faire des heures » et être « tout le temps barré » sur le marché légal. La compétence ouvrière constitue donc toujours une valeur centrale de classement et de reconnaissance sociale. Mais contrairement aux générations précédentes d'ouvriers du village, elle n'est plus rattachée à une mono industrie métallurgique qui formait elle-même et pouvait absorber une large partie des demandes d'emploi dans les environs. Mieux vaut à présent accumuler différents savoir-faire mobilisables dans un espace professionnel géographiquement élargi que de trop s'attacher à une industrie singulière. En effet, avec la fermeture de l'usine en 1981, le secteur de la métallurgie s'est brutalement trouvé sinistré et, du jour au lendemain, ne constituait plus un avenir ni vraiment possible, ni enviable. Au-delà de Didier, qui a la particularité d'avoir été partiellement élevé par ses grands-parents artisans, de nombreux jeunes se sont tournés vers les filières de formation destinant au petit commerce ou à l'artisanat (majoritairement CAP de coiffure pour les filles, de maçonnerie, plâtrerie ou peinture pour les garçons). Une fois que les deux PME nouvellement installées dans le village ont commencé à embaucher plus de personnel, beaucoup ont hésité à y postuler tant l'usine a constitué un repoussoir tout au long de leur enfance et de leur scolarité. Si bien que, même pour ceux qui finissent par entrer à l'usine, la mobilité et l'instabilité professionnelles se sont imposées dans les parcours.
La deuxième, et sans doute la plus complexe des appartenances bouleversées au cours de ces années de crise, est l' appartenance familiale . On perçoit bien que pour Didier, la référence au père est détournée, concurrencée par celle du grand-père. Au-delà de l'expérience intime de Didier, ce type d'image paternelle - et de rapports sociaux qu'elle introduit - est récurrent chez les jeunes hommes rencontrés. Ici, elle prend la forme d'une opposition entre la formation première de Didier, un CAP de fraiseur qui renvoie à l'univers usinier auquel a appartenu son père et dans lequel on aurait voulu le « balancer », et celle de charpentier acquise à l'AFPA, qui fait référence au monde artisan. Mais beaucoup plus généralement, les jeunes interviewés ont toujours eu beaucoup de mal à parler de leur père. Ce pan de l'enquête a souvent rencontré une forme de déni , comme chez cet ouvrier d'usine de vingt ans qui explique sa distance aux « vieux » ouvriers ainsi : « les vieux, les plus de quarante ans quoi, comme mon père, ils se font manipuler ». Par le directeur d'atelier qui se jouerait de leur manque de culture (« il y en a pas beaucoup qui doivent bien écrire »), par l'ancienne usine qui les a un jour débauchés sans qu'ils aient un mot à dire, et sans qu'ils puissent faire autre chose que d'attendre qu'un nouvel employeur se présente, par le patron actuel qui « les a choisis », et qui sait bien ainsi « qu'ils ne bougeront jamais » (Renahy, 2005, pp. 116-121). Ce déni de la filiation paternelle pose d'autant plus vivement la question de l'appartenance familiale que celle-ci est, de fait, souvent prolongée tardivement. En effet, la dépendance à la maisonnée parentale reste forte lorsque l'accès au monde du travail est chaotique, lorsque l'accès à un logement indépendant est rendu difficile du fait de la pénurie d'offres sur le marché locatif dans cette campagne bourguignonne, lorsqu'enfin le marché matrimonial lui-même est devenu instable. Didier fait référence à un « petit conflit » qu'il a eu avec sa petite amie il y a plus de dix ans. Depuis, tout en continuant à se fréquenter, ils habitent chacun de leur côté, lui dans la maison familiale, elle à 25 km de là, dans la petite ville où elle travaille. A 35 ans, Didier n'a donc pas d'enfants, et prolonge un état de célibat. Le logement qu'il habite n'est meublé que de manière sommaire, de nombreux travaux sont entamés ou bien « à faire », tant la vieille maison de village n'a pas été réellement entretenue depuis des années. Ce genre de situation de report de la vie maritale et de la procréation n'est pas rare, et la seule différence de Didier par rapport à beaucoup de jeunes trentenaires rencontrés, c'est que lui ne vit pas au domicile de ses parents.
Dans ce contexte, c'est dès lors l'appartenance élective qui trouve le mieux à se prolonger. Elle constitue un espace d'accès à une autonomie relative. La perduration des relations de bande établies dans l'enfance ou l'adolescence constitue une forme de rempart ultime contre les crises d'appartenances professionnelles et familiales. En marge du marché du travail où il faut sans cesse prouver sa « motivation » ou son « autonomie » avant d'obtenir un « vrai contrat », fréquenter régulièrement les copains permet de maintenir une place stable au sein d'un espace de reconnaissance où l'on à rien à prouver.
Et comme cette appartenance élective s'établit en partie contre les parents, elle engendre une forte incompréhension entre générations, que la consommation de stupéfiants peut cristalliser et rendre visible, mais qui renvoie, nous l'avons vu, à un processus beaucoup plus global de fragmentation du groupe ouvrier 92 ( * ) .
f) Conclusion
Le fait que Didier s'attache depuis de nombreuses années à une maison familiale en mauvais état, qu'il ne restaure que marginalement et qui ne lui appartient pas, illustre cette démonétisation du capital d'autochtonie que nous évoquions en introduction. Héritier d'un patronyme d'artisans auparavant reconnus dans l'espace local, Didier tente de se raccrocher à ce qui n'est plus qu'un symbole. Contrairement à la majorité des membres de la génération précédente, il lui est impossible de valoriser ce capital, bâti sur l'accumulation en un même lieu de ressources provenant d'appartenances professionnelles, familiales et électives. Les crises connues par les deux premières ont donné beaucoup d'importance à l'appartenance élective, qui se prolonge à présent tardivement dans les parcours des jeunes ouvriers, mais ne peut favoriser une intégration et une reconnaissance professionnelles. Si bien que l'isolement géographique de Foulange par rapport aux principales villes des environs est aujourd'hui synonyme de relégation sociale. Les frontières sociales, mesurées ici en termes de mobilité intergénérationnelle, se sont rigidifiées en regard de la situation rencontrée à l'entrée sur le marché du travail trente ans auparavant. Lorsque les savoir-faire ouvriers localisés, tels que ceux qui ont été développés dans ce village pendant des décennies, ne trouvent plus à être transmis d'une génération à l'autre, les jeunes générations des membres des classes populaires éprouvent beaucoup plus de difficultés à « trouver une place », et la reconnaissance sociale qui l'accompagne.
|
Bibliographie Beaud et Pialoux , 1999, Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de Sochaux Montbéliard, Paris, Fayard. Bouffartigue P. (dir.), 2004, Le retour des classes sociales. Inégalités, dominations, conflits, Paris, La Dispute. Castel R. , 1995, Les Métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard. Chauvel L. , 1998, Le destin des générations : structure sociale et cohortes en France au XXe siècle, Paris, PUF. Chauvel L. , 2001, « Le retour des classes sociales », Revue de l'OFCE, n° 79, pp. 315-359. Gollac S., 2005, « Faire ses partages. Patrimoine professionnel et groupe de descendance », Terrain , n° 45, pp. 113-124. Linhart D. Rist B., Durand E. , 2002, Perte d'emploi, perte de soi, Erès, Ramonville St-Agne. Oberti M. et Préteceille E. , 2004, « Les classes moyennes et la ségrégation urbaine », Éducation et sociétés, vol 14, n° 2, pp. 135-153. Pinçon M. et Pinçon-Charlot M. , 2007, Les Ghettos du Gotha : Comment la bourgeoisie défend ses espaces, Paris, Seuil. Renahy N. , 2005, Les gars du coin. Enquête sur une jeunesse rurale, Paris, La Découverte. Renahy N. , 2008, « Une lignée patronale à la mairie. Genèse et vieillissement d'une domination personnalisée (1850-1970) », Politix , n° 83, pp. 75-103. Renahy N. , 2009, « «Les problèmes, ils restent pas où ils sont, ils viennent avec toi". Appartenance ouvrière et mobilité de précarité », Agora Débats/Jeunesses, n° 53, pp. 135-148. Retière J.-N. , 2003, « Autour de l'autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire », Politix, n° 63, pp. 121-143. Schwartz O. , 1990, Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord, Paris, PUF. Terrail J.-P. , 1990, Destins ouvriers. La fin d'une classe ?, Paris, PUF. Trotzier C. , 2005, « Vingt ans de trajectoire après un licenciement collectif », Revue économique , Vol. 56, n° 2, p. 257-275. Weber F. , 1989, Le travail à-côté. Etude d'ethnographie ouvrière, Paris, EHESS. |
3. Les effets politiques d'accession
à la propriété sur les territoires
périurbains : mixité sociale et racialisation des rapports
de voisinage
Anne Lambert
(Ecole normale supérieure)
Cette communication propose de revenir, à partir des Enquêtes nationales sur le logement de l'INSEE et d'une enquête ethnographique menée dans une commune périurbaine du Nord de l'Isère, située à 35 km à l'Est de Lyon, sur la représentation très largement répandue - et souvent négative - des territoires périurbains comme espace de peuplement homogène destiné à des ménages modestes et « blancs », en proie à un séparatisme culturel. Au contraire, l'enquête souligne la diversification sociale et ethnique du peuplement des lotissements, qui peut être très marquée selon les configurations locales. La hausse des prix dans les grandes agglomérations et les politiques de soutien à la propriété mises en oeuvre par les élus locaux contribuent à fixer sur place des habitants qui n'ont ni les mêmes trajectoires sociales, ni les mêmes perspectives de mobilité : des jeunes couples de classes moyennes issus des grands centres urbains, des ménages d'ouvriers des environs, des familles de cités HLM souvent originaires du Maghreb ou d'Afrique sub-saharienne. Cette évolution sociale et ethno-raciale du peuplement interroge dès lors la redéfinition des modes de cohabitation à l'échelle locale mais aussi, plus largement, le sens social de la propriété.
a) Introduction
Je vous remercie pour cette invitation. Je vais donc vous parler au cours de cette brève présentation des effets des politiques de soutien à la propriété sur le peuplement des territoires périurbains, en termes de milieu social et d'origine géographique (j'utilise également au cours de l'exposé le terme « origine ethnique » par commodité de langage, même si cela renvoie trop, me semble-t-il, à des dimensions socio-culturelles et anthropologiques 93 ( * ) ). Quels changements peut-on observer au cours de ces vingt dernières années concernant les dynamiques de peuplement des territoires périurbains ? Et dans quelle mesure la doxa aujourd'hui très répandue « du » périurbain comme refuge pour « petits blancs », hantés par la peur du déclassement et tentés par le vote FN, apparaît-elle vérifiée ? Autrement dit, qu'est-ce que l'enquête sociologique approfondie apporte à cette représentation relativement figée, qui associe un type d'espace, de peuplement et de mode de vie ?
Pour répondre à ces questions, je confronte deux niveaux d'analyse, qu'il faut d'ailleurs toujours tenir ensemble quand on fait de la sociologie urbaine : le national et le local. En effet, les politiques de logement et de soutien à la propriété sont décidées et définies au niveau national mais leur mise en oeuvre apparaît de plus en plus conditionnée par le vote de subventions municipales, par exemple dans le cadre du Pass Foncier. En outre, les élus jouent un rôle croissant en matière de politique urbaine (par le classement des terrains à bâtir, la délivrance du permis de construire, etc.) tandis que le marché immobilier fonctionne au niveau de territoires ou de bassins d'emploi relativement circonscrits. Les évolutions locales peuvent donc être dé-correlées de certaines évolutions nationales, saisies par les analyses statistiques, et inversement, invitant à faire un va-et-vient constant entre ces différentes échelles d'analyse.
Dans mon travail de thèse, je m'appuie sur les données de l'Enquête nationale sur le logement de l'INSEE, une très riche et grande enquête réalisée à périodicité régulière qui permet de connaître les conditions de logement en France métropolitaine et leurs évolutions. J'ai comparé les données de 1984 et de 2006 sous l'angle de l'habitat pavillonnaire (en construisant une nouvelle variable « ménages qui ont récemment fait construire une maison dans une commune périurbaine » en 1984 et en 2006). Je m'appuie également sur une enquête ethnographique approfondie réalisée dans une commune périurbaine du Nord de l'Isère, située à 35 km à l'Est de Lyon. Au cours de six séjours de terrain dans cette ancienne commune rurale en forte croissance, j'ai notamment pu suivre la construction d'un grand lotissement de 64 lots et son peuplement, que j'ai comparé avec un autre lotissement équivalent construit dans la commune à la fin des années 1970, et avec les données du recensement. Les entretiens biographiques que j'ai menés avec tous les habitants du nouveau lotissement ainsi qu'avec les élus m'ont en outre permis de saisir les logiques (sociales, économiques et politiques) qui sous-tendaient la mobilité résidentielle des ménages et la manière dont l'action publique, au niveau local comme au niveau national, avait influencé leurs trajectoires. On peut dès lors mettre en avant trois résultats principaux.
b) La spécialisation sociale des lotissements périurbains
Au niveau national, les lotissements périurbains se sont spécialisés dans l'accueil des classes populaires sous l'effet combiné de la hausse des prix immobiliers dans les centres urbains d'une part, et du ciblage des aides publiques sur l'accession et le secteur du neuf d'autre part. Ainsi, les Enquêtes logement de l'INSEE montrent que les classes populaires ont de plus en plus de difficultés à accéder à la propriété depuis le milieu des années 1980 (ce qui constitue un résultat connu). Mais pour ces dernières, l'achat d'une petite maison sur catalogue en périphérie apparaît de plus en plus comme la seule manière d'accéder à la propriété.
Cette évolution s'inscrit dans un contexte historique de plus long terme. En France, après un demi-siècle de diffusion de la propriété dans les couches populaires, l'essor du modèle de la propriété occupante marque un coup d'arrêt au milieu des années 1980 (en lien avec la montée du chômage et la lutte contre l'inflation), et peine à repartir après la crise économique et immobilière des années 1990 malgré la multiplication des dispositifs publics d'aide (Prêt à l'accession sociale, Prêt à taux zéro simple ou doublé, Pass Foncier, etc.). Le taux de propriétaires stagne ainsi autour de 57 % 94 ( * ) . La répartition des statuts d'occupation du logement selon la PCS de la personne de référence du ménage montre alors qu'en 2006, les ouvriers sont proportionnellement près de deux fois moins nombreux que les cadres à accéder à la propriété (17 % des ouvriers contre 30 % des cadres) - un écart qui s'est creusé depuis 1984. Aujourd'hui, seul un tiers des ouvriers est propriétaire de son logement contre 41 % des cadres, alors que la proportion de propriétaires parmi les ouvriers et les cadres était quasi similaire en 1984 (respectivement 22 % et 24 %). Mais surtout, les ouvriers sont deux fois plus nombreux que les cadres à « choisir » de faire construire une maison quand ils deviennent propriétaires, alors que les cadres se tournent nettement plus souvent vers l'ancien et s'établissent majoritairement en ville. La géographe Martine Berger l'a très bien montré pour le cas de l'Ile-de-France : plus on s'éloigne des centres urbains, plus la part des ouvriers, notamment des ouvriers peu qualifiés, augmente, dans des proportions inverses à celles des cadres et professions intellectuelles supérieures.
Dans l'ensemble, les ménages ouvriers sont ainsi surreprésentés dans les espaces ruraux et les couronnes périurbaines par rapport à leur part dans la population métropolitaine et représentent respectivement 28 % et 32 % des habitants des territoires ruraux et périurbains en 2006. Ce mouvement centrifuge et sélectif socialement risque de se renforcer puisqu'en 2006, deux-tiers des ouvriers qui « font construire » une maison, quel que soit le mode effectif de construction (promoteur, constructeur, artisanat, auto-construction), s'installent dans une commune rurale. Au contraire, les professions intermédiaires et les cadres, même s'ils vont un peu plus souvent qu'avant dans l'espace périurbain et ses franges rurales, parviennent à maintenir leur avantage relatif dans les communes centres.
L'autre grand apport de l'enquête statistique est de montrer que le repli des classes populaires sur la construction de maison en périphérie s'accompagne d'un coût financier croissant pour ces ménages. En effet, c'est pour les ouvriers et les employés que le coût d'accès à la propriété a le plus fortement augmenté entre 1984 et 2006 en comparaison des cadres et professions intermédiaires. Les Enquêtes logement permettent dès lors d'analyser finement l'évolution des conditions de financement des logements à travers une série d'indicateurs. Les ouvriers sont par exemple ceux qui connaissent la plus forte progression des durées d'emprunt alors que la part de ceux qui achètent comptant a, dans le même temps, augmenté à l'autre bout de l'échelle sociale. La part des ménages qui s'endettent sur plus de 20 ans est ainsi passée en moyenne nationale de 2 % à 19 % entre 1984 et 2006, et de 2 % à 29 % pour les seuls ouvriers, renchérissant du même coup le coût du crédit pour ces catégories. On peut encore noter que c'est pour les ouvriers que le crédit immobilier représente le plus grand nombre d'années de revenus : en 2006, les emprunts contractés pour la maison représentent 3,4 années de revenus pour les ouvriers, contre 2,5 pour les cadres. C'est aussi pour les ouvriers que l'âge moyen d'accès à la propriété a le plus fortement reculé passant de 36 ans à 40 ans, sans lien avec l'évolution de la structure démographique de ce groupe. On pourrait multiplier les indicateurs socio-économiques mais je m'arrête ici pour aborder la deuxième conclusion de ce travail - la diversification ethnique du peuplement des lotissements périurbains -, une évolution qui est concomitante à la première mais qui ne la recoupe qu'imparfaitement.
c) La diversification ethnique du peuplement des lotissements périurbains
En sociologie et dans les études urbaines plus largement, les espaces pavillonnaires ont été appréhendés par opposition au parc HLM, que les couches moyennes et les fractions stables des classes populaires d'origine française ont commencé à quitter dès la fin des années 1960 à mesure que se développaient le marché de la maison individuelle et les aides à l'accession. Ainsi, la question des « origines ethniques » dans les pavillons a longtemps constitué un impensé en lien avec la faiblesse historique des migrants dans les banlieues pavillonnaires, mais aussi en raison d'un certain aveuglement du questionnement sociologique en la matière 95 ( * ) . La prégnance du débat, en France, sur les « statistiques ethniques » a également constitué un obstacle méthodologique à la saisie des « origines ». Jusqu'en 1996, les Enquêtes logement ne recensent en effet que la nationalité des individus, introduisant pour la première fois une question sur leur pays de naissance en 1996, puis une question sur la nationalité et le pays de naissance de leurs parents en 2006.
Pour autant, les données nationales disponibles montrent que la part des ménages issus de l'immigration qui accèdent à la propriété pavillonnaire a augmenté depuis les années 1980 même si cette évolution est lente d'une part, et reste difficile à mesurer d'autre part, à cause de la nature même des données. Ainsi, tout type de logement confondu, il apparaît que la part des ménages immigrés qui accèdent à la propriété a augmenté entre 1992 et 2006, passant de 32 % à 39 % 96 ( * ) . Non négligeable, cette évolution est deux fois plus forte pour les ménages immigrés que pour l'ensemble des ménages à la même période, montrant que l'écart entre les immigrés et le reste de la population tend à se réduire en matière de statut d'occupation du logement. Concernant le marché de la maison individuelle, les immigrés comptent pour 8 % des « acquéreurs récents de maison neuve », ce qui représente environ 46 000 ménages en 2006. Si la part des immigrés qui achètent une maison neuve apparaît faible en moyenne relativement à la part des immigrés dans la population française, elle masque toutefois de fortes différences selon les pays d'origine : les immigrés du Maghreb, notamment d'Algérie, sont proportionnellement moins nombreux à « faire construire » que les ménages originaires du Portugal et, dans une moindre mesure, de Turquie.
Concernant les secondes générations, l'enquête Trajectoires et Origines de l'INSEE et l'INED réalisée en 2008 montre que le taux de propriétaires est, en moyenne, plus élevé que celui des immigrés malgré de fortes différences selon les pays d'origine. L'échantillon est toutefois trop faible pour effectuer des traitements plus fins à l'échelle des différents groupes, en croisant type de logement, de statut d'occupation et de quartier. C'est également sur cet obstacle que bute l'Enquête logement de 2006.
Toutefois, ces données cumulées, qui demandent donc à être complétées, contribuent à remettre en cause certaines représentations figées du rapport des immigrés au logement. Certes, les immigrés restent surreprésentés dans les grandes agglomérations (de plus de 200 000 habitants notamment) et dans le parc d'habitat social par rapport à la population dite « majoritaire » 97 ( * ) . Mais, comme tendent à le montrer certains travaux récents, en moyenne, les immigrés et encore plus leurs descendants habitent majoritairement dans des espaces où ils sont minoritaires, dans le parc privé de logement 98 ( * ) . En outre, si les ménages d'origine étrangère restent en moyenne sous-représentés dans l'ensemble du parc pavillonnaire, les données agrégées peuvent masquer, localement, des évolutions très marquées. C'est le cas de certaines communes du Nord de l'Isère qui voient les zones pavillonnaires nouvellement construites connaître une forte diversification ethnique sous l'effet, notamment, de l'évolution des dispositifs nationaux d'aide à l'accession, de la redéfinition des politiques locales de logement et de l'ancrage des communes dans un bassin d'emploi industriel.
d) Au niveau local, des évolutions très marquées
A Cleyzieu 99 ( * ) , la diversification ethno-raciale du peuplement des lotissements est particulièrement marquée pour trois raisons principales d'ordre historique, politique et conjoncturel :
- cette évolution tient tout d'abord à l'ancrage de la commune dans un bassin d'emploi industriel et à sa situation plus large dans l'espace régional. Dès les années 1920/1930, mais surtout à partir des années 1960, une importante main d'oeuvre italienne, portugaise et algérienne s'est en effet établie dans le bourg industriel voisin, pour pourvoir les emplois d'ouvriers et de manoeuvres dans les usines locales. La stabilité professionnelle et le renouvellement des générations ont alors favorisé localement des trajectoires résidentielles promotionnelles, le foncier étant moins cher dans ce secteur et, plus largement, dans l'Est lyonnais que dans l'Ouest et les Monts d'Or.
- la mise en place d'une vaste politique de construction et d'aménagement par le maire de Cleyzieu à partir des années 2000 a en outre favorisé la production en masse de terrains à bâtir. Ainsi, de nombreux terrains ont été ouverts à la construction, viabilisés et divisés en petits lots dans le cadre de ZAC ou de lotissements privés. Des terrains de 400 à 500 m 2 se vendent ainsi autour de 100 000 euros dans la commune à la fin des années 2000, auquel il faut rajouter 80 000 à 100 000 euros pour une maison d'entrée de gamme vendue sur catalogue. Ce faisant, les nouveaux programmes immobiliers deviennent accessibles à une partie des ménages stables de classes populaires.
- il faut aussi prendre en compte des effets proprement conjoncturels. La crise économique amorcée en 2008 suite aux subprimes et à la déstabilisation du système financier international semble avoir joué « en faveur » des ménages issus de l'immigration sur le marché du logement, au niveau local. En effet, devant la difficulté à commercialiser les lots nouvellement viabilisés, les promoteurs et élus locaux ont retiré certains critères architecturaux et de peuplement qu'ils avaient formulés au moment de l'établissement du projet, au début des années 2000 (l'idée était alors de faire des « lotissements à l'américaine » favorisant l'installation des classes moyennes urbaines dans la commune). Au contraire, pour favoriser le remplissage des nouveaux lotissements, les élus se sont saisis des nouveaux dispositifs d'aide à « l'accession sociale » et ont voté des subventions municipales permettant de solvabiliser des ménages plus modestes (Pass Foncier notamment). Ainsi, la nouvelle conjoncture économique a laissé moins de place aux pratiques discriminatoires des intermédiaires du logement et des élus comme le résume un ouvrier algérien de 52 ans, ancien locataire HLM, qui a acheté un petit pavillon sur catalogue dans la commune en 2010 après avoir tenté d'obtenir un crédit pendant près de 5 ans : « Quand tu veux acheter, il y a pas ni Blanc, ni Noir, ni Rouge, le lotisseur il voit que les sous, il te voit en euros ! Franchement, c'est plus dur de faire la demande pour les logements en mairie... ». A partir de 2009, se sont ainsi installés dans la deuxième tranche du lotissement des Blessays (dont nous avons pu suivre la construction) des ménages beaucoup plus divers du point de vue de leurs origines sociales et géographiques.
L'enquête ethnographique permet de saisir finement ces évolutions. Dans le lotissement des Blessays, les nouveaux propriétaires sont pour moitié des ménages d'ouvriers, ce qui représente une proportion importante relativement à la part des ouvriers dans la population française. Un tiers des ménages d'acquéreurs a également à sa tête un immigré ou un étranger 100 ( * ) , une proportion qui passe à plus de 40 % quand on intègre les secondes générations. Cette évolution constitue un réel changement en comparaison avec d'autres lotissements plus anciens de la commune, où la part des ménages immigrés était quasi nulle au moment de la commercialisation. L'analyse systématique des entretiens réalisés avec tous les acquéreurs du lotissement des Blessays a alors permis de dégager 3 types de trajectoires d'accédants, qui n'ont ni les mêmes propriétés sociales, ni le même rapport au logement :
- le premier groupe est constitué de ménages d'ouvriers biactifs, ancrés dans l'espace local et plus âgés en moyenne que le reste des acquéreurs. Ces ouvrier-e-s travaillent dans les industries métallurgiques, textiles ou automobiles du secteur. Ils/elles sont plus souvent issus de l'immigration algérienne et, dans une moindre mesure, marocaine et turque. Pour ce groupe d'acquéreurs, la maison constitue l'aboutissement de la trajectoire résidentielle et fait l'objet d'un soin particulier, étant plus souvent construite sur un mode artisanal comme dans cette famille d'ouvriers marocains où ce sont deux frères maçons qui ont pris en charge l'établissement des plans et le gros oeuvre.
- le deuxième groupe est constitué des familles venues des grandes cités HLM de la banlieue lyonnaise, et massivement issues de l'immigration africaine (Maghreb et Afrique subsaharienne). Ces ménages se sont saisis des dispositifs d'aide à l'accession à la propriété pour « faire construire » une maison dans l'Est lyonnais, les aides permettant de financer, pour certains, jusqu'à la moitié du coût d'achat du terrain et de la maison. Pour ces ménages, la maison représente une promotion résidentielle certaine mais déstabilise aussi fortement l'économie domestique en raison de l'éloignement géographique des réseaux de sociabilité et d'entraide qu'elle génère, et de la nouvelle pression budgétaire qu'elle implique. C'est en particulier pour les femmes peu qualifiées qui travaillaient dans le tertiaire (comme vendeuse, caissière, etc.) dans la première couronne lyonnaise que le coût de la mobilité résidentielle apparaît le plus élevé. Certaines ont ainsi renoncé au travail salarié pour se spécialiser dans le travail domestique, n'ayant pas les moyens d'externaliser la prise en charge des enfants.
- le troisième groupe d'acquéreurs est constitué des jeunes couples de professions intermédiaires et de cadres venus de Lyon, souvent sans enfants ou avec des enfants en bas âge, pour lesquels la maison est vue comme une étape résidentielle en attendant de trouver « mieux ». Ces couples passent d'avantage par les circuits privés de financement du logement (banques commerciales et mutualistes). Plus jeunes que les autres habitants, moins présents en journée du fait de leurs horaires de bureau, ces derniers tendent pourtant à imposer leurs normes sociales et résidentielles au sein du lotissement et disposent d'un fort « pouvoir résidentiel » sur la scène locale. Ils prennent par exemple en charge le travail de représentation des nouveaux habitants auprès des élus, organisent les fêtes de voisinage, etc.
Au quotidien, la proximité spatiale entre ces trois groupes d'habitants aux trajectoires et aux propriétés sociales fortement différenciées ne favorise pas, mécaniquement, le rapprochement des modes de vie mais apporte son lot de conflictualité - rappelant certaines conclusions établies par Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire (1970) à propos des modes de cohabitation dans les grands ensembles d'habitat social de première génération. Des conflits éclatent par exemple régulièrement à propos de l'aménagement des jardins, de l'usage des parkings ou encore de la place des enfants dans le lotissement, qui sont liés à la confrontation de normes résidentielles et éducatives socialement situées. Toutefois, à la différence des deux sociologues précédents, les logiques d'identification raciale apparaissent nettement plus prégnantes dans les nouveaux lotissements. Les catégories ethno-raciales mobilisées, plus ou moins raffinées selon le degré de connaissance pratique de l'immigration (des « Noirs », aux « Camerounais », « Congolais »...), servent à identifier les voisins au quotidien, parfois davantage que le statut professionnel. Mais elles ne signifient pas systématiquement racisme et adhésion à une idéologie raciste, de sorte que l'on aurait tort de réduire l'ensemble des habitants de ces nouveaux lotissements à des électeurs potentiels du FN (le vote FN reposant lui-même sur des logiques complexes). Dans certains cas toutefois, les processus d'assignation identitaire sur la base de catégories ethno-raciales servent à altériser et à inférioriser certaines familles et groupes d'habitants dans l'espace local, recréant une hiérarchie largement indépendante des ressources socio-économiques et des statuts socio-professionnels des individus.
e) Conclusion
En conclusion, l'enquête montre que les lotissements périurbains constituent des espaces de mixité sociale et ethnique dont l'importance a été sous-estimée. Ces derniers contribuent à redéfinir les frontières entre groupes sociaux au sein de la société française, sur des fondements à la fois matériels et symboliques qui sont largement entremêlés comme le montre l'observation ethnographique et l'analyse des rapports de voisinage. Les conclusions de notre enquête font plus largement écho au travail de l'historienne Annie Fourcaut (2000), qui avait souligné le rôle spécifique des lotissements construits dans la banlieue parisienne dans l'entre-deux-guerres (qualifiés de « lotissements défectueux »). Dans un contexte de pénurie de logement et d'absence de politique patronale de logement pour les ouvriers, ces nouveaux lotissements avaient en effet massivement accueilli des migrants de l'intérieur (les « provinciaux ») et de l'extérieur (les « étrangers »), contribuant à créer une grande diversité de peuplement au niveau local.
|
Bibliographie Barth F. (1999), « Les groupes ethniques et leurs frontières », in Poutignat P. et Streiff-Fenart J. (dir.), Théories de l'ethnicité , Paris, PUF, 203-249. Beauchemin C., Hamel C. et Simon P. (dir.) (2010), Trajectoires et Origines. Enquête sur la diversité des populations en France. Premiers résultats , Paris, INED, Document de travail n°168. Chamboredon J.-C. et Lemaire M. (1970), « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement », Revue française de sociologie , 11 (1), 3-33. Fassin D. (2002), « L'invention française de la discrimination », Revue française de science politique , 52 (4), 395-415 Fourcaut A. (2000), La banlieue en morceaux. La crise des lotissements défectueux en France dans l'entre-deux-guerres , Grâne, Créaphis. Pan Ké Shon J.-L. et Scodellaro C. (2011), Discrimination au logement et ségrégation ethno-raciale en France , Paris, INED, Document de travail n°171 Préteceille E. (2009), « La ségrégation ethno-raciale a-t-elle augmenté dans la métropole parisienne? », Revue française de sociologie , 50 (3), 489-519 Safi M. (2009), « La dimension spatiale de l'intégration des populations immigrées (1968-1999) », Revue Française de Sociologie , 50 (3), 521-552 Simon P. (2008), « Les statistiques, les sciences sociales françaises et les rapports sociaux ethniques et de `race' Revue française de sociologie , 49 (1), 153-162. |
TABLE-RONDE N° 3 - INSTITUTIONS ET PARTICIPATIONS POLITIQUES ET CITOYENNES
Président : Christian Paul, député de la Nièvre
Modérateur : Sylvain Bourmeau, Libération
Invitée témoin : Michèle Bedu-Dumas, présidente de la MJC de Feigneux
La recomposition institutionnelle du territoire a eu des effets profonds : l'intercommunalité contribue à redéfinir les politiques publiques et la fiscalité tout autant que le profil des élus. Dans le même temps, certaines représentations stigmatisantes des mondes ruraux se perpétuent.
1. La montée en puissance de
l'intercommunalité, entre gestion rationnelle et renforcement des
identités
Francis Aubert, Quentin Frère
(UMR 1041 CAESER, INRA, AgroSup Dijon)
L'organisation territoriale du pays est caractérisée par l'extrême fragmentation de son échelon élémentaire, l'échelon communal, à laquelle s'ajoute une superposition complexe de collectivités territoriales aux combinaisons parfois peu lisibles. Périodiquement, le législateur entend réformer et simplifier l'ensemble du dispositif. L'exercice est d'autant plus important que la décentralisation a produit un accroissement notable des compétences des collectivités territoriales dans un contexte de transformations profondes de la géographie humaine de l'ensemble. Au niveau local, les acteurs cherchent à s'organiser sur le mode de la coopération volontaire dans le respect des prérogatives de chacun, en constituant un plan d'échelon supérieur de nature intercommunale.
Dans le paysage national de la coopération intercommunale, les enjeux sont de nature et d'intensité différentes selon les caractéristiques des espaces. Les communes qui constituent des pôles urbains ont à gérer un ensemble conséquent de services et d'équipements, avec un niveau élevé de charges de centralité, dans des espaces relativement peu intégrés ; les communes rurales sont fragmentées et leurs moyens limités, alors qu'elles doivent couvrir les effets de la dispersion et de l'éloignement, sachant que la plupart des solutions se situent à un échelon plus élevé ; entre ces deux situations polaires, les petites villes ou les communes périurbaines sont aussi sujettes à différents problèmes qui rendent compte également des tensions entre l'autonomie locale et l'intégration territoriale.
Pour examiner ces questions, nous rappelons d'abord les termes principaux par lesquels l'évolution de la carte des territoires a abouti à la situation actuelle, associant les maillages communaux et intercommunaux dans de subtils entrelacs, et la resituons dans le contexte européen. Nous nous plaçons essentiellement d'un point de vue économique, en réinterrogeant les difficultés apparentes de gestion territoriale du double point de vue de la nécessité de concilier, d'une part, des effets d'échelle, qui tendent à priori à élargir les périmètres pour diminuer les coûts, et des effets de cohérence, qui pousseraient au contraire à limiter les aires d'action pour être au plus près des préférences des habitants et, d'autre part, des comportements stratégiques individuels des communes, à la recherche de solutions adaptées à leur propre situation.
a) La question intercommunale, un paradoxe de la décentralisation à la française
(1) Un découpage communal hérité
Une commune pour chaque paroisse. C'est sur cette logique que la carte communale a été construite à l'issue de la Révolution française. Depuis, elle n'a évolué qu'à la marge, si bien qu'aujourd'hui on dénombre près de 36 700 communes dans le pays. En comparaison avec ses voisins européens, la France peut se prévaloir d'être le pays au plus grand nombre de communes, loin devant l'Allemagne (11 553 communes), l'Espagne (8 116 communes) et l'Italie (8 094 communes). Toutefois, si ce maillage fin du territoire présente des avantages certains (voir Section 2), il n'est pas sans présenter d'importantes limites.
Le principal écueil est évidemment la faible population de chaque commune. Juste après la République tchèque, la France est le pays européen où la population communale moyenne est la plus faible (1 770 habitants en moyenne par commune). En conséquence de l'urbanisation, le territoire est aujourd'hui marqué par de fortes inégalités démographiques, avec plus d'une commune sur deux ne dépassant pas les cinq cents habitants. Bien souvent, elles sont alors en grande difficulté pour financer les biens et services publics dont elles ont la charge. C'est le principal problème de la fragmentation municipale.
Par ailleurs, cette tension est exacerbée par la hausse constante des standards de qualité des biens et services publics locaux. À titre d'exemple, la loi du 13 juillet 1992, prescrivant une gestion des déchets plus respectueuse de l'environnement, a quasiment doublé les coûts de ce service en l'espace de dix ans (Dallier, 2006). Des illustrations similaires peuvent être fournies dans les domaines des transports publics urbains ou du traitement et de la distribution de l'eau, deux services publics relevant des compétences communales.
Enfin, ce constat s'inscrit dans un contexte général de rationalisation du secteur public, où l'on cherche à mieux produire et à moindre coût les biens et services publics. Or aujourd'hui, les limites administratives des communes se révèlent trop petites par rapport aux aires d'activités économiques ou de consommation des ménages, considérablement élargies par l'interdépendance des territoires et les mobilités toujours plus fortes des agents.
Aussi, les transformations qui marquent la géographie économique et sociale du pays tendent à redistribuer les populations dans l'espace par un phénomène général de desserrement urbain, tandis que les activités demeurent principalement soumises au mécanisme d'agglomération. Les villes centres, tout en conservant leurs fonctions de centralité, voient se développer des couronnes périurbaines au sein desquelles des zones entières se spécialisent sur des orientations résidentielles, mais aussi commerciales ou productives, voire récréatives. Les décalages se multiplient entre ces aires spécialisées, qui tendent parfois à une certaine autonomisation, et l'organisation territoriale de l'agglomération au sein de laquelle se déroulent l'essentiel des flux et des transferts. Ils sont d'autant plus marqués dans leur inscription spatiale que l'agglomération est de grande dimension, mais toutes les aires urbaines sont concernées, y compris celles qui sont centrées sur des petits pôles.
Du côté des communes rurales, les changements passent par une dynamique démographique renouvelée, à base de flux migratoires, ainsi que par une restructuration du tissu économique, où les fonctions productives traditionnelles sont progressivement érodées et partiellement remplacées par des fonctions résidentielles. Dans la plupart des cas, le décalage s'accentue entre les lieux de concentration des activités, qui génèrent les bases fiscales les plus élevées, et les lieux de résidence, qui supposent les dépenses publiques les plus fortes. Par conséquent, il paraît pertinent de raisonner certaines compétences à un niveau supra-communal, tant pour améliorer la qualité que pour bénéficier d'économies d'échelle, permettant ainsi de réduire la dépense publique locale.
Dès lors, le découpage historique apparaît en décalage par rapport aux enjeux et contextes locaux actuels. Afin d'alléger la charge des communes, une première solution consisterait logiquement à remonter certaines responsabilités à un niveau de gouvernement supérieur. Pourtant, au début des années 1980, l'Acte I de la décentralisation a impulsé le mouvement inverse. Des compétences ont été transférées depuis l'État central vers les communes, les départements et les régions, ces dernières devenant à l'occasion le troisième niveau de collectivité territoriale. Au lieu de les apaiser, cette redistribution des compétences a alors exacerbé les tensions pesant sur l'échelon communal qui a vu s'élargir ses prérogatives. Pour résoudre ce dilemme, une réforme ambitieuse du niveau communal s'imposait.
(2) La coopération intercommunale volontaire comme compromis
Afin d'apporter une solution au problème de la fragmentation municipale, le législateur entend réformer l'échelon élémentaire : la loi du 16 juillet 1971 s'y attache. L'objectif est alors d'accroître la taille des communes en les incitant à fusionner selon deux modes : ( i ) la fusion simple, où une commune nouvelle est créée et se substitue intégralement aux anciennes communes fusionnant ; ( ii ) la fusion-association, prévoyant la création de communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes. Ce second mode de fusion permet alors aux communes fusionnant de conserver une certaine autonomie, à travers notamment la mise en place d'un maire délégué et d'une annexe de la mairie.
Dans ses grandes lignes, cette loi lassait donc déjà entrevoir la difficulté de réaliser des fusions de communes à grande échelle en France. En effet, il apparaît que les citoyens possèdent un attachement identitaire fort à leur commune, qu'il leur est difficile de rompre au nom d'une rationalisation institutionnelle ou d'une efficacité de gestion. La fusion-association présentait alors un compromis entre la préservation des identités locales et la nécessité de réformer l'organisation du secteur public local.
Toutefois, avec seulement 1100 communes supprimées par l'intermédiaire de ces fusions (Courtois, 2009), soit une diminution de moins de 3% du nombre de communes françaises, la loi de fusion apparaît aujourd'hui comme un échec. Il a donc fallu explorer une nouvelle piste pour résoudre le problème de la fragmentation municipale, sur le mode de la coopération intercommunale volontaire. Plusieurs communes voisines peuvent décider d'exercer collectivement une ou plusieurs compétences. Elles créent un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), auquel elles transfèrent les compétences qu'elles ont défini comme relevant d'un intérêt communautaire.
Il ne s'agit pas d'une création ex nihilo. Les premiers EPCI sont apparus en France à la fin du XIX ème siècle avec la loi du 22 mars 1890. Ce sont à l'époque des SIVU (syndicats intercommunaux à vocation unique) prenant la forme d'une simple association de communes. L'objectif est limité mais toujours d'actualité : il s'agit de permettre aux communes de s'organiser collectivement pour assurer certaines compétences qui dépassent leurs capacités individuelles. C'est alors par le biais de ces SIVU que la France a parachevé son électrification et développé son réseau d'eau. Aujourd'hui encore, on dénombre plus de 10 000 SIVU en France dont les compétences de prédilection se sont étendues aux services publics locaux de réseaux en général, avec par exemple le ramassage scolaire ou la collecte et le traitement des ordures ménagères.
Mais après l'échec de la politique de fusion des communes, et étant donné les tensions pesant sur l'échelon municipal, la France donne un second souffle a l'intercommunalité avec une série de réformes à partir des années 1990 101 ( * ) . L'objectif est alors de s'orienter vers une forme de coopération locale volontaire plus intégrée, où l'EPCI se voit doté de compétences élargies et de pouvoirs fiscaux. La coopération intercommunale passe alors d'une forme associative à une forme fédérative. D'un point de vue quantitatif, cette stratégie s'est avérée efficace avec plus de neuf communes sur dix qui ont spontanément intégré un EPCI à fiscalité propre en 2010.
Ainsi, la récente montée en puissance de l'intercommunalité en France est le fruit d'un contexte historique et institutionnel particulier, avec une carte communale figée depuis la Révolution française, qui se trouve aujourd'hui en décalage dans des contextes socio-économiques locaux en perpétuelle mutation. Avec les Actes I et II de la décentralisation, ce besoin de réformer en profondeur l'échelon communal s'est fait encore plus pressant. La coopération intercommunale volontaire à la française a alors permis, en substitution aux fusions de communes qui n'ont pas trouvé de terrain politique propice, de réaliser un compromis entre la recherche d'une efficacité de gestion et le maintien des identités locales indissociables des communes. Toutefois, loin d'être un cas isolé, la situation française présente d'importantes similitudes avec ses voisins européens.
(3) La coopération intercommunale dans les autres pays européens
Ces dernières décennies, on observe trois tendances communes à la plupart des pays européens dans les choix de réforme institutionnelle de leur secteur public : la décentralisation, le redécoupage de l'échelon élémentaire et le développement d'un mode de coopération locale volontaire (voir aussi Frère et Paty, à paraître ).
Comme en témoigne Greffe (2005), au cours des deux dernières décennies, les pays européens ont tous mis en oeuvre d'importantes réformes en faveur de la décentralisation. Cette volonté de rapprocher les décideurs publics des citoyens s'appuie sur une idée simple : en rapprochant les gouvernants des gouvernés, la qualité démocratique du secteur public s'améliorerait via deux canaux complémentaires. D'une part, les citoyens bénéficieraient ainsi d'une meilleure information sur les actions des décideurs publics (Brennan et Buchanan, 1980), et d'autre part, les politiques publiques mises en place pourraient mieux prendre en compte l'hétérogénéité spatiale des préférences des citoyens (Tiebout, 1956). Dès lors, une responsabilité devrait être attribuée au plus petit niveau d'autorité publique compétent pour la gérer. C'est le principe de subsidiarité. En revanche, cela ne déresponsabilise pas pour autant les niveaux supérieurs, au contraire : le niveau supérieur a le devoir d'intervenir si la responsabilité excède les capacités de l'échelon inférieur, ou s'il peut la gérer plus efficacement. C'est le principe de suppléance, parfois appelé « principe de subsidiarité ascendante ». Ainsi, principes de subsidiarité et de suppléance marchent de concert et définissent la logique générale de décentralisation partagée par l'ensemble des pays européens.
Cependant, afin d'assumer pleinement cette décentralisation accrue, de nombreux pays d'Europe ont en parallèle mis en place d'importantes révisions des périmètres administratifs de leur échelon élémentaire de gouvernement. Le but était de réduire le nombre de communes afin d'en accroître la taille, souvent par le biais de fusions volontaires ou obligatoires (voir CCRE-CEMR, 2009). Ainsi, au cours des années 1970, le nombre de communes allemandes a été divisé par trois, et par cinq pour les communes danoises et belges. Plus récemment en Grèce, les lois Kapodistrias et Kallikratis ont fait passer le nombre de communes de près de 5 800 en 1997, à seulement 325 aujourd'hui. Dans un autre genre, le Danemark et la Suède ont opté pour une solution radicale mais efficace : le redécoupage des circonscriptions municipales.
Là où la France avait échoué avec la loi Marcellin, comment d'autres pays européens sont-ils parvenus à redessiner leur carte communale ? Les raisons sont sans doute multiples et propres à chaque cas. A titre illustratif, le cas de la Finlande peut se révéler instructif : « Les fusions étendues, impliquant plusieurs communes, soulèvent évidemment la question d'identité, mais cela n'a pas été au centre du débat. En Finlande, l'administration locale est, par-dessus tout, responsable des services sociaux et du cadre de vie, dont la gestion et le financement nécessitent d'importantes ressources économiques et humaines. La structure municipale ne pouvait y être maintenue uniquement pour des fins identitaires » (CCRE-CEMR, 2009, p.21). Aussi cet arbitrage met-il en évidence toute la complexité des mécanismes déterminant le paysage institutionnel d'un pays, où se mêlent contextes culturels, historiques, économiques et institutionnels, faisant de chaque pays un cas unique. Ainsi, les différents pays européens témoignent d'une très forte diversité d'organisation institutionnelle plus ou moins centralisée, avec des Etats fédéraux, des Etats unitaires dont certains à autonomies régionales, une structure en un, deux ou trois niveaux de gouvernements locaux et dont la population moyenne de l'échelon élémentaire varie dans un rapport de 1 à 90 selon les pays.
Pourtant, comme le remarquent Hulst et Van Montfort (2010, p.8), « [...] la coopération intergouvernementale impliquant les communes est un phénomène présent chez tous les pays de l'Europe de l'Ouest. Dans certains elle a une longue histoire, dans d'autres elle est relativement récente ; elle varie par son étendue, son poids et sa forme, mais n'est jamais complètement absente . » Le modèle de coopération le plus largement répandu en Europe correspond à une intercommunalité associative à vocation le plus souvent multiple, avec pour domaines privilégiés de compétences la gestion de l'eau, des déchets, la circulation et les transports, l'aménagement du territoire, l'éclairage, les services de secours, la protection de l'environnement, le développement touristique, économique, culturel, les équipements sportifs et les services médicaux (CDLR, 2007). Sa création respecte le volontariat des collectivités, lequel étant plus ou moins encadré par le gouvernement central, comme en Italie par exemple où les communes en régions montagneuses sont obligées de coopérer au sein d'une comunità montana . Même si certaines compétences peuvent être obligatoires, il revient aux communes membres de déterminer collectivement quelle(s) compétence(s) elles transfèrent à la structure intercommunale. Les organes de l'intercommunalité sont élus au suffrage universel indirect.
Mais derrière ce modèle général, les pratiques en matière de coopération intercommunale en Europe révèlent ici encore une forte diversité que l'on ne peut interpréter indépendamment des contextes socio-économiques locaux, de l'organisation institutionnelle des Nations, de leur degré de décentralisation et de leur Histoire 102 ( * ) (voir aussi CCRE-CEMR, 2009). L'exemple finlandais est à nouveau instructif. Les communes sont de taille relativement importante (15 961 habitants en moyenne), et pourtant elles sont bien souvent dans l'incapacité de financer de manière individuelle un grand nombre de biens et services dont elles ont la responsabilité. Avec un secteur public très fortement décentralisé, les communes finlandaises sont responsables de compétences extrêmement étendues et coûteuses. Avec des communes pourtant plus grandes, la Finlande fait ainsi appel à la coopération intercommunale pour des motivations similaires à la République tchèque et la France, et dans une moindre mesure à l'Italie et l'Espagne, pays où la fragmentation municipale et la disparité des territoires ne permettent pas aux communes de répondre individuellement aux besoins de leurs citoyens. A contrario, au Royaume-Uni où les districts, pourtant collectivités territoriales de premier niveau, atteignent des sommets avec plus de 150 000 habitants en moyenne (contre 1 767 pour une commune française), le rôle de la coopération intercommunale y est limité et la priorité mise sur des objectifs de coordination via les orientations stratégiques communautaires.
Ainsi, si la coopération intercommunale est aujourd'hui présente à travers toute l'Europe c'est que son ambition générale demeure universelle : celle d'améliorer le design institutionnel territorial. En revanche, la diversité des pratiques témoigne de la multitude d'enjeux portés par l'intercommunalité et résulte notamment des caractéristiques institutionnelles, économiques, culturelles et historiques des pays.
b) La coopération intercommunale ou la quête du design institutionnel optimal
(1) La taille optimale des unités de gouvernements locaux, un arbitrage délicat entre avantages et inconvénients d'agglomération
« Faire ensemble mieux et à moindre coût pour le contribuable, ce que chaque commune seule ne peut faire ou ferait moins bien et à un coût plus élevé. » Cette maxime révèle la vocation première de l'intercommunalité qui apparaît alors comme une application directe du principe de subsidiarité ascendante. Plusieurs arguments économiques peuvent expliquer cette demande de centralisation, avec en ligne de mire, la possibilité de réaliser des économies de taille. En effet, il apparaît que de nombreux coûts peuvent être mutualisés par des communes voisines (coûts fixes de production, coûts organisationnels ou administratifs, coûts décisionnels, etc.). En coopérant, ces coûts ne sont plus supportés par chaque commune individuellement mais par l'ensemble. Elles peuvent ainsi parvenir à réduire le coût total - et donc le coût moyen - de production de certains biens ou services publics locaux. De telles économies apparaissent notamment pour les services en réseau comme la distribution et la gestion de l'eau et de l'énergie. Dès lors, plusieurs effets sont envisageables.
Tout d'abord, les décideurs publics locaux pourraient choisir de maintenir l'offre de biens publics constante et réduire ainsi la dépense publique locale. En ces temps où la maîtrise des déficits publics figure parmi les enjeux prioritaires de la plupart des pays européens, cette possibilité fait de l'intercommunalité un outil d'aménagement du territoire de choix 103 ( * ) . A contrario, ces économies de taille pourraient être réinvesties dans l'offre de biens publics - en améliorant par exemple leur qualité - et la dépense publique locale serait maintenue constante. Enfin, cette mutualisation des moyens pourrait permettre de produire de nouveaux biens publics locaux qui étaient jusqu'alors trop coûteux, mais qui deviennent désirables lorsqu'ils sont financés par une base plus large. C'est « l'effet zoo » d'Oates [1988], un enjeu particulièrement important pour les communes rurales qui ont vu leur population considérablement diminuer du fait de l'exode rural 104 ( * ) .
On remarque alors que les économies de taille dégagées par l'intercommunalité ne peuvent être résumées à une baisse de la dépense publique locale. Ces trois effets se mêlent, si bien que l'on pourrait même observer une hausse de la dépense publique locale dans les cas où l'effet zoo est le plus intense. Toute la difficulté consiste alors à disposer de données fines pour développer une méthodologie empirique ceteris paribus . En outre, ces trois enjeux constituent les fondements économiques principaux de l'intercommunalité qui aspire, de manière générale, à améliorer l'efficacité productive du secteur public local.
Par ailleurs, en élargissant les zones de production et de financement des biens publics locaux, la coopération intercommunale permet de limiter deux types d'effets externes dus à la mobilité des agents économiques : les effets de débordement des biens publics locaux et la concurrence fiscale qui peut exister entre communes.
Dans le premier cas, on analyse l'impact de la mobilité des citoyens sur la production de biens publics locaux. On remarque alors que des citoyens mobiles peuvent profiter des biens publics produits par les communes voisines. Ils bénéficient ainsi d'un bien qu'ils ne financent pas et préfèreront donc que leur commune ne le produise pas. On assiste alors à une sous-production générale de biens publics locaux.
Dans le second cas, c'est la mobilité des bases fiscales qui est en cause. Lorsqu'une commune diminue son taux d'imposition, une partie de la base fiscale concernée migre depuis les communes voisines vers cette commune. Il s'agit d'une externalité fiscale négative que chaque commune ignore lorsqu'elle définit sa politique fiscale. Si les décideurs publics sont bienveillants, il en résulte alors une sous-imposition générale, d'autant plus importante que la base fiscale est mobile (voir Wilson [1999] ou Madiès et al. [2005] pour une revue de littérature).
En transférant une compétence à une collectivité supérieure plus grande géographiquement, on rend plus coûteux tout déplacement de ce type. La mobilité des agents est ainsi plus faible entre intercommunalités qu'entre communes et ces effets externes sont (partiellement) internalisés.
De manière générale, ce phénomène soulève le problème de l'interdépendance des économies locales. Aussi, la coopération intercommunale permet-elle de raisonner à une dimension plus haute qui, dans certains cas, peut se révéler plus pertinente que l'échelon communal, trop petit et dépassé par la dimension géographique que recouvrent certaines compétences locales. En particulier, la coordination de politiques publiques locales peut ainsi être améliorée, notamment en matière de transports urbains, d'aménagement du territoire ou de développement économique. C'est dans cette logique qu'en France, près de neuf EPCI à fiscalité propre sur dix se sont vus transférer les compétences d'aménagement et de développement économique. De même, on constate que l'organisation des transports publics urbains est une compétence privilégiée par les communautés urbaines et communautés d'agglomération, avec plus de 97 % d'entre elles exerçant cette compétence (Frère et al. , 2011). Cette statistique illustre le fait qu'en coopérant, des communes voisines peuvent dégager des gains substantiels de coordination. La qualité des services de transports collectifs notamment peut ainsi être améliorée par ce seul remaniement organisationnel, sans que son coût de production ait augmenté.
Par ailleurs, en mutualisant les dépenses et éventuellement les recettes fiscales des communes, la coopération intercommunale génère, de fait, d'importants mécanismes redistributifs. Guengant et Gilbert [2008] en dénombrent quatre au sein des EPCI à fiscalité propre français, tous contribuant à faire de l'intercommunalité un vecteur important de péréquation locale. Ils constatent que la coopération intercommunale a ainsi permis de gommer jusqu'à 80 % des inégalités de potentiel fiscal entre les communes membres.
L'intercommunalité semble donc apporter une solution aux nombreuses difficultés auxquelles les communes sont aujourd'hui confrontées. Néanmoins, ce mouvement de centralisation de la décision publique génère aussi des inconvénients. Ainsi, comme nous l'évoquions précédemment, la qualité démocratique du secteur public diminue avec son degré de centralisation. Lorsqu'une compétence est exercée par une intercommunalité plutôt que par chacune des communes membres, l'hétérogénéité intercommunale des préférences des citoyens est alors moins bien satisfaite et un coût social apparaît. Cette dimension est par ailleurs d'autant plus sensible dans le cas de l'intercommunalité qu'elle est pointée du doigt dans la plupart des pays européens pour son manque de légitimité démocratique 105 ( * ) .
De plus, comme précisé plus haut, la coopération intercommunale permet de financer et de produire les biens publics locaux sur des zones géographiques plus étendues et ainsi, en limite les effets de débordement. Mais en parallèle, les citoyens devront alors parcourir, en moyenne, des distances plus importantes pour consommer les biens publics produits par leur propre intercommunalité. Par conséquent, la coopération intercommunale augmente mécaniquement le coût moyen d'accessibilité aux biens publics locaux. De même, il est à noter que lorsque plusieurs communes coopèrent pour la production d'un bien public local, cela peut générer des coûts de congestion que les communes ne supportaient pas auparavant. Ces coûts d'accessibilité et de congestion peuvent ainsi constituer un frein à la coopération intercommunale et peser sur la taille géographique et démographique des intercommunalités.
Au final, la coopération intercommunale révèle un savant dosage entre les avantages et inconvénients d'agglomération, où se mêlent coûts de production, coûts de l'hétérogénéité des préférences, coûts d'accessibilité et interactions spatiales. Et c'est en améliorant notre maîtrise de ces différentes composantes que l'on parviendra à construire une carte intercommunale pertinente.
(2) Pour une construction pertinente de la carte intercommunale
Le principe de volontariat, les larges marges de manoeuvres laissées aux communes et les importantes subventions de l'Etat ont, sans nul doute, constitué les principaux ingrédients du succès de l'intercommunalité en France. Plus de 95 % des communes ont ainsi spontanément intégré un EPCI à fiscalité propre, et plusieurs milliers de syndicats intercommunaux quadrillent le territoire. Quatre décennies après l'échec des politiques de fusion, la coopération locale semble donc apporter une solution à la fragmentation municipale du pays. Toutefois, le caractère apparemment inachevé de la nouvelle carte se découvre si l'on examine la pertinence des périmètres intercommunaux. Souvent trop petits, parfois même morcelés en dépit du principe de continuité territoriale, la « rationalisation » de la carte intercommunale s'impose dans la seconde phase du développement de l'intercommunalité 106 ( * ) . L'heure est maintenant venue de se concentrer sur des objectifs davantage qualitatifs et moins quantitatifs.
Un important travail est actuellement réalisé par les préfets, en concertation étroite avec les élus locaux, sur l'examen de la pertinence des périmètres intercommunaux. L'objectif est alors de redéfinir les limites des EPCI de telle sorte qu'elles soient davantage en adéquation avec leur intérêt communautaire. De manière générale, le périmètre économique pertinent d'un EPCI peut être défini comme le périmètre qui maximise les bénéfices d'agglomération et en minimise les coûts. Ainsi, on comprend qu'à chaque compétence donnée correspond un périmètre pertinent spécifique résultant de cet arbitrage. En particulier, on définira des périmètres d'autant plus importants que la compétence considérée permet de réaliser des économies de taille et répond à une demande spatialement homogène. A cet égard, l'entre-soi apparaît comme un comportement rationnel : une commune a intérêt à coopérer en priorité avec les communes voisines qui présentent des populations aux caractéristiques socio-économiques proches.
Par conséquent, la solution optimale consisterait à définir une multitude de niveaux gouvernementaux, chacun se révélant pertinent pour une compétence donnée. Toutefois, comme Buchanan et Musgrave (1999, p.157) le soulignent, « la cartographie détaillée [d'une telle situation] révèlerait un enchevêtrement d'unités de service, créant des coûts excessifs d'administration et surpassant les capacités administratives ». De plus, des économies de gamme peuvent apparaître lorsqu'une unité de production se voit confier plusieurs compétences. Le coût de production des biens et services publics diminue et le secteur public devient plus efficace. Ainsi, ces deux arguments plaident en faveur d'un nombre limité de niveaux de gouvernement, afin de contrôler les coûts administratifs engendrés, mais aussi de réduire les coûts de production des biens et services publics (voir Alesina et Spolaore, 2003, pour une illustration).
Dans ce cadre général, un EPCI admettrait donc pour périmètre pertinent l'ensemble de communes qui génère les plus grands bénéfices nets de coopération. Autrement dit, il s'agit de l'ensemble qui maximise les économies d'échelle, minimise les coûts de congestion et les coûts d'accessibilité aux biens publics locaux, internalise le plus d'externalités des choix publics locaux et dont les populations communales présentent des préférences similaires. Face à cet optimum, on se doute bien que la variété des situations locales, et notamment des possibilités effectives de coopération entre élus locaux, ne permettent pas de respecter mécaniquement cette pertinence économique.
(3) Principe de volontariat et comportements stratégiques
Une nouvelle tension apparaît ici entre l'idée initiale de l'intercommunalité, défendant une rationalité collective raisonnée à un niveau communautaire, et sa mise en oeuvre confiée aux communes, dont les choix sont opérés individuellement. Autrement dit, la rationalité communautaire diffère généralement de la rationalité des communes prises individuellement (Frère, 2012).
Afin d'illustrer ces propos, considérons le cas d'une commune périurbaine dont les citoyens bénéficient des biens publics fournis par la commune centre voisine. Ces effets de débordement peuvent alors être internalisés en créant un EPCI sur ce territoire, et les distorsions induites par ces externalités ne nieraient pas au bon fonctionnement du secteur public local. C'est la rationalité communautaire sur laquelle se base la pertinence économique des périmètres. Toutefois, pour que l'intercommunalité soit créée, il faut qu'une majorité qualifiée y soit favorable, soit : (i) deux tiers des communes, représentant plus de la moitié de la population de la communauté, ou (ii) la moitié des communes, représentant plus des deux tiers de la population de la communauté. Or la commune périurbaine n'a à priori pas intérêt à intégrer un tel EPCI, auquel cas elle devrait supporter une partie du financement de biens dont ses citoyens bénéficient gratuitement, moyennant un certain coût d'accessibilité. C'est la rationalité individuelle des communes sur laquelle s'est construite la carte intercommunale que nous connaissons aujourd'hui.
A l'opposé, comme la construction d'un EPCI ne nécessite pas une majorité absolue mais qualifiée des communes parties prenantes, les choix individuels des communes ne sont pas toujours respectés et une commune peut, par exemple, se retrouver membre d'un EPCI contre son gré. Pour se préserver d'une telle situation, certaines communes peuvent alors être tentées de se regrouper à des fins défensives. On observe notamment le cas de communes rurales qui se sont regroupées au sein d'un même EPCI afin d'éviter de se faire aspirer par l'EPCI de la ville centre voisine, et de voir ainsi leur pouvoir décisionnaire dangereusement s'affaiblir face à la position dominante de cette dernière. De même, d'autres communes, relativement « aisées » par rapport à leurs voisines, se sont regroupées pour se soustraire au rôle de financeurs nets des activités de l'EPCI. Enfin, les affinités et enjeux politiques ont parfois joué un rôle déterminant dans les décisions de coopération, au détriment de toute rationalité économique. Comme le résume Dallier (2006) « il existe donc une intercommunalité politique qui, comme l'intercommunalité d'aubaine, s'écarte du projet initial de l'intercommunalité à fiscalité propre ».
Ainsi, les différentes illustrations énumérées ci-dessus révèlent des cas de figure contrastés sur lesquels chacun peut se prononcer. Mais de manière générale, elles ne font que mettre en évidence un dilemme profondément ancré dans l'intercommunalité française, où les intérêts communautaires peuvent diverger des intérêts individuels des communes.
c) Conclusion
L'objectif de ce papier est de resituer la situation communale et intercommunale française dans une perspective géographique européenne et d'en apprécier les traits surprenants ou inattendus du point de vue de l'analyse économique. Le long cheminement de la carte des territoires rend compte des objectifs du législateur, qui a cherché à la fois la préservation de la forme communale historique et son regroupement à des fins d'efficacité de la gestion publique locale. La période contemporaine marque l'aboutissement de cette longue phase de recomposition volontaire, même si la taille et les contours des intercommunalités ne correspondent pas toujours aux périmètres attendus. Mais les différentes situations des pays européens montrent le caractère général de ces préoccupations d'inter-municipalité, par-delà les spécificités et les choix politiques nationaux.
L'analyse économique nous apporte des éléments de compréhension des difficultés de la coopération intercommunale, en reformulant les questions d'identité et d'attachement à l'échelon communal en termes de préférences homogènes à l'échelon fin de l'organisation sociale. Leur expression et leur satisfaction constituent un puissant contre-point à la recherche des économies d'échelle et d'agglomération. Dès lors, les effets de taille des communes considérées individuellement jouent un rôle prépondérant pour définir leurs perspectives territoriales. Mais ils se combinent aux effets de position dans l'espace, notamment à l'égard des pôles urbains où se constituent les économies d'agglomération. Les pôles urbains, les communes des couronnes périurbaines et les communes rurales se retrouvent ainsi reliées solidairement dans le maillage intercommunal avec leurs intérêts propres et leurs contributions respectives à la gestion publique locale du territoire de la République.
|
Bibliographie ADCF (2009). Portrait des intercommunalités rurales : périmètres, compétences et actions. Les Notes territoriales de l'ADCF . Alesina A, Spolaore E (2003). The size of nations . Cambridge : MIT Press. Brennan G, Buchanan JM (1980). The power to tax . Cambridge : Cambridge University Press. CCRE (2008). Balancing Democraty, Identity and Efficiency. Changes in local and regional structures in Europe . Publication du Conseil des communes et régions d'Europe. CCRE-CEMR (2009). The quest for «perfect territorial organisation»: Comparison across Europe. Publication du Conseil des communes et régions d'Europe et du Council of European municipalities and regions. CDLR (2007). Les bonnes pratiques en matière de coopération intercommunale en Europe. Publication du Comité européen sur la démocratie locale et régionale. Charlot S, Aubert F, Lépicier D (2010). Dynamiques de périurbanisation et intercommunalité dans les aires d'attraction urbaine de la région Champagne-Ardenne. Préfecture de Région-Cesaer. Courtois JP (2009). Projet de loi de réforme des collectivités territoriales . Rapport Sénat N°169. Dallier P (2006). L'intercommunalité à fiscalité propre. Rapport Sénat N°193. Frère Q (2012) Coopération intercommunale et offre de biens publics locaux. Une approche microéconomique des enjeux et des choix politiques des collectivités territoriales. Thèse de Doctorat, Université de Bourgogne. Frère Q, Hammadou H, Paty S (2011). The range of local public services and population size: Is there a «zoo effect» in French jurisdictions? Louvain Economic Review , 77 (2-3), 87-104. Frère Q, Pay S (à paraître). La coopération intercommunale en Europe : A la recherche du design institutionnel optimal. Dans La crise des systèmes fiscaux en Europe , Presses Universitaires de Grenoble, Collection libres cours, 23p. Greffe X (2005). La décentralisation . Paris : La Découverte. Guengant A, Gilbert G (2008). Le rôle péréquateur de l'intercommunalité : effets redistributifs entre communes au sein des communautés. Publication de l'Assemblée des communautés de France et DEXIA. Krouri M (2012). Bilan de l'intercommunalité avant la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale. Bulletin d'information Statistique de la DGCL , N°88. Madiès T, Paty S, Rocaboy Y (2005). Externalités fiscales horizontales et verticales. Où en est la théorie du fédéralisme financier ? Revue d'Economie Politique , 115 (1), 17-63. Buchanan JM, Musgrave RA (1999). Public finance and public choice: two contrasting visions of the state. MIT Press. Oates WE (1988). On the measurement of congestion in the provision of local public goods. Journal of Urban Economics , 24 (1), 85-94. Tiebout CM (1956). A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy , 64 (5), 461-424. Wilson JD (1999). Theories of tax competition. National Tax Journal , 52 (69), 269-304. |
2. De la mairie à la
communauté de communes : renouvellement des formes traditionnelles
d'action publique et transformation du personnel politique local dans les
mondes ruraux107
(
*
)
Sébastien Vignon
(UMR 7319 CNRS)
Bien qu'ils constituent une part écrasante du contingent des élus, les maires des petites communes n'ont fait l'objet que de rares études de science politique. Si la décentralisation a suscité un regain d'intérêt pour le pouvoir local, les recherches se sont presque toujours focalisées sur les villes et les professionnels de la représentation politique 108 ( * ) . C'est d'ailleurs en opposition à ces derniers que les maires des petites communes sont généralement désignés implicitement comme étant des « amateurs » de la politique dans la littérature scientifique 109 ( * ) . Pourtant, les campagnes ont connu des transformations socio-démographiques (déprise du monde agricole, extension de la mobilité résidentielle) et institutionnelles (généralisation de l'intercommunalité à fiscalité propre) majeures ces dernières décennies. Ces restructurations sont susceptibles de modifier les logiques de recrutement social des élus, les principes de (re)définition et les mécanismes d'appropriation des rôles électifs locaux. À partir d'une enquête de terrain réalisée dans le département de la Somme, cette contribution entend ainsi démontrer que cette double dynamique socio-démographique et institutionnelle engendre un renouvellement des formes traditionnelles d'action publique et une transformation du personnel politique local dans les mondes ruraux.
|
Le département de la Somme : un laboratoire d'observation privilégié Si le département a connu un processus de périurbanisation au cours de ces dernières décennies, il faut insister sur son caractère éminemment rural. En effet, 500 des 744 communes comprenant moins de 2 000 habitants appartiennent à l'« espace à dominante rurale » si l'on se réfère au zonage en aires urbaines et en aires d'emploi de l'espace rural (ZAUER) mis en place par l'Insee. Cette approche statistique détermine les espaces de faible densité selon l'intensité du lien fonctionnel qu'ils entretiennent avec la ville. Ce lien est mesuré par des effectifs d'emplois dans les centres urbains et par l'intensité des déplacements quotidiens entre le domicile à la périphérie de la ville et le lieu de travail dans le centre urbain. Les espaces de relation où sont concentrés des flux d'actifs et des lieux de résidences sont appelés des « aires urbaines ». L'« espace à dominante rurale » est un espace « résiduel », ce qu'il reste une fois définies les aires fonctionnelles d'influence des villes 110 ( * ) . Dans la mesure où nous souhaitons appréhender les modes d'exercice des activités d'élus au sein des espaces politiques les moins professionnalisés - et plus particulièrement le rôle de maire - nous avons retenu dans notre champ d'étude uniquement les communes comprenant moins de 2 000 habitants. Ce seuil démographique peut être soumis à discussion sur son degré de pertinence (pourquoi pas 2 500 ou 1 500 habitants ?), mais dans toute phase de construction de l'objet s'impose un choix de délimitation qui nécessite une part d'arbitraire. La nomenclature du ZAUER a été introduite dans nos analyses afin de prendre en compte la diversité et la mixité des différentes catégories d'espaces étudiés. Lors du recensement général de la population de 1999, le département de la Somme comptait 783 communes dont 744 avaient moins de 2 000 habitants. Au 1 er janvier 2008, 700 communes étaient rattachées à l'un des trente-et-un EPCI à fiscalité propre (une communauté d'agglomération, trente communautés de communes dont trois sont des structures inter-régionales). Le dispositif d'enquête déployé privilégie la complémentarité des méthodes : - une base de données intégrant les propriétés socio-politiques (sexe, âge, CSP, cumul de mandats, longévité élective, etc.) de l'ensemble des maires de la Somme et des édiles occupant un mandat dans un EPCI à fiscalité propre au lendemain des renouvellements municipaux de 2001 et 2008 ; - une série d'entretiens (70) avec les élus ruraux et périurbains et les agents administratifs des communautés de communes du département. 110 Philippe Perrier-Cornet, « La dynamique des espaces ruraux dans la société française » in Philippe Perrier-Cornet (dir.) , Repenser les campagnes, éd. de l'Aube, 2002 . |
Effectivement, les catégories socioprofessionnelles qui permettaient traditionnellement d'accéder au pouvoir mayoral laissent place - progressivement et de manière inégale selon les espaces considérés - à des élus qui revendiquent une légitimité gestionnaire ou managériale. Si les valeurs attachées à la personne et au dévouement du maire sont toujours présentes, elles tendent de plus en plus à être supplantées par de nouvelles ressources électorales : la compétence et la technicité. Ces dernières sont d'ailleurs hautement valorisées à l'échelon intercommunal. La réorganisation de la coopération intercommunale instaure effectivement une redéfinition de la hiérarchie symbolique des ressources politiques nécessaires à l'exercice du métier d'élu local. Les mandats de président et de vice-présidents des EPCI à fiscalité propre constituent de nouveaux trophées politiques à conquérir pour des élus dont le déroulement de la carrière politique s'organisait autour d'un cursus honorum exclusivement municipal. Cependant, les conditions d'accès aux postes stratégiques de ces nouvelles institutions sont très réduites puisque seule une minorité de maires détenteurs de ressources bien spécifiques peut y prétendre.
a) Évolutions du profil socio-professionnel des maires et des registres de légitimité électorale
Les critères qui jalonnent la sélection professionnelle des maires des petites communes ont effectivement évolué de manière significative depuis la Libération, et ce au détriment des agriculteurs qui ont longtemps occupé une position dominante dans les mairies. En effet, le modèle du maire sédentaire, ayant ses racines familiales dans la commune où il travaille et où il vit, incarné principalement par le maire agriculteur, est en perte de vitesse dans les communes les plus marquées par le processus de périurbanisation. Pour les élus des petites communes, à l'instar de leurs homologues urbains, il ne s'agit plus seulement d'accéder au centre du pouvoir municipal, mais aussi d'impulser des projets et de définir des stratégies de développement attestant de leur volontarisme et du dynamisme de leur territoire. La légitimité locale ne se réduit pas à la proximité ; l'activité des maires s'est technicisée. Le rôle du maire se définit aussi comme un entrepreneur de politiques publiques.
b) Déclin numérique des agriculteurs et essor des couches moyennes et supérieures
Le recrutement social des maires se caractérise par une écrasante domination masculine. Même si un processus lent de féminisation du poste s'est opéré depuis 1983, seulement 12 % des conseils municipaux ont désigné une femme maire lors du dernier renouvellement. Concernant l'âge des édiles, aucune évolution sensible n'est à souligner si ce n'est que l'âge moyen demeure supérieur à celui de leurs homologues des villes : 54,9 ans contre 51 ans. Les élus ayant moins de 40 ans sont toujours très minoritaires (6 %) dans les mairies où dominent les quinquagénaires (plus d'un élu sur trois). Le statut d'éligible se construit progressivement et suppose un long apprentissage pour se faire reconnaître . C'est en franchissant des étapes successives et en faisant ses preuves, soit dans des fonctions électives subalternes (conseiller municipal, adjoint), soit par un engagement préalable au sein des associations municipales, que se construisent les carrières politiques locales. Une écrasante majorité des édiles interrogés par questionnaire au lendemain des élections municipales de 2001 ont déclaré avoir appartenu à au moins une association communale (comité des fêtes, parents d'élèves, société de chasse, etc.) avant de briguer le mandat mayoral. Cet activisme associatif confère un capital de reconnaissance à leurs adhérents, surtout à ceux qui ne peuvent se prévaloir d'un fort ancrage territorial.
C'est principalement du point de vue professionnel que s'opèrent les mutations les plus importantes. En effet, le recul des agriculteurs est un des traits les plus marquants de l'évolution de la représentation politique des petites communes depuis la Libération. Plus généralement, ce sont les professions indépendantes qui voient leur autorité politique se dégrader. Depuis le scrutin de mars 2001, elles ont été supplantées par les salariés 110 ( * ) . Si les agriculteurs fournissent le contingent de maires le plus important et restent très largement surreprésentés au regard de leur part dans la population active (plus de 20 points d'écart), leur poids - actifs et retraités confondus - s'est néanmoins réduit de moitié depuis 1947 (72,5 % contre un peu moins de 33 % en 2008). La prédominance des agriculteurs perdure dans les communes de petite taille du rural profond , plus homogènes du point de vue de leur composition sociale. À l'inverse, ils éprouvent plus de difficultés à se maintenir dans les zones périurbaines : en 2008, un quart des maires de ces communes sont des exploitants agricoles contre un peu plus du tiers dans les villages de l'espace à dominante rurale (39 %) 111 ( * ) . Un écart se creuse effectivement entre les espaces périurbains, les villages situés dans l'espace à dominante rurale qui ont accueilli de nouvelles populations résidentes dès la fin des années 1970 - comme les communes situées en périphérie des pôles d'emplois ruraux - et ceux les plus excentrés, de (très) petite dimension, qui sont restés plus en marge de ce processus de restructuration sociale. Ce dernier rend de moins en moins opérantes les normes traditionnelles qui régissaient la sélection des élus dans les espaces d'interconnaissance qu'étaient les villages ruraux. Cette redistribution sociale du pouvoir municipal ne s'effectue pas au profit des catégories populaires. Depuis l'après-guerre, jamais le taux de représentation des employés et ouvriers n'a dépassé le seuil de 12 %. Le pouvoir municipal dans les petites communes promeut ainsi des profils d'individus qui ne sont que très imparfaitement les reflets sociologiques de la population comme en témoigne le graphique ci-dessous. Dans les petites communes, ce sont incontestablement les couches moyennes (instituteurs, fonctionnaires de catégorie B, techniciens principalement) et supérieures salariées (cadres d'entreprise et du secteur public, ingénieurs, professeurs) qui bénéficient du recul des agriculteurs.
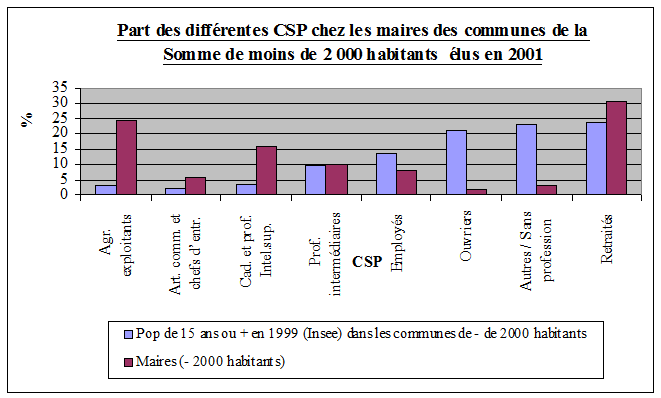
Source : Annuaires des maires de la Somme (1983, 1989, 1995 et 2001), ministère de l'Intérieur (2001, 2008), enquête par questionnaire auprès des maires (avril 2001),
Cette inégalité d'accès au pouvoir politique est une tendance lourde qui ne concerne pas uniquement les positions les plus élevées et les plus centrales du champ politique 112 ( * ) . Bien sûr, cette perte d'influence des agriculteurs est à mettre en relation avec la diminution des effectifs agricoles parmi les actifs. Mais, dans les villages où la population s'accroît et se diversifie socialement et où les enjeux locaux se revitalisent, celle-ci désigne des élus porteurs d'un autre modèle de gestion municipale. Les registres de la concurrence entre les candidats à la mairie ont évolué au cours de ces dernières décennies 113 ( * ) . On assiste à une démonétisation tendancielle, certes inégale selon les territoires, du « capital d'autochtonie » 114 ( * ) (ressources liées à l'enracinement local) des maires et à la nécessité pour les prétendants à la mairie d'en appeler à de nouveaux registres de mobilisation et de légitimité politique.
c) Un glissement progressif de la légitimité mayorale
L'apolitisme reste toujours un puissant ressort de l'engagement villageois 115 ( * ) , mais les formes classiques du dévouement se révèlent moins adaptées aux exigences croissantes de la bonne gouvernance municipale qui privilégie la détention de compétences techniques. Dans les campagnes des années 1960, les administrés attendaient de leur équipe municipale qu'elle symbolise avant tout une certaine unité au sein du village, et non qu'elle satisfasse des exigences 116 ( * ) . Or, depuis la décentralisation, le maire, y compris au sein des petites collectivités, n'est plus simplement intercesseur entre les services de l'État et la communauté villageoise et le gardien du consensus local, mais doit désormais être un décideur efficace. La réduction de la population agricole, les pressions foncières grandissantes sous l'effet de la périurbanisation, l'arrivée de ménages urbains en lotissement ou encore l'établissement de résidences secondaires, ont modifié en profondeur la composition sociale des campagnes et leurs modes de représentation politique. Les maires doivent satisfaire des attentes - inspirées des modes de vie urbains - qui ne s'exprimaient pas sous cette forme et qui supposent la détention de compétences et la maîtrise de savoir-faire et connaissances plus pointus en matière de gestion publique. La généralisation de la mobilité résidentielle fait que le seul nom ou l'attachement au lieu ne suffisent plus pour parvenir à conquérir ou à préserver le pouvoir municipal. Les valeurs attachées à la personne (notabilité locale) et au dévouement (proximité, services personnalisés, etc.), bien que toujours présentes, tendent de plus en plus à être supplantées par de nouvelles formes de ressources à mobiliser par les candidats à la mairie. À l'«éthos du dévouement» se substitue progressivement un « éthos de la compétence » (compétences techniques et/ou entrepreneuriales) 117 ( * ) . Ainsi, le mode de légitimité des élus qui se fonde exclusivement sur la proximité et le dévouement familier (le maire paternaliste ), tend progressivement à se déprécier. Ce registre « domestique » 118 ( * ) de l'engagement mayoral, qui repose sur la tradition et l'habitude, ne saurait être considéré comme l'apanage des grandes familles de notables ayant investi la fonction mayorale en raison de leur statut socio-économique, mais comme étant aussi celui d'élus, issus des milieux populaires (ouvriers, petits agriculteurs, artisans). Leur élection reposait essentiellement sur une notoriété acquise de longue date (enfant du pays ) grâce à un ancrage territorial ancien et leur volonté de se donner corps et âme à leur commune. Bien évidemment, la figure passéiste et désuète du notable rural, certes de plus en plus marginalisée dans le champ de la représentation politique, trouve encore à s'exprimer. C'est parfois le cas dans les petits villages à dominante agricole peu concernés par les migrations résidentielles et où les réseaux sociaux localisés sont les plus denses et les plus consistants. En revanche, dans les communes situées au coeur des recompositions sociale et résidentielle, les élus n'étant pas disposés politiquement et/ou socialement à revendiquer d'autres types de ressources (capacités décisionnelles, esprit d'entreprise) voient leur leadership disputé par des individus qui, jusque là, restaient marginalisés dans la compétition politique, parmi lesquels des nouveaux résidents qui choisissent de s'engager dans la vie municipale. L'accroissement du nombre d'élus appartenant aux catégories moyennes et supérieures, dépourvus d'attaches locales, témoigne d'ailleurs d'une certaine détérioration des mécanismes infra-politiques qui, traditionnellement, dans les villages où l'interconnaissance était généralisée, régulaient l'accès au rôle de maire et excluaient les individus et catégories sociales non-conformes aux normes dominantes 119 ( * ) . Plus généralement, les couches moyennes et supérieures s'investissent dans le rôle en y important des ressources (compétences techniques, capacité d'expertise) qui participent à la dévaluation progressive, selon les contextes, de celles détenues par les autres catégories d'élus (petits agriculteurs et artisans principalement) dont la légitimité s'est construite (uniquement) sur des critères traditionnels (interconnaissance, ancrage communal). Cette transition correspond à un lent processus d'obsolescence du capital d'autochtonie qui profite le plus souvent aux catégories sociales supérieures et moyennes en raison de la présomption de compétence dont ils jouissent.
Il ressort de nos analyses que l'enracinement local est devenu un des éléments de différenciation les plus significatifs entre les représentants du monde agricole et les autres élus. D'après notre enquête, un agriculteur sur cinq seulement ne peut se prévaloir d'aucune attache familiale dans la commune qu'il administre, ce qui est le cas de plus de la moitié des cadres, professions intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires. Pour ces élus qui ne bénéficiaient pas d'un ancrage territorial, l'activisme associatif et les pratiques qui en découlent ont constitué un vecteur de leur intégration locale et permis l'élargissement de leur notoriété au sein du village. L'élection de nouveaux résidents, sans aucun lien familial dans le village, occupant des professions socialement valorisantes (cadres supérieurs, ingénieurs, etc.) et recrutés pour leur profil d' experts de l'action publique locale est un signe supplémentaire de la prégnance de cette légitimité technique (connaissance des dossiers, insertion dans des réseaux politico-administratifs, mise en forme de projets). Bien entendu, les élus peuvent alterner, combiner et articuler ces deux registres - le dévouement familier / notabilité locale et la compétence gestionnaire - en fonction des contextes sociaux, relationnels et institutionnels, le métier d'élu local tenant dans l'articulation de ces rôles et registres d'action 120 ( * ) . Les maires se doivent d'être tout à la fois proches de leurs administrés (provoquer le contact, être à l'écoute et disponibles...) et impliqués dans des dispositifs d'action publique technicisés s'ils veulent maximiser les chances d'élection ou de réélection. On comprend ainsi que les agriculteurs modernistes , inscrits dans des réseaux d'interconnaissance localisés, et très investis dans les organisations professionnelles agricoles (militantisme syndical, fonctions à la chambre d'agriculture), familiarisés avec la prise de parole en public, les techniques managériales et les rouages administratifs, sont ceux qui résistent le mieux à ces reconfigurations sociales et politiques. Pouvant user à volonté de l'interconnaissance et de la familiarité avec leurs administrés, ils apparaissent aussi (auprès des nouvelles populations) comme des élus capables de mobiliser et rassembler autour de projets structurants en raison de leurs savoir-faire en matière d'action publique. Pour ceux qui sont les moins dotés en capital culturel et/ou ne disposant pas d'un « capital militant » 121 ( * ) à reconvertir sur la scène municipale leur permettant de s'ériger en entrepreneur du développement local, le succès électoral devient de plus en plus aléatoire. Les critères de compétence prennent progressivement le pas dans l'ensemble des ressources qui président à l'attribution du rôle de maire. Cette emprise se renforce en outre, depuis une période très récente, avec l'extension des structures intercommunales à fiscalité propre. En effet, les valeurs promues par la réorganisation de la coopération intercommunale sont moins celles du dévouement familier, qui prévaut encore sur le terrain communal, que la compétence et l'efficacité.
d) Intercommunalité et redéfinition des normes d'éligibilité locale
Le renforcement des prérogatives des groupements à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d'agglomération) et leur volonté de mener des actions politiques locales d'envergure sur des territoires sans cesse élargis a accru les responsabilités des élus locaux et complexifié la gestion des affaires intercommunales. Cette emprise croissante de l'intercommunalité de projet a eu pour effet de bouleverser la hiérarchie des qualités et des compétences légitimes nécessaires à l'exercice d'une bonne gouvernance locale . La logique qui structure désormais le processus de désignation des exécutifs intercommunaux repose effectivement davantage sur la détention des ressources rares nécessaires à la maîtrise du jeu intercommunal. En privilégiant certaines propriétés individuelles spécifiques, la sélection des membres des exécutifs communautaires participe d'une homogénéisation sociologique du personnel politique qui, en retour, s'accorde plus facilement sur l'importance de la compétence technique. Celle-ci est d'autant plus prégnante et mieux acceptée dans ces arènes qu'il s'agit d'élus du « second degré », désignés par leurs pairs 122 ( * ) .
e) La professionnalisation des savoir-faire politiques intercommunaux.
Sur la base d'une technicisation du travail intercommunal, la légitimité élective cède progressivement le pas à une légitimité technique ; la compétence devenant une qualité incontournable. La notabilité locale ( l'ancienneté et la reconnaissance dans l'espace politique local ou/et l'ancrage territorial) est une qualité qui ne (se) suffit plus pour exister politiquement 123 ( * ) , y compris dans les structures les plus excentrées des grandes agglomérations. Les élus placés sur le devant de la scène intercommunale doivent désormais être en mesure de projeter et de réguler l'action publique locale sur le moyen et long terme, tout en contrôlant l'avancée effective des dossiers qu'ils élaborent à court terme en commission, et que met en oeuvre le personnel administratif.
Les savoir-faire attendus des leaders de ces instances politiques locales (présidence et vice-présidences) sont généralement récurrents et peuvent se décliner ainsi : connaissances techniques des dossiers, expérience managériale et maîtrise des jeux de la diplomatie intercommunale. Relevant de plus en plus des problématiques de développement local, l'action intercommunale impose d'abord une connaissance du langage et du jargon de ses spécialistes et experts, ainsi qu'une familiarité avec les enjeux sectoriels des politiques publiques (développement économique, culture, logement, environnement, etc.). Ensuite, l'organisation par projets étant la caractéristique principale de l'action communautaire, le rapprochement avec les valeurs du management (motivation, implication, réseaux, etc.) et du monde de l'entreprise (efficacité, rentabilité) contribue à la redéfinition des compétences et des pratiques légitimes dans l'espace politique local. Il s'agit d'imposer l'image normative du bon élu intercommunal comme décideur , moderne , responsable , gestionnaire , avec une idéologie neutre 124 ( * ) dans laquelle l'expertise vient supplanter les clivages politiques qui se trouvent disqualifiés dans ces arènes 125 ( * ) . Enfin, reposant sur la définition d'arbitrages entre les communes, qui sous-tend des transactions permanentes entre les protagonistes et des stratégies de négociation subtiles, l'espace intercommunal privilégie les élus qui sont capables d'allier la sophistication des argumentaires déployés (qui suppose bien sûr une connaissance approfondie des dossiers intercommunaux dont on a la charge) et le sens aigu de l'euphémisme qu'impose la recherche de points d'équilibre. Le savoir-faire des dirigeants intercommunaux se fonde ainsi sur leur capacité d'enrôlement et d'animation qui permet de construire une solidarité politique autour des formes du bien public à venir. C'est en cela aussi que la posture de l'expert, souvent nécessaire parce qu'elle confère autorité et crédit, ne peut se suffire à elle-même lorsqu'il s'agit d'exercer et de tenir des positions de leadership ou d'animation et qu'elle ne produit son plein effet que lorsqu'elle se double de celle du diplomate. Pour garantir la progression des projets et la légitimité démocratique des orientations définies pour le territoire, les leaders intercommunaux doivent nécessairement sensibiliser, coordonner et motiver leurs pairs pour obtenir leur coopération et leur soutien en trouvant des arguments dotés d'un degré d'universalité suffisant pour fédérer les participants. En faisant la démonstration de leur aptitude à impulser et à mettre en oeuvre des projets (raisonnables et mesurés) et à tenir compte des points de vue des municipalités représentées, ils apparaissent comme les mieux disposés à garantir la cohésion de l'édifice communautaire aux yeux de leurs pairs, mais également auprès des personnels administratifs de l'institution.
Bien évidemment, il est possible d'affirmer que cette légitimation managériale des élus par l'expertise n'est pas spécifique au niveau intercommunal et que les maires peuvent très bien concevoir leur action municipale et leur rôle de premier magistrat à partir du même registre 126 ( * ) . Toutefois, les budgets et les compétences de plus en plus limités des communes - au profit des instances intercommunales - la rendent moins évidente. L'espace intercommunal permet de disposer de moyens d'action financiers et humains, d'une équipe administrative professionnalisée et d'élus spécialisés travaillant en commissions qui sont au coeur du savoir-faire intercommunal qui ne peut être le fait d'un seul (comme très souvent le maire dans sa commune rurale) mais d'une petite entreprise en nom collectif, seule à même de traiter des dossiers complexes. Les élus municipaux qui détiennent un domaine d'expertise se font (rapidement) un nom et par conséquent sont les plus à même d'acquérir un crédit politique au sein de cette nouvelle sphère d'action publique locale. Pour faire face aux attributions qui leur sont déléguées, les vice-présidents doivent mobiliser des connaissances techniques beaucoup plus importantes que celles que nécessite l'administration municipale et se consacrer plus assidûment aux projets d'envergure qu'ils portent pour le territoire, afin de les faire aboutir à temps. Les espaces politiques intercommunaux valorisent ainsi les compétences techniques personnelles des élus que ces derniers possèdent parfois à l'origine, puisqu'elles sont fréquemment liées à leur activité professionnelle, ou qu'ils acquièrent rapidement sur le terrain, délimitant ainsi une sphère de pouvoir propre. Ces nouveaux lieux de pouvoir participent à l'avènement d'une nouvelle élite politique, caractérisée par une standardisation croissante des profils au profit des régions supérieures de l'espace social
f) La sur-sélection sociale des dirigeants intercommunaux
La prise en charge d'actions publiques locales d'envergure se caractérise, même pour les petits élus, par la revendication d'une légitimité fondée sur le savoir-faire professionnel au point que les postes les plus prestigieux des institutions intercommunales (présidents, vice-présidents) sont tendanciellement monopolisés par des élus qui sont de moins en moins représentatifs socialement de ceux qu'ils sont censés représenter. Si les élus retenus à l'issue de l'élection des maires présentent déjà une image déformée de la réalité sociologique, la distorsion s'accentue au niveau de la désignation des exécutifs communautaires. La différenciation des critères de sélection sociale qui prévalent d'une sphère politique (municipale) à l'autre (intercommunale) traduit bien le fossé qui se creuse progressivement entre les porteurs de projets et ceux à qui ils doivent bénéficier. Ainsi, l'appartenance aux catégories socialement dominantes constitue une ressource déterminante pour conquérir les échelons hiérarchiques supérieurs de l'édifice intercommunal. Les EPCI à fiscalité propre, par la technicité relative de leurs domaines d'intervention, tendent à valoriser les dispositions intellectuelles et/ou l'expérience professionnelle de certains maires qui leur permettent de maîtriser mieux que d'autres la complexité d'un secteur d'intervention (développement économique, voirie, scolaire, culture, logement, etc. ) et de se sentir légitimes en vertu de celles-ci, comme les seuls à pouvoir contrôler le processus intercommunal.
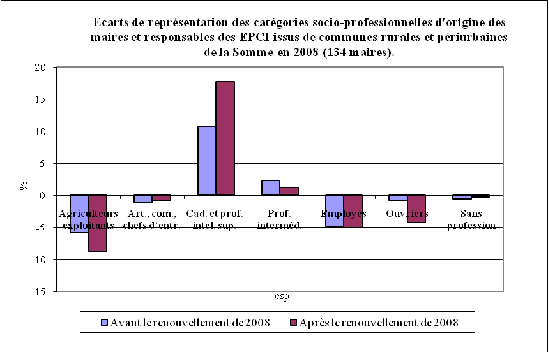
Lecture : Avant le renouvellement de 2008, l'écart de représentation (brut) des professions intermédiaires (pourcentage de maires présidents ou vice-présidents des EPCI - pourcentage de maires issus de cette catégorie socio-professionnelle) est de 2,3 points alors qu'au lendemain des élections, il est de 1,2 point.
Sources : annuaires des maires de la Somme (1983, 1989, 1995 et 2001), annuaire des EPCI à fiscalité propre de la Somme (2002), ministère de l'Intérieur (2001, 2008), enquête par questionnaire auprès des maires (avril 2001), liste des bureaux obtenue auprès des structures intercommunales de la Somme (2001,2008).
Loin de s'estomper, les logiques censitaires du pouvoir intercommunal tendent à se raffermir à mesure que les structures gagnent en visibilité et en surface décisionnelle. Pour preuve, la surreprésentation des cadres et professions intellectuelles supérieures s'accélère assez nettement. À la veille du renouvellement de 2008, 31,6 % des maires des communes rurales et périurbaines présidents et vice-présidents des communautés de la Somme sont des cadres ou des professions intellectuelles supérieures. Leur part à la direction des EPCI enregistre une progression supérieure à 10 points : 42 % des responsables de ces structures sont issus de cette catégorie contre 24 % des maires (ré)élus dans les communes rurales à l'issue du scrutin municipal. Les ouvriers et les employés d'une part - alors qu'ils sont pourtant un peu plus nombreux à figurer à la tête des conseils municipaux à l'issue des élections municipales de 2008 127 ( * ) - et les agriculteurs - dont le poids numérique parmi les maires ne cesse de s'affaiblir - d'autre part, sont les grands perdants des dernières élections intercommunales. Précisons que les agriculteurs portant les dossiers stratégiques des EPCI sont dans des situations sociopolitiques spécifiques. Ce sont ceux qui sont placés à la tête des plus grosses exploitations et sont les plus diplômés, ou ceux qui, malgré leur origine populaire et/ou leur faible capital scolaire, ont pu, grâce à leur activisme au sein des organisations professionnelles agricoles (syndicats, chambres d'agriculture), faire l'apprentissage des discours (valorisation du projet, de l'ouverture sur l'extérieur, etc.) et des pratiques liés à l'aménagement du territoire et au développement local (animation de commissions de réflexion ou groupes de travail, négociation avec de nombreux acteurs professionnels locaux, mise en forme de projets, savoir-faire managériaux, etc.) valorisés dans la sphère intercommunale.
Même si le processus n'est pas achevé, la recomposition du paysage politico-institutionnel à l'oeuvre dans les campagnes provoque des changements dans les modes d'administration et de gouvernement qui se traduisent par la spécialisation des activités de l'élu local, une professionnalisation progressive des compétences et des savoir-faire nécessaires pour la gestion des instances intercommunales. Les critères de la bonne gestion ont ainsi considérablement évolué par rapport aux petites communes. Les politiques d'aménagement et de développement local tendent à instaurer une « démocratie d'expertise » 128 ( * ) sur la base de compétences techniques qui privilégient une catégorie d'élus : ceux qui peuvent se prévaloir d'assurer le management d'enjeux socio-économiques dépassant le cadre d'action strictement communal et peuvent contribuer à la professionnalisation de l'action publique. Le déficit démocratique de l'intercommunalité 129 ( * ) ne se traduit donc pas uniquement par l'occultation de ses enjeux lors des campagnes électorales et par le contournement de l'idée d'imputation des actes politiques locaux 130 ( * ) - conforme à l'idéal de transparence de la démocratie - dans le cadre du changement d'échelle de l'action publique qu'elle induit. Il est aggravé par le processus de monopolisation croissante des postes les plus prestigieux des communautés par des élus qui sont de moins en moins représentatifs socialement de ceux qu'ils sont censés représenter, c'est-à-dire les conseillers municipaux et la population.
3. La
prise en charge de la vieillesse depuis 1970 : entre solidarités
familiales et solidarités publiques
Christophe Capuano
(LARHRA, Université Lyon 2)
Plusieurs drames récents ont fait la « Une » de la presse, notamment régionale 131 ( * ) , durant le mois d'août 2012 : des meurtres, généralement en zones rurales, de personnes en perte d'autonomie par leur époux. Près de Champagnole dans le Jura, cela concerne ainsi un couple d'octogénaires : le mari, lui-même en mauvaise santé, a tué son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années 132 ( * ) , avant de se suicider. À Murinais, village de l'Isère, c'est un agriculteur en retraite qui abat d'un coup de fusil son épouse, septuagénaire en perte d'autonomie, avant de mettre fin à ses jours 133 ( * ) . Ces drames témoignent dans les campagnes d'une nouvelle réalité : la souffrance fréquente à la fois des personnes âgées dépendantes et de leurs aidants familiaux, en particulier lorsque ceux-ci sont leurs conjoints. Cette souffrance est-elle le symptôme d'une relégation de la vieillesse, notamment la vieillesse démunie et fragile, dans les espaces ruraux ? Plus largement, cela signifie-t-il que l'on est plus vulnérable parce qu'on vieillit en milieu rural ? Pour apporter quelques éléments de réponse, deux types de réalités doivent être prises en compte. Il s'agit d'abord des représentations dont font l'objet les personnes âgées vieillissant à la campagne. Deux représentations opposées coexistent en effet. Soit les aînés sont présentés comme isolés, voire abandonnés, dans un environnement bientôt vidé de ses habitants et progressivement déserté par les services ; soit ils apparaissent au contraire comme pris en compte et très bien entourés par le cercle familial élargi et par une solidarité villageoise active, de type communautaire. Il faut ainsi évaluer dans quelle mesure les politiques publiques ont été marquées par ces représentations. Il s'agit également de tenir compte des évolutions récentes qui ont marqué le monde rural. Cela se traduit notamment par l'émergence, parallèlement au déclin de l'agriculture, d'une fonction résidentielle de l'espace rural - des retraités venant s'installer dans les communes rurales, de manière plus ou moins permanente. Cela entraîne une diversification de la population âgée dans les campagnes surtout à partir des années 1980-90 : on y trouve les aînés, toujours demeurés sur place, pour la plupart anciens agriculteurs, artisans ou indépendants ; les personnes originaires du pays revenues habiter les lieux de leur enfance ; les nouveaux résidents, venus s'installer après la retraite 134 ( * ) .
Pour traiter les différents aspects du phénomène, nous aborderons tout d'abord les dispositifs mis en place pour lutter contre la vulnérabilité sociale de la vieillesse en milieu rural depuis les années 1970 avant d'analyser la question spécifique des enjeux de la dépendance des personnes âgées et les réponses apportées.
a) Le traitement social du vieillissement des campagnes : une entreprise de long terme
À la fin des années 1960, deux enquêtes réalisées par l'INED mettent au jour, dans un contexte de vieillissement des campagnes 135 ( * ) , la grande vulnérabilité sociale des personnes âgées en milieu rural, en particulier les plus âgés, en matière de conditions de logement, de conditions de vie et d'isolement.
|
Enquêtes Ined dirigées par Paul Paillat
sur les populations âgées en milieu rural
En 1966, 55 % de la population âgée (de 65 ans et plus) vit à la campagne. Deux enquêtes de l'INED montrent les difficultés des populations rurales : Selon une première enquête Ined (1967) menée auprès d'agriculteurs âgés, 59 000 personnes âgées de plus de 80 ans vivent seules, 32 000 sont seules dans une maison isolée géographiquement, 58 000 n'ont pas l'eau à proximité, 25 000 sont en mauvaise santé et ne perçoivent pas de soins, 23 000 personnes âgées sont presque aveugles. Selon une seconde enquête Ined (1968), 53% de la population âgée (65 ans et plus) est isolée voire très isolée géographiquement. Les conditions de logement de cette population âgée sont déplorables : 20 % des ruraux non agricoles et 33% des agriculteurs n'ont pas l'eau dans leur logement (contre 7 % des citadins) - idem pour les WC et le chauffage. Le niveau de vie est très bas : chez les hommes, 62 % des agriculteurs et 52 % des ruraux non agricoles vivent très modestement ; ces hommes sont respectivement 14 % et 7 % à vivre très pauvrement. Chez les femmes, 68 % des agricultrices et 60 % des ruraux non agricoles vivent très modestement ; ces femmes sont 19 % et 14 % à vivre très pauvrement. Leurs conditions de vie sont donc très difficiles bien que presque tous bénéficient de pensions de retraite. |
Cette réalité est prise très au sérieux par l'État, notamment dans le champ du logement. Des habitats nouveaux sont créés pour cette population âgée comme les Foyers Soleil (studios pour personnes âgées autonomes aux revenus modestes) et une politique de concertation est instituée entre les ministères de la Santé publique (circulaire du 6 mars 1973) et de l'Équipement (circulaire du 5 décembre 1974), en concertation avec la Mutualité sociale agricole (MSA). La réfection de logements ruraux est aussi permise par la coordination des acteurs publics et privés dans le cadre d'un plan d'amélioration de l'habitat grâce aux accords passés entre la Fédération nationale de l'habitat rural, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), les organismes associatifs PACT (Propagande et action contre les taudis) et la MSA. L'investissement de l'État se traduit aussi dans la lutte contre la pauvreté des personnes âgées 136 ( * ) , citadines et rurales, grâce au relèvement du minimum vieillesse durant la décennie 1970 : en 1963, ce minimum vieillesse représente 40 % du SMIG, il s'élève à près de 55 % du SMIC en 1979. 137 ( * )
Plusieurs expériences sont également tentées par les collectivités locales à la fin des années 1970 et au début des années 1980 pour lutter contre l'isolement des aînés 138 ( * ) . Sont ainsi mis en place dans l'ouest de la France des services adaptés aux personnes âgées en milieu rural, même si l'on souligne l'impossibilité de généraliser ces mesures en raison de leur coût élevé lié à la dispersion de l'habitat 139 ( * ) . Dans les milieux ruraux isolés comme dans la Creuse, des actions sont développées pour entretenir le lien social. C'est le cas en 1983-1984 par exemple avec le maintien du facteur comme agent de liaison quotidien avec le monde extérieur. De même l'accès des personnes âgées des milieux ruraux au réseau téléphonique devient prioritaire 140 ( * ) .
Au début des années 1980, la vie des ainés dans les espaces ruraux devient aussi l'objet de réflexions internationales. En novembre 1983, une rencontre d'experts internationaux (hauts fonctionnaires, gériatres, chercheurs) a ainsi lieu à Eymoutiers, en Limousin. Elle est organisée par le ministère français des Affaires sociales et de la Solidarité nationale sur le thème « Vieillir dans les zones rurales isolées. Un défi aux services sociaux et médicaux ». Plusieurs pistes sont proposées en matière de recherche de politiques publiques et d'actions de terrain. On insiste notamment sur l'articulation entre les orientations pour les personnes âgées en zones rurales isolées et les exigences d'une politique de protection sociale « générale 141 ( * ) ».
En matière de service à domicile, plusieurs initiatives sont menées depuis les années 1960 dans les espaces ruraux. Ainsi des structures pluri-communales se constituent regroupant plusieurs bureaux communaux d'aide sociale. Dans le Médoc par exemple se crée en 1965 « l'Association pour l'aide aux vieillards de l'arrondissement de Lesparre » (loi 1901), puis se constitue en 1968 une association du même type à Saint-Médard-en-Jalles. Ces deux organismes passent un protocole d'agrément avec le conseil général de la Gironde, ce qui les habilite à assurer des prestations de services ménagers. Ils sont liés par convention avec chaque commune participante. En outre une allocation en espèce dite « allocation représentative des services ménagers » est instituée à l'échelon de ce département et peut remplacer les services en nature 142 ( * ) . D'autres initiatives originales sont engagées dans les territoires ruraux comme dans l'Aube où est fondée, à la suite d'une journée d'étude 143 ( * ) et d'une grande enquête menée auprès des personnes âgées pour connaître leurs besoins, une association départementale d'action sociale pour le développement de l'aide-ménagère en 1959 (association coordonnée par l'UDAF de l'Aube) 144 ( * ) . Les territoires, en particulier dans le cadre départemental, apparaissent ainsi comme des laboratoires où sont initiées différentes actions visant à répondre aux besoins locaux de la population concernée, avant l'adoption de dispositifs nationaux ou pour pallier l'absence de mesures adaptées.
Les acteurs associatifs sont également essentiels dans le développement de l'aide à domicile qui connait une forte dynamique depuis les années 1970 - celle-ci coïncide avec la mise en oeuvre de la nouvelle orientation politique du maintien au domicile des personnes âgées. Le cas le plus fameux est celui de l'association ADMR (Aide à domicile en milieu rural) qui mène dès la fin des années 1950 des actions en faveur des mères âgées. En 1959, 900 travailleuses familiales effectuent ainsi 16 000 journées d'aide aux personnes âgées. L'association développe régulièrement ses services durant les années 1960-1970, avec un premier essor au début des années 1980 puis un second durant les années 1990 avec une croissance qui s'accélère durant les années 2000. Le nombre d'heures consacrées à l'aide aux personnes âgées est de 11,3 millions en 1991 ; il passe à 21,2 millions en 2002 puis 51,3 millions en 2010 145 ( * ) (ce qui équivaut à 32 000 temps plein). Le nombre de personnes âgées aidées augmente aussi significativement : il passe de 146 000 en 2002 à 362 000 en 2011 - cette population âgée constituant désormais les trois-quarts de la population aidée par l'ADMR. L'association diversifie aussi son action en assurant de plus en plus des services de soins (24 000 personnes soignées en 2002, 67 650 en 2011) 146 ( * ) . D'autres organismes extra-étatiques ou parapublics sont également déterminants dans la diffusion de l'aide à domicile, comme l'action menée par les services de la MSA, surtout depuis les années 1970-1980 147 ( * ) .
Les quarante dernières années correspondent ainsi à un fort développement des actions, où se conjuguent, nous l'avons vu, une grande diversité d'acteurs publics et privés, en faveur des aînés en milieux ruraux dans le cadre de l'essor d'une politique de maintien au domicile menée à l'échelon national et d'une prise de conscience des difficultés spécifiques de cette population dans ces territoires. Dans ce contexte se développent aussi de nouveaux comportements chez les ruraux âgés encore autonomes qui gardent le plus longtemps possible leur mobilité personnelle (grâce à la voiture, avec ou sans permis), même dans les espaces ruraux isolés et parfois à des âges avancés (ils bénéficient en outre du développement du réseau téléphonique dans les campagnes). Il s'agit d'un bon indicateur du maintien de l'autonomie et de l'insertion sociale des aînés du milieu rural isolé 148 ( * ) . Plusieurs études sociologiques le montrent, comme dans la Creuse et en Ardèche 149 ( * ) , mais les situations sont contrastées entre d'une part les personnes âgées originaires du « pays » dont la déprise des mobilités personnelles est compensée par le recours à l'entourage familial et au voisinage, qui permettent des reprises de mobilité ; et d'autre part des personnes installées après la retraite, qui maintiennent plus longtemps des pratiques de mobilité autonomes, plus diversifiées en raison de leurs liens avec des groupes sociaux plus lointains, souvent citadins 150 ( * ) . Si elle est parfois isolée géographiquement, il est donc rare que la vieillesse des campagnes le soit socialement en raison de l'importance des réseaux sociaux (notamment du voisinage pour les gens du cru 151 ( * ) ) et de la mobilité conservée le plus longtemps possible mais aussi grâce aux efforts des collectivités locales pour maintenir des services et développer l'aide à domicile. Le problème apparaît généralement au moment de la perte d'autonomie et de mobilité (il n'est plus possible de conduire son automobile), souvent synonymes d'entrée dans la dépendance - même si là encore, il n'y a rien de mécanique (des personnes âgées pouvant recevoir des visites au domicile, voire en institution).
b) Les problèmes de la dépendance et des aidants en milieu rural
La question de la perte d'autonomie est-elle moins prise en compte dans les espaces ruraux, où vivent pourtant de nombreuses personnes très âgées 152 ( * ) ? En matière de places d'hébergement, les espaces ruraux apparaissent effectivement sous-équipés depuis longtemps. Dans un rapport officiel de 1970, on note déjà que dans le « milieu rural l'organisation de l'hospitalisation gériatrique soulève actuellement des difficultés considérables » 153 ( * ) . En 1985, le Conseil économique et social rapporte encore que « les meilleurs équipements se situent dans les régions urbaines et industrialisées, où il y a proportionnellement moins de personnes âgées » 154 ( * ) . Le nombre de ces places en hébergement augmente durant les années 1980 mais la couverture reste insuffisante par rapport aux besoins - en raison soit d'une forte présence de personnes très âgées soit d'un développement modeste (tableau 1).
Places d'hébergement pour personnes
âgées.
Le cas de quelques départements en 1992 (tableau
1)
|
Départements |
Hébergement (nombre de places pour 1000 personnes de 75 ans et plus en maison de retraite) |
Part des personnes de 75 ans et plus dans le département en % 155 ( * ) |
Taux d'urbanisation (population agglomérée de plus de 20 000 habitants en 1992) |
|
Ariège |
118,5 |
11,8 |
0% |
|
Aveyron |
148 |
11,3 |
23% |
|
Creuse |
155 |
13 |
0% |
|
Dordogne |
153 |
10,7 |
25,1% |
|
Doubs |
134 |
5,7 |
24,1% |
Source : EHPA 156 ( * )
Quant aux services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), ils restent pendant longtemps insuffisants en France même s'il n'y a pas toujours de grande différence entre la situation des départements ruraux et urbains durant les années 1990 157 ( * ) (tableau 2). Des départements ruraux (Ariège, Dordogne) mais aussi des départements fortement urbanisés (Bas-Rhin), en raison de l'importance de la population à couvrir, sont ainsi peu équipés. Si des efforts sont réalisés dans certains départements ruraux (Vosges, Yonne), ce sont les départements très urbanisés qui restent les mieux couverts (Oise, Nord-Pas-de-Calais).
Services de soins infirmiers à domicile en 1993 : quelques cas départementaux (tableau 2)
|
Départements |
Nombre de places pour les services de soins infirmiers à domicile |
Ratio places/population de 75 ans et plus |
|
Ariège |
273 |
13 |
|
Bas-Rhin |
427 |
7,31 |
|
Dordogne |
205 |
5 |
|
Oise |
734 |
19,63 |
|
Pas de Calais |
2345 |
27,92 |
|
Rhône |
1050 |
11,25 |
|
Vendée |
820 |
20 |
|
Vosges |
349 |
12 |
|
Yonne |
459 |
15 |
Source : enquête CNAM 158 ( * )
Les collectivités locales, notamment dans les départements ruraux, mettent aussi en place, durant les années 1990, des politiques gérontologiques départementales importantes (tableau 3). Chaque politique est composée des allocations compensatrices pour personnes âgées (ACPA pour des déficiences de 80 % et plus 159 ( * ) ) et des dépenses d'aide sociale (hébergement et aide à domicile). Dans certains départements, souvent les plus vieillis, cette politique met l'accent sur l'allocation compensatrice (Ariège, Aveyron), dans d'autres, elle insiste sur l'aide sociale (Côtes d'Armor). Des départements très urbanisés comme le Rhône mettent l'accent sur l'une et l'autre à la fois.
Politique gérontologique départementale
en 1993.
Quelques exemples départementaux
160
(
*
)
(tableau 3)
|
Départements |
Personnes âgées de plus de 60 ans ( en milliers ) |
Nombre de bénéficiaires ACPA de plus de 60 ans ( pour 1000 ) |
ACPA brute en francs par personnes âgées de plus de 60 ans |
Dépenses nettes Aide sociale en francs par personnes âgées de plus de 60 ans |
Dépenses totales pour les personnes âgées de plus de 60 ans |
|
Ain |
85 |
9,3 |
168F (34€ 161 ( * ) ) |
362F (73€) |
529F (107€) |
|
Ariège |
40 |
25,8 |
671F (136€) |
341F (69€) |
1012F (205€) |
|
Aveyron |
76 |
26,2 |
712F (144€) |
298F (60€) |
1010F (204€) |
|
Bas-Rhin |
168 |
11,6 |
393F (79€) |
211F (42€) |
603F (122€) |
|
Côtes d'Armor |
136 |
19,6 |
548F (111€) |
485F (98€) |
1034F (209€) |
|
Doubs |
83 |
20,1 |
395F (80€) |
372F (75€) |
766F (155€) |
|
Rhône |
266 |
22,7 |
622F (126€) |
544F (110€) |
1166F (236€) |
|
Yonne |
80 |
14,1 |
444F (90€) |
541F (109€) |
984F (199€) |
Ce sont surtout les familles de ces personnes âgées qui ont manqué de soutien de la part des pouvoirs publics. Cette situation touche les ruraux comme les citadins 162 ( * ) . Il en est ainsi en matière financière par exemple, avec les effets négatifs des conditions de versement de la prestation spécifique dépendance (PSD). Celle-ci est instituée en 1997 afin de remplacer pour les personnes de plus de 60 ans, l'allocation compensatrice pour personnes âgées ou pour tierce-personne (en vigueur depuis 1975 et attribuée aux personnes ayant un taux d'incapacité au moins égal à 80 %). Le montant de la PSD est calculé en fonction de la grille AGGIR qui évalue le degré de la dépendance des personnes âgées sur une échelle de 1 à 6 (grille Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources). Surtout, à la différence de l'allocation compensatrice, cette PSD met en vigueur la récupération sur succession après décès : cela est souhaité notamment par le Sénat pour responsabiliser les familles, comme le montrent les discussions parlementaires 163 ( * ) . Cette disposition a pour principal effet de pénaliser les familles qui consentent déjà des efforts soutenus pour garder leurs parents âgés à domicile 164 ( * ) . Les conséquences sont également désastreuses dans les milieux ruraux où les patrimoines sont importants mais les revenus sont faibles. L'introduction de ce recours sur succession 165 ( * ) dissuade ainsi une partie des personnes âgées et leur entourage d'avoir tout simplement recours à la PSD pour éviter de grever le patrimoine familial.
Les pouvoirs publics estiment que ces problèmes sont atténués dans les espaces ruraux en raison d'une persistante cohabitation intergénérationnelle et de l'existence d'une large fratrie. Or le phénomène de la décohabitation, même s'il est plus tardif que dans les espaces urbains, touche également les campagnes 166 ( * ) . En outre, le nombre d'enfants diminue, l'éloignement géographique des enfants ne facilite pas la prise en charge quotidienne et la charge repose sur l'enfant "aidant principal" ou le conjoint (« aidant piégé » 167 ( * ) ). Enfin, la cohabitation à distance - caractérisée par une résidence dans la même commune, voire le même hameau, avec des relations fréquentes entre ascendants et descendants - se développe comme dans les espaces urbains (où l'on réside parfois dans le même quartier ou le même immeuble) 168 ( * ) .
Ces évolutions apparaissent dans une enquête de 1990 menée par le CLEIRPPA 169 ( * ) auprès de personnes âgées rurales bénéficiaires d'une prise en charge "aide-ménagère" (délivrée par une caisse de retraite de base ou de l'aide sociale). Cette enquête montre qu'il s'agit d'une population très âgée (75 % ont 75 ans et plus), vivant majoritairement seule (64 %) 170 ( * ) , et financièrement défavorisée (un tiers des personnes interrogées perçoivent ainsi moins de 2907F/mois (635,58 €) pour une personne seule et 5082F/mois (1111,11 €) pour un couple). Ces personnes habitent des petites communes rurales (70 % dans des communes de moins de 2 500 habitants) et une partie d'entre elles vit dans des logements sans confort ou au confort faible 171 ( * ) mais elles n'envisagent pas de quitter leur logement (79 % refusent d'envisager, même plus tard, un déménagement). Surtout cette enquête met au jour l'importance de l'entourage familial (30 % seulement des interrogées sont isolées ou très isolées sur ce plan) : ce sont les personnes les plus âgées et les plus dépendantes qui sont aussi les plus entourées par leur famille. L'enquête souligne que « cela remet en cause des préjugés [car] les relations familiales tendent à se resserrer quand la vieillesse est là » et « l'aide-ménagère n'entraîne pas le relâchement du soutien familial mais le complète ». En cas d'isolement géographique, aide-ménagère et famille sont ainsi largement mises à contribution pour le ravitaillement (l'épicerie est située à plus d'un kilomètre pour 44 % des personnes interrogées, 52 % en ce qui concerne la pharmacie). Plus généralement, la famille intervient pour 43 % des foyers bénéficiaires d'aide-ménagère et pour des tâches où celle-ci intervient moins : les courses, les démarches diverses (se rendre à la banque, à la pharmacie) l'entretien du linge, la cuisine, etc. L'enquête souligne donc « la complémentarité par rapport à l'aide-ménagère ».
En 2002, la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) change la donne en supprimant le recours sur succession après décès. Cette nouvelle disposition contribue à doubler le nombre de bénéficiaires : 135 000 personnes âgées bénéficient de la PSD en 2000 ; elles sont plus de 300 000 bénéficiaires de l'APA à domicile en 2002 et passent à 686 000 bénéficiaires en 2009 (292 000 bénéficiaires au titre d'une dépendance sévère). Mais certaines collectivités locales conçoivent encore l'APA comme subsidiaire de l'aide familiale : cela paraît clairement dans le cadre de la loi du 13 août 2004 dont l'article 56 reconnaît aux conseils généraux un rôle de « chef de file » dans l'action sociale en direction des personnes âgées 172 ( * ) . Si l'APA est perçue comme un dispositif non-subsidiaire par certains conseils généraux (l'aide financée par la collectivité étant conçue comme indépendante de l'implication familiale), d'autres en revanche (départements ruraux ou très urbanisés 173 ( * ) ) estiment que la solidarité familiale doit être prise en considération dans l'élaboration du plan d'aide. Cette question de la complémentarité ou de la subsidiarité des aides publiques par rapport aux aides privées est déterminante.
Cela conduit à faire de l'APA un dispositif subsidiaire, les dépenses éligibles de l'APA venant seulement en complément de l'aide familiale. Certains conseils généraux estiment également que l'APA ne doit pas servir aux familles à se désengager et vont ainsi oeuvrer à en limiter le nombre des bénéficiaires (en jouant par exemple sur une éligibilité à l'aide rendue plus difficile) 174 ( * ) . Aussi les solidarités familiales sont-elles encore souvent conçues par les collectivités locales comme une "ressource" additionnelle ou substitutive en matière de prise en charge des personnes âgées dépendantes.
Une autre lacune vient d'une absence de réponse à la souffrance des aidants familiaux : le manque d'hébergements temporaires et d'accueils de jour pour les aînés dépendants destinés à soulager les aidants et éviter une fatigue physique et psychique 175 ( * ) . Dès le début de la décennie 1990, l'ADMR envisage ainsi des « formules innovantes pour soulager les familles qui prennent en charge leurs ainés » 176 ( * ) mais aussi permettre à la personne concernée de garder un réseau de relations et éviter le déracinement : mise en place de garde à domicile de nuit et de jour ; placement de la personne âgée dans une famille d'accueil proche du domicile initial ; diffusion du modèle de domicile collectif ou de la petite unité de vie - adapté au milieu rural ; développement de l'hébergement temporaire ; extension de la téléalarme à domicile (système Filien mis au point par l'ADMR). Pendant longtemps, ces réalisations restent cependant limitées en raison de leur coût ; seules des initiatives locales atomisées permettent de nouvelles créations et subventionnent les frais occasionnés par les placements temporaires. La CRAM de Bretagne à partir de la fin des années 1990 développe ainsi le programme « Rester chez soi » pour favoriser l'accueil dans des structures d'hébergement temporaire des pensionnaires du régime général 177 ( * ) . D'autres expériences sont portées par des collectivités locales comme dans l'Hérault où le conseil général met en place une mesure d'aide sociale facultative pour financer le placement temporaire des personnes âgées dépendantes (schéma gérontologique 1997-2001) 178 ( * ) . Le nombre de ces places d'hébergement reste néanmoins insuffisant 179 ( * ) . Ce constat, valide à l'échelon national, peut avoir des conséquences particulièrement lourdes dans les campagnes pour des aidants de personnes dépendantes qui ressentent une forte détresse et une certaine solitude psychologique (voire un désespoir). Dans l'enquête (déjà citée) menée par le CLEIRPPA en 1990 180 ( * ) , ces aidants - surtout les conjoints - sont souvent sollicités de fait pour répondre aux besoins des personnes dépendantes 181 ( * ) car ils les soutiennent au quotidien et de manière constante (la famille et l'aide-ménagère n'intervenant qu'une durée limitée dans la journée). Ils paraissent déjà très fragiles et ne sont guère plus vaillants que les personnes aidées tant sur le plan physique que psychique 182 ( * ) . Cette fragilité du couple, qui entraîne parfois des séjours hospitaliers et des retours difficiles au domicile 183 ( * ) , ne semble guère avoir reçu de réponses adaptées.
Ces difficultés s'ajoutent aux problèmes liés à une pénurie d'offre sanitaire et de services à domicile dans certains espaces ruraux où il faut payer davantage que dans les territoires où cette offre médicale est riche (services assurés par les infirmières libérales ou les services de soins infirmiers à domicile, remboursés par la Sécurité sociale) pour des services parfois de moindre qualité médicale (offerts par les aides à domicile subventionnées en partie par l'APA et sous conditions de ressources ).
Même dans les territoires où l'offre d'aide à domicile est dense, les familles restent aujourd'hui les principaux fournisseurs d'aide, avec des coûts en temps et en argent beaucoup plus importants 184 ( * ) que les services professionnels et les allocations financières relevant de la solidarité publique 185 ( * ) . Mais ces aides sont peu visibles 186 ( * ) surtout quand il s'agit des conjoints 187 ( * ) . En outre, il existe dans les campagnes des obstacles psychologiques comme un rapport encore « hésitant aux services d'aide à domicile, en particulier les plus médicalisés, une moindre consommation de soins dans le sens de la prévention et d'un suivi régulier » 188 ( * ) . De même restent rares la fréquentation des formations pour aidants ainsi que celle des groupes de paroles organisés (par France Alzheimer, la Mutualité française, la MGEN etc.) actuellement dans les espaces ruraux, en particulier lorsque les aidants sont des hommes (lors de ces formations, on ne trouve au mieux que deux hommes pour huit femmes selon France Alzheimer en 2012).
c) Conclusion : développer le care dans les campagnes
Derrière ces difficultés, c'est plus largement la question de la place à attribuer au care dans notre société qui est posée ainsi que la reconnaissance de l'entourage familial, tant rural que citadin, comme principal fournisseur d'aide. Mais mettre en avant le rôle des solidarités familiales et amicales ainsi que l'aide du voisinage pour construire une société du bien-être et du soin 189 ( * ) peut aussi alimenter un discours visant à réduire le rôle de l'État social. La diffusion de l'idée du care en Grande-Bretagne durant les années 1980-1990 a ainsi correspondu, de manière ambivalente, à la fois à une prise en compte des besoins des aidants avec des dispositifs adaptés (grâce au rôle des groupes de pression des associations de carers 190 ( * ) ) et à un désengagement relatif de l'État dans la prise en charge des personnes fragiles 191 ( * ) . Si le développement du care dans les campagnes françaises peut quant à lui constituer une des pistes possibles pour soulager de manière efficace la souffrance des personnes dépendantes et de leurs aidants, le rôle de la solidarité publique doit néanmoins rester essentiel pour seconder ces solidarités familiales. Certaines conditions semblent dans cette perspective devoir être réunies : le renforcement du rôle des pouvoirs publics en faveur du développement des soins et services à domicile (et du nombre d'heures effectives), non pour se substituer aux familles, mais pour les renforcer 192 ( * ) grâce à la création de vrais emplois dans un secteur médico-social rénové 193 ( * ) . Cela doit être complété par l'essor des places d'hébergement temporaire pour soulager quelque peu l'entourage et la création de petites structures d'hébergement de proximité. Le soutien psychologique semble également central et doit se traduire par une multiplication des initiatives par les acteurs locaux ou départementaux en faveur des consultations Alzheimer et réunions d'aidants dans les campagnes au plus près des besoins spécifiques des personnes âgées aidées et de leur entourage. Plus largement, la disparition de toute référence à l'obligation alimentaire envers un ascendant faciliterait aussi l'expression d'une entraide familiale (comme c'est le cas en Suède où cette référence a été supprimée du Code civil depuis 1978). Si cette injonction financière est maintenue en France aujourd'hui, elle ne joue plus en effet un rôle déterminant dans la motivation à aider ou à accompagner un proche (7 %). Elle se situe loin derrière l'obligation morale (48 %) et surtout la dimension affective, aujourd'hui essentielle (75 %) dans le choix de soutenir un parent en perte d'autonomie 194 ( * ) .
CONCLUSION
Stéphane Rozès
Président de Cap et enseignant à Sciences-Po et HEC
« Comment voulez-vous gouverner un pays qui possède 360 fromages ! », disait le général de Gaulle. Comment faire la synthèse de travaux si variés et l'analyse transverse de réalités si diverses et si singulières ? C'est une gageure.
Relater la richesse des débats, c'est se rapprocher d'un tableau impressionniste pour en saisir toute la diversité et tout le contraste.
Les réflexions issues de mes propres travaux depuis 25 ans dans la métropole nantaise, les Pays de Loire, la Bretagne, l'Oise et le Dauphiné viendront compléter ce qui me semble avoir été commun aux interventions et débats du colloque.
Historiquement, la sociologie s'est tout d'abord intéressée, d'une part, à la ville, lieu de concentration de la bourgeoisie et de la classe ouvrière, d'autre part, au monde rural, à la paysannerie. Dès son émergence, le monde périurbain a été un centre d'intérêt de l'imaginaire collectif non pour son territoire, mais pour les questions sociales et les situations politiques dont il est le terreau. Ce monde rurbain s'est révélé comme un no man's land qui s'est fait entendre, connaître, et ausculter au travers du vote Front National, comme je l'ai analysé par exemple dans l'Oise.
Ce postulat liminaire constitue la base d'une réflexion menée depuis plusieurs années par des universitaires et des professionnels, et ce colloque a permis de dégager plusieurs constats.
Tout d'abord, les représentations sont fixes là où les réalités bougent. Cela induit une déconnexion entre les représentations et les conduites effectives des individus. Plus les réalités bougent et plus les imaginaires doivent se figer pour se l'approprier.
Le travail des universitaires vise à s'interroger sur l'articulation entre les conduites et les représentations. Les métropoles urbaines sont le moteur de la croissance et de l'emploi, mais également sources de fractures du territoire : les contraintes imposées par le marché foncier et la forte concurrence pour l'attractivité des territoires génèrent une ségrégation tant spatiale que sociale. La congruence de ces mécanismes conduit à un hiatus entre les conduites des citoyens au quotidien sur les territoires et les représentations qu'ils en font. Ainsi, alors que le citoyen professe la République et la mixité sociale, l'habitant accompagne et accélère les fractures géographiques des territoires. La gestion de ces contradictions entre identités locales et représentations nationales, intrinsèques aux individus, est laissée au politique.
Ensuite, l'absence de réflexion menée au niveau national sur la définition du territoire exacerbe les tensions. Ces tensions apparaissent en premier lieu entre les différents échelons territoriaux : l'unicité de l'Etat-nation s'oppose à des logiques départementalistes, régionalistes, et métropolitaines de plus en plus marquées. La tension entre l'efficience économique et l'égalité des territoires est également présente. Le retrait de l'Etat et l'affaiblissement des solidarités verticales au travers des péréquations de service public ont redoublé la concurrence entre les territoires. Enfin, les tensions entre les évolutions du foncier et les différentes stratégies de mobilité géographique ont également été mentionnées au cours des diverses interventions.
Cependant, le seul recours aux tensions entre conduites et représentations, intérêts et idéologies, ne permet pas d'expliquer les particularités des territoires et les singularités de leur fonctionnement. Il y a un esprit des lieux qui, pour être mis en place, recourt à la mise en perspective individuelle et collective des individus et des territoires, sur leur façon de s'assembler et de fonctionner ensemble. L'imaginaire, c'est-à-dire la façon dont les individus s'approprient le réel au travers des représentations, joue ici un rôle primordial ; à la fois individuel et collectif, il est une composante majeure de l'identité socio-territoriale.
Lorsque le territoire ne nourrit pas un sentiment d'identité locale - parce que l'individu ne travaille pas sur le territoire où il habite, par exemple - la construction d'une identité particulière, de nature défensive, peut mener à des votes Front National. Il y a donc un lien entre la déliaison sociale et le besoin de s'abriter derrière la préférence nationale. Cela n'empêche pas pour autant, aux élections locales, de se reconnaître dans des élus d'autres tendances politiques. Les processus d'insertion sociale et territoriale sont complexes, et force est de constater qu'au bout d'un certain temps, une matrice, un imaginaire collectif du lieu imprègne les imaginaires individuels. Ainsi, 50 % des individus arrivés dans l'Oise depuis moins de cinq ans se sentent proches des idées du Front National, sur un territoire historiquement bonapartiste.
Finalement, les identités politiques ne sont qu'un vecteur du besoin qui nous est propre de construire les modalités de nos rapports aux autres au travers de projections, qui ont pour objet de faire vivre ensemble nos différences. Mais la fragmentation des disciplines qui travaillent sur les territoires et leurs représentations ne permet pas de rendre compte de la richesse et de l'inventivité des pratiques, d'un réel qui s'inscrit entre permanences historiques et constantes mutations économiques et sociales.
Vu de loin, le tableau impressionniste de la France est gris ; vu de près, il est multiple, grouillant et tacheté de couleurs.
* 1 « Mes électeurs ne sont pas des fachos, du moins pas encore » par Laurence Rossignol
* 2 La tendance à l'internationalisation y est ainsi bien moins développée que dans d'autres sciences sociales, notamment la science économique ou la démographie.
* 3 La dérive a été illustrée de manière exemplaire à travers « l'affaire Teissier », cette thèse soutenue en bonne et due forme, « en Sorbonne », par l'astrologue Elisabeth Teissier, et qui a constitué un symptôme des plus inquiétants de l'évolution de la discipline. Cf. LAHIRE (Bernard), « «Ce qui nuit à notre discipline... » : la non-thèse de sociologie d'Elizabeth Teissier », Apses info , n° 32, juillet 2001, p. 25-26, disponible en ligne : http://www.homme-moderne.org/societe/socio/teissier/analyse/socio.html.
* 4 Cf. Emmanuel Pierru, Alexis Spire, « Le crépuscule des catégories socioprofessionnelles », Revue française de science politique , vol. 58, n° 3, 2008, p. 457-481.
* 5 D'un point de vue de la théorie et de la méthode sociologique, la crise des grands paradigmes de type holiste (marxiste, structuraliste, fonctionnaliste) a eu pour pendant l'attrait croissant chez les sociologues, notamment des nouvelles générations, pour les analyses interactionnistes, la méthode de l'enquête de terrain, et la relative déshérence des enquêtes statistiques. Sans compter que bien des cursus de sociologie ne comprennent plus d'enseignement consacré à ces questions de classes perçues comme désuètes et ringardes.
* 6 Ces enquêtes s'inscrivent dans la lignée de l'ouvrage de M. Cartier, I. Coutant, O. Masclet et Y. Siblot, La France des petits moyens. Enquête sur la banlieue pavillonnaire , Paris, La Découverte, 2008.
* 7 Peter L. Berger, Invitation à la sociologie , Paris, La Découverte, 2006.
* 8 Bessière Céline, Doidy Eric, Jacquet Olivier, Laferté Gilles, Mischi Julian, Renahy Nicolas, Sencébé Yannick (dir.), 2007, Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales, Paris, Symposcience. Disponible sur http://www.symposcience.org/exl-php/colloques/30-colloque.htm (consulté le 29/08/2012); Alphandéry Pierre et Billaud Jean-Paul (dir.), 2009, « La sociologie rurale en questions », Études rurales , n° 183, 233 p.
* 9 Pour les cantons faiblement peuplés, nous avons effectué des regroupements de cantons. Par ailleurs, les délimitations administratives ne sont pas toujours respectées, puisque l'INSEE a redéfini des « pseudos-cantons » (http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/canton-ou-ville.htm) dans les agglomérations urbaines.
* 10 Cf. la mise au point centrale de Beaud Stéphane, Pialoux Michel, Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard , Paris, Fayard, 1999, et tout récemment : Lomba Cédric, Mischi Julian, « Ouvriers et intellectuels face à l'ordre usinier », Actes de la recherche en sciences sociales , n° 196-197, 2013, p. 4-19.
* 11 Cf. Mischi Julian, Renahy Nicolas, « Classe ouvrière », notice pour le Dictionnaire de Sociologie , Encyclopaedia Universalis, 2008.
* 12 Vanderschelden Mélanie, 2006, « Les ruptures d'unions : plus fréquentes, mais pas plus précoces », Insee Première , n° 1107.
* 13 Bessière Céline, Bruneau Ivan, 2011, « La vie moderne de R. Depardon : la beauté de la mort paysanne », Revue de Synthèse , vol. 136, n° 3 : 448-454.
* 14 Combes P.P. et M. Lafourcade (2012). Revue de la littérature académique quantifiant les effets d'agglomération sur la productivité et l'emploi . Rapport préparé pour la Société du Grand Paris.
* 15 Ciccone, A. (2002). Agglomeration effects in Europe. European Economic Review , 46: 213-227.
* 16 Une aire urbaine comporte une unité urbaine centre et une couronne. Une unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. Une « grande aire urbaine » est un ensemble de communes , d'un seul tenant et sans enclave, constitué par une unité urbaine offrant plus de 10 000 emplois et par une couronne périurbaine constituée de communes contigües dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans l'aire urbaine.
* 17 A savoir : moyennes aires urbaines (entre 5000 et 10000 emplois dans l'unité urbaine centre), petites aires urbaines (entre 1500 et 5000 emplois dans l'unité urbaine centre), communes multipolarisées par plusieurs grandes aires urbaines, autres communes multipolarisées et, enfin, communes hors influence de pôles qui sont ce qu'on désigne parfois comme l'espace rural.
* 18 Ces deux postes de dépenses représentent approximativement 40 % de la consommation des ménages.
* 19 Cavailhès J., Gaigné C., Tabuchi T. et Thisse J.F. (2007). Trade and the structure of cities, Journal of Urban Economics , 62 (3): 383-404.
* 20 Cavailhès J., Gaigné C., Tabuchi T. et Thisse J.F. (2007), op. cit .
* 21 La définition statistique des communes de banlieue ne correspond pas au sens que les journalistes donnent généralement à ce terme. Par exemple Neuilly-sur-Seine, la commune française fiscalement la plus riche de France, est une commune de banlieue.
* 22 Le terme de couronne périurbaine ne correspond pas à l'image d'une mince frange entourant les villes. D'une part, la majorité des communes périurbaines sont rurales (elles comptent moins de 2000 habitants agglomérés). D'autre part, en 2010, les couronnes des grandes aires urbaines (plus de 10000 emplois dans l'unité urbaine centre) couvrent plus du quart du territoire national (28,4%).
* 23 Eric Charmes (2011), La ville émiettée. Essai sur la clubbisation de la vie urbaine, PUF, coll. « La ville en débat », 288 p.
* 24 Brueckner J. K., Thisse J. F., Zenou Y. (1999). Why is central Paris rich and downtown Detroit poor? An amenity-based theory, European Economic Review , 43: 91-107.
* 25 L'Insee publie des résultats de revenu médian par ménage, mais il n'est pas possible d'effectuer des calculs sur des médianes, ce qui nous conduit à privilégier le revenu moyen par foyer fiscal.
* 26 Dans la commune de Toulouse, le revenu médian par ménage varie presque de 1 à 4 : de 11 279 € dans l'IRIS « Loire » à 42 998 € dans l'IRIS « Deltour » (source : Insee, données 2009).
* 27 Friggit J., Prix de l'immobilier d'habitation sur le long terme, CGEDD.
* 28 Par exemple : la population étudiante a augmenté depuis 1984 ; or, elle réside principalement dans les villes universitaires centres et les foyers fiscaux d'étudiants ont de bas revenus, ce qui peut expliquer en partie la dégradation de la situation de ces villes.
* 29 Le dernier rapport de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles (ZUS) confirme à la fois l'importance et l'accroissement des écarts entre les ZUS et les unités urbaines qui les contiennent. Par exemple, les écarts entre taux de chômage dans les ZUS et hors de ces zones sont considérables et continuent de croître : ils étaient respectivement de 17% et 9% en 2003, ils sont de 22,7% et 9,4% en 2011.
* 30 J. Cavailhès, J-F. Thisse. « Faut-il choisir entre égalité des territoires et développement économique ? ». In : Eloi Laurent (dir.) (2013), Vers l'égalité des territoires. Dynamiques, mesures, politiques , La Documentation Française, pp. 364-380.
* 31 Données concernant 37 aires urbaines de plus de 80 000 emplois en 1999, hors Paris, ces aires rassemblant 53 % de l'ensemble des emplois en France. (Beaucire et Chalonge 2011, p. 61)
* 32 INSEE, RP 2008, calcul de l'auteure à partir du zonage en aires urbaines de 1999. Le zonage 1999 a été retenu au détriment de celui de 2010, dans lequel la catégorie des espaces ruraux disparaît au profit de celle des communes isolées hors influence des pôles, qui ne rassemble plus que 5 % de la population française (Brutel, Levy, 2011). L'enquête emploi 2010 de l'Insee montre également que la moitié des ouvriers réside dans des communes rurales ou périurbaines de moins de 2 000 habitants ou dans des agglomérations de moins de 20 000 habitants.
* 33 « Entre 1975 et 1996, la part des établissements du secteur industriel de plus de 200 salariés est passée de 54,4 % à 39,7 % » (Renahy, 2002, p. 3). Dans le parc de la Riboire, en 2007, on compte ainsi 80 établissements de moins de 200 salariés sur 91 établissements.
* 34 Emplois au lieu de travail à l'échelle d'un canton périurbain dans lequel est implanté le parc industriel de la Riboire, Insee, RP 1999.
* 35 Insee, enquête emploi 2008.
* 36 Bases de données communales du recensement de la population (BDCOM) 1982, 1990, 1999, INSEE [producteur], Centre Maurice Halbwachs [diffuseur].
* 37 Texte support extrait de Céline Bessière, De génération en génération, Arrangements de famille dans les entreprises viticoles de Cognac , Paris, Raisons d'Agir, 2010, Chapitre 7.
* 38 S. Rattin, « Deux jeunes ménages d'agriculteurs sur cinq ont des ressources non agricoles », Données sociales, Paris, Insee, 2002, p. 439-446.
* 39 Depuis les années 1950, le Ministère de l'agriculture distingue les exploitations professionnelles parmi l'ensemble des exploitations agricoles françaises. Pour entrer dans cette catégorie, les exploitations doivent remplir simultanément deux critères : une surface de production supérieure à 12 hectares équivalent-blé et l'occupation d'au moins une personne à trois quart de temps pendant l'année.
* 40 Laurent Bisault, « Agricultrice : un métier qui s'impose à tout petits pas ». Agreste Primeur n° 223, mars 2009 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur22, p. 2.
* 41 Cf. C. Giraud, J. Rémy, « Le choix des conjoints en agriculture », Revue d'Etudes en Agriculture et Environnement , 3 (88), p. 25. Selon l'enquête Emploi de l'INSEE, en 1990, 70% des agriculteurs avaient une conjointe d'origine agricole ; en 2000, seulement 55% des conjointes d'agriculteurs et 39% des conjointes de jeunes agriculteurs (âgés de 25 à 35 ans) étaient d'origine agricole. En tenant compte de la part des conjointes d'origine agricole dans l'ensemble de la population, on aboutit à une baisse de l'indice d'homogamie.
* 42 Ibid. p. 34. Dans les secteurs de la polyculture et de l'élevage laitier, la part des conjointes co-exploitantes est plus importante.
* 43 A l'échelle nationale, selon l'enquête Structure des exploitations 2007 , 30% des conjointes d'exploitants professionnels sont employées, 10% sont des professions intermédiaires, moins de 5% sont cadres. Cf. L. Bisault, « Agricultrice... », art. cit ., p. 4.
* 44 Sur les caractéristiques de l'emploi salarié féminin : M. Maruani (dir.), Les nouvelles frontières de l'inégalité. Hommes et femmes sur le marché du travail , Paris, Syros, 1998.
* 45 F. Weber, « Pour penser la parenté contemporaine. Maisonnée et parentèle, des outils de l'anthropologie », in D. Debordeaux et P. Strobel, Les solidarités familiales en questions. Entraide et transmission , Paris, LGDJ/ MSH, 2002, p. 73-116.
* 46 S. Gollac, « Maisonnée et cause commune : une prise en charge familiale », in F. Weber, S. Gojard et A. Gramain (dir.), Charges de famille, op. cit. , p. 274-311.
* 47 P. Champagne, L'héritage refusé, La crise de la reproduction sociale de la paysannerie française 1950-2000 , Seuil, 2002, p. 121-199 ; A. Barthez, Famille, travail, agriculture, Paris, Economica, 1982, p. 59-73.
* 48 J. Rémy, « La crise de professionnalisation en agriculture : les enjeux de la lutte pour le contrôle du titre d'agriculteur », Sociologie du travail , n°4, 1987, p. 415-441.
* 49 B. le Wita, Ni vue, ni connue. Approche ethnographique de la culture bourgeoise, éditions de la MSH, Paris, 1988.
* 50 Nadine Lacheux représente un cas typique de ce qui est prédit par les statistiques : « Le taux d'activité des femmes bien mariées est plus faible, la dépendance objective vis-à-vis du mari augmente (...). Ce mouvement ascensionnel exige la sujétion. Les femmes bien mariées pensent avoir moins de pouvoir au sein de leur ménage, la dépendance subjective vis-à-vis du mari augmente », cf. F. de Singly, Fortune et infortune de la femme mariée. Sociologie des effets de la vie conjugale , Paris, PUF, 2004 (1 ère ed. 1987), p. 152.
* 51 Le travail salarié des compagnes d'agriculteurs est même devenu légitime pour la profession agricole, dans le cadre d'une meilleure reconnaissance des fonctions non-productives de l'agriculture, notamment le maintien du tissu économique et social rural. Cf. C. Laurent, J. Rémy, « Multifonctionnalité des activités, pluralité des identités », Les cahiers de la multifonctionnalité , n°7, 2004, p. 11.
* 52 Sur l'argent dans les rapports conjugaux, Cf. D. Roy, « Tout ce qui est à moi est à toi ? Mise en commun des revenus et transferts d'argent dans le couple », Terrain, n°45, 2005, p. 41-52 ; H. Belleau et C. Henchoz (dir.), L'usage de l'argent dans le couple : pratiques et perceptions des comptes amoureux, perspective internationale, Paris, L'Harmattan, 2008 ; A. Martial, La valeur des liens, Hommes, femmes et transactions familiales, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2009.
* 53 « Les femmes parlent de la crise », Le Paysan Français , Revue régionale viti-vinicole des Charentes et du Bordelais, n°967, septembre 1998. L'article reprend plusieurs témoignages de femmes de viticulteurs, dont le salaire constitue quasiment le seul revenu familial. « A l'heure actuelle, mon salaire constitue le seul revenu de la famille : il sert à payer la voiture, les travaux de la maison, les frais courants. A noter qu'en 17 ans de mariage, ce fut toujours le cas » (Marie-Claire, 40 ans, enseignante, mariée à un viticulteur de Grande Champagne) ; « On savait dès le départ que sans mon salaire on n'y arriverait pas. Mon salaire sert aux charges familiales ainsi qu'aux dépenses autour de la maison » (Marie-Christine, 50 ans, cadre, mariée à un viticulteur de Petite Champagne).
* 54 En reprenant les termes de Joan Scott et Louise Tilly, on peut qualifier ce recours au marché salarié du travail d' économie de salaire familiale . Ces deux historiennes étudient en France et en Angleterre le processus d'industrialisation au XIX e siècle. Leurs conclusions se veulent beaucoup plus nuancées que le constat d'une « émancipation » des femmes dans le travail salarié : « L'entrée des femmes sur le marché du travail n'était souvent qu'une stratégie familiale, une manière pour elles d'assurer leur part habituelle de responsabilités familiales », Cf. J. Scott, L. Tilly, Les femmes, le travail et la famille , Paris, éditions Rivages, 1987 (1 ère éd. 1978), p. 13.
* 55 J'ai rencontré un seul exemple d'une jeune femme, diplômée d'une petite école de commerce et directrice d'une association d'aides à domicile, qui a imposé la location d'un appartement en ville à proximité de son lieu de travail et à environ 30 km de l'exploitation de son conjoint.
* 56 Sur les relations entre belle-fille et belle-mère, dans différents groupes sociaux, y compris agricoles, Cf. C. Lemarchant, Belles filles. Avec les beaux-parents, trouver la bonne distance, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1999.
* 57 Le recours aux grands-parents comme mode de garde des enfants en bas âge n'est pas spécifique aux familles agricoles. Une enquête de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse auprès de personnes de la génération pivot âgées de 49 ans à 53 ans, montre que 85% des grands-mères et 75% des grands-pères gardent au moins occasionnellement leurs petits-enfants en bas âge. Lorsque les deux membres du jeune couple travaillent, les enfants bénéficient d'autant plus d'une garde régulière (toutes les semaines), que leurs revenus sont faibles. Cf. C. Attias-Donfut, M. Ségalen, Grands-parents : la famille à travers les générations , Paris, Odile Jacob, 1998.
* 58 Sur le temps partiel subi, très fréquent dans les emplois féminisés du tertiaire, voir T. Angeloff, Le temps partiel, un marché de dupes ? , Paris, Syros, 2000.
* 59 Dans les vignes, tâche manuelle exécutée entre mars et avril qui consiste à attacher les rameaux sur le palissage.
* 60 A partir des données de l'enquête Etude de l'histoire familiale de 1999, Mélanie Vanderschelden établit que le risque annuel de rupture des hommes agriculteurs est de 37 % inférieur à celui des hommes employés ayant les mêmes caractéristiques qu'eux (année de mise en couple, âge à la mise en couple, âge relatif de fin d'études, nombre d'enfants, etc.). Le groupe des agriculteurs est la catégorie socio-professionnelle masculine qui a le plus faible risque de rupture, toutes choses égales par ailleurs. Cf. M. Vanderschelden, « Les ruptures d'unions : plus fréquentes, mais pas plus précoces », INSEE Première, n°1107, 2006, p. 1-4.
* 61 O. Schwartz, La notion de « classes populaires », Habilitation à diriger des recherches, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 1998, p. 127, sur le cas des chauffeurs de bus à la RATP.
* 62 J. Kellerhals, J.-F. Perrin, G. Steinauer-Cresson, L. Voneche, G. Wirth, Mariages au quotidien. Inégalités sociales, tensions culturelles et organisation familiale, Lausanne, Pierre-Marcel Favre, 1982.
* 63 A. Boigeol, J. Commaille, B. Munoz-Perez « Le divorce », Données sociales, Paris, Insee, 1984, p. 428-446.
* 64 L'appauvrissement des femmes lors des séparations conjugales n'est pas spécifique aux familles agricoles : cf. L. Cardia-Vonèche, B. Bastard, Les femmes, le divorce et l'argent , Genève, Labor et Fides, 1991.
* 65 Dans l' Enquête Foncière de 1992, seulement 6% des couples mariés comprenant au moins un agriculteur avaient opté pour un contrat de séparation des biens, mais c'était le cas en revanche de 14% des couples dont le chef d'exploitation était âgé de moins de 36 ans, cf. A. Barthez, « Le patrimoine foncier des agriculteurs vivant en couple », Agreste Cahier n°17-18, 1994, p. 23-36.
* 66 Samuel Aisard est chef d'exploitation depuis 1999. L'exploitation comporte une vingtaine d'hectares de vignes (dont la production est commercialisée en eau-de-vie à de grandes maisons de négoce), 70 hectares de terres cultivées en céréales et en prairie et un troupeau d'une quinzaine de vaches allaitantes. L'exploitation est en agriculture biologique depuis 2001. Elle emploie deux ouvriers agricoles. Sophie Aisard a interrompu son activité d'aide-soignante en 2000-2001 pour travailler à mi-temps en tant que conjointe-collaboratrice sur l'exploitation de son compagnon, peu avant leur séparation.
* 67 I. Théry, Le démariage. Justice et vie privée , Paris, Odile Jacob, 1993 ; B. Bastard, Les démarieurs. Enquête sur les nouvelles pratiques de divorce , Paris, La Découverte, 2002. Les grandes étapes juridiques sont : la mise en place des premières gardes conjointes dans les années 1980 ; l'attribution de l'autorité parentale conjointe de principe (loi du 8 janvier 1993) qui permet, de fait, l'augmentation du nombre des « résidences en alternance » comme modalité pratique de cet exercice conjoint de l'autorité parentale ; l'entrée de cette modalité dans le Code Civil (loi du 4 mars 2002) qui donne le pouvoir au juge d'imposer une « résidence en alternance » en cas de désaccord entre parents.
* 68 G. Augustins, Comment se perpétuer ? Devenir des lignées et destins des patrimoines dans les paysanneries européennes , Nanterre, Société d'ethnologie, 1989.
* 69 83% des fils d'agriculteurs nés avant 1940 ont quitté le système scolaire sans diplôme ou avec, au mieux, le CEP contre 59% seulement des hommes nés avant 1940. 8% des fils d'agriculteurs nés après 1970 sont sortis avec, au mieux, le seul CEP contre 12,3% des hommes de la même génération.
* 70 24,9% des fils d'agriculteurs nés après 1970 ont acquis un niveau de bac technologique, professionnel ou un brevet de technicien. 14,8% des hommes de moins de 30 ans sont dans ce cas. Les fils d'agriculteurs ont deux fois plus de chance que l'ensemble de la population d'accéder à ces diplômes des filières techniques longues. Et on sait aujourd'hui avec les premiers résultats du Recensement agricole 2010 que les BTS deviennent des diplômes de plus en plus prisés par les fils d'agriculteurs.
* 71 Le pourcentage de diplômés s'est accru au fur et à mesure de l'élévation du niveau exigé pour l'obtention des aides (passant du CAPA au bac professionnel gestion d'exploitation agricole).
* 72 Enquête Formation et Qualification Professionnelle (FQP) 2003 de l'INSEE.
* 73 Les diplômés : 51,7% des fils d'agriculteurs âgés de 40 à 49 ans en 1999 et titulaires d'un BEP, sont devenus agriculteurs. Les non-diplômés : 22,2% des fils d'agriculteurs âgés et de 40 à 49 ans et titulaires au mieux d'un BEPC ont choisi le métier d'agriculteur.
* 74 Il ne s'agit pas ici de laisser penser que les agriculteurs non-diplômés ne sont pas assez « doués » scolairement. C'est l'école qui ne fait pas sens. La transmission des compétences passant essentiellement par la famille. D'une certaine manière, c'était le sentiment dominant avant les années 1960 parmi les agriculteurs.
* 75 Nous forçons le trait au risque d'être schématique. Une frange des « diplômés » peut avoir le même sentiment et éprouver des difficultés scolaires importantes mais a pu mieux gérer sa scolarité par le choix de formations en alternance (en Maisons familiales rurales par exemple).
* 76 Notons toutefois que le clivage culturel n'oppose pas strictement les petits exploitants aux grands, mais qu'il traverse chaque catégorie d'exploitation.
* 77 Ainsi 43% des fils âgés de 40 à 49 ans sortis sans diplôme ou avec le CEP et 45,9% des titulaires d'un CAP ont un emploi d'ouvrier (plus particulièrement dans les emplois industriels de l'artisanat pour ces derniers) contre 31,6% de l'ensemble des fils de cette génération en moyenne.
* 78 Ainsi 30,9% des fils âgés de 40 à 49 ans disposant d'un bac professionnel ont une profession intermédiaire contre 15,3% des fils disposant d'un CAP.
* 79 Parmi les hommes de 40 à 49 ans en 2000 qui participent au travail dans les exploitations agricoles sans y être salariés, 30,1% déclarent une autre profession principale qu'agriculteurs.
* 80 Le recensement agricole de 2010 fait état d'un taux de 27% des chefs ou des coexploitants d'exploitations agricoles qui sont des femmes. Si l'évolution par rapport à 1970 est saisissante (le même taux n'était que de 8%), c'est essentiellement parce que les femmes de 1970 avaient un statut d'aide familial, de travailleur à titre gratuit. L'agriculture n'est pas plus « féminine » qu'il y a 40 ans comme on a pu l'entendre dans la presse récemment. Il faudrait plutôt dire qu'elle donne aujourd'hui plus souvent qu'avant un statut professionnel reconnu aux conjointes qui travaillent sur l'exploitation. En 2010 cependant, 62% des conjoints actifs sur l'exploitation et qui n'ont pas le statut de coexploitant sont des femmes (Laisney, 2012).
* 81 Et même un choix réversible s'il n'est pas satisfaisant pour la conjointe (Dufour, Giraud, 2012).
* 82 Il faudrait ajouter un troisième groupe qui est celui des agriculteurs sans ascendance familiale agricole qui représente, en 1999, environ 15% des agriculteurs.
* 83 Ce texte est la version légèrement remaniée de : N. Renahy, « Relégation au village. Sur la crise de reproduction du groupe ouvrier en milieu rural », SociologieS , Dossier « Frontières sociales, frontières culturelles, frontières techniques », mis en ligne le 27 décembre 2010.
* 84 Les noms de lieux et de personnes ont été modifiés.
* 85 Des premières enquêtes de sociologie industrielle dirigées par Alain Touraine à l'après-guerre aux plus récentes qui ont porté un nouveau regard sur le monde ouvrier dans les années 1990 (Schwartz, 1990 ; Beaud et Pialoux, 1999), ce sont surtout les sites d'implantation de la grande industrie automobile ou minière qui ont intéressé les sociologues.
* 86 Dans la commune, le vote à destination du PCF atteint 19 % des voix au premier tour des présidentielles de 1969, celui pour le PS 32 % en 1969 et 53 % en 1974.
* 87 Sources des données généalogiques : Etat civil et listes nominatives des recensements de la commune de Foulange ; enquête orale.
* 88 Ce point est important : une des limites (ou des caractéristiques) de l'enquête à base monographique est de ne prendre uniquement en compte la population restée sur place. On ne s'intéresse donc pas ici aux jeunes qui ont (massivement) quitté le village encore enfants, suite au licenciement de leurs parents, ni à ceux qui l'ont fait plus tard du fait d'une réussite scolaire ou d'une opportunité professionnelle. Certains « retours au village » ont cependant pu être observés vers l'âge de trente ans, ils sont généralement synonymes d'échecs professionnels ou matrimoniaux, et donnent à voir qu'il ne suffit pas de « bouger pour s'en sortir » (cf. Renahy, 2009). L'inégalité face à la réinsertion professionnelle suite à un licenciement collectif est par ailleurs excessivement genrée : cf. Trotzier, 2005.
* 89 Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes.
* 90 Employé du Service Après Vente.
* 91 10 000 Francs français, soit 1500 € environ.
* 92 Ce point mériterait un plus long développement. Ne pouvant le traiter ici, nous nous permettons de renvoyer à l'ouvrage Les gars du coin (Renahy, 2005), dans lequel sont mesurées les articulations problématiques des appartenances électives avec les sociabilités villageoises et usinières, mais aussi dans des domaines aussi divers que la politisation ou l'accès à une relation affective stable.
* 93 En effet, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est d'abord la trajectoire migratoire saisie à travers le pays de naissance des individus et de leurs parents. Dans le second temps de l'exposé, je suis davantage attentive à l'origine perçue et aux processus d'altérisation à l'oeuvre dans l'espace local, justifiant l'usage des termes « ethnique », « race » et « ethno-racial » dans une perspective à la fois relationnelle et constructiviste. Sur ce point, voir notamment le travail de l'anthropologue F. Barth (1969).
* 94 Ce taux était passé de 35 % en 1954 à 51 % en 1984. Mais la part des catégories populaires et des primo-accédants parmi les accédants récents diminue, au profit des ménages plus aisés et des multipropriétaires.
* 95 Sur ce point, voir notamment l'article de Didier Fassin (2002) ainsi que les travaux de Patrick Simon à l'INED.
* 96 Nous mobilisons ici les données de l'enquête Mobilité géographique et insertion sociale (MGIS) de l'INED (1992) et des Enquêtes logement de l'INSEE (1996, 2002 et 2006).
* 97 Avec 39% de propriétaires et 30% de locataires HLM en 2006, les ménages immigrés sont surreprésentés dans le parc locatif social et sous-représentés dans la propriété par rapport à leur poids dans la population française ; les proportions sont inverses pour les ménages non immigrés, qui comptent 59% de propriétaires.
* 98 Sur ces aspects, voir notamment le travail d'Edmond Préteceille (2009), de Jean-Louis Pan Ké Shon et Claire Scodellaro (2011) et de Mirna Safi (2009, 2011).
* 99 Nom anonymisé de la commune dans laquelle nous avons conduit l'enquête ethnographique.
* 100 Le terme fait référence au critère de la nationalité.
* 101 La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a considérablement relancé cette forme de coopération locale.
* 102 Ainsi, on remarquera que si la plupart des pays européens ont connu une réduction de leur nombre d'unités de gouvernements locaux, les pays d'Europe Centrale et d'Europe de l'Est font exception : après la forte tendance centralisatrice du régime communiste, de nombreux pays - comme la République tchèque, la Slovénie ou la Roumanie - ont rétabli des communes anciennement fusionnées.
* 103 Un tel phénomène reste toutefois difficile à mettre en évidence dans le cas de la France (Dallier, 2006).
* 104 Dans une étude économétrique sur les EPCI français, Frère et al. (2011) apportent les premières preuves empiriques de l'existence d'un tel effet zoo dans le secteur public local français.
* 105 En France, au vu des compétences et budgets extrêmement importants alloués aux structures intercommunales, cette carence démocratique y est vigoureusement dénoncée. Pour y remédier partiellement, un mode d'élection par fléchage est maintenant prévu : sur les listes des candidats aux élections municipales, les membres qui siègeront au conseil communautaire de l'EPCI à fiscalité propre de la commune seront clairement identifiés. Néanmoins, « il ne faut pas [...] négliger les effets négatifs d'une élection au suffrage universel direct, comme une réduction des transferts de compétences, du fait de la volonté des maires de préserver leurs pouvoirs » (CDLR, 2007, p.35).
* 106 En effet, la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (dite loi « RCT ») poursuit un triple objectif en matière de coopération intercommunale : (i) couvrir la totalité du pays par des EPCI à fiscalité propre d'ici au 1 er juin 2013 ; (ii) rationaliser les périmètres de ces EPCI ; (iii) simplifier l'organisation territoriale intercommunale en intégrant dans ces EPCI les compétences des syndicats intercommunaux afin de les supprimer.
* 107 Ce texte a été publié dans la revue POUR, n°209-210 - Juin 2011.
* 108 Philippe Garraud, Profession : homme politique. La carrière politique des maires urbains, L'Harmattan, 1989 ; Albert Mabileau, Claude Sorbets (dir.), Gouverner les villes moyennes , Pedone, CERVL, 1989.
* 109 Joseph Fontaine, Christian Le Bart (dir.), Le métier d'élu local, L'Harmattan, 1994.
* 110 En 2008, 29 % des maires sont issus du secteur privé et 26 % viennent du secteur public.
* 111 L'« espace à dominante rurale » est un espace «résiduel», ce qu'il reste une fois définies les aires fonctionnelles d'influence des villes.
* 112 Nicolas Hubé, « Le recrutement social des professionnels de la politique » in Antonin Cohen, Bernard Lacroix, Philippe Riutort (dir.), Nouveau manuel de Science politique , La Découverte, 2009.
* 113 Sébastien Vignon, Des maires en campagnes. Les logiques de (re)construction d'un rôle politique spécifique , thèse de doctorat en Science Politique, Université de Picardie Jules Verne, 2009.
* 114 Jean-Noël Retière, « Autour de l'autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire », Politix , 16, n° 63, 2003.
* 115 Sébastien Vignon, « La dynamique des marchés électoraux périphériques. L'exemple des élections municipales de mars 2001 dans les communes rurales de la Somme » in J. Lagroye, P. Lehingue, F. Sawicki (dir . ), Mobilisations électorales. Le cas des élections municipales de mars 2001 , Presses Universitaires de France/CURAPP, 2005.
* 116 Mark Kesselman, Le consensus ambigu . Étude sur le gouvernement local , Cujas, 1972.
* 117 Jean-Noël Retière, « Être sapeur-pompier volontaire. Du dévouement à la compétence », Genèses n° 16, juin 1994.
* 118 Le registre « domestique » donne une valeur primordiale aux relations personnelles entre les gens, et plus exactement aux relations de hiérarchie implicite ; Luc Boltanski, Laurent Thévenot, De la Justification. Les économies de la grandeur , Gallimard, 1991, p. 214.
* 119 Nicole Chambron, Bertrand Hervieu (dir.), Le pouvoir au village , Paris X, Groupe de recherches sociologiques, 1974.
* 120 Jean-Louis Briquet, « Communiquer en actes. Prescriptions de rôle et exercice du métier politique », Politix 28, 1994.
* 121 Frédérique Matonti, Franck Poupeau, « Le capital militant. Essai de définition », Actes de la Recherche en Sciences sociales n° 155, 2004.
* 122 Rémy Le Saout, « De l'autonomie fonctionnelle à l'autonomie politique. La question de l'élection des délégués des établissements intercommunaux », Actes de la recherche en sciences sociales n° 140, 2001.
* 123 En 2001, dans le département de la Somme, près de la moitié (48 %) des maires présidents/vice-présidents (n= 63) ont été élus à ce poste la première fois en ayant moins de 12 ans d'expérience municipale (mandat de conseiller municipal inclus), ce qui est relativement faible dans des espaces où le cursus honorum municipal reste une modalité fréquente.
* 124 Luc Boltanski, Pierre Bourdieu, « La production de l'idéologie dominante », Actes de la recherche en sciences sociales , 2-3, 1976.
* 125 Fabien Desage, David Guéranger, La politique confisquée. Sociologie des réformes et des institutions intercommunales , Le Croquant, 2011.
* 126 Alain Faure, Le village et la politique. Essai sur les maires ruraux en action , L'Harmattan, 1992.
* 127 À peine 1 % des présidents et vice-présidents des groupements à fiscalité propre appartiennent au(x) monde(s) ouvrier(s) en 2008.
* 128 Sébastien Vignon, « Les élus ruraux face à la `démocratie d'expertise' intercommunale. Les `semi-professionnels' de la politique locale » in Sylvain Barone, Aurélia Troupel (dir.), Battre la campagne. Elections et pouvoir municipal en milieu rural , L'Harmattan, 2010.
* 129 Jacques Caillosse, Patrick Le Lidec, Rémy Le Saout, « Le `procès' en légitimité démocratique des EPCI », Pouvoirs locaux n° 48, 1/2001.
* 130 Rémy Le Saout (dir.), L'intercommunalité en campagne . Rhétoriques et usages de la thématique intercommunale dans les élections municipales de 2008 , Presses Universitaires de Rennes, 2010.
* 131 « Alzheimer : deux nouveaux drames » en "Une" du Progrès , le 13 août 2012.
* 132 L'épouse atteinte d'Alzheimer était allée visiter une maison spécialisée quelques semaines auparavant et aurait refusé d'y entrer estimant que « c'était une horreur ». Progrès , le 13 août 2012, p.7.
* 133 Ces deux drames ont eu lieu à un jour d'intervalle début août 2012.
* 134 Sur ces types de population, nous renvoyons à Isabelle Mallon, « Le milieu rural isolé isole-t-il les personnes âgées ? », Espace populations sociétés , 2010/1 | 2010, 109-119, notamment p.109-110.
* 135 Ce vieillissement s'accélère durant les années 1970, cf. « L'accélération du vieillissement en milieu rural », in Rapport Maurice Arreckx (dir), Rapport sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées dépendantes , 1979, p.28-29.
* 136 Selon l'INSEE, en 1970 le taux de pauvreté des personnes âgées de 70 ans et plus est le double de celui de l'ensemble de la population (soit 37%).
* 137 Cela s'accompagne d'une revalorisation des pensions de retraite au cours des années 1970 et 1980. La pension de retraite perçue en moyenne s'élève en 1991 à 7100 francs par mois (1504 euros de 2011).
* 138 Le vieillissement des campagnes s'accompagne d'un recul de l'activité agricole qui s'accentue des années 1960 aux années 1980. De 1954 à 1962, l'agriculture perd 25% de sa population active. De 1954 à 1982, la population rurale est passée de 42% à 27% de la population française - 26% des actifs travaillant dans l'agriculture. Ils ne sont plus que 7% au milieu des années 1980. De la fin des années 1950 jusqu'en 1970, l'agriculture perd 160 000 emplois par an. Plus de la moitié des agriculteurs ont 50 ans ou plus au milieu des années 1980.
* 139 Le rapport insiste sur la nécessité d'agir surtout en amont pour « stimuler le maintien en vie de certains secteurs, maintien des jeunes en milieu rural, seul à même d'éviter la dégradation du tissu humain ». Rapport du groupe de travail « Vieillir demain » 1981-1985 , Commissariat général au Plan, préparation du 8 ème Plan, La documentation française, 1980.
* 140 Centre des archives contemporaines (CAC), 2000 359/1.
* 141 Rapport « Vieillir dans les zones rurales isolées. Un défi aux services sociaux et médicaux », Bilan du groupe d'experts international, Eymoutiers/Limoges, 23-25 novembre 1983, Paris, Ministère des Affaires sociales et de la solidarité nationale, Direction de l'action sociale, Vienne, Centre européen de formation et de recherche en action sociale, 1984. CAC, 2000 359/1.
* 142 Cette allocation est accordée dans les mêmes conditions de ressources que celles définies pour les services ménagers et elle est attribuée lorsqu'il n'existe aucun des services ménagers dans la commune ou en raison du choix de la personne. Le montant de l'allocation ne peut dépasser 60% du coût des services ménagers.
* 143 Cette journée d'étude sur le « vieillard dans la société contemporaine » rassemble tous les acteurs locaux intéressés par le problème de la vieillesse (organismes publics, associations, communes, élus du département).
* 144 Cette association est fondée quelques mois avant la publication des textes concernant la création d'un Fonds d'action sociale du régime général de la Sécurité sociale (septembre 1959) et avant la législation sur l'aide sociale en avril 1962. « Aide ménagère. Action à domicile en faveur des personnes âgées, dans les communes rurales », Le délégué au bureau d'aide sociale , trimestriel, 4 ème année, n°16, décembre 1972, p.1.
* 145 Nous remercions l'ADMR de nous avoir fourni ces chiffres.
* 146 Ces services de soins à domicile répondent à une forte demande des personnes aidées et de leurs aidants. Une enquête menée durant les années 1980 auprès des aidants de Haute-Garonne par la Fédération nationale des associations de retraités (FNAR) avait permis de dénoncer « la répartition inégale des soins à domicile surtout en milieu rural et son développement insuffisant ainsi que le nombre trop limité d'aides ménagères en particulier pour les cas lourds ». Avait également été souligné « le manque de petites structures d'hébergement à proximité ». Lettre de la FNAR , mars 1987.
* 147 En 1983, par exemple, la MSA dépense 100 millions de francs pour le service à domicile pour 37 500 bénéficiaires (3,2 millions d'heures assurées en aide à domicile). Secrétariat d'État chargé des personnes âgées, Lettre d'information n°8 , janvier-février-mars 1984, p.11. CAC, 2000 359/1.
* 148 Isabelle Mallon, « Le milieu rural isolé isole-t-il les personnes âgées ? », op.cit ., p.117-118.
* 149 C. Gucher, I. Mallon, V. Roussel, Vieillir en milieu rural : chance ou risque de vulnérabilité accrue ?, Contrat de recherche émanant du GIS Institut national de la Longévité et du vieillissement, Inserm, 2004-2007.
* 150 Isabelle Mallon, « Le milieu rural isolé isole-t-il les personnes âgées ? », op.cit ., p.117-118.
* 151 Sur l'importance du voisinage, nous renvoyons à : D. Argoud, F. Le Borgne-Uguen, F.Mantovani, J.Pennec, P. Pitaud, Prévenir l'isolement des personnes âgées. Voisiner au grand âge , Paris, Dunod, 2004 ; P. Pitaud (dir.), Solitude et isolement des personnes âgées : l'environnement solidaire , Ramonville-Saint-Agne, Erès, 2004.
* 152 Le pourcentage des personnes âgées, voire très âgées vivant en zone rurale est important : il s'élève à 17,7 % pour les personnes de plus de 80 ans dans l'espace à dominante rurale alors qu'il est à un peu moins de 16 % pour ce type de population dans l'espace à dominante urbaine.
* 153 François Bourlière (dir.), Rapport du groupe de travail sur les aspects médicaux du vieillissement , 1970.
* 154 Rapport Benoist, Les problèmes médicaux et sociaux posés par les personnes âgées dépendantes, Conseil économique et social, 1985.
* 155 INSEE, recensement population, 1990.
* 156 Dossier dépendance des personnes âgées (rapports, analyses), 1990-1994. CAC, 2000 359/8.
* 157 Dossier dépendance des personnes âgées (rapports, analyses), 1990-1994. CAC, 2000 359/8.
* 158 Dossier dépendance des personnes âgées (rapports, analyses), 1990-1994. CAC, 2000 359/8.
* 159 On la désigne également sous le terme Allocation compensatrice tierce-personne (ACTP).
* 160 Dossier dépendance des personnes âgées (rapports, analyses), 1990-1994. CAC, 2000 359/8.
* 161 Les sommes indiquées en euros 2011 prennent en compte l'inflation (calcul INSEE).
* 162 Sur cette question, nous nous permettons de renvoyer à Christophe Capuano, « Les déterminants sociopolitiques de la vieillesse », in Sarah Carvallo et Elodie Giroux (dir.), Comprendre la vieillesse , Bruxelles, EME, 2012, p.111-124 et Christophe Capuano, " Aux origines des aidants familiaux". Les transformations de l'aide familiale aux personnes âgées, handicapées et malades mentales en France dans la seconde moitié du vingtième siècle, Rapport de recherche Mire/DREES et CNSA, 2012.
* 163 « M. Chérioux a estimé que la proposition de loi est opportune, le système actuel conduisant souvent les familles à se décharger de leurs obligations sur l'aide sociale ». A. Jourdain, Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi visant à la création d'une allocation pour les situations de dépendance résultant d'un état de sénescence , n°78, Sénat, séance du 14 novembre 1990, 1990, p.6.
* 164 Les familles naturelles ont aussi été écartées des bénéfices de la loi du 10 juillet 1989 sur les familles d'accueil : seules les familles d'accueil nourricières (et donc non naturelles) peuvent percevoir une rémunération pour l'entretien d'une personne âgée à domicile. Christophe Capuano, « Les déterminants sociopolitiques de la vieillesse », op.cit . p.121
* 165 Nous pouvons également parler de ré-introduction car cette disposition existait avant la loi de 1975.
* 166 Paul Paillat, Les personnes âgées et la famille dans le monde rural , s.d. CLEIRPPA/FNG.
* 167 Florence Weber, Handicap et dépendance. Drames humains, enjeux politiques , éditions de la rue d'Ulm, 2012, p.29-30.
* 168 Ibid, p.24.
* 169 Enquête menée par le CLEIRPPA (Centre de liaison, d'étude, d'information et de recherche sur le problème des personnes âgées) auprès de 3821 personnes âgées vivant à la campagne entre mi-janvier et mi-février 1990. Document 60bis, ADMR. Commission dépendance, CAC 19970435/5.
* 170 24% sont des couples seuls, 12% cohabitent avec d'autres personnes.
* 171 Parmi ceux-ci : 40 % ont des WC à l'extérieur du logement, 41% n'ont pas d'eau chaude. Ce sont souvent des personnes seules, très âgées, aux revenus faibles. Elles vivent dans une maison individuelle, plutôt dans l'habitat rural dispersé ou isolé. Leur maintien à domicile est considéré comme étant « à la limite de la faisabilité ».
* 172 Cela doit prendre place dans un cadre légal spécifique, fixé au plan national (justifié par la volonté d'harmoniser l'action publique sur l'ensemble du territoire national et l'existence de financement sur le budget de la CNSA). Cf. Agnès Gramain, Florence Weber, et alii ., La prise en charge de la dépendance des personnes âgées : les dimensions territoriales de l'action publique , Rapport pour la Mire/Drees, avril 2012, p.35-53.
* 173 Ibid.
* 174 Il est possible d'influer sur les critères de l'éligibilité (et notamment, le GIR) ou de mettre en place des dispositifs d'incitation et de désincitation face aux demandeurs potentiels. Outre le nombre de bénéficiaires, d'autres consignes peuvent être prises pour limiter les coûts : consignes sur le contenu des plans d'aide, sur la prise en compte des familles et sur la coordination avec les services d'aide constituent aussi des choix mis en oeuvre par certains départements. Cf. Agnès Gramain, Florence Weber, et alii ., La prise en charge de la dépendance des personnes âgées : les dimensions territoriales de l'action publique , Rapport pour la Mire/Drees, avril 2012, p.35-53.
* 175 Selon une enquête de France Alzheimer en 1995, 50% déclarent qu'ils utiliseraient une à deux fois par semaine une structure d'accueil de jour si elle existait et 64% auraient recours à un hébergement temporaire entre 2 et 4 semaines par an.
* 176 Les propositions de l'ADMR pour la reconnaissance et la prise en charge du risque dépendance des personnes âgées, ADMR, p.2. Document n°60, ADMR. Commission dépendance, CAC 1997043/5.
* 177 Ce programme donne lieu à la création d'une aide financière, d'un montant annuel maximal de 4 036 francs en 1999, pour couvrir 80% de la charge financière engendrée par l'accueil temporaire de ses pensionnaires dans l'un des cent établissements médico-sociaux conventionnés dans la région.
* 178 ENA, « Les politiques sociales et l'entourage des personnes âgées », séminaire de questions sociales : Le vieillissement de la population française et ses conséquences sur les politiques publiques, 2001.
* 179 Cette insuffisance est une constante : en 1997, on ne dénombrait que 7 037 places en hébergement temporaire à l'échelon national. SESI, « Les établissements d'hébergement pour personnes âgées », document statistique n°297, janvier 1998.
* 180 Enquête de 1990 du CLEIRPPA, op. cit. Document 60bis, ADMR. Commission dépendance, CAC 19970435/5.
* 181 De cette enquête, il ressort en effet que 40% des personnes interrogées éprouvent des difficultés pour faire seules leur toilette, 50% pour se lever seules de leur lit ; plus de 70% ont des difficultés pour ramasser un objet à terre ou lacer leurs chaussures, 60% ont besoin d'aide pour sortir de leur logement (25% ont une mobilité très réduite).
* 182 Selon l'enquête de 1990, 20% des personnes interrogées et 17% des conjoints sont aveugles ou ont une très mauvaise vue, 20% des personnes interrogées et 17% des conjoints sont plus ou moins sourds, utilisent un appareil, 13% des personnes interrogées et 13% des conjoints ont des troubles psychiques, 22% des personnes interrogées et 26% des conjoints affirment avoir souvent/toujours des troubles de mémoire.
* 183 Selon l'enquête de 1990, 26% des personnes interrogées et 25% des conjoints ont été hospitalisés au cours de l'année précédente. Si 42% affirment n'avoir rencontré aucun problème pour le retour au domicile, les autres disent souffrir de difficultés notamment d'un manque d'aide ménagère ou d'heures attribuées pour cette aide (32% des cas).
* 184 En 1998, l'enquête HID-domicile montre que seulement 22% des personnes âgées dépendantes à domicile, citadines et rurales, ne sont aidées que par des professionnels. La plupart d'entre elles reçoivent l'aide de proches : 33% ont recours exclusivement à une aide familiale et 45% combinent aide familiale et aide professionnelle.
* 185 En 2009, les comptes de la protection sociale en France représentent 624 milliards d'euros, l'APA représente quant à elle 4,7 milliards. Si l'on inclut dans les sommes consacrées à la dépendance les dépenses de santé spécifiques des personnes dépendantes et les exonérations dont elles font l'objet, le total est de 21,6 milliards (3% des comptes de la protection sociale). Cf. Florence Weber, Handicap et dépendance. Drames humains, enjeux politiques , op.cit., p.11-12.
* 186 Selon l'enquête « Handicap incapacités dépendance », les personnes qui déclarent de sévères difficultés quotidiennes bénéficient dans trois quarts des cas de la présence d'un cohabitant (le conjoint le plus souvent, un parent, un enfant ou un autre cohabitant). Parmi le quart d'entre elles qui vivent seules, une moitié reçoit encore une aide familiale hors ménage. L'aide professionnelle aux personnes âgées dépendantes à domicile est largement complémentaire de l'aide familiale ; 10 % seulement des personnes confinées à leur domicile reçoivent une aide professionnelle exclusive.
* 187 La première enquête « Handicap incapacités dépendance » sous-estimait en 1998 l'aide des conjoints et plus généralement des cohabitants. Elle considérait leur comportement comme naturel et ne le qualifiait pas comme de l'aide. Une deuxième enquête en 2008 envisage mieux cette aide.
* 188 DREES, Études et résultats, n°142 nov.2001 ; n°182-07 2002 ; n°147 décembre 2001.
* 189 Joan Tronto, Un monde vulnérable, pour une politique du care , 2009, Paris, La Découverte ( Moral Boundaries : a Political Argument for an Ethic of care , New York: Routledge, 1993).
* 190 Rôle actif des associations d'aidants (Careers United kingdom, création 1965) en faveur de la reconnaissance du travail des aidants et de l'obtention de droits : 1995 loi accordant un statut aux aidants ( community care Act 1989 et community care services ).
* 191 Le développement du Care peut aussi être interprété comme la traduction d'une nouvelle politique, impulsée par le gouvernement conservateur britannique et sa politique très libérale, visant à réduire les dépenses publiques de santé : ces divers dispositifs auraient ainsi pour fonction de transférer le soutien fourni par les institutions publiques à un soutien fourni par les ressources familiales et informelles - ce développement des dispositifs correspondant à un désengagement de l'État.
* 192 Au principe d'équité doit s'ajouter le principe d'efficacité. 20000359/8. Claudine Attias-Donfut, Le coût de l'aide bénévole, journée d'étude sur la dépendance, Paris, 12 septembre 1990, CNAV, document n°19.3.
* 193 Nous rejoignons en cela les propositions que Florence Weber préconise in Handicap et dépendance. Drames humains, enjeux politiques , op.cit ., p.60.
* 194 Enquête BVA/Novartis, les aidants familiaux en France, 2008/2010.







