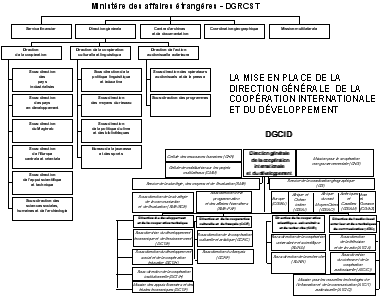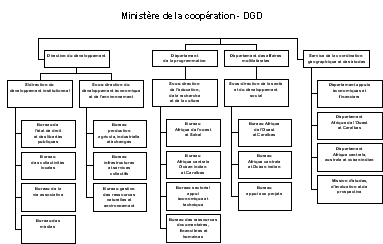Rapport d'information n° 46 (2001-2002) de MM. Guy PENNE , André DULAIT et Mme Paulette BRISEPIERRE , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 30 octobre 2001
Disponible au format Acrobat (323 Koctets)
-
INTRODUCTION
-
I. UNE RÉORGANISATION INSTITUTIONNELLE
INACHEVÉE
-
A. LE DISPOSITIF ANTÉRIEUR À LA
RÉFORME
-
A. A. A. B. LE QUAI D'ORSAY, NOUVEL ACTEUR DU
DÉVELOPPEMENT
-
C. UNE RÉORGANISATION
INACHEVÉE
-
D. POUR UNE GRANDE AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT
-
A. LE DISPOSITIF ANTÉRIEUR À LA
RÉFORME
-
II. QUELLES PRIORITES POUR L'AIDE AU
DEVELOPPEMENT
-
A. LA DIFFICILE DÉFINITION DE
VÉRITABLES PRIORITÉS GÉOGRAPHIQUES ET SECTORIELLES
-
B. LA TRADUCTION DES NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA
COOPÉRATION SUR LE TERRAIN : LES EXEMPLES DE MADAGASCAR ET DU
KENYA
-
A. LA DIFFICILE DÉFINITION DE
VÉRITABLES PRIORITÉS GÉOGRAPHIQUES ET SECTORIELLES
-
III. QUELS MOYENS POUR UNE NOUVELLE
AMBITION ?
-
A. LE DÉCLIN DE L'EFFORT EN FAVEUR DE
L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT MALGRÉ LA RÉNOVATION DES
INSTRUMENTS FINANCIERS
-
B. L'ASSISTANCE TECHNIQUE : UN INSTRUMENT QUI
DOIT REDEVENIR PRIORITAIRE
-
A. LE DÉCLIN DE L'EFFORT EN FAVEUR DE
L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT MALGRÉ LA RÉNOVATION DES
INSTRUMENTS FINANCIERS
-
IV. LES SYNERGIES INDISPENSABLES AVEC LES AUTRES
BAILLEURS DE FONDS
-
A. L'IMPORTANCE CROISSANTE DES ACTEURS NON
GOUVERNEMENTAUX DONT LE POTENTIEL DEMEURE ENCORE MAL EXPLOITÉ
-
1. Le Haut Conseil de la coopération
internationale : une réponse au besoin de visibilité des
partenaires de la société civile.
-
2. Les ONG : une action dont l'impact doit
être mieux évalué.
-
3. Les nouvelles responsabilités des
collectivités territoriales
-
4. La nécessité d'une reconnaissance
plus affirmée du rôle crucial du secteur privé.
-
1. Le Haut Conseil de la coopération
internationale : une réponse au besoin de visibilité des
partenaires de la société civile.
-
B. L'INFLUENCE DE LA FRANCE AU SEIN DES ENCEINTES
MULTILATÉRALES : ENJEU ESSENTIEL POUR DÉMULTIPLIER L'EFFORT
DE NOTRE PAYS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT.
-
A. L'IMPORTANCE CROISSANTE DES ACTEURS NON
GOUVERNEMENTAUX DONT LE POTENTIEL DEMEURE ENCORE MAL EXPLOITÉ
-
I. UNE RÉORGANISATION INSTITUTIONNELLE
INACHEVÉE
-
CONCLUSION
-
EXAMEN EN COMMISSION
-
ANNEXE I -
MISSIONS D'INFORMATION
A MADAGASCAR ET AU KENYA -
PROGRAMME DES ENTRETIENS
-
ANNEXE II -
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
N° 46
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
|
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 2001 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1), sur la réforme de la coopération,
Par M. Guy PENNE, Mme Paulette BRISEPIERRE
et M.
André DULAIT,
Sénateurs.
(1) Cette commission est composée de : M. Xavier de Villepin, président ; MM. Michel Caldaguès, Guy Penne, André Dulait, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Robert Del Picchia, Jean-Paul Delevoye, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe François, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Henri Torre, André Vallet, Serge Vinçon.
|
Affaires étrangères et coopération. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le 4 février 1998, le gouvernement adoptait une profonde réforme de notre dispositif de coopération.
La principale des dispositions arrêtées, la plus spectaculaire et la plus novatrice, portait sur le regroupement des services du secrétariat d'Etat à la coopération et du Quai d'Orsay afin de permettre la constitution d'un « grand ensemble diplomatique » placé sous l'autorité du ministère des affaires étrangères. Les quatre autres mesures s'inscrivaient davantage dans le prolongement des évolutions progressives de notre politique d'aide au développement au cours de la dernière décennie : création d'un comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) composé des principaux ministres intéressés par ces questions ; promotion de l' Agence française de développement (nouvelle désignation de la Caisse française de développement) comme « opérateur pivot » des projets d'aide au développement ; délimitation d'une « zone de solidarité prioritaire » destinataire de notre aide au développement ; enfin, mise en place d'un Haut conseil de la coopération internationale représentant la société civile.
En dépit des interventions répétées des sénateurs et des députés, le Parlement n'a guère été associé à cette réforme. Il était donc particulièrement nécessaire que notre Haute Assemblée, quatre ans après, puisse en dresser un premier bilan. C'est pourquoi votre commission des affaires étrangères a décidé de confier à ses trois rapporteurs pour avis du budget du ministère des affaires étrangères : MM. Guy Penne (relations culturelles extérieures et francophonie), André Dulait (affaires étrangères), vice-présidents, et Mme Paulette Brisepierre (aide au développement), la mission de s'informer sur les conditions dans lesquelles a été conduit ce vaste chantier ainsi que sur les résultats obtenus. Ces derniers doivent être jugés à l'aune des trois grands objectifs qui les ont inspirés :
- rationaliser un dispositif d'aide souvent complexe et favoriser en particulier une meilleure coordination des services ;
- renforcer l' efficacité de l'aide ainsi que sa « sélectivité » ;
- réaffirmer une véritable priorité pour les pays en développement en maintenant notamment des « flux substantiels » d'aide.
A travers ces trois grandes priorités, la réforme présente un double enjeu essentiel : quelle place occupe le continent africain , principal bénéficiaire de l'aide, au sein de notre diplomatie ? Comment mieux valoriser la somme de compétences et d'expériences qui constitue sans doute l'atout le plus précieux de la coopération française ?
Afin de nourrir sa réflexion, la mission a procédé à un grand nombre d'auditions 1 ( * ) . Elle s'est également rendue dans deux pays de la zone de solidarité prioritaire, Madagascar et le Kenya -le premier, partenaire traditionnel de notre coopération, le second, récemment intégré à la ZSP- afin de prendre la mesure sur le terrain des conséquences de la réforme. Vos trois rapporteurs se sont en outre déplacés à Bruxelles puisque l'aide européenne à laquelle notre pays apporte une large contribution, représente désormais une dimension essentielle de notre politique de coopération.
Vos rapporteurs examineront successivement le nouveau cadre institutionnel mis en place, les grandes orientations de notre aide au développement, nos principaux instruments d'intervention -financiers mais aussi et surtout humains à travers l'assistance technique 2 ( * ) - et enfin les conditions de coordination avec les autres acteurs du développement -organisations non gouvernementales, secteur privé, bailleurs de fonds multilatéraux, principalement l'Union européenne.
La réforme de la coopération répondait à une véritable nécessité. Elle traduit par ailleurs la capacité d'adaptation d'une administration que l'on a parfois taxé, abusivement, d'immobilisme. Cependant, certaines des orientations retenues, à l'épreuve des faits, suscitent de nombreuses réserves. Il en est ainsi de la prise en charge par l'outil diplomatique de missions de coopération technique. En outre, par bien des aspects, la réforme engagée paraît inachevée. Aussi, dans leurs conclusions, vos rapporteurs reviendront-ils sur ces interrogations et présenteront quelques propositions qui tentent de tenir compte des leçons de l'expérience.
I. UNE RÉORGANISATION INSTITUTIONNELLE INACHEVÉE
A. LE DISPOSITIF ANTÉRIEUR À LA RÉFORME
Avant la réforme de 1998, la responsabilité de l'aide au développement se partageait principalement entre le ministère de l'économie et des finances -pour la part la plus importante-, le secrétariat d'Etat à la coopération.
• Le ministère de la coopération
Le ministère de la coopération a été créé par un décret du 10 juin 1961. Cependant, l'administration qui en constituait l'ossature lui préexistait. En effet, elle avait été mise en place dès 1959, dans le prolongement de l'indépendance des colonies françaises d'Afrique subsaharienne, sous l'autorité du Premier ministre. Celui-ci avait alors été chargé de veiller aux relations entre la France, les Etats membres de la Communauté et, en particulier, « l'action d'aide et de coopération dans les domaines économique, financier, culturel et social » (décret du 27 mars 1959).
Dans ce cadre, un « Conseil interministériel pour l'aide et la coopération entre la République et les autres Etats de la Communauté » avait été institué, doté d'un secrétariat réunissant des fonctionnaires de l'ancien ministère de la France d'outre-mer, des administrateurs venus d'autres ministères ainsi que des contractuels. Cet embryon d'administration centrale avait été complété sur le terrain, en Afrique, par des missions d'aide et de coopération (décret du 25 juillet 1959) et la mise en place du Fonds d'aide et de coopération (FAC) -héritier du Fonds d'investissement pour le développement économique des territoires d'outre-mer (FIDES)- destiné à appuyer, sous forme de subventions d'investissements le développement des pays issus de l'ancien empire colonial français. Ce dispositif, installé rue Monsieur, avait d'abord relevé d'un ministre d'Etat auprès du Premier ministre avant de constituer une entité propre, le ministère de la coopération, chargé de « l'action d'aide et de coopération à l'égard des Etats africains situés au sud du Sahara et de la République malgache ». En 1964, la montée en puissance de cette administration se manifestait par la progression de ses effectifs (quelque 165 agents, dont 30 issus de l'ancien ministère de la France d'outre-mer, 27 du ministère de l'intérieur, 23 du ministère des finances, 25 du secteur privé, les autres de différents ministères, notamment l'éducation nationale, l'agriculture, l'industrie). En 1996, le ministère comptait 637 personnes en administration centrale, 366 dans les missions de coopération et d'action culturelle.
Tantôt confiée à un ministre de plein exercice, tantôt à un ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, tantôt à un secrétaire d'Etat, la structure dévolue à la coopération avec l'Afrique conserva sa spécificité jusqu'en 1998. Son principe ne fut jamais vraiment remis en cause même si son champ d'abord rigoureusement limité aux anciennes colonies françaises avait été progressivement étendu à l'ensemble des pays francophones de l'Afrique subsaharienne, puis en 1995, aux Etats africains anglophones ou lusophones et aux pays de la région des Caraïbes.
• Le ministère des affaires étrangères
La coopération avec les autres pays du monde -appelés pays « hors champ »- relevait de la direction de la coopération scientifique et technique du ministère des affaires étrangères. Les interventions conduites dans ce cadre différaient de celles du ministère de la coopération tant par leur nature -axée davantage sur les échanges culturels que sur le développement- que par leur impact. D'un montant modeste et dispersés sur un grand nombre de pays, ces concours pesaient naturellement beaucoup moins dans l'économie des pays bénéficiaires.
• Le ministère de l'économie et des finances
Dans les faits, le rôle principal en matière de développement revenait au ministère de l'économie et des finances à travers les responsabilités qu'il assume dans la coopération avec les pays de la zone franc ainsi que par le biais des prêts accordés aux pays en développement. A cet égard, la crise financière des années 80 a conféré à la direction du Trésor en particulier, une responsabilité éminente dans les opérations de consolidation ou de remise de dettes qui conditionnent dans une large mesure le versement de l'aide au développement. Par ailleurs, cette administration est également l'interlocuteur privilégié des grands acteurs internationaux du développement : Fonds monétaire international (FMI) et Banque mondiale. Enfin, le ministère des finances, conjointement avec les ministères de la coopération, des affaires étrangères et de l'outre-mer, exerce la tutelle de la Caisse française de développement, opérateur principal de l'aide au développement.
• La Caisse française de développement
D'abord sous le nom de Caisse centrale de coopération économique de 1958 à 1992, la Caisse française de développement dotée du statut d'établissement public et d'institution financière spécialisée soumise à la loi bancaire de 1974 est devenue l'un des principaux instruments de l'aide publique au développement. En effet, si elle intervient à deux titres assez différents : comme bailleur de fonds sous la forme de prêts privilégiés ou de subventions pour des projets d'investissement producteurs (prêts dits de « premier guichet » comportant une proportion minimale de dons à hauteur de 50 % pour les pays les moins avancés et de 35 % pour les pays à revenu intermédiaire) et comme banquier à travers des prêts accordés aux conditions de marché, ces prêts dits de « deuxième guichet » ont décliné par rapport aux opérations intégrant une forte part de subventions. Enfin, la CFD soutient par le biais de sa filiale Proparco le secteur privé ou les entreprises publiques en voie de privatisation sous la forme de fonds propres au capital ou de prêts participatifs. La caisse dispose de ressources procurées par le budget de l'Etat qu'elle complète par des prêts sur le marché.
*
* *
La principale transformation introduite par les mesures gouvernementales de 1998 s'est traduite par la disparition du secrétariat d'Etat à la coopération et la prise en charge de ses attributions par le ministère des affaires étrangères.
Cette mesure comporte trois implications : l'intégration progressive des quelque 1 150 agents en poste au secrétariat d'Etat à la coopération au sein du ministère des affaires étrangères ; la transformation des 31 missions de coopération et d'action culturelle en services de coopération au sein des ambassades ; la mise en place d'un budget unique du ministère des affaires étrangères regroupant l'ensemble des crédits dévolus aux affaires étrangères et à la coopération.
Compte tenu de son ampleur, ce chantier a été conduit par étapes sous la responsabilité d'une équipe de pilotage conjointe placée auprès du secrétaire général des affaires étrangères :
- la nouvelle organisation des services s'est mise en place au début de l'année 1999 ;
- le budget unique s'est appliqué pour l'exercice 1999 ;
- l'harmonisation des statuts des personnels -l'un des points les plus délicats de la réforme- a avancé même si elle reste inachevée.
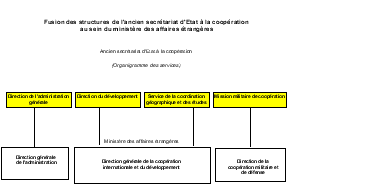
|
|
|
|
A. A. A. B. LE QUAI D'ORSAY, NOUVEL ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT
Plutôt que de « rapprochement » ou de « réunion » des structures administratives, le terme d' « intégration », même s'il a été rarement employé par les concepteurs de la réforme, paraît mieux adapté pour décrire la réalité de la réforme : la disparition d'une structure ministérielle propre à la coopération et son absorption au sein d'un ministère des affaires étrangères dont l'organisation a été révisée en conséquence. Ce mouvement a concerné non seulement les services centraux mais aussi les missions de coopération du secrétariat d'Etat à l'étranger. Toutefois, la fonction de ministre chargé de la coopération et délégué auprès du ministre des affaires étrangères a été sauvegardée.
En revanche, les attributions des autres acteurs de la politique française de développement n'ont pas été remises en cause ; elles ont même, s'agissant de la Caisse française de développement, été élargies.
1. L'intégration du secrétariat d'Etat à la coopération au sein du ministère des affaires étrangères
a) La création de la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID)
L'absorption des services de la rue Monsieur n'a entraîné de bouleversement de l'organigramme du ministère des affaires étrangères que pour la prise en charge des responsabilités assumées par la direction la plus importante de l'ancien secrétariat d'Etat à la coopération, la direction du développement.
En effet, les attributions de cette direction ont été réunies à celles de la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques, elle-même la direction la plus importante du Quai par ses effectifs.
Le nouvel ensemble issu de cette fusion constitue la direction générale de la coopération internationale et du développement (créée par le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998).
Pour le reste, la direction de l'administration générale de la coopération fusionne avec la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères (une sous-direction est créée au sein de la direction des ressources humaines pour prendre en charge la gestion de quelque 2 500 coopérants).
La mission militaire de coopération est devenue la direction de la coopération militaire et de défense rattachée à la direction générale des affaires politiques et de sécurité.
Ces modifications de structure impliquent l'intégration progressive de quelque 1 150 agents de l'ancien secrétariat d'Etat au sein du ministère des affaires étrangères.
b) Le rapprochement des statuts
Les disparités des statuts respectifs des personnels de la coopération et des affaires étrangères a longtemps constitué de fait le véritable obstacle à une fusion des administrations.
L'hétérogénéité statutaire est liée à la vocation initiale très différente assignée aux deux ministères. En effet, lorsqu'il fut créé, en 1960, le ministère de la coopération a constitué ses effectifs sur une base contractuelle afin de recruter des personnels de compétence non disponible parmi les corps de la fonction publique d'Etat, qu'il s'agisse d'économistes, d'agronomes, de médecins, d'informaticiens... Ainsi, à l'origine, l'aide au développement reposait principalement sur des contractuels chargés de postes de responsabilité au sein de l'administration centrale comme dans les services extérieurs. Ce n'est qu'à la fin des années 70 que la rue Monsieur a bénéficié de postes de catégorie A d'administrateurs et d'attachés et obtenu la possibilité, pour les catégories B, C et D, de constituer des corps de fonctionnaires spécifiques.
A la veille de la réforme, les effectifs du ministère de la coopération comprenaient quelque mille personnels : 250 contractuels, 250 détachés d'autres administrations, 500 fonctionnaires titulaires.
• Les fonctionnaires titulaires
Les administrateurs civils de la coopération ont été intégrés, dans le cadre des dispositions du décret n° 99-1153 du 29 décembre 1999, dans le corps des conseillers des affaires étrangères à compter du 1er janvier 2000.
Les attachés d'administration centrale ont été intégrés au 1er janvier 2000 dans le nouveau corps unique des secrétaires des affaires étrangères regroupant les secrétaires adjoints des affaires étrangères et les attachés d'administration centrale.
Les agents de catégories B et C ont été intégrés dans les catégories analogues de l'administration centrale du quai d'Orsay.
La réforme, dans ses aspects statutaires, ne doit pas emporter en principe de conséquences négatives sur la rémunération indiciaire et la carrière
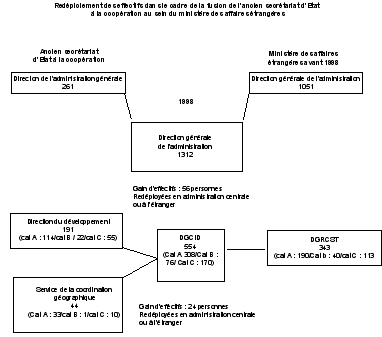
des agents de la coopération dans la mesure où les corps homologues ou spécifiques qu'ils ont intégrés présentent une grille indiciaire et un déroulement de carrière identique à ceux de leur corps d'origine.
La fusion des corps s'est traduite, d'une part, au sein de l'administration centrale, par l'alignement du régime indemnitaire des agents des affaires étrangères sur celui, plus avantageux, des personnels de la coopération et, d'autre part, à l'étranger, par l'application aux personnels des services de coopération et d'action culturelle du barème des indemnités de résidence du réseau diplomatique et consulaire.
• Les personnels détachés
A la suite de la fusion des administrations, les personnels détachés ont été rémunérés sur des postes de contractuels du ministère des affaires étrangères. Cette situation ne leur permet pas de faire valoir leur droit à intégration dans les corps du Quai d'Orsay au terme de leur détachement comme ils le pourraient s'ils avaient été placés sur des postes de titulaires.
• Les personnels contractuels
Les contractuels à durée indéterminée de l'ancien ministère de la coopération recrutés avant juin 1993 sont régis par un arrêté de 1992 qui leur assure un déroulement de carrière plus souple et généralement plus rapide que celui dont bénéficient les contractuels du quai d'Orsay (principalement affectés au sein de l'ancienne DGCRST), placés quant à eux sous le régime d'un décret de 1969.
Le principe de la titularisation des contractuels avait été posé par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (dite loi « Le Pors »). Il ne s'est concrétisé qu'en 1999 : 54 contractuels de la coopération (sur un effectif de 110 bénéficiaires potentiels) se sont présentés à l'examen professionnel ; 11 n'ont pas été reçus.
Sur les 43 autres, 31 ont accepté leur titularisation ; 12 l'ont refusée faute de propositions en rapport avec les compétences et l'expérience des intéressés.
Le nombre de contractuels du Quai d'Orsay intéressés par les dispositions de la loi Le Pors s'élevait à 220 ; 110 se sont présentés aux examens ; 17 ont échoué ; parmi les admis, 54 seulement ont finalement opté pour la titularisation.
A l'instar des attachés d'administration centrale de la coopération, les agents contractuels de niveau A titularisés en 1999 ont été intégrés au 1er janvier 2000 dans le nouveau corps unique des secrétaires des affaires étrangères.
Aujourd'hui, le ministère des affaires étrangères compte encore quatre catégories d'emplois pour lesquels les perspectives de carrière, et donc le niveau de rémunération malgré des qualifications souvent comparables, diffèrent notablement de la situation faite aux titulaires :
- les personnels sous contrat à durée indéterminée , en poste avant le 11 juin 1983, qui ont renoncé aux dispositions de la loi Le Pors. Ils souhaitent aujourd'hui conserver le bénéfice des dispositions de l'arrêté ministériel de 1992 ;
- les contractuels recrutés sur la base d'un contrat à durée déterminée avant le 11 juin 1983 ayant exercé des missions de service public dans le cadre d'organisations périphériques du ministère de la coopération ou du Quai d'Orsay ; les dispositions de la loi Le Pors ne leur étaient pas applicables ; ils ont reçu l'engagement de l'administration du ministère des affaires étrangères de leur accorder le renouvellement automatique de leur contrat jusqu'à leur retraite ;
- les contractuels recrutés depuis 1983 jusqu'en juin 2000 sur la base d'un contrat à durée déterminée ; aux termes des dispositions de la loi Sapin, ils pourront être titularisés dans un délai de cinq ans à compter de leur prise de fonction au sein du ministère ;
- les fonctionnaires détachés dont les perspectives d'intégration dans les cadres du quai d'Orsay paraissent faibles.
2. L'alignement des missions de coopération sur le modèle commun des services d'une ambassade
Les 31 missions de coopération et d'action culturelle de l'ancien secrétariat d'Etat ont été supprimées le 1 er janvier 1999 (décret n° 18-1238 du 21 décembre 1998) et transformées en services de coopération et d'action culturelle (SCAC) au sein des ambassades.
Les anciens chefs de mission, précédemment nommés par décret du Président de la République, sont devenus conseillers de coopération et d'action culturelle désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2000, les personnels en poste dans les SCAC, à l'instar des autres personnels titulaires issus du cadre du ministère de la coopération ont été intégrés dans les corps du ministère des affaires étrangères.
Si, jusqu'en 1999, période de transition, les conseillers de coopération disposaient de dotations spécifiques et conservaient la qualité d'ordonnateur secondaire, ils sont désormais, depuis 2000, ordonnateurs délégués de l'ambassadeur, institué quant à lui ordonnateur secondaire.
Cette évolution s'accompagne de la mise en place, depuis le 1 er janvier 2000, d'un service administratif et financier unique chargé de coordonner la gestion des crédits du ministère. Au chapitre des moyens matériels, il convient également de relever :
- la suppression des quotes-parts existantes pour des consommations en commun (énergie électrique, communications...) ;
- le regroupement du parc automobile ;
- le regroupement du parc immobilier avec l'instauration d'une commission du logement sous l'autorité de l'ambassadeur pour les affectations au départ d'un agent logé dans un immeuble appartenant à l'Etat français.
3. Un dispositif maintenu autour de trois grands pôles
Les attributions des autres acteurs institutionnels de la coopération n'ont pas été remises en cause. Elles ont même été élargies pour la Caisse française de développement devenue Agence française de développement (AFD).
Dès lors, le dispositif institutionnel s'articule comme par le passé autour de trois grands pôles :
- le ministère des affaires étrangères chargé de la définition des grandes orientations de la politique de développement et de la gestion directe des opérations relevant des secteurs institutionnels et sociaux -à l'exception des infrastructures- (par la voie notamment du Fonds de solidarité prioritaire et de l'assistance technique rattachés l'un et l'autre au Quai d'Orsay), ainsi que des actions de développement culturel (dont l'audiovisuel extérieur), scientifique et technique ;
- le ministère des finances responsable des relations avec les autres grands bailleurs de fonds multilatéraux, de la gestion des protocoles financiers liés à un projet de développement ainsi que de la remise de la dette ;
- l' Agence française de développement , considérée comme l'opérateur pivot de l'aide-projet ; l'autonomie qui lui garantit son statut d'établissement public lui confère une plus grande souplesse que l'administration : elle continuera de mener pour le compte de l'Etat, et à la demande des autorités de tutelle, des opérations sur dons et prêts dans les secteurs du développement économique, de l'environnement et du soutien au secteur privé. Ses activités couvrent l'ensemble des infrastructures, y compris celles touchant les secteurs de l'éducation et de la santé, jusqu'alors réservés au secrétariat d'Etat à la coopération.
Demeure par ailleurs la multiplicité des autres institutions affectées à des titres très divers à intervenir dans le domaine de la coopération.
C. UNE RÉORGANISATION INACHEVÉE
La principale transformation introduite par la réforme doit donc être appréciée à sa juste mesure : il s'agit moins d'une simplification des structures que d'une substitution du ministère des affaires étrangères au secrétariat d'Etat à la coopération pour la partie de l'aide au développement dont la charge incombait à cette administration.
Cette nouvelle organisation permet-elle mieux que la précédente d'assurer une action efficace en faveur du développement ? La réponse apparaît nécessairement nuancée. Elle dépend de trois facteurs clefs : l'organisation de la DGCID, le « métissage » des cultures lié à la diplomatie et au développement, l'articulation des responsabilités respectives du ministère des affaires étrangères et des autres institutions responsables de la coopération.
1. La DGCID, instrument de nouvelles « synergies » ou « usine à gaz » ?
De la lutte contre le sida au Kenya à la promotion de l'audiovisuel français aux Etats-Unis, la DGCID embrasse un ensemble d'activités d'une extraordinaire diversité. L'étendue des attributions de cette nouvelle direction peut donner le vertige et vos rapporteurs ne jureraient pas que les responsables de cette administration n'éprouvent pas parfois ce sentiment.
Lors de son audition devant votre commission, M. Bruno Delaye, placé à la tête de la DGCID depuis août 2000, a rappelé les raisons qui plaident pour la réunion des instruments diplomatiques et d'aide au développement ; l'aide publique, a-t-il souligné, est vouée à l'inefficacité si les mesures de régulation à l'échelle internationale ne sont pas mises en oeuvre. A titre d'exemple, appuyer financièrement certains pays d'Afrique subsaharienne sans adopter parallèlement un dispositif international efficace contre le trafic des armes ne revient-il pas à « construire des châteaux de sable » ? L'efficacité de la coopération française dépend ainsi, dans une large mesure, de la capacité de notre pays à rallier la communauté internationale à la défense d'une mondialisation ordonnée, soucieuse des intérêts des pays du sud.
Pour donner tout l'impact nécessaire à notre aide, il nous faut donc d'abord gagner la « bataille des valeurs » auprès des Etats mais aussi des populations, selon les termes du directeur général. Or quel meilleur instrument pour cette stratégie d'influence que notre diplomatie culturelle ? Tel serait l'argument fondamental de l'intégration réalisée par la DGCID de la coopération culturelle et des métiers du développement. L'argument ne convainc pas entièrement car si la capacité pour la France de peser sur les positions des institutions multilatérales détermine pour une large part l'efficacité de sa politique de développement, l'effort de coordination souhaitable entre action culturelle et politique de développement n'implique pas nécessairement l'intégration de l'une à l'autre.
Par l'étendue de son champ d'attribution, l'importance de ses effectifs, la diversité des directions et services qu'elle réunit, la DGCID apparaît en fait comme une structure très lourde.
L'organigramme initial de la DGCID superposait aux quatre directions sectorielles (coopération culturelle, développement, coopération scientifique, audiovisuel extérieur) une direction à vocation horizontale , chargée de la stratégie, de la programmation et de l'évaluation . Cette structure constituait l'innovation emblématique de la réforme : elle apparaissait comme le creuset de la fusion des cultures de la diplomatie et du développement. Les missions avaient été définies de manière ambitieuse ; lui incombaient en effet « les fonctions de coordination et d'organisation de la concertation, de mise en évidence des contradictions et des conflits (...), la fonction d'arbitrage ou plus souvent de préparation d'arbitrages... Aucune des directions et sous-directions sectorielles ou des missions de la DGCID ne peut seule décider de sa politique, de ses modes opératoires, du déploiement de ses budgets et de ses programmes, de l'exécution de ses projets ».
En janvier 2000, un document établi par le Gouvernement à l'attention du Parlement dressait un bilan plutôt flatteur du rôle joué par la direction de la stratégie de la programmation et de l'évaluation, « principal creuset de fusion des traditions et des personnels hérités des deux anciennes structures, a pleinement joué son rôle de pilotage et de gestion au service de l'ensemble de la structure » 3 ( * ) .
Sept mois plus tard, pourtant, cette direction était supprimée. Ses compétences ont été réparties autour de trois pôles :
- le pôle de la stratégie et de l'évaluation ;
- le pôle de programmation des moyens du réseau et du contrôle de gestion ;
- le pôle de coordination géographique.
Ces ajustements inhérents sans doute à toute réorganisation traduisent cependant une difficulté de fond : l'étendue et surtout la diversité des tâches requièrent une instance de coordination ; parallèlement, cette structure introduit un nouvel échelon dans le processus de décision et la chaîne hiérarchique ; elle entraîne de nombreux délais à rebours de l'objectif d'efficacité mis en avant par la réforme. Si des modifications apparaissaient inévitables, pendant une période transitoire et même au-delà, elles ont porté ici sur l'instrument le plus marquant de la volonté exprimée par cette réforme.
2. « Métissage des métiers » ou effacement des coopérants au profit des diplomates ?
La fusion des logiques diplomatiques et de développement dépend moins d'un organigramme, si ingénieux soit-il, que du rapprochement et des échanges entre des hommes et des femmes dont les métiers, les cultures administratives appartiennent à l'origine à des univers très différents.
Quel bilan peut-on dresser à cet égard du regroupement des personnels des affaires étrangères et de la coopération dans les services centraux mais aussi les postes à l'étranger ?
A cette question, diplomates et coopérants n'apportent pas la même réponse. Tel est le premier constat qui s'impose à l'issue des nombreuses auditions auxquelles vos rapporteurs ont procédé Pour le directeur général de la coopération internationale et du développement, la fusion des carrières et des cultures est une réalité ; « on a appris les uns des autres » : selon l'un des responsables de la DGCID, la culture et le savoir-faire gestionnaire des coopérants ont été mis à profit par la coopération culturelle tandis qu'en contrepartie, l'expérience propre aux diplomates d'une action fine, à même de jouer les effets de levier, a bénéficié aux actions de développement.
Le sentiment exprimé par les personnels de la coopération entendus par votre mission présente une tonalité très différente : il relève parfois du « syndrome d'absorption » d'une administration légère par un ministère aux effectifs beaucoup plus importants.
L'élaboration d'un « projet de la DGCID », au terme d'un travail de réflexion commun à l'ensemble des personnels, ne semble pas avoir conjuré ces craintes.
Au-delà de ces échos contrastés, la situation actuelle inspire trois observations :
- les échanges d'expériences demeurent limités ;
- les perspectives de carrière présentent une grande disparité ;
- les moyens de garantir la diversité pourtant nécessaire des compétences ne sont pas réunis.
• Les échanges d'expérience demeurent limités
Les personnels issus de la coopération sont restés dans leur majorité concentrés sur leur matière d'origine. Ils représentent 80 % des effectifs de la direction du développement au sein de la DGCID. Le brassage des cultures a donc revêtu une portée limitée. En outre, conséquence logique des déséquilibres des effectifs des administrations, les diplomates semblent plus nombreux à s'être investis dans les métiers du développement que les « développeurs » dans ceux de la diplomatie. Il est vrai que la proportion des personnels de l'ex-coopération affectés en poste diplomatique et consulaire tend à augmenter comme le montre le tableau suivant :
Comparaison des affectations en postes
diplomatiques
et consulaires et en centrale 2000/2001
|
Service |
2000 |
2001 |
|
postes diplomatiques et consulaires |
56 |
79 |
|
administration centrale |
398 |
475 |
|
dont DGCID |
211 |
197 |
|
dont DGA |
156 |
150 |
|
dont directions géographiques |
2 |
7 |
|
dont DFAE |
2 |
10 |
Cette évolution reste cependant très timide. Ainsi, parmi les 40 administrateurs civils de l'ex-coopération intégrés en 1999 dans le corps des conseillers des affaires étrangères et des ministres plénipotentiaires, 16 étaient affectés en 2001 dans le réseau diplomatique et consulaire (5 ambassadeurs -Bosnie, Kenya, Ouganda, Lettonie, Djibouti- 3 consuls généraux -Marrakech, Beyrouth et Stuttgart- 8 conseillers d'ambassade), 5 dans le réseau culturel (qui compte 93 agents diplomatiques...). Si l'on considère les pays d'affectation, la portée du croisement des cultures apparaît cependant encore plus modeste : depuis 1999, 20 agents de l'ex-coopération ont été affectés dans les pays de l'ex-hors champ tandis que 10 agents des affaires étrangères l'ont été dans les pays de l'ex-champ.
La répartition détaillée des personnels de l'ex-coopération au sein du ministère des affaires étrangères en 2001 montre les limites du brassage recherché.
Répartition détaillée par catégorie au 7 juin 2001
|
Service |
Cat A |
CAT B |
CAT C |
|
étranger |
77 |
23 |
189 |
|
dont SCAC |
55 |
19 |
136 |
|
dont réseau diplomatique et consulaire |
22 |
4 |
53 |
|
Administration centrale |
161 |
96 |
218 |
|
dont DGCID |
93 |
35 |
69 |
|
dont DGA |
36 |
36 |
78 |
|
dont dir. géographiques |
6 |
0 |
1 |
|
dont DFAE |
1 |
2 |
7 |
|
dont DCI |
2 |
4 |
3 |
|
dont Protocole |
1 |
1 |
1 |
|
dont Directions des affaires juridiques |
1 |
0 |
0 |
|
dont Direction des archives |
0 |
2 |
1 |
|
dont Service de l'action humanitaire |
1 |
1 |
0 |
|
dont cabinet du ministre délégué à la coopération et à la francophonie |
0 |
2 |
20 |
Au-delà de ces aspects quantitatifs, les perspectives de carrière ne se présentent pas de la même manière pour les personnels selon leurs ministères d' origine.
• Des perspectives de carrière différentes
A la différence des diplomates de carrière, les personnels issus des ministères de la coopération n'auront sans doute qu'une possibilité réduite de poursuivre leur carrière hors de la DGCID, voire hors de certains services spécialisés au sein même de la direction générale. Cette situation est liée d'abord à la grande spécificité des formations des personnels de la coopération, mais aussi à la diversité de leurs statuts. A cet égard, la situation des contractuels constitue un motif particulier de préoccupation.
Du reste, l'image d'une certaine spécialisation s'attache aussi aux diplomates de la DGCID, rendant parfois difficile une mobilité dans d'autres services du Quai.
A cet égard, la réforme n'a pas mis fin aux cloisonnements traditionnels au sein même du ministère des affaires étrangères.
Ces rigidités ne sauraient vraiment surprendre : les métiers du développement présentent une réelle spécificité et ne s'assimilent pas facilement aux tâches du diplomate.
• Une diversité menacée à terme
Les règles statutaires du ministère des affaires étrangères ne permettront sans doute pas d'assurer les recrutements à même de satisfaire la diversité des missions dont la DGCID la charge : elles rendent difficile le détachement de fonctionnaires issus d'autres ministères, et presque impossible l'emploi de personnes venues du secteur privé. D'ores et déjà, la direction générale se débat avec ces difficultés. Ainsi, malgré les enjeux soulevés par la lutte contre le sida et la priorité qu'y attache la France, elle ne compte qu'un spécialiste reconnu dans ce domaine. Par ailleurs, certains parmi les représentants syndicaux entendus par votre délégation ont manifesté la crainte que la fusion des statuts, mise en oeuvre dans le cadre d'une logique administrative, ne permette plus de reconnaître la diversité des métiers.
La diversité des compétences dont la DGCID a hérité de la coopération risque ainsi de se tarir avec le temps . Dès lors, le principe même de métissage aura vécu. Notre politique de coopération n'aurait pourtant rien à gagner de l'uniformisation des formations et des expériences. S'agissant des détachements, le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères a rappelé la position traditionnelle du ministère : le quai d'Orsay reçoit les agents à mobilité statutaire ou ceux qui cherchent un détachement ; la présence de personnels venus d'autres administrations doit cependant s'inscrire dans un cadre temporel délimité ; en contrepartie, certains agents du ministère des affaires étrangères peuvent être détachés à l'extérieur. L'intégration des personnels détachés risquerait de figer ces mouvements croisés.
Aujourd'hui le quai d'Orsay emploie quelque 160 agents détachés d'autres ministères et compte 130 agents en position de détachement dans d'autres administrations. Parallèlement, le directeur général de l'administration a rappelé à vos rapporteurs que, conformément aux règles de la fonction publique, le recrutement de contractuels devait revêtir un caractère exceptionnel. Il a toutefois relevé sur ce point certaines évolutions dans le sens d'un assouplissement, afin notamment de renforcer la concertation avec les services concernés du ministère. Ainsi, une commission de recrutement associant la Direction générale de l'administration (DGA) et la DGCID devrait élaborer un document comparable à un « appel d'offre » prévoyant en particulier une rémunération adaptée sur la base des indices de la fonction publique.
3. Meilleure coordination des acteurs ou rapports de force inchangés ?
La réforme de la coopération visait à assurer une meilleure coordination des intervenants publics impliqués dans l'aide au développement. Un tel objectif suppose entre les différents acteurs un certain équilibre qui les invite à se concerter plutôt qu'à agir isolément. Or dans le système institutionnel antérieur à la réforme, Bercy bénéficierait de par les moyens financiers dont il disposait d'une réelle prépondérance. Ainsi, en 1998, le ministère de l'économie et des finances mettait en oeuvre 43 % de l'aide publique au développement (budget du ministère , charges communes et AFD) contre 22 % pour le ministère des affaires étrangères. Au regard de la répartition des responsabilités, retenue par les autres grands bailleurs de fonds, il y a bien là une exception française.
Poids respectif dans la gestion de l'AFD
Comparaison
dans les pays de l'OCDE-Année 1997
|
France |
Canada |
Allemagne |
Suède |
Royaume-Uni |
Etats-Unis |
Belgique |
|
|
MAE-COOP |
20 % |
80 %
|
80 % |
100 %
|
100 %
|
100 %
|
65 %
|
|
Finances |
55 % |
20 % |
15 % |
- |
- |
- |
22 % |
|
Autres |
25 % |
- |
5 % |
- |
- |
- |
13 % |
Données de 1997. Source : OCDE-CAD
En unifiant le pôle diplomatique, le nouveau dispositif a cherché à lui conférer un plus grand poids vis à vis du ministère des finances.
Qu'en est-il réellement ? A l'appui d'une coordination améliorée, les interlocuteurs de vos rapporteurs ont cité plusieurs exemples : d'abord -et il en sera question plus loin- le secrétariat du Comité interministériel pour la coopération internationale et le développement (CICID) est assuré conjointement par le Quai d'Orsay et le ministère des finances. Par ailleurs, les notes stratégiques qui précèdent la programmation de l'aide par pays ont été élaborées en commun entre la DGCID et la direction du Trésor. L'un des responsables de la DGCID a souligné qu'à l'occasion de cet exercice, chacune des deux parties avait mieux pu prendre la mesure de la complémentarité de leur approche. Ce dialogue, a-t-il ajouté, pouvait préluder à la définition d'instruments d'analyse et de réflexion communs. D'autre part, l'avenir de l'assistance technique a également fait l'objet d'un travail interministériel.
Un véritable rééquilibrage doit cependant procéder d'une évolution dans la répartition des dotations budgétaires. A cet égard, les tendances observées par le passé s'infléchissent lentement mais dans un sens positif.
Les crédits du budget des affaires étrangères en 2000 (9 milliards de francs) dépassent désormais ceux inscrits au budget du ministère de l'économie et des finances (8,3 milliards de francs). Une part cependant des crédits du Quai d'Orsay est déléguée à l'AFD sur laquelle la tutelle de Bercy apparaît au moins aussi forte que celle des affaires étrangères.
Sur le terrain, la coordination a-t-elle progressé ? La multiplicité des intervenants -ambassade, mission de la coopération, agence française de développement- a, par le passé, pu favoriser certaines luttes d'influence. L'intégration des missions au sein des ambassades a permis de mieux asseoir l'autorité de l'ambassadeur. Le processus, s'il n'a pas toujours été conduit dans une complète sérénité (il a pu susciter certaine amertume parmi les agents des missions- nivellement des moyens matériels, du parc automobile...) apparaît aujourd'hui, sous réserve de certains ajustements, achevé.
En revanche, l'articulation des rôles respectifs de l'AFD, d'une part, et de l'ambassade, et notamment du service de coopération et d'action culturelle, d'autre part, demeure un facteur de complexité.
D. POUR UNE GRANDE AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
A la lumière de l'expérience, il ne semble pas que, même si elles sont complémentaires, les fonctions liées à la diplomatie et au développement soient interchangeables. D'une part, les métiers du développement présentent un caractère à la fois très divers et très technique. D'autre part, les structures administratives classiques, encadrées dans les règles strictes de la fonction publique, ne paraissent pas les mieux adaptées pour mettre en oeuvre l'aide au développement. Cette double exigence - spécificité et souplesse - semble impliquer de réunir l'ensemble des missions liées au développement au sein d'une agence- établissement placé sous tutelle ministérielle mais doté d'une réelle autonomie de fonctionnement. Cette formule a été retenue, avec une efficacité variable selon l'organisation choisie, par les grands bailleurs de fonds. Conduite à son terme, la logique de la réforme de la coopération aurait dû aboutir à transférer à l'Agence française de développement l'ensemble des missions liées au développement.
1. L'Agence, modèle de référence pour les grands bailleurs de fonds
Le principe d'une (ou de plusieurs) agence(s) en charge de la mise en oeuvre de l'aide au développement apparaît aujourd'hui comme le modèle dominant parmi les principaux bailleurs de fonds, même si ce schéma se décline différemment d'un pays à l'autre en fonction notamment du mode d'articulation entre cette structure et l'autorité politique.
Aux Etats-Unis , les opérations bilatérales en faveur du développement relèvent de l'agence USAID .
Celle-ci agit pour le compte du Département d'Etat, chargé de la politique de coopération bilatérale ainsi que des participations aux programmes des Nations unies. Elle bénéficie de règles propres pour son budget et son personnel. Son action s'est toutefois trouvée entravée par la lutte d'influence à laquelle s'est livré le Département d'Etat pour renforcer son contrôle sur l'agence. La nouvelle administration Bush s'est fixée une triple priorité dans le domaine du développement : la lutte contre le sida ; l'ouverture du marché américain aux exportations africaines à travers la mise en oeuvre de la « loi sur le commerce et les opportunités en Afrique » ; la gestion des conflits.
Au Japon , l'aide est éclatée entre plusieurs opérateurs. L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) met en oeuvre les subventions dont est doté le ministère des affaires étrangères.
Par ailleurs, les prêts étaient gérés par deux organismes distincts placés sous la tutelle du ministère des finances (le Fonds japonais de coopération économique extérieure pour les prêts aidés, la Banque japonaise pour le financement des importations et des exportations pour les crédits de droit commun) désormais réunis en une structure unique. La nouvelle entité capable de porter quelque 12 milliards de dollars par an semble disposer d'une certaine latitude vis à vis de la direction du Trésor qui ne bénéficie pas en la matière d'une véritable capacité d'expertise technique. Le système japonais, partagé entre de nombreux intervenants, connaît encore malgré les réformes récentes certaines difficultés de coordination.
La Belgique a mis en oeuvre en 1999 une réforme de son dispositif de coopération. Les missions liées au développement ont été dissociées autour de trois grandes fonctions confiées chacune à un service distinct :
- la conception et l'élaboration des programmes ont été dévolus à une nouvelle direction générale du ministère des affaires étrangères ;
- l'évaluation (contrôle préalable et a posteriori) incombe à un service directement rattaché au secrétaire général de ce ministère, et tenu de faire rapport au Parlement ;
- l'exécution des opérations a été confiée à un nouvel acteur : la coopération technique belge , sorte d'établissement autonome de droit public chargé de gérer en propre des programmes d'un montant total de quelque 1 milliard de francs (soit le quart des dotations annuelles consacrées à la coopération internationale) réparti sur 33 pays.
En Allemagne , l'aide relève principalement du ministère de la coopération économique et du développement (70 % des subventions) et, d'une manière plus marginale, des ministères de l'éducation, des sciences, de la recherche et de la technologie.
En pratique, les fonds sont mis en oeuvre par deux agences para-étatiques : GTZ (Deutsche Gesellschaft für technische zuzammenarbeit) pour la coopération technique en faveur des pays en développement, KFW (Kredtitanstalt für wiederaufbau) pour toutes les infrastructures... y compris sur le territoire allemand. Ce dernier établissement se trouve placé sous la tutelle exclusive du ministère des finances. Cette situation reste une source de frictions dans l'organisation de l'aide au développement.
Le Royaume-Uni , quant à lui, a privilégié en 1997 une orientation opposée à celle retenue par la réforme française puisqu'il a choisi de détacher le développement du Foreign Office pour en faire un ministère de plein exercice.
Le DFID (Département pour le développement international) placé sous l'autorité d'un ministre du développement international gère directement la coopération technique et financière (499 millions de livres sterling en 2000 pour l'Afrique subsaharienne). Bien que présentant le caractère d'un ministère, il dispose d'une autonomie complète en matière de recrutement. La gestion des ressources repose sur une programmation « glissante » à trois ans d'objectifs évaluables rendus publics dans un rapport d'activité adressé au Parlement (ce document est complété par une quarantaine de documents stratégie-pays également établis sur une période de trois ans).
L'évaluation fait l'objet d'un effort particulier. Ainsi, une structure privée de mutualisation des compétences et des connaissances en matière d'évaluation est destinée à réunir des personnels du DFID mais aussi des collaborateurs issus de la société civile afin de jouer le rôle d'un groupement de consultants.
Par ailleurs, le DFID est associé à l'Institut du développement d'outre-mer (Overseas development institute - un « think tank » dans le langage anglo-saxon) qui associe une cinquantaine de chercheurs chargés d'effectuer des études à même d'éclairer un choix politique et administratif en matière de développement.
L'efficacité du nouveau dispositif, son dynamisme en termes de production d'idées confère aujourd'hui au Royaume-Uni un rôle éminent parmi les autres bailleurs de fonds.
2. La mise en place d'une grande agence de développement, aboutissement logique de la réforme de la coopération.
L'intérêt d'une grande agence n'avait évidemment pu échapper aux inspirateurs de la réforme de la coopération : l'agence française de développement, érigée en opérateur pivot de l'aide au développement, s'étant vu confier de nouvelles responsabilités en matière d'infrastructures sanitaires et éducatives. Force cependant est de constater qu'en retenant au sein du ministère des affaires étrangères un important pôle consacré au développement, la logique de la réforme n'a pas été menée à son terme. Tant la cohérence que l'efficacité des dispositifs apparaissent aujourd'hui incertains. Cohérence d'abord : n'est-il pas plus conséquent de confier à l'organisme chargé de concevoir les infrastructures en matière de santé, la mise en oeuvre des différentes politiques d'aide dans ce secteur plutôt que d'en laisser la responsabilité à un organisme -la DGCID- chargé tout à la fois de la lutte contre le sida et de la défense de la francophonie. Efficacité, ensuite. Une agence de développement dispose de la souplesse nécessaire pour faire appel à la variété des compétences requises dans le domaine du développement.
La réorganisation du dispositif institutionnel devrait également permettre de restaurer la cohérence de notre action sur le terrain. La situation présente n'est en effet guère satisfaisante. Certes, depuis la réforme, la procédure de mise en oeuvre des projets de l'Agence requiert l'avis de l'ambassadeur aux trois étapes -identification, examen devant le conseil de surveillance, exécution. Il est avéré cependant que l'Agence conduit ses projets d'une manière autonome, l'avis de l'ambassadeur apparaissant à bien des égards théorique. En effet, l'organisation de l'AFD reste peu déconcentrée et le choix des projets appartient en fait au siège parisien. Dans ces conditions, le manque d'articulation entre les projets de l'AFD et ceux conduits par la coopération ne saurait étonner. Il se traduit par des redondances ou, au contraire, des lacunes dans notre action. Ces discordances peuvent produire des effets paradoxaux. A titre d'exemple, à Madagascar, le SCAC a souhaité mettre en oeuvre un projet d'appui aux collectivités locales ; il s'est alors tourné vers l'AFD pour obtenir un soutien aux infrastructures de base. En vain toutefois car l'Agence ne prête pas aux collectivités territoriales. En conséquence, la coopération française a choisi de travailler, sur ce projet, avec la Banque mondiale... La mise en place d'un bloc de compétences unique pourrait permettre de surmonter ces difficultés.
Comment s'organiserait dès lors la répartition des attributions entre l'Agence et le Quai d'Orsay ? Les compétences actuelles de l'AFD pourraient être étendues à la mise en oeuvre des projets dont deux sous-directions de la DGCID sont actuellement en charge : la sous-direction du développement économique et de l'environnement et la sous-direction du développement social et de la coopération éducative.
La DGCID conserverait les attributions classiques de la diplomatie culturelle ainsi que le volet régalien de la coopération (appui à la construction de l'Etat de droit). Surtout, elle pourrait se recentrer sur ses missions fondamentales d'élaboration des grandes orientations de la politique de coopération française et d'influence au sein des instances internationales intéressées par le développement. Dégagée de toute fonction d'exécution, elle consacrerait en effet le temps nécessaire à la préparation des réunions internationales relatives à l'aide au développement, afin de mieux défendre les positions françaises.
Par ailleurs, il reviendra aux services de la DGCID de fixer le cadrage des priorités géographiques et sectorielles de l'aide.
Cette clarification des rôles respectifs du Ministère des affaires étrangères et de l'Agence française de développement suppose que deux conditions soient satisfaites. D'une part, il est indispensable d'établir des passerelles entre l'AFD et le Quai, afin que les fonctions de conception puissent être nourries en permanence par les leçons de l'expérience. Une pratique constante d'échanges de personnels pour des périodes déterminées doit ainsi s'instaurer. D'autre part, il est essentiel que la tutelle du Ministère des affaires étrangères sur l'AFD soit renforcée.
Le principe de crédits délégués par les affaires étrangères à l'AFD conserve toute sa pertinence. Mais la tutelle doit aussi et surtout recevoir une traduction concrète sur le terrain. Ainsi la note de prise en considération, point de départ de l'instruction d'un dossier, devrait être signée par l'Ambassadeur. Ce document pourrait alors déclencher une mission d'évaluation dont le rapport recevrait l'aval de la double tutelle -Quai d'Orsay, Bercy- avant d'être présenté au conseil de surveillance de l'Agence. L'ambassadeur doit ainsi conserver un rôle de pilotage et recevoir des instructions claires pour orienter son action.
Le regroupement des fonctions de mise en oeuvre de l'aide au sein de l'AFD requiert aussi une adaptation importante des structures et de l'organisation de l'Agence dans trois directions principales : une distinction plus claire des activités de banquier et d'opérateur (agissant sur des critères définis par le maître d'ouvrage) ; un effort de déconcentration du processus de décision ; une véritable intégration de la culture et des personnels d'une assistance technique modernisée.
La réforme ne pourra être accomplie sans un volontarisme politique fort à même de surmonter les rigidités et les corporatismes qui demeurent aujourd'hui au sein des structures chargées du développement.
II. QUELLES PRIORITES POUR L'AIDE AU DEVELOPPEMENT
La réforme de la coopération n'avait naturellement pas pour seul objet la modification du dispositif institutionnel. La restructuration de l'appareil administratif n'est que l'un des instruments d'un dessein plus ambitieux : la rénovation de notre politique d'aide au développement. Depuis plusieurs décennies, en effet, l'efficacité des politiques d'aide suscite le scepticisme. Le débat est d'ailleurs loin de ne concerner que notre pays : il touche tous les grands bailleurs. Les constats dressés annuellement par la Banque mondiale font état d'une dégradation des conditions de vie dans beaucoup de pays en développement, singulièrement en Afrique. Ces évolutions préoccupantes ne sauraient faire l'objet d'explications réductrices ; elles trouvent leur origine dans de nombreux facteurs dont il est parfois malaisé de départager le rôle respectif. Force cependant est d'observer que les politiques de développement n'ont pas répondu aux objectifs qui leur avaient été assignés.
La réforme décidée en 1999 ne s'est pas appuyée sur une analyse approfondie et détaillée des lacunes et faiblesses de la coopération française qui aurait permis d'étayer les moyens d'une politique plus efficace. Du moins, a-t-elle recherché, comme le plaidaient de manière récurrente de nombreux parlementaires, une plus grande sélectivité qui constitue sans doute la meilleure façon de renforcer l'impact de nos interventions tout en permettant de mieux évaluer leur intérêt et leurs limites.
A cet égard, quatre grandes orientations se dégagent : la définition des priorités définies par une enceinte à caractère interministériel -le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID)- ; elle s'inscrit dans un cadre géographique : la zone de solidarité prioritaire ; elle requiert pour chaque pays l'élaboration d'objectifs précis, sur la base d'un exercice de programmation concerté avec les bénéficiaires ; enfin, la pertinence des priorités retenues et des conditions de mise en oeuvre suppose une évaluation rigoureuse.
Vos rapporteurs se sont d'abord interrogés sur les dispositions destinées à concrétiser ces quatre grands principes avant de chercher à en mesurer la prise en compte sur le terrain. Leur choix s'est porté sur Madagascar, partenaire traditionnel de la France et l'un des principaux bénéficiaires de notre aide au développement et sur le Kenya, pays anglophone, considéré jusqu'alors comme extérieur au champ de coopération français et désormais intégré à la zone de solidarité prioritaire.
A. LA DIFFICILE DÉFINITION DE VÉRITABLES PRIORITÉS GÉOGRAPHIQUES ET SECTORIELLES
Des quatre grands axes retenus pour favoriser une politique d'aide plus efficace -le CICID, la zone de solidarité prioritaire, l'exercice de programmation, le renforcement de l'évaluation-, les deux premiers ont montré de réelles limites tandis que les deux derniers se sont traduits par des mesures novatrices et intéressantes quoique encore incomplètes.
1. Une politique de développement encore en quête d'une impulsion commune
Le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement a été créé par décret du 4 janvier 1998. Il s'est substitué à une autre instance interministérielle, le Comité interministériel d'aide au développement institué par le Gouvernement précédent et dont les résultats s'étaient avérés décevants.
La nouvelle structure réunit sous la présidence du Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de la coopération ainsi que tous les ministres impliqués à un titre ou à un autre dans les actions de coopération (intérieur -pour ce qui concerne principalement les questions migratoires- défense, environnement, budget, outre-mer...). Le Comité interministériel s'est vu assigner quatre missions : la détermination de la Zone de solidarité prioritaire, la définition des grandes orientations en matière de coopération, la cohérence des priorités géographiques et sectorielles de l'aide au développement sur la base d'une programmation globale annuelle, la conformité des politiques conduites aux objectifs arrêtés.
Le CICID se réunit une fois par an. Deux comités se sont tenus jusqu'à présent, le premier, le 28 janvier 1999, a arrêté la composition de la ZSP. Le second, le 22 juin 2000 a retenu trois orientations principales : le maintien de la configuration de la ZSP, la garantie que l'effort particulier consenti par la France pour l'annulation de la dette n'aura pas pour contrepartie une baisse des autres types de financement d'aide ; la relance de notre coopération en faveur du Maghreb.
Compte tenu de la diversité des acteurs de l'aide au développement, la nécessité d'une organisation interministérielle ne fait aucun doute. Cependant, le CICID rencontre de réelles difficultés à se présenter comme une véritable instance d'impulsion . Les comptes rendus de ses réunions ne permettent pas de mettre réellement en lumière les choix prioritaires de la coopération française. Faut-il mettre en cause des réunions épisodiques irrégulières ou une composition trop lourde ? La bonne formule reste à trouver.
2. Les faux-semblants de la sélectivité géographique
Lors de sa réunion du 28 janvier 1999, le CICID a défini le contenu de la Zone de solidarité prioritaire en fonction de trois critères :
- en premier lieu, la ZSP réunit les pays les moins développés en termes de revenu et qui connaissent des difficultés pour accéder au marché de capitaux ;
- ensuite, la solidarité de la France s'exerce plus particulièrement avec les pays d' Afrique en raison des liens tissés par l'histoire, avec les Etats de la zone ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) afin d'assurer une bonne synergie avec l'aide européenne, enfin avec le monde francophone dans son ensemble ;
- enfin, la définition de la ZSP vise également à renforcer la cohérence régionale des actions de développement.
La liste définie en janvier 1999 réunit 61 Etats. Le CICID du 22 juin 2000 a décidé de ne pas réexaminer cette composition avant 2001.
Zone de solidarité prioritaire en 2001
|
Anciens pays du champ |
Extension en 1999 |
|||
|
Bénin |
1978 |
Djibouti |
Liban |
|
|
Burkina-Faso |
1980 |
Guinée Equatoriale |
Palestine |
|
|
Cameroun |
Gambie |
Afrique du Sud |
||
|
Centrafrique |
Sainte-Lucie |
Algérie |
||
|
Congo |
Grenade |
RD Congo |
||
|
Côte d'Ivoire |
1983 |
Dominique |
Erythrée |
|
|
Gabon |
Saint-Vincent |
Ethiopie |
||
|
Madagascar |
St Kittes et Neviez |
Ghana |
||
|
Mali |
1984 |
Guinée Conakry |
Guinée |
|
|
1959 |
Mauritanie |
1985 |
Angola |
Kenya |
|
Niger |
Mozambique |
Liberia |
||
|
Sénégal |
1990 |
Namibie |
Maroc |
|
|
Tchad |
1993 |
Cambodge |
Ouganda |
|
|
Togo |
Sierra Leone |
|||
|
Zaïre |
Tanzanie |
|||
|
1964 |
Rwanda |
Tunisie |
||
|
Burundi |
Zimbabwe |
|||
|
1971 |
Maurice |
Laos |
||
|
1973 |
Haïti |
Vietnam |
||
|
1975 |
Comores |
Cuba |
||
|
Cap Vert |
République dominicaine |
|||
|
1976 |
Guinée Bissau |
Petites Antilles |
||
|
Sao Tomé |
Surinam |
|||
|
Seychelles |
Vanuatu |
|||
Même si l'appartenance à la ZSP ne confère à aucun de ses membres un droit de tirage automatique qui serait attribué selon des clés de répartition prédéterminées, il aurait cependant paru assez logique que l'extension du nombre de pays couverts par notre coopération mobilise un effort financier supplémentaire . Il n'en a rien été. Deux éléments d'appréciation permettent de préciser ce constat :
- d'abord, il convient certes de relever que 27 postes ont été créés au sein du réseau culturel et de coopération, depuis trois ans, dans les pays de la ZSP ; toutefois, ces créations résultent, pour une part, de redéploiements de personnels : 14 postes de catégorie A ou B ont ainsi été supprimés sur la même période dans les pays de l'ancien champ ;
- ensuite, globalement, les moyens financiers consacrés à la ZSP ont tendance à s'éroder au fil des années.
Evolution de l'aide publique française au
développement
dans les pays de la zone de solidarité
prioritaire
|
En millions de FRF |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
APD bilatérale totale |
36 706 |
32 085 |
29 438 |
27 877 |
24 688 |
25 395 |
|
Zone de solidarité prioritaire |
19 241 |
15 155 |
14 198 |
13 880 |
10 979 |
11 214 |
|
Autres zones géographiques |
17 465 |
16 930 |
15 240 |
13 997 |
13 709 |
14 181 |
|
Part de la ZSP dans l'APD bilatérale |
52,4 % |
47,2 % |
48,2 % |
49,8 % |
44,5 % |
44,2 % |
On ne peut donc que constater et regretter la contradiction entre la réduction des ressources financières consacrées au développement et l'augmentation du nombre des bénéficiaires théoriques de notre coopération. Il en résulte un risque accru de dispersion et d'éparpillement de ses actions. L'objectif d'efficacité affiché par la réforme pourrait alors se trouver compromis. En effet, comme l'a d'ailleurs observé l'un des responsables de la DGCID devant vos rapporteurs, l'aide n'a de réel impact qu'au-delà d'un seuil critique , variable, naturellement, d'un pays à l'autre. D'après cet interlocuteur, l'aide française ne dépasse ce seuil que dans une vingtaine de pays . N'eut-il pas été plus sage de prendre acte de cette situation et conserver une forte sélectivité, même s'il doit clairement être affirmé que la liste des pays bénéficiaires de notre coopération n'est en rien intangible et peut varier en fonction des résultats de l'aide et de l'effort des intéressés.
Les conséquences politiques et diplomatiques de ces évolutions ne sauraient par ailleurs être sous-estimées : elles peuvent se traduire par certaines désillusions du côté des pays incorporés dans la ZSP et par le sentiment d'une relation moins privilégiée chez les partenaires traditionnels de la France.
Les choix des auteurs de la réforme apparaissent à cet égard au rebours des orientations retenues par d'autres bailleurs de fonds. Ainsi, les Pays-Bas ont ramené de 83 à 17 le nombre de pays éligibles à l'aide au développement. La Norvège et la Finlande ont également choisi de concentrer leur aide respectivement sur 10 et 12 pays.
3. Un véritable effort de rationalisation de notre coopération par pays.
Si les priorités géographiques de notre politique de coopération n'apparaissent pas clairement, la définition des conditions de mise en oeuvre de notre aide pour chaque pays fait actuellement l'objet d'une méthodologie rénovée au terme de laquelle les priorités de notre action devraient apparaître plus clairement.
C'est l'une des constantes de notre coopération d'avoir privilégié une approche très complète du développement embrassant les différents aspects d'une même question : ainsi, dans le domaine de la santé, assurer le développement des centres de santé communautaire, des hôpitaux, l'approvisionnement en médicaments génériques, la lutte contre le sida, la formation des médecins, le cadre juridique et réglementaire. Comme le relevait une étude de la DGCID sur l'efficacité de l'aide française, au regard de la lutte contre la pauvreté et les inégalités « cette approche est sans doute intellectuellement séduisante et fondée, mais, en période de diminution budgétaire, elle risque fort d'aboutir à une dispersion des efforts et à un saupoudrage, faute de choix explicites, en concertation avec les partenaires nationaux (Etat et « société civile ») et les autres bailleurs de fonds . »
Incontestablement, les responsables de la DGCID ont pris la mesure de ces risques. Afin de mieux mettre en lumière les priorités de notre coopération avec chacun de nos partenaires, une nouvelle méthode est aujourd'hui progressivement mise en place, fondée sur l'élaboration d'un document stratégique pays (DSP). Ce document, selon les termes des instructions adressées aux ambassadeurs, «a vocation à fournir, sous deux angles, celui du diagnostic et celui des orientations pour l'avenir, un cadre de référence pour l'ensemble de notre coopération dans un pays donné, en liaison, le cas échéant, avec les documents stratégiques des organisations multilatérales et de l'Union européenne ». Quatre aspects du document stratégique retiennent plus particulièrement l'attention.
- D'abord le document doit replacer « l'analyse diplomatique et le choix politique » au centre de notre action ; c'est du reste la raison pour laquelle l'ambassadeur joue un rôle essentiel de coordination dans cet exercice et que la rédaction finale du document stratégique relève de sa seule responsabilité.
- Ensuite, malgré le rôle éminent de l'ambassadeur, la préparation du DSP repose sur un véritable travail de concertation entre les acteurs français concernés par le développement ; à cet égard, il constitue l'instrument de l'indispensable coordination ; un premier cercle associera le service de coopération et d'action culturelle, l'Agence française de développement, mais aussi les instituts de recherche, les représentants de la coopération décentralisée et des principales ONG ; un deuxième cercle sera formé des conseillers du commerce extérieur et des représentants d'entreprises ainsi que de la communauté française ; enfin un troisième cercle réunira les représentants des institutions multilatérales ainsi que ceux des pays conduisant des opérations de coopération significatives. Ce dernier point mérite d'être souligné car le document stratégique pays doit aussi permettre une meilleure articulation de notre coopération avec les actions de l'Union européenne et des autres bailleurs de fonds multilatéraux.
- Le document stratégique ne constitue pas seulement un instrument d'analyse ; il s'inscrit dans une perspective opérationnelle . Le document comprend en effet deux parties : la première consacrée à l'analyse des besoins du pays et à l'examen critique des opérations de coopération déjà conduites, la seconde, aux orientations qu'il convient de privilégier sur une durée de trois années. Le document stratégique pays fait l'objet d'un examen par le co-secrétariat du CICID ainsi que par l'AFD ; les observations sont alors transmises aux postes ; le document stratégique est le fruit de cet enrichissement successif ; le document final, validé par l'ambassadeur est alors présenté au CICID sous la forme d'une fiche synthétique mettant en évidence les éventuelles divergences susceptibles de donner lieu à un arbitrage politique.
L'élaboration d'un document stratégique pays a d'abord été conduite à titre expérimental dans six pays pilotes en 2000 (Afrique du sud, Colombie, Laos, Liban, Mauritanie et Roumanie) avant d'être étendue à 16 autres pays (Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Kenya, Madagascar, Mali, Mozambique, Niger, Pologne, République centrafricaine, République du Congo, Sénégal, Tanzanie, Tchad et Vietnam).
Le CICID 2001 pourra ainsi examiner 13 documents stratégiques pour validation (Afrique du sud, Colombie, Kenya, Mauritanie, Madagascar, Cameroun, Laos, Liban, Mali, Mozambique, Sénégal, Tanzanie).
Ce document doit constituer le point de départ du dialogue engagé avec le pays partenaire. Notre pays, sur la base des orientations adoptées en 1998, souhaite en effet désormais mettre en oeuvre sa politique d'aide dans un cadre contractuel . La coopération reposera sur un accord de partenariat et de développement destiné à préciser, dans un cadre pluriannuel, les différents aspects concernés (développement, mais aussi action culturelle, coopération militaire, maîtrise des flux migratoires) et les modalités de mise en oeuvre de nos interventions.
Jusqu'à présent, et avant même l'achèvement des procédures d'élaboration du DSP, cinq accords de ce type ont d'ores et déjà été signés (Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Tchad). On a mieux conscience aujourd'hui qu'une coopération réussie repose sur une véritable implication du pays partenaire . Le principe de la contractualisation va dans ce sens.
De même que la coordination des différents acteurs du développement trouve désormais son expression unique dans le DSP au terme d'un travail de concertation approfondie, de même la mise en place d'un partenariat doit aussi apparaître comme le fruit d'un véritable dialogue. Les commissions mixtes organisées à intervalles parfois très espacés entre la France et les Etats bénéficiaires de l'aide apparaissent à certains égards un exercice excessivement formel. C'est pourquoi il reste à mieux définir les cadres et l'organisation du dialogue. Tel devrait être aujourd'hui l'un des champs de réflexion privilégié de notre politique de coopération.
4. L'indispensable renforcement de l'évaluation
L'accent mis sur l'évaluation constitue l'un des aspects positifs de la réforme de la coopération.
Le CICID doit examiner chaque année un rapport d'évaluation de la coopération française. Un groupe de travail a été institué à cette fin. Son président, M. Claude Villain, inspecteur général des finances, a indiqué à vos rapporteurs que les travaux porteraient d'abord sur l'évaluation de la coopération administrative internationale. Un comité de pilotage interministériel a d'ores et déjà finalisé les termes de référence de cette évaluation (champ de l'étude, objectifs, problématiques, modalités, expertises...). Il aura également pour mission de suivre le déroulement de l'étude, d'assister les experts, de valider le rapport, d'en prendre en compte les recommandations dans les politiques conduites.
Parallèlement, au sein de la DGCID , le bureau de l'évaluation organise à l'aide d'une expertise externe, des évaluations rétrospectives -relatives à la coopération avec un pays ou dans un domaine déterminé, à un instrument de notre coopération ou encore à un projet ou programme important. Un programme d'une quarantaine d'évaluations a ainsi été approuvé sur la période 2000-2002 par la Comité des évaluations du 7 avril 2000 -où sont représentés l'Inspection générale des affaires étrangères, le Trésor et l'Agence française de développement. Ce programme, s'agissant des pays de la ZSP, représente un montant de 10 millions de francs.
La plupart de ces évaluations sont rendues publiques ; citons à titre d'exemple, l'évaluation des relations avec les partenaires multilatéraux, l'évaluation dans le secteur de la santé au Cambodge, l'évaluation rétrospective des systèmes financiers décentralisés ou encore l'aide française en Côte d'Ivoire (évaluation pays, 1989-1998).
L' AFD dispose également de son propre dispositif d'évaluation rétrospective afin de s'assurer de la conformité du déroulement de ses interventions aux objectifs et d'apprécier l'impact des projets sur les plans institutionnels, techniques, environnementaux et économiques. Une trentaine d'évaluations sont ainsi conduites chaque année.
Les enseignements des évaluations mises en oeuvre à ce jour mettent en exergue la difficulté d'assurer la pérennité de nos projets . Conférer aux bénéficiaires de notre aide l' autonomie nécessaire pour assurer dans la durée la continuité d'action de développement représente à coup sûr une véritable gageure.
Pour vos rapporteurs, l'utilité de ces évaluations ne fait pas de doute, même si elles donnent parfois le sentiment d'un certain foisonnement. Une double préoccupation doit cependant être mise en avant : d'abord, il importe de systématiser l'évaluation pour tous les projets d'aide au développement (telle semble la voie retenue pour les projets du Fonds de solidarité prioritaire qui devraient faire l'objet d'une évaluation à mi-parcours et finale, de préférence externe) ; ensuite, il est impératif de lier évaluation et orientation de notre aide de sorte que les leçons de l'expérience puissent être mises à profit dans les choix de notre politique de coopération.
L'évaluation est avant tout une aide à la décision . Or, il n'est pas sûr, comme l'a reconnu l'un des interlocuteurs de votre délégation, que la « substance » des rapports d'évaluation et le regard critique extérieur soient aujourd'hui toujours pris en compte.
B. LA TRADUCTION DES NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA COOPÉRATION SUR LE TERRAIN : LES EXEMPLES DE MADAGASCAR ET DU KENYA
Vos rapporteurs se sont rendus à Madagascar et au Kenya du 9 au 18 février 2001. Leur mission poursuivait quatre objectifs complémentaires : évaluer les actions de coopération conduites jusqu'à présent, mesurer, le cas échéant, les modifications introduites par la réforme, mieux appréhender sur place les attentes des personnels de la coopération et de l'ensemble des acteurs français -ONG, entreprises- impliqués dans le développement, prendre en compte enfin les attentes de nos partenaires. Elle a pu bénéficier du concours constant de nos ambassadeurs, M. Stanislas Lefebvre de Laboulaye, à Tananarive et de M. Pierre Jacquemot à Nairobi, de leurs collaborateurs ainsi que de l'ensemble des services français intéressés, notamment ceux de l'AFD. Qu'ils en soient vivement remerciés.
1. Madagascar : les voies d'une coopération rénovée
Par bien des aspects, la coopération à Madagascar se prête à une appréciation approfondie des atouts et des limites de la politique française en matière d'aide au développement. En premier lieu, le pays se range parmi les plus pauvres du monde (l'indice de développement humain classe ainsi la Grande île au 153 ème rang sur 174). Ensuite, notre coopération mobilise des moyens considérables : près d'un milliard de francs si l'on prend en compte toutes les formes de coopération et les quotes parts françaises dans les financements internationaux (FED, Banque mondiale, FMI...). Par ailleurs, notre action dans ce pays présente d' importants enjeux liés à trois facteurs : la présence de la plus importante communauté française d'Afrique subsaharienne -devant la Côte d'Ivoire- forte de 25 000 compatriotes, dont 20 000 immatriculés, parmi lesquels beaucoup de binationaux ; le rôle des entreprises françaises au nombre de 500 -la France représente le tiers du commerce extérieur et 65 % du stock total des investissements étrangers ; enfin Madagascar est situé au coeur d'un espace marqué par l'influence française et la francophonie- avec les îles éparses, Mayotte, la Réunion, les Comores, Maurice et les Seychelles.
Enfin, une commission mixte, exercice qui associe l'ensemble des acteurs de la coopération française pour définir avec le pays partenaire les grands axes de la coopération, s'était tenue en mai 2000. Elle ne s'était pas réunie depuis dix ans. Elle a permis de dresser un état assez complet de l'action de la France.
Au cours de leur déplacement qui les a conduits à Tananarive, à Antsirabé et à Tamatave, vos rapporteurs ont pu visiter une dizaine de projets illustrant l'étendue et la variété de la coopération française (développement rural, humanitaire, secteur privé, développement social, éducation, institutionnel). Ils ont pu s'entretenir de manière approfondie avec les représentants de l'assistance technique, de l'Agence française de développement ainsi qu'avec les responsables des principaux investisseurs français à Madagascar. Enfin, ils ont également pu rencontrer les autorités malgaches -le Premier ministre, M. Tantely Andrianarivo, le ministre des affaires étrangères, Mme Lila Atsifandrihamanana, le ministre des forces armées, le général Marcel Ranjeva- afin de recueillir leur sentiment sur l'évolution de l'action française. Par ailleurs, un déjeuner organisé sous les auspices de notre ambassadeur a permis des échanges très fructueux avec les représentants des bailleurs de fonds -pays ou instances multilatérales- les plus actifs à Madagascar.
Avant de présenter les principaux enseignements de cette mission, vos rapporteurs analyseront le cadre général dans lequel s'inscrit la coopération française ainsi que les principaux axes de notre action.
a) Un contexte général marqué par la stagnation, voire la dégradation des conditions de vie.
Depuis 1996, Madagascar a retrouvé une certaine stabilité politique. Le pays s'apprête aujourd'hui à mettre en oeuvre le chantier de la décentralisation tout en évitant que ne resurgisse, à la faveur de cette réforme, le clivage traditionnel entre les côtiers et les habitants des hauts plateaux.
Dans le domaine économique, la conjoncture paraît plus favorable depuis 1997, même si les fruits de cette croissance demeurent très inégalement répartis et ne touchent guère les campagnes. Le pays, l'un des premiers concernés par l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), est désormais assez avancé dans le processus mis en place par les organisations de Bretton Woods : il a ainsi obtenu l'accord du FMI à la fin de l'année 2000 pour atteindre le « point de décision » qui lui permet d'être exonéré du service de la dette ; les économies correspondantes devront être affectées aux dépenses de caractère social.
Par ailleurs, les autorités malgaches ont engagé un programme de privatisations des entreprises étatisées, pour la plupart d'entre elles, dans les années soixante-dix. Les premières opérations se sont traduites par un net renforcement du capital français dans l'économie du pays. Il reste sans doute à mieux impliquer les opérateurs privés malgaches dans les futures privatisations.
Le niveau de vie de la population apparaît très préoccupant, comme le traduisent quelques indices : l'espérance de vie du tiers de la population ne dépasse pas 40 ans ; 80 % des Malgaches n'ont pas accès à l'eau potable ; la population compte plus de 50 % d'analphabètes- et cette proportion est encore plus forte pour les jeunes, signe de la dégradation de l'enseignement au cours des deux dernières décennies. D'une manière générale, les infrastructures sont sans rapport avec les besoins des pays, en particulier dans les secteurs de l'éducation et de la santé.
On mesure mieux à travers ces quelques indicateurs les défis que doit relever notre coopération.
b) Un champ d'action très large pour la coopération
Malgré l'effort affiché pour mieux concentrer notre aide, le champ d'intervention couvre encore un très large spectre d'actions. En effet, les « priorités » définies par notre coopération concernent le développement humain et social (valorisation des ressources humaines, amélioration des services sanitaires, développement social), le développement économique (infrastructures et modernisation des services publics marchands ; filières de production -par exemple pour l'exploitation des crevettes- et organisation du monde rural -notamment à travers le micro-crédit), la modernisation et l'adaptation du cadre institutionnel -justice, sécurité publique, capacité d'action de l'Etat, renforcement de la démocratie, décentralisation).
Le tableau suivant donne la mesure des moyens engagés.
|
Moyens |
Effectifs |
Coût 2001 |
|
Assistance technique |
110
(37 enseignants
|
61,8 MF |
|
FSP |
35 MF |
|
|
Bourses |
5,6 MF |
|
|
Appuis logistiques |
10 MF |
|
|
Recherche . Institut Pasteur . CIRAD . IRD |
12 24 |
13,4 MF 6,9 MF 17,5 MF |
|
SCTIP |
0,8 MF |
|
|
Coopération militaire |
21 |
32 MF |
En outre, il convient de relever :
- l'encours des concours de l'AFD s'élève à 1,3 milliard de francs ;
- la coopération financière : remise de dettes du club de Paris (120 MF en 1999), aide budgétaire (80 MF en 1997 et 1999), Fonds de contrepartie de l'aide alimentaire (7 MF), annulation de la dette (mesure additionnelle française à compter de 2003 : 40 MF).
Vos rapporteurs insisteront pour leur part sur trois aspects en particulier :
• L'assistance technique
Comme dans les autres pays de l'ancien champ, l'assistance technique a été marquée, au cours de la dernière décennie, par une forte déflation : l'enveloppe financière est ainsi passée de 130 millions de francs en 1991 à 62,5 millions de francs en 2000 et le nombre de postes de 300 -ouverts en programmation 1991- à 135 -pourvus en octobre 1999.
Cette contraction s'est accompagnée d'une réorientation de l'assistance technique : les enseignants hier majoritaires ne représentent plus que 33 % de l'assistance technique et les techniciens sont désormais majoritaires. Cette évolution répond à la volonté affirmée au début des années 90 de mettre fin à la coopération de substitution : techniciens comme enseignants sont aujourd'hui tous investis de missions d'appui, de conseil ou de formation de formateurs.
La réduction des effectifs apparaît aujourd'hui -provisoirement ?- enrayée. Pour vos rapporteurs, le nombre actuel des coopérants constitue un minimum et il doit impérativement être maintenu . Plusieurs observations militent en ce sens ; d'abord, on mesure mieux aujourd'hui, en particulier dans un pays comme Madagascar, la complexité des conditions du développement -et notamment le poids des mentalités et des traditions- le facteur « temps » est donc essentiel tant pour la compréhension des problèmes que pour la mise en oeuvre de l'aide. Les projets de crédit rural et d'aménagement des espaces cultivés en témoignent. C'est pourquoi une présence sur le terrain, inscrite dans une certaine durée est indispensable.
Seule, en second lieu, la France bénéficie d'un tel instrument. Les autres bailleurs de fonds portent une appréciation généralement très positive sur l'assistance technique. Celle-ci constitue une garantie dans la mise en oeuvre de projets cofinancés ; ainsi il a été rapporté à la mission parlementaire que les Japonais cesseraient d'apporter leur aide à un projet sur Majungha si les Français devaient retirer leur assistance technique. Nos coopérants représentent par ailleurs une capacité d'expertise pour des organisations comme l'Union européenne dont les moyens financiers -considérables- dépassent de beaucoup les moyens humains. L'assistance technique peut donc représenter un relais pour des financements multilatéraux. Il y a là un atout que notre pays se doit de cultiver davantage.
Enfin, Madagascar souffre d'un manque de cadres formés . Cette lacune s'accentuera encore avec le départ à la retraite d'une génération qui a pu bénéficier par le passé d'une formation de qualité. Ainsi un effort de formation fondé sur une présence forte de coopérants reste donc nécessaire.
Il apparaît donc souhaitable de donner un coup d'arrêt à la déflation des effectifs mais aussi de redonner confiance à un personnel qui connaît un réel malaise, même si ce sentiment, comme vos rapporteurs ont pu le constater, n'entame en rien leur implication dans les projets dont ils ont la charge.
Des différents témoignages qu'ils ont recueillis sur place, vos rapporteurs ont la conviction que le mode de gestion de l'assistance technique doit profondément évoluer . Sans doute est-il d'abord nécessaire de mieux accorder la durée de la mission des coopérants avec la mise en oeuvre du projet -tout en posant naturellement des garde-fous pour éviter que ne s'instaurent de nouvelles rentes de situation. Surtout, les affectations doivent répondre de manière plus adaptée aux types de projets mis en oeuvre . La définition précise des profils de poste doit devenir systématique. Vos rapporteurs reviendront plus longuement sur ces deux points.
• Développement rural
Le secteur rural -agriculture, élevage, pêche- présente une importance cruciale pour Madagascar. Il emploie 80 % de la population active . Les produits de la pêche représentent, il convient de le souligner, la première source de devises du pays. Les campagnes connaissent toutefois une situation très préoccupante. La faiblesse et la stagnation des rendements (dix fois inférieurs à ceux des pays développés pour le maïs et cinq fois pour le riz) conjuguées à la croissance démographique entraînent depuis une trentaine d'années la réduction de la consommation calorique journalière. Parallèlement, la pression foncière s'accroît et provoque une raréfaction des sols à bon potentiel agricole. L'érosion des terres, liée à un défrichement mal maîtrisé représente aujourd'hui pour Madagascar une véritable catastrophe écologique.
En outre, les productions traditionnelles d'exportation, sources de revenus monétaires en zone côtière, apparaissent en déclin (café, poivre, girofle...). Le secteur privé tend à se cantonner aux activités de commercialisation (collecte et vente des produits) : il ne s'implique pas dans la fonction de relance de la production, ni dans la gestion de la qualité et investit peu.
La coopération française paraît aujourd'hui avoir tiré les leçons des expériences passées : elle privilégie des actions de long terme destinées à surmonter progressivement les blocages structurels au développement. Vos rapporteurs citeront en particulier les projets dont l'objet est de mieux structurer le milieu rural : appui à la création d'institutions privées de microfinance afin de financer de façon décentralisée le développement rural (caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel mis en place à Antsirabé grâce à l'appui technique d'ONG françaises) ; transfert aux associations paysannes des fonctions de gestion des infrastructures productives (périmètres irrigués) ; appui au développement technique et organisationnel des filières tournées vers l'exportation afin de remobiliser les opérateurs privés sur la mise en oeuvre de productions de qualité (la délégation a été notamment très favorablement impressionnée par la promotion -grâce à l'appui d'un assistant technique français et un soutien financier de la coopération- de l'approche intégrée des filières exportation). Les financements de projets privés d'investissements productifs agro-industriels dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture- ont été par ailleurs longuement évoqués avec l'AFD.
Une deuxième évolution positive mérite d'être soulignée : l'effort de coordination entre les différents bailleurs de fonds . En effet, les interventions dans le secteur rural s'inscrivent dans le cadre du Plan d'action de développement rural élaboré en concertation avec les autorités malgaches et les différents bailleurs de fonds. Ce cadre commun a favorisé le cofinancement de projets par la coopération française et la délégation de la Commission européenne ainsi que la mise à disposition de coopérants français auprès de projets européens.
La coopération en matière de développement rural rencontre cependant plusieurs difficultés . Les premières sont liées à certains aspects fondamentaux du mode d'organisation rural et, au premier chef, aux limites du cadastrage -qui ne concerne guère plus de 5 % du territoire malgache- et à l'absence de réforme foncière. Les secondes trouvent leur origine dans le caractère encore fragmentaire des projets conduits. Alors même que les méthodes d'action semblent porter leurs fruits au niveau local et répondent aux enjeux globaux du développement agricole à l'échelon national, leur effet sur la croissance du monde rural tarde à se faire sentir. Sans doute faudrait-il une assistance technique renforcée ou, à tout le moins, une certaine continuité dans les actions entreprises, ce que les aléas du budget français de la coopération interdisent malheureusement. C'est pourquoi la priorité accordée à la coordination avec les autres bailleurs de fonds constitue désormais une perspective obligée.
• La coopération militaire
La coopération militaire, reprise à la demande des autorités malgaches en 1993, s'inscrit dans un cadre politique désormais très favorable. Le ministre des forces armées qui avait souhaité accueillir et accompagner la délégation sénatoriale lors de la visite des écoles militaires d'Antsirabé a tenu à marquer par ce geste l'intérêt qu'accorde la partie malgache à notre coopération dans ce domaine. La coopération militaire revêt plusieurs formes : une aide directe, l'assistance technique (21 coopérants militaires dont 18 intégrés dans les états majors et les écoles avec la responsabilité de chefs de projets) ainsi que la participation des forces malgaches à certaines activités de la force stratégique française de l'Océan indien.
Le concept de défense malgache se singularise par l'accent placé sur la sécurité intérieure. D'après les informations recueillies par votre mission, les militaires sont intervenus à l'occasion des différentes manifestations d'une manière très contrôlée. Cette évolution doit sans doute pour une part être portée au crédit de l'effort de formation mis en oeuvre par la coopération.
A l'occasion de sa visite, la mission a pu constater la bonne intégration des coopérants militaires français au sein des forces malgaches, même si elle a regretté la relative brièveté -deux ans- de leur affectation.
c) Un bilan nuancé de notre action
L'évaluation de notre politique de coopération avec Madagascar inspire à vos rapporteurs cinq observations principales :
• Premier constat : une mise en oeuvre satisfaisante de la réforme de la coopération même si les limites de cette dernière se manifestent sur le terrain.
La mise en oeuvre de la réforme de la coopération, dans ses aspects institutionnels, a été conduite de manière satisfaisante à Madagascar. Le service de coopération et d'action culturelle aujourd'hui dirigé par un haut fonctionnaire issu de l'ancien secrétariat d'Etat à la coopération avait été confié précédemment à une diplomate dont l'action a recueilli les suffrages des assistants techniques. Il n'en reste pas moins que la politique d'aide au développement menée par la France sur la Grande île soulève certaines interrogations -écho, à l'échelon local des difficultés plus générales présentées par la réforme.
En premier lieu, les priorités de notre coopération n'apparaissent pas clairement.
Par ailleurs, l'assistance technique s'interroge sur son avenir. Malgré une forte implication dans les missions dont ils sont investis, les coopérants rencontrés sur place ont fait état d'un malaise certain lié à une reconnaissance insuffisante des actions menées sur le terrain de la part de l'administration centrale et aux incertitudes profondes sur le déroulement de leur carrière. Malgré la grande diversité de leur formation et des tâches qui leur sont confiées, nombre d'entre eux se sentent beaucoup plus proches, par leur culture comme par leur expérience professionnelle de leurs collègues de l'AFD que des diplomates. Beaucoup jugent également que l'Agence, par sa souplesse de gestion comme par les perspectives de carrière qu'elle offre, constituerait un cadre de rattachement plus approprié que le Quai d'Orsay.
Enfin, la cohérence entre les nouvelles orientations de la réforme et les moyens financiers nécessaires apparaît souvent problématique : ainsi la prise en charge par l'AFD des infrastructures dans les domaines de la santé et de l'éducation ne s'est accompagnée d'aucune dotation supplémentaire.
• Deuxième constat : des progrès réels pour mieux articuler l'action des différents bailleurs de fonds, mais un lien encore insuffisant entre la coopération française et les investisseurs privés.
Vos rapporteurs ont pu observer en général un véritable effort pour mieux coordonner l'action des bailleurs de fonds internationaux même s'il subsiste certaines différences d'approche. La proximité entre la délégation de l'Union européenne et l'assistance technique française mérite à cet égard d'être soulignée. Il doit plus cependant à la qualité des liens personnels qu'à la mise en oeuvre d'un cadre formel de concertation. A ce titre, il n'est pas sans présenter certaines fragilités.
Vos rapporteurs ont pu en revanche relever que les liens entre la coopération et les investisseurs français devaient encore se développer. Nos entreprises représentent en effet un puissant relais pour le développement de Madagascar. Sans doute apparaît-il nécessaire de mieux conjuguer les forces de l'action publique et du secteur privé. La préparation de la Commission mixte a d'ailleurs permis d'associer les opérateurs privés français à l'élaboration des orientations de la coopération française à Madagascar mais cette orientation doit se poursuivre dans la durée. Le déplacement de notre délégation a d'ailleurs été l'occasion à plusieurs reprises -et notamment à Tamatave- d'un dialogue entre investisseurs et assistants techniques qui a permis de dissiper certains malentendus de part et d'autre. Il serait opportun de poser les bases d'une concertation permanente.
• Troisième constat : assurer une plus forte visibilité à l'aide française.
Les interventions de la coopération française apparaissent trop peu valorisées. Quant aux opérations conjointes, la part souvent déterminante qu'y a pris la France n'apparaît que très rarement. Cette faible visibilité, vos rapporteurs ont pu le constater, contraste avec la publicité dont l'Union européenne sait entourer une opération. Si l'identification de la participation française dans une opération multilatérale peut soulever quelques difficultés, une meilleure reconnaissance des projets bilatéraux devrait être plus systématiquement recherchée.
• Quatrième constat : un mode d'action en mutation.
Les différents projets visités par vos rapporteurs présentent plusieurs caractères communs : ce ne sont pas des réalisations spectaculaires mais des opérations très proches du terrain, conduites dans la durée, dont les résultats ne seront perceptibles que progressivement. La page des « éléphants blancs » -ces grandes infrastructures dont les coûts de fonctionnement apparaissent rapidement prohibitifs- paraît donc tournée. Laissant le financement des grandes infrastructures telles que la construction de routes aux bailleurs de fonds dotés d'importants moyens comme l'Union européenne, la coopération française cherche à privilégier les actions de long terme au plus près des besoins des populations. Cette évolution, qui tire les leçons de plusieurs décennies de coopération, s'appuie sur une meilleure connaissance des obstacles au développement. Elle ouvre une nouvelle voie pour notre coopération qui mérite d'être encouragée. Moins spectaculaire dans ses réalisations, elle n'en reste pas moins exigeante par l'encadrement humain qu'elle requiert et la constance dans l'effort qu'elle exige. Maintien de la présence humaine et continuité de la mobilisation financière apparaissent ainsi comme la double priorité d'une coopération rénovée.
La réflexion sur les nouvelles modalités d'aide devrait du reste être engagée à l'échelle de l'ensemble des bailleurs. Aujourd'hui, les capacités de gestion de l'aide internationale par les autorités malgaches paraissent en voie de saturation . L'annulation de la dette dans le cadre de l'initiative PPTE et les nouvelles conditionnalités prises par la communauté internationale -transfert des économies dégagées par les annulations de dette sur les dépenses sociales- ne peuvent qu'aiguiser ces difficultés.
Par ailleurs, au regard des montants mis en oeuvre, le bilan de l'aide apparaît pour le moins insuffisant. Il est donc indispensable de s'interroger sur les conditions de mieux dépenser les moyens disponibles. Il semble que le chantier d'une aide rénovée n'en soit encore qu'aux prémices. Notre pays, par la part qu'il a prise dans l'aide et l'évolution qu'il a su lui imprimer, a un rôle essentiel à jouer dans cette prise de conscience internationale.
• Cinquième constat : les risques d'un partenariat exclusif.
Les interlocuteurs malgaches de votre délégation ont confirmé au plus haut niveau, leur satisfaction dans la coopération française. Parmi les partenaires de la Grande île, notre pays est celui qui a apporté le soutien le plus fort et le plus fidèle. Les Malgaches en sont conscients et nous en savent gré. Ils ne s'illusionnent guère sur les quelques ouvertures américaines dont la portée apparaît jusqu'à présent limitée. Le tête à tête n'est toutefois pas sans présenter certains risques : les difficultés du dialogue sont rapidement mises au débit de l'ancienne puissance coloniale. Par ailleurs, les difficultés économiques auxquelles Madagascar se trouve en prise dépassent les capacités d'action de la France. Aussi notre pays, également conscient des limites de ses moyens financiers, a-t-il mieux pris la mesure de l'intérêt d'impliquer davantage d'autres pays dans l'aide au développement à Madagascar. Moins exclusif, le dialogue peut reposer sur des bases sans doute plus sereines. Telle est sans doute l'une des conditions de la rénovation d'une relation encore marquée par la logique de l'assistanat.
2. Notre coopération avec le Kenya, ou comment mener une coopération plus dynamique avec des moyens réduits
Le déplacement de la mission sénatoriale au Kenya a permis de mieux évaluer les enjeux et les moyens de la coopération française dans les nouveaux pays intégrés à la zone de solidarité prioritaire.
a) Les enjeux de la coopération avec le Kenya
Le Kenya dispose de plusieurs atouts au premier rang desquels la stabilité politique dont il a bénéficié depuis son indépendance. Le Kenya a restauré en 1991 le multipartisme sous la pression de la population et des bailleurs de fonds. Les deuxièmes élections pluralistes de décembre 1997 ont été marquées par la continuité : elles ont été en effet remportées par le Président Moi (dernier mandat de cinq ans) et l'ancien parti unique -la KANU- sur une opposition divisée. Toutefois, depuis 1992, les tensions foncières ont nourri à intervalles réguliers, en particulier dans la vallée du Rift, des violences politico-ethniques.
Par ailleurs, le potentiel économique du pays se compare très favorablement aux autres Etats de la région : les capacités agricoles permettaient encore, au cours des années 80, quand la pluviométrie présentait un niveau normal, d'assurer l'autosuffisance alimentaire et d'exporter du café, du thé et diverses productions légumières et horticoles ; les infrastructures de transport (l'aéroport de Nairobi constitue un noeud de communications pour toutes les destinations transrégionales ; le port de Mombasa, l'état des réseaux ferré et routier permettent le transit vers l'Ouganda et au-delà vers toute la région des Grands lacs) ; le dynamisme de l'activité touristique lié à la richesse et la variété du patrimoine humain et naturel ; les bases d'un développement industriel ; la promotion de l'intégration régionale au sein de l' « East African Community » (EAC) -avec deux pays voisins : l'Ouganda et la Tanzanie et du « Common Market for Eastern and southern Africa ».
L'économie kenyane reste toutefois marquée par de nombreux facteurs de fragilité dont le poids s'est plutôt accru dans la période récente. En premier lieu, la prédominance du secteur agricole rend l'économie particulièrement vulnérable aux aléas climatiques : l'aggravation de la sécheresse en 2000 a provoqué une augmentation de la mortalité du bétail ainsi qu'une contraction de la production céréalière estimée à 30 % par rapport à 1999. En 1999, la croissance n'avait pas dépassé 1,4 %, taux qu'il convient de rapporter à la croissance de la population de l'ordre de 2,4 %.
Par ailleurs, les vicissitudes des relations avec les bailleurs de fonds multilatéraux ont aussi pesé sur la conjoncture économique ; ainsi la facilité d'ajustement structurel renforcé accordée par le FMI en 1996 a été suspendue l'année suivante afin de sanctionner la lenteur des privatisations et le manque de détermination des autorités kenyanes dans la lutte contre la corruption. Le redressement engagé par les autorités depuis 1999 a toutefois conduit la Banque mondiale et le FMI à reprendre leurs décaissements.
Enfin, le développement du pays reste hypothéqué par l'extension de la pandémie de sida : 14 % de la population est séropositive et la moitié des lits d'hôpitaux est occupée en 2001 par des malades du sida. Les effets de la maladie apparaissent d'autant plus alarmants qu'ils touchent plus particulièrement les forces vives du pays -et notamment les jeunes.
b) La sélectivité obligée des actions
Les crédits du service de coopération et d'action culturelle apparaissent très modestes : 6 millions de francs en 2000 (90 millions de dollars pour l'aide américaine, 22 millions de livres sterling pour l'aide britannique). Ils représentent quelque 2 % de l'aide au développement totale dont bénéficie le Kenya. En outre, ils n'ont cessé de se réduire depuis cinq ans -ils représentaient 9,6 millions de francs en 1995, soit depuis lors une baisse de 35 %. Cette évolution présente un caractère paradoxal alors même que l'intégration du Kenya dans la ZSP aurait dû s'accompagner pour le moins d'un maintien des dotations. L'enveloppe a été reconduite en 2001, abondée toutefois d'un crédit du Fonds de solidarité prioritaire d'un montant de 4 millions de francs. Les interventions de l'AFD s'élèvent quant à elles à 224 millions de francs auxquelles il convient d'ajouter 125 millions de francs au titre de la PROPARCO.
La relative modestie des moyens mis en oeuvre a conduit à porter l'accent sur une triple orientation : l'amélioration de l'accès aux services de base (notamment l'accès à l'eau potable et l'amélioration de l'assainissement), la recherche des coopérations régionales, le souci d'une complémentarité entre les actions des différents bailleurs français.
L'action conduite dans le secteur de l'eau apparaît révélatrice de cette triple démarche. Votre délégation a pu mesurer lors d'une visite du bidonville de Kibera, à la périphérie de Nairobi, les besoins considérables de la population en matière d'accès à l'eau. L'AFD a d'ores et déjà décidé des programmes d'adduction d'eau dans les centres urbains et les bidonvilles -notamment à Kibera-. Ces projets seront complétés par des projets d'appui financés par le Fonds de solidarité prioritaire (en particulier dans le domaine de la formation à travers l'appui au Kenyan Water Institute chargé de la formation des administrations mais aussi des collectivités locales, des sociétés privées, des agences non gouvernementales...). Ils comportent aussi une dimension régionale : un séminaire associant le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda s'est réuni en 1998 sur le thème de la participation des entreprises privées à la gestion de l'eau au moment où les trois pays s'engageaient dans le processus de privatisation de ce secteur. La France a pu faire valoir à cette occasion le savoir-faire de ces entreprises nationales dans ce domaine d'activité.
Sélectivité des projets et optimisation des synergies possibles entre les interventions des différents bailleurs de fonds représentent sans doute un double impératif dans les pays de la ZSP où la France ne dispose que de moyens limités. Ainsi concentrée, notre action peut s'assurer une bonne visibilité comme le montre d'ailleurs l'exemple Kenyan où, comme l'ont confirmé les interlocuteurs de votre délégation, les initiatives françaises bénéficient d'une appréciation très favorable. Il n'en reste pas moins que, même dans un champ ainsi recentré, assurer un prolongement aux actions entreprises afin de leur conférer tout leur impact, requerra un accroissement des moyens humains et financiers par rapport à ceux alloués par le passé.
III. QUELS MOYENS POUR UNE NOUVELLE AMBITION ?
Les nouvelles ambitions dans le domaine de l'aide au développement peuvent-elles s'appuyer sur des moyens adaptés ? Telle est, sans doute, l'une des principales interrogations soulevées par la réforme.
La politique de coopération repose traditionnellement sur différents instruments financiers mis en oeuvre par l'ancien secrétariat d'Etat à la coopération, le ministère de l'économie et des finances et l'Agence française de développement mais aussi, et c'est là un trait propre à la France, sur une importante assistance technique humaine. Les premiers ont été rénovés mais les moyens financiers globaux consacrés à l'aide au développement enregistrent une baisse indéniable depuis plusieurs années ; la seconde a singulièrement été, dans un premier temps du moins, largement ignorée par la réforme.
A. LE DÉCLIN DE L'EFFORT EN FAVEUR DE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT MALGRÉ LA RÉNOVATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
1. La contraction des moyens financiers consacrés par la France à l'aide au développement
L'aide publique au développement, au sens où la définit l'OCDE, correspond aux fonds des organismes publics, y compris les collectivités locales ou régionales, versés aux pays et territoires figurant sur une liste établie par le Comité d'aide au développement. Elle a vocation à favoriser le développement économique et améliorer les conditions de vie, et à des conditions financières libérales (dans le cas des prêts, l'élément don doit être d'au moins 25 %).
Evolution de l'aide publique au développement 1990-2000
(versements nets en millions de francs) TOM inclus
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
Versements |
39 178 |
41 660 |
43 788 |
44 818 |
47 004 |
42 139 |
38 119 |
36 808 |
33 872 |
35 257 |
29 390 |
31 343 |
32 755 |
|
% du PNB |
0,60 |
0,62 |
0,63 |
0,63 |
0,64 |
0,55 |
0,48 |
0,45 |
0,40 |
0,38 |
0,31 |
0,33 |
0,34 |
(Source : Direction duTrésor)
Deux constats s'imposent :
En premier lieu, la France demeure encore l'un des principaux bailleurs de fonds ; son aide en valeur absolue la classait au troisième rang des 22 pays membres du CAD et en valeur relative -rapportée au PNB- au 1 er rang des pays du G7.
Cependant -et c'est le deuxième constat- la contribution de notre pays n'a cessé de se réduire au cours de la dernière décennie, au risque de mettre fin à l' « exception française ». Ainsi, de 1993 à 1999, l'aide publique a perdu 13 milliards de francs en prix courant, soit une réduction de 40 % en prix constant. Après avoir représenté à son point le plus élevé 0,64 % du PIB en 1994 -il s'agissait alors, il est vrai, d'un pic exceptionnel, correspondant aux mesures financières apportées en contrepartie de la dévaluation-, l'aide française a atteint son niveau le plus bas en 1999 à 0,38 %. Elle a amorcé depuis lors un léger redressement . Quoi qu'il en soit, la France apparaît désormais très éloignée de l'objectif « idéal » souvent réitéré dans les enceintes internationales de consacrer 0,7 % du PNB à l'aide publique au développement 4 ( * ) .
Parallèlement, la composition de l'aide s'est profondément modifiée : l' aide-projet tend désormais à présenter un caractère résiduel, alors que l' aide macroéconomique sous forme d'allégement de la dette et d'appui à l'ajustement structurel occupe une part prépondérante. Cette tendance s'accusera encore en raison de la mise en oeuvre du renforcement de l'initiative « pays pauvres très endettés » (PPTE). Notre pays est, en effet, avec le Japon, l'un des deux plus importants créanciers de l'ensemble des pays éligibles à l'initiative PPTE (en raison notamment du poids de ses créances sur la Côte d'Ivoire et le Cameroun).
Lancée au sommet du G7 de Lyon en 1996, l'initiative « pays pauvres très endettés » a pour objectif de rétablir la solvabilité des pays bénéficiaires en annulant, par des mesures exceptionnelles, la part de la dette extérieure dépassant un niveau considéré comme « soutenable » au regard de leurs perspectives de croissance économique. En juin 2001, 23 pays avaient atteint le « point de décision » qui permet de bénéficier d'allégements intérimaires du service de la dette.
Une triple préoccupation doit être rappelée :
- d'une part, comme les bailleurs de fonds s'y sont engagés, l'effort consenti en matière de dette ne doit pas avoir pour contrepartie une réduction de l'aide-projet ; ce principe d' « additionnalité » vaut en particulier pour notre pays dont l'effort au titre des allégements et annulations de dette dépasse 10 milliards d'euros.
- D'autre part, les ressources dégagées par les allégements de dette doivent, conformément aux conditions fixées par les créanciers, financer des dépenses de caractère social . L'affectation de ces ressources devra faire l'objet d'un contrôle approfondi de la part des bailleurs. Les procédures d'annulation devraient en particulier avoir pour condition l'engagement des Eats bénéficiaires de garantir le versement des prestations sociales -en particulier les retraites- à leurs ressortissants mais aussi à nos compatriotes qui ont régulièrement cotisé.
- Enfin, si le principe de nouveaux prêts, même concessionnels, était exclu pour les pays bénéficiant de mesures d'allégement de dettes, les flux financiers en direction de certains pays -Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo...- bénéficiaires traditionnels de prêts souverains risqueraient de se tarir.
2. Un effort de clarification des instruments financiers malgré des ambiguïtés récurrentes
L'aide projet est mise en oeuvre par les trois grands acteurs de la politique de coopération :
Le ministère des affaires étrangères -à travers le Fonds de solidarité prioritaire-, le ministère de l'économie et des finances -par le biais des protocoles financiers-, l'Agence française de développement. Jusqu'en 1998, la spécificité des différents intervenants n'apparaissait pas toujours clairement. Ainsi, les protocoles financiers servaient, d'une part, d'aide au développement, en finançant par exemple des projets d'infrastructure de base et, d'autre part, de soutien commercial aux entreprises françaises. La réforme de la coopération s'est accompagnée d'une plus grande spécialisation de ces différents instruments. Le rôle privilégié de l'AFD et du FAC en matière d'aide au développement a été réaffirmé et, dans le même temps, les responsabilités respectives de ces deux organismes ont été mieux précisées. Quant aux protocoles financiers, leur vocation économique apparaît désormais prédominante.
a) Le Fonds de solidarité prioritaire
Le Fonds de solidarité prioritaire (FSP) a pris en 1999 la suite du Fonds d'aide et de coopération créé en 1959. Considéré comme l'instrument « emblématique » de l'aide projet, il a vocation à financer des dépenses d'investissement. Les crédits qui lui sont affectés sont ainsi inscrits au titre VI du budget (subvention d'investissement). Il couvre trois types de projets :
- les projets bilatéraux conclus avec un Etat (avec lequel il est passé une convention de financement) ;
- les projets inter Etats bénéficiant à un groupe d'Etats déterminés réunis dans le cadre d'une organisation internationale ;
- les projets d'intérêt général qui ne sont pas négociés avec un Etat déterminé et peuvent concerner des opérations de développement dans différents domaines (francophonie, thèmes sectoriels transversaux -sida, etc-, financement d'opérations pilotes).
La réforme n'a pas transformé substantiellement ce dispositif. Elle l'a modifié sur deux aspects :
- elle a réduit le périmètre des domaines concernés par le FSP : les infrastructures dans les domaines de l'éducation et la santé ont été confiées à l'AFD ;
- elle a changé, avec l'adoption du décret n° 2000-880 du 11 septembre 2000, la procédure de décision : le Comité directeur du FAC chargé de statuer sur chacun des projets envisagés par l'administration a laissé place à deux instances distinctes : le Conseil d'orientation stratégique dont le rôle est de formuler des recommandations de caractère général « sur l'utilisation des crédits du Fonds par secteurs d'activité et par zones géographiques » et un Comité de projets appelé à se prononcer au cas par cas sur les opérations.
L'évolution du FSP suscite une certaine préoccupation à cinq titres :
- d'abord, comme le soulignait notre collègue Michel Charasse devant la commission des finances, lors de sa présentation des crédits consacrés à l'aide publique au développement dans le cadre du projet de budget pour 2001, la concentration du FSP sur les secteurs institutionnels et de souveraineté risque d'exposer les crédits afférents à la censure du contrôleur financier, dans la mesure où ils relèvent davantage des dépenses d'intervention du titre IV que des subventions d'investissement du titre VI ;
- ensuite, le pouvoir de contrôle des parlementaires qui s'exerçait auparavant dans le cadre du comité directeur s'est trouvé affaibli : ils sont désormais représentés au sein du comité d'orientation stratégique mais non au sein du comité de projets ;
- surtout, l'évolution de l'enveloppe du FSP ne laisse pas d'inquiéter ; les dotations inscrites en loi de finances connaissent une érosion continue depuis plusieurs années ; en outre, cette enveloppe apparaît la cible privilégiée des mesures de régulation décidées par Bercy en cours d'année : ainsi, en 1999, l'annulation de 250 millions de francs d'autorisations de programme avait ramené la dotation initiale du FSP destinée aux pays de la ZSP à 60 % de sa valeur initiale ; la vocation du FSP à servir de « variable d'ajustement » des économies budgétaires s'est ainsi confirmée au fil des années ;
- cette évolution apparaît d'autant plus préoccupante que les crédits du FSP destinés en principe aux pays de la ZSP peuvent être mobilisés pour des opérations hors de cette zone , en particulier dans le cadre des opérations de reconstruction dans les Balkans 5 ( * ) ;
- enfin, la mise en oeuvre des projets souffre encore de nombreux retards ; ainsi, la durée prévue des projets en cours, de l'ordre de 35 mois, se trouve prolongée en moyenne de 11 mois. Ces délais interviennent à plusieurs niveaux : entre la décision du comité directeur et la signature des conventions de financement (cinq à six mois séparent parfois ces deux étapes), mais aussi entre la décision d'attribution des fonds et le déblocage effectif des crédits. L'impéritie des administrations locales ne saurait toujours exonérer notre pays de ses propres responsabilités dans ces retards : évaluation insuffisante des projets, lourdeur du circuit de décision, régulation budgétaire dont les effets conduisent souvent à paralyser une opération. Or, il faut y insister, l'intérêt même d'une intervention peut se trouver compromis lorsque l'exécution prend un retard excessif.
b) L'aide-projet mise en oeuvre par l'AFD
L'AFD met en oeuvre des concours destinés au financement des projets productifs publics et privés, créateurs d'emplois dans les secteurs les plus divers. Elle intervient à ce titre sous deux formes :
- dans les pays les moins avancés ainsi que dans certains Etats à faible revenu, des subventions destinées à financer les opérations, à l'exception des projets rentables du secteur public marchand (les subventions sont généralement accordées aux Etats) ;
- dans les autres pays de la ZSP, des prêts accordés aux Etats ou à des entreprises publiques ou parapubliques avec l'aval des Etats.
L'AFD, reconnue comme « opérateur principal » de la réforme, a vu ses compétences s'élargir au financement des infrastructures de santé et d'éducation. Une telle évolution s'imposait, dans la mesure où l'Agence bénéficie d'une solide expérience que lui a acquise la conduite de projets d'infrastructure dans d'autres secteurs.
Par ailleurs, l'AFD gère également les concours d'ajustement structurel décidés par le gouvernement français.
Institution financière spécialisée, elle se procure ses ressources, pour une part, sur les marchés sous forme d'emprunts, et pour une autre part, sur les ressources budgétaires de l'Etat. Le montant annuel des subventions allouées à l'AFD dépasse le milliard de francs au titre de l'aide-projet, cette subvention est inscrite au budget du ministère des affaires étrangères. Au 31 juillet 2001, les engagements de l'agence représentaient 2,6 milliards de francs.
L'aide-projet mise en oeuvre par l'AFD soulève une double interrogation.
En premier lieu, la prise en charge par l'AFD des infrastructures dans les domaines de l'éducation et de la santé suppose un effort de coordination renforcé avec les services de coopération responsables pour leur part des autres aspects de coopérations liés à ces deux secteurs ; il serait vain de construire des hôpitaux ou des écoles sans prévoir par ailleurs les moyens humains à même de les faire fonctionner.
Ensuite, de même que le FSP a pu servir à financer des projets hors de la ZSP, les ressources de l'AFD ont été sollicitées pour des actions situées dans les Balkans. S'il apparaît que l'Agence est intervenue en 2000 au Kosovo grâce à une subvention complémentaire par rapport à l'enveloppe dont elle disposait, on ne peut exclure pour l'avenir que ces actions hors de la ZSP ne pèsent sur les moyens destinés aux pays en développement.
c) Les protocoles financiers du Trésor
Avant la réforme de la coopération, l'aide-projet dans les pays « hors champ » relevait des protocoles financiers gérés par le Trésor. Ces protocoles prenaient la forme de dons ou de prêts destinés à financer des projets d'équipement réalisés par des entreprises françaises. Les protocoles participaient donc à la politique d'aide au développement et au soutien de nos entreprises. Ces programmes faisaient l'objet d'une programmation annuelle par pays, l'affectation des enveloppes à des projets étant ensuite négociée avec les autorités locales.
Une première réforme est intervenue en 1996. Elle innovait, à un double titre :
- la création d'un Fonds d'étude et d'aide au secteur privé (FASEP) destiné à financer des prestations d'étude ou d'assistance technique réalisées par des consultants français, afin d'orienter dans un sens favorable à nos intérêts économiques les choix des décideurs étrangers et des bailleurs de fonds internationaux ;
- la mise en place d'une réserve pour les pays émergents appelés à financer sélectivement des projets jugés particulièrement « stratégiques » dans des pays où les montants mis en oeuvre dans le cadre des projets « classiques » ne paraissaient plus à la mesure des marchés et de leur potentiel.
Ces orientations ont été prolongées en 1998 dans le souci de redonner aux protocoles leur vocation première de soutien aux entreprises françaises, afin de renforcer notre présence économique sur certains marchés prometteurs. Les nouvelles dispositions modifient l'aide projet-protocole traditionnelle et conforte le FASEP mis en place en 1996.
Les protocoles financiers sont attribués non plus à un pays, comme par le passé, mais à un projet ponctuel, afin d'échapper à la logique d'un droit de tirage systématique au profit d'un pays donné et de mieux adapter l'instrument à la durée d'un projet qui peut ainsi s'étaler sur plusieurs années. En outre, les protocoles financiers concernent désormais exclusivement les seuls pays émergents.
Parallèlement, le FASEP est renforcé avec la création, aux côtés du FASEP-études, d'un FASEP-garantie . Ce fonds de garantie interviendra en appui du développement des filiales majoritaires de PME-PMI françaises à l'étranger (en garantissant des fonds propres apportés par la maison-mère ou des sociétés de capital-risque ou en garantissant des prêts consentis aux filiales locales par des banques locales).
B. L'ASSISTANCE TECHNIQUE : UN INSTRUMENT QUI DOIT REDEVENIR PRIORITAIRE
La réforme de la coopération est restée muette sur l'assistance technique. Comment comprendre, cependant, qu'elle ait pu laisser de côté ce qui a constitué l'instrument le pus important et, sans aucun doute, le plus original de l'aide publique française ? Ce silence apparaît d'autant plus inexplicable que l'assistance technique connaît, depuis plusieurs années déjà, d'importantes mutations : une réduction drastique du nombre de postes au cours de la dernière décennie, un raccourcissement de la durée du séjour, le développement, rendu possible dès 2001, de missions d'expertise courtes.
La conjonction de ces différents changements, sans qu'aucune orientation politique claire n'ait été fixée, a laissé planer de nombreux doutes sur l'avenir de l'assistance technique et a créé parmi les coopérants une crise de confiance dont la mission d'information a recueilli de nombreux témoignages au cours de ses déplacements ou de ses entretiens. Il apparaissait donc indispensable que le gouvernement arrête, en cette matière décisive pour notre politique d'aide, un cap clair qui tienne compte de l'avis des intéressés et des acquis indéniables de près de quatre décennies. L'annonce d'une réforme de l'assistance technique, le 11 avril 2001, répond à ces préoccupations même si elle ne dissipe pas toutes les incertitudes.
1. Un avantage comparatif majeur de la coopération français
a) Un dispositif original
Le choix fait par la France de mettre à la disposition des pays bénéficiaires de notre aide, pour une longue durée, des experts dans les disciplines susceptibles de favoriser le développement constitue un trait propre à notre coopération qui n'a pas d'équivalent chez les autres bailleurs de fonds bi ou multilatéraux. Cette orientation trouve son origine dans l'histoire de nos relations avec les Etats africains. Elle s'est traduite par une mobilisation très importante des ressources humaines, ainsi que par la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire spécifique.
• Le moyen de préserver des liens historiques
La mise en place d'une assistance technique nombreuse, au lendemain de la décolonisation, s'explique d'abord par la volonté de la France de maintenir des liens privilégiés fondés sur la solidarité avec les pays de son ancien empire colonial. Elle a été facilitée par le déroulement pacifique, dans la plupart des pays d'Afrique noire, du processus d'indépendance. Elle a permis, dans un premier temps, d'assurer la continuité de l'appareil administratif hérité de la période coloniale, avant de se concentrer sur des missions plus spécifiquement orientées vers le conseil, la formation et le développement.
• Un cadre juridique spécifique
L'importance reconnue à ce volet de notre politique de coopération a justifié l'organisation d'un cadre juridique spécifique. Il s'articule autour de trois volets :
- les accords de coopération signés avec les pays bénéficiaires d'une forte présence de coopérants : ils traitent des modalités d'affectation des coopérants, des conditions dans lesquelles ils sont placés sous l'autorité de l'Etat bénéficiaire, des obligations qui peuvent incomber à celui-ci (en particulier la prise en charge d'une partie de la rémunération correspondant au moins au coût du fonctionnaire équivalent dans la fonction publique locale -les Etats bénéficiaires se sont apparemment acquittés de cette obligation jusque dans les années 70). La France pour sa part, au vu des demandes de ses partenaires, propose des candidatures et prend en charge, sur la base d'un contrat auquel l'Etat bénéficiaire n'est pas partie, la rémunération, les frais de voyage, la garantie de la couverture sociale. Elle peut mettre fin à la mission du coopérant à la demande de l'Etat bénéficiaire ou de sa propre initiative.
- les textes législatif et réglementaires :
1° Deux décrets du 2 mai 1961 fixent les règles statutaires et le régime de rémunération propre aux assistants techniques ; ils posent, en particulier, deux principes qui caractériseront pendant une quarantaine d'années le système français : d'une part, une assistance technique fondée sur la mobilisation de fonctionnaires volontaires ; d'autre part, le recours à la position de détachement qui permet au gouvernement français de placer des personnels français auprès de gouvernements étrangers.
Les coopérants gérés par le ministère des affaires étrangères n'étaient pas, quant à eux, soumis au décret de 1961. La rémunération de ceux -les plus nombreux- affectés dans les pays du Maghreb était, en effet, déterminée par les accords de coopération bilatéraux. Celle des agents qui ne relevaient pas de ce type d'accord a été soumise, à partir de 1967, aux dispositions du décret du 28 mars 1967.
Le régime de rémunérations et de congés des coopérants gérés par le ministère de la coopération, fixé en 1961, a été modifié en 1972 (deux décrets du 25 avril 1972) puis, de nouveau, en 1992 . Trois décrets (18 décembre 1992) ont alors introduit trois innovations principales : la définition d'une « mission de coopération » (l'obligation d'établir entre le gouvernement de l'Etat concerné et l'administration française une lettre de mission individuelle), la durée maximale -fixée à six ans dans un même pays-, la flexibilité (possibilité de moduler la durée du contrat entre six mois et trois ans, en fonction de la nature et du contenu de la mission d'assistance technique ; régime de rémunération articulé sur les fonctions effectivement exercées plus que sur la situation statutaire de l'intéressé).
2° La loi du 13 juillet 1972 reconnaît dans la coopération culturelle, scientifique et technique « une responsabilité nouvelle de l'Etat qui présente le caractère d'une véritable mission de service public ». Elle est aussi le premier texte qui ouvre la possibilité d'exercer des missions de coopération à « l'ensemble des secteurs d'activité , en fonction des qualifications recherchées ». Cependant, en la matière, elle se sera bornée à fixer des principes, car l'essentiel de ses dispositions a porté sur un aspect limité de la coopération : les garanties assurées aux personnels « contre les risques particuliers du service en coopération ». Par ailleurs, comme le notait le rapport de M. Jean Nemo 6 ( * ) , « elle se limitait à une seule modalité de l'assistance technique, celle directement gérée par l'Etat au bénéfice d'autres Etats : elle ne permettait pas d'encourager et d'asseoir d'autres modalités, plus indirectes, mais éventuellement plus souples et plus évolutives ».
• Un effort considérable en termes d'effectifs
L'assistance technique française s'est enfin caractérisée par l'importance des effectifs mobilisés , soit quelque 23 000 à leur plus haut niveau au début des années 1980 (hors les enseignants de l'enseignement français à l'étranger). Ces derniers se trouvaient toutefois concentrés dans un nombre limité de pays puisque la moitié des effectifs des pays du champ se regroupaient dans quatre pays et 90 % des coopérants « hors champ » dans les trois pays du Maghreb.
b) Un bilan positif
Si l'assistance technique a pu montrer certaines limites, elle s'est révélée dans l'ensemble un instrument efficace de l'aide au développement et un relais essentiel de l'influence française.
L'assistance technique dans les pays du champ a fait l'objet de quatre séries de critiques principales :
- la pérennisation des fonctions ; comme le note le rapport Nemo, la carrière des coopérants les plus anciens a pu se dérouler à l'étranger « depuis leur période de volontariat du service national jusqu'aux abords de la retraite » ; cette tendance n'était pas propice au renouvellement des compétences et à l'adaptation de l'aide aux besoins ;
- la pratique d'une coopération de « substitution » et, pour conséquence, un transfert retardé des compétences aux cadres nationaux et une certaine déresponsabilisation des élites locales ;
- un appel insuffisant aux personnels locaux dans la mise en oeuvre des projets d'aide au développement ;
- enfin, la facilité du recours à l'assistance technique a pu conduire, comme le souligne le rapport Nemo, à écarter d' « autres formules qui auraient pu être mieux adaptées ». Or, « en cas d'impossibilité de disposer d'assistants techniques « directs » pour épauler certains projets, le recours à d'autres formes d'appui en compétence (organismes sous-traitants, bureaux d'études ou de conseil), optiquement plus coûteuses, a le plus souvent conduit à rationaliser l'analyse des besoins réels et à réduire la demande de personnel nécessaire à l'accomplissement des missions, sans pour autant compromettre la bonne fin de ces projets » .
Cependant, la portée de ces critiques reste limitée.
En premier lieu, l'assistance technique a su évoluer au fil des années et corriger les principales faiblesses qui lui étaient reprochées. Ainsi, à partir des années 80, la coopération dite de « substitution » a été progressivement réduite. Parallèlement, à la suite du décret de 1992, le temps de séjour dans un même pays a été ramené à six ans et la mission des coopérants mieux précisée.
Ensuite, et surtout, les avantages du système français apparaissent difficilement contestables. En premier lieu, à la différence des missions d'expertise courte pratiquées par les institutions internationales, un séjour prolongé permet une meilleure connaissance des réalités du « terrain » et des attentes de nos partenaires. Cette expérience a contribué à prémunir la coopération française des excès dont les institutions de Bretton Woods ont parfois fait montre en voulant appliquer sans véritable discernement aux économies en développement les principes inspirés du libéralisme anglo-saxon. La Banque mondiale et le FMI ont, depuis lors, largement infléchi leur politique, donnant raison a posteriori aux orientations françaises. Il est regrettable, à cet égard, que notre pays n'ait pas su réellement valoriser le savoir-faire des coopérants afin de peser sur les décisions des institutions internationales et de prévenir les conséquences, parfois désastreuses, de choix trop dogmatiques.
L'assistance technique représente également un gage d'efficacité pour la politique de développement. Elle fournit, en effet, l'encadrement humain indispensable dans un premier temps à la mise en oeuvre des projets de développement, en particulier lorsqu'il s'agit d'infrastructures sociales (santé et éducation). La présence de coopérants constitue une garantie aux yeux mêmes d'autres bailleurs de fonds. A contrario , l'absence de soutien humain peut constituer une contrainte et conduire le bailleur à se replier sur un nombre limité de projets. Il en est ainsi de l'Union européenne qui, à Madagascar par exemple, tend à privilégier la construction de routes dont la mise en service ne requiert pas, en principe, un véritable accompagnement (bien que l'expérience montre que la pérennité des infrastructures dépend de l'entretien et, partant, d'une organisation et d'une logistique humaine qui trop souvent font défaut).
La présence humaine permet de varier le champ de la coopération, de l'adapter aux besoins des populations et de fournir les bases d'une action plus fine et plus efficace. Certes, l'une des difficultés majeures de la politique de coopération porte sur les conditions dans lesquelles s'organise la relève des assistants. Parfois, en effet, à la suite du départ d'un coopérant, un projet peut péricliter. La formation des responsables locaux, la pérennité de l'action entreprise constituent, à coup sûr, les objectifs fondamentaux de l'action de coopération. Ces éléments apparaissent déterminants pour fixer la durée nécessaire de l'assistance technique sur place. Vos rapporteurs reviendront plus loin sur ce point.
Enfin, l'assistance technique constitue un vecteur de l'influence française , instrument d'autant plus pertinent que, du fait de la durée de leur séjour, les coopérants français peuvent réellement s'intégrer au sein des structures auprès desquelles ils travaillent : ils sont ainsi en mesure de gagner la confiance de leurs partenaires. Par ailleurs, cette présence demeure aussi un relais non négligeable de la diffusion de notre langue.
Source d'un savoir-faire, gage d'efficacité, instrument d'influence, l'assistance technique apparaît comme l'atout majeur de la coopération française . Elle connaît cependant, depuis une décennie, une crise sérieuse dont les effets peuvent se révéler très préjudiciables pour notre politique de développement.
2. La crise de l'assistance technique
La crise de l'assistance technique trouve son origine dans la déflation considérable des effectifs depuis dix ans et dans la diminution progressive du temps de séjour des coopérants.
a) La contraction des effectifs
Etat des effectifs en octobre 2000
(Titre IV)
|
Statut |
Coopérants décret 92 pays de l'ancien champ |
Coopérants décret 67 pays de l'ex « hors champ » |
Coopérants CSN |
|
Fonctionnaires |
866 |
263 |
|
|
Contractuels |
480 |
213 |
|
|
Militaires hors budget |
46 |
||
|
Contrats complémentaires |
27 |
||
|
CSN |
1 306 |
||
|
Total |
1 419 |
476 |
1 306 |
A la veille de la réforme de la coopération, en 1998, les effectifs sur le terrain ne dépassaient pas 1 800 coopérants dans les pays de l'ex-champ et 450 dans les pays de l'ex-hors champ. Ils s'élevaient, au total, rappelons-le, à 23 000 au début des années 80.
Toutes catégories confondues (personnels culturels et scientifiques, chefs de projets, conseillers de ministres, experts, coopérants dans les pays en développement ou les pays « en sortie de crise »), le nombre d'assistants techniques s'élève aujourd'hui à 2.000.
La réduction a été particulièrement forte pour les pays du champ de l'ancien ministère de la coopération qui concentrait la grande majorité des effectifs. Ainsi, dans cette zone, le nombre des coopérants s'est contracté de plus de 30 % sur les quatre dernières années.
Sans doute, le souci légitime d'alléger la coopération dite « de substitution » explique-t-il une part de cette évolution. Mais la contrainte budgétaire a également joué son rôle.
D'après les nombreux témoignages recueillis par la mission, la logique de réduction de la coopération de substitution a été conduite à son terme depuis quelques années déjà et, pourtant, les suppressions de poste se poursuivent. Cette évolution apparaît particulièrement préoccupante, dans la mesure où elle affecte notre capacité d'action dans les pays bénéficiaires de notre aide. Dans beaucoup de pays en développement, en effet, le nombre de cadres formés apparaît encore insuffisant. Par ailleurs, les autres bailleurs de fonds ne procurent pas de véritables alternatives à l'encadrement humain procuré par la coopération française. Par ailleurs, la réduction des effectifs prive notre pays de la possibilité d'assurer, grâce à l'assistance technique, la maîtrise d'ouvrage ou la bonne exécution d'opérations cofinancées avec d'autres bailleurs de fonds internationaux. La France pourrait perdre ainsi progressivement le rôle d'influence et de conseil qui lui est reconnu, du moins dans les pays qui bénéficient traditionnellement de notre coopération. Enfin, la poursuite de la déflation des effectifs interdit de renforcer notre présence dans les pays « hors champ » intégrés désormais dans la zone de solidarité prioritaire.
Il y a déjà deux ans, lors du débat budgétaire devant la Haute Assemblée, le ministre délégué à la coopération avait indiqué que l'assistance technique était à l'étiage. Depuis lors, pourtant, et contrairement à ces engagements, la déflation s'est poursuivie.
Cette évolution apparaît d'autant plus préoccupante qu'elle se conjugue avec la remise en cause de la présence des coopérants du service national (CSN), à la suite de la réforme du service national. Or, les CSN apportaient une compétence très précieuse à la coopération française, en particulier dans des domaines présentant une certaine technicité. En 2000, le nombre des coopérants du service national s'élevait à 238 dans les pays de l'ancien champ. Ils représentent un coût budgétaire annuel de 19 millions de francs (indemnité mensuelle, couverture sociale et voyages).
En principe, les CSN devraient être remplacés par des volontaires. Cependant, la mise en oeuvre de la loi du 14 mars 2000 relative au volontariat soulève encore bien des incertitudes. Pourra-t-on trouver la ressource suffisante en quantité, mais aussi et surtout en qualité, pour pourvoir les postes progressivement libérés par les CSN ? Depuis l'entrée en vigueur de la loi, 1 500 dossiers ont été présentés. 30 % des candidats disposaient d'un niveau de formation bac + 5. Cependant, certains secteurs demeurent déficitaires tels que l'informatique ou la médecine.
b) Le raccourcissement de la durée du séjour
En 1992, dans la zone de l'ancien champ, la durée de séjour des coopérants dans un même pays avait été limitée à six ans. En 2000, le souci d'aligner progressivement le statut de ces personnels sur celui des pays de l'ex « hors champ » a conduit à limiter à quatre ans la durée du séjour et à huit ans la période d'expatriation. L'encadrement du temps de séjour s'avère sans doute nécessaire pour supprimer certaines rentes de situation. Toutefois, une application indifférenciée des règles peut aussi aboutir à priver la coopération française de cadres compétents sur des postes de haute technicité, pour lesquels il n'est pas toujours possible de trouver des remplaçants. En outre, le raccourcissement du temps de séjour provoque aussi une accélération de la rotation des coopérants et rend plus aiguë la question de la réintégration des personnels dans l'administration centrale. La rigidité de l'organisation administrative et des règles statutaires de la fonction publique ne permet que rarement de valoriser les compétences acquises au cours d'une expérience à l'étranger. Aussi, l'accélération des carrières dans la coopération peut-elle également avoir pour effet la dilapidation d'un capital humain précieux.
Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères a estimé devant votre délégation que la durée d'un projet excédait rarement quatre années. Par ailleurs, le renouvellement d'une mission sur un autre projet demeure toujours possible : sur 220 demandes de prolongation en 2001, 200 ont été acceptées par l'administration.
Les difficultés de réintégration ont été particulièrement marquées pour les cadres contractuels de l'assistance technique qui représentent un peu plus du tiers des personnels placés sous le régime du décret de 1992.
c) La mise en place, longtemps attendue, des mesures de titularisation pour certains personnels contractuels
Le principe de la titularisation des contractuels de l'assistance technique avait été posé par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (dite « loi Le Pors »), mais il n'avait reçu qu'une application limitée. Les contractuels de l'assistance technique dans les pays de l'ex champ regroupent quelque 600 personnes. Près de seize ans se sont écoulés avant que les décrets fixant les conditions d'intégration des agents non titulaires puissent enfin être adoptés.
Ces textes, publiés au Journal Officiel du 22 août 2000, fixent les principes suivants :
- la répartition des agents, par corps et par ministère, en fonction de leur expérience professionnelle et de leurs diplômes,
- la mise à disposition au profit du ministère d'accueil des agents concernés dans l'attente des transferts de crédits du ministère des affaires étrangères vers les administrations d'affectation,
- la mise en réserve par les ministères d'accueil des postes nécessaires au réemploi des agents,
- à la date de la publication des décrets, les ayant-droit à la titularisation dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat bénéficient d'un délai d'option d'un an pour faire acte de candidature auprès de leur ministère d'affectation, ce délai étant ramené à six mois pour les agents de catégorie B et C. Les intéressés disposeront ensuite d'un délai d'option d'une égale durée pour accepter la proposition, unique, de titularisation formulée par l'administration, avec indication du niveau de reclassement.
La mise en oeuvre pratique de ces dispositions présente encore bien des incertitudes. Une circulaire du 28 décembre 2000 a, notamment, invité les administrations d'accueil à constituer la réserve d'emplois indispensable à la réalisation de la titularisation des coopérants contractuels. Dans la mesure où aucune création d'emploi n'est envisagée, cette réserve reposera sur les vacances d'emploi des administrations d'accueil ; de nouveaux délais s'imposeront donc nécessairement avant une réintégration effective. Sans doute la circulaire autorise-t-elle la constitution de cette réserve par l'apport d'emplois de catégorie B et C transformés, autant que de besoin, en emplois de catégorie A. Cette faculté conduit cependant à s'interroger sur l'intérêt des fonctions ainsi confiées aux personnels titularisés.
Aussi, si le dispositif réglementaire mis en place au cours de l'année passée fournit une solution administrative quant à la titularisation des ayant-droit « Le Pors », il ne prend pas en compte la valorisation de l'expérience et des compétences acquises.
d) L'absence d'une vision globale sur l'assistance technique
La déflation des effectifs et le raccourcissement de la durée du séjour ont été décidés sans que les pouvoirs publics aient défini une vision claire de l'avenir de l'assistance technique. La réduction du nombre de nos coopérants s'est ainsi poursuivie bien au-delà de ce que pouvait justifier la remise en cause de la coopération de substitution. La limitation du temps de séjour semble avoir obéi à la seule logique de l'uniformisation statutaire. Ces évolutions pouvaient laisser augurer une remise en cause du principe même de l'assistance technique. Ces doutes ont eu pour toile de fond la baisse de l'aide publique au développement et le scepticisme croissant sur l'efficacité de la politique de coopération.
Loin de dissiper les inquiétudes, la réforme de la coopération les a plutôt amplifiées. Le silence observé sur ce volet essentiel de notre action autorisait toutes les conjectures. Le gouvernement n'avait-il pas programmé, sans l'annoncer, la disparition de l'assistance technique ? La poursuite de la déflation des effectifs depuis 1998 pouvait, en tout cas, le laisser croire.
3. les conséquences de la crise
La diminution de l'assistance technique et du temps de séjour conjuguée à l'imprécision des intentions du gouvernement sur l'avenir de l'assistance technique ont été les éléments constitutifs d'une crise dont le vieillissement des personnels apparaît comme l'une des manifestations les plus inquiétantes.
D'après le rapport Nemo, près de la moitié des effectifs présents dans les pays de l'ancien champ atteignent ou dépassent l'âge de 50 ans (60 % de plus de 45 ans, 40 % de plus de 50 ans), moins de 10 % ont moins de 35 ans.
Ces déséquilibres s'expliquent principalement par deux facteurs : d'une part, la déflation des effectifs aurait tari le recrutement à la base plutôt que provoqué le départ des coopérants les plus anciens. D'autre part, les incertitudes liées à la « carrière » d'un coopérant et les difficultés de réinsertion dans le milieu professionnel hexagonal ont aussi joué un rôle dissuasif.
a) Les vacances de poste
Cette crise de vocation permet, par ailleurs, de rendre compte de l'augmentation du nombre de postes vacants -quelque 350 postes n'ont pu ainsi être pourvus en 2000 faute de candidats. Cette situation, il faut le regretter, fournit souvent un argument à Bercy pour procéder à des suppressions supplémentaires d'effectifs.
b) Une crise de confiance
Au cours de ses déplacements, votre délégation a rencontré des coopérants motivés accomplissant un travail souvent remarquable et apprécié de nos partenaires. Il n'en reste pas moins que différents griefs ont été évoqués à plusieurs reprises :
- le manque de cohérence entre la mission confiée et la durée de séjour -souvent trop courte. Cette observation vaut également pour les assistants techniques militaires dont les contrats d'une durée de deux ans paraissent excessivement brefs pour mener à bien la tâche qui leur a été confiée ;
- les incertitudes sur les conditions de la réintégration au sein de l'administration centrale. L'expérience professionnelle à l'étranger n'est pas toujours perçue de manière positive, alors même qu'elle représente un capital précieux qui mériterait d'être valorisé ;
- une concertation insuffisante avec les pouvoirs publics.
A plusieurs reprises, de nombreuses voix se sont fait entendre au sein du Parlement, quelles que soient les sensibilités politiques, pour s'inquiéter du sort réservé à l'assistance technique. Ces inquiétudes ont été entendues. Une réflexion approfondie sur le rôle de l'assistance technique est désormais engagée. Votre délégation a pu obtenir des éclaircissements sur les objectifs des pouvoirs publics dans ce domaine crucial pour notre coopération, même si les incertitudes sont encore loin d'être toutes levées.
4. Un changement de nature de l'assistance technique ?
Les pouvoirs publics paraissent aujourd'hui soucieux de rectifier l'erreur qu'a représentée la sous-estimation du rôle de l'assistance technique lors de la présentation de la réforme de la coopération et de sa mise en oeuvre. Cette prise de conscience s'est traduite en deux étapes : le rapport confié à la fin de l'année 1998 à M. Jean Nemo sur les appuis en personnel dans les actions de coopération et la réunion d'un groupe de travail interministériel sur l'assistance technique. Elle pourrait se traduire par d'importants changements sur lesquels la mission d'information sénatoriale a pu obtenir des informations précises qui faisaient jusqu'à présent défaut. Pour votre délégation, ces orientations qui marquent un tournant important par rapport aux axes traditionnels de notre politique d'aide méritent l'ouverture d'un large débat public.
a) Les propositions du rapport Nemo
Le rapport de M. Jean Nemo présenté en mars 2000 s'appuie sur un vaste travail d'information et de consultation. Il part du constat selon lequel « la grande majorité des pays partenaires disposent dorénavant, dans la plupart des domaines, de cadres suffisamment formés pour qu'il ne soit plus nécessaire de s'y substituer (...). Les besoins et, de plus en plus, les demandes portent maintenant sur un renfort temporaire dans des domaines pour lesquels les partenaires ne disposent ni des traditions, ni des compétences, ni de l'expérience suffisantes ». De ce constat, le rapport déduit quatre principes :
- Le recours à des professionnels dans les différents domaines utiles pour le développement, spécialistes pour lesquels une mission de coopération ne représente, en tout état de cause, qu'une étape dans une carrière.
- La constitution d'un « vivier » de personnes susceptibles de mener une ou plusieurs missions d'assistance technique à un moment donné de leur carrière. Ce vivier suppose, d'abord, un effort de formation spécifique dans le domaine du développement. Il pourrait également reposer, comme l'a suggéré M. Jean Nemo devant votre délégation, sur un cadre institutionnel comparable à ce que représente l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) pour la défense nationale. Par ailleurs, la mobilisation de la ressource nécessaire peut suivre deux voies :
1° La « sous-traitance » à travers la délégation d'actions de coopération à des administrations déconcentrées, des collectivités territoriales, des universités, des établissements publics, voire des entreprises du secteur privé et la mise en oeuvre des mesures incitatives nécessaires (moyens financiers de compenser les « hommes/mois » consacrés au projet ; assouplissement des règles budgétaires d'imputation des crédits).
2° Pour ce qui ne peut être sous-traité, la gestion par le biais de structures ad hoc consacrées à l'« appui en personnel dans les actions de coopération ». Ces structures pourraient échapper aux contraintes administratives traditionnelles, incompatibles avec la souplesse requise par les actions de coopération ; elles permettraient d'assister les opérateurs -y compris les ministères- dans l'organisation logistique de leurs missions et de remplir, en tant que de besoin, une fonction de « portage » des personnels concernés.
Ces recommandations remettent en cause le principe d'une gestion directe par l'administration, dans un cadre réglementaire de droit commun, des personnels chargés d'une mission de coopération.
- La flexibilité tant pour la durée (variable selon les projets -de quelques semaines à plusieurs années) que pour l'organisation (présence d'une équipe sur place, mais aussi nécessité d'un appui logistique et institutionnel en France) ;
- Un dispositif de transition , pour les coopérants actuellement en poste, fondé sur des mécanismes de reconversion (une proportion importante de coopérants peut s'adapter aux types de mission de la nouvelle coopération et bénéficier d'une formation complémentaire), des mécanismes de réinsertion (réouverture des perspectives de titularisation permises par la loi Le Pors), des mécanismes d'encouragement au départ (mise en place d'une prime spécifique).
L'ensemble de ces propositions pourrait s'inscrire dans le cadre d'une loi d'orientation et des textes réglementaires nécessaires.
b) Les propositions du groupe de travail interministériel
Dans le prolongement du rapport confié à M. Nemo, le groupe de travail interministériel sur l'assistance technique a, au cours de l'année 2000, avancé sur une double voie : l'harmonisation entre les statuts hérités de l'ancien ministère de la coopération et de l'ex-DGRCST et la modernisation de l'assistance technique.
. L'harmonisation des statuts
La première orientation privilégiée par le groupe de travail vise à réduire les disparités entre les coopérants -la grande majorité d'entre eux- soumis au décret du 18 décembre 1992 et ceux régis par le décret du ler juillet 1967.
Certains ajustements avaient été apportés l'an passé au régime de 1992 : une réévaluation des majorations familiales au niveau appliqué par le régime de 1967 ; l'alignement de l'évolution des rémunérations sur le mécanisme change/prix de 1967, afin de garantir aux agents affectés dans un même pays une évolution identique de leurs émoluments, en utilisant les mêmes données et en adoptant la même périodicité trimestrielle.
Le ministère des affaires étrangères a décidé de poursuivre ce processus d'harmonisation de sorte qu'au terme d'une période transitoire de trois ans , l'ensemble de l'assistance technique soit placée sous le régime du décret de 1967 , en particulier sur le plan des rémunérations .
Un nouvel arrêté pris sur la base du décret de 1967 précisera les conditions d'emploi des personnels concernés en reprenant à son compte certaines des particularités prévues dans le cadre du décret de 1992 :
- les assistants techniques sont recrutés pour le temps d'une mission d'une durée pouvant varier d'un an à six ans, indépendante du ou des contrats d'emploi ;
- les fonctions de chaque assistant technique sont définies par une lettre de mission, qui précisera son rôle dans le partenariat entre la France et le pays d'accueil ;
- le calcul de la rémunération tiendra compte du niveau de responsabilité.
La mise en oeuvre de cette harmonisation suppose, sur le plan financier, que Bercy donne au Quai d'Orsay la possibilité de réintégrer dans ses moyens d'intervention la retenue logement des coopérants relevant du décret de 1992 (ces derniers, logés dans leur grande majorité, bénéficiaient en effet d'une rémunération qui tenait compte de cet avantage). L'unification du régime de rémunérations pourrait avoir des effets contrastés : elle favorisera les agents de l'éducation nationale mais rendra moins attractive l'expatriation pour les personnels des ministères techniques et des finances qui bénéficiaient statutairement de primes que le décret de 1967 exclut. La coopération risquera de perdre de ce fait, nombre de candidats de valeur .
Le nouveau dispositif présenté au Comité technique paritaire du 27 février 2001 pourrait s'appliquer à compter du ler janvier 2002 aux nouveaux contrats. Le renouvellement des contrats en 2001 est intervenu sur la base du décret de 1992. Toutefois, il semble d'ores et déjà acquis que les assistants techniques relevant du régime de 1992 et dont le contrat arrivera à expiration au ler janvier 2002 -après la mise en place du nouveau système-, ne pourront voir leur contrat renouvelé dans les mêmes conditions au-delà de cette date.
• Une nouvelle assistance technique
La réforme élaborée dans le cadre du Comité interministériel a aussi pour objet d'organiser aux côtés de l'assistance technique traditionnelle, dite « résidentielle », une nouvelle forme de coopération. Cette dernière, d'après les informations communiquées à votre délégation, s'articule autour de cinq axes principaux :
- la prise en compte des situations relativement nouvelles où le savoir-faire français a jusqu'à présent été trop peu mobilisé, telles que les sorties de crise ou la mise en place des programmes européens ou multilatéraux ;
- la diversification de l'origine des assistants techniques non seulement au sein de l'administration mais aussi à travers le recrutement de cadres du secteur privé, de ressortissants des pays bénéficiaires de la coopération française ;
- une capacité de mobilisation rapide de l'expertise nécessaire ;
- la mise en oeuvre de missions dont la durée, variable , se caractérise cependant par une grande brièveté.
Le ministre délégué à la coopération et les responsables de la DGCID ont confirmé à vos rapporteurs que cette forme d'expertise courte viendrait non pas en substitution, mais en complément de l'assistance technique résidentielle (la part de l'expertise courte pourrait représenter le tiers des effectifs de l'assistance technique). Elle portera sur des interventions « ciblées » de plusieurs semaines ou de plusieurs mois de façon parfois fractionnée.
Le nouveau système -inspiré sur ce point des recommandations du rapport Nemo- reposerait sur un opérateur géré selon les règles de droit privé, destiné à prendre en charge toutes les opérations liées à la mise en place de la mission d'expertise (billets, assurance, prise en charge de tous les frais relatifs au séjour dans le pays étranger, éventuellement logistique du séjour, paiement éventuel d'honoraires ainsi que, dans certains cas, remboursement du salaire principal de l'expert). Un tel organisme pourrait également gérer un vivier d'experts. Il est entendu que l'employeur resterait, dans le cas d'un agent public, l'administration d'origine qui pourrait alors recourir à la position de mise à disposition.
Le groupe de travail interministériel a également réfléchi sur les moyens de coordonner ce mode d'organisation destiné à prendre sa place au sein du ministère des affaires étrangères avec les différentes modalités de mobilisation d'expertise utilisées par les autres administrations publiques (mise en oeuvre des structures existantes sous la forme d'un groupement d'intérêt public par exemple ; gestion coordonnée des viviers de compétences...).
Le dispositif devra intégrer les compétences du secteur privé, des associations et aussi de la coopération décentralisée. De même, il pourrait bénéficier à l'ensemble des intervenants qui inscrivent leur action dans une logique d'intérêt général : coopération européenne ou multilatérale, coopération décentralisée.
Le système pourrait être mis en place de manière expérimentale à compter du quatrième trimestre de cette année.
Il peut d'ores et déjà s'appuyer sur une nomenclature budgétaire refondue depuis l'adoption de la loi de finances pour 2001 : en effet, l'intitulé « assistance technique » a disparu pour être remplacé par deux rubriques inédites : d'une part, « transfert de savoir-faire-expertise de longue durée » ; d'autre part, « transfert de savoir-faire-missions d'experts de courte durée ».
Dans la perspective de ces évolutions, les postes ont été sollicités afin d'estimer les besoins qui pourraient être éligibles à la nouvelle forme d'expertise et de prévoir également la durée des contrats de l'assistance technique proposés à compter du 1 er janvier 2002 -un an, deux ans ou trois ans.
De nombreuses questions demeurent cependant en suspens :
- comment garantir le maintien global des moyens de l'assistance technique dont les effectifs, selon l'appréciation du Quai d'Orsay ont atteint l'étiage, voire un niveau inférieur à celui-ci tout en favorisant la montée en puissance progressive d'une expertise de courte durée ?
- comment mobiliser les expertises du secteur privé que l'on juge, à juste titre, indispensables dans le cadre de la diversification des missions de coopération ?
- comment valoriser , pour les agents du secteur public, dans le déroulement de leur carrière, une mission de coopération à l'étranger ?
5. La sauvegarde indispensable de l'assistance technique
A la suite des auditions auxquelles elle a procédé, ainsi que du déplacement accompli à Madagascar et au Kenya, votre délégation a acquis la conviction que l'assistance technique constitue un instrument indispensable de notre coopération, même si cet outil peut et doit être adapté.
Cette adaptation ne justifie cependant pas, aux yeux de vos rapporteurs, un bouleversement majeur du dispositif en place. Elle pourrait reposer sur trois principes.
- La souplesse de gestion ; à cet égard, la mise en place d'un organisme de portage va dans la bonne direction même si, on l'a vu, certaines incertitudes doivent encore être levées ; un mode de gestion souple, à même de mobiliser les compétences au sein des différentes administrations -et naturellement, aussi, du secteur privé- doit s'appliquer non seulement aux missions de courte durée mais aussi aux mission plus longues. La nouvelle structure devrait également prendre en compte, outre l'identification des compétences et leur adaptation aux besoins manifestés chez nos partenaires, les conditions de réintégration des personnels intéressés dans leur cadre d'origine.
Il apparaît aujourd'hui indispensable d'engager une gestion prévisionnelle des emplois : procéder à un inventaire précis des qualifications requises et déterminer ainsi des profils de postes ; évaluer les compétences existantes et favoriser la meilleure adéquation possible entre les personnels et leur affectation ; rechercher les ressources nécessaires dans les autres domaines de spécialité. L'effort de recrutement doit être conduit dans un souci de rajeunissement des cadres de l'assistance technique qui permette de donner toutes leurs chances aux jeunes diplômés. Conformément aux observations déjà présentées par la mission sénatoriale dans la première partie du présent rapport, il serait judicieux d'intégrer l'organisme de portage prévu au sein de l'AFD. Cette formule aurait l'avantage de simplifier la mise en place de cette structure dont le rattachement au ministère des affaires étrangères suppose, en revanche, une adaptation relativement complexe des règles de droit public.
- Le maintien d'une assistance de longue durée ; même si les missions d'expertise de courte durée peuvent se développer à l'avenir, cette progression ne doit pas se faire au détriment d'une assistance longue, aujourd'hui à l'étiage. La durée constitue, rappelons-le, le principal avantage comparatif de la coopération française. C'est pourquoi il est aujourd'hui indispensable de maintenir au minimum le nombre de postes actuels de coopérants.
Il est d'ailleurs significatif qu'au terme d'une enquête conduite dans les pays de l'ex-champ, nos ambassades aient dans leur majorité confirmé leur attachement à une assistance technique résidentielle considérée comme une valeur ajoutée forte de la coopération française.
- Le pragmatisme tant pour l'évaluation de la durée que pour la nature de la mission confiée au coopérant ; la durée devrait être adaptée au projet suivi par le coopérant ; l'application de règles uniformes, alors même que les missions confiées aux coopérant présentent une grande variété, constitue un élément de rigidité dont pâtit notre action. Une plus grande souplesse apparaît nécessaire également pour prendre en compte la difficulté de remplacer certains assistants sur des postes présentant une grande technicité. S'agissant de la nature des missions confiées, il faut admettre, à la lumière de l'expérience, que la coopération de substitution peut encore se révéler utile dans certaines circonstances -sous réserve, bien sûr, qu'elle s'accompagne de l'effort de formation indispensable des cadres locaux.
IV. LES SYNERGIES INDISPENSABLES AVEC LES AUTRES BAILLEURS DE FONDS
Même s'il est indispensable d'enrayer la décrue de l'aide au développement, on ne peut guère espérer, à horizon rapproché, une augmentation substantielle des dotations dans ce domaine. Il convient dès lors d'optimiser les moyens existants. Une première voie, on l'a vu, repose sur une rationalisation des méthodes d'action. La seconde vise à mieux coordonner l'action des différents acteurs du développement. Cet effort ne saurait se limiter aux seules interventions de l'Etat. Il doit prendre en compte plusieurs évolutions fondamentales : l'essor d'une coopération non étatique animée par les collectivités territoriales et les organisations non gouvernementales (ONG) ; le rôle essentiel du secteur privé ; la part croissante prise par le volet multilatéral de l'aide au développement.
Les risques de dilution et d'éparpillement des actions apparaissent sans doute aujourd'hui comme l'une des faiblesses majeures de la politique de développement. Une meilleure articulation des différentes interventions représente dès lors une priorité. Outre une efficacité améliorée de l'ensemble de l'aide, notre pays peut aussi attendre du renforcement de la coordination un effet multiplicateur des orientations qu'il entend privilégier et des moyens qu'il souhaite y consacrer.
A. L'IMPORTANCE CROISSANTE DES ACTEURS NON GOUVERNEMENTAUX DONT LE POTENTIEL DEMEURE ENCORE MAL EXPLOITÉ
La multiplication des acteurs non gouvernementaux, collectivités territoriales et associations pour l'essentiel, apparaît comme l'une des mutations les plus marquantes de la politique de coopération. La réforme a permis de donner une voix à ces nouveaux intervenants avec la mise en place du statut du Haut Conseil de la coopération internationale. Toutefois, le cadre d'une harmonisation aujourd'hui indispensable, manque encore.
1. Le Haut Conseil de la coopération internationale : une réponse au besoin de visibilité des partenaires de la société civile.
Autorité indépendante, rattachée au premier ministre, le Haut Conseil de la coopération internationale se compose de soixante membres représentant la société civile et en particulier, les organisations ayant pour activité principale la solidarité internationale.
Cette nouvelle instance s'est vue assigner trois missions principales :
- il émet et formule des recommandations sur les politiques bilatérales et multilatérales de la France, ainsi que sur l'action des opérateurs privés en matière de coopération internationale ;
- il propose toute mesure de nature à faciliter les échanges sur les diverses actions publiques et services de coopération ;
- il remet chaque année un rapport , rendu public.
Depuis sa création, le Haut Conseil de la coopération internationale a su affirmer sa position dans notre dispositif institutionnel. Il a notamment produit en 2000 quatre avis 7 ( * ) . Il est certainement trop tôt pour apprécier la portée de l'activité du Haut Conseil sur la politique de coopération. Il constitue en tout cas un lieu utile d'échanges et de réflexion et répond au besoin de visibilité d'une société civile dont le rôle n'a cessé de s'affirmer.
2. Les ONG : une action dont l'impact doit être mieux évalué.
Le monde des ONG dans sa multiplicité et sa diversité se laisse difficilement appréhender. D'après le Quai d'Orsay, plus de 800 associations françaises sont impliquées dans des actions de solidarité internationale. De manière plus précise, la coordination nationale des associations de solidarité internationale, coordination Sud, regroupe 107 ONG françaises d'aide au développement et d'action humanitaire. L'apport des ONG est évalué à plus de trois milliards de francs par an.
Les différents entretiens avec les représentants du monde associatif inspirent à vos rapporteurs trois observations principales.
• Un morcellement, source de fragilité
En premier lieu, la fragmentation de ce pôle de coopération limite considérablement son influence et apparaît comme un facteur de faiblesse.
Les ONG forment un ensemble hétérogène où les grandes organisations voisinent avec de nombreuses structures dont le champ d'action apparaît souvent très circonscrit. Cependant, même les associations les plus importantes ne peuvent rivaliser avec les ONG anglo-saxonnes mieux structurées et plus puissantes. A titre d'exemple, les moyens conjugués des plus grandes associations de solidarité internationale françaises demeurent inférieurs aux ressources mobilisées par l'ONG britannique OXFAM. Selon l'avis du HCCI rendu public cette année « sur le nécessaire renforcement de la capacité d'intervention internationale des associations par une amélioration de la fiscalité sur les dons », seules 7 organisations françaises de solidarité internationale réunissent des budgets annuels supérieurs à 200 millions de francs. Il apparaît aujourd'hui nécessaire que les ONG et les pouvoirs publics réfléchissent sur les moyens de conjurer ce morcellement, facteur d'inefficacité. La HCCI pourrait sembler un cadre adapté pour poser les bases d'une plus grande coordination. Mais il faudra sans doute compter avec les inévitables chasses gardées et les concurrences traditionnelles entre ces nombreuses structures.
• Une évaluation indispensable des actions des ONG
Les interventions de ces organisations devraient être mieux évaluées. Si le dévouement des femmes et des hommes engagés sur le terrain force l'admiration, on peut s'interroger sur l'impact d'actions de « micro développement » parfois excessivement ponctuelles. Or, beaucoup de ces associations bénéficiant de subventions souhaiteraient d'ailleurs mettre en oeuvre une part croissante des fonds publics destinés à la coopération.
Aujourd'hui, la part même de l'aide publique qui transite par le secteur associatif reste mal connue. En 2000, le ministère des affaires étrangères a consacré 1,3 milliard de francs aux interventions des acteurs non gouvernementaux (soit 4 % de l'aide publique totale alors que la part de l'APD mise en oeuvre par les ONG dans les pays de l'Union européenne s'élève en moyenne à 12 %) : 405 millions de francs de subventions 8 ( * ) et rémunération de prestations de service d'ONG et collectivités locales pour l'aide au développement, 268 millions de francs de subventions du Fonds de solidarité prioritaire à des associations françaises et étrangères, 24 millions de francs pour des ONG humanitaires auxquels s'ajoutent 52 millions de francs de subventions à la discrétion des ministres et 608 millions de francs au titre de la coopération culturelle (subventions à l'Association française d'action artistique, à l'Association pour la diffusion de la pensée française, à l'Alliance française et au Centre français pour l'accueil et les échanges internationaux EGIDE). En fait, les crédits destinés aux associations autonomes et collectivités locales pour l'aide au développement, au sens strict, représenteraient quelque 700 millions de francs auxquels il convient d'ajouter 85 millions de francs provenant d'autres ministères, soit au total 2,3 % de l'ensemble de l'aide publique au développement .
Si la part dévolue aux ONG dans la mise en oeuvre de l'aide publique demeure plus faible que la moyenne des autres pays, il n'en reste pas moins qu'une augmentation des dotations doit être subordonnée à un contrôle plus rigoureux des dépenses de ces associations .
• Mieux prendre en compte le rôle croissant des ONG internationales
Il apparaît enfin que notre diplomatie n'a peut-être pas encore pris la juste mesure de l'influence des grandes ONG internationales. Celles-ci ont en effet su s'ériger en groupes de pression efficaces auprès du Congrès américain et elles pèsent par ce biais sur les grandes organisations multilatérales dont les ressources dépendent souvent pour une part importante des décisions du Trésor américain. Une institution comme la Banque mondiale peut ainsi être conduite sous l'influence des ONG à fixer des conditions draconiennes à certains types de projets et à les rendre ainsi impossibles. Une doctrine d'action peut ainsi s'imposer à tous les bailleurs.
La capacité de réaction des Etats est compliquée par le caractère parfois imprévisible des thèmes ainsi mis en avant. Plutôt que de subir cet état de fait, les principaux bailleurs et la France en tout premier chef ont tout intérêt à défendre leurs positions auprès de grandes ONG afin d'infléchir leur action dans un sens plus conforme à leurs propres orientations, voire à les utiliser comme un formidable relais d'influence.
3. Les nouvelles responsabilités des collectivités territoriales
L'action extérieure des collectivités territoriales en faveur de l'aide au développement a connu un essor considérable au cours de la dernière décennie : ainsi, la part de l'Etat dévolue au cofinancement des collectivités s'élevait en 1986 à 5 millions de francs pour une cinquantaine de projets de coopération décentralisée ; elle représentait en 1998 56 millions de francs pour quelque 250 projets d'un montant total d'environ 193 millions de francs. Alors même que le développement urbain et la mise en place d'institutions locales démocratiques représentent deux priorités majeures pour nos partenaires, l'expérience des communes, départements ou régions se révèle particulièrement précieuse pour notre politique de coopération.
La place désormais reconnue à la coopération décentralisée appelle toutefois une double observation :
- D'abord, le foisonnement des initiatives mérite sans doute d'être mieux ordonné . Il incombe aux collectivités de chercher les voies et moyens d'agir de manière complémentaire et non redondante. L' échange d'information apparaît à cet égard un préalable. La Commission nationale de la coopération décentralisée 9 ( * ) a été chargée d'établir un tableau de la coopération décentralisée qui recense les opérations par types de collectivités, par pays ou domaines d'intervention. Aux yeux de vos rapporteurs, cet instrument pourrait être utilement complété par un réseau informatique permettant une connaissance actualisée des différents projets envisagés et mis en oeuvre par les collectivités.
- En second lieu, il importe que l'Etat, sous l'effet de la contrainte budgétaire, ne se défausse pas sur les collectivités de ses responsabilités en matière d'aide au développement. La recherche, nécessaire, des synergies ne doit pas se traduire par un transfert de charges. C'est pourquoi la part dévolue par l'Etat aux cofinancements, qu'il convient d'accroître, ne doit pas être financée sur la base de redéploiements de crédits au sein du budget de la coopération mais sur des ressources complémentaires.
4. La nécessité d'une reconnaissance plus affirmée du rôle crucial du secteur privé.
On ne doit jamais l'oublier, l'initiative privée constitue l'un des principaux facteurs de développement . Les investissements de nos entreprises contribuent à la création de richesses, d'emplois, à l'amélioration des conditions de vie et à l'émergence d'une classe moyenne. En outre, la présence des sociétés françaises peut contribuer à diffuser un modèle d'organisation -souci de la rentabilité, respect du droit du travail, de la fiscalité, etc- au sein de la société dans son ensemble et en tout cas agir comme un aiguillon pour une adaptation du cade juridique national. Il n'est pas inutile de le rappeler, quelque 1 300 filiales de sociétés françaises sont établies en Afrique (soit près de 65 % de l'ensemble des entreprises du continent).
Compte tenu de son rôle, le secteur privé s'impose ainsi comme un interlocuteur essentiel de la politique de coopération. Or, les responsables d'entreprises rencontrés par vos rapporteurs ont regretté l'insuffisance de dialogue et l' absence d'instances de concertation avec les représentants du secteur privé. De ce point de vue, la France leur apparaît même en retrait de l'Union européenne. Même si certains progrès ont été accomplis -ainsi le secteur privé a été associé à la Commission mixte franco-malgache chargée de définir en 2000 les grandes orientations de notre coopération avec ce pays- il reste en effet beaucoup à faire pour rapprocher l'administration et les entreprises privées. Du reste, au sein même des ambassades, les relations entre les services de coopération et les postes d'expansion économique apparaissent souvent trop distendues.
Par ailleurs, s'il appartient aux pays en développement de mettre en place un cadre institutionnel et juridique stable, indispensable à la confiance des acteurs économiques, il revient à notre pays d'apporter à nos ressortissants qui prennent le risque de s'expatrier et de parier sur des zones souvent instables certaines garanties . Or, les autorités n'ont pas toujours assumé leurs responsabilités en refusant notamment toute indemnisation pour nos compatriotes victimes d'événements dans lesquels ils n'ont aucune part et qui peuvent laisser certains d'entre eux ruinés.
B. L'INFLUENCE DE LA FRANCE AU SEIN DES ENCEINTES MULTILATÉRALES : ENJEU ESSENTIEL POUR DÉMULTIPLIER L'EFFORT DE NOTRE PAYS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT.
La complémentarité des concours nationaux et des financements multilatéraux apparaît encore insuffisante. Elle peut prendre plusieurs formes telles que la mise en oeuvre de projets conjoints entre la France et les organisations internationales. Cette voie commence d'être explorée : les opérations « bi-multi », selon le jargon en cours, ont été engagées avec le Fonds des Nations unies pour les activités en matière de population -FNUAP- (santé de la reproduction), l'UNICEF 10 ( * ) (santé en milieu urbain et éducation des jeunes filles), la CNUCED 11 ( * ) (préparation à la négociation internationale)... Ces opérations permettent de promouvoir l'expérience et l'expertise françaises dans des pays où nos ambassades ne disposent pas toujours des moyens nécessaires pour instruire des projets d'une certaine ampleur.
Une meilleure articulation des interventions bilatérales et multilatérales dont l'objectif, rappelons-le, vise non seulement à l'efficacité globale de l'aide mais aussi à démultiplier l'action de la France, passe aussi par un renforcement de l' influence française au sein des organisations internationales dont les choix fixent pour une large par les orientations de la coopération.
Comment donner à la France les moyens de peser réellement sur la politique des instances multilatérales ? Tel est assurément l'un des principaux enjeux de notre politique de coopération.
1. Un déficit d'influence française auprès des grandes organisations multilatérales
• Les agences des Nations unies
La part de l'aide française consacrée aux agences du système des Nations unies s'est érodée au cours des dernières années, sous l'effet de la contraction de nos contributions volontaires. En 2000, elle représentait 2,5 %de l'aide publique totale. A cet égard, notre pays se singularise parmi les autres bailleurs plus présents au sein de ces organismes : le Japon fait transiter le tiers de son aide par les Nations unies, le Danemark, 23 %, la Suède, 18 %, les Pays-Bas, 6,5 %, les Britanniques, 5 %. Cet effort financier se conjugue avec une forte présence politique : les ministres anglais et néerlandais interviennent en moyenne tous les trois mois aux Nations unies.
Même si ces structures ont parfois vu leur efficacité mise en cause, en raison notamment de coûts de fonctionnement excessifs, elles présentent néanmoins des avantages indéniables : la neutralité et l'universalité des Nations unies leur confère une crédibilité certaine pour conduire des programmes de renforcement de l'Etat de droit auprès des Etats bénéficiaires ; en outre, la compétence et l'expertise de certains fonds sont avérées dans plusieurs secteurs -santé environnement, commerce.
Notre pays aurait-il intérêt à accroître sa participation financière ? Il est vrai que la France pourrait se satisfaire aujourd'hui du « taux de retour commercial » de ses contributions (à titre d'exemple, en 1998, le PNUD a acheté 14,7 millions de dollars de biens et services -consultants, transports- d'origine française pour une contribution de notre pays de 5 millions de francs, et l'UNICEF 45,2 millions de francs -pour moitié consacrés à des vaccins de l'Institut Pasteur- pour une contribution française totale de 8,7 millions de francs).
Toutefois, la pérennité de cette position n'est en rien assurée. Par ailleurs, envisager notre position au sein de ces agences sous cet angle seul apparaît évidemment excessivement réducteur. La décrue de notre effort financier nous interdit de peser de manière déterminante sur les stratégies des organisations des Nations unies dont les choix sont pourtant d'une grande importance pour l'évolution de l'aide au développement. Le Royaume-Uni, avec son pragmatisme habituel, a du reste, pour sa part, augmenté ses contributions à plusieurs fonds et programmes, en particulier au PNUD. La logique d'influence recherchée, à juste titre, par la réforme de la coopération, risque de rester vaine si elle n'est pas relayée par la mobilisation des moyens financiers correspondants.
• La Banque mondiale
La contribution française à la Banque mondiale représente le double de celle accordée aux agences des Nations unies. La participation de 4,44 % au capital de la Banque confère à la France un siège à part entière au conseil d'administration qui compte 24 administrateurs. Notre droit de vote proportionnel à notre part de capital se compare à celui dont bénéficient le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Ce poids institutionnel indéniable nous permet-il de contribuer à inspirer les choix de cette institution ?
D'après les témoignages recueillis par vos rapporteurs, si la France tient incontestablement son rang -grâce à la qualité de ses administrateurs successifs et au soutien de la Direction du Trésor -sur tous les sujets relatifs aux activités macroéconomiques et financières, elle exerce une influence beaucoup plus limitée sur la définition des stratégies géographiques et sectorielles et des opérations. Le Royaume-Uni -ici encore-, les Pays-Bas ou les pays scandinaves paraissent mieux à même de défendre leurs positions au sein d'une institution où la coordination européenne fait du reste défaut.
Comment expliquer une telle situation ? Pour être effective, l'influence française doit s'exercer très en amont du processus de décision, bien avant la réunion du conseil d'administration. Or, notre administrateur signale régulièrement le manque de réactivité du ministère des affaires étrangères sur les grands dossiers pour lesquels il le sollicite. Comment en serait-il autrement alors que l'énergie des agents de la DGCID demeure trop souvent accaparée par une multiplicité d'opérations au détriment de notre capacité à intervenir de manière continue et cohérente au sein des instances multilatérales. Telle devrait être pourtant l'une des vocations principales de la DGCID.
2. L'union européenne, partenaire majeur
L'Union européenne constitue désormais le partenaire privilégié de notre pays pour la politique d'aide au développement. Les dépenses qu'engage la Communauté, conjuguées avec l'aide française, peuvent en effet présenter une véritable force d'impact dans les pays bénéficiaires. En outre, le poids traditionnel de notre pays au sein de l'Union ainsi que l'importance de sa contribution financière lui donneraient en principe la capacité de peser sur les orientations communautaires au service d'une politique d'aide au développement cohérente et ambitieuse Or, au terme d'une brève mission accomplie le jeudi 14 juin 2001 à Bruxelles, vos rapporteurs, après avoir mieux évalué le rôle de l'aide communautaire, l'effort de rénovation engagé, les progrès qu'il restait à accomplir, ont dû constater que l'influence de la France n'était pas encore à la mesure de son poids politique et financier.
Lors de son déplacement, votre délégation a particulièrement apprécié la qualité de ses échanges avec les fonctionnaires de la Commission. Qu'ils soient ici remerciés pour leur disponibilité.
a) L'impératif de réforme de l'aide européenne
• Le poids de l'Union
L'aide communautaire a plus que doublé au cours de la dernière décennie, passant d'un total de 4,2 milliards d'euros engagés en 1988 à 8,6 milliards d'euros en 1998 (soit 6,8 milliards d'euros pour les pays en développement et 1,8 milliard pour les autres pays). Elle est financée, d'une part, par le budget communautaire (6,5 milliards d'euros en 1999 gérés par la voie de programmes géographiques 12 ( * ) ou thématiques), d'autre part, par le Fonds européen de développement (FED) créé par la convention de Lomé. Ce fonds destiné exclusivement aux 71 pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) est alimenté par des contributions spécifiques de la part des Etats membres.
• Les faiblesses
L'aide européenne souffre d'une faiblesse majeure : l' excessive lenteur des décaissements . Le montant des reliquats sur le FED s'élève à près de dix milliards d'euros -que les Quinze ont décidé d'engager au cours des sept prochaines années, en complément des fonds accordés au titre du neuvième FED (13,5 milliards d'euros). Le volume des crédits engagés mais non décaissés apparaît encore plus élevé pour les zones non couvertes par le FED -principalement l'Amérique latine et la Méditerranée. Il atteignait en effet, fin 1999, plus de 20 milliards d'euros. Les délais de mise en oeuvre des projets peuvent dans certains cas excéder 8 ans.
En fait, 35 à 40 % seulement des ressources disponibles ont été à ce jour dépensés.
A l'initiative du commissaire chargé des relations extérieures, M. Chris Patten, la Commission a tenté de dresser un diagnostic de ces insuffisances.
Elle a d'abord mis en avant l' insuffisance de ses effectifs . Les volumes d'aide communautaire ont été multipliés par 2,8 au cours des dix dernières années, alors même que le nombre de postes supplémentaires n'avait été multiplié que par 1,8. La Commission a dû dès lors recourir à la sous-traitance (l'aide extérieure représente 90 % des dépenses totales de sous-traitance de la Communauté). L'utilisation des bureaux extérieurs n'a pas toujours permis à la Commission d'assurer un contrôle rigoureux de l'utilisation des fonds.
Les retards ne s'expliquent pas seulement par l'insuffisance des effectifs. Ils trouvent également leur origine dans l' extrême complexité des procédures et la lourdeur du circuit de décision . L'action extérieure de la Commission s'appuie en effet sur pas moins de 80 règlements différents et de nombreuses lignes budgétaires. Le nombre de directions générales chargées des relations extérieures est passé de 2 en 1984 à 6 en 1997, avec pour conséquence une dispersion des ressources, le cloisonnement des méthodes, l'affaiblissement des capacités de gestion et la difficulté de définir clairement les responsabilités de chaque service.
La Commission avait admis elle-même que la « gestion est devenue extrêmement complexe et onéreuse en raison de l'hétérogénéité des procédures et l'éclatement ou l'inadéquation des systèmes de communication ».
Ces dérives ont jeté un discrédit certain sur l'aide extérieure communautaire. Une réorientation s'imposait. Les Etats membres et la Commission en ont récemment pris conscience. Ils ont souhaité, en novembre 2000, à l'initiative de la présidence française , jeter les nouveaux fondements d'une politique européenne de développement. Parallèlement, la Commission a engagé un réel effort de rénovation et de rationalisation de la gestion de l'aide extérieure sur lequel vos rapporteurs ont pu recueillir certains éclaircissements lors de leur déplacement à Bruxelles.
• Les nouvelles bases de la politique de développement de l'Union
Une déclaration commune du Conseil et de la Commission, adoptée lors du Conseil « développement » du 10 novembre 2000, a permis de fixer en quelque sorte la charte de l'action de l'Union en matière de développement. Deux orientations majeures se dégagent de ce texte. En premier lieu, il pose pour principe une division du travail entre la Commission et les Etats membres en fonction de leurs avantages comparatifs . Il recentre l'activité de la Communauté sur dix domaines d'intervention prioritaires : le lien entre le commerce et de développement 13 ( * ) , la promotion de l'intégration et des coopérations régionales, l'appui aux politiques macroéconomiques et l'accès équitable aux services sociaux, le développement des moyens de transport, la sécurité alimentaire et le développement rural durable, le renforcement des capacités institutionnelles et de la démocratie. Au vu de cette liste, la Communauté continue d'embrasser, il est vrai, un champ très large d'activités. La définition de vraies priorités représente décidément un exercice difficile. Ce constat appliqué à la politique nationale vaut aussi, on le voit, à l'échelle européenne.
Ce « recentrage » doit, en second lieu, s'accompagner d'un changement de méthode : la recherche d'une coordination et d'une complémentarité accrues entre les opérations des Etats membres et celles de la Communauté, d'une part, entre la Communauté et les autres donateurs internationaux, d'autre part. La déclaration prévoit notamment la « possibilité de déléguer la gestion des crédits communautaires aux Etats membres ou à leurs agences d'exécution en cas de cofinancements, comme le prévoit l'accord interne sur le 9 ème FED ».
Les Quinze ont apporté par ailleurs leur soutien au processus de refonte de la gestion de l'aide extérieure engagé par la Commission.
• La réforme de la gestion de l'aide
La Commission a décidé d'engager en 2000 une réforme de la gestion de son aide extérieure visant trois objectifs principaux :
- réduire de manière significative le temps nécessaire à la mise en oeuvre des projets approuvés ;
- améliorer la qualité de gestion des projets et leur condition de contrôle ;
- renforcer l'impact et la visibilité de la coopération européenne.
Le plan d'action envisagé par la Commission repose sur trois grands volets :
- l'unification de la programmation de l'aide extérieure conformément aux objectifs des politiques de l'Union européenne ;
- le développement d'une culture administrative commune au sein des services de la direction des relations extérieures ;
- la création d'un organe unique, Europeaid, chargé de la gestion du projet depuis l'identification jusqu'à l'exécution et, parallèlement, une plus grande déconcentration de l'aide (tout ce qui peut être mieux géré et décidé sur place, près du terrain, ne devrait pas l'être à Bruxelles). A la fin 2003, les 128 délégations de la Commission dans le monde devraient gérer les programmes d'aide extérieure dans les pays relevant de leur compétence.
La mise en place, en janvier 2001, d'Europeaid constitue incontestablement la pièce maîtresse de cette réforme.
Europeaid a pris la place du Service commun des relations extérieures institué en 1998 pour assurer une exécution plus efficace du programme d'aide aux pays tiers. Le nouvel organisme s'est vu chargé de la mise en oeuvre de 80 % de l'aide extérieure de l'Union (les exceptions concernent les instruments de pré-adhésion tels que Phare, la politique étrangère et de sécurité commune et l'aide d'urgence). Il assure en conséquence la responsabilité de toutes les phases du cycle d'opérations décidées dans le cadre des programmations établies par la direction générale du développement et par la direction générale des relations extérieures : identification et instruction des projets, préparation des décisions de financement, mise en oeuvre, évaluation.
L'Office disposera d'un effectif total de 1 200 personnes. Lorsque le transfert des responsabilités et des personnels vers les délégations sera achevé, la moitié environ de ces personnels sera redéployé vers les délégations.
Europeaid est placé sous la double autorité des commissaires en charge des relations extérieures d'une part, du développement et de l'aide humanitaire d'autre part, l'un et l'autre membres du Comité de direction (respectivement avec le titre de président et d'administrateur général).
La réforme de la Commission inspire quatre séries d'observations.
• Un effet de déstabilisation à court terme
La réforme de la Commission traduit un véritable effort pour corriger les faiblesses du système d'aide communautaire. Il est encore trop tôt pour juger les conséquences d'un processus qui en est encore à ses prémices. Cependant, les délais nécessaires à la mise en place du nouvel Office risquent de se traduire dans un premier temps par des retards supplémentaires dans les décaissements des fonds communautaires.
La gestion de l'aide extérieure est soumise depuis quelques années à un processus de transformation continue. Un premier effort de rationalisation de l'aide avait ainsi été entrepris en 1998 avec la création du service commun des relations extérieures . A peine cette structure commençait-elle de produire les premiers résultats sous la forme d'une amélioration des niveaux de décaissement dont les statistiques pour 2001 devraient porter le témoignage qu'elle doit céder la place à l'office Europeaid. Les experts s'attendent ainsi à de nouveaux délais. Sans doute le souci de renforcer l'efficacité de l'aide communautaire ne peut que recueillir l'assentiment, mais il apparaît aujourd'hui indispensable que le dispositif se stabilise et devienne rapidement opérationnel.
• Le chantier de la simplification
En second lieu, l'efficacité de l'aide communautaire dépendra, dans une large mesure, de la simplification des procédures. Or, le chantier est immense : 27 000 contrats en cours dans 132 pays avec 2 000 appels d'offre par an ; 70 lignes budgétaires sur quelques 87 bases juridiques différentes. Plusieurs de ces lignes ont été créées sous la pression du Parlement européen. Cette multiplicité est source de lourdeurs bureaucratiques et de nombreux délais. Quelques progrès ont d'ores et déjà été accomplis ; ainsi le nombre de procédures de passation de marché est passé en deux ans de 80 à 8... Mais c'est, aujourd'hui, l'architecture d'ensemble des lignes budgétaires qui doit être revue.
Un effort de simplification et de rationalisation particulier doit porter sur les relations nouées entre la Commission et les ONG . L'aide versée à ces dernières dépasse 200 millions d'euros par an. Cependant, le nombre des dossiers traités par les services de la Commission -de l'ordre du millier- ne leur permet pas toujours d'assurer un contrôle rigoureux des fonds.
En outre, les conditions d'éligibilité d'une ONG à l'aide communautaire restent très ouvertes -une ONG doit être légalement enregistrée et bénéficier d'une certaine notoriété. Cette dernière condition se prête à une marge d'appréciation très large. Lié à la diversité des droits nationaux en matière d'association, ce cadre souple conduit parfois à accorder une aide à des organisations dont la vocation ne correspond pas aux objectifs poursuivis par l'Union.
• Les interrogations soulevées par l'augmentation des effectifs et le renforcement du rôle des délégations de l'Union.
La réforme de l'aide communautaire reposera sur une déconcentration, sous la responsabilité d'Europeaid.
Le renforcement du rôle des délégations de l'Union représente, on l'a vu, un axe fort de la réforme. Il reposera sur une déconcentration, organisée sous les auspices d'Europeaid, vers les délégations de l'ensemble des opérations qui peuvent être mieux gérées sur place, ainsi que sur une augmentation progressive de leurs effectifs . En effet, la Commission procédera à la création de 400 postes supplémentaires dont 250 pour la direction des relations extérieures -en raison de la mise en place d'Europeaid. Dans un deuxième temps, sur une période de 3 ans, 600 fonctionnaires seront redéployés vers les délégations. Jusqu'à présent, le manque de moyens humains sur le terrain pouvait constituer pour l'Union une incitation assez forte à recourir aux services des Etats membres, favorisant ainsi la recherche des complémentarités. Désormais dotée de ressources nécessaires, ne sera-t-elle pas conduite à mener seuls les projets qu'elle finance ? On peut craindre que l'extension du rôle des délégations ne complique plus qu'il ne favorise l'indispensable effort de coordination.
Le Conseil « affaires générales » du 22 janvier 2001 a certes fixé des lignes directrices pour le renforcement de la coordination sur le terrain entre les Etats membres de la Commission -réunions régulières, coordination appliquée à toutes les étapes non seulement de la programmation mais aussi des projets, désignation, le cas échéant, d'un « chef de file » pour suivre la coordination dans un secteur particulier. Le Conseil avait déjà adopté en 1998, des orientations sur le renforcement de la coordination opérationnelle. La réitération, trois ans plus tard, des mêmes principes montre la difficulté de l'exercice.
• La définition de priorités
L'action communautaire a souffert jusqu'à présent d'une dispersion préjudiciable à son efficacité. Le commissaire européen en charge des questions de développement, M. Poul Nielson, a tenu à cet égard à votre délégation des propos dont la franchise tranche avec le langage convenu trop souvent de règle dans ces enceintes : « on a voulu tout faire ou on a fait semblant de le faire ». Il a mis en avant certains goulots d'étranglement dans la mise en oeuvre des projets sur le terrain ; l'augmentation des ressources financières ne changerait rien à cette situation. L'exemple de la santé apparaît particulièrement significatif : les projets dans ce domaine ont fini par représenter sur cinq ans 1,7 million d'euros. Pourtant moins du quart de ces sommes a été effectivement dépensé. La définition de priorités n'a pas beaucoup avancé, comme l'a reconnu M. Poul Nielson. Elle permettrait seule pourtant de mettre en évidence les secteurs dans lesquels les interventions communautaires peuvent s'avérer le plus efficace.
La volonté de recentrer l'activité de l'Union sur les six domaines où elle offre une valeur ajoutée permettra-t-elle d'avancer dans cette voie ? Incontestablement elle marque une prise de conscience par les Etats membres et la Commission des risques d'un éparpillement excessif. On l'a vu cependant, le champ ouvert à la Communauté demeure très large. En outre, il recoupe sur plusieurs aspects les priorités que la France a assigné à sa politique de développement, qu'il s'agisse de l'intégration et de la coopération régionale, de l'accès équitable aux services sociaux ou encore du développement rural durable. Enfin, comme l'a souligné le commissaire européen devant vos rapporteurs, l'Union n'entend pas se laisser enfermer dans le rôle de simple payeur, voué aux projets les plus dispendieux. Elle souhaite faire prévaloir une démarche plus exigeante : « On ne veut pas payer des coûts récurrents ».
L'accroissement des moyens des délégations concourra à cette nouvelle ambition. Une fois encore la perspective de transformation des délégations en véritables missions de coopération, loin de favoriser les complémentarités, risque d'aiguiser la concurrence avec les représentations nationales. Trop souvent, l'Union européenne est perçue par les bénéficiaires comme un seizième Etat membre. L'action communautaire doit être encore plus sélective. Compte tenu des compétences reconnues à la Commission dans le domaine des négociations commerciales, elle pourrait ainsi privilégier l'intégration des pays en développement dans l'économie mondiale (coopération dans les domaines liés au commerce et à la préparation aux négociations multilatérales).
b) Les responsabilités particulières de la France
Comment mieux articuler l'aide européenne et la politique de développement française ? Cette question met en jeu non seulement l'efficacité globale de l'aide mais aussi la capacité de donner un prolongement européen aux priorités qu'entend défendre la France en matière de développement et, singulièrement, le maintien d'un flux d'aide substantiel à l'Afrique subsaharienne.
La réponse dépend dans une large mesure de l'influence qu'exerce notre pays sur l'organisation de l'aide communautaire. Certes, le poids de notre pays se retrouve dans les grandes orientations -il a été déterminant, par le passé, pour établir un lien durable entre la Communauté et les Etats ACP ; il s'est manifesté de nouveau avec la signature de l'accord de Cotonou en 2000 destiné à remplacer les accords de Lomé afin de préserver une relation privilégiée avec cette zone et maintenir le volant d'aide que plusieurs Etats membres voulaient revoir à la baisse.
En revanche, l'influence de notre pays dans le circuit de décision, au quotidien, des instances communautaires paraît plus modeste et ne semble en tout cas pas à la mesure de sa contribution financière .
• La France, premier contributeur de l'aide européenne
La participation française à l'aide européenne représente actuellement 14 % du montant total de notre aide publique au développement contre 11 % en 1994. Cette évolution s'explique principalement par l'importance de la quote-part française -24,3 %- au Fonds européen de développement qui place notre pays au premier rang des contributeurs européens.
A l'occasion des discussions relatives au financement du neuvième FED dans le cadre des accords de Cotonou signés le 23 juin 2000, notre pays aurait souhaité un rééquilibrage de sa clé de contribution dans un sens plus conforme à sa part dans le budget communautaire.
Pour préserver l'enveloppe destinée aux pays ACP, contestée par une partie de nos partenaires européens, la France a cependant dû consentir, à l'heure où elle prenait la présidence de l'Union, au maintien des clés de répartition.
Toutefois, la Commission a récemment fait part de son intention de soumettre au Conseil avant 2003 un examen des avantages et des inconvénients d'une budgétisation du FED. L'intégration de l'aide aux pays ACP au sein du budget communautaire permettrait un partage des charges proportionnel aux participations des Etats membres au budget et donc une répartition plus équitable que celle retenue dans le cadre d'un fonds dont les dotations doivent régulièrement être renégociées.
La relative inefficacité de l'aide communautaire dont témoigne la part considérable des engagements non liquidés a conduit certains à se demander s'il était opportun pour la France de maintenir son effort financier et s'il ne serait pas plus efficace de privilégier le canal bilatéral. Le rapport de M. Yves Tavernier au Premier ministre 14 ( * ) s'est fait l'écho de cette interrogation : « l'Europe n'est pas à la hauteur de ses engagements et de ses responsabilités. Son cadre fonctionnel, sa bureaucratie centralisée, ses lourdeurs procédurières et ses contradictions limitent son influence dans le débat sur les valeurs, les objectifs et les moyens. La France, premier contributeur au FED, est en droit de s'interroger sur la lisibilité et l'efficacité de sa dotation ».
• Les conditions d'une influence accrue
Le renforcement de l'influence française peut prendre différentes formes. Mais il apparaîtra d'autant plus efficace qu'il respectera une certaine discrétion et s'appuiera sur les procédures de décision traditionnelles.
Il est possible et souhaitable en premier lieu d'étendre les délégations de crédit comme le permet le neuvième FED sur la base de procédures qu'a encouragées, comme on l'a vu, la déclaration commune du Conseil et de la Commission de novembre 2000. L'AFD a déjà participé à des dispositifs de ce type : elle a signé deux accords financiers lui déléguant la gestion de crédits multilatéraux : ligne de financement de projets PME/PMI pour le compte de la société financière internationale (20 millions de dollars), facilités de refinancement PROPARCO pour le compte de la Banque européenne d'investissement (20 millions d'euros). En juin 1999, l'AFD et la Commission ont signé un protocole d'accord relatif au cofinancement, à la gestion de projets, d'échanges de personnels, de rapprochement des procédures et d'évaluation conjointe des projets. La généralisation de ce dispositif peut toutefois rencontrer certains obstacles : on a déjà dit la réticence de la Commission à jouer le rôle de simple guichet ; en outre, nos autres partenaires européens dont beaucoup restent faiblement représentés dans les pays de la zone ACP soupçonnent parfois la France de privilégier ses intérêts diplomatiques et économiques. Les services de la Communauté leur apparaissent comme une garantie utile de neutralité. C'est pourquoi, la voie des délégations de crédit, qu'il convient de développer, doit être utilisée avec un souci constant d'explication et de transparence de la part de notre pays tant vis à vis de la Commission que des autres Etats membres.
Aussi conviendrait-il de ne pas négliger l' influence indirecte qui peut s'exercer en amont du processus de décision auprès des cadres de la Commission. Le Royaume-Uni est passé maître dans un exercice destiné à influer sur les « décideurs » communautaires, à les convaincre si bien de la pertinence de ses positions qu'ils les font leurs. Cet exemple devrait être médité par la France. D'après les témoignages recueillis par votre délégation auprès de hauts fonctionnaires de la Commission, les Britanniques procurent aux services communautaires des dossiers d'information très documentés et des analyses qui contribuent à nourrir leur réflexion. Plus encore, au cours de 2001, ils ont adressé à une cinquantaine de fonctionnaires de la Commission un document intitulé « Comment influencer l'aide communautaire ? » et organisé par la suite des réunions individuelles avec chacun des destinataires. Les interlocuteurs de vos rapporteurs ont reconnu que ces efforts, conduits intelligemment, avaient pour résultat une certaine imprégnation des choix communautaires par les idées britanniques. La France a-t-elle suffisamment réfléchi à ce type de démarches comme elle y aurait intérêt ?
CONCLUSION
La réforme doit être jugée à l'aune des cinq principaux objectifs qu'elle s'était fixés : la recherche d'une plus grande cohérence au sein de notre instrument diplomatique ; une meilleure coordination entre les différents acteurs de la politique d'aide française ; une véritable sélectivité de notre aide ; le maintien de « flux substantiels d'aide publique au développement » ; enfin, une efficacité renforcée de notre action sur le terrain.
Or, sur ces cinq grands thèmes, les résultats ne paraissent pas encore à la mesure des ambitions .
A. CINQ CONSTATS PRINCIPAUX
1. Une cohérence problématique
L'absorption des services du Secrétariat d'Etat à la coopération par le Quai d'Orsay avait pour vocation d'assurer une plus grande complémentarité entre l'action diplomatique et la politique de coopération.
Cette ambition s'est traduite sur le plan institutionnel par la création d'une nouvelle direction générale au Quai d'Orsay -la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) qui réunit dans un même ensemble les attributions de l'ancienne direction du développement de la rue Monsieur et celles de l'ancienne direction générale des relations culturelles et scientifiques (DGRCST) du ministère des affaires étrangères.
Un bilan de trois ans de fonctionnement de la DGCID appelle un triple constat.
- D'abord, la DGCID représente un ensemble institutionnel très lourd du fait de l'étendue de ses compétences qui va de la promotion de l'audiovisuel en Amérique du Nord à la lutte contre le SIDA en Afrique centrale, du fait aussi des procédures de décision complexes et du poids de ses effectifs.
- Ensuite le brassage des cultures diplomatique et de coopération n'a reçu qu'une application limitée. Il n'a vraiment fonctionné que dans un sens. Si plusieurs diplomates se sont investis dans les actions de développement, très peu des personnels issus de la coopération se sont vu affectés à des postes diplomatiques. De là ce sentiment « d'absorption » de la coopération par le quai d'Orsay dont plusieurs des interlocuteurs de la délégation sénatoriale se sont fait l'écho.
- Enfin, la réforme avait pour objectif de renforcer notre politique de coopération grâce à notre influence diplomatique et réciproquement. Or elle risque d'affaiblir l'une et l'autre. D'un côté, comme l'a d'ailleurs reconnu l'un des inspirateurs de la réforme, l'énergie des agents de la DGCID est accaparée par la mise en oeuvre d'une multiplicité d'opérations , au détriment de notre capacité à intervenir de manière méthodique et persévérante dans les instances multilatérales. De l'autre côté, la somme de compétences souvent remarquables réunies en matière de coopération n'a pas été valorisée comme elle l'aurait mérité. En outre, et c'est peut-être encore plus grave, ce vivier d'expertises risque de se tarir car les règles statutaires du Quai d'Orsay ne favorisent ni les détachements, ni l'emploi de contractuels. Or l'aide au développement requiert des spécialités pointues -médecine, économie, agronomie...- qui ne se trouvent pas au ministère.
2. Une coordination encore insuffisante
La multiplicité des responsabilités dans le domaine du développement a souvent été cause de dispersion et donc d'inefficacité. Un effort de coordination s'imposait mais il rencontre de difficultés.
- A l' échelon gouvernemental , le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) n'est pas en mesure de jouer le rôle d'impulsion qui lui incombe. En outre, même si la part respective des ministères des finances et des affaires étrangères tend à se rééquilibrer, le poids déterminant de Bercy sur des aspects décisifs de notre politique de coopération inscrit les relations entre les deux administrations davantage dans le cadre d'un rapport de forces que d'un partenariat réel.
- Sur le terrain , le souci d'une coordination plus efficace s'est traduit par un renforcement de l'autorité de l'ambassadeur . La transformation des missions de coopération en service de coopération et d'action culturelle a atténué le risque de « dyarchie » -ambassadeur, chef de mission- au sein de nos représentations. En outre, l'ambassadeur est désormais appelé à donner son avis d'opportunité sur les projets mis en oeuvre par l'AFD.
Toutefois, il semble que l'AFD continue de conduire ses projets d'une manière indépendante et considère encore l'avis de l'ambassadeur comme théorique.
3. Les faux-semblants de la sélectivité
La réforme de la coopération s'est aussi traduite par la création de la zone de solidarité prioritaire dans laquelle doit se concentrer l'aide bilatérale française afin de répondre à l'objectif de « sélectivité ». Définie sur la base de critères larges, la zone a permis d'inclure 61 pays alors que l'ancien champ de notre politique de coopération, avant 1998, se « limitait » à 37 pays. On peut se demander si l'objectif de concentration est vraiment atteint...
Le choix français apparaît d'autant plus paradoxal qu'il ne s'est accompagné d'aucune augmentation des moyens budgétaires . Plus encore, la part de la ZSP au sein de l'aide totale apportée par la France n'a cessé de se dégrader depuis la réforme de la coopération, passant de 50 % à 44 %.
Ce décalage entre les ambitions et les moyens ne met pas seulement en cause la cohérence interne de la réforme. Il soulève un double risque. Risque d'inefficacité d'abord : l'application de moyens réduits à un plus grand nombre de pays peut entraîner la multiplication d'opérations peu significatives, l'éparpillement, la dispersion et finalement la dilution de notre aide. Risque politique ensuite ; en effet, l'espoir suscité dans certains pays par leur incorporation dans la zone de solidarité prioritaire peut être déçu et nourrir une certaine amertume vis-à-vis de la France tandis que certains des anciens pays du « champ » appréhendent la banalisation de nos relations bilatérales. A vouloir être présent partout, ne risque-t-on pas de ne compter nulle part ? L'influence de la France n'a rien à gagner à cette dispersion.
4. L'érosion des moyens
Le maintien de « flux substantiels » d'aide au développement constituait l'un des objectifs de la réforme. Or l'aide publique au développement française n'a cessé de se réduire depuis 1994 même si cette contraction semble enrayée depuis 1999.
S'agissant de l'aide qui transite par le Quai d'Orsay, on peut craindre que la fusion des budgets de l'ancien secrétariat d'Etat à la coopération et du ministère des affaires étrangères ne favorise un glissement des crédits de l'aide au développement vers d'autres priorités . L'exemple du Fonds de solidarité prioritaire qui est l'instrument privilégié de l'aide-projet, paraît à cet égard très significatif. Il a permis dans la période récente de financer des opérations dans la région des Balkans alors que cet instrument a vocation à bénéficier à la zone de solidarité prioritaire. L'aide-projet apparaît donc aujourd'hui sérieusement menacée.
5. Une efficacité subordonnée pour une large part par l'avenir de l'assistance technique.
La réforme a ignoré, dans un premier temps du moins, l'un des instruments privilégiés -et sans doute le plus original- de la coopération française : l'assistance technique . Notre pays est en effet le seul à avoir pris en charge la présence sur le terrain d'assistants techniques chargés de superviser un projet pour une durée rarement inférieure à deux ans. A l'expérience, le modèle français a montré ses atouts. Le professionnalisme des coopérants est d'ailleurs apprécié par les autres bailleurs eux-mêmes qui considèrent souvent leur présence comme une garantie pour le bon emploi de l'aide qu'ils financent.
Depuis plusieurs années pourtant l'assistance technique est en proie à un malaise certain dont la délégation sénatoriale a reçu beaucoup de témoignages. Cette crise est d'abord liée à la réduction drastique des effectifs passés de 20 000 à 2 000 en dix ans ... Cette contraction, d'abord justifiée par le souci légitime de mettre fin à une coopération de substitution qui, dans plusieurs pays, n'avait plus de raison d'être, s'est poursuivie bien au-delà de cet objectif, avec la suppression de postes d'assistance, de soutien et de conseil. La poursuite de cette évolution, conjuguée au silence des autorités sur la place qui revenait aux coopérants dans le nouveau dispositif institué par la réforme de 1998, a pu faire craindre une disparition programmée de l'assistance technique .
B. CINQ PROPOSITIONS POUR UNE COOPÉRATION RÉNOVÉE
Les propositions de vos rapporteurs répondent à deux motivations essentielles :
- renforcer l' efficacité en allant au bout de la logique de la réforme en créant une grande agence de développement ;
- renforcer la légitimité de l'aide aux yeux de nos concitoyens, ce qui à terme constitue le meilleur gage de la pérennité de notre action dans ce domaine.
Dans cette perspective, il importe d' impliquer davantage le Parlement dans les choix adoptés par les pouvoirs publics en matière de coopération.
Dans ce cadre, ces propositions s'articulent autour de cinq grands axes :
1. Parachever la réforme en créant une grande Agence de développement
La diplomatie et le développement sont deux métiers différents . Leur spécificité doit être reconnue. Si ces deux activités apparaissent à bien des égards complémentaires, cette complémentarité n'implique pas nécessairement qu'elles soient fusionnées au sein d'un même ensemble.
La spécificité du développement suppose une grande diversité de formations et donc un cadre institutionnel souple . A cet égard l'exemple britannique doit être médité : le Royaume-Uni a en effet suivi une option aux antipodes du choix français : il a retiré au Foreign Office ses responsabilités en matière du développement et créé un nouveau département ministériel confié à un secrétaire d'Etat chargé de la coopération. Cette nouvelle structure a été affranchie des règles propres à la fonction publique afin de bénéficier d'une grande souplesse de recrutement .
La France dispose avec l' Agence française de développement dotée du statut d'établissement public, d'une structure souple à même de faire appel à des compétences diversifiées. En outre, l'Agence française de développement a vu ses attributions étendues par la réforme aux infrastructures dans les secteurs sociaux. Pourquoi ne pas aller au bout de cette logique et confier à l'AFD l' ensemble des projets d'aide au développement ? La culture de projet est en effet commune aux agents de l'Agence française de développement et à ceux de la coopération. C'est pourquoi vos rapporteurs plaident pour une grande agence de développement .
Deux pôles seraient ainsi constitués : d'une part, autour de l'Agence française de développement, un pôle développement - réunissant aux compétences actuelles de l'AFD celles dévolues aujourd'hui à deux sous-directions de la DGCID : développement économique et de l'environnement, développement social- d'autre part, autour de la DGCID, un pôle diplomatie d'influence appuyé notamment sur les outils traditionnels de la coopération culturelle et la francophonie .
L'Agence doit rester un organe d'exécution. La préparation et l'élaboration des grandes orientations de notre politique de coopération incombent au Quai d'Orsay. La DGCID devra ainsi participer de manière déterminante au cadrage des priorités géographiques et sectorielles de notre aide. De même, dégagée de toute fonction d'exécution, elle pourra se concentrer sur sa mission prioritaire de préparation des grandes réunions internationales dans le domaine du développement afin de mieux défendre les positons françaises.
Cette réorganisation suppose que trois conditions soient satisfaites : le maintien de « passerelles » entre les personnels du Quai d'Orsay et ceux de l'Agence afin que les fonctions de conception puissent être nourries en permanence par les leçons de l'expérience ; une adaptation importante des structures de l'AFD dans le sens, notamment, d'une plus grande déconcentration et un renforcement de la tutelle du ministère des affaires étrangères sur l'AFD.
D'une manière générale, le contrôle politique sur l'agence doit être renforcé. Le Parlement devrait être mieux représenté au sein du Conseil de surveillance.
2. Un renforcement de la coordination à travers la réaffirmation du rôle déterminant du Quai d'Orsay dans la définition des grandes orientations de l'aide
Il importe de rappeler qu'il appartient au ministère des affaires étrangères et non à Bercy de conduire notre politique de coopération. Cette prééminence peut se traduire sous deux formes : d'abord une part accrue des dotations consacrées au développement doit figurer au budget du Quai d'Orsay. A cet égard, l'inscription des crédits du Fonds européen de développement au budget du ministère des affaires étrangères dans le projet de loi de finances pour 2002 va dans le bon sens. Ensuite, la tutelle du Quai d'Orsay sur l'AFD doit recevoir une application effective : en particulier la consultation de l'ambassadeur sur les projets de l'AFD doit revêtir la forme d'un avis conforme.
Par ailleurs, l'impératif de coordination ne vaut pas seulement au sein même de l'appareil administratif. Il s'inscrit désormais dans un cadre beaucoup plus large. Il faut en effet tenir compte à l'échelle nationale des nouveaux acteurs du développement et, à l'échelle internationale, des institutions multilatérales , au premier rang desquelles l' Union européenne . A cet égard, vos rapporteurs présenteront quatre séries d'observations.
1° Les ONG françaises impliquées dans le développement, soit quelque 800 associations, souffrent de leur morcellement . Beaucoup de ces ONG souhaitent qu'une part plus importante de l'aide publique au développement transite par leur intermédiaire . Mais une telle évolution ne serait possible que si un contrôle plus approfondi de ces organisations était mis en place, qu'il s'agisse de leur ressource, de leur gestion et de leur action. Or aux côtés d'associations qui mènent un travail admirable, certaines ont une activité plus opaque. Un effort de transparence et d' évaluation s'impose aujourd'hui.
2° La coopération décentralisée joue désormais un rôle croissant dans l'aide au développement. Cette évolution positive mérite d'être encouragée même si elle ne doit pas servir de prétexte à un désengagement de l'Etat . Le foisonnement d'initiatives mérite sans doute d'être mieux ordonné. Un réseau informatique permettant une connaissance des différents projets envisagés et mis en oeuvre par les collectivités constituerait une première étape.
3° Acteurs essentiels de l'aide au développement, les entreprises ne doivent pas être les oubliées de la politique de coopération. La mise en place d' instances de concertation entre l'administration et les représentants du secteur privé s'impose aujourd'hui.
4° Les institutions multilatérales constituent des interlocuteurs privilégiés pour la coopération française. Or la mission a dû constater un déficit d'influence française au sein de ces grandes organisations. Recentrer la DGCID sur une stratégie délibérée d'influence au sein des institutions multilatérales constitue donc une priorité.
Le constat d'un déficit d'influence vaut aussi paradoxalement pour l' Union européenne alors que la France est le premier contributeur du Fonds européen de développement. Les fonctionnaires de la Commission ont indiqué à vos rapporteurs que le Royaume-Uni défendait mieux ses positions auprès de la Commission que la France.
Deux voies mériteraient d'être explorées de manière plus systématique : d'abord favoriser le mécanisme de la délégation de crédits communautaires aux organismes français de coopération afin de renforcer l'efficacité de l'aide et de mieux valoriser l'expertise technique française. Ensuite, mieux informer les services de la Commission sur les positions françaises.
3. Définir plus clairement les priorités géographiques et sectorielles de notre aide
En principe, il revient au CICID de fixer les priorités géographiques et sectorielles de notre aide. Mais cette instance ne joue pas vraiment son rôle d'impulsion. Le principe d'une instance de décision interministérielle demeure indispensable mais elle devrait prendre la forme d'une structure plus légère, appelée à se réunir à échéance régulière.
Aujourd'hui, il serait nécessaire de procéder à un recentrage de nos actions sur un cercle plus restreint de pays dont la composition peut d'ailleurs varier sur le moyen terme au regard des résultats obtenus. Quant aux modalités de choix, il est nécessaire -compte tenu des enjeux soulevés pour notre diplomatie- qu'elles fassent l'objet d'une consultation préalable du Parlement.
4. Stopper la baisse des moyens et renforcer la prévisibilité de l'aide
Sans doute l'objectif de consacrer 0,7 % du revenu national à l'aide au développement, fixé par les conventions internationales, apparaît-il hors d'atteinte. Il n'est d'ailleurs respecté par aucun pays. Il semble plus réaliste et plus pertinent de préserver le flux d'aide actuel et d'axer la réflexion sur les moyens de dépenser mieux et de manière plus efficace les fonds existants . L'une des conditions de cette efficacité est la prévisibilité des ressources consacrées à l'aide. En effet, différer une action ou, pire encore, la suspendre en cours de déroulement, c'est bien souvent la compromettre définitivement.
Une programmation pluriannuelle indicative constituerait un gage d'efficacité. Une loi de programme fournirait également un signal politique fort vis-à-vis de nos partenaires, d'une valeur au moins comparable à un objectif fixé par rapport au PIB.
On peut craindre par ailleurs que l'effort considérable engagé par la France dans le cadre de l' allégement de la dette pour les pays les plus pauvres n'ait pour contrepartie une nouvelle diminution des moyens consacrés à l'aide-projet.
Deux observations sur ce point :
- il faudra s'assurer, comme les bailleurs de fonds s'y sont engagés, que l'effort de réduction de la dette viendra non pas en substitution mais en complément de l'aide au développement ;
- il conviendra également de mettre en place les dispositifs nécessaires pour contrôler l'utilisation des ressources dégagées par les annulations de dette. L'initiative en faveur des pays très endettés doit être mise à profit, en particulier pour renflouer les systèmes sociaux, aujourd'hui défaillants, et leur permettre d'honorer les engagements qu'ils ont contractés non seulement vis-à-vis de leurs nationaux, mais aussi de nos compatriotes.
5. Redonner à l'assistance technique un rôle majeur dans le dispositif de la coopération
L'annonce tardive, en 2001, d'une réforme de l'assistance technique n'a permis de dissiper qu'une partie des inquiétudes relatives à ce volet primordial de notre aide au développement : l'intérêt de l'assistance technique dite « résidentielle » a été réaffirmé ; parallèlement, le gouvernement entend instituer une expertise de courte durée qui pourrait se révéler en effet plus adaptée dans certaines circonstances. Il paraît important aujourd'hui de rappeler trois principes essentiels pour l'assistance technique : la pérennité , la souplesse , la diversité .
- La pérennité d'abord :
L'assistance technique, dite résidentielle, doit être maintenue . Consultés par le Quai d'Orsay sur l'avenir des coopérants, tous nos postes dans les pays en développement ont confirmé que la présence sur une certaine durée d'experts constituait la vraie valeur ajoutée de la France. Or compte tenu d'une enveloppe budgétaire contrainte, on peut craindre que la montée en puissance des missions de courte durée se fasse au détriment de l'assistance technique classique. Il faut donc que les expertises courtes restent résiduelles .
Faut-il rappeler aussi que la Commission européenne entend, comme la délégation sénatoriale l'a appris à Bruxelles, renforcer ses effectifs sur le terrain. L'assistance technique n'appartient donc pas au passé, c'est une forme d'action d'avenir.
- La souplesse ensuite :
Le statut, les conditions d'activité des coopérants ne doivent pas être alignés sur les règles rigides de la fonction publique. Il paraît en particulier essentiel de mieux ajuster la durée du séjour du coopérant sur la durée du projet dont il a la charge . Trop souvent en effet, un coopérant doit quitter son poste avant d'avoir achevé sa tâche.
- La diversité enfin :
Il faut ouvrir l'assistance technique le plus largement possible, non seulement sur l'ensemble des administrations techniques intéressées mais aussi sur le secteur privé. Parallèlement, trois orientations s'imposent : d'abord mieux connaître les besoins et dresser en conséquence des profils de poste détaillés, ensuite mener une politique dynamique de recrutement en direction des spécialités recherchées, enfin valoriser l'expérience accomplie sur le terrain dans le déroulement des carrières. Il y a là un vaste chantier dont les orientations pourraient figurer dans une loi-cadre .
*
Alors même que s'ouvre pour le monde une période de crise et de grandes incertitudes, les politiques de développement peuvent représenter un facteur de stabilisation. La France a vocation à jouer un rôle moteur dans cette prise de conscience. Cette position de premier plan, elle ne pourra la reconquérir sans une amélioration de son dispositif de coopération, la sauvegarde de son effort financier et la valorisation de ses moyens humains. Tels sont les enjeux que soulève aujourd'hui l'achèvement de la réforme entreprise en 1998.
*
* *
EXAMEN EN COMMISSION
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport lors de sa séance du jeudi 25 octobre 2001.
A la suite de l'exposé de M. Guy Penne, Mme Paulette Brisepierre, corapporteur, a d'abord relevé que l'un des rares aspects positifs de la réforme se traduit par le renforcement de l'Agence française de développement qui a su prendre toute sa part au sein du dispositif de la coopération. Elle a estimé que les motivations réelles de la réforme manifestaient, dans une certaine mesure, l'incompréhension des diplomates vis-à-vis des personnels de la coopération. Elle s'est fait, également, l'écho de l'inquiétude des assistants techniques et exprimé sa crainte que la ressource humaine remarquable qu'avait su réunir la coopération se tarisse progressivement. Elle a rappelé, à cet égard, que l'Union européenne, au rebours des orientations privilégiées par la France, entendait mettre en place, sur le terrain, à échéance rapprochée, des effectifs nombreux et spécialisés dans le domaine du développement. Elle a également souligné que le Royaume-Uni avait, pour sa part, choisi de constituer une structure ministérielle consacrée exclusivement à la coopération et dotée de moyens importants.
Mme Paulette Brisepierre a ajouté que la constitution d'une zone de solidarité prioritaire aurait sans doute représenté une orientation intéressante, si elle s'était accompagnée des moyens financiers nécessaires, mais tel n'a pas été le cas. Elle est revenue sur les annulations de dettes en estimant que ces dernières devaient avoir pour condition l'engagement des Etats bénéficiaires à garantir à leurs ressortissants, mais aussi à nos compatriotes, les prestations sociales pour lesquelles ils ont cotisé. Enfin, elle a regretté que les affectations décidées par le Quai d'Orsay ne tiennent pas toujours compte du profil de poste nécessaire.
M. André Dulait, corapporteur, a, quant à lui, insisté sur le poids excessif de Bercy dans la politique d'aide française au développement. Il a estimé, en outre, que la spécificité de l'action de la France dans le domaine du développement repose, pour une large part, sur la présence de nos coopérants dans les pays bénéficiaires de notre aide. Il a souhaité, en conséquence, que l'expertise de courte durée que le Gouvernement cherche à développer, ne conduise pas à une remise en cause de l'assistance technique classique. Enfin, il a jugé que la mise en place d'une grande Agence, chargée de la mise en oeuvre des opérations de développement, permettrait de renforcer l'efficacité de notre coopération.
M. Xavier de Villepin, président, a d'abord souhaité rendre hommage aux personnels de la coopération, dont le dévouement et la compétence représentaient une valeur ajoutée inestimable pour notre action dans les pays en développement. Il a relevé le décalage entre les ambitions trop nombreuses de la réforme de la coopération et des moyens financiers décroissants. Il est revenu sur l'articulation complexe des compétences respectives du ministère des affaires étrangères et de celui des finances, en estimant que le Quai d'Orsay devait jouer un rôle prépondérant dans la tutelle exercée sur l'AFD.
M. Xavier de Villepin, président, a ajouté qu'à l'issue d'un déplacement effectué avec les trois rapporteurs à Bruxelles, l'organisation de l'aide communautaire lui est apparue très complexe. Il a jugé à cet égard que notre pays a une responsabilité particulière pour renforcer l'efficacité du dispositif européen. Il a souligné que le Parlement n'avait pas suffisamment été associé à la réforme et, d'une manière générale, à la mise en oeuvre de notre politique de coopération ; il a regretté, notamment, l'absence de données claires et comparatives sur les moyens financiers consacrés à l'aide au développement.
M. Serge Vinçon est revenu sur le caractère paradoxal de l'extension de la zone de solidarité prioritaire, alors même que les crédits destinés au développement se réduisent. Il s'est demandé, dans le contexte actuel de tension internationale, si les nouveaux pays intégrés à la ZSP respectent les principes fixés par la communauté internationale au regard, notamment, de la lutte contre le terrorisme. M. Guy Penne a regretté, pour sa part, que l'augmentation du nombre de pays au sein de la ZSP soit intervenue à un moment où la contrainte budgétaire avait conduit à une réduction de notre effort en faveur du développement.
M. Robert Del Picchia s'est interrogé sur les conditions dans lesquelles sont arrêtées les orientations géographiques et sectorielles de notre aide. Il s'est demandé, également, s'agissant de l'aide européenne, s'il ne serait pas préférable, afin d'accélérer les décaissements, que les Etats membres puissent mettre en oeuvre directement les fonds communautaires. En outre, rappelant la situation très difficile des retraités français des caisses de retraite africaines, il a souhaité que les opérations d'allégements de dettes puissent se traduire par l'engagement des Etats bénéficiaires d'honorer les créances de leurs systèmes sociaux. Enfin, dans l'hypothèse où une grande agence de développement serait mise en place, il s'est demandé quelles seraient les attributions de la DGCID.
En réponse, M. Guy Penne a apporté les précisions suivantes :
- les orientations politiques en matière de développement sont, en principe, fixées par le CICID ; cette structure, toutefois, devrait impérativement être transformée car elle n'apparaît pas en mesure de répondre aux missions qui lui sont assignées ;
- la procédure de délégation de crédits à des organismes nationaux doit être systématisée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'aide extérieure communautaire ;
- la question des retraites de nos compatriotes peut être traitée très utilement dans le cadre des commissions mixtes ;
- dégagée de la mise en oeuvre des projets de développement, la DGCID pourra se recentrer sur ses fonctions prioritaires d'élaboration des grandes orientations de la politique de coopération, ainsi que sur le renforcement de l'influence française au sein des institutions internationales.
M. Hubert Durand-Chastel a estimé que l'insuffisance des moyens financiers constitue le problème principal de notre coopération et que la mise en place d'une grande agence de développement représenterait, sans doute, le moyen de conférer une plus grande efficacité à notre aide.
A la suite de cet échange de vues, la commission a donné son accord à la publication de cette communication sous forme d'un rapport d'information.
ANNEXE I -
MISSIONS
D'INFORMATION
A MADAGASCAR ET AU KENYA -
PROGRAMME DES
ENTRETIENS
_____
MISSION A MADAGASCAR
|
Samedi 10 février |
|
|
9 h 30 |
Réunion de travail à la Résidence Tour d'horizon de la situation politique et économique de Madagascar et de la Coopération franco-malgache |
|
16 h 00 |
A Antsirabe : visite de projets agricoles |
|
20 h 00 |
Dîner à Antsirabe : avec le Maire, le Sous-Préfet, le Directeur du Développement rural, le Directeur malgache de l'Alliance Française, les directeurs français de deux entreprises COTONA et CORALMA (BOLLORE) |
|
Dimanche 11 février |
|
|
9 h 00 |
Visite du projet de l'ONG « Enfants du Soleil » |
|
10 h 45 |
Visite de l'Alliance Française d'Antsirabé |
|
11 h 00 |
Visite des projets de l'assistance technique militaire en présence du ministre des forces armées, le général Marcel RANJEVA |
|
17 h 00 |
Rencontre, à leur demande, avec les représentants syndicaux des assistants techniques |
|
Lundi 12 février 2001 |
|
|
Matinée |
Tamatave - Visite du projet PAEA (projet d'appui aux
exportations agricoles)
|
|
Déjeuner |
avec le Maire, Roland RATSIRAKA |
|
Après-midi |
|
|
16 h 30 |
Visite du projet PAIQ (Programme d'appui aux initiatives de quartier) y compris le dispensaire (lutte anti-choléra) et l'atelier bois |
|
18 h 00 |
Entretien avec le GEPAT (Groupement des entreprises de la province autonome de Tamatave) |
|
Mardi 13 février 2001 |
|
|
10 h 00 |
Tananarive - Réunion CITE (Centre d'Information Technique et Economique), organisme malgache financé par la coopération française, avec les assistants techniques du projet ville, ceux du projet contrôle de légalité, ceux du projet d'appui aux médias (hébergés par le CITE) |
|
12 h 30 |
Déjeuner avec les opérateurs économiques français (Conseillers du Commerce Extérieur) |
|
Après-midi |
Audiences avec : - le Premier Ministre, M. TANTELY ANDRIANARIVO - la Ministre des Affaires étrangères, Mme Lila ATSIFANDROHAMANANA |
|
19 h 00 |
Réception à la Résidence |
|
Mercredi 14 février |
|
|
9 h 30 |
Réunion de travail avec l'Agence Française de Développement |
|
11 h 00 |
Projet MADSUP (appui à l'enseignement supérieur) à l'Université de Tananarive |
|
13 h 00 |
Déjeuner à la Résidence avec les représentants des principaux bailleurs de fonds (Union Européenne, Banque Mondiale, FMI, PNUD, Ambassadeur du Japon) |
MISSION AU KENYA
|
Jeudi 15 février 2001 7 h 45 9 h 00 11 h 00 12 h 30 14 h 30 16 h 00 21 h 00 |
Entretien avec le Dr Bonaya GODANA, ministre des affaires étrangères kenyan Bidonville de Kibera . visite du site . discussion avec les services techniques du Nairobi City Council Visite AFD - Réunion de travail Déjeuner AFD Réunion au Poste Expansion Economique Réunion avec la Délégation de la Commission de l'Union Européenne Dîner de travail chez le directeur du SCAC, M. F. Humbert, avec des représentants des ONG |
|
Vendredi 16 février 2001 9 h 00 11 h 00 11 h 45 |
Visite De La Société Horticole « WARIDI » - Financement PROPARCO Visite de la Maison française Conférence de presse |
ANNEXE II -
LISTE DES
PERSONNES AUDITIONNÉES
|
17 janvier |
M. MALLOCH-BROWN |
Administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) |
|
18 janvier |
M. Bruno DELAYE |
Directeur général de la Direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID Ministère des affaires étrangères) |
|
23 janvier |
M. Jean-Jacques BEAUSSOU M. Jean NEMO |
Chef du service de la programmation, des moyens et de l'évaluation (DGCID Ministère des affaires étrangères) Président du Centre français pour l'accueil et les échanges internationaux (EGIDE) Auteur du rapport de mission sur les appuis en personnel dans les actions de coopération (mars 2000) |
|
30 janvier |
M. Patrick BONNEVILLE |
Chef du pôle de coordination géographique (DGCID - Ministère des affaires étrangères) |
|
1 er février |
M. Antoine POUILLIEUTE |
Directeur de l'Agence française de développement |
|
6 février |
M. Jean-Michel SEVERINO |
Inspecteur général des finances Ancien Directeur du développement au ministère de la coopération Directeur de l'Agence française de développement (AFD), depuis le 26 avril 2001 |
|
6 février |
M. Dominique BOCQUET |
Directeur de cabinet du ministre de la coopération |
|
8 février |
M. Jean-Pierre JOUYET |
Directeur du Trésor |
|
20 février |
M. Claude VILLAIN |
Inspecteur général des finances |
|
M. BAYART Mme Mireille GUIGAZ |
Directeur du Centre d'études sur les relations internationales (CERI) Directeur du développement et de la coopération technique (DGCID Ministère des affaires étrangères) |
|
|
27 février |
M. Marc GENTILINI |
Président de la Croix-Rouge française |
|
M. Stéphane HESSEL |
Ambassadeur de France et membre du Haut conseil de la coopération internationale (HCCI) |
|
|
20 mars |
M. Bernard STASI |
Membre de la Commission nationale de la coopération décentralisée Président de Cités unies France |
|
3 avril |
M. Nicolas VASIC et M. Claude COLNOT M. Laurent LAPEYRE Mme Danièle MILANINI et M. Alain FERRE M. Daniel VAZEILLE et M. Thierry ROBERT M. Régis KOETSCHET et M. Pascal VAGOGNE M. Frédéric Baleine du LAURENS M. Henri GELAS Mme Annie DUBERNET et M. ALAIN SCHNEIDER Mme Geneviève VENTURI Mme Marie-Claire BOULAY et M. Gilles LAINE |
1 er Vice-président - Union syndicale du ministère des affaires étrangères (USMAE) Secrétaire général (CFDT) Secrétaire général Délégué général (FO) Secrétaire général Secrétaire général adjoint (CGT) Secrétaire général Membre du conseil d'administration - Association Syndicale des Agents Diplomatiques et Consulaires d'Orient (ASAO) Président de l'Association Syndicale des Agents Diplomatiques et Consulaires issus de l'ENA (ADIENA) Secrétaire général - Fédération des Personnels de Coopération Outre Mer (FPCOM) Secrétaire générale Acteurs de la Coopération Internationale et de l'aide au développement auprès du M.A.E. (ACAD-MAE) Présidente de l'Association des agents contractuels et titularisés de Catégorie A du M.A.E. (AACTA-MAE) Président et Vice-président- Association des Contractuels Coopération (ACC) |
|
25 avril |
M. Jean-Louis BIANCO , |
Président du Haut Conseil de la coopération internationale |
|
15 mai |
Général de VAISSIÈRE |
Directeur de l'Assistance technique militaire (Ministère des affaires étrangères) |
|
12 juin |
M. Alain CATTA M. Michel ROUSSIN |
Directeur général de l'Administration (Ministère des affaires étrangères) MEDEF International |
|
14 juin |
M. Pierre VIMONT M. Gérard GUILLONNEAU M. Giorgio BONACCI EUROPEAID Mme Catherine DAY M. Poul NIELSON Direction générale « développement » de la Commission européenne : M. Bernard PETIT M. Athanassios THEODORAKIS M. Michel ARRION |
Représentant permanent de la France près de l'Union européenne Conseiller « coopération au développement » - Représentation permanente de la France près de l'Union européenne Directeur général de l'Office de coopération à la Commission européenne Directeur général adjoint à la Direction générale « relations extérieures » de la Commission européenne Commissaire européen pour le Développement et l'aide humanitaire Directeur de la politique de développement Directeur général adjoint Assistant du directeur général. |
|
19 juin |
M. Michel ROCARD |
Président de la Commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen |
LA RÉFORME DE LA COOPÉRATION
A L'ÉPREUVE DES RÉALITÉS
Le gouvernement a engagé en 1998 une profonde réforme du dispositif français d'aide au développement : le secrétariat d'État à la coopération a en particulier été intégré au sein du ministère des affaires étrangères.
Quatre ans après, la politique de la coopération française est-elle devenue plus efficace ? Le présent rapport, étayé par un travail d'investigation de plusieurs mois et l'audition des principaux responsables du développement, cherche à apporter une réponse à cette interrogation décisive pour la place de la France dans le monde.
* 1 Voir en annexe liste des personnalités auditionnées.
* 2 Le présent rapport n'abordera pas - sinon dans le compte rendu de la mission effectuée à Madagascar- la coopération militaire, sujet dont l'importance justifie une analyse séparée.
* 3 Réponse au questionnaire budgétaire, projet de loi de finances de 1999.
* 4 Cet objectif figurait pour la première fois dans la résolution 2026 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 24 décembre 1970 sur la stratégie internationale pour le développement.
* 5 Le décret du 11 septembre 2000 reconnaît ainsi au FSP la possibilité de « financer à titre exceptionnel des opérations d'aide et de coopération situées, le cas échéant, hors de la ZSP ».
* 6 Jean Nemo - Les appuis en personnel dans les actions de coopération, rapport de mission, mars 2000.
* 7 « Sur la coopération avec la Russie au regard des événements de Tchétchénie » (13 mars 2000), « Sur la coopération et la présidence française de l'Union européenne » (18 avril 2000), « Pour que la coopération internationale soit une priorité forte de la présidence française de l'Union européenne » (26 juin 2000) ; « Pour une position française lors du sommet du millénaire » (29 août 2000) ; sur « gestion, prévention de crises et coopération (23 novembre 2000).
* 8 Ces subventions sont gérées par la mission pour la coopération non gouvernementale, service du ministère des affaires étrangères, sous la forme de cofinancements dans la limite de 50 % du coût du projet.
* 9 La Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) rassemble à parité élus représentants des collectivités territoriales et représentants de l'Etat.
* 10 Fonds international de secours à l'enfance
* 11 Conférence des Nations unies pour le Commerce et le Développement
* 12 PHARE pour les dix pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, TACIS pour les 14 pays issus de l'éclatement de l'URSS, OBNOVA pour les pays de l'ex-Yougoslavie, MEDA pour les Etats du bassin méditerranéen, ALA pour les pays d'Asie et d'Amérique latine.
* 13 Cette priorité a trouvé sa première traduction avec l'initiative « tout sauf les armes » adoptée par le Conseil du 26 février 2001 afin d'étendre le libre accès au marché communautaire en franchise de droits et contingents à tous les produits originaires des pays les moins avancés à l'exception des armes et des munitions.
* 14 Yves Tavernier, la coopération française au développement, rapport au premier ministre, 1999, La documentation française.