CHAPITRE II - LA POLITIQUE CONDUITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS
I. LES GRANDES ORIENTATIONS
Le rôle du ministère de l'agriculture en matière d'agro-alimentaire a été renforcé par l'extension de ses compétences au domaine de l'alimentation.
Le décret du 8 juin 1995 qui fixe les attributions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, charge en effet ce dernier de déterminer la politique de l'alimentation et d'en assurer l'exécution. Cette précision ne figurait pas dans le précédent décret d'attribution du 8 avril 1993.
Ses compétences en ce domaine sont donc affirmées et renforcées. Il en résulte, en particulier, que la politique de l'alimentation et celle de la qualité qui sont intrinsèquement liées doivent constituer un axe majeur des actions du nouveau ministère.
La lettre de mission adressée par le Premier ministre charge d'ailleurs le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation d'étudier et de présenter des projets de texte de portée législative et réglementaire visant à améliorer notre système de contrôle, pour assurer la garantie sanitaire des produits et la sécurité des processus de production et de transformation. Selon les informations dont dispose votre rapporteur « la préparation de ces textes, sous la responsabilité directe de ce ministère, est très avancée ».
D'autre part, les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de divers organismes (par exemple le Conseil national de l'Alimentation ou le Codex alimentarius) ont été précisées.
De même, un protocole d'accord a été élaboré afin de renforcer et de mieux formaliser les modalités de coopération avec les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Enfin, en ce qui concerne les services propres du ministère, la présence et l'action d'un pôle agro-alimentaire seront confortées aux niveaux régional et départemental. Il est envisagé de « formaliser la coopération, sur la chaîne agro-alimentaire, » des directions départementales de l'agriculture, de la concurrence et de la consommation, et des affaires sanitaires et sociales.
A. L'ANALYSE DU MINISTÈRE
Les avis budgétaires des années passées avaient longuement présenté les modifications de l'environnement immédiat ainsi que les problèmes structurels rencontrés par ce secteur depuis la réforme de la PAC 1 ( * ) .
Selon le ministère, les faiblesses de ce secteur « dues à un développement économique encore récent et à une taille généralement insuffisante persistent :
- le manque de fonds propres, notamment des PME, constitue un handicap d'autant plus important que les délais de paiement pratiqués par la grande distribution entraînent un besoin accru en fonds de roulement ;
- des marges financières réduites provenant d'un rapport de force déséquilibré avec la grande distribution, qui a développé fortement ses marques de distributeurs et plus récemment des produits des premiers prix ;
- des difficultés de perception de la qualité par les consommateurs du fait de la multiplication des identifiants de la qualité (AOC, labels, agriculture biologique...) et une insuffisance de communication ;
- une présence sur les marchés étrangers encore faible, nécessitant la poursuite des implantations dans l'Union européenne et des efforts à cibler vers les pays d'Asie, ceux d'Europe centrale et orientale et d'Amérique latine ;
- des dépenses d'innovation et de recherche peu en rapport avec le poids économique du secteur 2 ( * ) et leur effet d'entraînement sur l'agriculture ».
C'est dans ce cadre que s'inscrit la politique du Gouvernement qui vise, principalement, à adapter les structures d'aval de l'agriculture aux nouvelles contraintes nées de la réforme de la politique agricole commune et des accords du GATT et d'autre part, à conforter un tissu régional de PME performantes.
Cette politique, d'après le ministère, tend donc à :
« - inciter à la restructuration des entreprises de collecte et de stockage des céréales et des oléagineux affectés par la baisse des volumes et des prix ;
- préparer les industries des viandes à faire face à une réduction des volumes exportés vers les pays tiers induite par les accords du GATT ;
- développer les débouchés industriels non alimentaires, notamment pour les amidons et les sucres ou des usages nouveaux tels les biocarburants ;
- privilégier le développement des PME en leur consacrant la majeure partie des aides publiques à l'investissement physique et en leur réservant les aides aux investissements immatériels ;
- conduire et développer une politique active de qualité. Il s'agit d'adapter l'offre agricole à la demande de l'aval, de valoriser les produits grâce au dispositif de signes de qualité, de promouvoir et contrôler l'hygiène alimentaire ;
- étudier les aménagements à apporter au titre IV de l'ordonnance de 1986, visant à rééquilibrer les rapports entre producteurs, transformateurs et distributeurs ;
- stimuler le transfert de technologies vers les entreprises en prenant appui sur les centres techniques et les centres de transfert ».
Selon les informations fournies à votre rapporteur, le ministère entend privilégier cinq orientations principales.
B. LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES
1. La sélectivité des aides
Cette orientation principale en matière d'aide aux industries agroalimentaires résulte de l'addition de plusieurs sujétions.
L'analyse faite par le ministère est difficilement contestable : « les contraintes qui pèsent sur les industries agro-alimentaires du fait de la réforme de la PAC et surtout des nouvelles règles relatives au commerce mondial dont les répercussions seront sensibles sur les productions animales et la transformation des céréales vont conduire les entreprises à se restructurer plutôt que développer leurs capacités de production ».
Il est clair désormais que les pouvoirs publics seront conduits à accompagner les restructurations, parfois difficiles, plutôt que de financer l'accroissement des capacités de l'outil industriel.
De leur côté, les directives communautaires en matière d'hygiène des produits d'origine animale obligent les entreprises à faire des investissements coûteux de mise à niveau de leurs installations pour la réalisation desquelles il est logique que les aides publiques, nationales ou communautaires, soient prioritairement mobilisées.
Les onze plans sectoriels acceptés par la Commission en mars dernier reflètent bien ces contraintes : ils privilégient les restructurations, la réduction de capacités, la mise aux normes sanitaires européennes, le développement de la qualité, la recherche d'une meilleure valorisation, l'adaptation au marché... C'est en cohérence avec ces priorités que se font désormais les interventions publiques nationales.
En définitive, comme le note le ministère, « cette cohérence est d'autant plus importante que les interventions publiques (régions - État -FEOGA) représentent environ 600 millions de francs face à des investissements de l'ordre de 22 milliards. Ces interventions seraient, en effet, dérisoires si elles n'étaient pas centrées sur des secteurs bien ciblés reconnus prioritaires ».
2. La priorité donnée aux PME et à l'emploi
En dépit d'une tendance à la concentration 1 ( * ) , les PME constituent encore la très grande majorité des entreprises agro-alimentaires. Leur rôle dans l'animation économique du monde rural, en créant ou en maintenant des emplois, justifie qu'elles fassent l'objet d'une attention particulière. On peut, sur ce point, indiqué que le ministre de l'agriculture a évoqué la possibilité de doubler la création annuelle d'entreprises, à travers une opération « 100 PME ».
• Déjà, à ce titre, les aides
aux investissements physiques attribuées au niveau régional,
national ou communautaire bénéficient majoritairement aux PME.
C'est particulièrement le cas pour les interventions entrant dans le
cadre des contrats de plan État-régions. De leur
côté, les fonds régionaux d'aide aux investissements
immatériels (FRAI), adaptés à leurs besoins, leur sont
intégralement réservés.
Pour votre commission, le soutien apporté au tissu des PME revêt, en effet, une importance particulière, compte tenu de l'apport des industries agro-alimentaires à l'emploi et à la vitalité de l'espace rural
L'agro-alimentaire est, en effet, l'industrie dans laquelle la part des emplois ruraux induits est la plus importante.

Selon le ministère, on constaterait, d'ailleurs, une « ruralisation » de l'agro-alimentaire.
Les entreprises auraient tendance à quitter les grands pôles de consommation (Paris, Lille, Lyon) et certains sites portuaires (Bordeaux, Marseille, Nantes...) pour s'installer dans les bassins de production.
Cette évolution profiterait à la fois aux régions dans lesquelles l'agriculture est la mieux structurée (Bretagne et Sud-ouest), mais aussi aux zones rurales fragiles dans lesquelles se développent des productions de qualité, comme la Dordogne, le Gers ou les Landes...
Ainsi entre 1975 et 1982, les communes rurales auraient enregistré, pour les industries agro-alimentaires, un gain d'emplois de 17%. De 1982 à 1990, le taux d'augmentation est resté de 5 %. Sur 100 actifs ruraux, 36 travaillaient dans l'agro-alimentaire en 1990, contre 31,5 en 1975.
• L'amélioration des relations avec
la grande distribution
constitue le second volet de l'action
déjà conduite en faveur des PME de l'agro-alimentaire.
La réduction des délais de paiement applicables aux produits frais ou périssables a, déjà, selon le ministère, permis d'alléger la trésorerie des entreprises et de réduire les risques de non paiement, ce qui est tout particulièrement profitable aux PME, particulièrement exposées aux pressions de la grande distribution. La réforme de l'ordonnance de 1986 relative à la concurrence, afin de prendre en compte la fragilité des producteurs et des transformateurs, qui résulte du déséquilibre dans les rapports de force entre la production et la distribution, constituerait une amélioration significative.
3. La nécessaire réforme des relations avec la grande distribution
a) Le poids pris par la grande distribution dans les ventes de produits alimentaires.
La part croissante prise par les grandes enseignes dans la distribution des produits de l'alimentaire est une caractéristique majeure de l'évolution de la filière agro-alimentaire au cours des dernières décennies.
Cette situation explique, pour partie, le partage défavorable de la valeur ajoutée entre agriculteurs et industriels, d'une part, et distributeurs, d'autre part.
RÉPARTITION DES ACHATS ALIMENTAIRES PAR TYPE DE COMMERCE

En 1993, comme l'illustre le tableau ci-après, pour de nombreux produits, les hyper et super marchés représentaient les deux tiers des ventes. Les commerces spécialisés, à l'exception des boulangeries-pâtisseries, et dans une moindre mesure, des poissonneries représentant moins du tiers des ventes.
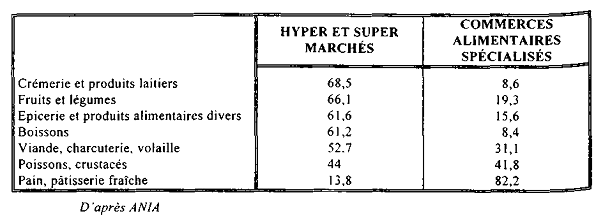
b) L'inadéquation des dispositions actuelles
Comme l'a analysé le rapport Vilain, la législation actuelle apparaît en porte à faux par rapport au poids économique respectif des distributeurs et des producteurs.
L'ordonnance de 1986 privilégie le contrôle et la sanction des comportements du vendeur, alors même que les relations entre producteurs et distributeurs sont aujourd'hui dominées par la puissance d'achat acquise par la grande distribution.
Ce déséquilibre des rapports de force au profit de la distribution est particulièrement marqué. Les entreprises agro-alimentaires vendent les 2/3 de leur production aux hypermarchés et aux supermarchés. Un producteur réalise usuellement 20 à 30 % de son chiffre d'affaires avec un même distributeur, alors que celui-ci s'approvisionne auprès de lui pour au plus 2 à 3 % de ses achats. Ainsi, quasiment aucun fournisseur n'est indispensable pour un grand distributeur, alors qu'un fournisseur peut rarement se passer d'un de ses principaux distributeurs.
En outre, la puissance d'achat considérable de la grande distribution a privilégié la concurrence effrénée sur les prix. Cette pression permanente dépasse souvent les progrès de productivité obtenus et ne permet plus aux producteurs de financer, dans des conditions satisfaisantes, l'innovation, l'investissement et la qualité. À terme, c'est l'emploi même qui est menacé.
Or, l'ordonnance de 1986 est beaucoup plus contraignante pour le producteur que pour le distributeur.
Le droit en vigueur contribue donc à accentuer une situation économique défavorable aux producteurs, en multipliant leurs obligations (facturation, publicité des conditions de ristourne, conditions générales de vente, interdiction des prix minimums), ou les présomptions défavorables pesant sur leur activité (restrictions très sévères aux possibilités de discriminations ou de refus de vente). La puissance d'achat de la distribution fait que même l'interdiction de la revente à perte voit en pratique le fournisseur en supporter les conséquences financières, en devant dédommager le distributeur pouvant se trouver dans cette situation.
Le producteur se trouve donc devoir faire face aux demandes toujours plus pressantes des distributeurs, tout en respectant scrupuleusement, sous peine de lourdes sanctions pénales, civiles ou administratives, les nombreuses obligations qui lui sont imposées.
En revanche, la liberté d'action de l'acheteur est quasi-totale hormis l'existence de délais de paiement légaux pour les produits périssables. Les pratiques de déréférencement abusif ne sont même pas mentionnées par l'ordonnance et, faute de voie d'action appropriée, une saisie des tribunaux n'a guère de chances de succès, au simple plan juridique.
c) Les modifications préconisées
Selon le ministère, l'amélioration des relations production-distribution « passe nécessairement par une réforme de l'ordonnance de 1986. Les dispositions légales doivent tirer les conséquences du profond changement de l a situation économique intervenu depuis près de 10 ans ». Les règles actuelles apparaissent comme datées et il ne semble pas que la jurisprudence puisse permettre l'évolution nécessaire.
Il s'agirait donc de retrouver un équilibre dans les obligations respectives fixées par l'ordonnance aux producteurs et aux distributeurs, en modifiant les dispositions concernant les producteurs : actions concertées pour promouvoir la qualité, règles sur la facturation, les conditions de vente, la revente à perte, les discriminations, le refus de vente.
Le ministère estime, d'autre part, que la lutte contre les pratiques restrictives ou abusives devrait être largement confiée au juge commercial, au lieu de relever comme actuellement de contrôles administratifs assortis de sanctions pénales et qu'une action en justice visant spécialement les pratiques de déréférencement abusif devrait être créée.
L'ensemble des modifications préconisées devrait permettre aux producteurs et aux industriels de mieux se défendre face aux exigences de la grande distribution, en n'étant plus placés, dès l'ouverture des négociations commerciales, en position d'infériorité juridique vis-à-vis de l'acheteur.
Ces positions rejoignent, pour partie, celles des professionnels.
En la matière, l'ANIA estime que, sans bouleverser l'économie de l'ordonnance, des aménagements doivent être apportés.
|
La position de l'ANIA 1. Abus de dépendance économique et déréférencement abusif Une application effective du droit français à l'ensemble des secteurs et des agents de l'économie apparaît comme indispensable. C'est l'objet de la proposition visant l'abus de dépendance économique sans atteinte au marché. Le fait pour un client professionnel d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un fournisseur, sous la menace d'un déréférencement : - des conditions commerciales qui diffèrent sans justification des conditions générales de vente, - des avantages, quelle qu'en soit la nature, sans contrepartie véritable, quantifiable et proportionnelle, - ou l'achat de services subordonnés à la vente des produits du fournisseur est présumé constitutif d'une exploitation abusive de sa puissance d'achat. Le distributeur est tenu au respect d'un délai de préavis minimum avant toute rupture ou modification substantielle des relations commerciales. La rupture doit être motivée. 2. Clarification des règles de facturation Pour ce qui est de la facturation, l'expression « tout rabats, remise ou ristourne dont le principe est acquis et le montant chiffrable... quelle que soit leur date de règlement » qui figure à l'article 31 de l'ordonnance, doit être amendée. Ne doivent être mentionnées sur la facture que les « rabais, remises ou ristournes présentant un caractère inconditionnel ou bien conditionnel si les conditions sont réalisées au jour de la facturation ». Les services vendus par le distributeur qui doivent faire l'objet d'un contrat et d'une facture ne peuvent en aucun cas être pris en compte dans le calcul du seuil de la revente à perte. 3. Revente à perte - Refus de vente Il semble irréaliste en l'état actuel des rapports de force de considérer que la suppression de l'interdiction du refus de vente ou de la revente à perte conduirait à une meilleure mise en oeuvre du droit de la concurrence. La sanction effective des abus de dépendance économique et du déréférencement abusif apparaît comme une première étape indispensable avant toute modification en profondeur des équilibres internes de notre droit. Il est indispensable en revanche de clarifier la définition du seuil de la revente à perte afin qu'elle puisse être effectivement sanctionnée et ce dans des délais qui ne rendent pas la sanction inopérante. Le seuil de la revente à perte doit correspondre au prix qui figure sur la facture (voir point 2 sur la clarification des règles de facturation) majoré des taxes afférentes à la revente et, le cas échéant, du prix du transport. L'exception à l'interdiction de la revente à perte au nom d'un droit pour le distributeur d'alignement sur le prix d'un concurrent dans la même zone de chalandise doit être supprimée. Il s'agit d'une rémanence du droit des prix, qui contribue à la spirale de dévalorisation, qui revient à se faire justice à soi-même, et non d'une disposition visant à favoriser la concurrence loyale. Dans un esprit d'équité, les dispositions relatives au refus de vente devraient comporter le respect d'un préavis minimum de la part du fournisseur ainsi que l'obligation de motiver la décision. |
Source : Agra-Alimenlation n° 1449, 19 octobre 1995
De leur côté, les organisations professionnelles agricoles, estimant que l'aménagement ne peut porter que sur le seul titre IV, ont dégagé une « plate-forme » commune (FNSEA, Coopération agricole, APCA...) autour de trois axes principaux :
- permettre aux accords assurant l'adaptation quantitative et qualitative des produits agro-alimentaires aux marchés de pouvoir déroger au principe de l'interdiction des ententes,
- agir sur les prix anormalement bas,
- initier de nouveaux comportements dans les relations commerciales.
|
La position des organisations professionnelles agricoles 1. Reconnaître le bien-fondé de certaines ententes L'objectif est d'obtenir que le droit de la concurrence autorise une meilleure organisation de la production pour permettre un ajustement, tant qualitatif que quantitatif, des produits aux marchés. Il s'agirait : ï d'intégrer expressément la politique de qualité. En complétant l'article 10.2 du titre III de l'ordonnance de 1986 dans sa partie concernant les ententes, afin que les accords destinés à améliorer la qualité des produits agricoles et alimentaires et leur distribution bénéficient d'une des dérogations possibles à l'interdiction des ententes, ï d'élargir les possibilités d'intervenir en cas de situation de crise, en permettant par exemple une réduction des capacités de production et en prévoyant, quand la situation l'exige, la possibilité de recourir au « cartel de crise ». Il convient donc d'introduire explicitement dans l'article 10.12 de l'ordonnance de 1986 la possibilité pour l'État de mettre en place un cartel de crise temporaire, en étendant certains accords ou catégories d'accords définis par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles. 2. Lutter contre les prix anormalement bas
Ce nouvel alinéa doit permettre de considérer comme déloyale la vente à un prix artificiellement bas d'un produit ou d'un service dans l'une des conditions suivantes : - la vente est susceptible d'induire en erreur le consommateur sur le niveau des prix et services du même établissement ou de la même enseigne ; - la vente a pour effet de porter atteinte à la marque ou à l'image d'un produit ou d'une entreprise ; - la vente résulte d'une action destinée à éliminer d'un marché un concurrent ou l'un de ses produits ou services. Ce nouvel alinéa à l'article 32 de l'ordonnance doit ouvrir également la possibilité d'encadrer, par voie réglementaire, les promotions de produits sensibles, notamment sur les périodes, fréquences et le prix servant de référence à la promotion.
ï Clarifier les règles de facturation afin, notamment, que les remises, les ristournes -ou tout autre avantage commercial- soient chiffrées au moment de la vente. ï Maintenir le dispositif sur les délais de paiements 3. Introduire de nouveaux comportements dans les relations commerciales À ce titre, il conviendrait de :
L'interdiction de l'abus de dépendance économique prévue à l'article 8.2 de l'ordonnance est jugée inefficace. Il convient, en conséquence, de modifier l'article 36 de l'ordonnance qui régit les relations entre les fournisseurs et les acheteurs, en introduisant la notion d'interdiction d'abus de dépendance économique, afin de pouvoir sanctionner un déréférencement abusif analysé comme une menace ou une rupture partielle ou totale des relations commerciales régulières avec un fournisseur sans motif légitime. Il pourrait être également envisagé pour les distributeurs que tout déréférencement fasse l'objet d'un préavis minimum.
La suppression de l'interdiction du refus de vente permettrait, en cas de désaccord producteur-distributeur, d'inverser la charge de la preuve. Ce serait donc au distributeur de prouver que le refus de vente d'un producteur constitue une pratique discriminatoire, déloyale ou anticoncurrentielle, alors qu'actuellement c'est au producteur d'établir les preuves du caractère anormal de la demande du distributeur.
L'article 34 de l'ordonnance de 1986 et la jurisprudence qui en découle fonctionnent aujourd'hui comme une arme qui se retourne contre les fournisseurs. En effet, la moindre réaction des producteurs pour lutter contre un prix bas est aujourd'hui considérée comme une tentative directe ou indirecte d'imposer un prix minimum de vente.
|
d) La voie contractuelle : les accords interprofessionnels
La recherche d'une amélioration des relations avec la grande distribution intéresse à la fois les agriculteurs et les industriels.
Pour les produits non transformés, notamment les fruits, les légumes, les fleurs et, à moindre degré, les volailles, le maintien ou le relèvement des prix de vente à la grande distribution, ainsi que la meilleure prise en compte de l'effort qualitatif de la production est un moyen d'obtenir un partage de la valeur ajoutée plus favorable.
À ce titre, après un premier accord de juillet 1994 sur les pratiques promotionnelles, l'accord sur la qualité de juin dernier entre les organisations professionnelles agricoles et la grande distribution présente l'intérêt d'instaurer un dialogue permanent entre les deux parties pour une meilleure connaissance des besoins réciproques. Il pose, d'autre part, les bases d'une véritable chaîne de la qualité allant du producteur au consommateur, ce qui demande aux distributeurs des efforts de formation de son personnel à l'achat et à la vente, et le respect de règles précises sur le transport, l'état sanitaire, l'identification et la présentation en magasin des produits.
L'efficacité réelle de cet accord national interprofessionnel est toutefois limitée par son contenu : une déclaration de principes d'action, acceptée par les producteurs et les distributeurs, non assortie d'un calendrier de réalisation.
Cet accord devrait être prolongé par l'adoption de cahiers des charges par produit, au niveau de chaque région ou filière, consignant les obligations de chaque « maillon », avec l'objectif d'améliorer les conditions de conservation et de présentation en linéaires ainsi que de permettre au consommateur de mieux identifier les produits. Mais il semblerait que ce cadre ne soit pas adapté, du fait de la faible organisation professionnelle de la distribution. La fédération (FCD), signataire pour les distributeurs, ne compte pas parmi ses membres Leclerc et Intermarché (soit 35 % des ventes de la grande distribution).
Par ailleurs, la concurrence acharnée sur les prix entre les enseignes conduit chaque distributeur à privilégier des accords bilatéraux avec les producteurs. Plusieurs distributeurs ont ainsi entrepris de conclure des « chartes de qualité » avec des regroupements locaux d'agriculteurs, par exemple pour certains fruits, les volailles ou la viande bovine.
De son côté, l'industrie agro-alimentaire avait également passé des accords en 1994 avec la distribution. Il ne semble pas jusqu'ici, qu'ils aient entraîné tous les effets positifs qui pouvaient en être attendus.
Il apparaît, par conséquent, que les négociations interprofessionnelles ne sont pas nécessairement suffisantes pour obtenir une meilleure valorisation des productions agricoles auprès des distributeurs. On peut même se demander si dans certains cas, la distribution ne s'en est pas servi pour tenter d'éviter une réforme de l'ordonnance de 1986 : l'affichage de la volonté de régler les problèmes, de façon partenariale, dans un cadre contractuel, devant rendre inutile l'intervention du législateur... Des voies d'action complémentaires doivent donc être recherchées dans la réforme de l'ordonnance de 1986.
4. La politique de qualité
Parce qu'elle permet d'accroître la valeur ajoutée, qu'elle répond à une attente croissante du consommateur et qu'à ce titre elle ouvre des perspectives nouvelles à l'agro-alimentaire dans un contexte de saturation de la plupart des marchés solvables, la politique de qualité doit constituer un des axes de la politique en faveur des industries agro-alimentaires.
La politique de qualité recouvre d'ailleurs plusieurs acceptions.
Il peut s'agir de rechercher une plus grande adéquation entre les produits agricoles fournis et les besoins des transformateurs, qui reflètent les attentes du consommateur. Elle passe, dans ce cas, par le développement de la politique contractuelle ou interprofessionnelle, qui permet notamment d'appliquer des barèmes qualitatifs et de mener des actions et des recherches en vue d'adapter les produits agricoles aux besoins de leur aval.
La qualité peut également être considérée sous son aspect sanitaire et nécessiter une réglementation et des contrôles de plus en plus précis et stricts, afin de garantir que les produits vendus au consommateur seront conformes aux normes édictées.
Enfin, la qualité peut également être considérée à travers le développement de signes distinctifs garantissant soit une spécificité, soit une conformité à des normes préétablies.
Dans ce dernier cas, plusieurs objectifs sont recherchés :
- faciliter la reconnaissance du produit par le consommateur, ce qui présente un intérêt pour les PME qui, le plus souvent, n'ont pas de marques connues ;
- sécuriser les rapports entre les producteurs et les acheteurs, à travers les certifications de conformité et les certifications d'entreprise ;
- enfin, mieux valoriser les produits lorsqu'ils répondent à des spécifications tenant à la zone et aux modes de production (appellation d'origine protégée (AOP) et indication géographique protégée (IGP) ou à des critères précis et vérifiés de qualité (labels - produits biologiques).
Les produits bénéficiant d'un signe distinctif sont en progression constante et représentent désormais une part importante de la production agroalimentaire. Par exemple, la part des vins sous appellation d'origine contrôlée atteint ainsi 46% ; pour les fromages, cette part est de 17%. Au total, l'ensemble des AOC représenterait un chiffre d'affaires de 80 milliards de francs.
De leur côté, les produits sous labels ont généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de francs en 1994, (dont près de la moitié réalisée par les volailles) et ceux issus du mode de production biologique un chiffre d'affaires de 3,2 milliards de francs (poursuivant une croissance supérieure à 10 % par an). Enfin, de nombreux cahiers des charges de certification de conformité ont été déposés en 1994, tous secteurs confondus. Enfin, la marque NF agroalimentaire a été lancée : elle ne concerne encore que le jambon cuit supérieur et le tonyu (lait de soja).
La politique de promotion de la qualité menée par les pouvoirs publics peut donc s'appuyer sur un système cohérent de certification et
d'identification, sous forme des divers instruments que sont l'appellation d'origine contrôlée, les labels, la certification de conformité, l'agriculture biologique et la loi montagne.
Ce système a été largement rénové au cours des années 1994 et 1995, à travers notamment la loi du 3 janvier 1994 qui a permis « d'articuler » le dispositif français avec les règlements européens relatifs aux appellations d'origine et aux indications géographiques et aux attestations de spécificité : seul un produit faisant l'objet d'une reconnaissance au plan français pourra bénéficier d'une protection au niveau communautaire.
C'est dans ce cadre que la France a transmis, en janvier 1994, à la Commission européenne dans le cadre de la procédure simplifiée, 44 appellations d'origine contrôlée, 54 labels et 8 appellations d'origine judiciaire.
Au total, la Commission européenne a reçu plus de 1.300 demandes de reconnaissance de la part des États membres. Après avoir examiné la totalité de ces dossiers et demandé des compléments d'information, elle devrait proposer une première liste de dénominations à reconnaître d'ici la fin de l'année 1995.
Au plan national, une étude commanditée par le ministère a montré que, si les quatre signes officiels de reconnaissance de la qualité (label, certification de conformité, agriculture biologique, appellation d'origine contrôlée) correspondent véritablement à des attentes du consommateur, l'identification de ces signes par ce dernier n'est pas toujours évidente.
La lisibilité de ces signes serait, en effet, souvent perturbée, non pas par leur multiplicité, mais par les démarches parallèles, telles que les médailles, les marques collectives régionales et les multiples allégations qui brouillent leur perception par le consommateur.
À la suite de cette étude, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, a décidé de lancer une campagne de communication en direction du consommateur pour mieux lui expliquer l'existence de signes de reconnaissance officiels de la qualité et leur signification.
Des problèmes doivent également être résolus, en matière de prise en compte par le droit de la concurrence des exigences imposées par la qualité : le cadre juridique permettant aux producteurs de s'organiser pour promouvoir la qualité doit être redéfini, afin d'éviter que les producteurs ne se retrouvent en porte à faux avec l'interdiction des ententes anticoncurrentielles prévue par l'article 7 de l'ordonnance de 1986 sur la concurrence.
Enfin, au sein même de la profession, des arbitrages doivent être rendus entre les tenants d'une logique purement économique et ceux d'une politique de qualité étroitement liée à des préoccupations d'aménagement rural. Le débat au sein des appellations d'origine fromagères qui porte sur l'opportunité d'ancrer, plus profondément, les appellations au terroir et aux industries locales en resserrant les disciplines de production (limitation du rayon de collecte, limitation du litrage par vache, interdiction ou non des ateliers polyvalents...) est, à cet égard, significatif.
À l'occasion notamment d'une conférence de presse, tenue le 31 août dernier, sur les signes de qualité, M. Philippe Vasseur a réaffirmé l'importance qu'accordait le ministère à cette politique, soulignant son intérêt économique mais aussi son impact très favorable sur l'emploi : les modes de production de ces produits sont, en effet, souvent peu intensifs et leur « contenu en emploi » important. Ainsi, pour le ministre de l'agriculture, un agriculteur sur deux pourrait produire des produits bénéficiant d'un signe de qualité, dont la part pourrait atteindre 10 à 15 % par filière.
5. Le développement des usages non alimentaires
La compétence du ministère de l'agriculture, et spécifiquement de sa direction générale de l'alimentation, en matière de productions agroindustrielles, justifie que, dans le cadre de son avis sur les industries agro-alimentaires, votre commission consacre traditionnellement des développements aux utilisations non alimentaires.
L'institution de la jachère, qui a porté sur 1,5 million d'hectares en France en 1993-1994, accompagnée de la possibilité de pratiquer des cultures destinées à des usages non alimentaires sur les superficies gelées a donné une nouvelle impulsion à la recherche de nouveaux débouchés non alimentaires. En outre, en 1994, au sein de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), un groupement d'intérêt scientifique « Agriculture pour la chimie et l'énergie » (AGRICE) a été créé, qui regroupe les établissements publics de recherche, les organisations agricoles et les ministères de la recherche, de l'industrie et de l'agriculture.
Ce groupement a pour objet l'évaluation, la coordination et le financement des programmes de recherche portant sur les valorisations non alimentaires des produits agricoles, notamment dans le secteur de l'énergie et les produits pouvant être substitués à ceux d'origine pétrolière.
Cet effort est soutenu, d'autre part, par des subventions publiques et l'exonération de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), dont bénéficient les biocarburants, (pour un coût fiscal, en 1994, de 153 millions de francs pour 728.000 hectolitres d'ester de colza et de 160 millions de francs pour 485.000 hectolitres d'éthanol).
Les résultats obtenus sont appréciables. Au titre des dispositions adoptées en 1986, pour permettre de fournir à l'industrie des amidons et des sucres à des prix proches des cours mondiaux, 340.000 hectares de blé, maïs et pomme de terre sont consacrés à des usages non alimentaires, essentiellement sous forme d'amidon et fécule destinés à la papeterie. De son côté, pour la campagne 1994-1995, la jachère non alimentaire concerne 411.000 hectares, dont 289.900 hectares destinés à la production de biocarburants (265.000 hectares pour le colza ; 17.000 hectares pour le blé ou la betterave éthanol), 115.600 hectares destinés à des cultures non énergétiques et 5.400 hectares pour la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Les perspectives globales de développement des surfaces de jachère non alimentaire pour la France sont favorables. En effet, les surfaces consacrées à ces débouchés pour les semis 1995-1996 devraient concerner plus de 450.000 hectares en France, dont 307.000 hectares en colza ester, 10 à 15.000 hectares en betterave éthanol et environ 100.000 hectares pour la chimie.
Il faut cependant indiquer que le développement des utilisations non alimentaires, compte tenu du succès rencontré par les esters de colza ou de tournesol, risque, à terme, de se heurter au contingentement imposé par l'accord oléoprotéagineux du GATT (limitation à 1 million de tonnes équivalent tourteaux de soja des utilisations non alimentaires sur les terres gelés au titre de la réforme de la PAC).
Ce développement a nécessité la mise en place des unités industrielles nécessaires.
|
Pour la production des esters destinés à la carburation ou à la combustion, le développement a été réalisé dans un premier temps à partir d'établissements spécialisés (Compiègne) ou d'outils de l'industrie chimique devenus disponibles (Peronne, Verdun et Boussens) avec des investissements complémentaires modestes (de l'ordre de la dizaine de millions de francs à Verdun). La première unité industrielle, d'une capacité de 150.000 tonnes d'esters construite à Rouen pour un coût estimé à 155 millions de francs a été inaugurée par le Premier ministre le 2 octobre dernier. Le site de Nogent-sur-Seine a été retenu pour la construction d'une seconde unité de grande taille, d'une capacité de 100.000 tonnes d'ester pour un investissement de 150 millions de francs auquel il est prévu d'adjoindre une unité de trituration pour environ 210 millions de francs. Ce site intégré (trituration-estéréfication) devrait entrer en service en 1997, sous réserve de l'adoption par la Communauté d'un dispositif d'exonération fiscale des biocarburants. L'éthanol produit est principalement destiné à la fabrication d'ETBE dont la production est actuellement assurée par l'unité ELF de Feyzin. Cette société a par ailleurs en projet deux autres usines d'ETBE à Carling (Moselle) et à Donges (Loire Atlantique) qui utiliseraient, ensemble, un million d'hectolitres d'éthanol par an pour un investissement de 215 millions de francs par unité et dont le démarrage pourrait intervenir en 1997. En application des dispositions prévues par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1993, deux accords de partenariat ont été signés le 9 mars 1994 entre l'État d'une part et les professionnels de la filière éthanol et la Société Total d'autre part. Aux termes de ces accords, deux unités d'ETBE (Gonfreville en Seine Maritime et Dunkerque), devant utiliser au total 600.000 hectolitres d'éthanol par an, seront mises en service en 1996, l'investissement à prévoir s'élevant à environ 170 millions de francs par unité. |
Mais, le développement du marché des biocarburants (et des unités de production) passe impérativement par des dispositions fiscales favorables au plan communautaire. À cet égard, la France soutient le projet de directive Scrivener sur la fiscalité des carburants d'origine agricole. La présidence française a ainsi obtenu, lors du Conseil des ministres de l'Économie et des Finances, du 19 juin 1995, que la Commission poursuive les travaux déjà entrepris et propose un nouveau texte conforme aux règles communautaires et internationales.
Il faut cependant, indiquer que la légalité des mesures d'aides et d'exonérations françaises a été contestée par la Commission, en contradiction, d'ailleurs, avec les orientations définies par la Communauté en faveur du développement des énergies renouvelables...
Votre commission est convaincue que la recherche de nouveaux débouchés non alimentaires peut, en outre, rejoindre les préoccupations actuelles en matière de réduction de la pollution. Elle veillera, sur ce point, à ce que le futur projet de loi sur l'air prenne en compte le rôle positif que peut jouer l'incorporation de composants oxygénés dans les carburants automobiles.
6. L'adaptation aux contraintes du GATT
L'entrée en vigueur des accords du GATT, en juillet dernier, s'est faite dans une relative indifférence si l'on considère les passions qu'avait suscitées leur négociation au cours des sept années écoulées.
Rappelons que ces accords programment sur cinq ans, d'une part, la baisse de 21 % des exportations européennes subventionnées et de 36 % des aides à l'exportation (les fameuses restitutions) ; d'autre part, une plus large ouverture du marché européen, via une baisse progressive de 36 % de droits d'entrée fixes, et la clause de « l'accès minimum ». Celle-ci prévoit l'ouverture en Europe de contingents d'importation (3 % à 5 % de la consommation intérieure d'ici 2001) à droits réduits.
Les conséquences de ces accords seront très contrastées selon les secteurs.
Certains secteurs seront peu touchés parce que l'essentiel de leur exportation se fait à l'intérieur de l'Union européenne (le tiers, seulement, de nos exportations est vendu hors Communauté européenne, 47 milliards de francs, dont une partie d'ailleurs sans subvention) ou parce qu'ils ne perçoivent quasiment aucune subvention. Pour certains secteurs même, comme les vins et spiritueux, la conclusion de ces accords ouvrent des perspectives de développement.
D'autres, cependant, sont particulièrement menacés : les industries céréalières d'aval (malterie, semoulerie), l'industrie de la volaille et les industries laitières, surtout fromagères... On estime ainsi pour ces dernières, que la « contrainte » à l'horizon 2000 représente 3 millions de tonnes d'équivalent lait, soit 3 % de la production communautaire.
Votre commission déplore, sur ce point, qu'aux diminutions mécaniques des quantités exportables avec subventions, se soit ajoutée la gestion contestable du système des restitutions par la Commission de Bruxelles, en matière par exemple d'exportations de céréales ou de viandes porcine et avicole.
Pour ces secteurs menacés, différentes stratégies sont envisagées ou mises en place : privilégier l'exportation de produits plus transformés (de la farine au lieu de céréales, par exemple) ; la recherche d'une matière première moins chère, ce qui peut passer soit par la délocalisation, soit par la possibilité de transformer sur place une matière première au cours mondial. Deux pistes sont explorées.
Le mécanisme du « trafic de perfectionnement actif (TPA) » permet à un industriel d'importer la matière première au cours mondial (sans droits de douanes), à condition de réexpédier le produit fini (sans subvention) sur les pays tiers.
L'autre solution est recherchée dans le cadre d'un système de double prix de la matière première (un pour le marché européen, un pour l'export).
|
Un groupe de travail a ainsi été créé à l'ONILAIT au début de 1995 pour examiner la faisabilité technique d'un système de double prix du lait. II s'agirait, pour les 2 ou 3 % de la production communautaire devant être exportés sans restitution à l'horizon 2000, de distinguer : - le lait produit dans le cadre du quota communautaire, vendu au prix communautaire, - le lait produit hors de ce quota, vendu au cours mondial et destiné exclusivement à la fabrication de produits exportés sans restitution vers les pays tiers. Selon le ministère, les mécanismes qui ont été envisagés sont complexes et très difficiles à contrôler. En outre, le nombre de producteurs capables de vendre du lait au prix mondial (environ 70 centimes le litre, soit 30 % du prix communautaire actuel) n'est pas considérable. Il n'est d'ailleurs pas assuré que la filière laitière française soit nécessairement la mieux placée pour bénéficier du double prix en raison de la taille de ses exploitations et de la dispersion des plus grosses unités dont le coût de production marginal est le plus faible. |
Il apparaît ainsi que les solutions envisagées se heurtent à des difficultés pratiques (comment, par exemple, mettre en place un système de double prix du lait) ou d'économie agricole : est-il concevable, pour les céréaliculteurs de la Communauté, que les volailles ou les porcins destinés à l'exportation consomment des céréales des pays tiers ou pour les éleveurs laitiers, limités dans leur volume de production, qu'une partie de l'industrie fromagère transforme du lait d'Europe centrale.... ?
* 1 Cette dernière, finalement, a eu un impact direct limité sur l'activité des entreprises, à l'exception du travail du grain et de la fabrication des huiles. La diminution du prix des céréales a élargi leurs débouchés, notamment dans l'alimentation animale et réduit le coût des produits transformés (farine, pâtes). De même, la réforme a généré des difficultés d'approvisionnement et des réductions de marges pour les triturateurs de graines oléagineuses. Confrontés à des problèmes de surcapacité, ceux-ci ont accéléré la rationalisation des unités industrielles en France et en Europe.
* 2 Comme votre commission l'avait, en effet, constaté dans les avis budgétaires des années passées, en dépit d'une progression sensible depuis 1985, la dépense des entreprises agroalimentaires en faveur de la recherche reste inférieure à celle du reste des entreprises (2 milliards de francs, soit 0,9 % de la valeur ajoutée en 1992, contre 4,5 % dans l'ensemble des secteurs industriels).
* 1 Aujourd'hui, 125 entreprises réalisent les 3/4 des ventes du secteur. Les dix premiers groupes français représentent les 2/5 du chiffre d'affaires et le premier groupe 11 % à lui seul.







