VI. LA REFONTE DU DISPOSITIF D'AIDE JURIDICTIONNELLE : UNE RÉFORME TRÈS ATTENDUE
A. UNE STABILISATION DES ADMISSIONS APPELÉES TOUTEFOIS A AUGMENTER MÉCANIQUEMENT
Le
nombre des admissions au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a
cessé de croître depuis 1991, dernière année de mise
en oeuvre de l'ancien dispositif de l'aide juridictionnelle, jusqu'en 1997,
passant de 348.587 à 709.606, soit une augmentation de 103 % en six
ans.
Depuis lors, ce nombre tend toutefois à se stabiliser, voire à se
réduire (704.650 en 1999 contre 698.779 en 2000), comme le montre le
graphique ci-dessous :
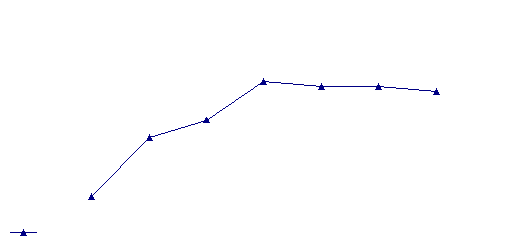
Source : infostat justice septembre 2001, n° 60
En revanche, la lente décroissance observée depuis 1998 se
confirme pour l'année 2000, qui enregistre
une baisse de
6.000 admissions par rapport à 1999
. Cette évolution
fait ressortir en revanche une hausse des aides concernant les
mineurs
123(
*
)
, les contentieux
administratifs et les contentieux relatifs aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers corrélée à une baisse
plus importante des admissions en matière civile et devant les tribunaux
correctionnels
124(
*
)
. Notons
toutefois
l'amplification de l'effet de ciseau
qui résulte d'une
baisse des admissions en matière civile (- 2,6 %) et d'une
hausse des admissions en matière pénale (+ 1,8 %).
Cette situation a donc permis de prévoir
une stabilisation de la
dotation budgétaire consacrée à l'aide
juridictionnelle
, qui s'est élevée en 2000 à 188
millions d'euros, soit un montant inférieur à la dotation
prévue en loi de finances 2001 (235,32 millions d'euros).
Toutefois, l'extension du champ de l'aide juridictionnelle ayant
résulté des réformes récentes
rend
prévisible une augmentation de la dotation budgétaire
consacrée à l'aide juridictionnelle
.
La loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et
à la résolution des conflits amiables
a étendu
l'application de l'aide juridictionnelle à plusieurs domaines
:
lors de toutes les transactions intervenues avant l'introduction de l'instance
afin de favoriser l'accès des plus démunis à des modes non
contentieux de traitement des conflits, en matière de médiation
pénale, ainsi que lors des contentieux devant les juridictions
compétentes en matière de pensions militaires.
On peut regretter que les décrets permettant à ces dispositions
d'entrer en vigueur n'aient été publiés qu'au cours de
l'été 2001, soit deux ans et demi après la promulgation de
la loi du 18 décembre 1998 précitée
125(
*
)
.
La loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence a
élargi le champ d'application de l'aide juridictionnelle en
réformant les modalités d'intervention de l'avocat au cours de la
garde à vue
127(
*
)
et en
prévoyant l'intervention de ce dernier lors des différents
débats contradictoires liés à la juridictionnalisation de
l'application des peines, et lors de l'assistance aux détenus faisant
appel des décisions rendues par les cours d'assises.
En outre,
des admissions supplémentaires sont également
susceptibles de résulter de
la revalorisation des plafonds de
ressources
fixés pour l'admission à l'aide juridictionnelle
intervenue en 2001 (+ 4,2%). En effet, pour la première fois, en
2001, la Chancellerie a consenti à un relèvement de ces plafonds
de ressources s'élevant désormais à 5.175 francs par mois
pour l'aide totale et à 7.764 francs par mois pour l'aide partielle,
afin de remédier à la hausse significative des rejets des
demandes d'aide juridictionnelle, motivée principalement par des
dépassements des seuils d'admission.
Notons que de 1992
128(
*
)
à 2001, l'évolution des plafonds de ressources, calquée
sur la progression de la tranche la plus basse du barème de
l'impôt sur le revenu, augmentait très lentement. Notons
également que la revalorisation opérée depuis 2001
s'ajoute à la progression résultant du dispositif d'indexation
prévu par la loi de 1991.
D'après les informations fournies par la Chancellerie à votre
rapporteur pour avis, une hausse similaire des plafonds était
envisagée pour 2002, cependant au cours de son audition devant votre
commission des Lois, Mme Marylise Lebranchu a annoncé qu' aucune
revalorisation de ces plafonds n'interviendrait.
B. LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 18 DÉCEMBRE 2000 ET LES PRINCIPALES CONCLUSIONS DU RAPPORT BOUCHET
Bien que
la dotation budgétaire soit essentiellement consacrée à la
rétribution des avocats par le biais des sommes versées aux
caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA),
l'insuffisance de cette indemnisation
a révélé les
limites du dispositif d'aide juridictionnelle mis en place par la loi du 10
juillet 1991.
Mécontents de la faible revalorisation de l'unité de valeur
intervenue depuis la mise en oeuvre de la réforme de 1991, l'ensemble
des avocats a exprimé son insatisfaction en engageant un mouvement de
grève générale en novembre et décembre 2000.
En effet, le
montant de l'unité de valeur (UV) de
référence
fixé à 19,06 euros (soit
125 francs) en 1992, s'est élevé à 19,51 euros (soit
128 francs) en 1993, 19,82 euros (soit 130 francs) en 1995,
20,12 euros en 1998 et
20,43 euros (soit 134 francs) en 2000
.
Aucune revalorisation n'est intervenue en 2001. Depuis 1992, la progression de
ce montant s'est limitée à 7,2 %, correspondant en
réalité à une baisse en francs constants
129(
*
)
. Ce montant concerne les missions
d'aide juridictionnelle partielle.
S'agissant de l'aide juridictionnelle totale, le montant de l'unité de
valeur de référence fait l'objet d'une majoration pour chaque
barreau en fonction du volume des missions effectuées au titre de l'aide
juridictionnelle au cours de l'année précédente au regard
du nombre d'avocats inscrits au barreau. Le montant prévisionnel moyen
de l'unité de valeur est pour 2000 de 21,95 euros (soit 144 francs).
De plus,
les modalités de calcul de la rétribution
allouée à l'avocat sont apparues
trop rigides
, ne
permettant pas la prise en compte de la réalité du travail
accompli. En effet,
chaque type de procédure correspond à un
barème attribuant un nombre défini d'unités de valeurs et
donnant lieu à une rémunération forfaitaire
, quels que
soient le temps effectivement passé par l'avocat et la difficulté
de la procédure
130(
*
)
.
Cette vague de protestation, relayée par l'ensemble des
représentants de la profession, soutenue par les magistrats, a conduit
la Chancellerie à
conclure un protocole d'accord le 18
décembre 2000 avec les organisations professionnelles
représentant les avocats afin de prévoir des mesures
d'urgence
revalorisant la rémunération accordée aux
avocats, dans l'attente d'une réforme globale de l'ensemble du
dispositif.
§ En premier lieu, un décret du 17 janvier 2001, a donc
été pris pour appliquer les mesures d'urgence prévues dans
le protocole d'accord afin de :
- revaloriser
le barème des procédures concernant
sept domaines contentieux particulièrement importants :
en matière de divorce et autres instances devant le juge aux
affaires familiales, d'assistance éducative, de reconduite à la
frontière, de baux d'habitation, de procédures correctionnelles,
de procédures devant le juge de l'exécution, de contentieux
devant le conseil de prud'hommes
131(
*
)
;
- revaloriser
le barème prévu pour l'intervention de
l'avocat au cours de la garde à vue
, afin de tenir compte de
l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000
132(
*
)
.
Notons que l'application de ces mesures intervient en deux étapes :
au 15 janvier 2001 et au 1
er
janvier 2002. Leur coût
total est estimé
à 56,25 millions d'euros, dont :
- une partie (16,66 millions d'euros) est financée en gestion 2001, sur
les disponibilités résultant de la baisse des admissions et du
délai de mise en oeuvre des mesures inscrites en loi de finances 2000 et
2001, le décret d'application de la loi du 18 décembre 1998
relative à l'accès au droit n'ayant été
publié que tardivement
133(
*
)
,
- l'autre partie étant assurée par
une mesure d'ajustement
prévue par le projet de loi de finances pour 2002
(39,59 millions
d'euros).
§ En deuxième lieu, le protocole d'accord a également
prévu
l'extension de l'aide juridictionnelle à l'assistance
aux détenus devant les conseils disciplinaires.
L'article 74
du projet de loi de finances pour 2002
134(
*
)
rend applicable ce point du
protocole.
En effet, le Conseil d'Etat
135(
*
)
a admis que l'article 24 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrés
136(
*
)
a permis la présence des
avocats aux côtés des détenus faisant l'objet d'une
procédure disciplinaire depuis le 1
er
janvier 2001.
Aucune disposition n'avait toutefois défini les modalités de
financement de cette assistance. Les conseils départementaux
d'accès au droit ont financé ces prestations hors de tout cadre
légal, et parfois avec difficultés, certains ne disposant plus
des crédits suffisants pour mener à bien leurs autres missions.
L'article 74 du projet de loi de finances pour 2002 vise donc à
remédier à cette situation et à garantir la
rétribution effective de l'avocat assistant des détenus faisant
l'objet de procédures disciplinaires.
Une enveloppe de 2,2 millions d'euros est donc prévue pour financer
cette mesure. Notons que la commission de réforme de l'accès au
droit
137(
*
)
a souligné
l'importance de l'assistance aux plus démunis au cours des
procédures dans lesquelles il peut être porté atteinte
à la liberté individuelle.
§ En troisième lieu, le protocole prévoyait également
la création de deux groupes de travail
,
l'un sur
la
gratuité des copies de dossier pénaux,
qui a
débouché sur la publication d'un décret du 31 juillet 2001
instaurant la gratuité de la première copie pénale,
l'autre sur
l'incidence du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur
l'accès au droit et sur l'exercice de la profession d'avocat
.
Parallèlement à la signature du protocole, Mme Marylise
Lebranchu, Garde des Sceaux, a mis en place
une commission de réforme
de l'accès au droit et à la justice présidée par M.
Paul Bouchet, chargée de formuler des propositions afin
d'améliorer le système d'aide juridictionnelle
. Le rapport
rendu public en mai dernier a proposé trois séries de mesures.
S'agissant de la rémunération des avocats
, elle a
préconisé la
suppression de l'aide juridictionnelle
partielle
et en contrepartie
le
relèvement du plafond de
l'aide juridictionnelle
(qui serait porté à
1.029,03 euros - soit 6.750 francs par mois - soit 120 % du SMIC),
estimant qu'un tel dispositif couvrirait un nombre de
bénéficiaires à peu près équivalent à
celui d'aujourd'hui. Elle s'est également prononcée en faveur de
la
suppression de l'unité de valeur
, jugeant ce système de
rémunération opaque. Enfin, elle a proposé de retenir de
nouvelles modalités de calcul du forfait prenant en compte la prestation
intellectuelle de l'avocat et l'indemnisation de ses frais de fonctionnement.
La prestation intellectuelle de l'avocat s'établirait à
33,54 euros de l'heure (220 francs), correspondant à la
rémunération nette d'un magistrat ayant dix ans
d'ancienneté (compte tenu à la fois des primes et de
l'ancienneté).
S'agissant de l'amélioration du dispositif à l'égard du
justiciable
, la commission Bouchet a proposé une série de
mesures destinées à renforcer son information. Le rapport
préconise la rédaction de chartes de qualité, le droit
à la consultation juridique d'un avocat pour toute personne
éligible à l'aide juridictionnelle. Il est également
envisagé de rendre obligatoire la conclusion d'un contrat écrit
entre l'avocat et son client définissant les droits et devoirs de chacun
et indiquant le montant de la rémunération de l'avocat.
Enfin, cette commission a souligné
la nécessité de
mettre en place un structure de pilotage de la politique d'accès au
droit
afin de coordonner et d'évaluer et d'associer les
différents partenaires concernés.
C. UNE AUGMENTATION SUBSTANTIELLE DE LA DOTATION CONSACRÉE À L'AIDE JURIDICTIONNELLE
A la stabilisation de la dotation consacrée à l'aide juridictionnelle observée les années précédentes succède donc une augmentation substantielle puisqu'elle passe de 235 millions d'euros en 2001 à 279 millions d'euros en 2002 138( * ) (+18%) comme le montre le graphique ci-après :
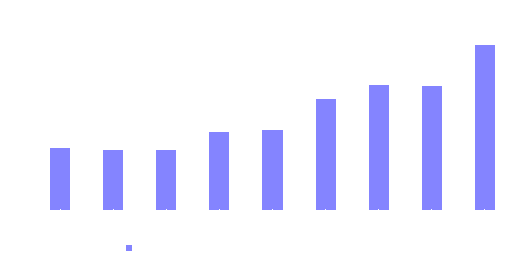
Source : chancellerie
Un ajustement total de 43,31 millions d'euros est donc prévu, qui se
décompose de la manière suivante :
- un ajustement de 39,59 millions d'euros destiné à financer
les dispositions du protocole d'accord conclu le 18 décembre 2000 mises
en oeuvre par le décret du 17 janvier 2001
139(
*
)
;
- une mesure nouvelle de 2,17 millions d'euros destinée à
financer l'extension de l'aide juridictionnelle aux procédures
disciplinaires des détenus (article 75 rattaché) ;
- une mesure de 1,48 million d'euros destinée à la
revalorisation de la rétribution des avoués pour les missions
d'aide juridictionnelle devant la cour d'appel
140(
*
)
;
- une mesure 80.000 d'euros pour étendre à la
Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte les décrets du
17 janvier 2001 et du 14 janvier 2001 précités.
On peut noter toutefois que si le projet de loi de finances pour 2002,
prévoit
une hausse du barème de certaines
procédures
141(
*
)
(voir supra), il n'est en revanche prévu aucune revalorisation du
montant de l'unité de valeur proprement dit
142(
*
)
.
Lors de son audition par votre commission des Lois,
Mme Marylise
Lebranchu, Garde des Sceaux,
a annoncé son intention de
déposer un projet de loi global plutôt que de prévoir
des mesures d'urgence partielles
. La Garde des Sceaux a toutefois reconnu,
compte tenu de la surcharge du calendrier parlementaire, que cette
réforme ne pourrait pas être adoptée définitivement
par le Parlement
avant la fin de la législature
.
L'ensemble des propositions de réforme de la commission Bouchet
fait actuellement l'objet d'une
étude approfondie
en concertation
avec les organismes intéressés. La Garde des Sceaux a
affirmé son intention de déposer
un avant projet de loi avant
le 30 novembre 2001
.
Les représentants des avocats entendus par votre rapporteur ont
regretté que l'effort budgétaire en faveur de l'aide
juridictionnelle se limite à la stricte application du protocole
d'accord signé le 1
er
décembre 2000 et qu'aucune
provision n'ait été prévue afin d'anticiper la future
réforme de l'aide juridictionnelle. Ils ont également vivement
regretté qu'aucun avant-projet n'ait été diffusé
à ce jour, dénonçant l'inadaptation du système
actuel et l'insuffisante revalorisation de leur indemnisation.
En marge de l'aide juridictionnelle, les représentants des avocats se
sont déclarés favorables à l'article 76 du projet de loi
de finances relatif au financement de la formation professionnelle des avocats
ainsi qu'aux modifications apportées au dispositif par
l'Assemblée nationale.
Rappelons que votre commission des Lois avait souhaité qu'une
réflexion sur les modalités de financement de la formation
professionnelle des avocats soit engagée au moment de l'examen de la loi
n° 98-388 du 14 mai 1998 portant diverses dispositions relatives
à la formation professionnelle des avocats (d'origine
sénatoriale
143(
*
)
).
Notons que l'article 76 du projet de loi de finances pour 2002 se limite
à pérenniser les modalités de financement existant
actuellement en leur attribuant un cadre légal.
L'article insère un article 14-1 dans la loi n°71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques afin de déterminer les sources de financement
des centres régionaux de formation professionnelle (CRFPA). Trois modes
de financement sont énumérés : une contribution de
l'Etat, une contribution provenant des produits financiers des CARPA et enfin
une contribution de la profession d'avocat dont le montant, qui ne peut
dépasser 11 millions d'euros, est fixé annuellement par le
conseil national des barreaux.
Actuellement, seule la contribution de l'Etat figure dans la loi de 1971
(près de 2 millions d'euros). La contribution des avocats (près
de 80 %) s'effectue hors de tout cadre légal
144(
*
)
. Or, un arrêt du 19 juin 2001
de la Cour de cassation a estimé que les CRFPA n'étaient pas
autorisés à imposer aux ordres d'avocats le paiement de
cotisations destinées au financement de la formation professionnelle.
L'article 74 vise donc à donner
une base légale
à
cette modalité de financement
145(
*
)
et à valider le recouvrement
des contributions des barreaux au financement de la formation professionnelle
intervenu antérieurement
146(
*
)
.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des
finances, a complété ce dispositif :
- afin de préciser que les produits financiers des CARPA constituent la
ressource « naturelle » de la formation
professionnelle
147(
*
)
;
- afin de renvoyer à un décret les conditions dans lesquelles les
dépenses supportées par un ordre au profit du centre
régional de formation professionnelle seront déductibles de sa
participation ;
- afin de compléter les modalités de financement, en ajoutant une
ressource résultant de la perception des droits d'inscription mis
à la charge des élèves avocats ; l'encadrement des
frais d'inscription perçus par les centres régionaux de formation
professionnelle étant renvoyé à un décret ;
notons que cet ajout permet de donner une base légale à la
perception de droits d'inscription mis à la charge des
élèves avocats destinés à financer la formation
professionnelle largement pratiquée par l'ensemble des
barreaux
148(
*
)
.
Ces dispositions sont le fruit d'une démarche concertée entre
l'ensemble des représentants des avocats (le conseil national des
barreaux, le barreau de Paris, et la conférence des bâtonniers) et
la Chancellerie, permettant ainsi de clarifier les modalités de
financement de la formation professionnelle. Votre commission des Lois, qui
porte la plus grande attention à la question de la formation
professionnelle des avocats, se réjouit de cette avancée.
*







