Banques: votre santé nous intéresse
Alain Lambert
Commission des Finances - Rapport 52 - 1996 / 1997
Table des matières
- AVANT-PROPOS
- INTRODUCTION
-
CHAPITRE I
UNE SITUATION DIFFICILE MAIS CONTRASTÉE- UNE CRISE D'UNE AMPLEUR SANS PRÉCÉDENT, QUI PRODUIT ENCORE SES EFFETS
- UNE CRISE DIFFÉRENTE DE CELLE QU'ONT CONNUE LES AUTRES SYSTÈMES BANCAIRES
- UNE CRISE QUI N'A PAS ÉTÉ TRAVERSÉE DE FAÇON IDENTIQUE PAR TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
-
CHAPITRE II
UNE CRISE D'ORIGINE STRUCTURELLE RENDUE INSUPPORTABLE POUR CERTAINS ACTEURS À CAUSE DE DISTORSIONS DE CONCURRENCE-
L'IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER AUX AJUSTEMENTS INDUITS PAR LES RÉFORMES
STRUCTURELLES EST LA CAUSE PREMIÈRE DE LA CRISE
- LES RÉFORMES STRUCTURELLES DES ANNÉES 1984-1989 ET L'ACCROISSEMENT DES PRESSIONS CONCURRENTIELLES
- L'IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER AUX AJUSTEMENTS
- LES ERREURS DE GESTION DES BANQUES ET LA CONCURRENCE DESTRUCTRICE
- LES FACTEURS AGGRAVANTS
-
LES DISTORSIONS DE CONCURRENCE SONT RÉELLES ET RENDENT LA CRISE INSUPPORTABLE À
CEUX QUI N'EN BÉNÉFICIENT PAS
- LES DISTORSIONS LIÉES AU MONOPOLE DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS PRODUITS SPÉCIFIQUES
- LES DISTORSIONS LIÉES À LA NATURE JURIDIQUE DES INTERVENANTS
- LES DISTORSIONS LIÉES À DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES
-
L'IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER AUX AJUSTEMENTS INDUITS PAR LES RÉFORMES
STRUCTURELLES EST LA CAUSE PREMIÈRE DE LA CRISE
-
CHAPITRE III
METTRE NOTRE SYSTÈME BANCAIRE EN SITUATION D'AFFRONTER LA CONCURRENCE INTERNATIONALE- METTRE FIN AUX BLOCAGES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
-
HARMONISER LES CONDITIONS D'EXERCICE DU METIER BANCAIRE
- GENERALISER LA DISTRIBUTION DES LIVRETS DÉFISCALISÉS
-
REDÉFINIR LE RÔLE DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE LA POSTE
- Permettre aux Caisses d'épargne d'affronter la concurrence dans les meilleures conditions
-
Redéfinir le rôle des services financiers de la Poste
- Cantonner sans restreindre les activités des services financiers, et favoriser le développement de la polyvalence
- Etablir une comptabilité analytique indiscutable et éventuellement filialiser les services financiers
- Mettre fin aux derniers privilèges fiscaux de la Poste
- Faire de la Poste un établissement de place
- CENTRALISER LA COLLECTE DES DÉPÔTS DES NOTAIRES
- POURSUIVRE LA BANALISATION DES CRÉDITS RÉGLEMENTÉS
- CHANGER LA POLITIQUE BANCAIRE DE L'ETAT
- CONCLUSION
- LISTE DES PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
- EXAMEN EN COMMISSION
-
CONTRIBUTIONS
DE CERTAINS MEMBRES DE LA COMMISSION
AVANT-PROPOS
La commission des finances du Sénat a
décidé, le 17 janvier 1996, de créer, en son sein, un
groupe de travail chargé d'étudier la
situation et les
perspectives du système bancaire français.
Ce groupe de travail, composé de Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE et de
MM. Claude BELOT, Jacques CHAUMONT, Henri COLLARD, Yann GAILLARD, Jean-Philippe
LACHENAUD, Paul LORIDANT, Philippe MARINI, Jean-Pierre MASSERET, Alain RICHARD,
et François TRUCY a été présidé par M. Alain
LAMBERT, rapporteur général.
Le présent rapport est le fruit des travaux de ce groupe. Il a pour
vocation d'éclairer la Haute Assemblée sur l'origine des
difficultés traversées par ce secteur déterminant de
l'économie nationale et de formuler un ensemble de propositions
destinées à en améliorer la situation.
En mettant l'accent sur l'analyse des causes structurelles de la crise du
secteur bancaire français, ce rapport se veut complémentaire du
rapport d'information déposé le 27 juin dernier par
M. Philippe Auberger, au nom de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, sur le "
contrôle des banques et la
protection des déposants
"
1(
*
)
.
Le groupe de travail a procédé à l'audition des
personnalités représentatives des grandes institutions et des
autorités de place concernées, ainsi que d'un grand nombre de
représentants d'organisations professionnelles et syndicales. La liste
des personnes auditionnées et le compte rendu de ces auditions figurent
en annexe au présent rapport.
Le
Commissariat général au plan
et le
Conseil de la
concurrence,
saisi sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance du 12
janvier 1986, ont apporté une contribution majeure à la
réflexion du groupe de travail au travers respectivement d'un rapport
relatif au "
système bancaire français
" et d'un avis sur
les "
distorsions de concurrence
", reproduits intégralement en
annexe au présent rapport.
Les contributions écrites des services financiers de nos ambassades de
Rome
, de
Londres
et de
Bonn
ont également
été d'une grande utilité. Elles ont apporté
l'indispensable éclairage, venu de l'étranger, sur les
spécificités du secteur bancaire en France.
Les services de la
Commission bancaire
ont enfin contribué
à étayer l'analyse chiffrée figurant en première
partie de ce rapport. Une telle analyse, dont le champ d'application porte sur
l'ensemble du secteur bancaire pour la période 1988-1995, n'avait
jusqu'à présent pas encore été
réalisée.
* *
*
Après y avoir consacré un long examen, la commission des finances a adopté le mercredi 30 octobre 1996 les conclusions du présent rapport d'information et autorisé sa publication. Certains de ses commissaires ont souhaité voir publiées leurs appréciations spécifiques. Ces contributions, ainsi que le compte rendu des débats en commission, sont consignés dans le présent document.
INTRODUCTION
Incapable de s'assurer une rentabilité suffisante sur le
marché domestique, le secteur bancaire français, pris dans son
ensemble, ne dispose pas des fonds propres nécessaires à
l'affirmation de sa présence sur les marchés tiers, aux prises de
participation dans un secteur bancaire mondial qui se reconfigure ou encore aux
investissements justifiés par les bouleversements de la sphère
financière.
Un grand pays comme la France,
soumis aux
défis de la monnaie unique et de la mondialisation des
échanges
, se doit de réagir sous peine de perdre son rang.
Si notre pays est une grande puissance économique, c'est aussi une
vieille Nation qui cultive un
héritage culturel spécifique.
La relation qu'il entretient avec son système bancaire est une
relation ambiguë, dont il convient de prendre la mesure avant de
préconiser des solutions.
Cet héritage possède plusieurs composantes
spécifiques :
· l'existence d'un secteur mutualiste et coopératif puissant ;
· l'exigence d'une contribution du secteur financier à
l'aménagement du territoire ;
· la volonté de maintenir, pour les moins favorisés de nos
concitoyens, l'accès à des services bancaires de qualité ;
· la large part prise par les fonctionnaires de l'administration des
finances dans la gestion des banques ;
· la méfiance manifestée à l'endroit des dirigeants
bancaires, à la suite de nombreuses fautes de gestion (crise
immobilière notamment) dont le contribuable est souvent appelé
à payer les conséquences.
C'est en tenant compte de cet héritage que le groupe de travail de la
commission des finances du Sénat propose un ensemble de mesures propres
à redynamiser un secteur bancaire, dont il convient encore de souligner
l'importance stratégique.
Le marché bancaire est un marché unique sur lequel il peut y
avoir pluralité d'acteurs, mais sur lequel il doit y avoir
égalité des conditions de concurrence. Cette
égalité des conditions doit être appréciée,
le cas échéant, au regard des missions de service public,
clairement définies et financées, que l'Etat peut vouloir imposer
au secteur bancaire en général, ou à tel
établissement en particulier.
De ce point de vue, il existe actuellement des distorsions de concurrence
dont la réalité ne fait plus de doute. Mais ces distorsions
n'expliquent pas la crise du secteur bancaire français, pris dans son
ensemble.
Cette crise tient en effet à des causes structurelles anciennes et
profondes que le présent rapport s'attache à mettre en
évidence
. Les contributions de toutes natures dont le groupe de
travail a souhaité disposer ont orienté et conforté son
analyse sur ce point fondamental.
* *
*
CHAPITRE I
UNE SITUATION DIFFICILE MAIS
CONTRASTÉE
La simple observation du système bancaire français
appelle trois constatations :
1. Le système bancaire vient de traverser une crise d'une ampleur sans
précédent qui, contrairement aux apparences, n'est pas
achevée.
2. Notre pays n'est pas le seul à avoir connu une telle situation. Mais
il est le seul dans lequel la crise bancaire ne s'est traduite ni par une
réduction du nombre des acteurs, ni par des licenciements significatifs,
ni même par une réduction des moyens mis en oeuvre par les
établissements de crédit.
3. Tous les établissements de crédit n'ont pas traversé la
crise de la même manière. La crise s'est accompagnée d'une
importante redistribution des cartes entre les différents types de
réseaux.
UNE CRISE D'UNE AMPLEUR SANS PRÉCÉDENT, QUI PRODUIT ENCORE SES EFFETS
Le système bancaire français vient de connaître la crise la plus grave depuis la seconde guerre mondiale. Cette crise, qui a atteint son paroxysme en 1994, s'est traduite par une baisse en valeur absolue du produit net bancaire et du résultat net d'exploitation. De tels phénomènes n'avaient jamais été observés depuis que les statistiques bancaires existent. Depuis, la situation s'est améliorée et pourrait laisser penser que la crise est derrière nous. Malheureusement, les comparaisons internationales montrent la sous rentabilité chronique de notre système bancaire et les conséquences importantes qui en résultent.
UNE CRISE D'UNE AMPLEUR SANS PRÉCÉDENT...
La crise a été d'une ampleur sans
précédent et s'est traduite non seulement par une diminution en
valeur du produit net bancaire mais aussi par des pertes record pour l'ensemble
du système bancaire.
On peut appréhender la mesure du phénomène au travers des
indicateurs d'activité et de résultat.
Les indicateurs d'activité
Comme le montre le tableau ci-après, la situation globale cumulée des établissements de crédit (la somme des bilans de l'ensemble des établissements de crédit, pour l'ensemble de leurs activités en France et à l'étranger) a connu un double ralentissement pendant les années 1991 et 1994.
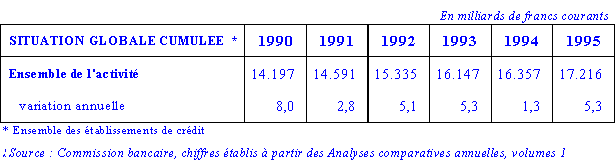
Une analyse plus fine des principaux postes de bilan fait apparaître de façon claire que le ralentissement de la croissance des activités bancaires résulte principalement de la diminution des opérations bancaires (crédits à la clientèle) et interbancaires, alors que, dans le même temps, les opérations de marché ont connu une croissance très forte.

Encore faut-il observer que la progression apparente des
crédits à la clientèle observée en 1995 s'explique
par l'impact sur les encours de crédit de certaines opérations de
défaisance, qui génèrent un double comptage à
hauteur d'environ 123 milliards de francs. Si l'on neutralise cet effet, la
progression apparente des encours de crédit fait place à une
légère contraction (- 0,2 %).
Globalement, la demande de crédit des entreprises est restée
faible, ces dernières ayant continué à dégager une
forte capacité d'autofinancement
(environ 105 à 115 %).
La
progression d'un point du taux d'épargne des ménages en 1995
,
à un niveau élevé, a continué à peser sur
leur demande de crédit, notamment en ce qui concerne les crédits
immobiliers. Même l'évolution des opérations de
marché commence à connaître une certaine stagnation
après plusieurs années de vive croissance, imputable
essentiellement à la diminution des opérations sur produits
dérivés à la suite d'un ralentissement à la demande
de la part des utilisateurs non bancaires.
Par ailleurs, l'augmentation de la collecte des dépôts depuis le
début des années 1990 résulte quant à elle de la
vive progression de l'épargne administrée, dont les encours ont
augmenté chaque année beaucoup plus vite que la moyenne (+11,9 %
en 1995).
Cette diminution de l'activité s'est traduite, jusqu'en 1995, par une
forte augmentation des provisions et par une détérioration du
taux de couverture des créances douteuses. Le rapport moyen des fonds
propres comptables au total de la situation s'est également
dégradé.

Les indicateurs de rentabilité
Il existe plusieurs façons d'apprécier et de
mesurer la rentabilité bancaire (voir encadré ci-après).
S'agissant du cas particulier de la France, cette mesure est rendue difficile
par les changements de méthodologie comptable intervenus depuis 1990 et,
notamment, par la réforme de la collecte des informations comptables
(BAFI) entrée en vigueur au 1
er
janvier 1993, qui introduit
une rupture dans les séries statistiques (voir tableaux ci-après).
On observera qu'il n'existe pas d'analyse globale sur les résultats des
établissements de crédit depuis dix ans. La seule étude
d'envergure dont on ait connaissance a été réalisée
par la Commission bancaire
2(
*
)
, mais ne porte
que sur les seules banques AFB.
L'analyse qui suit a été effectuée à partir des
Analyses comparatives (volumes 1 et 2) produites par la Commission bancaire
depuis 1988. Il en va de même des tableaux décomposant les
différents soldes de gestion établis dans la suite du
présent rapport.
Les résultats
L'analyse des résultats d'ensemble des établissements de crédit fait apparaître un fort ralentissement, voire une diminution du produit net bancaire. Face à cette évolution, la stabilisation des frais généraux ne suffit pas à éviter la chute du résultat d'exploitation et plus encore du résultat net.
Le ralentissement de la croissance du produit net bancaire
Le taux d'augmentation du produit net bancaire est passé
de 7,7 % en 1988 à 3,5 % en 1995, après avoir connu "
pour la
première fois que les statistiques sur les résultats bancaires
sont calculées
"
3(
*
)
une diminution
nette de 7,7 % en 1994.
Même si l'on neutralise les effets du
changement de méthode comptable, cette diminution demeure de l'ordre de
4,6 %.

DÉFINITION ET MESURE DE LA RENTABILITÉ BANCAIRE
Les différentes approches de la rentabilité
bancaire
La rentabilité d'un établissement de crédit
représente son aptitude à dégager de son exploitation des
gains suffisants, après déduction des coûts
nécessaires à cette exploitation, pour poursuivre durablement son
activité. Il existe plusieurs façons d'apprécier la
rentabilité bancaire, selon l'objectif poursuivi.
Pour les actionnaires
, le rapport du résultat net aux fonds
propres (
coefficient de rentabilité
ou
return on equity
ROE
) met en évidence le rendement de leur investissement. Cette
vision peut s'accommoder d'une sous-capitalisation structurelle des
établissements, un bon coefficient de rentabilité pouvant
provenir d'un faible niveau de fonds propres.
Les analystes extérieurs
, notamment les contreparties des
établissements de crédit, prennent également en compte les
autres aspects de la structure financière et en particulier, le
coefficient de rendement
ou
return on assets (ROA)
.
L'inconvénient de cette approche est qu'elle place tous les actifs sur
un même plan, alors que leurs risques sont différents et qu'elle
néglige les activités de hors-bilan qui se sont fort
développées au cours des dernières années.
C'est pourquoi,
les autorités prudentielles
utilisent plusieurs
de ces instruments d'appréciation de la rentabilité. C'est
l'éclairage d'ensemble qui résulte de leur analyse qui permet de
dégager une opinion sur la rentabilité d'un établissement.
Pour une étude plus approfondie de la mesure de la rentabilité
bancaire, le lecteur intéressé pourra se reporter utilement aux
travaux de la Commission bancaire présentés dans son rapport pour
1995 (p. 183 et suivantes).
Les instruments d'analyse de la rentabilité
* Les soldes intermédiaires de gestion
L'équilibre rentabilité/risque ne peut pas toujours être
apprécié par le seul examen du résultat net, qui est un
solde intégrant parfois des produits ou charges non récurrents
qui peuvent masquer la structure de la rentabilité des
établissements. C'est pourquoi l'analyse de celle-ci passe par la mise
en évidence de soldes intermédiaires de gestion qui permettent
d'identifier les éléments ayant concouru à l'obtention du
résultat final.
- Le produit net bancaire (PNB)
est calculé par différence
entre les produits bancaires et les charges bancaires (activité de
prêt et d'emprunt ; opérations sur titres, change, marchés
dérivés,...). Il mesure la contribution spécifique des
banques à l'augmentation de la richesse nationale et peut en cela
être rapproché de la valeur ajoutée dégagée
par les entreprises non financières. Depuis 1993, le calcul du PNB
intègre les dotations ou reprises de provisions sur titres de placement.
En revanche, les intérêts sur créances douteuses en sont
désormais déduits.
-
Le produit global d'exploitation (PGE),
calculé depuis 1993,
est un solde intermédiaire qui ajoute au PNB, les produits accessoires
et divers, les plus-values nettes de cession sur immobilisations corporelles ou
incorporelles, les plus values nettes de cession sur immobilisations
financières et les dotations nettes aux provisions sur immobilisations
financières.
- Le résultat brut d'exploitation (RBE)
s'obtient en retranchant
du PNB, majoré des produits accessoires, le volume des frais
généraux et des dotations aux amortissements. Il permet
d'apprécier la capacité d'un établissement de
crédit à générer une marge après imputation
du coût des ressources et des charges de fonctionnement.
- Le résultat d'exploitation (RE)
correspond au RBE
diminué des dotations nettes aux provisions d'exploitation. C'est
à ce niveau que la notion de risque est prise en compte. Depuis 1993, ce
solde a été remplacé par le résultat courant avant
impôt.
- Le résultat net (RN)
intègre, outre le résultat
d'exploitation, les autres produits et charges de caractère le plus
souvent exceptionnel, les dotations au fonds pour risques bancaires
généraux et l'impôt sur les sociétés.
* Les coûts, rendements et marges
L'évaluation de la rentabilité est le fruit des variations de
taux et de volume qu'il importe de pouvoir dissocier dans l'appréciation
de la situation d'un établissement de crédit. La mesure de
l'effet prix et de l'effet volume passe par l'analyse des coûts et des
rendements, obtenus en rapprochant le montant des intérêts
perçus et versés sur celui des prêts et des emprunts
correspondants. Un calcul de marge peut dès lors être
réalisé sur les différentes activités
d'intermédiation (opérations avec la clientèle,
opérations de trésorerie) et donner lieu en définitive
à une évaluation de la
marge globale
d'intermédiation
.
Depuis 1993, ce ratio a fait place à celui de
marge bancaire globale
dont la création a été motivée, d'une part, par
la nécessité d'avoir un ratio prenant en compte l'ensemble de
l'activité bancaire, y compris les activités de service et de
hors-bilan (la distinction entre intermédiation et non
intermédiation tendant à devenir plus imprécise), et,
d'autre part, le souci de calculer un indicateur simple facilement utilisable
dans les comparaisons internationales. Elle résulte du rapport du PGE
sur le total de bilan et "l'équivalent crédit sur instruments
financiers à terme".
Compte tenu du fort développement des opérations bancaires hors
intermédiation (services de conseil, opérations sur
marchés dérivés...) il est souhaitable de tenir compte
dans l'analyse des produits et charges qu'elles génèrent et de
rapporter l'ensemble des gains nets ainsi obtenus au total des fonds
utilisés, qui sont constitués des fonds empruntés et des
capitaux propres. Le taux ainsi calculé est un indicateur du
rendement global
d'un établissement de crédit. Cet
indicateur est resté inchangé par la réforme de 1993.
* Les ratios d'exploitation
Plusieurs ratios peuvent être calculés afin de mettre en
évidence les structures d'exploitation. Les plus utilisés sont :
- le coefficient global d'exploitation -
rapport des frais
généraux au PGE. Il montre de façon synthétique la
part des gains réalisés qui est absorbée par les
coûts fixes.
- le coefficient de rentabilité :
rapport du résultat net
aux fonds propres (capital, réserves et éléments
assimilés, report à nouveau), autrement appelé
return on equity ROE
.
- le coefficient de rendement :
rapport du résultat net au total
du bilan, autrement appelé
return on assets (ROA)
.
La maîtrise des frais généraux
Les frais généraux absorbent entre 60 et 80 % du
produit net bancaire. Aussi, leur évolution revêt-elle la plus
grande importance dans la perspective de l'amélioration de la
rentabilité. C'est ce qui explique que leur taux de progression ait
été fortement limité, passant de 7,1 % en 1988 à
0,9 % en 1994. Cet effort est particulièrement sensible sur les charges
de personnel qui ont légèrement diminué en 1994, ce qui
est en partie imputable à la diminution des effectifs dans le secteur
bancaire.
La croissance des charges générales s'est également
modérée en passant de + 7 % en 1990 à 1 % en 1994.
L'effort de modernisation des conditions d'exploitation est encore sensible,
mais beaucoup moins qu'à la fin des années 80, au cours
desquelles les dépenses en ce domaine ont été
élevées.

La diminution du résultat brut d'exploitation
L'évolution du
résultat brut d'exploitation
a fluctué pendant les dernières années entre un
maximum de 20,7 % d'augmentation en 1991 et un minimum de 25 % de
décroissance en 1994. Elle suit d'assez près l'évolution
du produit net bancaire.
Au vu des principaux ratios d'exploitation, les conditions d'exploitation
bancaire se sont dégradées. Le coefficient net global
d'exploitation qui avait diminué de 70,9 en 1990, jusqu'à 65,2 en
1993, est brutalement remonté en 1994 (il est passé selon les
nouvelles méthodes comptables de 71,2 en 1993 à 76,8 en 1994).
Cette dégradation des conditions d'exploitation a amputé le
résultat brut d'exploitation de 1994 de près du quart.
Par ailleurs, l'importance en volume des dotations aux provisions et aux
pertes sur créances irrécupérables, qui sont
passées de 42,6 milliards en 1990 à 127.8 milliards en 1993,
explique en grande partie l'effondrement du résultat d'exploitation qui
a connu une diminution historique en 1994 (-83 %).
On notera la diminution des provisions en 1994 (-15 %) même si,
calculé selon les anciennes méthodes comptables, ce chiffre
serait légèrement moins important (-10 %)
4(
*
)
.

La contraction du résultat net
Le tableau ci-après traduit de façon assez
éloquente l'ampleur de la crise traversée par le système
bancaire français puisqu'on constate que
le résultat net de
l'ensemble des établissements de crédit, qui était de 40,2
milliards de francs en 1988 est devenu négatif en 1994 à hauteur
de 11 milliards.
La récente amélioration de ce résultat en 1995,
imputable pour l'essentiel au raffermissement de la demande de crédit et
à la maîtrise des frais généraux, marque peut
être l'amorce d'un nouveau cycle. Ce résultat n'en demeure pas
moins très inférieur à son étiage normal et
témoigne de la sous-rentabilité du secteur.

La formation du résultat d'exploitation
Les composantes du produit net bancaire
Il convient de noter que, jusqu'en 1994, la croissance du
produit net bancaire imputable aux implantations à l'étranger a
été nettement supérieure à celle du produit net
bancaire sur l'activité métropolitaine. En 1994, cette tendance
ne s'est pas poursuivie
et la rentabilité s'est surtout
améliorée dans le financement de secteurs domestiques
(crédit à la consommation, engagements sur les petites et
moyennes entreprises).

Il convient également de noter que,
sur l'ensemble de
l'activité, les opérations avec la clientèle
(crédit bancaire classique) ont été à l'origine de
la faiblesse des résultats
. En tenant compte des opérations
de crédit-bail et de location simple, elles ont dégagé,
pour l'année 1995, 381,8 milliards de francs de produit net, (soit 107 %
du produit global d'exploitation, contre 116 % en 1994, 126 % en 1993
et 129 % en 1992
5(
*
)
).

L'évolution de la marge globale d'intermédiation
La dégradation de la rentabilité d'exploitation est attestée par l'évolution de la marge globale d'intermédiation. Celle-ci est en diminution constante depuis le milieu des années 80, passant de 2,07 % en 1988 à 1,19 % en 1994.

La marge bancaire globale, calculée depuis 1993, qui rapporte le produit global d'exploitation au total de l'activité (y compris le hors-bilan à terme) témoigne de la baisse persistante de la rentabilité brute. Elle est ainsi passée de 2,16 % en 1993 à 1,92 % en 1994 pour l'ensemble des établissements sur toutes les zones d'activité. Calculée sur les seules activités métropolitaines, elle est passée de 2,25 % à 2,02 %.
L'analyse du rendement global
Le rendement global a lui aussi connu une baisse tendancielle
depuis le milieu des années 80.
La contribution de l'activité de prêts et d'emprunts à la
formation du rendement global est passée de 70 % en 1990 à 56,3 %
en 1993. Établie à partir de soldes intermédiaires
différents à partir de 1993, cette contribution est passée
de 69 % à 59 %.
Cette diminution est d'autant plus préoccupante que le rendement
global doit être suffisant pour couvrir les charges d'investissement et
de fonctionnement, doter les comptes de provisions et dégager un
résultat net après impôt. Tel n'a pas été le
cas en 1994.

Les indicateurs ci-dessus, tout en permettant de mesurer l'ampleur de la crise traversée par notre système bancaire, montrent que la situation s'est améliorée depuis 1995. On pourrait en déduire que le pire est désormais passé et que la crise était essentiellement conjoncturelle. Malheureusement, il n'en est rien.
... QUI PRODUIT ENCORE SES EFFETS
Si l'on compare les banques françaises à leurs
compétiteurs internationaux, la situation demeure au contraire
très préoccupante. Les établissements de crédit
français, en situation de sous-rentabilité chronique, sont mal
placés dans la compétition internationale. Si l'évolution
se poursuit dans ce sens, on peut nourrir une vive inquiétude sur leur
capacité à faire face au choc concurrentiel qui résultera
de la mise en place de la monnaie unique.
On rappellera en préalable, que l'analyse des comparaisons
internationales doit être conduite avec prudence et doit s'attacher
davantage aux évolutions qu'aux valeurs absolues. En effet, ces
comparaisons sont difficiles du fait des différences de
réglementation, de comptabilité et de structure existant entre
les différents systèmes bancaires.
Sous ces réserves, les comparaisons dont on dispose
6(
*
)
mettent clairement en évidence l'insuffisance
de la rentabilité des banques françaises pour faire face à
la compétition internationale.
Le constat de l'insuffisante rentabilité des banques françaises
Si les banques françaises occupent une position médiane s'agissant du produit net bancaire, en revanche, les comparaisons en termes de rentabilité et de profitabilité apparaissent nettement défavorables. Insuffisance qui n'est pas sans conséquence.
La position médiane des banques françaises sur le produit net bancaire
Les principales banques suisses sont celles qui ont
enregistré la croissance la plus forte de leur PNB. Bien que la
période d'observation soit plus brève que
précédemment (1990-1995), le taux moyen de progression a
été de 9,42 %. Les principales banques allemandes ont
également enregistré un fort accroissement de leur PNB (+8,6 % en
moyenne), largement imputable au processus de réunification, de
même que les principales banques américaines (+ 8,09 %).
Les banques françaises font, avec les banques britanniques, partie du
groupe médian dans lequel le PNB a progressé d'environ 4,7 % par
an. La bonne position des banques françaises résulte en partie de
la concentration du système bancaire français, sans doute plus
prononcé que dans les autres pays.
Enfin, les principales banques espagnoles, italiennes et surtout japonaises
ont toutes connu une décroissance globale de leur produit net bancaire.

L'insuffisante rentabilité des banques françaises
Comme le met en évidence le rapport du Commissariat au plan sur le système bancaire français, la rentabilité des banques françaises comparée à celle de ses principaux concurrents apparaît faible, sous quelque critère qu'on l'examine.
La rentabilité brute
La rentabilité brute peut être appréhendée au travers du ratio résultat brut d'exploitation (avant provisions) sur l'actif moyen. Les chiffres du graphique suivant sont extraits d'une étude de Standard & Poor's et portent sur un échantillon d'environ soixante banques de rang international. Ils font apparaître que la rentabilité brute des banques françaises se situe bien en dessous de la rentabilité des banques britanniques et des banques américaines.

La rentabilité économique et la rentabilité financière
La rentabilité économique (voir
supra
encadré) peut être appréhendée à travers
le coefficient de rentabilité (ou
return on equity
) tandis que la
rentabilité financière peut être mesurée à
travers le coefficient de rendement (
return on assets
).
Le tableau ci-après montre que, de ces deux points de vue, la
rentabilité des banques françaises est parmi les plus mauvaises
des pays du groupe sélectionné, ne devançant, si l'on peut
dire, que les banques japonaises.
Il semble également important de relever que la rentabilité
des banques françaises est environ trois fois inférieure à
celle des banques britanniques et davantage encore par rapport à celle
des banques américaines.

Les conséquences de ce mauvais positionnement
L'handicap de développement et l'augmentation des coûts de refinancement
La faible rentabilité des banques françaises se
traduit évidemment par un handicap en termes de développement
tant interne
(accumulation d'actifs risqués nécessitant des
fonds propres)
qu'externe
(possibilités d'effectuer des
aquisitions).
Cet handicap de développement est pris en compte dans les classements
internationaux. La revue "
The Banker"
qui classait encore en
1991 quatre
banques françaises parmi les quinze premières banques du monde,
en fonction de l'importance des fonds propres, n'en classe plus aujourd'hui que
deux.
Cette perte de rang
ne serait pas très grave, sauf peut
être pour notre orgueil national, si elle n'allait de pair avec une
dégradation de la
notation des établissements
.
Or, l'évolution des notations établies par l'agence Standard
& Poor's fait apparaître que, de 1988 à 1990, la notation
moyenne des banques françaises était au même niveau que
celle des banques britanniques et allemandes et supérieure à
celle des banques américaines. En 1995, elle est devenue nettement
inférieure à celle des deux premiers pays et se situe au niveau
des banques américaines, qui remonte depuis 1992.

Par ailleurs, une récente étude du Crédit Agricole
7(
*
)
montre que, sur un an, à la fin
août les notations des banques françaises ont largement
baissé. Les notations établies par l'agence Ibca pour la dette
à long terme de 30 établissements se répartissent en 12
abaissements, 17 confirmations et 1 relèvement.
De même, en 1995, sur 70 groupes bancaires et financiers examinés
par Standard and Poor's, 21 ont été abaissés, 43
confirmés et 6 relevés. Selon l'auteur de l'étude, ce
phénomène s'explique par l'érosion des marges
d'intermédiation et la difficulté pour les banques à
poursuivre le relèvement des commissions, en raison de la concurrence.
Or, cette dégradation de ce qu'il est convenu d'appeler le
rating
des banques, se traduit mécaniquement par
un
renchérissement des coûts de refinancement
.
La situation d'opéabilité technique permanente du système bancaire français
Bien évidemment, la faible rentabilité des
banques françaises a pour corollaire la faiblesse de leur
bénéfice net.
Or, non seulement, les grands groupes bancaires français
réalisent moins de bénéfices que leurs concurrents
internationaux, mais encore ils voient ce bénéfice diminuer alors
que celui de leurs concurrents augmente. Les banques françaises ont en
effet enregistré une baisse de bénéfice depuis le
début de la période (- 80 %) alors que, dans le même temps,
les banques britanniques voyaient leurs profits augmenter de plus de 43 % et
les banques américaines de près de 38 %.

Si l'on cumule les bénéfices nets de ces groupes bancaires sur 5
ans, la France arrive en avant-dernière position.

Cette faiblesse des résultats entretient à son
tour ce que le rapport du Commissariat général au plan appelle
"
la situation d'opéabilité technique
" du
système bancaire français.
Pour reprendre les exemples formulés avec pertinence dans ce rapport :
avec 3,8 milliards de dollars de profit net, la Hong Kong and Shanghai Bank of
China peut acheter avec moins de trois ans de profit la Société
générale, avec moins de deux ans de profit Paribas ou la BNP et,
avec moins d'un an, le Crédit Lyonnais.
Barclays qui réalise presque 2 milliards de dollars de profit en 1995,
soit l'équivalent de la totalité des bénéfices des
banques françaises cette même année, se trouve dans une
"situation stratégique potentielle équivalente".
Dans ces conditions, il ne faudrait pas se réjouir trop vite des signes
encourageants qui émanent des derniers bilans bancaires. Le premier
octobre 1996, la revue Euromoney pouvait encore écrire : "
Tout ce que
vous avez appris au sujet des banques françaises est encore vrai. Leur
coefficient de rentabilité (ROE) et leurs ratios capitalistiques sont
parmi les plus bas du monde développé. Cela est aussi vrai pour
les banques qui ont été privatisées. Leur coefficient
d'exploitation est extrêmement élevé (même si cela
résulte davantage de la faiblesse de leurs revenus que de l'importance
de leurs coûts). La situation dans laquelle elles se trouvent est en
train de changer, mais de façon dramatiquement lente. Et, comme une
cerise sur le gâteau, leurs marges sur les crédits sont
inexistantes."
8(
*
)
*
On retiendra de cette première partie, les principaux
éléments suivants :
- le ralentissement de la demande de crédit et la baisse, pour la
première fois dans notre histoire, du PNB bancaire ;
- la sous-rentabilité chronique des banques françaises ;
- leur mauvaise position dans la concurrence internationale.
Cette situation laisse d'autant plus perplexe que beaucoup de systèmes
bancaires étrangers et, notamment, les systèmes bancaires
britanniques et américains, ont connu une crise d'une ampleur au moins
aussi importante que le système bancaire français et semblent
s'en être sortis de façon beaucoup plus rapide.
L'analyse comparative montre en effet le caractère spécifique
de la crise bancaire française.
*
UNE CRISE DIFFÉRENTE DE CELLE QU'ONT CONNUE LES AUTRES SYSTÈMES BANCAIRES
L'analyse comparée met en évidence la faiblesse et la lenteur des ajustements en France par contraste avec l'ampleur et la rapidité des ajustements à l'étranger.
LA FAIBLESSE ET LA LENTEUR DES AJUSTEMENTS EN FRANCE ...
Jusqu'en 1995, la crise bancaire ne s'est traduite, dans notre pays, ni par une disparition significative d'acteurs, dont le nombre réel a au contraire augmenté, ni par des réductions d'effectifs importantes. Le nombre de guichets bancaires est même resté relativement stable.
L'augmentation du nombre des acteurs
S'agissant tout d'abord du nombre des établissements de
crédit, trois observations s'imposent.
1° Le nombre apparent des établissements de crédit a
connu une forte diminution sur la période 1984-1995.
En effet, comme le montre le tableau ci-dessous, le nombre total des
établissements de crédit (hors Monaco) est passé de 2.001
en 1984 à 1445 en 1995. Cette diminution globale de 556 unités
correspond à une variation nette de - 28 % du nombre des
établissements.

2° Cette diminution apparente s'explique essentiellement par des
considérations d'ordre juridique.
En effet, la diminution constatée s'explique en grande partie par des
considérations d'ordre juridique (changement de catégorie) ou
tenant à la stratégie de certains groupes (regroupements).
Comme le montre le tableau ci-dessous, le décompte des
entrées-sorties du système bancaire, corrigé des effets de
structure, fait
apparaître un solde positif de 330 unités sur
la période
.

Cette restructuration a pris diverses formes :
- certaines filiales qui n'avaient plus guère d'activités et
n'avaient parfois été conservées que pour des raisons
liées à l'état de la réglementation (notamment du
fait de leur potentiel d'encadrement du crédit) ont été
soit absorbées, soit cédées ;
- les établissements qui ne possédaient pas une taille suffisante
pour conserver leur autonomie juridique et économique ont
été regroupés avec d'autres établissements
exerçant des activités comparables ou complémentaires ;
- en sens inverse, lorsque des perspectives suffisantes de développement
d'activités nouvelles sont apparues, ces groupes ont pris l'initiative
de créer de nouveaux établissements, de manière à
identifier la rentabilité comme les risques de ces nouvelles
activités ;
- certains établissements, désireux de se spécialiser dans
les activités de banques d'affaires, ont cédé tout ou
partie de leurs réseaux de guichets, notamment à des banques
étrangères qui ont pu ainsi trouver des structures
déjà opérationnelles en France ;
- enfin, des opérations de restructuration de plus en plus complexes ont
été réalisées au moyen de cessions partielles
d'éléments spécifiques d'actifs, voire de scissions
d'établissements, dans le cadre d'accords destinés à
réunir des branches d'activités ou des clientèles pour
constituer de nouveaux pôles de développement à
l'intérieur ou à l'extérieur des groupes concernés.
Ainsi, la baisse des effectifs des sociétés financières
s'explique par la disparition de nombreuses sociétés de caution
mutuelle en tant qu'établissements de crédit dont la plupart ont
été rattachées aux banques régionales avec
lesquelles elles exerçaient leur activité ("agrément
unique").
D'autres réseaux ont achevé (par exemple les Caisses
d'épargne en 1993) ou poursuivi (par exemple le Crédit agricole)
leur mouvement de restructuration.
La restructuration des caisses
d'épargne et de prévoyance dont le nombre est passé de 468
en 1984 à 35 en 1995 explique, à elle seule, la
quasi-totalité de la diminution apparente des établissements de
crédits (433 unités sur un total de 556).
En revanche, la catégorie des banques commerciales (banques
affiliées à l'AFB) n'a pas enregistré de baisse notable de
ses effectifs sur la période. Ce n'est qu'à partir de 1995, que
l'on assiste à une très légère diminution des
effectifs (- 6 unités).
3° Loin de diminuer, le nombre réel des acteurs a
augmenté sur la période.
Comme le montre le graphique ci-après, le nombre des banques AFB (ou
leur équivalent avant 1984), après avoir connu un plus bas en
1968 (284 établissements) est passé à 349 en 1984 (+ 65
unités en 16 ans) puis à 412 en 1994 (+ 63 en dix ans). Le trend
d'augmentation a été beaucoup plus rapide jusqu'en 1990, puis
s'est stabilisé à partir de cette période.
Graphique établi à partir des chiffres du rapport annuel du
Comité des établissements de crédit 1995

Ces évolutions, qui démontrent, pour le moins, une certaine stabilité du système bancaire , sont corroborées par les observations que l'on peut faire concernant les moyens mis oeuvre par les établissements et le maintien de l'offre de services bancaires de proximité.
La stabilité des guichets et des effectifs
Les guichets
Globalement, le nombre des guichets bancaires est resté stable sur la période 1984-1995 passant de 25.782 à 25.479 unités, ce qui représente une diminution de 1 %. Si l'on prend comme point de départ, la fin de l'année 1981 on constate même une augmentation du nombre des guichets d'environ 5 %. Accessoirement, on notera que le nombre des distributeurs automatiques de billets et des gestionnaires automates de banque a quasiment doublé en sept ans, passant de 11.457 unités en 1988 à 22.852 unités en 1995.
Les effectifs
Comme le met en évidence le graphique ci-après, on
constate également
une grande stabilité des effectifs des
différents réseaux bancaires
au cours des dix
dernières années. Ceux-ci n'ont varié que dans une
fourchette de 20.000 personnes entre le point le plus haut, atteint en 1988
(433.000 personnes employées par le secteur) et le point le plus bas en
1995 (409.800), ce qui représente une variation de l'ordre de 5 %. Si
l'on prend comme point de départ 1984, la baisse n'est plus que de 3 %.
Graphique établi à partir des chiffres du rapport annuel du
Comité des établissements de crédit 1995
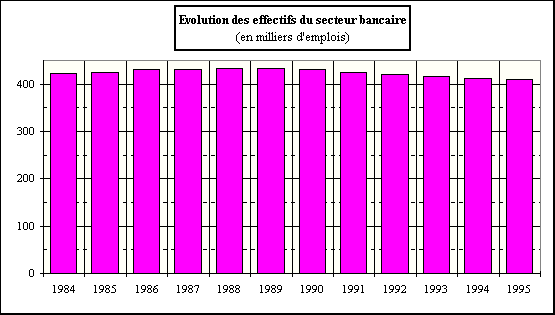
... CONTRASTENT AVEC L'AMPLEUR ET LA RAPIDITÉ DES AJUSTEMENTS À L'ÉTRANGER
Les difficultés rencontrées par les
établissements nationaux ne sont pas spécifiques à notre
économie. L'ensemble des systèmes bancaires des pays
développés est passé ou passe par de graves crises.
Certains, comme le Japon sont toujours au milieu de la crise ou, comme la
Suisse, mènent une restructuration en profondeur. D'autres comme les
Etats-Unis ou la Grande-Bretagne ont tourné la page de leurs
difficultés et développent une attitude offensive calculée
sur les marchés qu'ils ciblent.
On trouvera dans le rapport du commissariat général au plan, une
analyse détaillée, pays par pays, qui nous autorise à
présenter une vue cavalière des ajustements mis en place.
L'ampleur des ajustements
L'ajustement par le nombre des acteurs
Les Etats-Unis
Au tournant des années 1990, le secteur bancaire
américain a vécu une crise majeure. De deux en moyenne dans les
années 1970, les faillites bancaires sont passées à 130 en
moyenne entre 1982 et 1991. Leur nombre n'a baissé qu'à partir de
1992 (100 banques commerciales) pour revenir à 42 en 1993, 11 en 1994 et
6 en 1995. Le
Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC ou Fonds
d'assurance des dépôts bancaires) a fermé ou aidé,
de 1986 à 1991, plus de 900 banques commerciales.
Cette crise a été particulièrement grave concernant les
caisses d'épargne : de 4.000 en 1980, il n'en reste plus aujourd'hui que
1.700. Le
Federal Savings and Loans Insurance Corporation
(FSLIC ou
Fonds d'assurance des caisses d'épargne) a lui-même fait faillite
en 1989 et a dû être placé, sous la forme d'un FSLIC
Resolution Fund
(FRF né en 1989 pour gérer les actifs et
les obligations du FSLIC en faillite) placé sous la
responsabilité du FDIC. Le coût budgétaire de la crise des
caisses d'épargne, qui n'est pas encore tout à fait
terminée, s'est élevé à 150 milliards de dollars.
Le Royaume-Uni
Le système bancaire britannique s'est concentré
encore davantage avec l'absorption en 1991 de la Midland Bank par la Hong Kong
and Shanghai Bank pour devenir la Hong Kong and Shanghai Bank of China Holding.
La crise des
building societies
(équivalent des caisses
d'épargne) n'est pas encore terminée. Ramené de 126 en
1989 à 80 à la fin de 1995
9(
*
)
,
leur nombre est encore trop élevé pour certains observateurs
financiers.
La Suisse
Le système bancaire suisse, qui place ses trois grandes banques (Union de banques suisses, Crédit suisse, Société de banques suisses) dans les 220 premières sociétés cotées de la planète 10( * ) , a également entrepris une restructuration drastique de ses réseaux qui s'est traduite par la disparition de 175 banques. Ainsi, le Crédit Suisse a ramené son réseau de 376 à 250 succursales. L'UBS a fermé trente agences ces trois dernières années et n'offre la totalité des services bancaires que dans une trentaine d'agences sur 285.
Le Japon
Le système bancaire japonais vit certainement la plus
grave crise de son histoire. Il est aussi celui qui, sur le plan national, est
à l'heure actuelle, dans la situation la plus fragile, à cause de
la faillite des
Jusen
et de sa répercussion sur les bilans des
grandes banques japonaises.
Les
Jusen
sont des institutions de crédit
spécialisées dans le crédit hypothécaire
créées par les grandes banques japonaises au cours des
années 1970. Huit ont vu le jour, dont 7, en grande difficulté,
sont en voie de liquidation.
L'ajustement par les effectifs
Aux Etats-Unis, la baisse des effectifs a été
d'environ 10 % par rapport à l'effectif initial total.
Au Royaume-Uni, le secteur bancaire n'employait plus en 1995 que 370.000
personnes contre 460.000 en 1989, ce qui représente une diminution
d'environ 20 %. 75.000 emplois devraient encore être supprimés
dans les dix ans à venir
11(
*
)
.
En Suisse, 9.000 emplois ont été supprimés depuis 1988.
Le Crédit suisse, à lui seul, supprimé 5.000 emplois dont
3.500 en Suisse, ce qui est vécu, dans le premier pays bancarisé
du monde, comme une sorte de séisme. Le total des effectifs, qui
était encore de 119.000 à fin 1995, devrait passer sous la barre
des 100.000 d'ici à l'an 2.000 (- 16 %). La SBS devrait supprimer 1.700
emplois d'ici trois ans mais sans licenciement. Les trois grandes banques ont
refondu et concentré leurs organigrammes.
La vitesse des ajustements
Aux Etats-Unis, les banques commerciales ont recommencé
à enregistrer des profits records dès 1992 (32 Milliards de
dollars) et en 1993 ceux-ci passaient à 43,4 Milliards de dollars.
Même les caisses d'épargne ont recommencé à faire
des profits à partir de 1993 (7 Milliards de dollars).
Les grandes banques britanniques ont renoué avec les profits depuis
1992. Le système a également fait la preuve de sa capacité
à gérer efficacement des sinistres bancaires majeurs comme la
défaillance de la
Barings
, dont plus personne ne parle
aujourd'hui, contrairement au Crédit Lyonnais, même si ces deux
banques ne sont pas directement comparables.
Les grandes banques suisses n'ont jamais vraiment cessé de faire des
profits et ont joué, avec les banques néerlandaises, un
rôle majeur dans le rachat des grandes banques d'affaires britanniques,
ce que les banques françaises n'ont pas été en mesure de
faire.
Le Japon connaît une situation assez voisine de la France, avec une
crise bancaire qui n'en finit pas de durer et qui explique, en partie du moins,
la politique monétaire extrêmement accommodante de la Banque
centrale japonaise, dont le taux de refinancement est voisin de zéro.
Seul en définitive, le système bancaire allemand semble
être passé au travers de la crise en raison notamment de
l'accroissement de la demande de crédit résultant de la
réunification du pays. Il est vrai qu'il n'a pas connu une
révolution réglementaire comparable à celle du
système bancaire français et que sa modernisation est, pour
partie, encore à faire.
UNE CRISE QUI N'A PAS ÉTÉ TRAVERSÉE DE FAÇON IDENTIQUE PAR TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Il est possible de distinguer les différents
établissements de crédit en fonction des
critères
juridiques
tirés de la loi bancaire. On distingue alors
six
groupes
qui sont :
- les "
banques
" qui, entre autres caractéristiques communes,
sont
toutes affiliées à l'Association française des banques,
d'où leur nom de "banques AFB" ;
- les banques mutualistes ou coopératives ;
- les caisses d'épargne ;
- les caisses de crédit municipal ;
- les sociétés financières dans laquelle il convient de
ménager une place à part aux maisons de titres ;
- les institutions financières spécialisées.
Mais il est également possible de reprendre la classification
adoptée par la Commission bancaire sur la base de
données
économiques
et qui distingue
neuf grands groupes homogènes
qui sont :
- les très grands établissements ou réseaux à
vocation générale ;
- les grands établissements ou réseaux à vocation
générale ;
- les établissements ou réseaux petits ou moyens à
vocation générale ;
- les banques locales ou mixtes ;
- les établissements de financement spécialisés ;
- les établissements de marché ;
- les établissements de groupe, d'ingénierie ou de portefeuille ;
- les banques étrangères et enfin, les autres
établissements ;
- les "autres établissements".
Que l'on utilise l'une ou l'autre de ces classifications, on doit constater
que la crise n'a pas été traversée de la même
façon par tous les établissements de crédit.
LA DIVERSITÉ DES RÉSULTATS FINANCIERS
Les tableaux ci-après mettent en évidence la
diversité des résultats d'une catégorie à une
autre, observés sur la période 1988-1993.
S'agissant tout d'abord du
produit net bancaire
, on constate que la
part relative des banques dans ce solde de gestion a diminué
légèrement, passant de 53,6 % à 50,1 %. Cette tendance
s'est du reste confirmée en 1994, puisque cette part a été
ramenée à 48,6 %. Cette diminution relative a
bénéficié principalement aux banques mutualistes et aux
caisses d'épargne dont la contribution au PNB du secteur est
passée respectivement de 24,1 à 26,1 % et de 5,1 à 6,7 %.
Cette évolution s'explique par des taux de progression du PNB
très différents entre ces catégories.
Ainsi, alors que
le PNB des banques n'a progressé sur la période que de 26,7 %,
cette progression a été de 46,7 % pour les banques mutualistes et
de 76,8 % pour les caisses d'épargne.
Si l'on raisonne en termes de groupes homogènes, on constate une
certaine stabilité dans les parts respectives des différents
groupes, à l'exception toutefois des établissements de
financement spécialisés qui ont accru leur part de 2,4 points et
ont connu le taux de progression de leur PNB le plus élevé (+
56,1 % contre 35,3 % en moyenne) suivis de près par la catégorie
des banques étrangères (+46,2 %).
L'analyse des
frais généraux
montre, quant à elle,
que
les banques ont réussi à maîtriser leur
évolution beaucoup mieux que les caisses d'épargne (+ 30, 8 %
contre + 60,8 %), mais moins bien que les banques mutualistes (+ 23,9 %).
Par groupes homogènes, ce sont les grands moyens ou
établissements qui ont le mieux maîtrisé l'évolution
des frais généraux (+10,9 % contre 31,2 % en moyenne), ainsi
que les banques locales ou mixtes. En revanche, les très grands
établissements ou réseaux à vocation
générale ont moins bien maîtrisé cette
évolution (+31,2 %).
Dans ces conditions, l'évolution du
résultat brut
d'exploitation
des banques (+ 8,6 %) a été beaucoup moins
importante que celui des sociétés financières (+ 36,3 %),
des banques mutualistes (+ 76,6 %) et des caisses d'épargne (+ 89,6 %).
Par groupes homogènes ce sont les établissements de financement
spécialisés qui ont connu l'évolution la plus favorable (+
80,9 %) et les banques étrangères (+ 38 %), la moyenne
s'établissant à une progression du RBE de + 33,5 %.
Après prise en compte des dotations nettes aux
provisions
et des
pertes sur créances irrécupérables, ces évolutions
apparaissent encore plus contrastées au niveau du
résultat
d'exploitation
. En effet, celui des banques a diminué de 167 % alors
que celui des banques mutualistes augmentait de 67 % et celui des caisses
d'épargne de 206 %. Les autres catégories ont toutes
enregistré une diminution nette de leurs résultats moyens
d'exploitation.
Ce sont les établissements ou réseaux petits ou moyens à
vocation générale ainsi que les banques locales ou mixtes qui ont
enregistré la plus forte baisse du résultat d'exploitation
(respectivement - 451 % et - 761 %). Les très grands
établissements semblent avoir beaucoup mieux résisté
à la crise puisque leur résultat d'exploitation n'a
diminué que de 5,8 % contre 72 % en moyenne.
Enfin, on retrouve au niveau du
résultat net
ces mêmes
évolutions. Les banques qui réalisaient en 1988 un
résultat net de + 15,3 milliards, enregistraient en 1994 une perte de -
24 milliards. Dans le même temps, le résultat net des banques
mutualistes est passé de + 5,9 à 8,3 milliards et celui des
caisses d'épargne de 2,1 à 1,3 milliards de francs.

Économiquement, ce sont les établissements de
marché et les très grands établissements qui ont le mieux
résisté à la crise et les établissements petits ou
moyens ainsi que les banques locales ou mixtes qui ont le moins bien
résisté. Les banques étrangères ont du mal à
asseoir la rentabilité de leurs investissements en France, ce qui prouve
que le problème tient davantage aux caractéristiques du
marché bancaire français, qu'à la gestion des banques
françaises.
Ces éléments transparaissent clairement de l'analyse
chiffrée qui suit.






LA DIVERSITÉ DES ÉVOLUTIONS RÉELLES
Les tableaux ci-après mettent en évidence
l'importance des contrastes entre les différents réseaux
bancaires, que ce soit en termes de guichets ou en termes d'effectifs.
On constate ainsi que les banques AFB auxquelles on peut rattacher
également le groupe formé par les banques populaires ont
enregistré une diminution globale de leurs effectifs (-28.100 pour les
banques AFB) et une augmentation de leur présence sur le territoire (+
284 guichets).
A l'opposé, les Caisses d'épargne et le Crédit Mutuel ont
vu leurs effectifs s'accroître respectivement de 10.000 personnes et de
3.500 et leur présence diminuer (- 156 et -616 guichets).
Seul le Crédit Agricole semble être resté stable dans ses
effectifs comme dans le nombre de ses guichets.
Comme le relève le rapport 1995 de la Commission bancaire, cette
"
grande diversité
" des situations individuelles reflète
à la fois les performances réalisées par les
établissements en matière d'adaptation de leurs conditions
d'exploitation aux évolutions de la demande de produits et services
financiers et leurs situations différenciées au regard des
risques compromis, notamment immobiliers, issus de la crise du début des
années quatre-vingt-dix, tant en termes de coût de portage des
actifs improductifs que d'importance des besoins de provisionnement
complémentaire.


L'ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ
Il aurait été surprenant que l'évolution
contrastée de l'activité et des résultats des
différents réseaux fût sans conséquence sur
l'évolution des parts de marché.
Le tableau ci-après, établi à partir des chiffres
contenus dans les rapports annuels de la Commission bancaire, met en
évidence le fait que les parts de marché ont connu des
évolutions importantes depuis la fin des années 1980.
En effet, si l'on se réfère aux dépôts, l'on
constate que la part des banques AFB après avoir crû de
façon significative de 49 % en 1988 à 55,1 % en 1991 a
décrû depuis lors, de façon constante, jusqu'à 43,7
% en 1995. Les caisses d'épargne ont connu une évolution
exactement inverse : leur part a décru de 1988 à 1991, passant de
17,2 à 12,4 % en 1991 puis est remontée à 19,4 % en 1995.
Les banques mutualistes ont enregistré un accroissement constant de leur
part de marché qui est passée de 28,2 % en 1988 à 35,7 %
en 1995. La part des sociétés financières et celle des
institutions financières spécialisées ont, quant à
elles, constamment décru sur la période d'observation.
En termes de crédits, on constate une évolution similaire.
Jusqu'en 1991, la part des banques a légèrement crû,
passant de 49,5 % à 51 %, pour ensuite décroître
jusqu'à 48,8 % en 1995. Inversement, la part des caisses
d'épargne est restée stable jusqu'en 1991 autour de 4,2 % pour
ensuite croître jusqu'à 5,3 % en 1995. La part des mutualistes et
celle des sociétés financières ont augmenté de
façon constante, alors que celle des institutions financières
spécialisées a décru.
Ces évolutions ne se retrouvent qu'avec un certain retard dans la
situation globale de bilan, puisque la part des banques AFB a crû
jusqu'en 1993, passant ainsi de 55 % à 59,5 %, avant de
décroître jusqu'à 57,6 %. Les caisses d'épargne ont
enregistré une évolution inverse, leur part diminuant de 8,3 %
à 5,8 % pour ensuite remonter jusqu'à 6,4 %. Les mutualistes ont
enregistré une progression constante de leur part de marché de
15,7 à 17,7 %, contrairement aux institutions financières
spécialisées et aux sociétés financières qui
ont vu leur part décroître de façon
régulière.

Force est donc de constater que la crise n'a pas été
traversée de la même façon par les établissements.
En termes juridiques, ce sont les banques commerciales classiques dites
banques AFB qui ont supporté l'essentiel de la crise. Elles ont vu leurs
bénéfices nets diminuer globalement et ont dû commencer
à réduire leurs effectifs pour faire face aux difficultés.
En revanche, les banques mutualistes et les banques coopératives ont
réalisé de bonnes performances. Quant aux caisses
d'épargne elles ont pu à la fois augmenter leurs
bénéfices et leurs effectifs.
En termes économiques, il semble que ce sont les petits et moyens
établissements à vocation générale et les banques
locales ou mixtes qui aient le plus mal supporté la crise. Les
très grands établissements ou réseaux à vocation
générale tirent leur épingle du jeu, mieux en tout cas que
les grands établissements. Les établissements de marché
sont ceux qui ont le mieux résisté à la crise.
*
En conclusion de cette première partie, il convient de
se poser deux questions :
- pourquoi certains établissements bancaires ont-ils mieux
traversé la crise que d'autres ?
- pourquoi les systèmes bancaires qui ont également
traversé une crise dans la période récente se sont-ils
rétablis plus rapidement que le système français ?
En réponse à ces questions, l'analyse semble montrer que la
crise du système bancaire français est essentiellement d'origine
structurelle et que les distorsions de concurrence, même si elles n'ont
joué qu'un rôle macro-économique mineur, conduisent
à une redistribution sectorielle importante des parts de marché
qui explique, au moins en partie, la situation contrastée de notre
système bancaire.
* *
*
CHAPITRE II
UNE CRISE D'ORIGINE STRUCTURELLE RENDUE
INSUPPORTABLE POUR CERTAINS ACTEURS À CAUSE DE DISTORSIONS DE
CONCURRENCE
Les réformes structurelles mises en place au cours de la
décennie 1980 se sont traduites, mécaniquement, par une
augmentation très importante des pressions concurrentielles.
C'est
l'impossibilité (ou le refus) de laisser se produire les ajustements
nécessaires pour faire face à ce surcroît de concurrence
qui a conduit à la situation actuelle.
Seule en effet l'absence
d'ajustement peut expliquer à la fois la longueur de la crise dans notre
pays, la sous-rentabilité comparée de nos banques et l'absence de
crise dans le système bancaire allemand. Dans ce dernier système
il n'y a pas eu à faire d'ajustements particuliers pour la simple raison
qu'une moitié des réformes n'avait pas de raison d'être et
que l'autre moitié n'a pas encore été
faite
12(
*
)
.
Les distorsions de concurrence quant à elles n'ont vraisemblablement
joué aucun rôle, au niveau macro-économique du moins, dans
la survenue de cette crise. En revanche elles induisent une puissante
redistribution sectorielle qui les rend insupportables aux acteurs n'en
bénéficiant pas.
L'IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER AUX AJUSTEMENTS INDUITS PAR LES RÉFORMES STRUCTURELLES EST LA CAUSE PREMIÈRE DE LA CRISE
Si on s'efforce d'établir, non pas une pondération entre les différents facteurs de la crise, mais l'enchaînement causal qui en est responsable, il apparaît que la cause première de la crise tient à l'impossibilité de laisser se réaliser les ajustements induits par les réformes structurelles et que les erreurs de gestion des banques et le retournement conjoncturel des années 1991-1993 n'ont joué qu'un rôle aggravant.
LES RÉFORMES STRUCTURELLES DES ANNÉES 1984-1989 ET L'ACCROISSEMENT DES PRESSIONS CONCURRENTIELLES
Les réformes structurelles
La politique monétaire d'encadrement du crédit,
menée quasiment sans interruption depuis la Libération, avait
installé les banques françaises dans une situation assez
confortable, caractérisée par l'absence de concurrence et
l'existence de circuits cloisonnés de financement concernant certains
secteurs ou certaines priorités. Cette situation masquait en
réalité une sclérose généralisée. Les
banques, assimilées à des services publics, n'étaient pas
considérées comme des entreprises comme les autres et leurs
agents étaient assimilés à des fonctionnaires. De ce point
de vue, les nationalisations de 1982 marquaient davantage l'aboutissement d'un
processus étalé sur quarante ans, qu'une véritable
révolution
13(
*
)
.
Cette situation a été totalement bouleversée par les
réformes intervenues dans le milieu des années 80. L'objectif de
ces réformes était d'abord de favoriser le financement de l'Etat
par la création d'un vaste marché de capitaux sur lequel il
pourrait financer plus facilement sa dette. Mais ces réformes
étaient également censées améliorer le financement
de notre économie en conduisant les établissements de
crédit à se livrer à une concurrence qui devait
normalement se traduire par une baisse du coût du crédit.
Regroupées sous le terme générique de
"
déréglementation
", ces réformes ont affecté
à la fois les marchés eux-mêmes (décloisonnement et
désintermédiation), les intermédiaires (banalisation) et
les flux de capitaux (internationalisation).
Le décloisonnement des marchés et la désintermédiation
Le décloisonnement a consisté à réduire le nombre des procédures dont la résultante formait un patchwork de marchés spécifiques (crédits hypothécaires, exportations, logement, agriculture, artisanat, création d'emplois, recherche...) afin de constituer un vaste marché des capitaux sur lequel la régulation monétaire pourrait se faire de façon plus efficace et plus conforme aux règles de la concurrence.
La création du marché monétaire
La création du marché monétaire, en
1985, a été la première étape du processus de
décloisonnement.
Elle a consisté à mettre en place le
chaînon manquant entre le marché interbancaire et le marché
obligataire. Elle a été réalisée par la mise
à disposition des intervenants de
titres de créances
négociables
14(
*
)
de
caractéristiques similaires permettant l'instauration d'un
continuum
d'échéances entre le très court terme (dix jours) et
le long terme (sept ans, soit le seuil du marché obligataire).
Fait notable, ce marché a été d'emblée ouvert
à tous les intervenants et notamment aux entreprises, avec
l'introduction en France des billets de trésorerie. Par contraste, le
marché monétaire était auparavant réservé
à un nombre limité d'établissements : les banques et les
"
établissements non bancaires admis au marché
monétaire
", plus connus sous le sigle d'ENBAMM.
Du côté de la demande, la mise en place de ce marché a
été grandement facilité par l'essor des organismes de
placement collectifs (SICAV et FCP), organismes bénéficiant d'une
fiscalité favorable et qui ont massivement souscrit des titres de
créances négociables.
La levée progressive de l'encadrement du crédit
La seconde étape du processus de
décloisonnement a été réalisée par la
levée progressive de l'encadrement du crédit entre 1985 et
1987
. Grâce à l'unification, la régulation
monétaire pouvait se faire sur un seul compartiment (le marché
interbancaire) par des variations de taux d'intérêt se
répercutant à l'ensemble des segments.
Par ailleurs, une bonne partie des enveloppes de prêts bonifiés a
soit disparu, soit fait l'objet d'une distribution plus ouverte par la mise en
place de procédures d'adjudication.
Enfin, la levée de l'encadrement du crédit a été
complétée par une
plus grande égalité dans les
conditions de collecte des ressources et d'octroi de financements
. Ainsi,
dès 1983, de nouveaux produits rémunérés et
défiscalisés (Codevi, livrets d'épargne populaire) on pu
être distribués indifféremment par tous les réseaux
bancaires.
On observera qu'avec cette politique la France ne faisait que rattraper un
retard dans la modernisation de ses instruments de politique monétaire.
Comme le relève le gouverneur de la Banque de France, "
aucun autre
système bancaire dans le monde industrialisé n'était
encore placé dans une telle situation au milieu des années quatre
vingt
"
15(
*
)
.
La désintermédiation
La
désintermédiation
ou
"
marchéisation
" a été, en quelque sorte, le
prix à payer pour le décloisonnement : dans la mesure où
l'on recherchait un marché monétaire ample et diversifié,
il fallait laisser les entreprises y avoir accès directement.
Mais d'autres réformes, inspirées de la vague d'innovation
financière qui secouait l'ensemble des marchés financiers, ont
également contribué au développement des marchés de
capitaux.
Ainsi, les conditions d'accès ont été
améliorées par l'ouverture internationale du marché
primaire en 1984, la liberté de négociation des courtages et des
commissions sur les émissions et l'ouverture d'un second marché.
Le système financier français a également profité
d'innovations sur le marché des actions (certificats d'investissement,
titres participatifs...) et sur celui des obligations (obligations à
taux variables, à taux révisables, convertibles, à bons de
souscription...).
En outre, la Bourse a été réformée techniquement
(marché en continu, règlement mensuel) et
réglementairement (création des sociétés de bourse
en 1988, réforme des autorités de marchés et renforcement
des pouvoirs de la Commission des opérations de bourse).
Enfin, la mise en place d'instruments de couverture des risques de
marché a été réalisée sous l'impulsion des
pouvoirs publics afin de permettre aux intervenants de limiter l'impact des
fluctuations de taux d'intérêt (création du MATIF), de
cours des actions ou de l'indice boursier (MONEP). Simultanément s'est
développée très rapidement l'utilisation d'instruments
dérivés négociés de gré à gré
(contrats d'échange, accords de taux futur, options).
Théoriquement la désintermédiation devait se traduire par
le passage d'une situation qualifiée d' "
économie
d'endettement"
,
dans laquelle les entreprises sont
essentiellement
financées par les banques au moyen de crédits bancaires
classiques, à une situation de "
finance directe
", dans laquelle
les entreprises se financent davantage par apport de fonds propres ou par
émission de titres de créances négociables, sur les
marchés financiers.
Il était donc prévisible que les banques, entendues au sens
classique de distributeurs de crédits, perdraient de leur importance par
rapport aux intermédiaires de marché. A moins toutefois qu'on ne
les autorise et les encourage à devenir elles mêmes des
intermédiaires de marché.
La banalisation des intermédiaires : la banque universelle
Le cadre juridique universel
La loi bancaire de 1984 avait pour objectif premier de créer les conditions d'une concurrence normale en mettant en place un cadre universel et moderne de la profession bancaire . Tout en respectant les spécificités statutaires du monde mutualiste et coopératif, elle a rendu fonctionnellement homogène le concept d'établissement de crédit 16( * ) . Tous les établissements de crédit doivent remplir les mêmes conditions pour être agréés 17( * ) ; une fois agréé un établissement de crédit peut effectuer toutes les opérations de banque 18( * ) .
La vocation économique universelle
Dans le même temps, la loi bancaire reconnaissait de
façon explicite la vocation universelle des établissements de
crédit puisque ceux-ci étaient non seulement habilités
à effectuer toutes les opérations de banque mais encore la
quasi-totalité des opérations de finance
(gestion et
intermédiation, à l'exception de la négociation de valeurs
mobilières réservée aux agents de change, puis à
partir de 1988, aux sociétés de bourse)
19(
*
)
.
La loi financière adoptée au printemps
dernier n'a fait, de ce point de vue, que parachever cette évolution en
donnant la possibilité aux établissements de crédit
d'exercer, directement, tous les métiers de la finance, y compris la
négociation de valeurs mobilières.
C'est ce glissement du juridique (les banques doivent exercer leur
métier dans les mêmes conditions) vers l'économique (les
banques pourront faire face au surcroît de concurrence en étendant
leurs activités sur tous les marchés et à tous les
métiers) qui permit à cette théorie de la banque
universelle de devenir, en quelque sorte, la pierre philosophale de l'ensemble
des réformes. En limitant la concurrence de nouveaux entrants sur le
marché et en orientant les banques sur les métiers de la finance,
elle devait amortir la "
casse sociale
" résultant du
surcroît de concurrence interne et structurel.
On peut penser, en effet, que la restriction du nombre des nouveaux
concurrents constituait une compensation, d'ordre juridique, destinée
à permettre aux banques d'affronter le surcroît de concurrence.
Cette restriction découle nécessairement du caractère
universel de l'agrément : puisqu'une banque peut effectuer tous les
métiers de banque, il convient d'exiger d'elle, au moment de son
agrément, les conditions, notamment en termes de fonds propres, que l'on
exigerait de celui qui veut faire le métier le plus risqué. C'est
le contraire de l'approche d'agrément limité retenue pour les
services d'investissement, dans la loi financière du 2 juillet 1996, et
qui permet de pondérer les exigences, notamment en fonds propres, par la
nature du métier exercé.
L'ouverture des banques sur les métiers de la finance était
censée permettre, de façon prosaïque, à celles-ci de
récupérer en volume d'activité sur les marchés
financiers ce qu'elles perdraient sur le crédit bancaire classique. Par
la suite, cette réorientation a été
théorisée sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Dans
cette optique, la banque universelle est censée présenter deux
avantages décisifs. En premier lieu, elle permet de s'assurer de la
fidélité de la clientèle importante en étant
capable de lui offrir l'ensemble des services financiers dont ils ont besoin.
C'est ce qu'il est convenu d'appeler l'approche
"
orientée-client
"
(par opposition à l'approche des établissements
spécialisés dite "
orientée-marchés
"). En
second lieu, elle permet d'amortir les fluctuations économiques en
diversifiant les secteurs d'intervention : financement bancaire/intervention
sur les marchés financiers ; banque de dépôt/banque
d'affaires ; national/international).
L'Etat lui-même a donné l'exemple en banalisant progressivement
les réseaux dont il avait peu ou prou la charge tels que le
réseau des Sociétés de développement
régional, le Comptoir des entrepreneurs, le CEPME ou encore le
Crédit Foncier.
L'internationalisation
L'internationalisation a d'abord été un
phénomène
technique,
grâce à la mise en place
d'un vaste réseau de télécommunications puis
d'échange de moyens de paiement capable de faire circuler les capitaux
en même temps que l'information (création du système SWIFT,
développement des chambres privées de compensation comme CEDEL ou
EUROCLEAR).
Mais elle a été également
juridique
avec
l'adoption en
1977
de la
première directive bancaire
qui
prohibe aux Etats membres de refuser l'implantation d'établissements de
crédit de pays de la Communauté et surtout
en 1989
avec la
deuxième directive bancaire
, transposée en droit
français en 1992, mais largement anticipée dès 1988. Cette
directive consacre les notions de
libre établissement
et de
libre prestation de services bancaires, sur la base de la reconnaissance
mutuelle des agréments
.
Cette internationalisation des acteurs, ainsi que la participation au
mécanisme de change du système monétaire européen,
puis la réalisation de la
phase I de l'UEM, nécessitaient la
libéralisation des mouvements de capitaux qui s'est traduite par
l'abandon du contrôle des changes, réalisé progressivement
de 1985 à 1989
20(
*
)
.
L'ensemble de ces évolutions a fortement contribué à
accroître la concurrence internationale entre grandes banques.
La
phase ultime de ce processus consistera dans le passage à la monnaie
unique qui, en accroissant la fongibilité des actifs, renforcera encore
davantage la concurrence entre établissements.
L'accroissement des pressions concurrentielles
Comme on a pu le constater, les réformes mises en place reposaient sur un maître mot : la concurrence. Celle-ci était à la fois interne (les établissements français entre eux), externe (avec les compétiteurs européens et internationaux) et structurelle (concurrence entre le crédit bancaire classique et le financement sur les marchés financiers). Elle aurait dû entraîner des ajustements.
La concurrence structurelle des marchés financiers
La marchéisation de l'économie a sans doute
été le phénomène le plus spectaculaire des
transformations induites par les réformes de la décennie 80.
Surtout, elle a contribué à inverser durablement les rapports
entre les banques et les entreprises au profit des secondes.
La création d'un marché du refinancement à court terme
ouvert aux entreprises a effectivement donné à celles-ci la
possibilité de ne plus s'adresser systématiquement à un
établissement de crédit pour obtenir des fonds à moins de
sept ans ou pour gérer leurs risques de taux d'intérêt ou
de change. En outre, les entreprises ont développé leurs
fonctions financières (placements financiers, gestion de
trésorerie, opérations de haut de bilan) pour exploiter au mieux
la gamme des produits financiers offerts. Pour les plus grandes d'entre elles,
des structures
ad hoc
ont même été
créées, allant parfois jusqu'à la création de
banques de groupe.
Le marché des billets de trésorerie a attiré les plus
grandes entreprises françaises, donc souvent les moins risquées,
qui avaient la surface financière suffisante pour émettre en
continu. Mécaniquement, ces "
très bonnes signatures
" ont
eu moins recours aux banques qui ont vu ainsi s'échapper leurs meilleurs
clients, en termes de volume d'activité et de risque.
Le taux d'intermédiation financière calculé sur les flux
par le Conseil national du crédit a connu une décroissance
spectaculaire puisqu'il est passé de 58 % en 1984 à 2 % en 1993.
Ce taux mesure le rapport entre les flux de crédit des
établissements résidents et le total des flux de financement.
La Commission bancaire fait toutefois observer que si le nouveau cadre
financier donne à des emprunteurs importants, le choix entre un
financement direct et un financement intermédié, le premier
relève néanmoins en grande partie des banques, qui, en
acquérant des titres, continuent de financer les agents
économiques. En d'autres termes, les titres se substituent aux
crédits, mais les emplois bancaires, donc les concours à
l'économie s'accroissent. Si l'on retient une approche en termes d'offre
de financement, la part des établissements de crédit est
passée de 66,9 % en 1984 à 22,6 % en 1993. Ainsi, la chute du
taux d'intermédiation entre 1984 et 1993 occulte un quadruplement du
portefeuille-titres sur la période et une augmentation de 38 % des
crédits sur le territoire métropolitain.
Cette observation corrobore le développement des activités de
marché des banques que nous avons observé dans la première
partie de ce rapport (voir
supra
chapitre I, première partie).
La concurrence interne
Concurrencées dans leur activité de crédit,
parfois ignorées par les meilleures entreprises, les banques se sont
livrées à une guerre des prix sur les segments les plus
risqués : les PME et l'immobilier. Cette guerre a été
d'autant plus forte que, même sur ces segments, elles ont dû
prendre en compte les prix de marché et consentir aux entreprises des
conditions plus favorables que celles qui leur étaient
antérieurement réservées.
Elles ont dû également adapter leur offre aux nouveaux besoins de
leur clientèle en proposant de nouveaux produits. L'essor des billets de
trésorerie a poussé les banques à multiplier les clauses
d'indexation sur le taux du marché monétaire pour les
crédits courts. De surcroît, le développement des
marchés de capitaux nationaux et internationaux les a
entraînées à accorder des taux voisins des taux des
émissions obligataires pour les financements plus longs. Ce
phénomène a pesé de façon non négligeable
sur les marges bancaires, alors que de moins en moins de concours sont
indexés sur le taux de base bancaire.
Parallèlement, les établissements de crédit ont subi une
évolution défavorable de la structure de leurs ressources et,
notamment, en ce qui concerne les dépôts à vue. Cette
évolution résulte du changement de comportement des agents
économiques qui ont partiellement délaissé les
dépôts bancaires traditionnels au profit de placements plus
rémunérateurs et aussi liquides, principalement les titres de
Sicav monétaires, qui ont bénéficié
d'évolutions de taux et de traitements fiscaux favorables.
La concurrence internationale
Une première mesure de la pression concurrentielle
exercée par les banques étrangères sur le système
bancaire français peut être effectuée à partir du
taux d'internationalisation tel qu'il est mesuré par la Commission
bancaire. Or ce taux est passé de 42,8 % à 67,7 % entre 1984 et
1993 pour les banques AFB qui assurent l'essentiel de l'activité
internationale des établissements de crédit français.
Cette internationalisation a été encore plus forte sur les
activités de marché.
Par ailleurs, le nombre d'établissements étrangers
exerçant en France a crû de façon considérable.
Ainsi, la part des banques sous contrôle étranger, qu'il s'agisse
de filiales de droit français d'établissements étrangers
ou de succursales d'établissements de l'Espace économique
européen exerçant en libre établissement est passée
de 40 % à 46 %.

Cela ne signifie pas, comme on l'a vu, que les banques étrangères occupent 46 % des parts du marché français (elles ne réalisaient en 1995 que 3,4 % du PNB bancaire). Mais ce phénomène traduit néanmoins une augmentation de la pression concurrentielle.
Les ajustements prévisibles
Cette augmentation sur trois fronts
21(
*
)
de la pression concurrentielle aurait dû
provoquer l'enchaînement suivant :
augmentation de la concurrence baisse des prix
22(
*
)
diminution des marges réduction d'effectifs
faillites des concurrents les plus faibles restructuration du secteur (OPA,
fusions, reprises...) amorce d'un nouveau cycle d'expansion avec
création d'emplois.
Une crise du système bancaire était donc à redouter
dès la mise en place des réformes. Il s'agissait d'un
phénomène naturel et prévisible tel que l'ont connu, par
exemple, le secteur des télécommunications ou celui des
transports aériens aux Etats-Unis.
Les ajustements induits, en termes de réduction d'effectifs ou de
disparition des acteurs les plus faibles auraient pu intervenir de façon
relativement indolore grâce à la forte croissance de la fin des
années 1980.
Après une première phase de crise, le
système bancaire français, restructuré, aurait dû
recommencer à créer des emplois et à générer
des bénéfices.
Mais il n'en a rien été et le processus décrit
ci-dessus a été bloqué au stade de la diminution des
marges.
Ce blocage, mesuré à l'aune de l'intérêt
général, ne peut qu'inquiéter. Comme le relève la
Commission bancaire dans son rapport de 1995 : "
Le renforcement de la
concurrence
, qui a résulté de la réforme du
système bancaire à partir de 1984, de l'intégration
européenne et de l'internationalisation de l'activité bancaire
ainsi que de la globalisation des activités financières,
était hautement souhaitable
, en particulier dans le but de
moderniser le système bancaire. Il s'est accompagné d'une
réduction prononcée et ininterrompue des marges bancaires depuis
1986 (...).
Une telle évolution est bénéfique pour
l'ensemble de l'économie lorsqu'elle traduit les performances
réalisées par les banques françaises en termes
d'efficacité économique. Elle devient source de
difficultés quand (...) la rémunération des fonds propres
n'est plus suffisante pour assurer le renforcement des structures
financières et pour permettre au système bancaire français
de rivaliser, dans des conditions d'égalité de concurrence, avec
ses concurrents étrangers."
L'IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER AUX AJUSTEMENTS
L'absence d'ajustements tient, d'une part, à la difficulté d'admettre que les banques puissent faire faillite - c'est le dogme du " zéro faillite agreement " - et, d'autre part, à une législation particulièrement rigide qui ne facilite pas les adaptations, notamment en ce qui concerne la durée du travail ou la tarification des services.
L'immortalité des banques et le dogme du "zéro faillite agreement"
Comme on a pu le voir, le nombre réel des acteurs de la
compétition bancaire a eu tendance à augmenter en dépit de
l'accroissement sévère des conditions de concurrence. Les
"
barrières à l'entrée
" de la profession
(agrément, capital minimum, actionnaire de référence)
n'ont pas véritablement fonctionné. Elles n'ont
représenté qu'un filtre individuel, sans impact réel sur
l'équilibre économique du secteur.
Au demeurant, une telle limitation du nombre des entrants eût
été impossible compte tenu des engagements internationaux et
notamment européens en matière de libre établissement et
de libre prestation, sauf à ne faire porter le poids des restrictions
que sur les seuls candidats nationaux.
Mais cette "
libre entrée dans la branche
" aurait
supposé, en toute logique, une libre sortie. Or, le contraire s'est
produit puisque a été mis en place une "
administration de la
sortie
" qui constitue, comme le souligne le rapport du Commissariat
général du plan
23(
*
)
, une
"
incohérence"
.
Cette incohérence, qui est, de l'avis du groupe de travail, la cause
première des difficultés actuelles du secteur bancaire, trouve
son origine dans la conjugaison de deux phénomènes, l'un
financier, l'autre juridique, se traduisant par une forme d'immortalité
bancaire.
L'immortalité financière : le comportement de l'État actionnaire et le "colbertisme résiduel"
Chaque fois que des établissements de crédit
public ont connu des difficultés,
l'Etat
, actionnaire pendant les
années 84-93 d'une grande partie (sinon la majeure) du secteur bancaire,
a recapitalisé ces établissements
(ce qui était
normal)
sans exiger de façon systématique une réduction
des activités des établissements en mauvaise posture
(ce qui
non seulement constituait un encouragement à la mauvaise gestion, mais a
entraîné des surcapacités). C'est la litanie des
recapitalisations des années 90 : SDR, banque Hervet, SMC, Crédit
Lyonnais, annonciatrice des plans de redressement et de défaisance
(Comptoir des entrepreneurs, Crédit Lyonnais, Crédit Foncier).
Au total, et hors effet patrimonial, l'Etat a plus donné pour le
secteur bancaire, sous forme de dotations budgétaires, qu'il n'a
reçu de ses banques, sous forme de dividendes.

En contrepartie de cette immortalité
financière, l'Etat a continué à utiliser les banques comme
instrument de politique économique, leur assignant des objectifs
d'intérêt public (maintien de l'emploi
24(
*
)
,
aménagement du territoire) ou de politique
industrielle.
Malheureusement, le colbertisme industriel, qui a permis
à la France de mener à bien de grands projets dans
l'aéronautique, le nucléaire ou les
télécommunications, n'a pas fait bon ménage avec le
libéralisme dominant dans les métiers de la banque et de la
finance
25(
*
)
.
C'est l'époque où les principales banques françaises,
"
grisées
" par les libertés nouvelles dont elles
bénéficiaient se sont lancés dans une course au bilan,
sans considération des règles élémentaires de
rentabilité et de contrôle des risques. C'est aussi
l'époque où le classement des banques se faisait avant tout en
fonction de leur "
total de bilan
".
Il faut bien admettre que l'Etat français n'est pas le seul à
être intervenu, par la voie de concours publics, au secours
d'établissements bancaires.
D'après les estimations dont on dispose,
26(
*
)
la Norvège a ainsi assuré entre 1987 et
1992 le sauvetage par nationalisation totale ou partielle des trois
premières banques du pays pour un coût total pour l'Etat de 20
milliards de francs. La Suède a apporté entre 1991 et 1993, 50
milliards de fonds publics à 3 établissements sous forme de fonds
propres et de garantie ainsi que de nationalisation, en attendant la reprise
par des investisseurs privés. L'Etat finlandais, également entre
1991 et 1993, a dirigé des restructurations massives par le truchement
d'un fonds public d'assurance dont le coût final a été de
50 milliards de francs.
Dans la crise des caisses d'épargne américaines, le coût
supporté par le
Résolution Trust Corporation
, organisme
financé sur ressources budgétaires et emprunts garantis par le
Trésor a été de 700 milliards de francs (132 milliards de
dollars) étalé entre 1989 et 1992. Cet organisme a pris le
contrôle des caisses d'épargne en faillite et en a
cédé les actifs. Déjà, entre 1985 et 1992, le
coût supporté par le fonds de garantie des banques (FDIC) pour la
disparition d'environ 500 banques texanes avait été de 70
milliards de francs (13 milliards de dollars).
En Angleterre, le soutien de 40 petites banques sous forme de concours directs
et de garanties accordés par la Banque d'Angleterre peut être
estimé à 1 milliard de francs. Le coût de la faillite de la
BCCI a été de 2,6 milliards de francs. L'essentiel des pertes a
été supporté par les déposants, les
autorités publiques refusant de prendre en charge la partie non couverte
par le système de garantie des dépôts.
En Espagne, le règlement du sinistre de la Banesto en 1993, d'un
coût total estimé entre 35 et 48 milliards de francs, a
été assurée par le fonds de garantie des
dépôts et par la Banque centrale qui a joué un rôle
très important.
Au Japon, a été créée en janvier 1993, une
structure de
defeasance
(ou
bad bank
) dont les actifs proviennent
de 162 établissements de crédit pour un total estimé
à 360 milliards de francs. En février 1995, a été
créée une structure au capital de 2,1 milliards de francs,
détenu pour moitié par la Banque centrale et pour moitié
par les principaux établissements de la place. Cette structure est
censée racheter 2 établissements de crédit mutuel qui
totalisent 5,4 milliards de francs de créances compromises. C'est la
première fois qu'il a été dérogé au principe
de non-assistance financière de la puissance publique à des
établissements de crédit.
Mais comme on a déjà eu l'occasion de le voir, ces crises
bancaires ont été résolues dans un laps de temps
relativement court et dans la totalité de ces pays, à l'exception
il est vrai du Japon, les principales banques ont renoué avec les
bénéfices
. Qui parle encore de la banque Banesto, ou de la
Barings ? Par contraste, il ne se passe pas une semaine sans que l'on ne puisse
lire un article de presse sur le Crédit Lyonnais.
Indépendamment de la question de savoir si l'Etat a
été un bon actionnaire ou un bon gestionnaire, qui sera
évoquée plus loin, on remarquera qu'il n'a pas su traiter avec
efficacité les difficultés de ses propres banques.
Schématiquement, l'Etat dispose de quatre moyens pour venir à la
rescousse d'une banque défaillante.
1) La liquidation :
les banques insolvables sont mises en faillite, les
déposants assurés sont remboursés et tous les actifs
restant sont liquidés. Dans sa forme la plus pure, une liquidation
entraîne la perte des participations des détenteurs de la banque,
tandis que les détenteurs de la dette de deuxième rang perdent
également une partie, ou la totalité de leur argent. Dans la
pratique, seuls les Etats-Unis ont été en mesure d'adopter cette
politique : environ une banque sur cinq ayant fait faillite a été
liquidée. En revanche, aucune banque japonaise ne l'a été
depuis 1945.
2) La fermeture par fusion :
cela implique de fusionner une banque en
mauvaise santé financière avec une autre en bonne santé.
Dans certains cas, les autorités réglementaires offrent au
repreneur des incitations, peut être en gardant une partie des actifs non
garantis ou en remboursant les déposants assurés ou les
créanciers. Les autorités réglementaires
américaines emploient souvent cette méthode et nombre
d'autorités européennes l'ont mise en pratique. C'est le cas par
exemple des autorités espagnoles lorsque la banque Banesto a fait
faillite en 1994. Cette banque fut mise aux enchères et rachetée
par la banque Santander. C'est le cas également de la
Barings
en
Angleterre.
3) Les dotations budgétaires, ou les garanties gouvernementales
:
le plus souvent cela consiste à nettoyer les bilans des banques en
transférant leurs plus mauvais actifs à l'Etat ou à faire
en sorte qu'il s'en porte garant. C'est l'approche la plus souvent retenue. Une
étude de la
London School of economics
portant sur 120 cas de
faillites dans 24 pays différents au cours des années 80 a
montré en effet que deux banques sur trois étaient
renflouées. La forme d'intervention la plus simple implique la garantie
que l'Etat agira en tant que prêteur de dernier ressort au cas où
les prêts à risque viendraient à menacer la solidité
d'une banque. La forme la plus fréquente a été la
création d'une agence comme le
Securum suédois
, la
Résolution Trust Company
américaine ou la
Coopérative d'achat de crédit au Japon, qui garde les mauvais
actifs jusqu'à leur maturité ou à leur réalisation.
Le sauvetage du Crédit Lyonnais s'inspire également de cette
approche.
4) La nationalisation :
c'est la solution la plus radicale. Elle est
souvent adoptée lorsqu'un Gouvernement craint que les problèmes
d'une banque se répercutent sur l'ensemble du système. L'exemple
le plus éloquent a été la nationalisation d'une vaste
partie du système bancaire norvégien. Elle suppose, bien
évidemment, que les banques ne soient pas déjà entre les
mains d'actionnaires publics.
En écartant systématiquement l'option de la liquidation et
celle de la vente, les gouvernements successifs n'ont fait que rendre ces
options plus coûteuses, une fois l'inefficacité du renflouement
avérée. Le Crédit Lyonnais illustre malheureusement cette
vérité : le coût de la procrastination s'avère
élevé
27(
*
)
.
En outre, les instances gouvernementales ne possédaient pas de
compétence particulière en tant que gérants d'actifs
défaillants et il s'avère également difficile
d'évaluer le coût réel de ces arrangements pour les
contribuables. Là encore, le cas du Crédit Lyonnais se
révèle démonstratif.
En premier lieu, les autorité de tutelle ont, pendant longtemps,
donné l'impression de refuser de prendre la mesure exacte du
désastre.
Ensuite, le plan de sauvetage a mis à la charge de la banque en
difficulté une contribution qu'elle n'était pas en mesure
d'apporter.
Enfin, à la suite de modifications successives, le plan de sauvetage a
du finalement prendre acte du montant total des pertes (de l'ordre de 80
milliards de francs) et séparer définitivement la bonne banque de
la mauvaise (l'ensemble formé par l'Établissement public de
financement et de restructuration et le Consortium de réalisation).
D'après les informations rendues publiques par le Gouvernement, le
processus de privatisation est en passe d'être engagé.
Quand bien même l'Etat ne serait-il pas intervenu de façon aussi
massive et récurrente, on peut s'interroger sur les effets pervers de
notre système de droit commun concernant le traitement des banques en
difficulté.
L'immortalité juridique : l'article 52 de la loi bancaire
La banque n'est pas la seule industrie à avoir
été transformée par les forces conjuguées de la
déréglementation et de la concurrence. Beaucoup d'autres secteurs
ont du faire face à des évolutions similaires.
Généralement la conséquence en est que les entreprises les
plus fragiles disparaissent, en théorie, pour le plus grand
bénéfice du secteur pris dans son ensemble.
Mais la question de la disparition des banques se pose en des termes
différents. La première raison en est que celles-ci ont
généralement des milliers de déposants, dont la plus
grande partie ont besoin de leurs dépôts bancaires pour vivre. La
seconde, au moins aussi importante, tient à la présence du
"
risque systémique
"
28(
*
)
. C'est
ce qui explique que depuis longtemps
29(
*
)
,
aucun Gouvernement au monde ne se soit désintéressé des
difficultés des banques, pourvoyeuses de crédit et gardiennes du
système de paiement de leur économie.
Cependant, la résolution de ce problème suppose de trancher un
noeud gordien : comment assurer la protection des déposants et
réduire le risque systémique sans assurer la survie des
établissements non rentables et, accessoirement, sans mettre en place de
système de garantie trop coûteux pour les banques ?
En d'autres termes : quel mécanisme mettre en place pour permettre
à la plupart des banques, sinon à toutes, de faire faillite sans
provoquer de crise systémique, en préservant les
déposants, sans trop faire payer les concurrents et, si possible, sans
faire intervenir l'Etat ?
Cette question centrale pour l'évolution économique du secteur
est au coeur des réflexions des analystes anglo-saxons sur le
système bancaire. Pour l'hebdomadaire britannique
The Economist
,
"
certains économistes estiment que si l'on ne fait pas figurer les
dispositifs de sauvetage parmi les facteurs d'instabilité, on ignore un
problème essentiel"
30(
*
)
. Pour
Martin Giles
31(
*
)
, "
les peurs au sujet
du
risque systémique ont conduit à des appels pour plus de
règles et de contrôle. Mais constituent elles une partie de la
solution ou bien une partie du problème ?".
Il est du reste significatif que, jusqu'au rapport de la Commission des
finances de l'Assemblée nationale sur le contrôle des banques et
la protection des déposants
32(
*
)
, cette
problématique n'ait pas été au centre
33(
*
)
de
la réflexion de place.
C'est qu'en effet, le système français de prévention des
crises bancaires, unique en son genre, a fonctionné de façon
souple et efficace jusqu'au tournant de la crise. Mais depuis, l'environnement
économique et réglementaire ayant considérablement
changé on peut légitimement se demander s'il ne produit pas plus
d'inconvénients qu'il ne comporte d'avantages.
Les spécificités du mécanisme français de traitement des crises bancaires
Les autorités bancaires disposent de trois instruments
pour faire face au risque systémique, instruments qu'ils utilisent
généralement de concert.
Le premier d'entre eux, le plus ancien aussi, consiste à
désigner la Banque centrale comme "
prêteur en dernier
ressort
" et la charger, en cas de crise, à fournir des
liquidités non seulement aux banques en difficultés mais à
l'ensemble du système. Au siècle dernier, l'économiste
Walter Bagehot, dans son livre "
Lombard Street
", formulait
ainsi ce
qu'il pensait devoir être la position des banquiers centraux : ils ne
devraient prêter qu'aux banques solvables mais illiquides (sous entendu,
ils ne devraient pas prêter aux banques insolvables), et seulement
à un taux de pénalisation. Selon lui, les prêteurs de
dernier ressort devraient également faire connaître leur intention
à l'avance et de façon claire afin de décourager les
banques de prendre des risques excessifs. Cette doctrine continue d'inspirer le
comportement de certaines banques centrales, à commencer par la Banque
d'Angleterre dont le gouverneur a déclaré à plusieurs
reprises qu'il n'aiderait que les banques dont la disparition provoquerait
l'apparition d'un risque systémique et qu'il ne le ferait qu'à un
coût très onéreux pour ces banques. La disparition de la
BCCI, puis celle de la Barings ont montré qu'il ne s'agissait pas de
"
propos en l'air"
.
Le second instrument consiste à établir un "
filet de
sécurité
" par l'intermédiaire d'un
fonds de
garantie
auquel cotise l'ensemble de la communauté bancaire, le plus
souvent sur une base obligatoire. Les premiers fonds de garantie furent
installés aux Etats-Unis - le
Federal Deposit Insurance Corporation
pour les banques et le
Federal Savings & Loans Insurance Corporation
pour les caisses d'épargne furent mis en place en 1934, à peu
près dans le même temps que le
Glass Steagall Act et le Mac
Faden Act,
lois qui, dans un but prudentiel, avaient pour objectif de
restreindre fonctionnellement et géographiquement l'activité
bancaire. Depuis, l'ensemble des pays de l'OCDE se sont dotés de fonds
de garantie sur le modèle américain, et dont la
caractéristique commune est un appel
ex ante
des cotisations. En
d'autres termes, les fonds sont disponibles avant la crise.
Enfin, plus récemment, sous l'impulsion du Comité de Bâle
34(
*
)
une troisième voie a
été explorée consistant, d'une part, à mettre en
place une
réglementation prudentielle
tendant au
développement des fonds propres des entreprises bancaires
35(
*
)
. La phase la plus achevée de cette voie
consiste à se rapprocher le plus possible de la naissance du risque en
incitant les banques à se doter d'un système de contrôle
interne le plus performant possible. C'est la voie recommandée aussi
bien par la Commission bancaire
36(
*
)
que par le
ministre de l'économie et des finances qui déclarait
récemment : "
après les difficultés de ces
dernières années, il faut améliorer le système de
surveillance, le contrôle interne, pour anticiper les risques nouveaux."
37(
*
)
Or, à défaut de mettre en oeuvre le troisième
instrument dont l'importance était à l'époque
vraisemblablement sous estimée, le système mis en place, dans
notre pays, en 1984 n'empruntait que partiellement aux deux premiers
instruments.
Il n'y a pas eu en effet de création d'un fonds de garantie obligatoire
et couvrant l'ensemble du système bancaire
. Le législateur de
l'époque semble s'être satisfait des systèmes existants sur
base professionnelle, qu'il s'agisse des systèmes mutualistes ou du
système de l'AFB, mis en place le 14 janvier 1980. Ces systèmes
sont des systèmes fonctionnant par appel de cotisation
ex post
:
ce qui signifie que tant qu'il n'y a pas de pas de problème, il n'y a
pas de cotisations.
S'agissant de la garantie de prêteur en dernier ressort
,
la
doctrine de notre Banque centrale s'est progressivement formalisée afin
de déboucher sur
ce qu'il est désormais convenu d'appeler
la théorie de
"
l'ambiguïté
constructive
". Afin de limiter la prise de risques trop importants
qu'encourage le sentiment qu'en fin de compte il y aura toujours quelqu'un pour
payer (ce que les anglo-saxons appellent le
moral hazard
et que
l'on pourrait traduire par
aléa de moralité
), les banques
commerciales, solvables ou non, ne doivent jamais être sûres de
pouvoir bénéficier de la garantie de la Banque centrale.
A vrai dire, le système mis en place reposait essentiellement sur la
codification dans la loi d'une pratique existante, en Angleterre notamment,
selon laquelle le Gouverneur de la Banque centrale invite les actionnaires d'un
établissement de crédit à le recapitaliser en tant que de
besoin.
C'est le célèbre
article 52 de la loi bancaire
38(
*
)
, manifestation selon certains du "
génie
financier français
"
39(
*
)
,
censé résoudre tout à la fois les problèmes du
risque systémique et du coût de la garantie (ce sont les
actionnaires qui paient), et dont on rappellera qu'en 1983 la Commission des
lois du Sénat, sans doute peu sensible à cette forme de
génie, avait, sous l'impulsion de son rapporteur, le président
Étienne Dailly, demandé la suppression du premier alinéa
40(
*
)
.
En effet, le Président Dailly s'était opposé à
l'alinéa premier de l'article 52 qui lui semblait contraire au droit des
sociétés et notamment le principe de la limitation de la
responsabilité des actionnaires au prorata de leurs apport Pour lui ce
texte était inutile et dangereux. Il craignait que sous cette
"invitation" du Gouverneur ne se cache en vérité une contrainte.
Il lui fut répondu qu'il n'en serait rien... (voir encadré)
Travaux préparatoires relatifs à l'article
52 de la loi bancaire
L'examen de cet article en séance publique, au
Sénat, avait appelé une longue discussion qu'il serait hors de
propos de rapporter ici intégralement. On en retiendra néanmoins
les passages les plus significatifs (
Journal Officiel
, débats
Sénat, Samedi 5 novembre 1983 p. 2630 et suivantes).
M. Étienne Dailly,
rapporteur pour avis.- "
Le gouverneur de la
Banque de France est donc tenu d'inviter - l'indicatif est évidemment
impératif - les associés à fournir leur soutien, mais ces
derniers, en revanche, ne sont pas tenus de répondre à son
invitation, puisque cette disposition n'est assortie d'aucune sanction,
grâce au Ciel !
"En fait cette disposition constitue une sorte de droit d'alerte, mais ce
droit
d'alerte est institué au profit du gouverneur de la Banque de France
dans le cadre d'un établissement de crédit en difficulté.
Cette mesure pourrait être, certes positive, mais l'article 41 du projet
prévoit déjà pour la commission bancaire un droit d'alerte
des établissements de crédit en difficulté, à
l'effet de prendre toutes mesures destinées à rétablir ou
renforcer son équilibre financier.
"En revanche, le gouverneur de la Banque de France ne paraît pas
habilité à imposer - personne ne soutiendra, j'imagine le
contraire - aux actionnaires des obligations financières nouvelles,
d'autant que le propre même des actionnaires est que leur
responsabilité financière est limitée à leur
participation au capital. Voilà pourquoi la commission des lois
préfère supprimer cet alinéa, qui, en définitive,
n'a qu'une portée pédagogique, mais pourrait, par son maintien,
donner à croire qu'il confère au gouverneur de la Banque des
pouvoirs qu'en aucun cas personne ne peut lui conférer. Tel est l'objet
de l'amendement n° 90 qui vise à supprimer le premier alinéa
de l'article 49
"
M. Yves Durand
, rapporteur.- "
La commission des finances vient
d'écouter le rapporteur pour avis de la commission des lois et a suivi
son raisonnement. Mais elle avait accepté le principe de cet
alinéa, qui confère au gouverneur de la Banque de France une
prérogative particulière, au demeurant non contraignante. Elle
demande donc que la commission des lois réfléchisse au maintien
ou au retrait de son amendement.
"
M. Jacques Delors
, ministre de l'économie, des finances et du
budget.- "
Le Sénat a manifesté à maintes reprises son
souci de voir le gouverneur de la Banque de France jouir de prérogatives
qui lui sont nécessaires et comparables, compte tenu de ce qu'est notre
pays, à ce qui existe dans les autres.
"Nous avons donc cru bon d'introduire cet article, qui montre bien que
l'équilibre entre les pouvoirs de l'Etat, d'un côté, et
ceux du gouverneur de la Banque de France, de l'autre, est établi avec
soin. Des affaires récentes montrent qu'il est important que le
gouverneur de la Banque de France soit conforté tant vis à vis de
l'intérieur que vis à vis de l'extérieur. Sa double
mission consiste, d'une part à veiller au maintien des règles du
jeu et, d'autre part, à organiser la solidarité de place.
"Cet article de loi me paraît donc indispensable
".
(plus loin)
M. Étienne Dailly,
rapporteur pour avis.- "
Dans
une récente affaire (...) si le gouverneur avait eu ce texte il aurait
pu le leur imposer
(aux actionnaires)"
M. Jacques Delors
,
ministre
de l'économie, des finances et du budget.- "
Non, pas du tout !
"
(plus loin)
M. Étienne Dailly,
rapporteur pour avis.- "
En tant
que rapporteur de la commission des lois, et nous plaçant, comme nous
devons le faire sur le plan du droit, nous vous disons que cet article est
inutile et dangereux
".
(plus loin)
M. Charles Lederman
.- "
Je suis persuadé, monsieur
Dailly, que vous ne pensez pas un seul instant que ce mot
(invite)
puisse prêter à confusion. (...) Mais vous ne pouvez pas, un
seul instant, permettre à nos collègues de penser qu'il peut y
avoir une confusion et que le terme "invite" qui figure dans
l'article 49,
alinéa premier, peut le moins du monde, être
considéré comme une contrainte
.
"
Par conséquent, puisque, incontestablement, il n'y a pas de
contrainte, il ne peut pas y avoir de confusion et nous en revenons à la
pédagogie à laquelle il a été fait allusion tout
à l'heure. Effectivement, c'est un moyen pédagogique qui, dans
les espèces qui peuvent nous intéresser, est important
".
A l'Assemblée nationale, la discussion de cet article a
été plus brève. Mais confirme sans aucun doute l'intention
du législateur.
M. le ministre de l'économie, des finances et du budget.- "
J'indique
simplement à M. Gantier que, par cet article, nous avons voulu mettre le
droit en conformité avec les faits et consacrer le rôle de
magistère moral de la Banque de France, magistère moral qui ne va
pas d'ailleurs sans lui imposer, le cas échéant, le devoir
d'intervenir.
"De telles interventions sont elles fréquentes ? Fort heureusement, non,
je crois me souvenir qu'il n'y a eu qu'une en cinq ans
."
Il ressort des investigations menées par la mission d'information de la
Commission des finances de l'Assemblée nationale, que l'alinéa
premier de l'article 52 aurait été utilisé, soit
explicitement, soit sous forme de "
menace
" à plus de vingt
reprises, "
en toute confidentialité et avec succès, sauf dans
un nombre très limité de cas
"
41(
*
)
.
Or, on peut se demander dans quelle mesure cet article n'a pas
sacralisé l'immortalité bancaire et, avec elle, les
surcapacités actuelles.
Comme le relèvent les analystes de Standard & Poor's
42(
*
)
"
la pratique française de soutien continu
aux banques en difficulté aboutit à un paradoxe. Le principe de
solidarité bancaire illustré par l'article 52 de la loi bancaire
de 1984 apporte une sécurité supplémentaire aux
créanciers des banques françaises. (...)
Mais, bien qu'ayant
réussi à préserver la confiance dans le système
bancaire dans son ensemble, cette politique de soutien systématique des
établissements en difficulté a contribué à la
faible rentabilité de l'ensemble du secteur en laissant subsister des
établissements non rentables ou au bord de la faillite
. Le sauvetage
du Crédit Lyonnais en 1994 n'est que l'exemple le plus spectaculaire
parmi ceux organisés par les pouvoirs publics depuis le début de
la décennie.
"
En effet, si une recapitalisation ponctuelle peut être
justifiée dans un souci patrimonial lorsque l'établissement est
viable, la recapitalisation érigée en système de
prévention des risques, même dans le cas d'établissements
non viables, aboutit à entretenir la surcapacité du
système et rend impossibles les ajustements.
Afin d'apprécier à sa juste mesure cet effet
macro-économique, il faudrait pouvoir connaître avec
précision dans combien de cas l'application du premier alinéa de
l'article 52 a débouché sur une liquidation de
l'établissement recapitalisé. Le caractère confidentiel de
son utilisation rend malheureusement une telle mesure difficile. On suppose
néanmoins que sur la vingtaine d'utilisations dont il a fait l'objet, ce
texte a conduit, dans une majorité de cas, à la survie de
l'établissement en difficulté. On imagine mal en effet des
actionnaires, même bancaires, accepter de recapitaliser un
établissement dont ils savent par avance qu'il va faire l'objet d'un
retrait d'agrément ou d'une liquidation.
En outre, ce dispositif a progressivement donné lieu à une
jurisprudence du Comité des établissements de crédit
consistant à exiger, lors de l'agrément des banques, la
présence dans leur capital
d'actionnaires de
référence
, s'engageant par des lettres de confort à
garantir leur intervention en comblement de passif, sur l'invite du Gouverneur
de la Banque de France. Dans la mesure où, pour être efficace, ce
dispositif supposait que les actionnaires de référence soient des
établissements de crédit existants et solides, cette pratique
aurait très bien pu déboucher sur une cartellisation de la place
bancaire de Paris.
Les possibles effets pervers de l'article 52
Deux évolutions ont profondément modifié
l'appréciation que l'on peut porter sur le dispositif
français.
La première, d'ordre économique, tient à
l'élargissement du capital des banques à des acteurs non
bancaires ou étrangers
. En effet, dans quelle mesure est-il possible
de contraindre ces acteurs, par nature moins sensibles à la pression des
autorités bancaires, à respecter la solidarité de place ?
La dissolution progressive des noyaux durs imposés lors de la
privatisation des banques de premier ordre
(Société
Générale, BNP, Paribas...)
a également contribué
à fissurer les fondements mêmes de la solidarité de place
à la française
. Ce système ne serait-il efficace que
pour les plus petites banques ?
La faillite de la banque Pallas Stern en 1995, qui fut la plus importante
faillite bancaire en France depuis la guerre, illustre bien la remise en
question de ce principe de solidarité bancaire. Les actionnaires de la
Banque Pallas Stern ont en effet décliné la requête des
autorités de tutelle visant à organiser le soutien de la banque.
Avec le cas de la Compagnie du BTP et de Banque Commerciale privée
(BCP), il s'agit du troisième cas depuis 1993 où l'utilisation
publique de l'article 52 est restée sans effet. En outre, dans un cas au
moins, le Comptoir des entrepreneurs, son application s'est
révélée très difficile. Comme le remarquent les
analystes cités plus haut : "
Cet échec montre que les
structures d'actionnaires de type consortial ainsi que les actionnaires
industriels (au contraire des actionnaires bancaires) sont
particulièrement réticents à soutenir leur filiales
bancaires en France.
"
La seconde évolution réside dans l'adoption, au niveau
européen, d'une réglementation relative à la garantie des
dépôts
. C'est la directive n°94/20/CE du 30 mai 1994;
transposée par la France dès le 8 août 1994 au niveau
législatif (article 10 de la loi n° 94-679 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier créant un
article
52-1 de la loi bancaire
43(
*
)
) et en 1995 au
niveau réglementaire (règlement 95-01 du 21 juillet 1995 du
Comité de la réglementation bancaire).
Ce nouveau dispositif pose évidement le problème de la
cohérence avec l'article 52 de la loi bancaire
44(
*
)
et notamment de l'ordre chronologique des
interventions. Certains analystes
45(
*
)
pensent
que le recours à la garantie des dépôts pourrait jouer de
façon concomitante avec l'article 52, après l'appel en comblement
de passif et avant l'appel à la solidarité de place. La mission
d'information de la Commission des finances de l'Assemblée nationale
46(
*
)
penche au contraire pour une utilisation
mi-consécutive, mi-alternative : dans tous les cas, le gouverneur de la
Banque centrale ferait appel, dans un premier temps, à la garantie des
actionnaires de référence. Si cet appel reste sans écho ou
s'il se montre inefficace, il serait alors décidé, en fonction de
la nature du risque encouru, de faire appel soit au mécanisme de
garantie des dépôts (risque non systémique) , soit au
mécanisme de la solidarité de place (risque systémique).
Le second problème est celui de la modification des systèmes de
garanties existant. Contrairement à la proposition avancée par la
mission d'information de l'Assemblée nationale consistant à
mettre en place un véritable fonds de garantie interbancaire, la
solution retenue par le Gouvernement semble être la reconnaissance des
systèmes actuels
47(
*
)
. En effet, le 26
juillet dernier, ont été approuvés par le Comité de
la réglementation bancaire, le système de garantie des
dépôts de l'AFB et les systèmes dits équivalents des
établissements mutualistes. L'homologation de ces décisions
devrait en principe intervenir prochainement.
Si tel était le cas, la transposition de la directive "
garantie des
dépôts
" n'aurait fondamentalement rien changé à
la structure de notre système de protection. Celui-ci continuerait de
reposer, avant tout, sur l'article 52 de la loi bancaire, et la
prédiction du Président Dailly se révélerait exacte
: cet article était dangereux quand il fonctionnait, il est devenu
inutile depuis qu'il ne fonctionne plus.
Les blocages législatifs et réglementaires
En l'absence d'une diminution du nombre des acteurs, d'autres
modes d'ajustement auraient normalement du être utilisés :
mobilité du travail (géographique et sectorielle), durée
du travail, flexibilité des rémunérations et enfin
licenciements. Il n'en a rien été, ou presque.
La mobilité géographique et sectorielle n'a pu offrir des
perspectives suffisantes d'ajustement en dépit du poids très
important des charges de formation dans le secteur bancaire
(le double de
la moyenne nationale). En effet, la structure démographique du secteur
bancaire a pour caractéristique de comporter un grand nombre de
personnels faiblement qualifiés, recrutés pendant les
années 60. Olivier Pastré fait remarquer à cet
égard que "
même un secteur comme le BTP n'a jamais connu un
niveau de sous-qualification aussi durablement marqué
"
48(
*
)
. Selon ce même auteur, "
les progrès
dans ce domaine ne sont pas à l'échelle des enjeux globaux.
D'abord, parce que la réforme du système de formation bancaire
est une oeuvre de longue haleine, mais aussi et surtout - ayons le courage de
le dire - parce qu'une partie encore trop importante des effectifs bancaires
libérés par l'informatisation n'est pas "recyclable" - au moins
à un coût financier acceptable - sur les segments créateurs
d'emploi. Les difficultés que présente la formation d'un
salarié à Bac - 2 sont d'autant plus grandes (ce que soulignent
tous les rapports scientifiques sur le système éducatif) que l'on
cherche à transformer un technicien administratif en cadre
commercial
"
49(
*
)
.
En ce qui concerne les rémunérations, d'importants efforts
ont déjà été consentis au cours des
dernières années
.
La seule marge de manoeuvre restante se
trouve peut être du côté de la variabilité des
rémunérations
, facteur à la fois de motivation et
d'intégration progressive.
S'agissant des réductions d'effectifs, le secteur bancaire a subi,
comme l'ensemble des autres secteurs, les rigidités du droit du travail
français
et notamment de l'autorisation administrative de
licenciement, introduite en 1975 et renforcée par la suite. Quand bien
même les possibilités de licenciement auraient été
plus fortes, il est douteux que des banques nationalisées eussent
réellement mis en oeuvre de telles procédures.
Il n'en reste
pas moins vrai que des réductions d'effectifs sont malheureusement
inévitables. Pour autant, ces réductions sont le plus sûr
garant des possibilités de créations d'emplois ultérieures
dans le secteur et il convient de refuser l'affirmation selon laquelle la
"
banque est la sidérurgie de demain
".
Le secteur bancaire reste, en effet, un des secteurs où les
créations potentielles d'emploi sont les plus significatives. Toute une
génération de diplômés, qui reste aujourd'hui aux
portes du marché de l'emploi, pourrait permettre d'opérer la
diversification de l'offre de services bancaires. Pour reprendre le
parallèle effectué par M. Pastré, l'évolution de ce
secteur doit être comparée à celle du secteur du service
informatique qui a subi lui aussi un passage à marches forcées de
la taylorisation à la vente de services à valeur ajoutée.
Or, l'industrie française des services informatiques reste parmi les
plus performantes et les plus exportatrices au monde et constitue un des atouts
dont nous disposons pour lutter contre le chômage des jeunes
qualifiés. Comme le dit M. Marc Viénot, président de la
Société Générale, la réduction des
coûts se fera automatiquement en 2003-2004, du fait de la pyramide des
âges dans le secteur bancaire.
A cette époque, "
le
problème ne sera plus de savoir s'il faut licencier, mais de savoir
comment il faut recruter
"
50(
*
)
D'ici là, les licenciements seront d'autant plus réduits que les
entreprises bancaires pourront utiliser les autres variables que sont la
durée du travail et la modulation des prix. Or, de ce double point de
vue, la législation actuelle est source de blocages et de
rigidités.
La législation en matière de durée du travail
La variabilité de la durée du travail constitue
une marge de manoeuvre qui a été, globalement, insuffisamment
utilisée. Or quelle qu'en soit la forme, il s'agit sans doute d'une des
variables clés pour éviter que les pressions concurrentielles ne
se traduisent par des licenciements.
Cependant, l'interdiction d'étaler la durée du travail sur une
semaine entière rend cette marge de manoeuvre particulièrement
difficile à utiliser.
En effet, le décret du 31 mars 1937 interdit l'organisation du travail
par relais et par roulement
51(
*
)
, ce qui
contraint en pratique les guichets à mettre en place un horaire unique
de travail pour tout le personnel. Car même si le travail en
équipe est autorisé (12
ème
alinéa de
l'article 2), le travail d'équipe doit être continu, la seule
interruption étant le repos hebdomadaire.
L'article 2 de ce décret oblige également les banques AFB
à respecter deux jours de repos hebdomadaires (le dimanche et soit le
lundi, soit le samedi). Ceci n'est évidemment pas condamnable, mais la
combinaison de cette disposition avec l'obligation de répartir de
façon uniforme la durée hebdomadaire du travail sur cinq jours
contraint en pratique les guichets à fermer deux jours
consécutivement. Ils ne sont donc ouverts que 37 heures 30 par semaine
sur cinq jours (20 heures de moins que la Poste, un jour de moins que les
agences du Crédit agricole ouvertes six jours sur sept).
Toutefois, l'article L 212-2 du code du travail permet de déroger aux
dispositions du décret de 1937 par accord entre les partenaires sociaux.
Toutefois la procédure actuelle est particulièrement lourde
puisqu'elle prévoit un arrêté du préfet pour
déroger au repos du samedi et un arrêté ministériel
pour déroger à l'interdiction du travail par roulement ou par
relais.
La négociation de ce dossier au niveau de la branche professionnelle
(commission paritaire de la profession bancaire) n'a guère
évolué depuis plus de dix ans. Après l'échec, en
décembre 1994, de la négociation de branche, l'AFB a
proposé, en novembre 1995, au ministre des affaires sociales, une
"
charte
" offrant des garanties formelles aux salariés du
secteur,
en contrepartie d'une suppression du décret. Mais cette initiative n'a
pas encore eu de suites.
Certaines banques ont alors négocié leur propre accord. La
Compagnie bancaire a ouvert la voie en janvier 1995. Elle a été
suivie depuis par le CFF, quelques banques du CIC, la BRED et la BNP en juillet
1995. Mais ces accords, tous dérogatoires au décret de 1937, sont
limités, dans leur quasi-totalité, à des plates-formes
téléphoniques dédiées à des services de
banque à domicile.
L'accord-cadre signé par le Crédit Lyonnais en avril dernier
tranche avec les précédents en prévoyant une
réduction du temps de travail sans réduction du salaire
52(
*
)
.
En dépit de cet accord, le dialogue entre les partenaires sociaux ne
semble toujours pas, à la rentrée 1996, en mesure de
déboucher sur un accord de branche, les syndicats (voir auditions des
responsables syndicaux en annexe) refusant d'envisager une diminution
généralisée du temps de travail, assortie d'une diminution
de salaires. Toutefois, l'utilisation des dispositifs prévus par la loi
du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et
la réduction conventionnels du temps de travail, dite loi Robien,
pourrait donner lieu à de nouveaux développements.
Réponses des conseillers financiers des ambassades de France à Rome, Londres et Bonn
La réglementation sociale dans le secteur bancaire se
caractérise-t-elle par des obligations spécifiques analogues
à celles auxquelles sont soumises les banques AFB (décret de
1937) en France ?
1. La réglementation sociale en Grande-Bretagne
"La réglementation sociale de base est minimale et chaque banque a ses
propres dispositions. Ci-joint les dispositions de la banque
National
Westminster
et
Lloyds bank.
Il est à noter que les
licenciements se font très rapidement sans préavis."
2. La réglementation sociale en Allemagne
"Les relations sociales à l'intérieur du secteur bancaire
relèvent en Allemagne, comme pour tous les autres secteurs de
l'économie, d'un strict paritarisme employeurs-organisations syndicales.
La réglementation sociale résulte d'accords trouvés dans
ce cadre sans intervention de l'Etat fédéral, tant pour les
conditions générales du travail (révisées à
intervalle régulier) que pour les augmentations salariales
(négociées actuellement)."
3. La réglementation sociale en Italie
"La réglementation sociale applicable aux banques italiennes est celle
de droit commun. Certaines d'entre elles, notamment les fondations, avaient,
dans le passé, constitué leur propre fonds de pensions prenant
entièrement en charge le paiement des retraites. Ces fonds ont
été transférés à l'Institut National de
Prévoyance (l'INPS), les banques ne gérant plus que les fonds de
pensions constitués à titre volontaire et assurant le paiement de
retraites complémentaires."
La législation en matière de tarification des services
L'interdiction de rémunérer les
dépôts et de tarifer les services nourrit une controverse
récurrente. On peut y voir un legs de l'ancienne conception de la
"
banque-service public
". A cet égard, on peut rappeler que la
décision de tarifer les chèques, qui avait été
adoptée à une très large majorité par les caisses
régionales de Crédit Agricole en 1985, s'était
heurtée, semble-t-il, au
veto
du Gouvernement.
Récemment, la Cour de cassation, dans un arrêt de janvier 1995, a
remis en cause les dates de valeur sur les espèces. Cette jurisprudence,
ainsi qu'un rapport du Conseil national du crédit sur le "
bilan et
les perspectives des moyens de paiement en France
", de février 1996
ont relancé ce débat, dont on rappellera brièvement les
fondements juridiques avant d'en présenter l'impact économique.
Les fondements juridiques
L'interdiction de tarifer la délivrance des
chèques résulte de l'article 65-1 du décret loi du 30
octobre 1935. Celui-ci dispose que : "
Lorsqu'il en est
délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement
à la disposition du titulaire du compte dans les conditions
déterminées par décision de caractère
général du Conseil national du crédit
".
Une rédaction analogue se retrouve à l'article premier de la loi
du 1
er
février 1943 relative aux règlements par
chèques et virements : "
Les formules de chèques sont mises
gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de
chèques par les personnes, établissements et entreprises sur qui
les chèques peuvent être tirés et par l'administration des
Postes, télégraphes et téléphones
."
On
observera que seule la délivrance de carnets de chèques doit
être gratuite, et non l'émission de chèques
elle-même.
L'interdiction de rémunérer les dépôts
résulte d'une décision de caractère général
du Conseil national du crédit du 8 mai 1969, dont la teneur est
reprise à l'article 2 du règlement n° 86-13 du
14 mai 1986 du comité de la réglementation bancaire (CRB)
53(
*
)
. Le principe législatif de cette
interdiction figure à l'article 1756 bis du code
général des impôts, qui énonce l'interdiction de
rémunérer les dépôts au-dessus d'un niveau
fixé par le CRB ou directement par le ministre de l'économie et
des finances.
L'impact économique
S'agissant de l'impact économique de cette
politique
du ni-ni
(ni tarification - ni rémunération), plusieurs
observations s'imposent.
En premier lieu, il est évident qu'
une situation qui repose sur
"
l'échange de gratuités
" n'est pas économiquement
propice aux évolutions.
Imagine-t-on une autre industrie où
les producteurs ne pourraient ajuster en rien l'évolution de leurs
coûts sur les prix de leurs services ? Or , la gestion de moyens de
paiements s'assimile véritablement à une activité
industrielle. Avec 10,3 milliards de transactions à traiter par an et
des taux de croissance annuelle de l'ordre de 4%, elle absorbe en moyenne
35 % des frais généraux des établissements et se
traduit pour les établissements de crédit par un déficit
de plusieurs milliards de francs. Du reste, le Conseil national du
crédit, dans son rapport précité, a
considéré que "
si la productivité économique et
l'adaptation sociale de la gestion de moyens de paiement dans notre pays sont
unanimement reconnues, il n'en demeure pas moins que
cette gestion reste
très déséquilibrée pour le système
bancaire
.
"
Par ailleurs, les distorsions dans la facturation des
moyens de paiement
restent à l'origine d'une
utilisation inefficiente desdits moyens
par la clientèle (50 % de chèques de petit montant).
Ensuite, la non tarification est source d'
importantes
péréquations entre produits et entre clients
, qui
correspondent de moins en moins aux réalités économiques
actuelles, tant du côté des banques que du côté des
clients. Elle est
source d'opacité
et donne lieu à des
tarifications occultes, dont la pratique des dates de valeur, qui est sans
doute la plus connue
54(
*
)
et la plus irritante
pour les clients des banques, n'est malheureusement pas la seule (Certaines
banques se sont fait une spécialité de
"
prélèvements pour frais de gestion
", ou
"
participations à la gestion des comptes
" soudainement
imposés aux clients, en marge des "
conditions
générales
"
d'ouverture et de tenue des comptes).
Une enquête réalisée auprès de quinze grands
établissements de la place et publiée par l'Institut national de
la consommation en mars dernier confirme cette péréquation des
produits. Cette enquête a montré que les prix des services
bancaires aux particuliers ont progressé en moyenne de 89 % entre 1986
et 1995, quand l'ensemble des prix à la consommation n'augmentait que de
27 %.
Dans le même ordre d'idées une étude publiée dans
la revue d'économie financière de l'hiver 1995 semble montrer
qu'il existe "
une péréquation forte
"
entre produits
de dépôts (surfacturés) et produits de crédits
(sous-facturés).
55(
*
)
Enfin,
la non tarification constitue un frein à la baisse des taux
bancaires
. Ce phénomène s'explique par la structure
particulière du PNB des banques françaises. Celui-ci comporte en
effet une part assez faible de commissions (22,5 % en 1994), comparée
aux PNB des banques américaines (34,3 %) et britanniques (43,2 %),
qui rend les banques françaises particulièrement
vulnérables à la baisse des taux d'intérêt.
Selon certains analystes
56(
*
)
, une baisse des
taux de 1 % conduirait, pour les "
très grands établissements
à vocation générale
" (nomenclature 100 de la
Commission bancaire), et sur la base des résultats de 1994, à une
baisse du PNB de 6 % et, par l'effet d'inertie des frais généraux
et du poids du réseau, à une baisse d'un tiers du résultat
d'exploitation. Selon ces mêmes analystes, la désensibilisation
des résultats des banques aux variations des taux d'intérêt
exige d'accroître la part des commissions dans le PNB. Or cet
accroissement passe par une tarification de l'ensemble des services bancaires,
sans exception, sur la base de leurs prix de revient, et non, comme c'est le
cas actuellement, en fonction du degré d'acceptation, réel ou
supposé, du client face à des hausses de tarifs.
Le tableau ci-dessous met en évidence la faible
élasticité du taux de base bancaire par rapport à un taux
de marché.

On observera encore que le démarrage de la
troisième phase de l'Union économique et monétaire, au
1
er
janvier 1999, va immanquablement confronter les
établissements français à l'arrivée de concurrents
étrangers, où la rémunération des comptes courants
est classique. La France restant avec la Grèce et la
Nouvelle-Zélande, l'un des derniers pays de l'OCDE où une telle
pratique est interdite.
Toutes ces raisons ont conduit le Conseil national du Crédit, à
émettre le souhait que soient trouvés "
les principes d'un
meilleur équilibre économique pour la gestion des moyens de
paiement, que celui mis en place dans le milieu des années soixante."
Réponses des conseillers financiers des ambassades de France à Rome, Londres et Bonn
Existe-t-il, en matière de protection des consommateurs,
des dispositions aussi rigides que celles de la législation
française (modalités de renégociation des taux
d'intérêt des prêts en cours en cas de baisse des taux, lois
sur le surendettement ?
1. Grande-Bretagne
"Les britanniques ont des dispositions similaires à celles de la
France, une période d'attente (
cooling period
) pendant laquelle
le contrat peut être résilié sans frais."
2. Allemagne
"La protection du consommateur existe naturellement en Allemagne pour les
opérations financières, mais relève pour l'essentiel de
dispositions juridiques de niveau législatif et relativement succinctes
(interdiction de l'usure, faculté de renégociation des
prêts bancaire, etc.) et de la jurisprudence.
"Par comparaison avec la situation qui prévaut en France, les
dispositions juridiques de nature réglementaire sont sans doute
nettement moins nombreuses en Allemagne."
3. Italie
Il semblerait qu'il n'y ait pas en Italie de législation sur la
renégociation des prêts, dans la mesure où certaines
associations de consommateurs ont demandé au gouvernement d'imposer aux
banques cette faculté.
Les autres blocages législatifs ou réglementaires
Dans l'ensemble européen, la réglementation
française apparaît aujourd'hui comme la mieux faite pour
défendre les consommateurs. Mais c'est aussi la plus rigide.
La Commission des Communautés européennes considère
toutefois que le désarmement du système français est la
seule solution possible en prévision d'une éventuelle
harmonisation.
Rupture abusive et soutien abusif
Les banques françaises sont certainement les seules parmi
les pays développés à être placées aussi
étroitement qu'elles le sont entre le marteau de la rupture abusive de
crédit et l'enclume du soutien abusif à entreprise en
difficulté voir la mise en cause pour gestion de fait. La jurisprudence
britannique, par exemple, est beaucoup plus restrictive en la matière
57(
*
)
. S'il est vrai que ces imputations ne
peuvent être retenues arbitrairement, le risque juridique encouru par les
banques en France est loin d'être négligeable et peut expliquer
l'attitude réputée "
frileuse
" des banques vis-à-vis
de certains "
risques
", notamment les PME.
De la même façon, des jurisprudences sont établies qui
cultivent l'exception française de manière exagérée
par rapport aux usages internationaux en vigueur. Ainsi, contrairement à
ceux-ci, la Cour de cassation
58(
*
)
, en
application du décret du 4 septembre 1995 sur le taux effectif global, a
cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait décidé
que l'expert pouvait s'appuyer sur l'usage "
lombard
"
consistant à
retenir 360 jours pour calculer les intérêts applicables aux
découverts successifs du compte courant d'une société.
La législation sur les faillites
La législation sur les faillites telle qu'elle
résulte de la loi de 1985 est très favorable aux
débiteurs. En effet, cette loi, en vue de faciliter la continuation de
l'activité de l'entreprise a rendu prioritaires les créanciers
titulaires de créances nées au cours de la période
d'observation, c'est à dire après l'ouverture de la
procédure, même par rapport aux créanciers
antérieurs, titulaires de sûretés réelles.
Toutefois, les excès les plus évidents de cette loi ont
été corrigés par la loi du 26 mai 1994 qui a
rétabli, dans une large mesure les garanties bancaires et
moralisé les procédures, notamment les reprises. Cette loi a
également amélioré les mécanismes de
prévention des entreprises en difficulté.
Le risque de remboursement anticipé des crédits aux particuliers
Introduite par la loi du 13 juillet 1979, la faculté offerte aux emprunteurs de pouvoir renégocier leurs prêts à taux fixe moyennant une pénalité assez faible constitue une source de pertes de revenus pour les banques, invoquée par de nombreuses personnalités entendues par le groupe de travail.
Rappel des règles relatives au remboursement
anticipé
· Crédit à la consommation :
article L 311-29 du code de la consommation.
Droit exerçable à tout moment, sans indemnité, pour un
montant au moins égal à trois fois le montant de la
première échéance non échue (décret
n° 90-979 du 31 octobre 1990).
· Crédit immobilier : article L 312-21 du
même code.
Droit exerçable à tout moment, avec une indemnité ne
pouvant excéder six mois d'intérêt, plafonnés
à 3 % du capital restant dû * (décret
n° 80-473 du 28 juin 1980 - art. 2), pour un montant qui
peut ne pas être inférieur à 10 % du montant initial
du prêt.
* 1 % pour les prêts aidés par l'Etat.
De fait, lorsque les taux d'intérêt baissent significativement,
les emprunteurs trouvent avantage à rembourser leurs prêts par
anticipation puis à réemprunter le capital restant dû, ou
à renégocier leur prêt sur la base du gain qu'ils
pourraient réaliser par ce remboursement.
Cette attitude n'est pas illégitime,
mais elle coûte
très cher aux établissements
59(
*
)
qui doivent répercuter ce coût sur les nouveaux emprunteurs
(phénomène connu sous l'expression de "
mutualisation
"
du risque de remboursement anticipé).
En outre, elle peut donner lieu, dans certains cas, à des pratiques
déontologiquement condamnables. C'est le cas par exemple des pratiques
qui affectent les établissements spécialisés, notamment
dans le secteur des crédits immobiliers (voir audition du
président de l'Association des sociétés financières
en annexe). Ces institutions, qui, le plus souvent, font tenir leurs comptes
par des banques domiciliataires, ont été victimes, de la part de
ces dernières, de détournements de fichiers dont l'objectif est
de démarcher les clients en leur proposant de renégocier les
crédits en cours.
Examiné tout au long de l'année par le comité des usagers
du Conseil National du Crédit, ce dossier a fait l'objet de
réflexions présentées dans le rapport 1994-1995, mais n'a
pu déboucher sur un accord. Faute d'un consensus quant aux solutions
à adopter, les banques sous l'égide de l'AFEC et de l'AFB, n'ont
pu que clore provisoirement le dossier.
*
Cette impossibilité de procéder à des
ajustements a provoqué une anémie
généralisée du secteur bancaire. Au lieu d'être
concentrées sur les acteurs les plus faibles, les difficultés ont
été partagées par l'ensemble du système
(phénomène dit du partage du fardeau ou
burden share)
, ce
qui a rendu les ajustements particulièrement lents par comparaison avec
les systèmes bancaires étrangers et notamment britanniques et
américains, où la crise a été surmontée
beaucoup plus rapidement.
Surtout, les établissements de crédit se sont lancés dans
une concurrence effrénée qui les ont conduits dans des situations
d'aveuglement collectif. A défaut d'être
"
régulatrice
" la concurrence est devenue
"
destructrice
".
LES ERREURS DE GESTION DES BANQUES ET LA CONCURRENCE DESTRUCTRICE
Les erreurs de gestion ont aggravé la situation générale des banques, aggravation qui, à son tour a débouché sur une guerre des prix et une situation de concurrence destructrice.
Les erreurs de gestion
Les erreurs commises par les banques ont été
nombreuses et pourraient justifier un rapport spécifique.
Plusieurs membres de la Commission des finances du Sénat ont
particulièrement insisté sur ces erreurs, lui attribuant une
responsabilité très importante voire prépondérante
dans la genèse de la crise
60(
*
)
.
Il est exact que l'on ne saurait minorer, pour expliquer cette crise,
l'importance de certains atavismes de notre système bancaire et,
notamment, les liens privilégiés qu'il entretient avec la haute
fonction publique. Le métier de banquier, comme tous les autres
métiers, nécessite un long apprentissage. Les hauts
fonctionnaires, même les plus brillants, ne sauraient s'improviser
dirigeants bancaires par la seule vertu d'un décret de nomination. Il
convient toutefois de ne pas succomber à la tentation d'une
généralisation sans nuances.
Il est non moins vrai qu'en nommant systématiquement des hauts
fonctionnaires de l'administration des finances dans les banques publiques,
(voire privées ou semi-privées) l'exécutif a engagé
sa responsabilité.
Néanmoins, le rôle du législateur n'est pas de
définir ce que doit être (ou ne pas être) la gestion des
établissements de crédit. Pour autant, il demeure comptable de la
bonne utilisation des deniers publics. De ce point de vue, la commission des
finances du Sénat reste fidèle à la doctrine qu'elle a
établie dans le cadre de son rapport sur l'Etat actionnaire
61(
*
)
.
On observera également que des erreurs de gestion ont été
commises par les dirigeants bancaires dans tous les pays du monde et que faire
peser la responsabilité de la crise du secteur bancaire français
sur la seule administration serait réducteur.
Enfin, on peut penser que dans, une large mesure, le facteur
"erreurs" a
revêtu un caractère endogène autant qu'exogène. En
d'autres termes, qu'elles aient été d'essence tactique, comme
l'aveuglement collectif sur l'immobilier, ou au contraire stratégique,
comme l'idée que toutes les banques sont capables de devenir des banques
universelles, les erreurs commises ont résulté davantage de la
situation créée par les réformes, que d'une
incapacité collective des dirigeants bancaires français, hauts
fonctionnaires ou non.
Les erreurs tactiques
Les erreurs privées
Les erreurs tactiques témoignent avant tout de la
volonté des établissements de crédit, marqués par
l'affaiblissement de leurs marges, de se "
refaire
". La crise de
l'immobilier est particulièrement révélatrice de cet
enchaînement des catastrophes.
A cet égard, trois erreurs peuvent rétrospectivement leur
être imputées : s'être précipitées à la
fin des années 1980 sur un marché lucratif mais
spéculatif, avoir nié la crise pendant des années et en
avoir sous-estimé l'ampleur en ne procédant pas aux
provisionnements nécessaires.
Dans un premier temps, les banques, séduites par une rentabilité
élevée, ont cherché à compenser la faiblesse des
marges sur leurs activités traditionnelles en se précipitant sur
le financement de l'immobilier de bureaux, essentiellement en région
parisienne. Les concours accordés aux professionnels de l'immobilier
auraient augmenté de 173 % entre 1988 et 1990 pour atteindre plus
de 300 milliards de francs en 1992. Cette stratégie pouvait se
comprendre s'agissant des établissements spécialisés ou de
petite taille qui cherchaient à survivre.
Le cas du Comptoir des entrepreneurs, qui a connu une défaillance en
1993, est exemplaire. Cette institution financière
spécialisée, privée de la distribution de prêts
bonifiés par l'Etat, a cherché à se constituer à la
hâte un fonds de commerce. Sans atout concurrentiel particulier, elle
s'est lancée sur un marché risqué mais
rémunérateur. Elle y était même encouragée
par l'administration de tutelle, qui porte une part de responsabilité
non négligeable dans la quasi-faillite de l'établissement.
Le cas du Crédit Lyonnais, qui, par le caractère massif de ses
engagements, a aggravé la crise de l'immobilier, est encore plus
révélateur. Selon certaines informations
62(
*
)
,
la banque publique représentait à elle
seule près d'un tiers (105 milliards de francs) des concours de toutes
les banques françaises. Si l'on prend l'ensemble des
établissements publics ou semi-publics on arrive à environ 200
milliards soit près des deux tiers des encours de crédit.
La deuxième erreur a été de nier ou de minimiser la crise
de 1990 à 1992. Pourtant les signes en étaient nombreux et
concordants : entre 1990 et 1993, les prix de vente des bureaux parisiens se
sont effondrés de 40 %. Les loyers de bureau dans Paris centre qui
s'élevaient en 1990 à 3.000 francs le mètre carré,
ne dépassaient guère les 2.000 francs en 1993. Enfin, le stock
des immeubles de bureaux anciens en Île-de-France a quasiment
doublé entre 1990 et 1993. En dépit de ces signes, les dirigeants
de banques ont considéré que la baisse des prix serait
passagère. Avec l'aval des commissaires aux comptes et de l'instance
régulatrice, les établissements de crédit ont
minimisé l'impact des créances impayées sur leurs comptes
en attendant, en vain, des jours meilleurs.
Les pertes potentielles étant considérables, la troisième
erreur a consisté, quand la crise est apparue, à tenter de lisser
les provisions et à éviter un effondrement des prix de
l'immobilier. Un consensus de place s'est instauré, sous l'impulsion,
notamment, du tribunal de commerce de Paris, dont le mot d'ordre était :
pas de faillite afin d'éviter le bradage des prix et, par ricochet,
d'obliger tous les établissements à afficher des provisions et
des pertes massives.
Cette stratégie a eu pour conséquence de limiter les pertes
affichées, mais aussi de "
tuer
" le marché de l'immobilier
de bureaux. Les rares transactions n'ont plus été fondées
sur la réalité des prix, mais sur des arrangements de
circonstances. Finalement, cette stratégie n'a pas empêché
les prix de baisser et les coûts de portage de gonfler. En contrepartie
d' "
un krach mou
" nous avons subi "
une crise très
longue
".
Non seulement cet aveuglement collectif dans le secteur des crédits
à l'immobilier, n'a pas permis aux banques de restaurer leurs marges sur
leurs activités traditionnelles, mais par un effet de retour
dévastateur, les a conduites, sur ces mêmes activités,
à se lancer dans une guerre des prix, débouchant dans certains
cas sur des ventes à perte.
Les erreurs publiques
Au-delà des effets conjugués d'une concurrence
exacerbée et d'une crise conjoncturelle, les établissements
publics ont sans aucun doute souffert d'un déficit de gestion. A cela
plusieurs raisons que l'on rappelera brièvement, tant ce sujet a
été balisé.
La première tient sans doute à
l'arbitraire des
nominations
. Pour Jacques Attali, "
nommer est l'ivresse du seul vrai
pouvoir
"
63(
*
)
. Les entreprises publiques
françaises (et leurs salariés), particulièrement dans le
secteur bancaire, ont fait les frais de cette ivresse. Même si l'on peut
accepter, dans l'intérêt général, une certaine
"
porosité
"
64(
*
)
entre
l'administration et le secteur privé, pratiquée à haute
dose l'endogamie (administrative mais aussi politique) des élites semble
avoir joué une part non négligeable dans la faillite du secteur
public.
On peut relever ensuite les
dysfonctionnement des conseils d'administration
des entreprises publiques. Les représentants de l'Etat y veillent le
plus souvent à ne rien dire, qui pourrait leur être
reproché par la suite. L'Etat actionnaire se montre indifférent.
Ni stratége, ni gérant, il ne dispose même pas d'une
comptabilité consolidée susceptible de lui donner une vue
d'ensemble de son patrimoine.
Enfin, on rappelera
l'inexistence des sanctions
. Comme le relevait le
quotidien "
Le Figaro
" : "
La République est bonne fille
avec
ses élites, rarement sanctionnées, jamais laissées sur la
touche. L'ancien président de la banque Worms, qui a perdu 14,9
milliards de francs, n'a-t-il pas été chargé de
réaliser l'audit de France Télévision ?
"
65(
*
)
Les erreurs stratégiques
Les erreurs privées : le dogme de la banque universelle
La Banque Universelle peut être une réponse
adaptée à la désintermédiation pour les grands
réseaux disposant d'une taille critique et d'un réseau
international développé. Mais s'agissant des
établissements de taille petite et moyenne, elle s'est assurément
révélée moins profitable qu'une stratégie de
spécialisation sur les créneaux pour lesquels les avantages
comparatifs sont les plus forts. L'analyse par "
groupes homogènes
d'établissements
", effectuée dans la première partie
de ce rapport confirme que ce sont ces établissements qui ont le plus
souffert de la crise.
Même pour les grands réseaux, le schéma de banque
universelle suppose une organisation sans faille, impliquant notamment une
maîtrise du risque global, qui était loin d'être de
règle dans toutes les banques universelles.
Sans préjudice de ce qui sera dit plus loin sur les distorsions de
concurrence, le groupe de travail retire de ses auditions et plus
généralement de l'ensemble des contacts qu'il a pu avoir avec le
milieu bancaire que la gestion des réseaux mutualistes, qui allie, on
pourrait dire par construction, la proximité et le pragmatisme dans la
prise de décision à une moindre implication sur la région
parisienne, explique, au moins en partie, les résultats
contrastés entre ces réseaux et les banques AFB. Au demeurant, le
Crédit Agricole, qui, comme les banques commerciales, ne
bénéficie pas du monopole de distribution du Livret A, est de
loin la banque française qui se porte le mieux. Cette opinion rejoint
celle de certains analystes pour qui la progression supérieure du
produit net bancaire des réseaux mutualistes à celui des banques
AFB ne serait pas dû aux rentes de monopole "
mais à une
activité de banque de proximité, aussi bien pour les particuliers
que pour les entreprises qui s'avère plus rentable que la banque
généraliste, contrairement à une opinion auparavant
établie
"
66(
*
)
.
L'erreur stratégique a donc été de croire que la
banque universelle était à la portée de tous.
Certains théoriciens se sont du reste récemment
interrogés sur la spécialisation. Parmi eux, Olivier
Pastré, auteur d'un célèbre rapport sur la modernisation
des banques françaises, remis en 1985 à M. Daniel Lebègue,
alors directeur du Trésor, pense désormais que : "
compte tenu
de l'incertitude qui caractérise l'environnement bancaire actuel, la
spécialisation est un moyen (si ce n'est le moyen) de créer une
différenciation et, au-delà, de créer de la valeur
ajoutée bancaire. Rendons justice aux spécialistes. Ce sont eux
qui créent la valeur ajoutée. Le mouvement de
déréglementation qu'a connu le système bancaire
français a eu, dans ce domaine, des effets pervers. (...) Le cas des SDR
est particulièrement représentatif. Structures
spécialisées dans le financement des PME, elles constituaient,
dans bien des cas, des pôles de compétence, viables à
terme, mais incapables de réagir immédiatement à une
concurrence à laquelle elles n'avaient pas été
préparées.
"
67(
*
)
Les erreurs publiques : les banalisations ratées
Sans aucun doute l'Etat porte une responsabilité majeure
dans la crise du système bancaire français. Comme le
relève le rapport du Commissariat au plan : "
la transition d'un
paysage bancaire rigidement cloisonné et administré, fortement
institutionnalisé, à un marché bancaire concurrentiel n'a
pas été gérée. Les nationalisations n'ont pas
été utilisées pour restructurer les établissements
les plus fragiles pour recomposer le secteur bancaire, avant de passer à
la politique de privatisation ou à l'occasion de ces opérations
de privatisation, ce qui était vraisemblablement l'avantage réel
procuré par la nouvelle vague de nationalisation
"
68(
*
)
Ce défaut de vision stratégique et d'implication de
l'État actionnaire et tuteur a eu des conséquences graves dans le
secteur des institutions financières spécialisées
.
Au lieu de recentrer des établissements de place sur leur mission
de service public mieux définie, l'Etat a fait entrer ses institutions
spécialisées dans une concurrence qu'elles n'ont pas
été capables d'affronter (SDR, CEPME, CFF).
En d'autres termes, l'Etat n'a pas su arbitrer le conflit
d'intérêt entre, d'un côté, sa volonté de
conserver aux IFS des objectifs de service public et, de l'autre, son obsession
de la banalisation des réseaux.
La concurrence destructrice
Poussés par une pression concurrentielle très
forte, échaudés dans leurs tentatives de diversification dans
l'immobilier, les établissements de crédit, obsédés
par leurs parts de marché, se sont peu à peu engagés dans
une "
guerre tarifaire
", dont le seul résultat a été
un écrasement supplémentaire des marges.
Un tel constat a été fait, dès juillet 1995, par le
rapport Delmas-Marsalet, remis au Conseil national du crédit (voir
encadré ci-dessous).
"
La déréglementation des années 80 a
généré une concurrence accrue qui n'a pas
été suffisamment régulée par la contrainte de
rentabilité.
"
La première conséquence est, bien sûr, un laminage
excessif des marges d'intermédiation, dont on sait qu'elles sont
aujourd'hui très inférieures en France à ce qu'elles sont
dans la plupart des systèmes bancaires étrangers. Inutile de
préciser que ces marges sont devenues insuffisantes pour couvrir les
risques les plus élevés portés par les
établissements de crédit, en particulier le risque PME.
"
Une étude récente présentée par l'ancien
président de la Sofaris
69(
*
)
montre que
sur la période 1986-1990, le risque supplémentaire que comporte
le crédit à moyen terme aux PME, du fait de leur plus grande
vulnérabilité mesurée au nombre de défaillances par
rapport aux grandes entreprises, eût justifié un supplément
de marge de 1,5 %. Les enquêtes de la Banque de France sur le coût
du crédit montrent que les banques ont été loin d'obtenir
cette couverture du risque sur les crédits à moyen et long terme
aux PME, au cours de la période 1986-1993.
"
Plus récemment, depuis la fin 1993 et surtout le second semestre
1994, cette concurrence insuffisamment régulée par l'exigence de
rentabilité s'est traduite par l'apparition, puis l'extension de
pratiques de distribution de crédits à moyen-long terme, aussi
bien pour l'équipement des entreprises que pour l'habitat des
ménages, à des taux assez largement inférieurs à
ceux des placements sans risque constatés, pour des durées
équivalentes, sur les marché financiers
. C'est ainsi
qu'au mois de décembre 1994, époque à laquelle l'OAT
à 10 ans était émise à plus de 8 % et les BTAN
à 5 ans à 7,87 %, on a pu relever des taux de 6,80 % pour des
prêts d'équipement à taux fixe de 10 ans, 6,70 % pour des
prêts à 7 ans et 6,50 % pour des prêts à 5 ans
à des PME.
Ces pratiques, caractéristiques de tarification
aberrantes du crédit, n'assurent plus la couverture d'aucune sorte de
risque. Elles s'expliquent, certes, par la faiblesse persistante de la demande
de crédit sur la période considérée. Mais leur
extension n'en serait pas moins totalement suicidaire pour le système
bancaire
".
Cette analyse a été en partie reprise par le gouverneur de la
Banque de France, président de la Commission bancaire, qui relevait lors
de la présentation du rapport 1995 que : "
un net accroissement de
comportements imprudents a pu être constaté ces dernières
années avec le développement d'attitudes individuelles
motivées par une logique de conquête ou de défense de parts
de marché, au détriment du souci indispensable de
rentabilité des opérations. Tel est le cas de certains
crédits aux particuliers, notamment dans le domaine du logement , et
d'une large fraction des concours aux collectivités locales où le
niveau des marges pratiquées est rarement de nature à permettre
une couverture minimale du risque dans un domaine où celui-ci n'est pas
absent. Il est clair que ce climat explique en partie que la
profitabilité du secteur bancaire reste insuffisante
."
70(
*
)
Au vu de cette évolution préoccupante, la Commission bancaire a
fait réaliser au printemps 1995 une large enquête, notamment par
l'intermédiaire des succursales de la Banque de France, sur les
conditions dans lesquelles étaient déterminés les taux
débiteurs pour les catégories de prêts à la
clientèle les plus usuelles.
Cette enquête a mis en lumière que : "
dans un contexte
d'atonie de la demande de crédit, un indéniable affaiblissement
des disciplines internes : certains établissements s'affranchissent dans
certains cas des préoccupations élémentaires en
matière de prise de garantie, les dérogations aux barèmes
internes à chaque établissement ont tendance à se
multiplier, alors même ceux-ci ne prennent déjà plus
suffisamment en compte la couverture du risque de crédit et la
rémunération des fonds propres. Celles-ci sont souvent
justifiées par le développement d'une approche globale de la
clientèle, de préférence à une approche par
produit, alors même que les instruments de gestion et de contrôle,
adaptés à une telle démarche, ne sont pas toujours
disponibles."
C'est au regard de ce constat représentatif d'une situation très
préoccupante que la Commission bancaire a adressé une mise en
garde solennelle à la profession par une lettre du 18 juillet 1995, plus
connue sous le nom de "
circulaire Trichet
" en demandant une
information
à l'attention des conseils d'administration et des commissaires aux
comptes sur les conditions d'octroi des concours à la clientèle.
La Commission bancaire a mis en place, par l'instruction n° 95-03, un
dispositif de recensement de cette information.
Cette action qui va dans le sens d'une reconstitution des marges bancaires
(aucun crédit ne devrait être consenti à moins de 60 points
au-dessus du taux des emprunts d'Etat), a malheureusement coïncidé
avec le ralentissement de la diminution des taux longs. De plus, selon certains
analystes financiers (Goldman Sachs notamment) il faudrait en fait porter ce
ratio à 200 points de base pour que l'activité de prêt
à la clientèle redevienne profitable.
Dans une telle situation, la rentabilité des banques diminue et les
parts de marché n'évoluent pas assez pour compenser, chez les
banques les plus performantes, la baisse de rentabilité unitaire, les
banques les moins compétitives conservant malgré tout une partie
de leur clientèle. Il en résulte un affaiblissement
général du système bancaire.
La concurrence au lieu d'être régulatrice devient
destructrice. L'agressivité commerciale s'accroît dans un contexte
de surcapacité et la vente à perte ne fait que traduire le
désarroi des acteurs. En l'absence d'ajustements ou de reprise de la
demande de crédit, toute tentative de juguler cette pratique semble
malheureusement vouée à l'échec.
*
C'est donc dans une situation de faiblesse généralisée, aggravée par des comportements collectivement suicidaires, que le système bancaire a du faire face à des facteurs aggravants et, notamment, le retournement conjoncturel des années 1991-1995, qui ont transformé une situation difficile en situation de crise.
LES FACTEURS AGGRAVANTS
Force est de reconnaître que deux facteurs conjoncturels ont aggravé la situation du secteur bancaire au tournant des années 1990-1993 : le retournement conjoncturel et la hiérarchie des taux d'intérêt. En outre, la surimposition des banques, qui pouvait être supportée sans trop de difficultés en période de croissance, a contribué à tirer les résultats dans le rouge.
Le retournement conjoncturel
Le système bancaire français a dû faire face
à deux événements majeurs qui ont profondément
affecté sa rentabilité : la crise immobilière, à
partir de 1991 et la récession de 1993 qui a particulièrement
frappé les PME. A elle seule, la crise de l'immobilier aurait
occasionné aux banques des pertes totales estimées à un
montant compris entre 210 et 280 milliards de francs, sur un total d'encours de
crédits à fin 1995 de 350 milliards de francs.
De façon plus générale, l'évolution de la richesse
nationale entre 1989 et 1995 a été marquée par le
ralentissement de 1991 et la récession de 1993.

Ce ralentissement de la croissance a sans doute lourdement
pesé sur le résultat brut d'exploitation du système
bancaire dont on rappelle qu'il a diminué de 34 % en 1990 et de 76 % en
1992.
Parallèlement, on constate que le nombre des défaillances
d'entreprises a connu deux pics conjoncturels à la fin de l'année
1990 et, surtout, au début de 1993.

Comme le relève le rapport du commissariat
général au plan, la dégradation conjoncturelle s'est donc
non seulement répercutée sur la demande de crédit, le PNB
et le résultat des banques, mais elle a fortement réagi sur le
niveau des encours de crédits compromis et les taux de provisionnement
nécessaires du fait de la multiplication des défaillances
d'entreprises.
Cette situation n'est guère surprenante, puisque le système
bancaire joue traditionnellement le rôle d'amortisseur des crises.
De façon plus structurelle et sans doute plus inquiétante, les
conditions économiques prévalant depuis cinq ans incitent de
moins en moins à l'endettement des entreprises. En effet, les taux
d'intérêt réels élevés découragent
l'endettement et incitent soit à la constitution de fonds propres plus
importants, soit aux placements financiers, soit encore au
désendettement. De plus, la conjoncture déprimée
modère la progression des concours aux sociétés, qui a
été quasi nulle en 1992 et a reculé de 10,6 % en 1993.
Enfin, le taux d'autofinancement des entreprises a atteint ces dernières
années des niveaux très élevés qui limitent le
recours aux financements bancaires.

Dès lors, l'activité de crédit ne constitue
plus par elle-même un levier suffisant pour constituer ou conserver une
clientèle d'entreprises.
Dans ces conditions, il ne sert a à rien de stigmatiser la
frilosité des banques : les années passées se
caractérisent moins par une restriction de l'offre bancaire que par une
contraction de la demande de crédit. En admettant même que les
banques aient fait preuve de frilosité, ce qui somme toute n'est
guère surprenant en période de crise, faut-il vraiment les en
blâmer en oubliant qu'elles sont également comptables des
dépôts des épargnants ? Faut-il également oublier
que les conditions d'exercice du métier bancaire conduisent à
sous-tarifer les crédits aux PME.
La structure des taux d'intérêt
Il est généralement admis que la
rentabilité à moyen terme des banques est
déterminée moins par le niveau des taux d'intérêt
que par la "
pente
" ou hiérarchie des taux d'intérêt,
c'est à dire par l'écart entre les taux à long terme et
les taux à court terme. Normalement les banques se financent à
court terme et prêtent à long terme. Les taux à long terme
étant, généralement, plus élevés que les
taux à court terme, elles effectuent ainsi des profits destinés
à rémunérer ce qu'il est convenu d'appeler le coût
de transformation.
Or, la hiérarchie des taux a pendant longtemps été
inversée interdisant un tel type de refinancement. En effet, comme on
peut le constater sur le tableau ci-après, entre 1989 et 1994, les taux
courts ont presque toujours été au-dessus des taux longs.
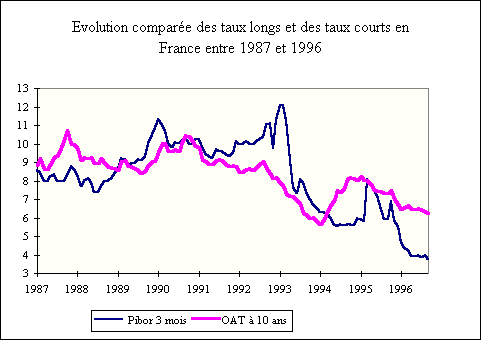
Depuis le milieu de l'année 1995, la structure des taux
est très pentue en France (il y a plus de 250 points de base au premier
trimestre 96 entre le 3 mois et le 10 ans). Mais, selon certains
économistes et, notamment Patrick Artus
71(
*
)
,
cette situation n'est pas exploitée par les
banques. En effet, en raison de la structure du bilan des banques, et,
notamment, de l'importance des dépôts à vue, "
une
pentification par une politique monétaire stimulante réduit les
profits bancaires, en France, ou au mieux est neutre, si la
rémunération de l'épargne contractuelle suit les taux
courts
".
Par ailleurs, le rapport du Commissariat général au plan met en
évidence le fait que, dans un système de change flottant
marqué par des crises monétaires à
répétition, les banques françaises sont sans doute
devenues de plus en plus réticentes à prendre des risques de
transformation et ont pratiqué l'adossement des maturités.
Cette caractéristique pourrait expliquer que les banques
américaines aient pu profiter pleinement du retour à une
hiérarchie normale des taux d'intérêt et du creusement de
l'écart entre les taux longs (les plus élevés) et les taux
courts (les banques prêtent à long terme et se refinancent
à court terme), alors que les banques européennes et en
particulier françaises, ayant plus ou moins renoncé à la
transformation, n'ont pu profiter de cette situation.
Pour autant, comme le fait remarquer Jean-Paul Betbèze
72(
*
)
, la "
leçon américaine
" n'est pas
entièrement transposable en France avec une Banque de France qui a un
objectif de change et compte tenu du risque de tensions spéculatives sur
les taux d'intérêt à l'approche de des
échéances de la monnaie unique.
La fiscalité excessive
Non seulement la fiscalité qui pèse sur les banques est supérieure à celle des autres secteurs économiques, mais l'évolution récente tend à faire des établissements de crédit des auxiliaires bénévoles du fisc.
Les impôts spécifiques aux banques
Comme toutes les autres entreprises, les banques acquittent l'impôt sur les sociétés et les impôts locaux. Mais elles supportent en plus la taxe sur les salaires (à laquelle il faut ajouter les problèmes résultant du non assujettissement à la TVA) et la contribution des institutions financières 73( * ) .
La taxe sur les salaires et le problème connexe de assujettissement à la TVA
Sans équivalent dans les pays européens, la taxe
sur les salaires a été imposée aux banques, ainsi qu'aux
assurances et à certaines associations, afin de tenir lieu de TVA. Elle
se justifie, d'une part, en raison des difficultés d'appréhender
fiscalement la valeur ajoutée produite par ces entreprises, d'autre part
et surtout, s'agissant des banques, des risques d'augmentation des taux
d'intérêt liés à assujettissement à la TVA
des opérations de crédit bancaire.
Cette taxe représentait, en 1994, environ 5 milliards de francs pour
les seules banques AFB et près de 9 milliards de francs pour l'ensemble
du secteur bancaire.
Par rapport à la TVA, la taxe sur les salaires comporte deux
inconvénients majeurs. D'une part, elle ne donne pas lieu à
déduction, ce qui signifie que les banques doivent l'inclure dans leurs
prix de revient, sans que les entreprises clientes puissent la
récupérer. D'autre part, elle n'est pas proportionnelle mais
progressive
74(
*
)
. Elle frappe donc davantage
les entreprises qui utilisent une main d'oeuvre abondante ou bien
rémunérée. On observera en outre que les tranches du
barème, fixées en 1979 n'ont fait l'objet d'une actualisation que
depuis 1989 et qu'en conséquence le poids de l'impôt s'est accru
plus vite que la masse salariale.
Elle handicape donc le secteur bancaire à trois points de vue :
- elle a un effet négatif sur l'emploi et incite les banques
françaises à se délocaliser ;
- elle place nos banques en situation défavorable par rapport à
leurs concurrents étrangers
; cet handicap a du reste
été reconnu par le Conseil des impôts dans son
quatorzième rapport sur la "
fiscalité et la vie des
entreprises
" (octobre 1994) ;
- elle prive les banques de la récupération de la TVA qui leur
est facturée.
Selon l'AFB, ce phénomène de
rémanence était estimé en 1994 à 4,5 milliards de
francs. Comme le fait observer le Commissariat général au plan,
ce phénomène a des effets d'autant plus importants en termes de
compétitivité internationale que le taux moyen de TVA est plus
élevé en France qu'à l'étranger. En outre, il a
été aggravé par l'article 17 de la loi de finances
rectificative pour 1993 qui prohibe la récupération de la TVA
pour les immobilisations et les frais généraux susceptibles
d'être affectés à l'encaissement des dividendes.
Toutefois, comme le souligne le rapport du Commissariat général
au plan, pour considérer que ces charges non récupérables
sont, en partie au moins, répercutées auprès de la
clientèle des banques, freinant de ce fait la capacité des
banques à répercuter la baisse des taux d'intérêt.
La "contribution des institutions financières" (taxe sur les frais généraux)
Instaurée en 1982, à titre exceptionnel, cette
contribution est devenue permanente en 1984
75(
*
)
. Elle ne frappe que les banques et les compagnies
d'assurance. Son assiette est constituée des frais
généraux qui comprennent en particulier, les charges de
personnel, les frais de gestion et les dotations aux amortissements. Son taux
est de 1 %. Elle n'est pas admise en déduction du bénéfice
imposable. En 1995, le produit de cette taxe était de 2,6 milliards
dont, selon l'AFB, environ la moitié serait payée par les
banques.
Cette taxe emporte les mêmes conséquences et les mêmes
critiques que la taxe sur les salaires.
- elle nuit à l'emploi,
puisque, pour l'essentiel, les frais
généraux sont constitués de frais de personnel. Cette
caractéristique est même aggravée puisque son assiette,
définie de façon extensive, inclut les charges sociales et la
taxe sur les salaires. En d'autres termes, plus les entreprises paient
d'impôt, plus le poids de la taxe sur les salaires est important. Il
serait plus simple d'admettre que son taux réel est supérieur
à son taux apparent.
- elle handicape les banques françaises dans la compétition
internationale.
Par comparaison avec les principaux pays européens, la fiscalité
applicable aux établissements bancaires français peut
apparaître pénalisante.
Réponses des conseillers financiers des ambassades de France à Rome, Londres et Bonn
1. La fiscalité des banques en Grande-Bretagne
La fiscalité des banques en Grande-Bretagne est de droit commun. Les
banques règlent l'impôt sur les sociétés qui est de
33 %.
En revanche, les rentrées fiscales au titre de la TVA sont marginales
car les activités financières en sont exonérées.
Les activités non-financières (comme la location de coffres) y
sont assujetties mais représentent un prorata de déduction de 5
à 10 %.
Les taxes sur les frais généraux n'existent plus et le Royaume
Uni n'a pas de taxe sur les salaires.
2. La fiscalité des banques en Allemagne
Les banques sont soumises en Allemagne à l'ensemble des impôts
dont sont redevables les autres entreprises. Les opérations de
crédit des banques ne sont cependant pas soumises à la TVA (de
même par exemple, que les crédits consentis aux détaillants
par les fournisseurs), alors que les commissions restent assujetties à
cet impôt. Les seules banques dispensées de la taxe
professionnelle (
Gewerkbesteuer
) sont des institutions publiques qui
n'ont pas de vocation commerciale proprement dite (
Bundesbank, Kreditanstalt
für Wiederaufbau, Ausgleichsbank
).
3. La fiscalité des banques en Italie
S'agissant du régime de la TVA, les banques comme toutes les
entreprises y sont assujetties et ne font pas l'objet de dispositions
particulières. Toutefois, en raison même des modalités
d'application de la taxe, la plupart des activités bancaires en sont
exonérées : octroi de crédits, opérations en
devises, transactions sur titres... Sont également exemptées de
la taxe les commissions applicables à ces opérations. Au total,
près de 99 % des activités bancaires n'entrent pas dans le champ
d'application de la TVA et les banques peuvent être
considérées comme des consommateurs finaux. Un régime
durement contesté.
Les banques sont redevables d'une taxe spéciale (en substitution des
droits d'enregistrement ou d'autres droits) qui frappe les opérations
à moyen et long terme (taux de 0,25 % du montant du crédit), d'un
impôt, l'ICIAP, comparable à notre taxe professionnelle (dû
également par les entreprises), de droits d'enregistrement forfaitaires
sur les relevés des comptes bancaires (environ 100 et 200 francs par an
pour les personnes physiques et les entreprises) et de droits de timbre
applicable aux transactions sur titres.
Le rôle de percepteur des banques
Comme le met en évidence le rapport du Commissariat général au plan, les banques sont devenues progressivement des percepteurs pour le compte de l'Etat puisqu'elles sont chargées de liquider, précompter, puis de verser au Trésor le prélèvement forfaitaire libératoire sur certaines catégories de revenus. La versatilité de la fiscalité de l'épargne rend cette tache, assurée à titre gratuit, particulièrement complexe et délicate.
Réponses des conseillers financiers des ambassades de France à Rome, Londres et Bonn
Les obligations de service public auxquelles sont soumises les
banques font-elles ou non l'objet d'une compensation financière
(prélèvement des impôts mensualisés,
déclarations fiscales, déclarations des mouvements de
capitaux...) ?
1. Grande-Bretagne
"En ce qui concerne les impôts, la retenue est faite à la source.
Vous avez différentes dispositions comme les prélèvements
automatiques (
standing orders
) dont les coûts sont tout à
fait variables d'une banque à l'autre. Il n'y a pas de règle
générale."
2. Allemagne
"Il n'existe pas en Allemagne, en faveur des banques, de telles
compensations
financières, mais : les "obligations de service public" auxquelles
sont
assujetties les banques allemandes sont moins importantes qu'en France
(l'impôt sur les salaires est prélevé à la source,
par exemple), et la tarification des services bancaires est la règle,
même pour les opérations simples (tenue d'un compte courant)."
3. Italie
"Les banques italiennes sont soumises à un série d'obligations
de service public.
"a) elles sont responsables du recouvrement de l'impôt frappant les
produits des dépôts. A ce titre, elles ne perçoivent aucune
commission. Au contraire, elles doivent avancer, en tranches au cours de
l'année, les sommes dues au titre de ces impôts, lesquelles sont
normalement imputées sur les intérêts qu'elles versent
à leurs clients à la fin de l'année.
"b) le régime de "l'autotaxation" (les contribuables calculent
eux-mêmes le montant de l'impôt sur le revenu) leur permet
d'encaisser pour le compte de l'Etat l'impôt sur les revenus. Elles
perçoivent à ce titre une commission forfaitaire par versement
effectué à ce titre.
"c) Tous les mouvements de capitaux à destination de l'étranger
d'un montant supérieur à 20 millions de lires (67.600 francs)
font l'objet d'une déclaration annuelle au fisc. Aucune commission
n'est perçue au titre de cette prestation."
*
Les réformes introduites dans le système
bancaire ont permis d'améliorer le financement de l'Etat en particulier
et de l'économie en général, mais au prix d'un
affaiblissement généralisé du secteur lui-même,
imputable essentiellement à l'impossibilité ou au refus de
procéder aux ajustements inscrits dans ces mêmes réformes.
Poussées par une concurrence sans cesse croissante, les banques, et
l'Etat qui était leur actionnaire, ont commis des erreurs de gestion,
tactiques voire stratégiques. Toutes ont rêvé au
schéma de la banque universelle, comme les alchimistes de la pierre
philosophale. Peu étaient en mesure de l'appliquer avec succès.
Des facteurs aggravants soit conjoncturels (crise des PME, crise de
l'immobilier, structure des taux d'intérêt), soit structurels
(fiscalité) ont aggravé la récession.
Globalement, les distorsions de concurrence n'ont guère influé
sur cette situation. Pour autant, elles sont réelles et ont conduit
à une redistribution sectorielle des parts de marché qui rend la
crise insupportable à ceux des acteurs qui n'en
bénéficient pas.
*
LES DISTORSIONS DE CONCURRENCE SONT RÉELLES ET RENDENT LA CRISE INSUPPORTABLE À CEUX QUI N'EN BÉNÉFICIENT PAS
Les distorsions de concurrence peuvent être
regroupées en trois catégories : celles liées au monopole
de la distribution de certains produits spécifiques, celles tenant
à la nature juridique des intervenants et celles qui résultent de
dispositions réglementaires ou législatives spécifiques.
Sur l'ensemble des ces questions à fort contenu passionnel, l'analyse
juridique effectuée par le Conseil de la concurrence apporte un
éclairage indispensable parce qu'impartial
76(
*
)
.
LES DISTORSIONS LIÉES AU MONOPOLE DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS PRODUITS SPÉCIFIQUES
Ces distorsions sont au nombre de deux : livret A et livret bleu, d'une part, monopole de la distribution des dépôts des notaires en milieu rural, d'autre part.
Le livret A et le livret bleu
Bref rappel des arguments en présence
Comme on le sait, la distribution de ces livrets est
réservée à certains réseaux (Caisse nationale
d'épargne, au travers des guichets de La Poste et Caisses
d'épargne et de prévoyance (dites "écureuil") pour le
livret A ; Crédit mutuel pour le livret bleu).
En contrepartie de ce monopole, les réseaux de distribution sont soumis
à des règles d'emploi des fonds.
Pour le livret A
, la totalité des fonds collectés est
centralisée à la Caisse des dépôts et consignations
qui en assure la gestion. Depuis 1990, ces fonds servent uniquement à
financer le logement social, principalement sous forme de "
prêts
locatifs aidés
" (PLA).
Toutefois, les réseaux distributeurs perçoivent une commission
annuelle qui est de 1,5 % de l'encours collecté pour le réseau de
La Poste et de 1,2 % pour les Caisses d'épargne. Concernant ces
dernières, les produits ainsi perçus représentent 15 %
environ de leur PNB globalisé. Le Centre national des caisses
d'épargne et de prévoyance (CENCEP) (voir audition
annexée) estime que le niveau de commissionnement est à peine
suffisant pour couvrir les frais de gestion liés à ce produit.
Cependant, un rapport de l'inspection générale des finances de
1994 sur la caisse d'épargne de Bourgogne aurait évalué le
coût de gestion du livret A à 0,96 % de l'encours des
dépôts collectés sur ce support en 1994, ce qui laisserait
à l'établissement une marge finale de 0,24 % sur l'encours (711
milliards de francs fin 1995), soit environ 1,7 milliard de francs.
Pour le livret bleu
, les fonds collectés sont, ou bien
utilisés pour l'octroi de prêts directs au logement social, ou
bien affectés en compte à la Caisse des dépôts et
consignations. Avant 1991, ce produit semble avoir été
générateur de marges brutes (avant imputation des frais de
gestion) substantielles pour le Crédit mutuel estimées par la
Commission bancaire à environ 3 ou 4 % des encours. Depuis cette date,
la marge se serait considérablement réduite, atteignant 1,3 %,
pour représenter un montant de 1,5 milliards de francs en 1995, soit 8,3
% du produit net bancaire du réseau du Crédit mutuel.
Commercialement il ne fait pas de doute que ces produits constituent des
"
produits d'appel
", permettant la distribution de produits plus
sophistiqués (SICAV notamment) sur lesquels les marges sont plus
importantes. Selon le président du CENCEP (voir audition
annexée), le produit net bancaire généré par le
Livret A serait de l'ordre de 5 milliards de francs.
On observera par ailleurs que ces produits enregistrent une forte
décollecte depuis quelques années et qu'en contrepartie de
l'avantage du monopole sur ces produits, les réseaux distributeurs n'ont
eu qu'un accès tardif à certains produits ou à certains
segments. Ainsi, les caisses d'épargne n'ont elles pu diffuser des
comptes chèques qu'à partir de 1978 et distribuer des
crédits aux PME qu'à compter de 1987. Aujourd'hui encore, elles
ne peuvent consentir de prêts aux entreprises faisant appel public
à l'épargne.
Réponses des conseillers financiers des ambassades de France à Rome, Londres et Bonn
Il existe une vive controverse en France sur la
nécessité ou non de banaliser la distribution du livret A. Par
comparaison, quelle est la place de l'épargne administrée (taux,
liquidité, sécurité) et existe-t-il des réseaux
spécialisés de distribution des produits financiers
correspondants ?
1. Grande-Bretagne
"Globalement l'épargne britannique se répartit entre trois types
de comptes : les TESSA (
Tax exempt special savings
), les comptes de
dépôt dans les banques (
saving accounts
) et les comptes de
dépôt dans les sociétés de crédit
hypothécaire (
building societies
). Il n'y a pas de réseau
spécialisé.
"En fait, les comptes de dépôt, tels qu'on les trouve dans les
banques et les sociétés de crédit hypothécaire,
sont assez peu différents les uns des autres. Les comptes sont
rémunérés dans les deux cas avec des taux et des
conditions variables selon les banques. Ces comptes ne font pas l'objet de
réglementation générale.
"En revanche, pour les TESSA qui sont des comptes d'épargne exempts
d'impôts, il y a des règles générales de base et
des conditions d'ouverture d'un compte (âge minimum requis 18 ans, ne pas
posséder d'autre compte TESSA ou avoir un compte qui arrive à
maturité), ainsi que des conditions de durée (5 ans ) et de
montant initial avec des plafonds limites d'investissement.
"Les conditions de transfert des montants épargnés d'un compte
TESSA à un autre compte varient aussi selon les banques ou les
sociétés de crédit hypothécaire (délai de
préavis de 0 à 3 mois et/ou une pénalité
financière pouvant aller jusqu'à 50 livres).
"De même, les taux d'intérêts servis sont variables selon
les banques et les montants déposés et peuvent être
modifiés à tout moment."
2. Allemagne
"Il n'existe pas en Allemagne de forme d'épargne administrée
telle qu'elle existe en France, ni non plus de réseaux bancaires
spécialisés dans la distribution de tel ou tel produit.
"L'émission "d'obligations hypothécaires" (
Pfandbrief
)
est certes réservée aux banques hypothécaires, mais pour
des raisons essentiellement prudentielles, et le statut de banque
hypothécaire est indépendant de la nature, publique ou
privée, de l'actionnaire."
3. Italie
"Il n'existe pas en Italie de circuits d'épargne
privilégiés ; seule la rémunération de
l'épargne postale est fixée par arrêté du ministre
du trésor."
L'analyse juridique du Conseil de la concurrence
Si, pour le Conseil de la concurrence, le monopole de distribution des livrets A et bleu ne peut être qualifié d'abus de position dominante, en revanche, il constitue une restriction de concurrence injustifiée par des considérations d'intérêt général.
Le monopole ne constitue pas un abus de position dominante
Pour le Conseil, même si aucun autre produit
d'épargne n'offre autant d'avantages que le livret A, certains produits
lui sont substituables (CODEVI, livrets jeunes, LEP... ). Si bien qu'il ne
constitue pas un marché financier spécifique, mais un segment
d'un marché plus vaste qui est celui des livrets d'épargne
administrée.
Sur ce marché, les caisses d'épargne, avec 38 % de parts de
marchés, ne détiennent pas une position dominante. D'une part,
parce le deuxième opérateur - La Poste - détient aussi une
part importante (24 %). D'autre part, parce les autres établissements
qui ne distribuent pas le livret A sont en progression, alors que la collecte
du livret A a tendance à diminuer.
A supposer même que les caisses d'épargne détiennent une
position dominante sur le marché des livrets d'épargne
administrée, des pratiques abusives sont difficilement envisageables,
puisque les conditions d'ouverture, de rémunération et de
plafonnement des livrets sont fixés par les pouvoirs publics.
En revanche, le Conseil n'exclut pas que les résultats éventuels
dégagés par la gestion du livret A soient utilisés pour
subventionner les ventes de produits sur d'autres marchés. Mais s'il est
vrai que le livret A constitue un produit d'appel plaçant les
établissements qui le distribuent en situation
privilégiée, d'autres produits ou services qui sont
distribués librement peuvent aussi comporter de tels effets.
Il suit de ce qui précède que le monopole des caisses
d'épargne ne constitue pas un abus de position dominante.
Le monopole constitue une restriction de concurrence injustifiée
Partant du postulat que ce monopole constitue une restriction
de
concurrence, le Conseil s'interroge sur le point de savoir si celle-ci est
justifiée ou non.
Il rappelle que le droit communautaire n'interdit pas l'octroi par un
État membre de droits exclusifs à des entreprises, publiques ou
non, chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, alors même que l'attribution de
tels droits entraîne des restrictions à la concurrence. Mais pour
que l'octroi de tels droits soit compatible avec le droit communautaire, encore
faut-il que soient réunis deux éléments. Il faut en effet :
D'une part,
une mission d'intérêt général
assignée par un
acte de puissance publique
;
D'autre part, que la
restriction
de concurrence soit
indispensable
à
l'accomplissement
de la mission.
Or, la distribution des livrets A et bleus est susceptible de répondre
à deux missions d'intérêt général : le
développement de l'épargne populaire, le financement du logement
social.
Le développement de l'épargne populaire.
C'est historiquement la première mission assignée
à la distribution de livrets de caisse d'épargne. Elle consiste
à favoriser la diffusion des comportements d'épargne dans les
couches modestes de la population.
Cette mission reste d'actualité dans la mesure où ces livrets
demeurent l'instrument d'épargne le plus utilisé par les
ménages les plus modestes, ce non seulement parce que les revenus qu'ils
produisent sont défiscalisés, mais aussi parce qu'ils constituent
souvent le seul moyen d'obtenir une domiciliation bancaire.
Pour autant cette mission n'est reconnue par aucun texte, et le Conseil en
déduit que, "
dans ces conditions, le rôle social
attribué au livret A ne saurait en principe justifier le maintien
de restrictions de concurrence
."
Poursuivant sa réflexion, le Conseil envisage le cas où
l'Etat confirmerait, expressément, cette mission par un acte de
puissance publique
. Dans ce cas, la question serait de savoir si la mission
ainsi confirmée pourrait être réalisée dans des
conditions financièrement équilibrées en l'absence de
droits exclusifs.
Dans cette perspective, le risque est que les banques commerciales
récupèrent la clientèle la plus rentable, laissant
à La Poste et aux caisses d'épargne la clientèle disposant
de livrets de faibles montants dont le coût de gestion deviendrait vite
insupportable en l'absence de péréquation actuelle entre
"
petits
" et "
gros
" livrets.
Le Conseil n'exclut pas une telle évolution. Mais, d'une part, elle
résulterait selon lui davantage des spécificités du
réseau des caisses d'épargne et de La Poste (implantation
très dense sur l'ensemble du territoire et notamment dans les zones
rurales et les banlieues difficiles) que d'une politique commerciale
sélective menée par les banques. D'autre part et surtout,
cette mission pourrait être assurée à condition que
l'Etat reconnaisse l'existence de contraintes particulières et en assure
la compensation financière
. Le Conseil semble même esquisser
une piste, inspirée de la réalité actuelle : faire varier
le taux de commissionnement en fonction des réseaux.
On peut en déduire que cette mission d'intérêt
général ne justifierait pas les restrictions de concurrence
actuelles.
Le financement du logement social
Le Conseil constate tout d'abord que cette mission est remplie
essentiellement non par les caisses d'épargne et La Poste, mais par la
CDC et qu'il ne lui appartient pas "
dans le cadre du présent avis de
s'interroger sur la justification, au regard des règles de concurrence,
d'un tel système de financement du logement social, consistant à
accorder pour cette mission des droits exclusifs à un seul
établissement
".
Toutefois, il considère que, même si "
aucun des
établissements auxquels est réservée la distribution du
livret A ou bleu n'a été chargé par un acte de la
puissance publique d'une mission de financement du logement social",
ces
établissements "
participent à l'accomplissement de cette
mission dès lors qu'ils ont l'obligation de centraliser les fonds des
livrets A et bleu à la CDC
."
S'agissant du caractère "indispensable" de la restriction de
concurrence le Conseil conclut qu' "
aucun élément ne permet de
considérer que l'ouverture à la concurrence de ce produit serait
de nature à entraîner à court et moyen terme une baisse du
montant des encours"
et que
a priori, "le financement du
logement social
selon les modalités actuelles ne serait pas affecté par une
éventuelle banalisation du livret A",
à la condition bien
évidemment que tous les établissements distributeurs soient
soumis à l'obligation de centralisation des fonds collectés.
Le Conseil considère par ailleurs qu'il "
n'apparaît pas que le
financement du logement social ne peut pas être effectué par le
recours à d'autres moyens."
On déduit de ce qui précède que cette mission
d'intérêt général ne justifie pas les restrictions
de concurrence actuelles et que le monopole en question constitue une
restriction de concurrence injustifiée.
La collecte des dépôts des notaires en milieu rural
Bref rappel de la situation
Depuis 1972, le Crédit agricole bénéficie
du monopole des dépôts des notaires, à moins de trois mois,
installés en milieu rural
77(
*
)
. L'encours
des sommes ainsi collectées est estimé entre 15 et 18 milliards
de francs à la fin 1994. Ces dépôts sont
rémunérés au taux de 1 %.
En contrepartie de ce monopole, le Crédit agricole a mis en place,
à partir de 1990 et dans le cadre d'une convention passée avec
l'Etat, un fonds d'allégement de la charge financière des
agriculteurs (FAC). Les interventions de ce fonds sont consacrées
à des abandons de créances ou des rééchelonnements
de dettes accordés à des agriculteurs en difficulté. La
dotation annuelle du FAC s'est élevée à 500 millions de
francs jusqu'en 1994. Une nouvelle enveloppe a été
négociée en juin dernier. Le ministère de
l'économie et des finances a, en effet, donné son accord pour le
renouvellement du FAC à concurrence de 1 milliard de francs pour la
période 1997-1999. Mais 200 millions ont été
débloqués, par anticipation, en 1996 en faveur de certains
secteurs agricoles sinistrés, comme celui de la filière bovine.
Une fraction de l'enveloppe globale sera consacrée au soutien à
l'installation des jeunes agriculteurs.
Depuis sa création en 1990, le FAC a permis de réaménager
2,9 milliards de dette agricole de près 400.000 agriculteurs, tous
clients du Crédit agricole.
Selon l'AFB, en une vingtaine d'années, la gestion des encours de
dépôts des fonds des notaires en milieu rural aurait
rapporté quelque 15 milliards de francs au Crédit agricole.
Ce calcul ne peut être qu'approximatif dans la mesure ou ni les taux de
placement ni les charges liées à la gestion de ces
dépôts ne sont connus. S'agissant d'un calcul sur une longue
période, il faut en outre rappeler qu'avant 1991, le Crédit
agricole bénéficiait de cet avantage - parmi d'autres - en
contrepartie de restrictions commerciales dont il conviendrait d'évaluer
aussi le coût pour connaître le gain net dégagé.
L'analyse juridique du Conseil de la concurrence
Le Conseil a tout d'abord rappelé que cette
réglementation (décrets de 1945 et 1967 et arrêtés
des 25 août 1972 et 7 juin 1973) ont fait l'objet d'une demande
d'abrogation de la part de l'AFB et que la réponse implicite
négative a fait l'objet d'un recours - non encore jugé - devant
le Conseil d'Etat.
Le Conseil s'est ensuite interrogé sur la question de savoir si le
maintien d'un tel monopole est compatible avec le droit communautaire, ce qui
suppose que les restrictions de concurrence qu'il implique soient
indispensables à la réalisation des objectifs
d'intérêt général invoqués.
En l'occurrence l'objectif d'intérêt général
consiste, d'une part, à s'assurer que ces fonds sont entourés
d'une sécurité particulière, d'autre part qu'ils peuvent
faire l'objet de contrôles vigilants, et en outre qu'ils sont
distribués par des réseaux offrant une grande proximité
avec les offices notariaux
78(
*
)
.
Or, le Conseil considère que " sous réserve de certains aménagements de nature à assurer la garantie de ces dépôts, d'autres établissements (...) pourraient accomplir la même mission " et ce pour trois raisons :
l'efficacité des contrôles ne serait pas
atténuée en raison des formalités auxquelles ces
dépôts sont soumis et des mécanismes de caution mutuelle
qui pourraient être mis en place ;
le mécanisme AFB de garantie des dépôts assure la
sécurité du système, puisqu'il prévoit, de
façon spécifique, que les dépôts des notaires pour
le compte de leurs clients sont remboursés intégralement ;
d'autres réseaux peuvent satisfaire l'exigence de proximité.
Il s'ensuit que "
dès lors que serait mise en place une
réglementation visant à assurer
à ces fonds
particuliers, en cas de défaillance d'un établissement de
crédit,
une garantie obligatoire et illimitée
,
l'attribution de droits exclusifs
à la CDC, à La Poste et
au Crédit agricole
ne serait plus justifiée
au regard de
l'article 90 du traité de Rome.
"
LES DISTORSIONS LIÉES À LA NATURE JURIDIQUE DES INTERVENANTS
Si l'on met de côté les formes mutualistes et coopératives, dont l'existence a été unanimement jugée bénéfique par le groupe de travail, et qui participent, par leur diversité, à l'enrichissement statutaire de notre système bancaire, deux établissements posent un problème en termes de distorsions de concurrence : le réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance et celui des services financiers de La Poste.
Les Caisses d'épargne et de prévoyance
Bref rappel des arguments en présence
Aux termes de la loi de 1990, les Caisses d'épargne sont
des "é
tablissements de crédit à but non lucratif
".
Cette catégorie juridique
sui generis
traduit en
réalité assez bien la nature des Caisses d'épargne et plus
encore leur caractéristique principale qui est l'absence de
propriétaire.
Compte tenu de cette nature juridique, les Caisses d'épargne
bénéficient de deux avantages concurrentiels non
négligeables :
- l'impératif de rémunération du capital est totalement
absent ;
- il est impossible à une banque commerciale de racheter tout ou partie
des parts sociales d'une Caisse d'épargne (comme du reste une
société mutualiste ou coopérative), alors que l'inverse
n'est pas vrai
79(
*
)
.
L'analyse juridique du Conseil de la concurrence
Dans un considérant de principe le Conseil de la
Concurrence est de l'avis que si "
le bon fonctionnement de la
concurrence
sur un marché n'implique pas nécessairement que tous les
opérateurs se trouvent dans des conditions d'exploitation
identiques
,
il suppose toutefois qu'aucun opérateur ne
bénéficie pour son développement de facilités que
les autres ne pourraient obtenir et d'une ampleur telle qu'elles lui permettent
de fausser le jeu de la concurrence, sauf à ce qu'elles soient
justifiées par des considérations d'intérêt
général
".
Dans le cas particulier des
caisses d'épargne
, le Conseil
considère que le fait qu'elles n'ont ni actionnaires, ni
sociétaires et que les résultats non distribuables peuvent
être en totalité intégrés aux fonds propres
confère à ces établissements un
avantage concurrentiel
dont aucun autre établissement ne dispose. Cet avantage leur permet
notamment de s'accommoder plus facilement que les autres établissements
de pertes conjoncturelles.
Le Conseil ne dit pas si cet avantage est susceptible de fonder une action
pour abus de position dominante ou restriction de concurrence
injustifiée.
Mais il considère néanmoins que : "
cette situation
paraît difficilement compatible avec la transformation des caisses en
établissements de crédit de plein exercice, en concurrence avec
les banques sur les marchés des particuliers et des petites et moyennes
entreprises."
Les services financiers de La Poste
Bref rappel des arguments en présence
Selon les banques commerciales l'activité de La Poste
constituerait une entrave au libre exercice de la concurrence, dans la mesure
où
l'exploitant public utiliserait des moyens destinés au
service public à des fins qui lui sont étrangères
. De
ce fait, les moyens budgétaires affectés au service public
subventionneraient, de manière déloyale, une activité
concurrentielle et contribueraient à l'affaiblissement du secteur
marchand.
Les moyens en question sont d'abord des moyens en hommes et en
matériel.
De ce point de vue, il est exact qu'il n'y a pas,
contrairement à ce qui a été fait dans d'autres pays
européens (Allemagne, Hollande, Royaume-Uni), de séparation
juridique dans l'allocation des moyens de La Poste entre les activités
de service public de courrier et les activités bancaires. Or ces
dernières bénéficient non seulement du concours des
effectifs affectés aux centres de services financiers régionaux
et des conseillers financiers, mais aussi d'une partie des 70.000 agents du
réseau affectés à des postes polyvalents, sur les 17.000
implantations locales de La Poste (à comparer aux 5.600 guichets du
réseau du Crédit agricole qui est le réseau le plus vaste,
ou aux 10.500 guichets que possèdent, ensemble, toutes les banques AFB).
On relèvera à cet égard que, selon M. André
Darrigrand, Président de La Poste (voir audition annexée),
l'activité guichet d'environ 8.000 petits bureaux de campagne
était tributaire à 70 % du livret A.
L'utilisation de la "force de vente" des préposés, qui
s'assimile dans certains cas, à du porte-à-porte quotidien
auprès de la clientèle, peut conduire cette dernière
à faire un amalgame entre les missions de service public et les services
financiers de La Poste.
Mais il pourrait aussi s'agir de moyens financiers, par le biais de
transferts occultes entre le prix du service public (le "
prix du
timbre
") et les activités marchandes
.
La Poste considère au contraire que ce sont les activités
financières qui subventionnent les activités de service public et
non l'inverse. Selon son président, les services financiers
apporteraient 25 % des recettes de La Poste et assurent 58 % du chiffre
d'affaires des bureaux de poste. 20 % seulement du chiffre d'affaires de
l'activité courrier est générée par les bureaux de
poste, alors que 87 % du chiffre d'affaires des services financiers passe par
les bureaux.
Ce serait donc l'activité financière qui permettrait à La
Poste de maintenir sa présence dans les communes rurales de moins de
2.000 habitants et dans les zones urbaines difficiles, contribuant ainsi
à l'aménagement du territoire.
On remarquera que les services financiers de La Poste, étant exclus du
champ d'application de la loi bancaire, ne sont pas soumis aux mêmes
obligations réglementaires ni aux mêmes contrôles que les
établissements de crédit avec qui ils sont en concurrence. Ils
n'ont, en outre, pas d'exigence en termes de fonds propres. Toutefois, selon le
président de La Poste, cette non application des ratios prudentiels se
traduirait, contrairement aux idées reçues, par une perte nette
d'environ un milliard de francs.
L'activité de collecte des dépôts est importante (sa part
de marché était de 10 % environ à la fin de 1994, avec un
encours collecté de 833 milliards de francs).
L'activité de distribution de crédit est jusqu'à
présent limitée. La Poste ne peut en effet octroyer que des
prêts épargne-logement, complémentaires et
conventionnés et consentir des découverts à titre
temporaire. Sa part sur le marché des crédits immobiliers demeure
inférieure à 1 %.
Toutefois, La Poste affiche pour l'avenir des objectifs ambitieux et certaines
de ses campagnes publicitaires sont de nature à générer
des confusions dans l'esprit du public. A cet égard, on relèvera
qu'un récent jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date
du 27 mars 1996 a condamné La Poste pour une campagne publicitaire
suggérant qu'elle pouvait octroyer des prêts immobiliers
classiques.
L'analyse juridique du Conseil de la concurrence
L'appréciation de la situation actuelle est rendue
difficile du fait du partage du réseau actuel entre des activités
de service public exercées en monopole et des activités
concurrentielles. Or, pour que cette situation n'entraîne pas de
distorsion de concurrence,
il est nécessaire, selon le Conseil, que
les activités en concurrence ne puissent pas bénéficier
des conditions propres à l'exercice de la mission de service public
confiée à La Poste
.
Or pour établir la preuve que tel n'est pas le cas
il faudrait que
soient connues les comptabilités analytiques de l'opérateur
public
et de ses concurrents et que la comptabilité du premier soit
éventuellement retraitée
de manière à ce que les
moyens mobilisés pour l'activité concurrencée soient
identifiés précisément et comptabilisés à
leur coût réel.
Toutefois le Conseil a considéré que : "
quelles que soient
les améliorations qui pourraient être apportées au
système de comptabilité analytique de La Poste, cela ne suffirait
pas dans tous les cas à permettre la mise en oeuvre d'un contrôle
effectif du respect des règles de la concurrence et qu'une
séparation plus claire des activités sous monopole et des
activités ouvertes à la concurrence, de nature comptable,
financière, organisationnelle, voire juridique par voie de
filialisation, serait propre à permettre un meilleur exercice de ce
contrôle
".
Ce raisonnement, transposé à l'ensemble des réseaux
publics exerçant concomitamment des activités de service public
et concurrentielles, imposerait donc la filialisation, comme préalable
au respect des règles de la concurrence.
LES DISTORSIONS LIÉES À DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES
On peut relever deux domaines principaux dans lesquels l'application sélective de mesures législatives ou réglementaires se traduit par des distorsions de concurrence entre établissements exerçant les mêmes activités.
La fiscalité
Rappel des spécificités bancaires
Non seulement la fiscalité bancaire handicape les banques
françaises par rapport à leurs compétiteurs
internationaux, mais encore, frappant de façon sélective les
établissements, elle introduit des distorsions de concurrence au sein
même du secteur.
Ainsi, convient-il d'observer que La Poste bénéficie d'un
régime privilégié d'assujettissement à la
taxe
professionnelle et à la taxe foncière
puisqu'elle
bénéficie d'un abattement de 85 % du montant de l'impôt
normalement dû.
La Caisse des dépôts et consignations et les caisses de
crédit municipal
80(
*
)
ne sont pas
assujetties à
l'impôt sur les sociétés
.
La Banque de France, le Trésor public et La Poste sont
exonérés de la
contribution sur les institutions
financières
81(
*
)
.
La Poste a bénéficié jusqu'en 1994 du plafonnement
à 4,25 % du taux de la taxe sur les salaires.
La Poste, la Banque de France, les Caisses d'épargne, les caisses de
crédit municipal, les Banques populaires, le Crédit mutuel, les
Caisses régionales de Crédit agricole et la Caisse des
dépôts et consignations étaient jusqu'en 1995,
exonérés de
la contribution sociale de solidarité sur
les sociétés de capitaux
(0,13 % du chiffre d'affaires)
instituée par la loi du 3 janvier 1970.
En outre,
la fiscalité de certains produits d'épargne
conduit à pénaliser les réseaux bancaires.
Au-delà du cas du livret A et du livret bleu, on observera que les
revenus tirés des comptes à terme, des bons de caisse et des
livrets bancaires ont été soumis pendant longtemps à une
fiscalité très importante (39,4 % en tenant compte des
prélèvements sociaux) qui explique, au moins en partie, le faible
développement de ces comptes en France, par comparaison avec
l'étranger. La loi de finances pour 1994 a ramené cette
imposition à un niveau plus raisonnable (19,4 %
prélèvements sociaux compris) et surtout a fait
bénéficier ces revenus des mêmes abattements que les
intérêts des obligations et des actions (8.000/16.000 F), à
l'exception des livrets bancaires. Toutefois, la loi de finances pour 1995 en
supprimant cet abattement pour les obligations et produits assimilés
(dont les comptes à terme et les bons de caisse) a reposé le
problème de la concurrence fiscale de ces produits par rapport aux
livrets défiscalisés.
L'analyse juridique du Conseil de la concurrence
Le Conseil a considéré que, désormais, seul le régime fiscal appliqué à La Poste faisait l'objet d'aménagements particuliers et méritait une analyse en termes de distorsions de concurrence.
Ainsi, La Poste n'acquitte pas la contribution annuelle des
institutions financières et bénéficie d'allégements
de fiscalité locale (abattement de 85 % sur les bases d'imposition de la
taxe foncière et de la TP) destinés à compenser les
contraintes de desserte du territoire national. Ces aménagements
représentaient en 1994 1,19 milliard de francs.
Le Conseil a rappelé que, dans une décision du 8 février
1995, la Commission de Bruxelles avait considéré que le
régime fiscal ainsi institué n'était pas constitutif d'une
aide de l'Etat aux activités financières concurrentielles de La
Poste dans la mesure où l'avantage procuré par l'abattement
fiscal n'était pas supérieur aux charges entraînées
par les contraintes de desserte et d'aménagement du territoire
chiffrées par elle à un montant compris entre
1,32 Milliards de F et 1,82 Milliards de F selon que l'on y inclut ou
non les banlieues difficiles.
Le Conseil s'abstient donc de formuler un avis sur ce point
rappelant
simplement que cette décision a fait l'objet d'un recours devant le
tribunal de première instance des Communautés européennes
et que, en application de l'article 21 de la loi du 2 juillet 1990, le
Gouvernement devra déposer avant le 31 décembre 1996 un rapport
au Parlement sur les charges supportées par l'exploitant en
matière d'aménagement du territoire.
Il semble toutefois intéressant de noter que les contraintes d'aménagement du territoire imposées à La Poste sont en quelque sorte " payées " deux fois : une première fois par la fiscalité, une deuxième fois par l'autorisation d'effectuer des activités financières concurrentielles.
Le droit du travail
Bref rappel
Force est de constater que le décret du 31 mars 1937 qui
impose, comme on l'a vu, des contraintes en ce qui concerne l'heure d'ouverture
des guichets et limite à cinq le nombre de jours ouverts par semaine, ne
s'applique ni aux banques coopératives et mutualistes, ni aux Caisses
d'épargne, ni à La Poste, ni même aux institutions
financières spécialisées (Crédit Local de France,
Comptoir des entrepreneurs, CEPME...).
Or, on ne peut nier que, commercialement, ces contraintes soient
pénalisantes dans une période où l'extension des plages
d'ouverture des commerces, et des guichets bancaires en particulier, sont
souhaitées par le consommateur.
L'analyse juridique du Conseil de la concurrence
Le Conseil a réaffirmé la position exprimée
dans son avis du 25 juin 1996 relatif à La Poste selon lequel
les
établissements qui ne sont pas soumis à la réglementation
du décret du 31 mars 1937
et qui peuvent notamment ouvrir leurs
guichets le samedi,
bénéficient d'un avantage
concurrentiel
, ce qui est le cas de La Poste, du Crédit agricole et
des caisses d'épargne,
mais qui n'est pas constitutif en
lui-même d'une pratique prohibée par le droit de la
concurrence.
Le Conseil considère néanmoins que :"
depuis que les
activités des services financiers de La Poste, des caisses
d'épargne et du Crédit agricole ont évolué dans la
voie de la banalisation et que ces réseaux exercent tout ou partie de
leurs activités sur les mêmes marchés que les banques,
une harmonisation des réglementations concernant le temps de travail
serait de nature à améliorer les conditions d'exercice de la
concurrence entre les différents établissements.
"
Cette harmonisation pourrait être obtenue soit par l'abrogation du
décret de 1937 soit par l'application de ses dispositions permettant des
négociations contractuelles, à l'instar de celle qui s'est
conclue au Crédit Lyonnais.
*
Les distorsions de concurrence n'expliquent donc pas
l'affaiblissement du secteur bancaire, pris dans son ensemble.
Pour autant, elles sont réelles et l'on peut comprendre qu'elles soient
de plus en plus contestées par les établissements qui n'en
bénéficient pas à mesure que la compétition
nationale, et internationale, s'avive.
Mais la portée de cette contestation dépasse de très loin
l'aspect sectoriel.
En nous plaçant, comme nous devons le faire, du seul point de vue de
l'intérêt général, force est de constater que les
distorsions de concurrence entraînent une allocation des resssources au
détriment du secteur le plus exposé à la concurrence
internationale et modifient, lentement mais sûrement, la physionomie de
notre secteur bancaire.
Il importe de prendre conscience de cette évolution et de ses
conséquences quant à la capacité de notre système
bancaire à se projeter à l'extérieur et à
accompagner le développement de nos entreprises, en France comme
à l'étranger.
* *
*
CHAPITRE III
METTRE NOTRE SYSTÈME BANCAIRE
EN SITUATION D'AFFRONTER LA CONCURRENCE INTERNATIONALE
Plus encore que le marché unique, la monnaie unique
contraindra rapidement notre pays à adopter une législation et
une réglementation permettant à notre secteur bancaire
d'affronter dans de bonnes conditions la concurrence européenne et
mondiale. Face aux règles internationales, certaines
spécificités françaises, qui handicapent nos banques sans
générer d'avantage véritable pour la clientèle,
devront être réexaminées.
Il est urgent de le faire, dans la sérénité, pour ne pas
avoir à se précipiter, comme ce fut le cas, pour partie, à
la veille de l'ouverture du marché unique des capitaux le
1
er
janvier 1990
82(
*
)
.
Le groupe de travail a défini trois axes de réforme : mettre
fin aux rigidités normatives touchant l'ensemble du secteur ; harmoniser
les conditions d'exercice du métier bancaire ; modifier en profondeur la
politique bancaire de l'Etat.
METTRE FIN AUX BLOCAGES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
AUTORISER LA RÉMUNÉRATION DES DÉPÔTS À VUE ET LA TARIFICATION DE L'ENSEMBLE DES SERVICES BANCAIRES
L'interdiction de rémunérer les
dépôts à vue, et corrélativement celle de tarifer
les mises à disposition de chéquiers sont deux anomalies à
corriger rapidement.
Cette situation est d'autant plus étonnante qu'elle est
résiduelle, puisque la quasi-totalité des services bancaires peut
être tarifée. Aussi, malgré son aspect symbolique assez
fort, il ne faut pas surestimer l'impact d'une telle mesure sur les
consommateurs, qui profiteraient
in fine
d'une gestion plus saine des
moyens de paiement et des dépôts à vue. La concurrence
permettra en effet aux clients de continuer à bénéficier
d'un service exceptionnellement peu coûteux, par rapport aux pays
étrangers.
Autoriser la tarification des chèquiers
L'interdiction de tarifer la délivrance des
chéquiers, qui résulte du décret-loi de 1935, accorde
à ce moyen de paiement plus coûteux que les autres (la monnaie
fiduciaire ou les cartes de crédit notamment) une prime d'utilisation
injustifiée
83(
*
)
. Pour l'usager,
l'utilisation du chèque n'est en effet pas plus commode que celle de la
carte bancaire ou du virement télématique.
La
possibilité de pouvoir tarifer le chèque à son juste prix
réduira son utilisation au profit d'autres moyens de paiement, et en
réduisant les charges des banques leur permettra de continuer à
offrir à leur clientèle des services globalement peu
onéreux.
Au demeurant, rien n'indique que les établissements profiteront
très vite et pleinement de cette possibilité. Il leur est ainsi
permis de facturer des frais de tenue de compte courant, ce qui peut pallier
l'interdiction de tarification du chèque. Ainsi, la banque Barclays
facture un prix fixe de 350 francs par trimestre aux titulaires de compte
dont l'encours est en moyenne inférieur à 15.000 francs, et
la Poste prélève une commission symbolique de 9 francs par
an, y compris sur les comptes les plus modestes. Mais la plupart des
établissements renoncent à cette possibilité pour des
raisons de concurrence.
L'objet de cette proposition est donc de conduire les banques à
moduler leur gamme de tarifs de façon conforme à la
réalité des coûts
, et non du fait d'une
réglementation qui contraint artificiellement à la
gratuité de services coûteux alors que des services pesant moins
sur les comptes d'exploitation sont tarifés à un niveau
élevé
84(
*
)
.
Autoriser la rémunération des dépôts à vue
Corrélativement, l'interdiction de
rémunérer les dépôts à vue devra être
supprimée.
Il est souvent objecté, par les organisations de consommateurs
notamment, que la rémunération des dépôts ne
compensera pas la tarification du chèque pour les titulaires de petits
comptes. Mais la réalité est aujourd'hui inverse pour les
titulaires de gros comptes qui peuvent faire rémunérer leurs
liquidités en attente d'emploi sans pour autant voir leurs
chèques être facturés. En effet, le règlement 92-09
du 15 octobre 1992 du comité de la réglementation bancaire
autorise les banques à signer avec leurs clients des conventions aux
termes desquelles un prélèvement permanent peut être
opéré sur leur compte à vue au profit d'un placement
rémunéré (compte à terme, livret d'épargne,
OPCVM monétaires...). Ceci autorise les diverses formules de
prélèvement ou d'écrémage existant sur le
marché
85(
*
)
. En réalité,
ce système permet la rémunération des
disponibilités des comptes à vue, créditeurs en permanence
d'une somme relativement élevée (plus de 15.000 francs en
général), ce dont les titulaires de petits comptes ne peuvent
bénéficier.
Il n'est donc pas établi que la tarification des chèques en
contrepartie de la rémunération des dépôts à
vue soit plus défavorable aux petits qu'aux gros comptes. Elle sera
surtout défavorable aux gros émetteurs de chèques, que ne
sont pas en général les titulaires de petits comptes. Ceux-ci
bénéficieront en revanche d'une rémunération de
leurs disponibilités à laquelle ils ne peuvent avoir accès
aujourd'hui.
Une fois ces deux interdictions levées, il appartiendra aux
établissements teneurs de comptes de dépôts de
définir la tarification adaptée. Il est improbable que celle-ci
soit d'emblée massive comme chez nos partenaires, puisque les services
tarifés aujourd'hui librement ne le sont que faiblement.
Prévoir des mesures d'accompagnement en faveur des consommateurs
Trois mesures de tempérament peuvent être
prévues en faveur des consommateurs.
La première consisterait à interdire explicitement
l'utilisation des dates de valeur à des fins de
rémunération des mouvements de fonds.
Dès lors que
tous ces mouvement peuvent être tarifés, cette utilisation n'aura
plus lieu d'être.
La deuxième aurait pour but de préserver les clients
modestes. Pour éviter de léser les petits comptes, il est
possible d'imaginer que la tarification des chèques n'intervienne
qu'au-delà d'un certain nombre de chèques émis
. La
concurrence, plus que la réglementation, devrait y pourvoir.
La troisième mesure serait inspirée du même souci de
justice sociale. Il s'agirait de faire en sorte
que les
différents frais de tenue de compte et d'émissions de
chèques puissent s'imputer fiscalement sur la rémunération
du compte courant
, de la même façon que les droits de garde
sur valeurs mobilières viennent en déduction des revenus
générés par celles-ci. Compte tenu de la
progressivité de l'impôt sur le revenu, les titulaires de gros
comptes fortement rémunérés seraient relativement moins
bien traités que les titulaires de petits comptes.
En tout état de cause, le statu quo actuel ne paraît pas tenable
à l'horizon 2002, lorsque l'ensemble des moyens de paiement aura
été converti en euros. D'ores et déjà, la libre
prestation de services permet à des banques européennes n'ayant
pas leur siège en France d'intervenir sur notre sol et de faire de la
publicité sur ce point. Mais ce sera encore plus facile pour les banques
de nos partenaires participant à la monnaie unique, qui pourront sans
entrave offrir des services comparables à ceux des banques
françaises, et il ne sera pas possible de leur interdire la
rémunération des dépôts et la tarification des
chèques.
Clarifier le coût des missions de service public attachées à la tenue des comptes
Les établissements teneurs de compte assument des
missions d'intérêt général attachées à
cette fonction : ils remplissent des déclarations fiscales à
l'intention de leurs clients et des services fiscaux, ils pratiquent
eux-mêmes certains prélèvements, ils peuvent être
obligés d'ouvrir un compte en raison du droit au compte reconnu par la
loi, ils doivent informer les services financiers des mouvements de fonds
suspects...
Il conviendrait de s'interroger sur le coût de ces obligations
administratives afin de faire la transparence sur la manière dont il est
répercuté.
Cela permettrait, à tout le moins, aux
autorités publiques d'affiner les obligations pesant sur les
établissement en fonction de ce coût.
ABROGER LE DÉCRET DU 31 MARS 1937
Pris en application de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures, le décret du 31 mars 1937 86( * ) fixe des normes contraignantes d'aménagement du temps de travail dans les établissements de crédit.
Un décret défavorable à l'emploi et qu'il est exclu d'étendre aux établissements non assujettis
Le décret de 1937 est trop rigide par lui-même, et
présente en outre le défaut de ne pas s'appliquer de façon
homogène à tous les établissements exerçant le
métier de banque, soit explicitement pour les Caisses d'épargne
(son article 2 prévoit pour elles des modalités
particulières de répartition du temps de travail), soit
implicitement pour le Crédit agricole et la Poste (le premier
relève des articles 922 et suivants du code rural, la seconde, dont le
personnel demeure fonctionnaire à plus de 80 %, du code des postes et
télécommunications).
Une des pistes envisageables aurait été l'extension du
décret de 1937 aux entreprises qui en sont aujourd'hui exclues
, bien
qu'elles pratiquent le même métier que les autres banques. Le
groupe de travail a écarté cette hypothèse pour deux
raisons : d'une part, les personnels de la Poste, du Crédit
agricole ou des Caisses d'épargne ne réclament pas leur
assujettissement au décret de 1937, et, d'autre part, ce dernier se
révèle nuisible à une bonne rentabilité des
réseaux.
Si le décret de 1937 représentait pour les salariés une
protection indispensable, il est probable que ceux des réseaux qui ne
lui sont pas soumis en réclameraient l'application. Or il semble que les
salariés de ces réseaux restent attachés à leur
propre organisation du travail.
Celle-ci est en effet plus adaptée que celle des banques soumises au
décret de 1937 qui ne permet pas un fonctionnement des guichets
bancaires conforme aux besoins du marché. Il nuit à leur
rentabilité et fait donc peser un risque sur l'emploi dans ces guichets.
L'inconvénient d'horaires étriqués est que les
réseaux d'agences ne peuvent pas servir les clients suffisamment
longtemps pour être rentables
. En conséquence, les banques
placées dans cette situation s'efforcent de réduire le nombre de
leurs guichets.
Une autre organisation du travail permettrait, à temps de travail
inchangé pour chaque salarié, une ouverture des guichets six
jours sur sept sur des plages quotidiennes plus grandes. L'exemple des Caisses
d'épargne ou du Crédit agricole, où la négociation
collective préside à cette organisation, montre que cette
solution est possible sans léser les salariés.
Un décret qu'il vaut mieux abroger que modifier
Les représentants des organisations syndicales
auditionnées par le groupe de travail ont en général
marqué leur attachement au décret de 1937, tout en se
déclarant favorables à une renégociation de son contenu.
Ils souhaitent que l'aménagement du temps de travail soit
compensé par une réduction de sa durée et par des
engagements en matière d'emplois.
Le groupe de travail préfère, quant à lui, une
abrogation pure et simple du décret et son remplacement par une
contractualisation négociée entre tous
les partenaires
.
Certes, le décret de 1937 prévoit des possibilités de
déroger à certaines de ses dispositions, notamment l'interdiction
du travail par relais ou roulement et le choix du samedi ou du lundi comme
second jour de repos. Ces dérogations doivent résulter d'accords
entre les partenaires sociaux.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, de nombreux accords de ce
type ont été signés récemment : à la BRED,
au CIC (ouverture six jours sur sept), à la Compagnie bancaire (et
à la Banque directe, sa filiale) et au Crédit Lyonnais.
Ces accords montrent qu'il est possible de déroger aux dispositions
les plus pénalisantes du décret de 1937, mais la procédure
reste lourde et inadaptée
:
·
pour la dérogation au repos du samedi ou du lundi, un
arrêté du préfet est nécessaire ;
·
pour la dérogation à l'interdiction du travail
par roulement ou par relais, un arrêté ministériel est
requis.
L'intervention de l'autorité administrative sous forme de
contrôle préalable n'a plus aucune justification. Dans ces
conditions, il est aussi simple d'abroger complètement le décret.
Il sera alors remplacé par une ou plusieurs conventions,
l'administration du travail contrôlant leur contenu et leur application
dans les conditions de droit commun.
Cette abrogation aura en outre l'avantage de contraindre les partenaires
sociaux, au sein de l'AFECEI, à aboutir sur les différents sujets
régis par le décret de 1937
87(
*
)
.
RÉDUIRE LES COÛTS DE LA LÉGISLATION CONSUMÉRISTE
La forte protection des débiteurs, qui est propre
à la France, majore le risque de crédit des banques et, en cette
période de forte concurrence, réduit leur marge
d'intermédiation. Elle tend à se retourner contre ses objectifs :
les postulants à l'emprunt présentant par ailleurs d'autres
risques peuvent se voir écartés de l'accès au
crédit, faute pour les établissements de pouvoir maîtriser
les coûts engendrés par les lois de protection des consommateurs.
Notre législation consumériste devra évoluer sous la
pression de la concurrence européenne: du fait de l'existence d'un
marché bancaire unique et de l'avènement prochain de l'Euro. Pour
l'essentiel, la négociation au sein des instances communautaires y
pourvoira.
A cet égard, il ne faut pas fermer la porte à la
possibilité, pour nos négociateurs, d'obtenir de nos partenaires
des avancées dans le sens de notre droit actuel.
Cependant, le
groupe de travail a jugé qu'un problème urgent devait être
traité plus rapidement en raison de son coût élevé
pour le système bancaire: celui des remboursements d'emprunt par
anticipation.
Une convergence des législations consuméristes se produira du fait de l'intégration européenne
Dans son rapport de mai 1995 sur l'application de la
deuxième directive bancaire créant le marché unique des
services bancaires, la Commission de l'Union européenne relève
que la protection des consommateurs de services bancaires est plus forte en
France que dans le reste de l'Union
88(
*
)
. Cette
protection est considérée par la France comme relevant de
l'intérêt général, ce qui lui permet, en application
de l'article 15 de la directive, de faire obstacle à la vente de
services par les banques européennes qui ne se conformeraient pas
à cette protection.
Cependant, la Commission rappelle dans son projet de communication du
4 novembre 1995 que la Cour de justice
89(
*
)
de Luxembourg considère que cet obstacle doit
être :
- d'intérêt général,
- non discriminatoire,
- objectivement nécessaire,
- proportionné à l'objectif poursuivi.
En effet, il faut reconnaître que l'obligation faite à des
banquiers anglais de se conformer à notre législation
consumériste, alors que celle-ci est restreinte dans leur État
d'origine, revient à les empêcher de distribuer des contrats sur
notre territoire.
Lors de l'entrée en vigueur de l'Euro, il deviendra très
difficile à la France d'exciper de l'intérêt
général pour maintenir des règles qui n'y répondent
pas de façon irréfutable
. Il sera aisé pour les
établissements des Etats participant à la monnaie unique de venir
concurrencer nos banques sur des critères autres que la protection des
consommateurs, notamment par des coûts de crédit moins
élevés.
Dans ces conditions, la législation et la réglementation
françaises devront évoluer naturellement.
Mais il est possible
aussi que la législation de nos partenaires évolue
. Beaucoup
d'éléments de notre appareil normatif peuvent paraître
protéger excessivement les consommateurs (la législation sur le
surendettement, le droit des offres de crédit notamment). Mais on peut
les juger efficaces quant à leurs objectifs (les consommateurs sont bien
protégés) et d'un coût non prohibitif pour les
établissements. Aussi faut-il permettre au gouvernement français
de défendre nos positions actuelles. Par la suite, l'ensemble devra
converger de manière à ce que la concurrence ne se fasse pas par
des différences normatives.
Aussi le groupe de travail n'a-t-il pas jugé nécessaire de
proposer à ce stade une réforme d'ensemble de notre
législation consumériste
. Il vaut mieux laisser se
développer la confrontation européenne, qui provoquera les
ajustements nécessaires en France, mais aussi dans le reste de l'Union.
Le problème plus urgent des remboursements anticipés
Malgré ce raisonnement de principe, le groupe de
travail s'est interrogé sur le problème des remboursements
anticipés
.
Les règles relatives au remboursement anticipé, créent
une asymétrie moins justifiée que le reste du droit de la
consommation entre les banques et leurs clients.
Il ne s'agit pas de
remettre en cause le principe du droit au remboursement anticipé, qui
est reconnu par une directive européenne
90(
*
)
.
Il s'agit en revanche de s'interroger sur
les modalités retenues par la France qui sont
particulièrement pénalisantes pour les établissements de
crédit.
Deux solutions peuvent être préconisées pour
résoudre cette difficulté :
·
permettre aux banques de provisionner, dès
l'octroi du crédit, les risques tenant au remboursement anticipé
et éventuellement aux autres protections des débiteurs
;
·
modifier le mode de calcul de l'indemnité de
remboursement anticipé.
Des débats ont eu lieu au sein du
comité consultatif du Conseil national du crédit à ce
sujet en 1995, qui ont abouti à un constat sans solution, faute d'accord
entre les représentants des établissements et ceux des
consommateurs
91(
*
)
. Les pouvoirs publics
pourraient trancher ce débat en proposant une indemnité
calculée actuariellement de façon à faire partager plus
équitablement la charge du remboursement anticipé entre les
établissements et les clients. Il ne s'agirait pas nécessairement
d'une indemnité actuariellement neutre, mais son calcul consisterait
à permettre un partage équitable de la baisse des taux entre la
banque et le client, ce qui supprimerait la " loterie " liée
aux variations d'amplitude des baisses de taux.
Cette solution ne vaudrait
que pour les remboursements de pure opportunité.
Les
remboursements contraints par une cause exogène
(vente du bien,
chômage, divorce, maladie, etc...)
pourraient au contraire
bénéficier de la suppression de toute indemnité
. Cette
solution présenterait en outre l'avantage de
favoriser la
diffusion des prêts à taux variable
:
il n'est en effet pas
sain que les banques comme les emprunteurs se mettent systématiquement
en position de risque de taux.
MODERNISER LA FISCALITÉ BANCAIRE
Deux contributions particulières pèsent lourdement
sur la rentabilité de notre secteur bancaire : la taxe sur les salaires
et la contribution sur les institutions financières.
Ces contributions ont trois défauts : elles pèsent sur l'emploi
et non sur la richesse produite, elles pénalisent les banques par
rapport aux autres secteurs de l'économie, et elles les affaiblissent
par rapport aux marchés financiers ou aux établissements
étrangers qui n'acquittent pas ce type d'impôt.
Réformer la taxe sur les salaires
Les propositions de votre groupe de travail pourraient
permettre
une augmentation de la part des commissions, assujetties à la TVA, dans
le produit net bancaire. En réduisant les rémanences de TVA,
cette augmentation est de nature à atténuer le problème de
la taxe sur les salaires. Mais cela ne suffit pas.
Le seul argument militant encore aujourd'hui en faveur de la taxe sur les
salaires est son produit élevé pour le budget de l'Etat (46
milliards de francs). C'est pourquoi
sa suppression
-qui ne concernerait
pas seulement les banques-
doit se faire sous réserve du respect de
la contrainte de l'équilibre des finances publiques.
A cet égard, au moins deux solutions peuvent peuvent être
envisagées :
-
prévoir une suppression progressive et programmée
sur cinq ou dix ans ;
-
remplacer la taxe sur les salaires par une fiscalité
substitutive, qui ne pénalise pas l'emploi.
Ces solutions devraient faire l'objet d'un examen approfondi, notamment en ce
qui concerne leurs conséquences sur le coût du crédit. Il
convient en tout état de cause d'agir pour réduire les effets
nocifs de cette taxe sur l'emploi.
Supprimer la contribution des institutions financières
Outre les inconvénients précédemment
cités au sujet de la taxe sur les salaires, la contribution des
institutions financières présente celui de ne pas être
applicable à la Poste.
Cette taxe doit être supprimée
. Lorsqu'elle avait
été créée en 1982, elle devait être
exceptionnelle. La caractéristique principale des
prélèvements exceptionnels en France est d'être
pérennisés, ce qui nuit à la crédibilité des
décisions fiscales.
Afin d'éviter de nuire à l'équilibre des finances
publiques (cette taxe rapporte 2,6 milliards de francs à l'Etat) cette
suppression peut se réaliser en trois étapes :
- autoriser sa déduction du bénéfice imposable,
- supprimer la partie de l'assiette constituée par les salaires,
- enfin la supprimer totalement.
*
HARMONISER LES CONDITIONS D'EXERCICE DU METIER BANCAIRE
Le groupe de travail considère qu'une allocation
optimale des ressources dans le système bancaire et de crédit en
France nécessite une homogénéisation des conditions
d'exercice du métier. Cette position, fondée sur un raisonnement
recherchant l'optimum économique, est corroborée en droit par
l'avis du Conseil de la Concurrence annexé au présent rapport.
Elle n'implique pas l'abolition des différentes sensibilités et
cultures d'entreprise existant au sein du monde financier.
Cette harmonisation doit se faire en prenant les précautions
nécessaires pour ouvrir enfin
l'ère des banalisations
réussies
.
GENERALISER LA DISTRIBUTION DES LIVRETS DÉFISCALISÉS
La quasi totalité des livrets d'épargne réglementée est aujourd'hui distribuée universellement.
L'oligopole maintenu pour deux d'entre eux n'a plus
aujourd'hui de véritable justification. Sa suppression doit
s'accompagner de précautions et d'une réflexion sur le rôle
de ses actuels détenteurs.
Le livret A et le livret bleu sont aujourd'hui des produits quasiment jumeaux:
mêmes conditions d'ouverture, même plafond, même taux
d'intérêt, même fonctionnement pour l'épargnant,
même (absence de) fiscalité. Seule l'affectation des ressources
diffère encore, mais très provisoirement: en mars 1991, la
décision a été prise d'affecter intégralement le
livret bleu au financement du logement social
92(
*
)
, par tranches cumulées de 10 % par an jusqu'en
l'an 2.000. Le livret bleu est actuellement à mi-parcours de ce
processus.
Sous cette réserve de calendrier, la problématique des deux
livrets est la même.
Distorsion de concurrence véritable,
l'oligopole de distribution de ces deux livrets peut être supprimé
en levant les obstacles qui justifient encore son maintien.
Le groupe de travail a ainsi retenu une méthode comportant
quatre
principes
:
· la banalisation doit être directe et
complète ;
· elle doit se faire à échéance fixée, de
façon à permettre aux acteurs de s'y préparer ;
· elle doit se réaliser en tenant compte des objectifs sociaux des
livrets défiscalisés ;
· elle doit s'accompagner d'une affectation solide au financement du
logement social.
Une généralisation de la distribution directe et complète
Une des voies alternatives à la banalisation des
derniers livrets faisant l'objet d'un monopole réside dans la
création de produits qui leur sont partiellement substituables, et
distribués par l'ensemble des réseaux bancaires
. Cette
technique est apparemment la plus commode à mettre en oeuvre, et elle a
été utilisée avec un certain succès quant aux
produits ainsi créés (le Codevi, le livret d'épargne
populaire, le livret jeune)
93(
*
)
, qui
connaissent aujourd'hui des encours importants.
Cependant, les expériences passées montrent que ce type de
mesure, s'il a l'avantage stratégique du compromis, présente des
imperfections qui lui font manquer l'objectif recherché
.
Ainsi, la création du Codevi n'a pas répondu à la
requête des établissements qui ne distribuent pas le livret A. Son
plafond est inférieur, le nombre de livrets par famille plus
réduit. Les augmentations successives du plafond n'ont pas permis
à ses distributeurs de concurrencer le livret A. Ils n'auraient pu
s'approcher de cet objectif que si sa distribution avait été
limitée aux établissements exclus du livret A et du livret bleu,
ce qui n'a pas été le cas.
De plus, contrairement au livret A, il n'a pas montré une grande
capacité à remplir sa mission d'intérêt
général, à savoir le financement des PME
94(
*
)
.
Son taux de centralisation auprès de la
Caisse des dépôts et consignations n'a cessé de baisser
pour les banques commerciales, le Crédit agricole et le Crédit
mutuel. A tel point qu'aujourd'hui son exemple est brandi comme un repoussoir
à une distribution universelle du livret A, par crainte que ce dernier
ne soit conduit à suivre les mêmes errements.
La création en 1982, puis l'extension du livret d'épargne
populaire, et la création du livret jeune en 1996 ont
révélé des défauts différents, mais tout
aussi significatifs.
L'apparition de ces livrets a d'abord constitué un frein à la
baisse des taux d'intérêt à court terme, une fraction
importante (178,4 milliards de francs au 31 août 1996) de
l'épargne à vue étant désormais placée
à un taux sensiblement supérieur à celui du livret A. Il
n'est d'ailleurs pas possible de financer des activités
d'intérêt général tel que le logement social par une
ressource aussi onéreuse compte tenu du coût de la collecte
95(
*
)
. Surtout, le fait que ces livrets soient
banalisés n'affecte que marginalement les conditions de la concurrence :
l'essentiel des transferts s'opère entre le livret A et le livret
bleu d'une part, et le livret jeune et le LEP d'autre part au sein des
réseaux distributeurs des premiers, et non entre les différents
réseaux
96(
*
)
. Taux
d'intérêt plus élevés, financement du logement
social remis en cause et conditions de concurrence à peine
modifiées : tel est le maigre bilan de ces livrets
97(
*
)
.
Pour les mêmes raisons, le groupe de travail a repoussé des
solutions dérivées de celles-ci, telles que l'augmentation du
plafond du Codevi
. En effet, ou bien le Codevi reste différent du
livret A, et il ne remplira pas les missions que celui-ci serait amené
à abandonner; ou bien il en devient le clone, et il s'agirait d'une
banalisation hypocrite, refusant de dire son nom, et à laquelle les
réseaux distributeurs du livret A pourraient ne pas pouvoir faire face.
Le groupe de travail privilégie donc une voie plus directe : la
distribution universelle des livrets défiscalisés.
Toutefois,
rien ne s'oppose à ce que les noms de ces livrets diffèrent en
fonction des réseaux distributeurs. On peut concevoir que "
livret
A
" et "
livret bleu
" restent des appellations
réservées. En effet, ces appellations sont commerciales, le droit
ne connaissant d'une part que le "premier livret des caisses
d'épargne",
d'autre part, que les "comptes spéciaux sur livret" du Crédit
mutuel. L'important est la possibilité pour tous de distribuer un
produit identique, seule de nature à supprimer l'anomalie
concurrentielle. Mais avec des précautions.
Définir une échéance
La première précaution à prendre pour
éviter l'échec de la banalisation est de définir une
échéance
.
Le groupe de travail a retenu
un délai de cinq ans,
qui
présente deux avantages :
- d'une part, il laisse à la Poste, aux Caisses d'épargne et au
Crédit mutuel le temps de réaliser les adaptations
stratégiques nécessaires
98(
*
)
.
Celles-ci seront facilitées par le maintien probable de la tendance au
déclin de la place des deux livrets administrés dans
l'épargne des ménages;
- d'autre part, il coïncide à peu près avec
l'échéance de l'affectation totale du livret bleu au logement
social.
Prévoir un commissionnement différencié
Un des effets induits par la banalisation des livrets A et
bleu pourrait être le recentrage des clientèles
"
naturelles"
des différents réseaux. Ainsi, la Poste, les
Caisses d'épargne et à un moindre degré le Crédit
mutuel pourraient être amenés à concentrer la
clientèle la plus modeste, la plus sociale ; alors que les autres
réseaux "récupéreraient" une clientèle plus
aisée. En effet, la clientèle aisée est souvent
multibancarisée et ne détient à la Caisse d'épargne
ou à la Poste que le livret A, dans un but d'optimisation fiscale.
Rien n'interdit à l'Etat
, par le truchement de la Caisse des
dépôts et consignations,
de verser une commission
différente à chaque établissement
. Cette
différenciation pourrait se faire selon deux critères :
- celui du réseau collecteur. La commission des anciens titulaires
du monopole pourrait être relevée (de 1,5 % à 2 %
pour la Poste ; de 1,3 à 1,8 % pour le Crédit mutuel ; de
1,2 à 1,7 % pour les caisses d'épargne). Les autres
réseaux percevraient 1 %
99(
*
)
;
- celui du niveau moyen de l'encours des livrets. Un barème
dégressif pourrait être établi selon le niveau de l'encours
moyen des livrets.
Confier au législateur la compétence d'affecter les ressources
L'exemple du Codevi, comme à certains égards
du livret bleu ou du livret jeune, montre qu'il n'est pas sain de laisser
ouverte la négociation entre la tutelle et la profession sur
l'affectation d'une ressource administrée, garantie par l'Etat et
partiellement financée sur dépense fiscale
. Le pouvoir
réglementaire n'a pas été apte à maintenir au
Codevi un but d'intérêt général, il a eu des
difficultés à en mettre en place un pour le livret bleu alors que
la loi le prévoit
100(
*
)
, et il a
renoncé pour le moment à le faire s'agissant du livret jeune.
Un des obstacles importants qui se dressent face à la banalisation du
livret A est le risque de voir ce dernier distrait à terme de sa
mission de financement du logement social, aujourd'hui parfaitement remplie par
les circuits de la Poste, de l'Ecureuil, du Crédit mutuel et de la
Caisse des dépôts et consignations. Il ne s'agit pas de prendre de
risque sur ce produit qui permet de transformer des dépôts
à vue en prêts à 32 ans et à 4,8 % aux
bailleurs sociaux.
Aussi le groupe de travail préconise-t-il que l'affectation au
logement social soit inscrite dans la loi et placée sous le
contrôle du législateur.
Une centralisation des fonds à
100 % à la Caisse des dépôts et consignations pourrait
en conséquence s'imposer.
REDÉFINIR LE RÔLE DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE LA POSTE
Le livret bleu ne représente plus, depuis
déjà quelque temps, un axe stratégique pour le
Crédit mutuel, qui ne devrait guère souffrir de la banalisation
d'un produit sur lequel il reste en position dominée par rapport
à la Poste et aux Caisses d'épargne.
Tel n'est pas en revanche le cas de ces deux derniers établissements. La
banalisation du livret A est donc indissociable d'une réflexion sur leur
avenir.
Permettre aux Caisses d'épargne d'affronter la concurrence dans les meilleures conditions
Dès lors que les livrets défiscalisés peuvent faire l'objet d'une distribution universelle, il est nécessaire de mettre les Caisses d'épargne en situation d'affronter efficacement la concurrence. Cela passe par deux réformes : les autoriser à distribuer les derniers produits bancaires qui leur sont fermés ; leur donner des propriétaires.
Autoriser les Caisses d'épargne à distribuer l'ensemble des produits bancaires
Les Caisses d'épargne sont aujourd'hui quasiment en mesure d'affronter avec succès et à armes égales la concurrence sur l'ensemble des services financiers. Elles ont acquis une compétence dans tous les domaines. Il ne reste plus qu'à leur donner la possibilité de proposer des crédits aux grandes entreprises (celles faisant appel public à l'épargne), seul service qu'elles n'ont pas encore obtenu le droit de rendre. Ce serait une juste contrepartie à la banalisation du livret A.
Donner des propriétaires aux Caisses d'épargne
Dans l'avis annexé au présent rapport, le Conseil de la concurrence considère comme une anomalie que les Caisses d'épargne n'aient ni actionnaires ni sociétaires 101( * ) , dès lors qu'elles exercent quasiment toutes les activités d'une banque commerciale. Il apparaît aussi dans leur propre intérêt d'avoir des propriétaires. La pression exercée par ceux-ci conduirait, tout naturellement, les caisses à chercher davantage de performance, comme c'est le cas dans toute entreprise.
Il convient en effet de
s'interroger sur le statut
"
d'établissement de crédit à but non lucratif
"
qui est celui des Caisses d'épargne
.
Cette notion n'a en
effet guère de sens
102(
*
)
.
Seuls les
établissements cherchant à réaliser des
bénéfices -ce qui est bien le cas des Caisses d'épargne-
oeuvrent dans l'intérêt de l'économie française.
Ceux qui font des pertes lui coûtent beaucoup.
A cet égard, il
n'y a aucune incompatibilité entre une vocation "
sociale
" et la
réussite financière.
Ainsi, les sociétés
anonymes de crédit immobilier, spécialisées dans le
crédit à l'habitat des personnes modestes, ont
réalisé 800 millions de francs de bénéfices en
1994. A l'inverse, Le Crédit foncier (qui s'est
précisément égaré hors de ce métier) ou le
Crédit Lyonnais sont des contre-exemples.
En revanche, il paraît bien exister une contradiction entre ce statut et
le fait pour les Caisses d'épargne de se porter acquéreur de
banques concurrentielles, comme certaines d'entre elles l'ont fait pour la
Société marseillaise de crédit et la banque Laydernier, ou
comme le Centre national des Caisses d'épargne (CENCEP) l'a
envisagé pour le Crédit industriel et commercial (CIC).
Le CENCEP a réfléchi à cette problématique, dont
la solution ne peut d'ailleurs se trouver que dans la loi, le statut des
caisses d'épargne étant de nature législative
103(
*
)
.
Le CENCEP doit se prononcer sur une proposition de réforme des
statuts.
La culture d'entreprise des Caisses d'épargne les pousse
naturellement vers le statut coopératif
, celui du Crédit
agricole, du Crédit mutuel ou des Banques populaires, qui
relèvent de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération.
Une solution pourrait consister dans la création d'une
société anonyme coopérative, à capital variable,
permettant l'entrée et la sortie des associés ou
sociétaires. Ces associés pourraient être divisés
entre associés-coopérateurs (les clients auxquels pourraient
s'adjoindre les salariés) et associés investisseurs (d'autres
personnes intéressées). Le capital de la Caisse
coopérative serait ouvert, de manière à permettre
l'entrée d'investisseurs extérieurs.
Ainsi, les Caisses
d'épargne auraient enfin de véritables propriétaires, et
leur capital serait ouvert à des partenaires extérieurs.
Dans ces conditions, le CENCEP, organe de tête du réseau,
pourrait devenir une société anonyme, possédée
comme aujourd'hui par les Caisses d'épargne coopératives (pour
65 %) et par la Caisse des dépôts et consignations (pour
35 %).
Le groupe de travail est favorable à ce système à la
condition qu'il recueille l'assentiment des Caisses d'épargne
. A cet
égard, l'objectif de donner des propriétaires aux caisses et
celui d'ouvrir leur capital aux investisseurs extérieurs sont remplis.
Dès lors, les pouvoirs publics n'ont aucune raison de ne pas faire toute
leur place aux choix des Caisses d'épargne et du CENCEP
104(
*
)
.
Une solution de cette nature permettrait de verser à l'Etat et aux
collectivités locales, le moment venu, le produit du placement dans le
public des parts sociales, au fur et à mesure qu'il se
réaliserait en fonction d'un calendrier progressif. Personne n'imaginant
de donner ou d'offrir les parts sociales aux souscripteurs, ni de doubler,
à cette occasion les capitaux propres des Caisses d'épargne qui
n'en ont nul besoin.
Cette formule aurait enfin le mérite de trancher la question de la
propriété des Caisses d'épargne.
Lors des débats portant sur la réforme du statut des Caisses
d'épargne (loi du 10 juillet 1991), le ministre de l'économie et
des finances déclarait que : "
les Caisses d'épargne
appartiennent à la nation
".
Il se fondait sur l'aide que l'Etat
leur a constamment apportée dans la constitution de leurs fonds propres
(garantie apportée aux livrets d'épargne, avantages fiscaux,
missions de service public rémunérées...).Il se fondait
également sur le principe selon lequel tout bien de mainmorte doit
revenir à la collectivité. Il est peut-être temps
aujourd'hui
d'
en tirer les conséquences
en
considérant que l'Etat et les collectivités locales sont les
propriétaires initiaux des Caisses d'épargne.
Cette proposition présente un double intérêt :
- d'un côté, elle restitue à l'Etat les sommes
accumulées grâce à lui, et qu'il a, selon les principes de
notre droit, vocation à récupérer, comme tout bien sans
maître. Les collectivités locales, qui ont toujours
participé à la gestion des Caisses d'épargne devraient
également en bénéficier ;
- d'un autre côté, cela permettrait aux Caisses d'épargne
de mettre en place le statut qu'elles souhaitent, au profit notamment de leurs
salariés qui pourraient
de jure
participer à leur capital,
sans pour autant procéder à leur profit à une injection de
liquidités supplémentaire et massive dont l'opportunité
n'est aucunement démontrée.
Redéfinir le rôle des services financiers de la Poste
On peut aujourd'hui regretter que les services financiers de
la Poste n'aient pas conservé la même discrétion que ceux
du réseau du Trésor Public
105(
*
)
.
A l'exception du livret A et de l'épargne-logement, le Trésor
peut offrir les mêmes services bancaires que la Poste. Les
trésoriers-payeurs généraux ont néanmoins
instruction de leur ministère de tutelle de conserver à cette
activité un caractère résiduel, afin de ne pas faire
concurrence au système bancaire. L'actuel ministre de l'économie
et des finances a ainsi récemment ordonné aux agents du
Trésor de ne plus démarcher la clientèle.
Mais, si environ 1.200 agents du Trésor se consacrent aux services
financiers et que cette activité est en voie d'extinction à la
Banque de France, 60.000 à 70.000
106(
*
)
agents s'y consacrent à la Poste qui en a
fait un axe majeur de développement.
Cantonner sans restreindre les activités des services financiers, et favoriser le développement de la polyvalence
On ne peut condamner la Poste pour son activité
offensive en matière de services financiers
. Cette attitude est
conforme à la réforme de son statut opérée par la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public des postes et télécommunications, à son
cahier des charges et au contrat de plan correspondants.
107(
*
)
Toute la difficulté vient de l'ambivalence des intérêts
de l'Etat, tuteur de l'ensemble du secteur bancaire et actionnaire de La
Poste
.
·
D'une part
, l'Etat actionnaire souhaite, ne serait-ce
que d'un point de vue budgétaire, que la Poste se développe et
soit rentable
, notamment pour assurer ses missions de service public. C'est
le sens de la loi du 2 juillet 1990.
Schématiquement, ces missions de service public sont de trois ordres: le
monopole de distribution des courriers de faible poids (le reste étant
concurrentiel), une contribution à l'aménagement du territoire et
le service bancaire ouvert à tous. La contribution à
l'aménagement du territoire est prévue par la loi
(article 6). La mission "sociale" d'accès au système
financier pour les ménages les plus modestes est réelle bien
qu'elle ne soit pas inscrite dans la loi.
L'exercice de ces deux dernières missions nécessite un
réseau très dense, réalisant un maillage complet du
territoire. La Poste dispose d'un tel réseau, avec 14.000 bureaux
et 3.000 agences. L'établissement de crédit le mieux
implanté, le Crédit agricole, est loin derrière avec
5.600 succursales.
Pour financer ce réseau et ces missions, la loi prévoit que la
Poste exerce trois activités marchandes, dans le respect de la
concurrence : la distribution du courrier et d'objets divers, et des
activités de dépôt et de gestion de moyens de paiement
(alinéas 3 et 4 de l'article 2). Le contrat de plan et le cahier des
charges signés en application de ce texte prévoient que la Poste
doit globalement équilibrer ses charges par ses recettes
108(
*
)
.
Or la conséquence logique de cet ensemble d'exigences est le
développement des services financiers.
En effet, le courrier ne
passe plus pour l'essentiel par les bureaux de Poste, dont la majorité
du chiffre d'affaires (58 %) vient désormais des services
financiers
109(
*
)
. Devant la commission de la
production et des échanges de l'Assemblée nationale, le ministre
des postes et télécommunications, M. François Fillon,
a récemment rappelé que 75 % de l'activité des points
de contact postaux en milieu rural provenait des services financiers
110(
*
)
. La rentabilisation du réseau, et
donc le maintien de sa densité, nécessitent le
développement de leur chiffre d'affaires. Et paradoxalement, cela exige
que la Poste soit présente et performante dans les zones urbaines et
prospères, car c'est à cette condition qu'elle peut effectuer une
péréquation avec les banlieues sensibles ou les zones rurales. On
peut rappeler à cet égard que si le droit de la concurrence
interdit une péréquation entre l'activité courrier et
l'activité services financiers, il autorise une
péréquation géographique au sein d'une même
activité
111(
*
)
.
Si le courrier a permis la constitution du réseau de la Poste (sa
création, son amortissement), ce sont les services financiers qui le
rendent aujourd'hui viable aux conditions posées par la loi de 1990,
des textes subséquents (contrat de plan et cahier des charges),
et au moindre coût pour l'Etat.
C'est pourquoi le ministère de l'économie et des finances, qui a
le pouvoir d'agréer les nouveaux produits financiers de la Poste, ne
refuse pas cet agrément.
·
D'autre part,
l'Etat tuteur se préoccupe du
développement d'une concurrence excessive dans le domaine des services
bancaires
112(
*
)
. Dans cette logique, il
pourrait souhaiter que ne se développent pas trop les services
financiers de la Poste, selon une solution qu'on pourrait qualifier
d'"
endiguement
".
Cet endiguement consisterait non seulement
à
ne pas étendre les compétences de la Poste, mais aussi à
les restreindre.
Dans cette optique, les services financiers
s'éteignent progressivement, à l'instar de ceux de la Banque de
France depuis la loi du 4 août 1993, ou bien se confinent dans une
activité d'appoint, comme pour le Trésor public. On peut imaginer
par exemple de les limiter aux activités traditionnelles de la Poste :
livret A, CCP, dépôt des notaires, épargne
administrée; l'assurance-vie et les placements de marché (OPCVM
notamment) étant supprimés.
Cette solution entraînerait alternativement deux conséquences :
-
soit une réduction de la taille du réseau de la
Poste
, dans l'optique du maintien d'une certaine rentabilité. En
effet, la diminution progressive de l'activité des services financiers
les plus rentables dans les grands centres urbains nécessitera la
fermeture des guichets peu rentables dans les zones difficiles, et une
sélection accrue de la clientèle ;
-
soit un coût grandissant pour les finances publiques
(Etat
et collectivités locales), dans une optique d'affranchissement des
contraintes de rentabilité. En effet, la Poste cessant de
développer ses services financiers ne pourra plus autofinancer son
réseau. Elle ne le pourrait pas davantage dans une tentative de relance
de la
polyvalence postale.
Cette solution, consistant à
réactiver le décret du 16 octobre 1979
113(
*
)
destiné à faire réaliser par
les succursales postales la plupart des prestations de service public,
permettrait sans doute de remplacer dans les guichets les activités de
services financiers amenées à disparaître. Mais le
remplacement d'un service marchand par un service non marchand
entraînerait nécessairement un transfert de charges de la
clientèle vers le contribuable. C'est déjà le cas dans le
cadre de conventions bilatérales Poste-communes pour le maintien de
l'activité des agences en milieu rural. La commune supporte alors une
partie des coûts de fonctionnement.
La polyvalence peut donc
compléter les services financiers mais non s'y substituer
114(
*
)
.
La conséquence de cette ambivalence est donc claire :
l'Etat ne peut
à la fois vouloir que la Poste maintienne sa présence sur le
territoire, notamment auprès des clients modestes, grâce à
des activités concurrentielles et vouloir qu'elle ne fasse pas
concurrence
-par à un réseau immense-
au reste du
système bancaire.
Le groupe de travail a donc cherché une solution qui tienne compte de
cette contradiction, étant entendu que la banalisation du livret A
en est une première étape. Cette solution doit chercher à
limiter le coût de la Poste pour la collectivité tout en
évitant une concurrence anormale aux autres établissements de
crédit.
Le caractère éventuellement déloyal de la concurrence des
services financiers de la Poste à l'égard du système
bancaire pourrait résulter de deux causes connexes :
- la première serait un transfert financier occulte entre
l'activité courrier et les services financiers (financement des pertes
des services financiers par le "prix du timbre");
- la seconde résulterait de la mise en commun des moyens du
courrier et de ceux des services financiers permettant le maintien en vie d'un
réseau extrêmement important avec lequel aucune banque ne peut
lutter.
Etablir une comptabilité analytique indiscutable et éventuellement filialiser les services financiers
S'agissant de la première cause, le Conseil de la
concurrence a estimé, dans son avis du 25 juin 1996 ainsi que dans
celui du 17 septembre 1996 annexé au présent rapport,
qu'elle ne pouvait être établie en l'absence d'une
comptabilité analytique suffisamment précise, imputant notamment
de manière appropriée la charge d'aménagement du
territoire à l'activité courrier et à l'activité
services financiers.
Afin de faire la transparence sur les liens financiers existant entre les deux
pôles,
il est nécessaire que la Poste affine la
comptabilité analytique qu'elle a déjà mise en place et
qu'elle la fasse certifier par un cabinet d'audit indépendant.
Au-delà, le Conseil de la concurrence considère qu'une
filialisation
des services financiers serait le meilleur moyen de
parvenir à cette clarification. Mais il l'estime difficile à
réaliser, car entraînant probablement la fin de la double
activité (financière et postale) des agents
115(
*
)
.
Le groupe de travail partage largement cet avis,
à l'exception
toutefois de la réserve émise. Il est en effet possible de
filialiser les services financiers. Il suffit de les structurer en services
centraux et régionaux.
Le réseau continuerait d'appartenir
à la branche courrier, et percevrait une redevance d'utilisation de la
part des services financiers
. Cette solution a été mise en
place en Allemagne et au Royaume-Uni (où plusieurs établissements
financiers utilisent le réseau postal). En Allemagne, ce nouveau
système rencontre des difficultés de mise en place, ce qui est
naturel s'agissant d'un changement d'une telle ampleur. Mais il pourrait
être transposé en France, avec la création d'une banque
postale utilisant le réseau de la Poste et la rémunérant
à cet effet.
D'autres pays ont filialisé les services financiers de leur entreprise
postale : les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne et la Finlande, avec des
modalités diverses quant aux relations Poste-services financiers.
Au demeurant, si cette solution n'a pas été retenue en France en
1990, il faut se souvenir que l'enjeu de l'époque était une
séparation des branches poste et télécommunications (
création de France Telecom), réforme dont l'ampleur se suffisait
à elle-même dans l'immédiat.
S'agissant de la seconde cause, on peut remarquer qu'elle n'est pas
constitutive d'infraction aux règles de la concurrence. Mais il est
indéniable qu'elle entraîne des difficultés pour l'ensemble
du système bancaire.
Sur ce point, le groupe de travail considère que deux solutions sont
envisageables.
Mettre fin aux derniers privilèges fiscaux de la Poste
La première consisterait à continuer dans la
voie de la suppression de la fiscalité dérogatoire dont la Poste
bénéficie.
Le groupe de travail ne préconise pas de la soumettre à la taxe
sur les institutions financières, dans la mesure où il
préconise la suppression de celle-ci. Mais dans l'hypothèse
où elle serait maintenue, la Poste pourrait y être assujettie au
prorata de son activité financière.
En revanche,
il paraîtrait justifié de mettre progressivement
fin à l'abattement de 85 % des bases de taxe foncière et de
taxe professionnelle
, en particulier dans les zones urbaines
prospères où il n'est guère justifié. En effet,
bien que la commission de l'Union européenne n'ait pas jugé que
cet avantage constitue une distorsion de concurrence dans la mesure où
il tend à compenser une contrainte d'aménagement du territoire,
il est difficile de justifier le maintien de cet avantage fiscal dès
lors que le développement des services financiers a également
pour but de permettre à la Poste de faire face à cette
contrainte. Par conséquent, l'abattement pourrait être
supprimé "en sifflet" sur dix ans, à l'exception des zones de
revitalisation rurale et des zones urbaines sensibles. Une
péréquation pourrait être opérée entre les
zones à fort rendement de taxe professionnelle et les autres.
Cette progression vers une fiscalité de droit commun est
cohérente avec ce que le groupe de travail propose par ailleurs, et va
dans le sens généralement observé dans le système
financier
116(
*
)
.
Faire de la Poste un établissement de place
La seconde, qui serait facilitée par la filialisation
des services financiers consisterait à favoriser
l'octroi de
crédits pour compte de tiers par les bureaux de Poste. Il ne s'agirait
pas d'autoriser la Poste à proposer les prêts auxquels elle n'a
pas accès actuellement
(elle n'a accès à aucun,
à l'exception des prêts principaux et complémentaires
à l'épargne-logement). Il s'agirait au contraire de la conduire
à proposer,
au profit des autres établissements de
crédit
et contre une commission commerciale, les prêts que ces
établissements financeraient et géreraient (à l'instar de
l'accord signé entre la Poste et le Crédit foncier pour l'avance
à taux nul).
Bien entendu,
la Poste agirait en tant qu'établissement de place,
ne donnerait pas de préférence à tel ou tel
établissement, la redevance commerciale étant fixée par
les pouvoirs publics (comme pour le livret A ou les CCP).
De cette manière, les établissements de crédit qui
estiment souffrir de la concurrence du réseau postal pourront la
neutraliser dans l'intérêt général
.
Cette solution aurait pu être étendue aux prestations de service
déjà réalisées par les services financiers de la
Poste. Mais le groupe de travail n'a pas jugé cette extension
réaliste, dans la mesure où les bureaux auraient naturellement
tendance à favoriser la vente des produits "maison", et ce même si
ce partenariat existe déjà ponctuellement
117(
*
)
. Ce dossier pourrait néanmoins être
rouvert à échéance, lorsque la filialisation aura produit
ses effets.
En revanche, le groupe de travail considère qu'il ne faut pas
étendre les activités de la Poste à de nouveaux services
pour son propre compte.
A la suite de la filialisation, une éventuelle subvention occulte entre
le courrier et les services financiers sera rendue plus difficile. La
banalisation du livret A et la suppression progressive des avantages
fiscaux dérogatoires supprimeront les distorsions de concurrence. En
revanche, la vente de crédits pour compte de tiers et le maintien d'une
activité soutenue pour les services financiers permettront de maintenir
le réseau, en limitant au maximum le coût pour l'Etat.
CENTRALISER LA COLLECTE DES DÉPÔTS DES NOTAIRES
Le service du dépôt des notaires est actuellement
un oligopole constitué des réseaux de la Poste et du
Trésor Public, qui en centralisent les fonds à la Caisse des
dépôts et consignations, et du réseau du Crédit
agricole.
Le groupe de travail considère que cette situation n'est certes plus
aujourd'hui justifiée, mais que des obstacles d'ordre technique
s'opposent encore à l'ouverture à tous les réseaux des
dépôts des fonds que les notaires détiennent pour le compte
de tiers, et qui s'élèvent à 50 milliards de francs
environ.
En effet, pour être assuré dans l'intérêt du public,
ce service doit réunir trois conditions :
- disposer d'un réseau suffisant pour que chaque étude ait une
agence à proximité;
- permettre des contrôles parfaitement fiables;
- garantir la totalité des dépôts sans aucun risque.
La première condition serait aisément remplie par la
généralisation du service à tous les
établissements. Cependant, le gain serait marginal par rapport au
réseau actuel, comportant au total 27.000 bureaux (Poste : 17.000,
Crédit agricole : 5.600, Trésor : 4.400).
La deuxième condition serait moins bien remplie en cas de multiplication
des dépositaires potentiels. En 1990, le Conseil supérieur du
notariat s'était ainsi opposé à la banalisation du
dépôt des notaires, car il craignait de rencontrer des
difficultés à contrôler l'encaisse d'études
multibancarisées. Cet obstacle ne peut être négligé
tant que le notariat estimera impossible de disposer des moyens suffisants de
contrôle en cas de multibancarisation. En outre, il pourrait être
malsain que les notaires fassent l'objet de sollicitations commerciales de la
part d'établissements en concurrence pour obtenir le dépôt
des fonds dont ces officiers publics ont la charge.
La troisième condition n'est actuellement parfaitement remplie que par
la garantie de l'Etat et ne le sera sans doute jamais complètement
autrement. En effet, la directive européenne sur la garantie des
dépôts a été transposée en France en 1994.
Les textes d'application sont parus, mais il reste à mettre en place de
façon concrète des systèmes dont la fiabilité devra
pouvoir être vérifiée. Les systèmes de garantie du
Crédit Agricole ou de l'AFB ne sont pas à mettre en doute, mais
l'Etat demeure pour le moment et pour longtemps encore sans doute le seul
garant irréfutable.
C'est pourquoi le groupe de travail préconise que le
dépôt des notaires soit exclusivement confié au
réseau de l'Etat
(Poste et Trésor public), tant que les
conditions d'une banalisation sans risque n'auront pas été
réunies.
L'enjeu pour le Crédit agricole paraît de faible importance, dans
la mesure notamment où cet établissement
bénéficiera fortement des autres mesures
préconisées par le groupe de travail (la banalisation du livret A
surtout). En revanche, établissement privé totalement
banalisé, le Crédit agricole ne pourrait justifier de conserver
cet avantage dont ne bénéficient pas les autres
établissements du secteur concurrentiel.
L'existence des fonds d'allégement de la charge financière des
agriculteurs (FAC), à laquelle le groupe de travail est très
attaché, ne serait pas remise en cause. L'instruction des dossiers
pourrait être gérée par le Crédit agricole et par
les autres banques distribuant des prêts bonifiés à
l'agriculture, le service de caisse étant assuré par la Caisse
des dépôts et consignations.
Néanmoins il serait
souhaitable d'attendre la fin de l'actuelle session du FAC (en 1999) pour
effectuer cette réforme.
POURSUIVRE LA BANALISATION DES CRÉDITS RÉGLEMENTÉS
Depuis le milieu des années quatre-vingt, la France
s'est engagée dans un processus de banalisation des actifs bancaires.
Les prêts à l'artisanat, les prêts à l'agriculture
ont été banalisés. Plus récemment, le
ministère de l'économie et des finances et celui du logement ont
décidé de faire distribuer les prêts à taux
zéro par l'ensemble du système bancaire alors que les PAP qu'ils
ont remplacés n'étaient distribués que par le
Crédit foncier, le Comptoir des entrepreneurs, et les SACI.
Il ne reste plus aujourd'hui dans les circuits spécialisés que
quelques prêts spécifiques au logement : les prêts locatifs
aidés (PLA) et les prêts locatifs intermédiaires (PLI). Ces
deux prêts relèvent du monopole de la Caisse des
dépôts et du Crédit foncier.
L'excellente réforme du PLI en vigueur depuis le 1er mars 1996
118(
*
)
, et qui est destinée à
populariser ce prêt actuellement réservé aux bailleurs
sociaux aurait probablement davantage de succès si elle faisait l'objet
d'une plus grande publicité. Celle-ci serait assurée par la
diffusion du produit par l'ensemble des réseaux bancaires.
Cependant, le groupe de travail reste conscient que les difficultés
de nombreux établissements dans la période récente (SDR,
CEPME, Comptoir des entrepreneurs, Crédit foncier) viennent d'une
maîtrise insuffisante des conséquences des banalisations des
formes de crédit qu'ils distribuaient à titre exclusif.
Aussi, le groupe de travail préconise-t-il que les banalisations qui
restent à accomplir se fassent dans la transparence, avec des
échéances déterminées, et en garantissant aux
établissements qui perdront leur monopole des périodes
transitoires d'adaptation.
Dans un premier temps, il serait ainsi envisageable de ne banaliser que la
diffusion des produits, le montage et la gestion restant confiés aux
établissements spécialisés.
CHANGER LA POLITIQUE BANCAIRE DE L'ETAT
Pour renforcer la compétitivité de notre système bancaire, il ne suffit pas de lever les entraves à son bon fonctionnement, il est également nécessaire de mettre fin à certaines " protections " dont l'Etat l'entoure. Le sentiment d'immortalité qu'elles provoquent est de nature à induire des comportements risqués qui aboutissent au résultat inverse de l'objectif des filets de sécurité 119( * ) .
A cet égard, deux voies complémentaires
méritent d'être explorées :
cesser de confondre la protection des déposants et la
prévention des risques systémiques avec la garantie de survie
pour tous les établissements ;
privatiser le secteur concurrentiel public et supprimer l'intervention
étatique en ne conservant à l'Etat que des missions de service
public identifiées après débat de place et clairement
situées hors de la concurrence.
LA PROTECTION DES DÉPOSANTS ET LA PRÉVENTION DES RISQUES SYSTÉMIQUES NE DOIVENT PAS GARANTIR LA SURVIE DE TOUS LES ÉTABLISSEMENTS
Il est évidemment de la plus haute importance de garantir la sécurité des déposants et de prévenir les risques systémiques, désormais largement transfrontaliers. Mais ces préoccupations légitimes ne doivent pas déboucher sur une "assurance-survie" des établissements qui empêche tout ajustement du système et peut conduire, dans certains cas, à des comportements peu responsables de la part des dirigeants bancaires .
Dans la pratique courante des États, la volonté de garantir les dépôts et le souci de prévenir le risque systémique se sont traduits en effet par des interventions permettant aux établissements provisoirement défaillants de continuer leur exploitation.
Pourtant, il n'y a aucune nécessité à ce que les dispositifs destinés à garantir le bon fonctionnement du système et la confiance du public se traduisent par le maintien en vie de tous les établissements défaillants.
Pour mettre fin à cet effet devenu pervers du système de prévention des crises bancaires, il convient, d'une part, de mettre fin à la recapitalisation systématique d'établissements non viables et, d'autre part, de s'assurer que l'appel à la solidarité des concurrents se traduise effectivement par le retrait du marché de l'établissement défaillant.
Mettre fin à la recapitalisation systématique d'établissements non viables
Ce problème concerne tous les actionnaires bancaires en général et l'Etat actionnaire en particulier.
Le cas général des actionnaires bancaires
Le premier alinéa de l'article 52 de la loi bancaire,
qui conduit au renflouement systématique des banques en
difficulté par leurs actionnaires de référence, doit
cesser d'être considéré comme l'instrument de premier rang
du système de protection français.
D'abord, parce qu'il ne semble plus possible de "
réaffirmer la
responsabilité des actionnaires bancaires"
. C'est le
caractère irréaliste d'une application systématique du
premier alinéa de l'article 52.
Sauf à rétablir des
barrières à l'entrée, incompatibles avec nos engagements
internationaux et notamment européens, et à remodeler
d'autorité le capital des banques françaises en organisant une
cartellisation forcée de la place, dont il est difficile de percevoir
comment elle pourrait être réalisée compte tenu des
privatisations passées et à venir,
il faut prendre acte de la
réalité et reconnaître que les actionnaires bancaires
peuvent être des actionnaires comme les autres
: "
petits
actionnaires
", actionnaires industriels, voire actionnaires
étrangers. Dans "
la banque du XXI
ème
siècle
"
120(
*
)
, ce n'est plus
l'actionnaire qui sera spécifique, c'est la banque elle même, qui
continuera de l'être.
A cet égard, la pratique des lettres de parrainage, exigée par
le Comité des établissements de crédit depuis 1988, et
dont la valeur juridique est incertaine
121(
*
)
,
ne semble plus constituer une fondation suffisamment solide sur laquelle
établir la crédibilité de place. Sa systématisation
constitue un frein à la vocation d'entreprendre des structures les plus
petites, sans pour autant garantir, de façon infaillible, la
solidité des établissements les plus grands.
Ensuite, parce que la recapitalisation, érigée en
système, aboutit à maintenir sous perfusion des
établissements non rentables pour le plus grand dommage du secteur dans
son ensemble. C'est l'effet pervers du premier alinéa de l'article
52.
Enfin, parce que son application dans le cas de sinistres majeurs, comme
celui du Crédit Lyonnais, affectant des banques privées semble
inenvisageable.
Si le besoin s'en faisait réellement sentir, est-on
vraiment sûr que Alcatel-Alsthom soit en mesure d'assumer une
recapitalisation de la Société Générale, ou l'UAP
(qui est également dans le noyau dur de Suez), une recapitalisation de
la BNP ?
Le
statu quo
actuel n'étant pas souhaitable, faut-il
envisager, comme le recommande l'excellent rapport de M. Philippe Auberger
122(
*
)
la mise en place d'un authentique fonds
de garantie interbancaire financé par des cotisations
ex ante
?
Assurément, cette proposition améliorerait
considérablement la solidité de notre mécanisme de
prévention et permettrait de dédramatiser la gestion des crises
bancaires.
On peut certes comprendre la réticence générale à
laquelle se heurte cette proposition dans le climat actuel de concurrence
exacerbée et de sous rentabilité chronique des banques
commerciales françaises. Il n'en reste pas moins qu'il serait
regrettable d'abandonner complètement cette idée, susceptible
d'être mise en oeuvre de façon programmée et progressive
afin d'en étaler le coût dans le temps. Un authentique fonds de
garantie inter-réseaux éviterait peut-être aux
autorités bancaires de recourir systématiquement aux actionnaires
de référence, de peur d'avoir à tester la solidité
des mécanismes actuels.
Mais, quoiqu'il en soit, cette solution ne résoudrait pas
complètement le problème des effets pervers de l'article 52
premier alinéa
. Cumuler un fonds de garantie inter-réseaux
avec l'appel, en premier ressort, aux actionnaires de référence,
risquerait même d'accroître dangereusement les comportements
irresponsables ("
l'aléa de moralité"
), sans être sur
de limiter les recapitalisations systématiques.
C'est pourquoi, il serait souhaitable, en tout état de cause, de
changer la doctrine d'application de ce texte afin de lui redonner le sens qui
était originellement le sien, celui d'une simple prérogative non
contraignante.
Dans cette nouvelle doctrine, sans doute plus conforme à l'intention
du législateur, l'appel aux actionnaires ne devrait être
utilisé que lorsque le Gouverneur de la Banque de France a la ferme
conviction que l'établissement est viable et qu'il ne s'agit que d'un
accident passager.
Cette conviction devrait être partagée par
les actionnaires de l'établissement en cause car rien ne serait pire que
de transformer une
invitation,
traduction dans notre système de
droit écrit d'un usage, mécanisme souple et pragmatique, en un
mécanisme obligatoire.
Dans le cas où l'une des deux parties (autorités bancaires ou
actionnaires) ne jugerait pas l'établissement viable, il conviendrait,
sans "
menace
" ni pression, d'éviter la recapitalisation et de
laisser les mécanismes de garantie des dépôts entrer en
action. Dans l'hypothèse, apparemment jugée improbable, où
les mécanismes actuels se révéleraient insuffisants, alors
faudrait-il se souvenir, qu'en France aussi, la Banque centrale est le
prêteur de dernier ressort.
Tout en appliquant cette pratique nouvelle pour les établissements
qu'elles sont chargées de surveiller, les autorités bancaires
françaises devraient plaider, au sein des instances internationales
idoines (Comité de Bâle, Commission européenne), pour que
l'absence de recapitalisation systématique devienne une règle
commune.
En effet, bien que la législation française soit la seule
à consacrer l'appel aux actionnaires bancaires, cette pratique existe
dans de nombreux autres pays. Son caractère coutumier rend difficile la
réponse à la question centrale de savoir si son recours y est
systématique ou non, c'est à dire s'il concerne également
des établissements non rentables. On peut néanmoins supposer que
dans au moins un pays, l'Italie, existe une pratique analogue à la notre
et que dans deux autres pays, cette pratique n'est pas systématique :
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne (voir plus loin l'encadré relatif
aux réponses de certaines de nos ambassades).
Le cas particulier de l'Etat actionnaire
L'Etat, premier concerné par les recapitalisations,
devrait reconsidérer sa doctrine vis à vis des banques dont il
est actionnaire. S'il est inconcevable qu'il n'honore pas sa signature, en
revanche l'apport de deniers publics ne devrait pas être utilisé
pour "
remettre les choses en l'état
". Même si certaines
banques sont trop grandes pour faire faillite, aucune ne doit être
jugée trop grande pour payer ses erreurs.
Pour prendre un exemple concret, chaque franc versé au profit du
Crédit Lyonnais ne fait qu'allonger la durée de la crise
traversée par le secteur bancaire. C'est non seulement une
désincitation à une gestion "
saine et prudente
", termes
consacrés aussi bien par les directives européennes que par notre
propre loi bancaire, mais c'est un biais macro-économique susceptible de
déséquilibrer l'ensemble du secteur.
Cette nouvelle attitude doit conduire à
mettre fin aux
recapitalisations récurrentes
d'établissements non rentables.
Si une recapitalisation ponctuelle peut être justifiée dans un
souci patrimonial lorsque l'établissement est viable
123(
*
)
, la répétition de ce type
d'intervention montre qu'au contraire l'établissement ne peut survivre
que sous perfusion. Son maintien contribue alors à un excès de
concurrence sur le marché. Il vaut mieux cesser les recapitalisations,
céder les actifs qui peuvent l'être et le fonds de commerce, en
tentant de limiter la perte de l'Etat à une seule opération.
Réponses des conseillers financiers des ambassades de France à Rome, Londres et Bonn
Existe-t-il dans ces pays une tradition analogue à celle
de la tradition française qui veut qu'une banque publique (Crédit
Lyonnais) ou presque privée (Comptoir des entrepreneurs) ne fasse jamais
faillite et soit l'objet quasi-systématiquement d'une aide de l'Etat ?
1. Grande-Bretagne
"La Grande-Bretagne n'a pas de banque publique. Lors de la chute de la
banque
Barings, la décision a été prise de vendre la plus vieille
banque anglaise à une banque néerlandaise (ING)."
2. Allemagne
"Il est vraisemblable qu'en Allemagne, tout comme en France, une
collectivité publique actionnaire majoritaire d'une entreprise ne
laisserait pas celle-ci dans une situation de cessation de paiements.
S'agissant du secteur bancaire allemand, cette hypothèse reste
néanmoins largement théorique. Le secteur public bancaire est en
effet détenu par l'Etat fédéral et les
Länder,
mais, d'une part, les banques majoritairement détenues par l'Etat
fédéral sont des organismes de distribution des aides
budgétaires aux entreprises (Kreditanstalt für Wierderaufbau,
Ausgleichsbank
) et non des établissements exerçant des
activités classiques de banque, d'autre part, les banques
détenues par les
Länder
(les
Ländersbanken
),
conjointement avec les caisses d'épargne, ont pour principale fonction
la gestion de la trésorerie de ces dernières, et sont
réputées pour la prudence de leurs opérations. "
3. Italie
"Les banques qu'elles soient publiques (le Banco di Napoli, de nombreuses
caisses d'épargne) ou privées (Banco Ambrosiano, les banques
Sindona) n'ont jamais fait et ne font pas faillite. Telle est la
stratégie du service de la surveillance bancaire (Banque centrale). Ce
sont les détenteurs de leur capital qui perdent leur mise, en cas de
difficultés. Dans la plupart des cas, l'autorité de surveillance
organise l'opération de sauvetage : la banque en difficulté est
reprise par un autre établissement de crédit ou elle
reçoit un financement ("prêt subordonné") de la part de
plusieurs groupes bancaires sollicités par la Banque d'Italie ou encore
elle est liquidée (banques de petite taille). Dans ce dernier cas, un
fonds professionnel de garantie interbancaire assure les dépôts de
la clientèle.
"S'agissant du sauvetage du Banco di Napoli, l'Etat a dû intervenir,
cette année pour 6 milliards de francs, souscrivant à une forte
augmentation de son capital. Il existe des mécanismes de financement ad
hoc dont peuvent bénéficier les repreneurs de banques en
difficultés (crédits accordés par la Banque d'Italie
à un très bas taux d'intérêt).
"En fait l'Etat n'est intervenu, jusqu'ici, que dans un seul cas : celui
du
Banco di Napoli (250 milliards de francs de dépôts). Dans tous les
autres sinistres, ce sont les banques elles-mêmes qui sont venues en aide
à celles en difficulté."
Retirer du marché les établissements bénéficiant des mécanismes de solidarité
Toute différente est la problématique des secours
apportés aux établissements par leurs concurrents, soit à
la suite d'un appel du Gouverneur de la Banque de France, soit à la
suite de la mise en jeu d'un système de garantie de dépôts.
Pour que les établissements cessent de voir dans ces
mécanismes une garantie de survie, il suffit peut-être d'afficher
clairement que des sanctions seront automatiquement prononcées
dès lors que ces mécanismes auront été mis en jeu
en leur faveur.
Ces dispositifs ne doivent plus être considérés comme des
sauvetages, mais comme des tentatives pour circonscrire des sinistres.
Circonscrire un sinistre ne veut pas dire l'effacer.
Pour les établissements qui font l'objet de la mise en jeu du second
alinéa de l'article 52 (appel à la place), comme de l'article
52-1 (mise en jeu de la garantie des dépôts), il conviendrait de
prévoir automatiquement une interdiction d'exercer les activités
ayant conduit à la situation qui a justifié la mise en jeu du
mécanisme, voire un retrait d'agrément
. De la sorte, les
établissements défaillants ne pourront plus penser pouvoir
bénéficier d'un sauvetage, et continuer après
été avoir été aidés par leurs concurrents,
à leur faire concurrence.
Le problème pourrait se poser dans des termes différents
s'agissant des systèmes de garantie des dépôts propres aux
établissements organisés en caisses affiliées à un
organe central. Deux cas peuvent alors se présenter. Soit, le
réseau souhaite voir la caisse défaillante continuer son
activité ; les autres caisses n'étant pas ses concurrentes mais
ses alliées, lui assurent alors les moyens de continuer son
activité. Soit le système de garantie des dépôts de
l'organe central entre en action, il est alors envisageable que les mêmes
sanctions soient prononcées.
L'ETAT DOIT SE RETIRER DU SECTEUR CONCURRENTIEL ET NE CONSERVER QUE DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DÉFINIES DANS LA TRANSPARENCE
Privatiser ce qui peut l'être
Le groupe de travail reprend à son compte une
proposition déjà émise par notre commission dans le
rapport de nos collègues Jean Arthuis, Claude Belot et Philippe Marini :
"
Il apparaît avec évidence que l'Etat n'a pas vocation
à détenir des entreprises du secteur concurrentiel pour
lesquelles le sort le plus normal doit être la privatisation.
"
124(
*
)
Cela signifie que l'Etat doit se retirer complètement de toutes les
entreprises dont les métiers sont également pratiqués par
des établissements privés selon des règles de
concurrence.
Il ne doit donc pas seulement privatiser les banques nationalisées
telles que la Société Marseillaise de Crédit, le CIC, la
Banque Hervet, la banque Laydernier, le Crédit Lyonnais... Il doit aussi
s'interroger sur la conservation d'éléments de son patrimoine
qui, tout en faisant partie d'un groupe à vocation de service public,
exercent des métiers concurrentiels.
Cela implique enfin que l'Etat abandonne tout pouvoir de nomination, et
même d'influence sur les nominations,
dans les établissements
de crédit privés, tels que le Crédit foncier. La
privatisation n'a en effet pas de sens si l'osmose entre la haute
administration financière et le secteur bancaire est
perpétuée
125(
*
)
.
Il est
nécessaire de laisser se développer peu à peu une
tradition entrepreneuriale dans ce secteur
.
Étatiser ce qui doit l'être
Inversement, un retrait aussi complet que possible du secteur
concurrentiel doit s'accompagner d'une
identification précise et
transparente des missions de service public
que l'Etat continuerait
à exercer, par la voie de subventions, de garanties, ou
d'établissements publics de place
. Cette identification doit se
faire de façon transparente
après débat de place
auquel tous les acteurs prendraient part, de façon à
définir les tâches que le secteur concurrentiel n'est pas
prêt à assumer.
Le groupe de travail ne se prononce pas sur le contenu de ces missions, qui
peut être évolutif et devra être renégocié
fréquemment. Traditionnellement, l'Etat intervient sur plusieurs
créneaux : le financement du logement social (le PLA, le PLI, le
prêt à taux zéro, le 1 % logement) ; les engagements
à long terme sur les PME (par les SDR, le CEPME, la SOFARIS);
l'épargne populaire (l'exonération des intérêts du
livret A), ou l'épargne-logement (l'exonération et la prime sur
les intérêts des comptes et plans)... Il demande également
au système bancaire de garantir des droits : droit au compte,
procédures de surendettement, etc...
Le débat de place est indispensable pour éviter l'apparition
de l'Etat sur des secteurs en situation de concurrence
. Ainsi, la nouvelle
banque des PME devra prendre la précaution de ne pas empiéter sur
les relations entre banques et PME ressortissant au secteur concurrentiel
(crédits à court et moyen terme notamment), et veiller à
n'intervenir qu'en partenariat avec les autres établissements, comme la
SOFARIS aujourd'hui
126(
*
)
.
Rien n'est plus détestable que l'ambiguïté dans ces
différents domaines. L'intervention de la puissance publique dans les
secteurs gérés convenablement par l'économie de
marché fausse l'allocation des ressources.
Dans les différents domaines d'intérêt
général ainsi définis, l'action de l'Etat devra être
prévisible de façon à constituer un socle solide sur
lequel l'ensemble du secteur pourra s'appuyer
. Ainsi il conviendra, entre
autres, que l'Etat gère enfin de façon appropriée le
niveau des taux de l'épargne administrée, afin de ne pas
introduire de perturbation aussi bien dans le volume des ressources
affectées à des missions d'intérêt
général que dans l'allocation de l'épargne entre les
différents produits.
* *
*
CONCLUSION
La situation des banques françaises, malgré sa
grande diversité, est préoccupante
. Leur insuffisante
rentabilité, non seulement porte atteinte à leur rang
international, mais surtout les expose à un rachat, à tout
moment, par des banques étrangères mieux capitalisées et
plus profitables.
Cette situation résulte, notamment, d'une surbancarisation
qui
découle de l'augmentation du nombre des acteurs alors que la demande de
crédit stagne voire diminue. De ce point de vue, une analyse plus fine
que celle effectuée dans le présent rapport, aurait peut
être permis de montrer que les établissements moyens à
vocation générale sont les plus concernés par ces
surcapacités.
L'État ne peut rester indifférent, car de la santé des
banques
, pourvoyeuses de crédit et gardiennes des systèmes de
paiement,
dépend, en partie, la santé de l'économie
.
Pour autant, l'État doit cesser de considérer les banques
comme des entreprises à part, ou comme un instrument de politique
économique chargé de trop nombreuses missions
d'intérêt général
. C'est en dégageant des
bénéfices que les banques sont utiles à l'économie.
Ces bénéfices attestent qu'elles ont effectué, de
façon économiquement efficace, le financement des
investissements. Ils leur permettent de jouer pleinement leur rôle
d'amortisseur conjoncturel.
Affirmer que les banques sont des entreprises comme les autres signifie
qu'elles doivent être gérées comme les entreprises à
part entière qu'elles sont
. De ce point de vue, il faut bien
reconnaître que la banque française traditionnelle a eu, pendant
longtemps, peu de ressemblance avec une entreprise concurrentielle. Elle
était une sorte "
d'annexe de l'administration
". Or, cette
"
gangue bureaucratique
" est en train de voler en éclats. Les
ajustements sont douloureux, mais nécessaires.
Mais dire que les banques sont des entreprises comme les autres signifie
également qu'elles doivent naître et mourir comme les autres.
Il est temps d'en finir avec le dogme de "
l'immortalité
bancaire
" qui empêche les ajustements et provoque l'anémie
de l'ensemble du secteur.
Les banques françaises conservent quelques beaux atouts pour
affronter leurs concurrents étrangers
et, notamment, une
maîtrise des systèmes de paiement électroniques
remarquable, une interbancarité unique au monde, des réseaux
puissants et organisés, une présence à l'international
encore cohérente et offensive. Il serait dommage de ne pas les utiliser
pleinement.
Pour ce faire, ce n'est pas d'aides publiques qu'elles ont besoin, mais
d'un signal fort. C'est tout l'objet de ce rapport.
* *
*
LISTE DES PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
I. METTRE FIN AUX RIGIDITÉS GÉNÉRALES
A. AUTORISER LA RÉMUNÉRATION DES DÉPÔTS À
VUE ET LA TARIFICATION DE L'ENSEMBLE DES SERVICES BANCAIRES
Tarification des chèques et rémunération des dépôts
Proposition n
o
1
Autoriser la
tarification des chéquiers.
Proposition n
o
2
Autoriser la rémunération
des dépôts à vue.
Mesures d'accompagnement en faveur des consommateurs
Proposition n
o
3
Interdire l'utilisation
des dates de valeur à des fins de rémunération des
mouvements de fonds.
Proposition n
o
4
N'autoriser la tarification des
chèques qu'au-delà d'un certain nombre de chèques
émis.
Proposition n
o
5
Permettre l'imputation fiscale des
différents frais de tenue de compte courant sur la
rémunération attachée aux dépôts à vue.
Établir la transparence sur les coûts des missions de services publics
Proposition n
o
6
Mesurer les coûts
des missions de service public liées à la tenue des comptes
bancaires.
B. ABROGER LE DÉCRET DU 31 MARS 1937
Proposition n
o
7
Abroger le décret du 31 mars 1937
et le remplacer par un régime conventionnel négocié au
niveau de l'AFECEI.
C. RÉDUIRE LES COÛTS DE LA LÉGISLATION
CONSUMÉRISTE
Traiter le cas particulier des remboursements anticipés
Proposition n
o
8
Permettre le
provisionnement immédiat du risque de remboursement anticipé.
Proposition n
o
9
Modifier le calcul de
l'indemnité de remboursement anticipé selon un partage plus
équitable entre la banque et le client, et en supprimant toute
indemnité pour les remboursements contraints.
D. MODERNISER LA FISCALITÉ BANCAIRE
Proposition n
o
10
Réformer la taxe sur les salaires
de façon à en supprimer les effets nuisibles sur l'emploi.
Proposition n
o
11
Supprimer la contribution des
institutions financières.
II. HARMONISER LES CONDITIONS D'EXERCICE DU MÉTIER BANCAIRE
A. GÉNÉRALISER LA DISTRIBUTION DES LIVRETS
DÉFISCALISÉS
Autoriser une diffusion universelle
Proposition n o 12 Autoriser la diffusion universelle de l'ensemble des livrets défiscalisés de façon franche et directe, en réservant les appellations livret "A" et livret "bleu" au profit de leurs distributeurs actuels.
Prendre des précautions
Proposition n
o
13
Définir une
échéance de cinq ans pour cette banalisation.
Proposition n
o
14
Envisager un commissionnement
différencié selon les réseaux et l'encours des livrets.
Proposition n
o
15
Donner compétence au
législateur pour l'affectation des ressources collectées, au
financement du logement social.
B. REDÉFINIR LE RÔLE DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE LA
POSTE
Favoriser la modernisation des Caisses d'épargne Ecureuil
Proposition n
o
16
Donner aux Caisses
d'épargne la possibilité d'exercer l'ensemble des métiers
bancaires.
Proposition n
o
17
Conférer aux Caisses
d'épargne un statut coopératif qui leur donne de
véritables propriétaires.
Proposition n
o
18
Verser à l'Etat et aux
collectivités locales le produit du placement dans le public des parts
sociales.
Clarifier la situation de La Poste
Proposition n
o
19
Cantonner les services
financiers de la Poste à leurs activités actuelles sans toutefois
les restreindre, pour des raisons d'aménagement du territoire.
Proposition n
o
20
Identifier précisément
les comptes respectifs des services du courrier et des services financiers par
une comptabilité analytique, voire par une filialisation.
Proposition n
o
21
Conduire progressivement la Poste vers
une fiscalité de droit commun.
Proposition n
o
22
Envisager de faire de la Poste un
établissement de place pour les activités qu'elle ne
réalise pas pour compte propre, tel que l'octroi de crédit.
C. CENTRALISER LA COLLECTE DES DÉPÔTS DES NOTAIRES
Proposition n
o
23
Confier le dépôt des
notaires au réseau du Trésor (Trésor public, Poste, Caisse
des dépôts et consignations).
D. POURSUIVRE LA BANALISATION DES CRÉDITS RÉGLEMENTES
Proposition n
o
24
Envisager la distribution universelle des
derniers crédits réglementés en ménageant les
transitions nécessaires (par exemple en distinguant la commercialisation
de la gestion).
III. CHANGER LA POLITIQUE BANCAIRE DE L'ETAT
La politique de l'Etat tuteur
Proposition n
o
25
Cesser les
"
recapitalisations-perfusions
" récurrentes des
établissements non viables par un changement de la doctrine
d'application de l'article 52, alinéa premier, de la loi bancaire et par
une modification du comportement de l'Etat actionnaire consistant à
envisager la liquidation ou la vente des banques publiques en difficulté.
Proposition n
o
26
Retirer du marché les
établissements qui ont bénéficié des
mécanismes de solidarité et de garantie des dépôts
(article 52 alinéa 2 et article 52-1 de la loi bancaire).
La politique de l'Etat-banquier
Proposition n
o
27
Privatiser tout le
secteur bancaire public concurrentiel.
Proposition n
o
28
Supprimer toute influence de l'Etat
sur la direction et la gestion des établissements de crédit
concurrentiel.
Proposition n
o
29
Identifier, après débat
de place, les missions de service public du crédit que l'Etat doit
conserver.
Proposition n
o
30
Gérer de façon
adéquate la fixation des taux d'intérêt administrés.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 30 octobre,
sous la
présidence
de M. Christian Poncelet,
la commission des
finances
a examiné le rapport de M. Alain Lambert, rapporteur
général, sur les propositions du groupe de travail sur la
situation et les perspectives du système bancaire français.
Après avoir remercié ses collègues
membres du
groupe de travail
pour leur participation active aux travaux de cette
instance,
M. Alain Lambert, rapporteur général
, a
rappelé que le groupe de travail avait tenu vingt-cinq auditions depuis
sa création en janvier 1996, ce qui représentait environ une
soixantaine d'heures de travail. Il a également précisé
que le groupe de travail avait jugé utile de recueillir l'avis du
Conseil de la concurrence et du Commissariat général au plan dont
les contributions ont apporté un éclairage utile sur la situation
du secteur bancaire.
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a également
rappelé la tenue, au printemps dernier, du colloque organisé par
M. Philippe Marini
sur la situation du secteur bancaire, qui a
permis de dégager d'utiles enseignements.
Il a ensuite présenté les principales conclusions du groupe de
travail.
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a tout d'abord fait
part à la commission des observations qu'appelait la situation du
secteur bancaire.
A cet égard, il a indiqué que le système bancaire venait
de traverser une crise d'une ampleur sans précédent qui,
contrairement aux apparences, n'était pas achevée. L'ampleur de
cette crise peut être appréciée, a-t-il dit, aussi bien au
travers des indicateurs d'activité (bilans des établissements de
crédit), que des indicateurs de résultat (produit net bancaire,
résultat net, coefficient de rentabilité). En 1994, a-t-il
souligné, et pour la première fois depuis que les statistiques
bancaires existent, le produit net bancaire a diminué de 7,7 %. Cette
même année, a-t-il ajouté, le résultat net de
l'ensemble des banques accusait une perte de 11 milliards de francs. Il a
reconnu que la situation s'était améliorée depuis 1995,
les principaux établissements renouant avec les profits et que l'on
pourrait en déduire, d'une part, que le pire était
désormais passé et, d'autre part, que la crise était
conjoncturelle. Il a ajouté que, malheureusement, il n'en
était rien.
Il a indiqué qu'en effet, si l'on comparait les banques
françaises à leurs concurrents internationaux, la situation
demeurait au contraire très préoccupante. Selon lui, les
établissements de crédit français, en situation de
sous-rentabilité chronique, éprouvent des difficultés
à rivaliser avec leurs concurrents étrangers. Reprenant les
exemples fournis par le Commissariat général au plan, il a
indiqué qu'avec 3,8 milliards de dollars de profit net, la Hong
Kong and Shanghai Bank of China pouvait acheter avec moins de trois ans de
profit la Société générale, avec moins de deux ans
de profit, Paribas ou la BNP et, avec moins d'un an de profit, le Crédit
Lyonnais. Il a encore indiqué que la banque britannique Barclays, qui a
réalisé presque 2 milliards de dollars de profit en 1995,
soit l'équivalent de la totalité des bénéfices des
banques françaises cette même année, se trouvait dans une
"
situation stratégique potentielle équivalente
". Si
l'évolution se poursuit dans ce sens, a-t-il souligné, on peut
nourrir de vives inquiétudes quant à la capacité des
établissements français à faire face au choc concurrentiel
qui résultera de la mise en place de la monnaie unique.
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a ensuite fait
observer que notre pays n'était pas le seul à avoir connu une
telle situation. Mais, il a ajouté que la France était le seul
pays dans lequel la crise bancaire ne s'était traduite ni par une
réduction du nombre des acteurs, ni par des licenciements significatifs,
ni même par une réduction des moyens mis en oeuvre par les
établissements de crédit.
A cet égard, il a fait observer que le nombre des banques commerciales
était passé entre 1984 et 1994, de 349 à 412, ce qui
représentait une augmentation de près de 20 % en dix ans,
que les effectifs étaient restés quasiment stables sur la
période, n'enregistrant qu'une faible baisse de 3 %, et que le nombre
des guichets était resté quasiment inchangé, avec une
diminution de seulement 1%.
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a
indiqué que, par contraste, les ajustements avaient été
d'une grande ampleur et d'une grande rapidité dans les autres pays ayant
connu une crise bancaire. Il a fait observer que dans ces pays la crise
s'était traduite par des ajustements importants, tant en termes de
nombre d'établissements bancaires qu'en termes d'effectifs, que des
banques avaient été fermées ou vendues et que l'Etat avait
bien souvent dû mettre "
la main à la poche
". Dans tous les
cas, a-t-il dit, la crise a été surmontée rapidement et
les banques étrangères ont renoué avec les
bénéfices depuis déjà quelques années.
Enfin, il a encore constaté qu'en France, tous les
établissements de crédit n'ont pas traversé la crise de la
même manière et a observé que celle-ci s'était
accompagnée d'une importante redistribution des actifs et des parts de
marché entre les différents réseaux. Selon lui, les
banques commerciales ont en effet perdu du terrain, alors que les banques
mutualistes ou coopératives ont continué d'accumuler parts de
marché et bénéfices.
A l'issue de ce constat,
M. Alain Lambert, rapporteur
général,
a posé deux questions :
- pourquoi certains établissements bancaires ont-ils mieux
traversé la crise que d'autres ?
- pourquoi les systèmes bancaires qui ont également connu une
crise, dans la période récente, se sont-ils rétablis plus
rapidement que le système français ?
En réponse à ces deux questions, il a indiqué que
l'analyse effectuée par le groupe de travail montrait que la crise du
système bancaire français était essentiellement d'origine
structurelle et que les distorsions de concurrence, même si elles
n'avaient joué qu'un rôle macro-économique mineur, avaient
conduit à une redistribution sectorielle importante des parts de
marché qui expliquait, au moins en partie, la situation
contrastée de notre système bancaire.
Puis,
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a
exposé les principales étapes du déroulement de la crise.
Il a expliqué que, dans une première étape, les
réformes des années 80 avaient libéré des
pressions concurrentielles d'une force et d'une ampleur sans
précédent.
A cet égard il a rappelé brièvement les réformes
et notamment, la banalisation, la désintermédiation et
l'internationalisation qui ont rythmé la déréglementation
du secteur bancaire.
Il a ensuite indiqué comment la concurrence s'était
manifestée sur trois fronts : interne entre les établissements de
crédit français, externe entre les établissements
français et les établissements étrangers, notamment
européens, et structurel, avec un recours sans cesse croissant au
financement par les marchés financiers.
Selon lui, cette augmentation de la pression concurrentielle sur trois fronts,
voire quatre, si l'on prend en compte l'importance du crédit
interentreprises, aurait dû provoquer l'enchaînement suivant :
l'augmentation de la concurrence aurait dû entraîner une baisse des
prix qui aurait dû s'accompagner d'une diminution des marges. Il aurait
dû s'ensuivre une réduction d'effectifs et la faillite des
concurrents les plus faibles. Le secteur se serait progressivement
restructuré par voie d'offres publiques d'achat ou de vente, de fusions
ou de reprises. Un nouveau cycle d'expansion avec des créations
d'emplois aurait pu enfin s'amorcer.
La crise du système bancaire, a-t-il indiqué, était donc
à redouter dès la mise en place des réformes ; il
s'agissait d'un phénomène naturel et prévisible tel que
l'avaient connu, par exemple, le secteur des télécommunications
ou celui des transports aériens aux Etats-Unis.
Pour
M. Alain Lambert, rapporteur général
, les
ajustements induits, en termes de réduction d'effectifs ou de
disparition des acteurs les plus faibles auraient pu intervenir de façon
relativement indolore grâce à la forte croissance de la fin des
années 1980. Mais, a-t-il fait observer, il n'en a rien
été et le processus décrit a été
enrayé au stade de la diminution des marges, en raison de blocages
d'ordre législatifs ou réglementaires.
Il a indiqué que le premier de ces blocages résidait dans le
mécanisme français de prévention des risques bancaires,
unique en son genre, qui repose presque exclusivement sur l'article 52 de la
loi bancaire et notamment son premier alinéa qui prévoit l'appel
en comblement de passif des actionnaires de référence. Ce
mécanisme, a-t-il dit, allié aux interventions
financières, aussi répétées que massives, de l'Etat
pour soutenir les banques en difficulté, s'est traduit par une certaine
forme d'immortalité bancaire. L'entrée dans le système,
a-t-il rajouté, était libre, alors que la sortie était
administrée au compte goutte ; il ne pouvait en résulter que
des surcapacités.
Il a indiqué que le second blocage résidait, notamment, dans la
réglementation de la durée du travail, issue du décret du
31 mars 1937, et dans celle relative à la tarification des
services. Ces réglementations ont introduit, selon lui, toutes sortes de
rigidités qui ont empêché les banques, à
défaut de pouvoir licencier, de s'ajuster, au moins, en faisant varier
la durée du travail ou le prix des services.
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a ensuite
décrit la troisième étape : poussées par la
concurrence et dans l'impossibilité de procéder aux ajustements
nécessaires, les banques, a-t-il dit, ont commis des erreurs de gestion
et se sont lancées dans une concurrence destructrice, qui s'est
manifestée, notamment, par des ventes à perte.
Il a fait observer que les erreurs de gestion aussi bien
stratégiques -comme la banque industrie à la
française à laquelle toutes les banques ont rêvé-
que tactiques -comme l'aveuglement collectif sur l'immobilier- ont
affecté, selon lui, aussi bien les banques publiques que les banques
privées.
Enfin,
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a fait
observer que, dans la dernière étape de ce processus, des
facteurs aggravants étaient intervenus qui ont
révélé l'ampleur de la crise.
Il a fait remarquer qu'en premier lieu, le retournement conjoncturel de 1993,
en augmentant le nombre de défaillances des PME, avait durement
affecté les banques intervenant dans ce secteur.
Il a ensuite indiqué que la politique monétaire n'avait pas
particulièrement contribué au redressement des banques :
avec une courbe des taux inversée, puis insuffisamment pentue, il a
été difficile à celles-ci de faire de la
"
transformation
", à l'instar de leurs consoeurs
américaines.
Enfin, il a fait remarquer que la fiscalité spécifique du
secteur bancaire, supportable en période d'expansion, s'était
révélée particulièrement pénalisante en
période de crise et ne contribuait pas au développement de
l'emploi dans ce secteur.
Abordant le sujet des distorsions de concurrence, qui constituent la seconde
partie de l'analyse du groupe de travail,
M. Alain Lambert, rapporteur
général,
a tenu à indiquer d'emblée que, selon
toute vraisemblance, ces distorsions n'expliquaient pas, à elles seules,
la mauvaise santé du secteur. En revanche, il a observé qu'elles
étaient réelles et avaient contribué à une
redistribution sectorielle qui, dans une situation difficile, les rendait
insupportables à ceux qui n'en bénéficiaient pas.
Selon lui, ces distorsions peuvent être rangées en trois
catégories : tout d'abord, celles liées au monopole de la
distribution de certains produits d'épargne ou de
dépôts : distribution des livrets d'épargne
défiscalisés, mais aussi collecte des dépôts des
notaires en milieu rural ; ensuite, celles liées à la nature
juridique des intervenants, ce qui renvoyait au problème du statut des
Caisses d'épargne et à celui de La Poste, et, enfin, celles
résultant de l'application discriminatoire de dispositions
législatives ou réglementaires. Il a rangé dans cette
dernière catégorie la fiscalité -application à
certaines institutions et pas à d'autres de telle ou telle taxe- et la
législation du travail, qui se traduit par un assujettissement des
banques commerciales au décret de 1937, alors que les autres
établissements de crédit n'y sont pas soumis.
Il a indiqué que, sur toutes ces questions, qui, a-t-il reconnu,
revêtent un fort contenu passionnel, le groupe de travail avait
jugé bon de recueillir l'avis de la l'institution, a priori la mieux
à même de dire le droit : le Conseil de la concurrence. Rapportant
les conclusions de cette institution, il a fait savoir à la commission
que, pour le Conseil de la concurrence, la majeure partie de ces distorsions
constituaient des "
restrictions injustifiées de concurrence
" et
seraient donc susceptibles de constituer des infractions au droit communautaire
ou national.
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a ensuite
présenté les principaux axes de réforme
préconisés par le groupe de travail.
Il a indiqué qu'il convenait, tout d'abord, de mettre fin aux
rigidités et blocages de tous ordres. Dans cette perspective, il
conviendrait, en premier lieu, d'autoriser la tarification des chèques
et la rémunération des dépôts, tout en prenant des
mesures d'accompagnement en faveur des consommateurs, notamment les titulaires
de petits comptes. Il serait souhaitable également de clarifier le
coût des missions de service public liées à la tenue des
comptes bancaires. En second lieu, il a indiqué que le groupe de travail
recommandait d'abroger le décret du 31 mars 1937 et de le remplacer
par un régime conventionnel dont la négociation devrait se faire,
selon lui, au niveau de l'Association française des
établissements de crédits.
Toujours pour mettre fin aux blocages,
M. Alain Lambert, rapporteur
général,
a déclaré qu'il convenait de
réduire les coûts de la législation consumériste et,
notamment, de se pencher sur le cas particulier des remboursements
anticipés dont il serait souhaitable de modifier le calcul de
l'indemnité de remboursement, tout en prévoyant des mesures plus
favorables qu'aujourd'hui pour les emprunteurs contraints à de tels
remboursements.
Enfin,
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a
indiqué qu'aux yeux du groupe de travail, il convenait de moderniser la
fiscalité bancaire et, notamment de réformer la taxe sur les
salaires de façon à en supprimer les effets nuisibles sur
l'emploi et d'abroger la contribution des institutions financières.
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a ensuite
indiqué que le deuxième axe de réforme
préconisé par le groupe de travail consistait à harmoniser
les conditions d'exercice du métier bancaire.
A cet égard, il a déclaré qu'il serait souhaitable de
généraliser de façon directe et complète la
distribution des livrets défiscalisés, en réservant
toutefois les appellations "
livret A
" et "
livret
bleu
"
à leurs distributeurs actuels.
Cependant,
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a
indiqué qu'il était indispensable de prendre des
précautions consistant, notamment, à définir une
échéance de cinq ans avant de réaliser la banalisation,
à envisager un commissionnement différencié selon les
réseaux et l'encours des livrets et enfin, à placer l'affectation
des ressources au logement social sous la protection du législateur.
Ces mesures supposent, a indiqué
M. Alain Lambert, rapporteur
général,
de redéfinir, au préalable, le
rôle et le statut des Caisses d'épargne et de La Poste.
A cette fin, il serait nécessaire, selon lui, d'autoriser les Caisses
d'épargne à offrir l'ensemble des services bancaires, et de
régler le problème de la propriété des Caisses
d'épargne en favorisant l'émergence d'un statut
coopératif. A ce sujet,
M. Alain Lambert, rapporteur
général,
a proposé de prévoir des
modalités de passage au statut coopératif qui intéressent
l'Etat et les collectivités locales. Il a rappelé la phrase du
ministre des finances en fonction à l'époque de la loi de 1990
selon laquelle "
les Caisses d'épargne appartiennent à la
Nation
". Il est temps, a-t-il conclu, d'en tirer les conséquences.
S'agissant de La Poste,
M. Alain Lambert, rapporteur
général,
a indiqué qu'il convenait de cantonner les
services financiers de cet établissement à leurs activités
actuelles sans toutefois les restreindre pour des raisons tenant à
l'aménagement du territoire. Il faudrait également, a-t-il dit,
identifier précisément les comptes respectifs des services du
courrier et des services financiers par une comptabilité analytique,
voire par une filialisation comme dans de nombreux Etats de l'Union
européenne. Par ailleurs, il a fait part du souhait du groupe de travail
de conduire progressivement la Poste vers une fiscalité de droit commun.
Enfin,
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a
indiqué qu'il serait souhaitable de faire de La Poste un
établissement de place pour les activités qu'elle ne
réalise pas pour compte propre, telles que l'octroi de crédit.
Toujours afin d'harmoniser les conditions d'exercice du métier
bancaire,
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a
indiqué que le groupe de travail avait considéré comme
opportun de soustraire le dépôt des notaires à la
concurrence et d'en confier la collecte au réseau du Trésor
(Trésor public, Poste, caisse des dépôts et consignations),
faute de pouvoir réunir des conditions de sécurité
satisfaisantes en cas de multiplication des dépositaires.
Enfin,
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a
déclaré qu'il fallait également envisager de poursuivre la
banalisation des crédits réglementés. Il s'agirait en
particulier d'envisager la distribution universelle des derniers crédits
réglementés, tout en ménageant les transitions
nécessaires, en distinguant, par exemple, la commercialisation de la
gestion.
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a ensuite
indiqué que le troisième et dernier axe de réforme retenu
par le groupe de travail consistait à changer la politique bancaire de
l'Etat. S'agissant du système de prévention des crises bancaires,
il a indiqué que le groupe de travail souhaitait voir cesser les
recapitalisations-perfusions récurrentes des établissements non
viables. A cet égard, il a indiqué qu'il serait souhaitable de
changer la doctrine d'utilisation de l'article 52, premier alinéa,
de la loi bancaire et de ne plus utiliser l'appel aux actionnaires de
référence de façon systématique et
privilégiée. L'Etat devrait également reconsidérer
sa doctrine de recapitalisation systématique des banques publiques et
opter plus souvent pour la fermeture ou la vente.
Dans le même ordre d'idées,
M. Alain Lambert, rapporteur
général,
a indiqué que le groupe de travail avait
estimé utile de proposer une modification de la loi bancaire afin de
sanctionner, par un retrait partiel d'agrément, les
établissements qui ont bénéficié de
mécanismes de solidarité et de garantie des dépôts
(article 52 alinéa 2 et article 52-1 de la loi bancaire).
S'agissant de la politique de l'Etat-banquier,
M. Alain Lambert,
rapporteur général,
a recommandé d'achever la
privatisation du secteur bancaire public concurrentiel. Il a également
indiqué qu'il serait souhaitable de supprimer toute influence de l'Etat
sur la direction et la gestion des établissements de crédit
concurrentiel. Par ailleurs, il a fait observer qu'il conviendrait
d'identifier, après consultation de la place, les missions de service
public du crédit que l'Etat doit conserver. Enfin, il a indiqué
que le groupe de travail avait manifesté son souhait de voir
gérer, de façon dépolitisée, les instruments aux
mains de l'Etat, tels que les taux d'intérêt administrés.
Un débat nourri s'est alors engagé auquel ont participé
MM. Joël Bourdin, Jacques Chaumont, Marc Massion, Paul Loridant,
Yann Gaillard, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Henri Torre,
Claude Belot, Philippe Adnot, Emmanuel Hamel, Philippe Marini et Christian
Poncelet, président.
M. Joël Bourdin
s'est déclaré surpris que le
rapport du groupe de travail se focalise à ce point sur les Caisses
d'épargne et La Poste.
Il a par ailleurs regretté que la part de responsabilité du
Trésor et de l'administration en général dans la crise
bancaire ne soit pas suffisamment mise en avant.
S'agissant des propositions du groupe de travail, il s'est
déclaré fermement opposé à la banalisation du
livret A. Il a considéré qu'une telle banalisation
n'était pas possible. Il s'est, en outre, déclaré
profondément déçu qu'un rapport sur les banques ne porte,
en définitive, que sur La Poste et les Caisses d'épargne.
M. Jacques Chaumont
s'est déclaré, pour l'essentiel,
favorable aux conclusions du rapport du groupe de travail. Toutefois, il a fait
valoir que la crise du secteur bancaire était avant tout la crise de la
"
nomenklatura
" formée par la haute administration des finances.
Pour lui, les inspecteurs des finances ont fini par former une
"
clique
"
qui "
s'auto-protège
". Afin de mettre fin à cette
situation, il a estimé qu'il était nécessaire d'instituer
un "
cordon sanitaire
" entre la haute administration et la
haute finance
par une réglementation plus sévère du
"
pantouflage
". Il a également fait remarquer que les banques
qui
ont le mieux réussi sont celles qui n'ont pas pour seule logique le
profit et qui sont contrôlées par leurs "adhérents" comme
les banques mutualistes.
Enfin,
M. Jacques Chaumont
a indiqué qu'il convenait de
conserver présent à l'esprit le souci de l'aménagement du
territoire. A cet égard, a-t-il dit, ou bien la Poste devient une
banque, ou bien l'Etat doit lui donner des moyens budgétaires. Mais,
a-t-il ajouté, la situation actuelle n'est pas satisfaisante.
M. Marc Massion
a interrogé le rapporteur général
sur le contenu qu'il entendait donner à la filialisation de La Poste. Il
a exprimé la crainte d'un démantèlement du service public
à la française.
M. Paul Loridant
a salué la qualité des travaux
menés par le groupe de travail. Il s'est déclaré en faveur
de l'abrogation du décret de 1937, mais à condition que cela ne
se fasse pas par "
ukase
", et en prenant en compte le dialogue
social. Il
s'est, en revanche, déclaré totalement opposé à la
modification de la loi Scrivener et au démantèlement de la
législation consumériste, notamment en ce qui concerne la
réglementation du remboursement anticipé des crédits. A
cet égard, il a déclaré que la gestion actif-passif
permettait déjà aux banques qui savent le faire de se garantir,
de façon satisfaisante, contre les demandes de renégociation des
prêts. S'agissant de la banalisation du livret A, il a
indiqué que cette évolution se traduirait par une diminution du
rôle social des Caisses d'épargne et de La Poste. Enfin, il a
déclaré que le "
métier de collecte des
dépôts
" qu'exerçait La Poste était radicalement
différent de celui de distributeur du crédit et qu'il fallait
s'attendre à de nouvelles catastrophes si on autorisait l'exploitant
public à exercer ce métier.
M. Yann Gaillard
a apporté son soutien aux travaux du groupe de
travail. Il a indiqué que la question posée était
fondamentale : existera-t-il demain un système bancaire
français capable de se projeter à l'extérieur ? Il a
souhaité qu'on ne se réfugie pas dans un "
culte de l'exception
française
". Toutefois, il a partagé l'agacement de ses
collègues quant à la responsabilité dans la crise bancaire
de la direction du Trésor, de l'inspection des finances et des
dirigeants bancaires en général. Il a en outre indiqué que
l'aspect "
contrôle des banques
" avait fait l'objet des travaux
de
la commission des finances de l'Assemblée nationale et que le groupe de
travail avait souhaité respecter cette division parlementaire du
travail. A cet égard, il a indiqué que le mécanisme de
prévention des risques bancaires n'avait été
envisagé qu'en raison de ses effets structurants sur l'économie
du secteur.
S'agissant de l'aménagement du territoire,
M. Yann Gaillard
a déclaré qu'il était nécessaire de trouver un
équilibre entre cet objectif et la nécessité d'assurer une
concurrence saine et loyale. S'adressant à M. Joël Bourdin, il
a fait observer qu'il était nécessaire de régler une fois
pour toutes la question des distorsions de concurrence mises en avant, en
partie à tort, en partie à raison, par l'Association
française des banques (AFB), il est vrai d'une manière
"
agaçante, contre productive et parfois pleurnicharde
".
Mme Maryse Bergé-Lavigne
a déclaré que si ce
rapport pouvait apparaître comme une "
machine de guerre
"
contre La
Poste, le secteur mutualiste ou les Caisses d'épargne, elle n'en
voterait pas les conclusions.
M. Henri Torre
a déclaré que l'équilibre financier
de La Poste posait un problème, mais que, dans une situation de
surbancarisation, il n'était pas sain de lui permettre de
s'équilibrer en exerçant des activités marchandes.
M. Claude Belot
a déclaré avoir été
agacé par la "
complainte
" des banquiers de l'AFB. Sa conviction
est que le problème du secteur bancaire n'est ni général,
ni structurel, et que sans la faillite du Crédit lyonnais, il n'aurait
pas été nécessaire de créer un groupe de travail.
Il a encore indiqué que le problème n'était pas de
maintenir ou de supprimer un privilège à La Poste ou aux Caisses
d'épargne et que les banques commerciales n'échapperaient pas, de
toutes façons, à la concurrence étrangère. Il a
indiqué que le seul vrai problème était celui de
l'aménagement du territoire et que la banque était un service
public. Enfin, il a fait remarquer que la suppression du privilège des
Caisses d'épargne, viderait la France d'une présence bancaire
indispensable au regard de l'impératif de l'aménagement du
territoire, sans pour autant résoudre les problèmes des banques
commerciales.
M. Philippe Marini
a souhaité rendre hommage au travail
réalisé par le président du groupe de travail,
M. Alain Lambert,
sur un chemin semé d'embûches. Il a
encore fait remarquer qu'à cet égard, il n'était
assurément pas facile de dégager une doctrine autonome de la
commission des finances dans un domaine où les groupes de pression
étaient très présents et où toute prise de position
risquait d'être mal interprétée.
Il a ensuite fait observer que poursuivre devant la justice les dirigeants de
certaines banques, aussi utile que fût cette action, ne résoudrait
pas le problème de la compétitivité de nos banques au
moment de la mise en place de l'Euro. A compter du 1
er
janvier
1999, a-t-il déclaré, la question sera de savoir comment le
système bancaire français affrontera la compétition
internationale ? Comment les banques françaises feront-elles face
aux tentatives de prise de contrôle, qui ne seront pas forcément
amicales, de la part des autres banques européennes ?
A partir du moment, a-t-il ajouté, où l'on a accepté la
monnaie unique, le problème pour l'Etat est de mettre ses entreprises en
"
ordre de bataille
". Or, a-t-il encore indiqué, c'est bien la
responsabilité de l'Etat que d'affirmer des objectifs, de définir
une stratégie et de faire prévaloir l'intérêt
général.
De ce point de vue, il s'est estimé au regret de constater que,
jusqu'à présent, l'Etat avait eu une attitude de "
Ponce
Pilate
" à l'égard du secteur bancaire. Il ne s'est pas
déclaré fâché que le rapport soit plus critique
vis-à-vis de l'attitude de la haute administration bien que ce
durcissement ne change rien à l'analyse.
S'agissant des Caisses d'épargne et de La Poste, il a souhaité
que la commission des finances fasse preuve d'une attitude valorisante et
constructive, car c'est une grande force pour la France que de disposer d'un
secteur mutualiste en bonne santé. De ce point de vue, il a
souhaité rendre un hommage appuyé aux gestionnaires des banques
mutualistes, aux "
gens prudents
" des Caisses d'épargne, à
"
l'imagination
" des gestionnaires du Crédit agricole et à
la "
pugnacité
" de La Poste. Sur ce dernier sujet, il s'est
déclaré choqué que l'absence d'une comptabilité
analytique appropriée empêche de prendre la mesure des
activités financières de l'établissement public.
Il a encore indiqué que, selon lui, ne parler que des distorsions de
concurrence relevait d'une optique malthusienne et que, de ce point de vue,
l'Association française des banques pouvait avoir une attitude aussi
malthusienne que les autres réseaux.
Il a encore indiqué que la force du Sénat était de
pouvoir inscrire sa réflexion dans le long terme, sans être
complaisant vis-à-vis de personne.
M. Maurice Blin
a rappelé que la tonalité qui
prévalait, il y a douze ans, était radicalement
différente. Il y avait à l'époque, a-t-il expliqué,
un vrai optimisme qui contrastait avec le pessimisme ambiant. Il a
indiqué que les hommes politiques qui avaient voté la loi
bancaire étaient loin d'imaginer les folies spéculatives des
banques. Il a estimé que le procès à instruire devait
être celui de l'Etat actionnaire et gestionnaire. Il a
souligné que nous étions aujourd'hui face à un secteur en
détresse et a constaté que certains dirigeants bancaires avaient
prouvé leur incapacité, voire dans certains cas leur
"
indignité
", à assumer leurs fonctions, mais que d'autres,
au contraire, avaient "
très bien travaillé
".
M. Emmanuel Hamel
a indiqué qu'il fallait éviter
d'apparaître adhérer aux thèses des banques AFB, qui
essaient de se disculper sur les autres réseaux des erreurs qu'elles ont
elles-mêmes commises.
M. Philippe Adnot
s'est déclaré convaincu qu'on ne
pouvait pas réduire les problèmes actuels du système
bancaire à l'existence de La Poste et qu'il ne pourrait pas affronter un
rapport préconisant la banalisation du livret A.
M. René Ballayer
a souhaité rendre hommage à
la qualité des travaux du groupe présidé par le rapporteur
général.
En réponse aux intervenants,
M. Alain Lambert, rapporteur
général,
s'est déclaré surpris qu'on puisse
penser que le groupe de travail ait pu relayer les préoccupations de tel
ou tel groupe de pression. Il a encore indiqué que si le Sénat et
sa commission des finances avaient bridé leurs réflexions dans la
crainte d'apparaître comme les porte-parole de l'AFB, l'analyse de la
situation et des perspectives du secteur bancaire aurait été
"
réductrice
", incomplète et, en définitive, inutile.
Il a indiqué que l'administration portait des responsabilités
incontestables dans la crise du secteur bancaire mais que pour autant,
consacrer 120 pages sur le sujet ne résoudrait en rien les
problèmes actuels. Il a souhaité que l'on se tourne plutôt
vers l'avenir.
S'agissant de l'immobilier,
M. Alain Lambert, rapporteur
général,
a reconnu que des fautes réelles avaient
été commises par les banques et qu'un certain "
panurgisme
"
existait dans le domaine.
En réponse à
M. Marc Massion
, il a indiqué
que la filialisation de La Poste, proposée par le groupe de travail,
n'avait qu'un but comptable.
En réponse à
M. Paul Loridant
, il a rappelé
le coût des remboursements anticipés et de la renégociation
des crédits : 20 milliards de francs entre 1986 et 1988,
8 milliards de francs en 1994 et 12 milliards de francs pour l'Etat
au titre des prêts d'accession à la propriété (PAP).
S'agissant de la capacité de La Poste à distribuer du
crédit, il a convenu qu'il fallait être prudent, et que le groupe
de travail ne proposait pas d'élargir les possibilités
actuellement reconnues à cet établissement.
En réponse à
Mme Maryse Bergé-Lavigne
, il a
indiqué que le rapport ne pourrait en aucun cas être
assimilé à une "
machine de guerre
" contre La Poste et les
Caisses d'épargne.
En réponse à
M. Emmanuel Hamel
, il a indiqué
que la sagesse permanente du Sénat saurait prévaloir et que les
propositions du groupe de travail étaient équilibrées, les
sénateurs sachant mieux que quiconque l'importance qu'il convenait
d'attacher à l'aménagement du territoire. Mais il a
rappelé que les propositions du groupe de travail se voulaient
tournées vers l'avenir.
La commission a alors
adopté les conclusions du groupe de travail et
décidé de les faire publier sous la forme
d'un rapport
d'information.
CONTRIBUTIONS
DE CERTAINS MEMBRES DE LA
COMMISSION
Philippe ADNOT
Sénateur de l'Aube
Membre de la Commission des finances
Président du Conseil général
--- ---
Paris, le 30 octobre 1996
Monsieur le Président,
Je vous confirme, par la présente, le soutien que j'apporte au rapport
de M. Alain LAMBERT, rapporteur général, sur les
propositions du groupe de travail sur la situation et les perspectives du
système bancaire en France.
Si je ne peux que saluer l'important travail de synthèse et de
concertation effectué, je tiens à souligner que j'ai voté
en faveur de ce texte sous réserve que figure, dans ses annexes, mon
intervention contre la banalisation du Livret A.
Je considère, en effet, que cette dernière n'est pas
nécessaire à l'équilibre financier des banques (la
meilleure preuve en est qu'en 1990 leur situation excédentaire se
situait autour de 18 milliards, soit 8 milliards de plus que leurs
homologues allemandes), équilibre qu'elles peuvent aisément
retrouver en apurant leurs comptes liés à l'immobilier et en
réduisant leurs frais de gestion.
Par contre, il est clair que si l'on prive la Poste de son principal produit,
qui crée un différentiel déterminant en sa faveur, elle
n'aura plus les moyens d'assurer convenablement sa mission en territoire
défavorisé ainsi que son rôle social, ce qui serait
dramatique en termes d'aménagement du territoire.
Je souhaite donc que soit bien portée en annexe du rapport ma prise de
position, et, vous en remerciant par avance,
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de
mes sentiments les plus distingués et dévoués.
Philippe ADNOT
Monsieur Christian PONCELET
Sénateur des Vosges
Président de la commission des finances
PALAIS DU LUXEMBOURG
Joël BOURDIN
Sénateur de l'Eure
---
---
Paris, le 31 octobre 1996
Le rapport, dont je n'ai malheureusement eu qu'une présentation orale,
en séance de commission, pour autant qu'il soit bien charpenté et
ait été l'objet d'un intense travail auquel je rends hommage,
recueille néanmoins un vote défavorable de ma part qui tient
à la doctrine qu'il sous-entend, à la méthode qui
l'oriente, et à la spécificité de ses conclusions.
La doctrine qui l'inspire est celle d'un libéralisme originel tel
qu'ont pu l'imaginer les penseurs anglo-saxons du siècle passé.
La volonté d'établir une concurrence pure et parfaite transpire.
Alors que personnellement je ne suis pas un adversaire du libéralisme,
j'observe :
1. Que le système bancaire français ne s'est, historiquement,
jamais épanoui dans un cadre concurrentiel parfait et qu'il a même
été très performant, dans les années 60 et 70,
alors même qu'il bénéficiait d'une garantie publique
avérée ;
2. Que l'évolution d'un système économique vers plus
de concurrence fait toujours le lit des entreprises les plus puissantes ;
3. Que le système bancaire français fragilisé, en
raison des propres erreurs de gestion de ses dirigeants, ne résisterait
pas à un degré supplémentaire de libéralisme, en
laissant le champ libre aux grandes banques étrangères.
En clair, profiter d'une période d'affaiblissement de nos banques afin
de les soumettre à une plus vive concurrence ne me paraît pas
opportun.
Quant à la méthode d'analyse choisie, elle consiste à
privilégier une approche comptable sur une recherche des causes de
l'évolution récente et peu encourageante de notre système
bancaire.
La crise des établissements bancaires et financiers n'était pas
inscrite dans un destin inéluctable. Il n'y a pas eu de fatalité
dans cette affaire.
Le système n'était pas mauvais en soi : il a été
dévoyé par des hommes, des équipes d'hommes.
Or, d'une certaine manière, j'ai l'impression que la philosophie du
rapport tient en ces quelques mots : des équipes d'hommes, n'ont pas su
gérer le système bancaire, il est donc urgent de changer le
système.
Je ne suis pas d'accord avec cette orientation, même si des retouches
doivent être apportées au mode de fonctionnement de nos banques.
Tant qu'on n'aura pas compris et admis que c'est le mode de désignation
des dirigeants de nombreuses banques, les processus décisionnels
utilisés, et le système de contrôle mis en oeuvre qui sont
en cause dans ce domaine, on n'aura pas cheminé réellement vers
l'étape opérationnelle qui nous permettra d'améliorer le
dispositif.
Une étude plus approfondie des causes aurait sans doute permis
d'infléchir l'éventail des propositions sur cet aspect certes
délicat mais incontournable du mode de désignation des
élites bancaires.
On comprendra dès lors que j'exprime ma surprise en constatant que dans
les orientations proposées on privilégie des mesures
contraignantes pour les banques mutualistes, les Caisses d'épargne et la
Poste.
Voilà des établissements bancaires originaux, qui ont une
vocation sociale ; qui participent activement à l'aménagement du
territoire en maintenant des agences dans nos campagnes et dans des quartiers
difficiles, en dépit parfois de leur rentabilité ; qui de tout
temps ont comblé les lacunes du système bancaire classique ; qui
ne se sont pas laissés entraîner par la folie spéculative
à laquelle ont succombé de grandes banques ; qui ont
continué, vaille que vaille, leur expansion quand d'autres sombraient
dans le déficit. Ô surprise, la grande réforme
institutionnelle proposée pour corriger les dérives du
système bancaire classique concerne ces modestes établissements.
Manifestement nous bénéficions là d'une version
financière moderne de la célèbre fable de La Fontaine "Les
animaux malades de la Peste".
C'est au titre des distorsions de concurrence qu'est proposée la
banalisation des livrets A et Bleu. Or, à cet égard, j'ai
plusieurs observations à faire :
1. Quelle est l'incidence des distorsions de concurrence dues au
Livret A et Bleu sur les difficultés ou la disparition de quelques
banques (Crédit Lyonnais, SMC, BTP, Hervet etc. ?). Est-on sûr que
la thérapie proposée est adaptée au mal bancaire
français ? Comme le disait Bernard Esambert, Président de la
banque Arjil, le 3 septembre à l'AGEFI "à les écouter
(les banques françaises) les difficultés sont dues, dans une
large mesure, à un phénomène de distorsion de concurrence.
Il faudrait qu'elles balayent un peu devant leurs portes".
2. Le livret A et le livret Bleu occupent une place de plus en plus
modeste dans les encours d'épargne des ménages, qui
désormais sont placés sur des produits distribués par
l'ensemble des banques (CODEVI, LEP, Livret Jeunes, Épargne Logement,
Assurance vie...). Si le livret A pour les Caisses d'épargne et la Poste
et le livret Bleu pour le Crédit Mutuel sont essentiels à leur
image, leur banalisation n'entraînerait qu'une infime influence sur la
rentabilité des banques commerciales.
3. La distribution des livrets A et Bleu par le canal des bureaux de
Poste, des agences de Caisse d'Épargne et du Crédit Mutuel
relève de la politique d'aménagement du territoire, laquelle
demeure une priorité du Gouvernement.
Qu'il y ait nécessité de modifier les statuts des Caisses
d'Épargne, certainement. Mais franchement ce n'est pas un enjeu
approprié à la crise que subit notre système bancaire. On
ne traite pas un phénomène en réglant un
épiphénomène. J'ai, en fait, la désagréable
impression d'un dispositif peu adapté à la réalité,
l'étendue, la gravité et la spécificité du mal
bancaire français.
Notre système bancaire est comme un cancéreux affligé
d'un rhume des foins. On peut toujours lui recommander de se moucher, cela lui
donnera sans doute passagèrement satisfaction, on ne l'aura pas
guéri pour autant.
Joël BOURDIN
Sénateur de l'Eure
Jacques CHAUMONT
Sénateur de la Sarthe
---
---
Paris, le 31 octobre 1996
En 1990, le bénéfice net global cumulé des cinq
principaux groupes bancaires français était de
18,5 milliards de francs. Ce résultat était obtenu dans des
conditions de concurrence avec les banques mutualistes et coopératives,
la Poste et la Caisse d'Épargne, identiques aux conditions actuelles.
Cela suffit à réduire à néant les analyses de
l'AFB sur les causes de l'actuelle crise bancaire.
Cette crise n'a touché que les banques AFB. Aussi, est-il
étonnant que ces banques offrent comme explication à leurs
déboires non leur goût immodéré pour la
spéculation immobilière mais les supposés
privilèges des autres organismes bancaires. Ces privilèges, si
privilège il y a, existaient en 1990.
L'AFB s'honorait en reconnaissant les prodigieuses erreurs de gestion commises
par quelques-uns des membres les plus prestigieux de cette Association.
En fait, cette crise bancaire n'est qu'un des aspects visibles de la crise de
la nomenklatura française. Le problème posé est de
protéger la société française et le contribuable
contre cette nomenklatura.
Ceci appelle quelques solutions simples :
1. Les dirigeants des banques
doivent à l'avenir être
des banquiers de profession, ayant une longue expérience de la banque et
non des nomenklaturistes venus d'ailleurs. Ceci implique :
a) La stricte application des règles sur le pantouflage et, en
particulier, l'interdiction à un fonctionnaire d'entrer dans une
entreprise qu'il a pour mission de contrôler avant une période de
cinq ans après l'achèvement de cette mission.
b) En raison des relations "
incestueuses
"
127(
*
)
entre pantouflant, pantouflé, pantouflard,
pré-pantouflard et post-pantouflard, le contrôle des banques ne
peut plus être exercé par ceux qui en ont actuellement la charge.
Cette mission pourrait être confiée aux Magistrats de la Cour des
Comptes, juridiction qui est un des trésors de nos institutions.
2. Le secteur coopératif et mutualiste
n'a pas connu de
crise. Il serait judicieux de favoriser plus encore son développement.
Ses millions de sociétaires répartis dans des milliers de
caisses locales exercent un contrôle permanent sur les dirigeants de
caisses locales, régionales et nationale. Le principe de
solidarité interne est, du reste, une forte incitation au contrôle.
Ces structures proches de la base sous-tendent, par ailleurs, une conception
de l'Homme et de la Société qu'il convient de préserver.
3. Les Caisses d'épargne
ont augmenté leurs
bénéfices et leurs effectifs. Il convient donc de maintenir ce
réseau et le privilège du livret A, mais en imposant aux
Caisses d'épargne l'obligation de maintenir un réseau dense de
guichets de proximité.
Si les Caisses d'épargne réduisaient leur réseau, il est
clair que la banalisation du livret A devrait devenir la règle.
4. La Poste
L'engagement solennel pris par le Président de la République de
conserver le caractère spécifique de la Poste, agent de
l'aménagement du territoire, implique la poursuite des activités
financières de la Poste dans leur cadre actuel.
Conclusion
: La crise bancaire ne peut être
réglée en affaiblissant les banques qui n'ont pas commis
d'erreurs de gestion.
Celles des banques AFB qui ont été mal gérées
auraient dû payer leurs erreurs. Tel n'est pas le cas.
Mais il convient que de tels errements ne se reproduisent plus. La solution la
plus juste, la plus équitable et la plus salutaire est de confier
désormais la gestion des banques à des banquiers.
Jacques CHAUMONT
Sénateur de la Sarthe
Philippe MARINI
Sénateur de l'Oise
Maire de
Compiègne
--- ---
Paris, le 31 octobre 1996
Je souscris totalement aux orientations et conclusions de ce rapport,
où l'on s'est efforcé de développer une approche
équilibrée et réaliste du devenir de notre système
bancaire et financier. Au sein de celui-ci, les groupes d'assurance mutualiste
ou coopérative ont pris une place croissante, en raison tout à la
fois de l'efficacité de leurs implantations, du dynamisme de leur
gestion, mais aussi des pertes de fonds propres constatées par les
banques commerciales.
L'un des problèmes les plus cruciaux, aujourd'hui, est de savoir tirer
parti, au bénéfice de l'ensemble du secteur financier, des
résultats ainsi acquis. L'évolution du Crédit Agricole
montre que cette voie est possible et fructueuse. La question est de savoir si
ce modèle peut être suivi, à bref délai, par
l'institution des Caisses d'épargne.
A l'occasion des réflexions récentes sur le devenir du groupe
CIC, j'ai eu l'opportunité de développer quelques idées
sur la nécessaire réforme des Caisses d'épargne. Je crois
utile de les joindre, à titre de document de travail, assurément
très imparfait, au rapport excellemment conçu et
présenté par M. Alain Lambert.
RÉFORME DES CAISSES D'ÉPARGNE
ET
RESTRUCTURATION
DE L'APPAREIL BANCAIRE FRANÇAIS
I - LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME
Grâce à la loi de 1983, qui a ouvert leurs instances vers
l'extérieur, grâce à l'extension, grâce à la
restructuration très profonde du réseau conduite en 1991, les
caisses d'épargne ont considérablement amélioré
leur productivité, sont devenues un acteur significatif en
matière de distribution de produits d'épargne autres que le
livret A, auprès d'une très large clientèle populaire, ont
fait preuve d'un réel dynamisme commercial, et constituent aujourd'hui
un groupe aux assises solides, doté de près de 60 milliards
de francs de fonds propres. Cette situation suscite des jalousies, de la part
de ceux qui estiment que la situation présente résulte
essentiellement des distorsions de concurrence créées par l'Etat,
ainsi que des caractères propres du réseau des caisses
d'épargne, dont les fonds propres sont en auto-contrôle, et ne
subissent aucune contrainte de rémunération. Mais le vrai enjeu
n'est pas à mes yeux celui-là. Il est de savoir quelles doivent
être les orientations stratégiques et les ambitions de ce groupe
financier, dont l'image est excellente auprès de la population, et qui a
les moyens d'une réelle croissance externe.
Aujourd'hui les caisses d'épargne ont des forces, que je viens de
rappeler, mais aussi des faiblesses ;
- il est vrai que leur situation juridique nécessite une
clarification, car elles n'appartiennent ni au monde capitaliste, ni au monde
mutualiste ;
- le réseau ne dispose pas de l'instance stratégique qui lui
est indispensable, car son centre national demeure essentiellement un organe de
tutelle administrative et de surveillance, tandis que la caisse centrale, dont
il a depuis peu la majorité, vit encore en symbiose très
étroite avec la caisse des dépôts ;
- l'assainissement du paysage bancaire français impose à
l'évidence un décloisonnement des circuits d'épargne, et
donc une banalisation du livret A, perspective à la fois
nécessaire et troublante pour les caisses d'épargne, si elle
remet en cause les ressorts de leur profitabilité.
Pour résoudre ces problèmes, une loi est indispensable, en ce
qui concerne le mode d'appropriation des fonds propres, mais elle doit
être accompagnée de la définition claire d'un cadre
stratégique valant engagement contractuel de l'Etat, lequel a le devoir,
à maints titres, d'intervenir : en tant que régulateur du
système financier, mais aussi en tant que responsable de la politique
économique, et encore en tant que propriétaire de la caisse des
dépôts ou actionnaire de plusieurs entreprises demeurées
jusqu'ici publiques.
II - L'OPPORTUNITÉ DE CETTE RÉFORME
Celle-ci, à mon avis, est double :
- d'un côté, la compétitivité du système
bancaire français est une question majeure et les mauvais
résultats, comme la mauvaise image des banques, portent préjudice
à l'emploi, à l'investissement des entreprises et plus
généralement à la prise de risques économiques dans
notre pays ; il est impératif de changer les comportements et de
redynamiser tout ce secteur ;
- d'autre part, l'Etat doit résoudre, à bref délai,
la question de la privatisation du groupe CIC, les offres des repreneurs
éventuels étant attendues pour le tout début de juillet ;
or, il existe aujourd'hui un risque tout à fait réel pour le GAN,
et donc pour l'Etat, de ne pas obtenir le prix escompté, tout en devant
accepter, selon les formules étudiées, soit une prise de
contrôle du groupe CIC par une institution financière
étrangère, soit une forte perte de substance des banques
régionales qui constituent ce groupe.
En effet, le prix de vente du CIC, s'il n'atteint pas la valeur comptable de
celui-ci dans les comptes consolidés du GAN, provoquera une perte de
quelques milliards de francs, au préjudice de ce dernier, et sera un
handicap supplémentaire pour la privatisation du GAN.
Paradoxalement, en raison de la détention partielle du contrôle
du CIC par la société GAN-vie, et au niveau des comptes sociaux
de celle-ci, un profit significatif sera enregistré par les
assurés, et viendra par conséquent accroître la perte pour
l'Etat...
Si l'opération de cession du CIC se fait au profit d'une banque
commerciale existante, la Société Générale ou la
BNP par exemple, les réseaux étant le plus souvent en concurrence
directe, une réduction importante des effectifs et des moyens
s'ensuivra, et l'on assistera donc à une conséquence
étonnante : la quasi disparition d'un groupe bancaire dont la
rentabilité est redevenue correcte (du fait de l'Etat), alors que le
même Etat réalise dans le même temps des efforts très
onéreux pour maintenir artificiellement en survie des institutions
financières qui demeurent fortement déficitaires en exploitation,
telles que le Crédit Lyonnais, le CEPME ou la Société
Marseillaise de Crédit...
Bien sûr, et avant d'envisager une acquisition par la caisse centrale
des caisses d'épargne du contrôle du réseau CIC, il faut
savoir répondre à deux questions essentielles :
1. Existe-t-il une réelle complémentarité de fonds de
commerce entre le CIC et les caisses d'épargne ?
2. Les caisses d'épargne sont-elles capables, et dans quelles
conditions, de gérer une telle mutation ?
Sur le premier point, l'analyse montre :
- qu'il est opportun, dans l'intérêt de l'économie, de
"brancher" un réseau régional de banques dont la part de
marché est significative en matière de crédit aux
entreprises, sur l'un des réseaux français les plus puissants de
collecte de ressources auprès des particuliers ;
- que, d'un côté comme de l'autre, l'identité
régionale est forte ;
- que des partages de marchés peuvent intervenir à certaines
rectifications de frontières près, entre les banques
régionales du réseau CIC et les caisses d'épargne
correspondantes ;
- que leurs forces conjuguées s'avèreront extrêmement
efficaces en matière de distribution de produits d'épargne, et en
particulier d'assurance-vie et de gestion de capitaux à long terme.
En ce qui concerne le second aspect, il est clair que trois préalables
devront être levés :
- la redéfinition de la nature juridique des caisses les conduisant
progressivement à rémunérer leurs fonds propres à
des conditions normales ;
- leur adaptation économique, là encore progressive, et sur
quelques années, à la perspective de banalisation du livret A ;
- la création d'un organe stratégique central qui soit aux
caisses d'épargne ce qu'est aujourd'hui aux caisses régionales de
crédit agricole la CNCA.
III - LE CONTENU DE LA RÉFORME SOUHAITABLE
Je pars du principe qu'une telle réforme doit valoriser et mobiliser
les caisses d'épargne. Je constate également que celles-ci ont
une image très spécifique et très positive dans la
population et qu'il importe avant tout de la préserver et de la mettre
en valeur. Je formule deux axes de propositions :
- En premier lieu, une fraction, représentant par exemple un
montant global de l'ordre de 15 milliards de francs, des fonds propres des
différentes caisses d'épargne, serait répartie sous forme
de parts sociales, entre les mains des déposants ; en assemblée
générale, et selon le principe mutualiste, chaque déposant
ne disposerait, quel que soit le montant de ses avoirs, que d'une seule voix ;
ces parts sociales seraient dans un premier temps échangeables entre les
sociétaires au sein de l'ensemble du réseau, ce qui ferait
apparaître progressivement une certaine valeur de marché des
caisses ; la rémunération de ces capitaux serait formée de
deux éléments, une part fixe en pourcentage de la valeur nominale
et un intérêt variable selon le résultat ; à moyen
terme, la rémunération variable progresserait par rapport
à la rémunération fixe.
- En second lieu, les instances centrales du réseau seraient
renouvelées, dès la promulgation de la loi, et la caisse centrale
prendrait immédiatement ou progressivement, selon le choix du
Gouvernement et les contraintes en la matière, son indépendance
stratégique et technique, par rapport à la caisse des
dépôts et consignations ; en cas de prise de contrôle du
réseau du CIC, la caisse centrale deviendrait la maison mère de
deux ensembles, les caisses d'épargne d'un côté, et les
banques régionales du CIC de l'autre, chacune de ces entités
conservant sa personnalité propre ; enfin on veillerait à
composer les instances de la caisse centrale de manière à ce que
les deux réseaux puissent bien être représentés, et
surtout de façon à susciter une bonne compréhension
mutuelle et un enrichissement de l'un par l'autre.
Tels sont les aspects à traiter par la loi et, simultanément
à celle-ci et de manière indissociable, un "contrat" serait
passé avec l'Etat, et réglerait les aspects suivants :
- l'objectif de banalisation du livret A, à terme de cinq ans par
exemple, serait affirmé ;
- en contrepartie, les caisses d'épargne réaliseraient
l'acquisition du CIC auprès du GAN, à la valeur comptable du CIC
dans les comptes consolidés du GAN ;
- pendant la période de transition qui nous sépare de la
banalisation complète du livret A, la rémunération des
fonds propres des caisses d'épargne progresserait de manière
à atteindre un taux de marché ; cette évolution pourrait
se faire à la fois par l'accroissement de la part variable visée
ci-dessus, et par la distribution aux déposants de fonds propres
supplémentaires par rapport aux 15 milliards de francs
évoqués à titre d'exemple plus haut.
Ainsi, on verrait émerger un groupe financier qui, au terme de la
période transitoire, serait totalement immergé dans la
compétition internationale, et qui deviendrait un pôle essentiel
du système financier français.
IV - LES EFFETS À ATTENDRE DE LA RÉFORME
Il est aisé de les prévoir :
- les déposants des caisses d'épargne, c'est-à-dire
30 millions de titulaires de livrets, seraient associés au
développement du nouveau groupe, ce qui serait peut-être de nature
à changer l'image aujourd'hui ingrate et défavorable du
système bancaire dans la population, et ce qui créerait de
racines régionales profondes, tant pour les caisses d'épargne que
pour les banques du réseau CIC ;
- le GAN pourrait être privatisé à bref délai,
à condition bien entendu que soit arbitrée la question de la
distribution d'assurance vie par les deux réseaux (il serait à
mon avis préférable de mettre en place pour l'ensemble caisses
d'épargne et CIC un accord de distribution de produits du GAN, la caisse
nationale de prévoyance gardant de son côté des liens
identiques avec le réseau de la Poste) ;
- la question lancinante des distorsions de concurrence dans le
système bancaire français serait enfin réglée par
l'affirmation d'une volonté claire de l'Etat, et les querelles
franco-françaises en ce domaine prendraient fin ; enfin et surtout,
l'émergence du groupe caisses d'épargne-CIC aurait un effet
structurant sur l'ensemble du système financier français et
entraînerait des réactions en chaîne dans le sens de
l'assainissement et de la rationalisation de ce dernier.
En quelque sorte, il est proposé ici de mettre en oeuvre une
réforme qui aurait sur le secteur financier des conséquences
assez analogues à celles qui vont être engendrées par la
restructuration des industries de défense en ce qui concerne de larges
pans de notre économie productive.
Philippe MARINI
Vice Président de la
Commission
des Finances
du Sénat
Groupe Socialiste
--- ---
Paris, le 4 novembre 1996
OBSERVATIONS PRESENTÉES PAR MME MARYSE
BERGÉ-LAVIGNE, MM. JEAN-PIERRE MASSERET ET ALAIN RICHARD POUR LE GROUPE
SOCIALISTE
______
Les membres socialistes du groupe de travail entendent
préciser leur désaccord sur l'analyse des causes de la crise
bancaire et sur les propositions qui sont présentées dans le
rapport du groupe de travail.
Si beaucoup de banques françaises AFB sont, aujourd'hui, dans une
situation difficile, ce n'est pas par des mesures visant à fragiliser
les réseaux mutualistes, coopératifs et les caisses
d'épargne que les réponses utiles seront trouvées.
Les difficultés des banques AFB ont pour partie une explication dans
l'atonie de l'économie française étouffée par les
choix politiques des gouvernements de droite. A ces considérations de
politique générale s'ajoutent des erreurs de choix
stratégique opérées, notamment, dans l'immobilier.
La distorsion de concurrence entre banques AFB et réseaux mutualistes,
coopératifs et les caisses d'épargne ne saurait expliquer les
difficultés de l'industrie bancaire française, dès lors
que ces distorsions jouent dans les deux sens.
Si la restructuration du système bancaire est nécessaire, et
personne ne le conteste, la réussite de cette réforme ne peut se
faire au détriment de certains de ses acteurs qui doivent conserver
leurs spécificités. Le système bancaire français
doit rester multiforme. C'est dans ce cadre que les réformes
susceptibles d'améliorer sa compétitivité doivent
être réfléchies, engagées et réussies.
A cet égard, les choix de sortie de crise proposés par le
rapport sont critiquables :
- En premier lieu, le rapport pousse à une
déréglementation du travail impliquant une régression de
grande ampleur de la situation des salariés et une perte de protection
pour les consommateurs.
Revenir sur des éléments-clés du droit du travail serait
grave pour la situation des salariés. Si l'on estime que le
décret de 1937 relatif aux horaires de travail est pénalisant
pour les entreprises, il est nécessaire de mener une négociation
préalable à sa révision. La méthode
proposée, c'est à dire l'abrogation de ce décret, rendra
impossible la réalisation d'un accord équilibré,
satisfaisant pour tous.
Par ailleurs, il est anormal de contester le droit du consommateur à
rembourser son prêt par anticipation, sans indemnité. Ce droit,
qui est la contrepartie du taux fixe et de la différence évidente
d'expertise entre les co-contractants, n'est guère susceptible d'abus.
- Le rapport recommande, en outre, une banalisation injustifiée de
certains produits spécifiques, en particulier le livret A.
Les fonds collectés sur ce livret sont essentiels puisqu'ils permettent
le financement du logement social. La baisse de taux, décidée par
le gouvernement, a entraîné sur ce produit, en 1996, une
décollecte de 80 milliards de francs, dangereuse pour le logement
social. L'extension du livret A aux banques AFB risquerait
d'accroître cette tendance. En effet, dans le but d'améliorer leur
rentabilité, elles inciteraient leurs nouveaux clients à
transférer leurs fonds du livret A vers d'autres produits sur lesquels
leur marge est plus élevée. Donc, même avec une affectation
obligée au logement social, le livret A banalisé ne serait sans
doute plus en mesure d'assurer l'équilibre de ce secteur.
En outre, si le rapport se prononce, à juste titre, pour le maintien
des activités financières de la Poste, la banalisation du livret
A entraînerait assurément une baisse de son volume
d'activité et remettrait en question son réseau, dans les zones
rurales et les quartiers en difficulté, d'où les banques
commerciales sont absentes. La banalisation aurait également des
incidences néfastes pour la politique d'aménagement du territoire
et viendrait contredire les engagements du gouvernement en la matière.
- Enfin, si la préconisation d'un compte distinct pour les
activités financières de la Poste peut être retenue,
l'idée de la filialisation ne peut s'analyser que comme une étape
vers la privatisation et le démantèlement des réseaux. Le
rapport se prononce en effet, en principe, en faveur de la privatisation
intégrale du réseau bancaire. Les membres socialistes du groupe
de travail, soucieux d'améliorer l'efficacité de l'Etat
actionnaire, ne tirent pas des privatisations passées, la conclusion que
l'actionnariat privé garantit des résultats supérieurs et
restent fortement attachés à la notion de service public et
d'intérêt général.
Conforter la situation de certains acteurs du monde bancaire, en en
pénalisant d'autres, faire porter le poids des restructurations sur les
salariés et les clients, notamment les plus modestes, ne constitue pas
une approche constructive et saine pour aborder les problèmes
posés. Ce n'est pas dans cette optique que se situent les socialistes.
Maryse Bergé-Lavigne
Sénateur de la
Haute-Garonne
Jean-Pierre Masseret
Sénateur de la Moselle
Alain Richard
Sénateur du Val d'Oise
COMMISSION DES FINANCES
Paul LORIDANT
Sénateur de l'Essonne
--- ---
Paris, le 4 novembre 1996
Le secteur bancaire français est incontestablement dans une situation
difficile et le présent rapport de la commission des finances du
Sénat a le mérite d'en faire l'analyse. Toutefois, je ne saurais
en partager toutes les conclusions et préconisations.
Je partage l'idée qu'il faudrait aujourd'hui revoir le décret de
1937 sur l'amplitude horaire du travail des salariés des banques AFB.
Toutefois, j'insiste sur le fait que dans ce domaine, la négociation
s'impose entre les partenaires sociaux. La voie a été ouverte
dans ce domaine par différents établissements bancaires. Je
considère que les évolutions en ce domaine dépendent pour
l'essentiel de la qualité du dialogue social.
La banalisation de la distribution du livret A et du livret bleu
préconisée dans le rapport me laisse perplexe. Le livret jeunes,
récemment mis au point par les pouvoirs publics, a montré que les
banques AFB n'ont su tirer profit de façon significative de sa
banalisation dans la distribution de ce produit d'épargne. Les emplois
adossés au livret A sont essentiellement tournés vers le
financement du logement social dont les besoins sont plus que jamais
nécessaires. Il me paraît impensable de revenir sur cet usage
privilégié des fonds collectés par ce livret. Au
demeurant, les dérives constatées dans un précédent
rapport de la commission des finances du Sénat (rapport Arthuis, Marini,
Loridant) sur l'usage des fonds CODEVI renforcent mes réticences
à la banalisation préconisée. Je considère que le
maintien des modes de distribution du livret A devrait avoir pour
contrepartie une obligation de présence des Caisses d'épargne et
de la Poste dans les zones rurales ou urbaines peu prisées par le
secteur bancaire. Les exemples abondent de retraits de guichets dans des villes
de banlieue jugées "difficiles" ou dans des "pays" atteints
par une
certaine désertification. A mes yeux, cette présence
relève d'une mission de service public dont la France n'a pas à
rougir.
Cette position me conduit à préconiser la consolidation des
services financiers de la Poste dont le rôle essentiel est de collecter
de l'épargne, métier qu'elle sait bien exercer. En revanche, je
suis plus circonspect sur l'opportunité de distribution de
crédits par les mêmes services, sauf à créer une
banque postale soumise aux mêmes obligations légales et
réglementaires que le reste du système bancaire. C'est en effet
une activité à hauts risques qui requiert un strict
contrôle des pouvoirs publics et une technicité certaine.
Enfin, je ne partage absolument pas l'orientation du présent rapport
sénatorial concernant la remise en cause de la "loi Scrivener"
permettant aux particuliers de rembourser de façon anticipée les
prêts souscrits. Curieusement, les banques, si soucieuses de
bénéficier de conditions banalisées de concurrence,
supportent mal d'être ainsi soumises à cette règle,
à l'initiative des souscripteurs d'emprunts. Il me paraît
contraire à l'évolution consumériste de notre
société que de limiter le droit à remboursement
anticipé moyennant paiement d'une indemnité légale au plus
à 3 % du capital restant dû. En ce domaine, ne faut-il pas
considérer que la France est en avance par rapport aux autres pays de
l'Union économique et monétaire ? Est-ce vraiment
insupportable de donner, de fait, la possibilité aux consommateurs de
renégocier les conditions de leurs prêts ? J'y vois
plutôt un élément d'équilibre dans les rapports
entre les banques et leurs clients. De plus, il faut tenir compte de
l'émergence depuis une dizaine d'années, dans le bilan des
banques, de ce qu'on appelle la gestion "actif-passif" qui permet aux
établissements de travailler en permanence la structure de leurs
ressources, de faire des arbitrages en fonction de la structure de leurs
emplois. A titre d'exemple, à quoi aurait-il alors servi d'introduire la
technique de la "titrisation" dans le système bancaire
français ?
En conclusion, je tiens à souligner l'excellent esprit d'équipe
qui a animé ce groupe de travail sénatorial... même si,
à l'évidence, il reste des points de désaccord.
Paul Loridant,
Sénateur de l'Essonne
1
Rapport d'information de
l'Assemblée nationale n° 2940.
2
Rapport de la Commission bancaire pour l'année 1994, p.
115 et suivantes.
3
Analyses comparatives établies par la Commission bancaire,
1994 vol 2 p. 17
4
Les séries statistiques calculées avant 1993
n'intégraient pas dans le poste provisions, les "intérêts
sur créances douteuses" qui étaient comptabilisés dans les
produits accessoires. Si l'on effectue un retraitement des données 93 et
94 on obtient respectivement les chiffres de 112,7 et 101,2 milliards.
5
Ce dernier chiffre serait encore plus important si on tenait
compte du changement de méthodologie comptable intervenu en 1993.
6
Les données qui suivent ont été extraites des
études et analyses de la Commission bancaire, lesquelles portent sur les
résultats sur base consolidée des cinq principaux groupes
bancaires de huit pays. Elles ont été complétées
par des statistiques établies par l'agence de notation Standard &
Poor's.
7
Voir le Quotidien
"Les Échos",
vendredi 11
octobre
1996 p. 19
8
"Why French banks need a shake-out" ; Euromoney Mardi
1
er
octobre 1996.
9
Le Building Society Act de 1986, modifié en 1988, a
étendu la gamme des services financiers que pouvaient offrir ces
sociétés. L'une des principales Building Societies, Abbey
National, est devenue en 1987 une clearing bank et la 4eme banque britannique.
10
Selon le classement établi par le magazine
américain Business Week
11
Voir Hervé de Carmoy, la Banque du XXI
ème
siècle, chapitre 2.
12
L'Allemagne n'a pas eu à "décloisonner" puisque
son modèle de "banque universelle", qui existe quasiment depuis
l'origine du système, ignorait les cloisonnements. En revanche, ce pays
accuse un certain retard en matière de "désintermédiation".
13
Il est assez révélateur que lors de sa
déclaration de politique générale à
l'Assemblée nationale, le 8 juillet 1981, M. Pierre Mauroy
présentait la nationalisation des banques comme le moyen de parachever
la grande réforme du système, initiée à la
Libération.
14
Bons du Trésor négociables, billets de
trésorerie, certificats de dépôt, bons des institutions
financières spécialisées, bons des sociétés
financières.
15
Voir "présentation du rapport annuel de la commission
bancaire" document en annexe à l'audition de M. Jean-Claude Trichet,
gouverneur de la Banque de France.
16
Article premier de la loi bancaire : "Les établissements
de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de
profession habituelle des opérations de banque. Les opérations de
banque comprennent la réception de fonds du public, les
opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition
de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement".
17
Article 15 de la loi bancaire : "Avant d'exercer leur
activité, les établissements de crédit doivent obtenir
l'agrément délivré par le Comité des
établissements de crédit".
18
Article 18 point 1 de la loi bancaire : "Les banques peuvent
effectuer toutes les opérations de banque". De même, "les banques
mutualistes ou coopératives, les caisses d'épargne et de
prévoyance et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer
toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui
résultent des textes législatifs et réglementaires qui les
régissent". Seules les sociétés financières "ne
peuvent effectuer que des opérations de banque résultant soit de
la décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont propres".
19
L'article 5 de la loi bancaire range les activités
financières comme la gestion, le placement, le conseil,
l'ingénierie financière parmi les "opérations connexes"
à l'activité de banque.
20
La libéralisation des investissements français
à l'étranger s'est faite progressivement par voie de circulaire
entre 1987 et 1988 (circulaire du 21 mai 1987 relative aux investissements
directs français à l'étranger et étrangers en
France); la libération des mouvements de change a été
effectuée par les décrets n° 89-938 du 29 décembre
1989 et n° 91-270 du 13 mars 1991.
21
On pourrait même dire quatre si on prend en
considération l'importance que revêt en France le crédit
interentreprises. En 1992, son encours total atteignait 2.288 milliards de
francs, soit deux fois plus que le total des prêts à court terme
consentis aux entreprises par les établissements de crédit (1.105
milliards de francs).
22
La concurrence dans le secteur bancaire porte avant tout sur les
prix, c'est à dire sur les taux d'intérêt pour les
opérations de crédit, sur les commissions pour les
opérations de marché.
23
Voir rapport en annexe p. 86.
24
M. Jean-Yves Haberer dans la défense de sa gestion du
Crédit Lyonnais a toujours expliqué qu'il ne s'agissait pas pour
lui "d'ajouter de la crise à la crise" et que sa gestion avait permis
de
sauver plusieurs milliers d'emplois.
25
Voir sur ce point l'ouvrage d'Elie Cohen : "la tentation
hexagonale. La souveraineté à l'épreuve de la
mondialisation" et l'article qui lui est consacré par Airy Routier dans
le Nouvel Observateur du 19 septembre 1996 : "Pourquoi le modèle
français s'épuise...".
26
Voir l'étude réalisée par la Correspondance
économique du 10 avril 1995 sur la base d'une note interne de la
Commission bancaire : "éléments internationaux de comparaison des
origines et des traitements des crises bancaires majeures". Voir
également The Economist en date du 25 mars 1995, article traduit et
rapporté dans le rapport moral sur l'argent dans le monde 1996 :
"Pardon, Monsieur le Gouverneur, pourriez vous nous dépanner d'un
milliard ?".
27
La crise des caisses d'épargne américaines
pourrait également illustrer ce problème. En 1982, ces
institutions auraient pu être sauvées pour un coût total de
20 milliards de dollars. Les autorités de tutelle, encouragés par
les hommes politiques qui militèrent pour la sauvegarde de
l'épargne publique, les aidèrent à rester à flot,
les transformant en ce que Ed Kane, économiste au Boston College,
appelle des "banques zombies". Ces institutions
"mort-vivantes"
faussèrent le reste du marché en offrant des taux
d'intérêt plus hauts sur les dépôts et plus bas sur
les crédits que ceux offerts par le marché. Par un effet de
contagion, les autres institutions devinrent également des zombies.
Quand le renflouement de l'entier secteur fut rendu nécessaire, le
coût total s'éleva à 132 milliards de dollars. Il faudrait
rajouter à cela les 12 milliards de dollars que les banques commerciales
américaines devront apporter au financement du fonds de garantie des
caisses d'épargne. En contrepartie, le statut des caisses
d'épargne américaines sera aligné sur celui des banques.
Par ailleurs, le sauvetage de la Continental Illinois, une banque commerciale
américaine ayant subi en 1984, les conséquences
désastreuses d'un mouvement de retrait des dépôt, a fait
également l'objet de critiques de la part des économistes
américains.
28
Les banques étant créancières les unes des
autres, quand une banque de premier ordre disparaît, elle est susceptible
d'entraîner une cascade de défaillances se répercutant
à l'ensemble du système. Même en supposant que cela ne se
produise pas, cette disparition est susceptible d'avoir des effets
dévastateurs sur l'économie réelle : les autres banques
s'efforçant de faire face aux pertes, hésitent à consentir
de nouveaux crédits, ce qui se traduit par une contraction de l'offre de
crédit ou
credit crunch.
C'est précisément ce qui
est arrivé dans les années 30. Entre 1930 et 1933, 9.000 banques
américaines ont fait faillite. En Europe, la faillite de la
Creditanstalt
, la plus grande banque autrichienne, a
entraîné des faillites en chaîne. Cela s'est traduit par une
contraction de l'offre de crédits qui a conduit à la "
grande
dépression
".
29
C'est depuis Adam Smith que le risque systémique
inhérent au système bancaire a été mis en
évidence. Dans son ouvrage "Recherches sur la nature et les causes de la
richesse des nations", il établit une analogie entre le besoin
qu'éprouvent les pouvoirs publics de violer l'espace naturel de
liberté des banques en réglementant leurs activités, et la
nécessité d'inciter les voisins à édifier des
barrières mitoyennes pour éviter qu'un éventuel incendie
ne gagne l'ensemble de la communauté d'habitants.
30
"The domino effect - A survey of international
banking" - The
Economist - 17 avril 1996, 44 pages.
31
Article cité p. 21
32
Rapport d'information n° 2940 précité d'une
mission d'information présidée par M. Philippe Auberger.
33
Voir néanmoins auditions en annexe et, notamment, celle
de M. Viénot ; lire également l'article du Nouvel Economiste du
26 juillet 1996 ; entretien avec M. François Schlumberger : "Certaines
banques ne devraient plus exister".
34
Le Comité de Bâle se compose des autorités
monétaires des pays suivants : Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis,
France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
35
De nombreuses règles prudentielle ont été
mises en oeuvre pour prévenir les risques systémiques. On
relèvera : le ratio européen de solvabilité (1989), le
contrôle de la division des risques (ou directive "grands risques" -
1992), la surveillance des opérations de marché (directive
"adéquation des fonds propres" - 1993), le renforcement de la
surveillance prudentielle (directive "post-BCCI" - 1995). D'autres
sujets (voir
sur ce point le rapport 1995 de la Commission bancaire) sont en discussion : la
prévention des risques liés aux produits dérivés,
le risque congloméral (risque inhérent aux groupes financiers
regroupant banques-assurances - entreprises d'investissement).
36
Voir le rapport pour 1995 de la Commission bancaire.
37
Propos rapportés par le quotidien "La Tribune", dans
son
édition du 1er octobre 1996 p. 20.
38
On rappelle que : l'alinéa premier de cet article
prévoit que le gouverneur de la Banque de France peut "
inviter
"
les actionnaires ou sociétaires d'un établissement de
crédit à fournir à celui-ci le soutien qui lui est
nécessaire. C'est l'appel en comblement de passif aux actionnaires de
référence. L'alinéa second prévoit quant à
lui, que le Gouverneur peut également "
organiser le concours
"
de
l'ensemble des établissements de crédit "
en vue de prendre
les mesures nécessaires à la protection des intérêts
des déposants et des tiers, au bon fonctionnement du système
bancaire ainsi qu'à la préservation du renom de la place
".
C'est l'appel à la solidarité de place.
39
Selon Olivier Pastré ("Le système bancaire
français". Revue d'économie financière n° 27 hiver 97
p. 243) : "la France a résolument joué la carte de la
"sécurité de place" organisée par les Pouvoirs publics
plutôt que celle de la codification de règles de garantie,
individuelle (et/ou collective), codification qui débouche
nécessairement sur la mise en avant du rôle de "prêteur en
dernier ressort". Cette stratégie correspond, me semble-t-il au
"génie financier français
".
Dans un pays dont la structure
financière est de nature oligopolistique, la gestion des crises au cas
par cas paraît la solution la plus réaliste et la moins
coûteuse. La présence d'investisseurs institutionnels, trop peu
nombreux pour que la concurrence ne se double pas de la coopération,
donne à ce schéma toute sa cohérence ; une fois de plus la
France se montre moins administrative en matière financière que
les Etats-Unis".
40
Avis n° 42 annexé au procès-verbal de la
séance du 27 octobre 1983 p. 37.
41
Rapport d'information précité p. 36 et 37.
42
Revue de Standard & Poor's : BankRatings Services mai 1996,
Robert Scott Bugie et Elisabeth Grandin
43
Le premier alinéa de cet article dispose que : "tout
établissement de crédit agréé en France
adhère à un système de garantie destiné à
indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs
dépôts ou autres fonds remboursables. Toutefois, les
établissements affiliés à l'un des organes centraux
mentionnés à l'article 20 sont réputés satisfaire
à l'obligation de garantie dans les conditions prévues au
troisième alinéa du présent article." Son dernier
alinéa dispose que : "le comité de la réglementation
bancaire arrête, par des décisions soumises à
l'homologation du ministre chargé de l'économie et
publiées au Journal officiel de la République française,
la liste des systèmes de garantie répondant aux conditions qui
résultent du présent article et des systèmes reconnus
équivalents".
44
Voir, notamment, Blanche Sousi-Roubi : "La directive sur la
garantie des dépôts et son application en France : à la
recherche d'une cohérence avec l'article 52 de la loi bancaire" ; Actes
du colloque sur "l'épargne française à l'heure de
l'Europe" Cinquièmes rencontres parlementaires organisées par M.
Philippe Auberger, p. 34 et suivantes.
45
Voir sur ce point Blanche Sousi-Roubi, article
précité.
46
Voir rapport précité de M. Philippe Auberger - Le
contrôle des banques et la protection des déposants - pages 32
à 39 et 47 à 58.
47
Voir article de Carole Pitras dans la "Banque des
particuliers"
septembre 1996 : "Les systèmes de garantie des dépôts
toujours en attente d'une homologation".
48
Olivier Pastré, rapport sur la modernisation des banques
françaises p. 215
49
Olivier Pastré, article précité p. 264.
50
Entretien accordé à la revue Euromoney, mardi
1
er
octobre 1996.
51
Article 2, 2ème alinéa :
"L'organisation du travail par relais ou par roulement est interdite."
52
Cet accord comporte deux volets principaux. Le premier
prévoit l'ouverture de certaines agences (au maximum 25 % des points de
vente) dans la plage 8 h - 19 h, avec deux équipes en relais pour
assurer une présence de 6 h 30 à 22 heures. Les contreparties
offertes aux salariés concernés reprennent, pour l'essentiel, les
dispositions de la "charte sociale" de l'AFB. Ainsi, l'exercice d'une
activité avant 8 heures et après 18 heures entraîne une
réduction du temps de travail de 50 % à salaire inchangé.
Plus innovant, le second volet de l'accord porte sur le travail par roulement,
notamment pour garantir l'ouverture d'une agence six jours sur sept (avec deux
jours de repos consécutifs, dont le dimanche). Dans ce cadre, la
direction propose le passage de la durée du travail hebdomadaire
à 37 heures sur quatre jours, sans réduction de salaire. Ces
mesures devraient se traduire, selon la direction de la banque, par la
création de 150 emplois à temps plein supplémentaires dans
le réseau.
53
"Article 2.- La rémunération des comptes
à vue est interdite."
54
Voir, notamment, sur ce point les actes du Séminaire
organisé par le centre interprofessionnel de recherches en droit
bancaire à Lyon, le 31 mars 1994 : "les dates de valeur ont-elles un
avenir ?"
55
Cette étude a été reprise dans la revue
"Problèmes économiques" n° 2.478 du 26 juin 1996, p. 26 et
suivantes.
56
Centre d'information sur l'épargne et le crédit
(groupe Paribas).
57
Deux jugements récents de la High Court britannique
viennent de confirmer que la jurisprudence britannique n'admet que très
restrictivement la qualification d'un établissement financier.
D'après Lord Justice Millett : "Aussi longtemps qu'il ne réalise
rien d'anormal, ne cherche pas à imposer à son client un
comportement particulier en échange du crédit octroyé et
lui laisse en définitive sa liberté commerciale, le banquier ne
peut se voir qualifier de dirigeant de fait. Une banque ne peut voir sa
responsabilité civile engagée, sauf dans le cas extrême
où la décision de poursuite ou de cessation d'activé
relève de son seul bon vouloir". Antoine Adeline, "Responsabilité
civile du banquier dispensateur du crédit ; le droit anglais", in Revue
Banque, septembre 1996.
58
Cour de cassation 10 janvier 1995 : Sarl Invitance c/ Sté
Crédit du Nord
59
20 milliards de francs entre 1986 et 1988 et
8 milliards de francs en 1994 selon la Compagnie bancaire et le professeur
Mouillart. Les remboursements anticipés ont également
coûté très cher à l'Etat, s'agissant des prêts
d'accession à la propriété (PAP) octroyés au
début des années 80 et renégociés en 1985 et 1986.
60
Cf. examen en commission et les contributions en
annexe
61
Les Ambiguïtés de lEtat actionnaire. Jean Arthuis,
Claude Belot, Philippe Marini. Rapport d'information n° 591. 1993-1994.
62
Voir article d'Eric Leser Quotidien "Le Monde" du 19
octobre
1995.
63
Verbatim 1.
64
Olivier Pastré, op. cité p. 245. Parlant du
contrôle des risques ce professeur déclare : "La route est encore
longue qui sépare l'ensemble des autorités de contrôle
d'une connaissance fine des nouveaux métiers bancaires. Dans ce domaine,
la solution passe d'abord et avant tout par la formation et aussi
peut-être par une certaine "porosité" entre le métier de
banquier et celui de fonctionnaire. Gageons que ce défi est à la
portée des Pouvoirs publics, si ceux-ci le veulent vraiment".
65
Nazanine Ravaï, article paru dans l'édition du 15
mai 1996, "Banques publiques : un terrible fiasco".
66
Patrick Artus, revue "étude" de la Caisse des
dépôts et consignations, n° 96-07 du 19 avril 1996 : "comment
expliquer les difficultés des banques françaises".
67
Olivier Pastré "le système bancaire
français : bilan et perspectives" ; Revue d'économie
financière n ° 27, hiver 1993 p. 251. On observera que, sur le cas
des SDR, cette analyse est tout à fait convergente avec l'analyse
effectuée par la Commission des finances du Sénat (rapport
d'information n° 44 "Les paradoxes du développement régional
: le cas des SDR" MM. Jean Arthuis, Philippe Marini et Paul Loridant,
octobre
1994.
68
Rapport reproduit en annexe, p. 63
69
Risque et financements bancaires des PME. Bertrand Larrera de
Morel.
70
Voir "présentation du rapport annuel de la commission
bancaire" document en annexe à l'audition de M. Jean-Claude Trichet,
gouverneur de la Banque de France.
71
Patrick Artus : "expliquer les difficultés des banques
françaises" Revue "étude" de la Caisse des dépôts et
consignations n° 96-07 du 19 avril 1996.
72
Jean-Paul Betbèze, "Banques : la leçon
américaine" article publiè dans "La tribune de La Tribune" avril
1996.
73
On rappelle que jusqu'en 1988, les banques étaient
également assujetties à la taxe sur les encours, instituée
en 1979, en remplacement de la taxe sur les activités bancaires et
financières.
74
4,25 % jusqu'à 40.010 F, 8,50 % de 40.010 F à
79.970 F, et 13,60 % pour la partie de la rémunération
supérieure à ce seuil.
75
Cette taxe a été instaurée par l'article 4
de la loi de finances rectificative du 28 juin 1982, puis
pérennisée par l'article 21 de la loi de finances pour 1985
(n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
76
On rappelle que l'avis du Conseil de la concurrence,
établi à la demande de la Commission des finances du
Sénat, est intégralement reproduit en annexe.
77
L'arrêté du 25 août 1972 a
précisé qu'étaient seuls habilités à
recevoir les fonds confiés aux notaires par leurs clients depuis moins
de trois mois : la Caisse des dépôts et consignations, le service
des chèques postaux et les caisses régionales de crédit
agricole "pour ce qui concerne les fonds détenus par les notaires
nommés à des résidences situées dans les communes
de moins de 30.000 habitants, à l'exception des communes dont la
population est comprise entre 5.001 et 30.000 habitants et qui font partie
d'agglomérations de plus de 50.000 habitants ou dans les zones de
rénovation rurale et d'économie de montagne, à l'exclusion
des agglomérations de plus de 50.000 habitants. Un nouvel
arrêté du 7 juin 1973 a étendu aux caisses du Crédit
agricole, l'habilitation initialement accordée aux caisses
régionales de cet établissement.
78
Le Conseil rappelle à cet égard les objectifs
affichés par M. René Pleven, alors garde des sceaux :
"l'arrêté du 25 août 1972 s'inscrit dans la ligne des
mesures prises par la Chancellerie pour renforcer le contrôle et la
gestion des études notariales (...). Il est évident que la
concentration des fonds notariaux dans un nombre limité d'organismes
financiers facilitera beaucoup le fonctionnement des inspections de
comptabilité."
79
La récente décision du Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement du
24 octobre dernier, vient de lever toute ambiguïté sur ce point
puisque, contrairement, aux objections formulées par l'AFB, il a reconnu
la capacité juridique des caisses d'épargne d'acquérir une
banque commerciale, en l'occurence, la banque Laydernier.
80
Les Caisses d'épargne ne l'étaient pas non plus
jusqu'en 1992, et le Crédit agricole, jusqu'en 1982. La Poste a en
également été exonérée jusqu'en 1991.
81
Les Caisses d'épargne et les caisses de crédit
municipal en ont été exonérées jusqu'en 1992.
82
Par crainte d'une délocalisation de l'épargne
liquide, la France avait adopté en 1989 une législation
exonérant d'impôt les OPCVM de capitalisation investis en titres
de taux (loi de finances pour 1990). En période de taux
d'intérêt élevés notre système bancaire a
ensuite traîné comme un boulet cette prime donnée à
une épargne liquide et sûre.
83
Le Conseil national du crédit a observé que,
de 1980 à 1994, les banques avaient réussi à diviser par
deux le coût de traitement des chèques en termes réels,
mais que le chèque restait un moyen de paiement plus coûteux que
les autres. Depuis 1987, l'utilisation du chèque diminue, mais encore
très faiblement (-0,15 % en 1994, année de "forte"
diminution). Elle représente encore 50 % des paiements.
84
Une des méthodes que les banques avaient
utilisée afin de compenser le coût des tenues de compte
était l'utilisation des dates de valeur à des fins de
rémunération lors des mouvements de liquidités en
espèces et par chèque. Un arrêt de la chambre commerciale
de la Cour de cassation du 6 avril 1993 a prohibé cette pratique
pour les espèces.
85
Ces formules consistent en des prélèvements sur les
comptes-courants, à date fixe, ou au-delà d'une certaine somme,
au profit de placements rémunérés.
86
"Application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de
quarante
heures dans les banques et tous les établissements de finance, de
crédit et de change, ainsi qu'aux entreprises d'assurances de toute
nature et aux sociétés d'épargne."
87
Les négociations au sein de la commission nationale
paritaire AFB/syndicats progressent lentement. La réunion du vendredi 20
septembre s'est traduite par un échec. Celle du jeudi 10 octobre s'est
achevée sur un constat mitigé, un désaccord persistant sur
la durée du travail.
88
Voir à ce sujet l'intéressante analyse du
Centre d'information sur l'épargne et le crédit - Bulletin
n° 193 - juillet 1996.
89
N° C 291/15, citant l'arrêt "Säger" du
25 juillet 1991. Ce projet de communication interprétative de la
deuxième directive fait actuellement l'objet d'une consultation dans
toute l'Union et a donné lieu à une grande audition à
Bruxelles le 18 septembre dernier.
90
Directive n° 86-102 du 22 décembre 1986 relative au
rapprochement des dispositions législatives réglementaires et
administratives des Etats membres en matière de crédit à
la consommation.
91
Rapport du président du comité consultatif -
29 février 1996.
92
Cette décision fut prise à une époque
où le livret A montrait des difficultés pour assurer cette
mission. Voir le rapport "Financement du Logement", dit "rapport
Lebègue" de juillet 1991.
93
On peut rappeler que la création du livret bleu en 1958
répondait à un souci similaire vis-à-vis du Crédit
mutuel
94
."Les Codevi : Une nécessaire remise en ordre" - Paul
Loridant, Philippe Marini-Sénat n°298, 1994-1995.
95
Le taux du prêt locatif intermédiaire (PLI),
financé sur LEP, n'a diminué que de 0,5 point (de 6,5 à
6,0 %) alors que le taux du LEP baissait de 0,75 point (5,50 à 4,75 %).
Tout en étant "tiré", le taux du PLI reste trop
élevé.
96
De décembre à mars 1996, dans les caisses
d'épargne (Poste + Ecureuil), l'encours du livret A a
régressé de 22,4 milliards de francs; celui du livret
d'épargne populaire a progressé de 24,7 milliards de francs
(contre 12,5 dans les autres banques, Crédit agricole compris). A
la fin de juillet 1996, la Poste et l'Ecureuil détenaient 57 %
des parts de marché du livret jeune. (Source : Banque de France).
97
L'utilité pour les épargnants est
négligeable. Un titulaire de livret jeune au plafond de 10.000 francs ne
gagne après un an d'épargne que 100 francs de plus qu'un
titulaire de livret A!
98
C'est ce délai qui a été retenu dans la loi
de finances pour 1996 pour l'assujettissement des SACI à l'impôt
sur les sociétés et à la taxe professionnelle.
99
Ces chiffres sont donnés à titre d'exemple et
mériteraient un calcul plus approfondi.
100
Article 9 - III. de la loi de finances rectificative pour
1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975) : "III. - La
moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux
mentionnés au I. ci-dessus doit être affectée à des
emplois d'intérêt général."
101
Conseil de la concurrence page 20.
102
Elle ne semble pas non plus avoir de portée juridique,
selon le professeur G.Knaub, cité par A.Moster, président de la
caisse d'épargne d'Alsace. "la restructuration du système
bancaire. L'enjeu pour les Caisses d'épargne" p.31
103
Interview de M. René Barberye au journal "Le
Monde"
du 9 octobre - "La Tribune" du même jour fait état d'un
rapport du CENCEP sur le sujet - "Les Echos" en dévoile les
détails dans son numéro du 21 octobre.
104
Des évolutions de ce type ont eu lieu au Royaume-Uni, au
Danemark, en Italie. En Italie, la loi d'Amato de 1990 a séparé
les Caisses d'épargne en fondations d'un côté et en
entité bancaire ordinaire de l'autre (voir CENCEP, études
prospectives n° 29 - mai 1993).
105
Dans son intervention en séance publique au
Sénat, sur le projet de loi réformant le statut de La Poste en
1990, M. Jean Arthuis avait mis en garde contre le développement
des services financiers (JO Débats n° 335 (CR) du mercredi
6 juin 1990 - page 1275). La commission des finances, par la voie de son
rapporteur, Henri Torre était elle-même très
réservée - page 1260.
106
60.000 selon la Poste. La commission bancaire observe que
70.000 agents exercent à la fois des fonctions postales et de
services financiers.
107
Le rapport d'information n° 2555 du 22 janvier 1991 (A.N.
1991-1992) du député Jean-Pierre FOURRE, au nom de la commission
de la production et des échanges, réfute un à un tous les
arguments défavorables au développement des services financiers,
et notamment ceux du rapport du secrétaire général du
Conseil national du crédit Yves Ullmo qui était réticent
à ce développement.
108
Le contrat de plan prévoit que les services
financiers de la Poste, qui ont vocation à évoluer dans une
logique concurrentielle, doivent consolider leur part de marché globale,
développer leurs produits d'exploitation, équilibrer leur gestion.
109
Les bureaux réalisent 30 milliards de francs
de chiffre d'affaires (sur un total de 80 milliards de francs pour
l'ensemble de la Poste).
110
Bulletin des commissions de l'Assemblée nationale
n° 25 page 2679.
111
Voir avis n° 96-A-10 du Conseil de la
concurrence du 25 juin 1996. BOCCRF du 3 septembre 1996 - page 450.
112
Le gouverneur de la Banque de France, dans une lettre
à l'AFEC en date du 18 juillet 1995, puis le directeur du Trésor,
devant l'ASF le 20 juin 1996 ont attiré l'attention des
établissements sur les risques de la vente à perte.
113
Décret n° 79-889 du 16 octobre 1979
relatif à l'organisation administrative en milieu rural et à la
création de services postaux polyvalents.
114
Voir réponse de M. Franck Borotra au député
Gérard Jeffray. Assemblée nationale, 1ère séance du
mardi 8 octobre 1996.
115
Avis précité, page 455.
116
Ainsi, la loi de finances pour 1996 a prévu de
soumettre progressivement les SACI à l'impôt sur les
sociétés et à la taxe professionnelle. Les SICOMI et SII
ont été progressivement soumises à l'IS à partir de
1991. La Poste elle-même a été soumise à l'IS et
à la taxe sur les salaires par la loi de 1991.
117
Avec le CCF, Indosuez, le Crédit national, le
Crédit foncier, la Société générale, chacun
sur un produit de placement.
118
V. rapport n° 270 - Sénat - Annexe au
Procès-verbal de la séance du 13 mars 1996 - Alain Lambert - pp.
236 et 237
119
Voir à ce sujet le dossier précité : "The
domino effect - A survey of international banking" - The Economist - 17
avril
1996.
120
Formule empruntée à l'ouvrage de M. Hervé
de Carmoy, "La banque du XXI
ème
siècle" dans lequel
l'auteur défend l'idée de la "banque-dividende", c'est à
dire l'idée d'un nouveau modèle bancaire aux antipodes des
institutions bureaucratiques gérées comme des administrations.
121
Voir Rapport de M. Philippe Auberger précité, p.
45.
122
Voir Rapport de M. Philippe Auberger précité, p.
47.
123
Les contraintes de ratio de solvabilité peuvent conduire
un établissement ayant une marge d'intermédiation convenable
à cesser ses activités faute de fonds propres. Une
recapitalisation peut alors se justifier.
124
Rapport d'information précité : "Les
ambiguités de l'Etat actionnaire" -- page : 31.
125
On pourrait objecter que l'Etat, pour la gestion de sa dette et
de son patrimoine a besoin de relations étroites avec le système
financier. Mais rien n'interdit de mener ces relations sur une base
contractuelle pour les prestations de service dont l'Etat a besoin. Cela
n'affaiblira pas non plus la tutelle qui s'exerce par la voie de la loi, du
règlement et du contrôle. Ce dernier sera mieux exercé en
l'absence de tout conflit d'intérêt.
126
Le groupe de travail rappelle que votre commission avait
justifié l'existence des sociétés de développement
régional précisément par une mission - le financement en
fonds propres et à long terme des PME - que le système bancaire
traditionnel n'était pas prêt à remplir, et comme
établissement de place- "Les paradoxes du développement
régional" - Sénat n° 44 (94-95) - Jean Arthuis, Paul
Loridant, Philippe Marini.
127
Georges Soros dans le Figaro du 29 octobre 1996







