Pour une République territoriale : l'unité dans la diversité
MERCIER (Michel)
RAPPORT D'INFORMATION 447 tome 1 (1999-2000) - MISSION COMMUNE D'INFORMATION
Rapport au format Acrobat ( 2016 Ko )Table des matières
-
MOTION ADOPTÉE
PAR LA MISSION D'INFORMATION - INTRODUCTION
-
PREMIÈRE PARTIE
LA DÉCENTRALISATION ET L'EFFICACITÉ
DE L'ACTION PUBLIQUE -
CHAPITRE PREMIER
LE CONTEXTE : UNE RÉFORME EFFICACE ET ADAPTÉE
AUX NOUVEAUX DÉFIS SOCIAUX- I. LA DÉCENTRALISATION : UNE REDISTRIBUTION DES POUVOIRS AU SERVICE DE L'EFFICACITE DE L'ACTION PUBLIQUE
- II. L'AFFIRMATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES COMME DES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE PREMIER PLAN
- III. DE NOUVEAUX DÉFIS POUR L'ACTION PUBLIQUE
-
CHAPITRE II
LA COMPLEXITÉ DU PAYSAGE INSTITUTIONNEL
DE LA DÉCENTRALISATION-
I. L'ÉTAT : UN ACTEUR ESSENTIEL QUI N'A PAS
ENCORE INTÉGRÉ LA LOGIQUE DE LA DÉCENTRALISATION
- A. LE RÔLE AMBIGU DE L'ÉTAT : CONTRÔLEUR ET ACTEUR DE LA VIE LOCALE
-
B. UN ÉTAT QUI N'A PAS ADAPTÉ SON
ORGANISATION À LA DÉCENTRALISATION
- 1. Le bilan mitigé des partages de services
- 2. La déconcentration et la restructuration des administrations territoriales de l'état sont toujours en chantier
-
II. UNE ORGANISATION TERRITORIALE EN DEVENIR
-
A. LES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES :
L'ABSENCE D'UN MODÈLE UNIQUE
- 1. Décentralisation et évolution du modèle fédéral
- 2. Décentralisation et mutation de l'État unitaire
- 3. Régionalisation et décentralisation
- 4. La " dévolution " au Royaume-Uni
- 5. L'Espagne : l'État des autonomies
- 6. L'Italie : en route pour une autonomie toujours plus grande des régions
- 7. La permanence du modèle allemand
- B. UNE NOUVELLE DONNE POUR L'ORGANISATION TERRITORIALE : LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'INTERCOMMUNALITÉ DE PROJET
- C. DES FACTEURS DE COMPLEXITE POUR L'ORGANISATION TERRITORIALE
- D. LES SPÉCIFICITÉS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
-
A. LES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES :
L'ABSENCE D'UN MODÈLE UNIQUE
-
I. L'ÉTAT : UN ACTEUR ESSENTIEL QUI N'A PAS
ENCORE INTÉGRÉ LA LOGIQUE DE LA DÉCENTRALISATION
-
CHAPITRE III
LE CADRE DE L'EXERCICE DES COMPÉTENCES LOCALES :
DES BLOCS DE COMPÉTENCES À LA COGESTION- I. UNE LOGIQUE INITIALE DÉVOYÉE
-
II. UNE LOGIQUE CONTRACTUELLE INÉGALITAIRE
-
A. L'IMPORTANCE CROISSANTE DES TECHNIQUES
CONTRACTUELLES
- 1. Les contrats de plan Etat-régions : une enveloppe financière considérable en partie seulement prise en charge par l'Etat
- 2. Les contrats de ville ou la tentative de rationalisation d'une politique foisonnante
- 3. Les contrats locaux de sécurité : un outil perfectible
- 4. Les autres contrats : quelle cohérence globale et quelle place pour les collectivités territoriales ?
- B. LA RUPTURE DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES CONTRACTANTS
-
A. L'IMPORTANCE CROISSANTE DES TECHNIQUES
CONTRACTUELLES
-
CHAPITRE IV
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
L'ETAT ÉLABORE DES RÈGLES INADAPTÉES DONT IL NE SUPPORTE PAS LES CONSÉQUENCES- I. UNE CONSTRUCTION STATUTAIRE LABORIEUSE QUI N'A PAS SUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
-
II. DES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET
RÉGLEMENTAIRES INADAPTÉES ET RIGIDES
- A. DES PROCÉDURES TRÈS LOURDES
- B. DES INSTITUTIONS QUI ONT MONTRÉ LEURS LIMITES
- C. LES RÉMUNÉRATIONS SONT CONTRAINTES AU NOM DU PRINCIPE DE PARITÉ
- D. LE RECRUTEMENT DE CONTRACTUELS EST FORTEMENT ENCADRÉ
- E. L'INADÉQUATION DES STATUTS PARTICULIERS AUX NOUVEAUX BESOINS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
- F. LE CAS PARTICULIER DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
- III. LES INCERTITUDES QUANT AU VOLUME DE L'EMPLOI PUBLIC TERRITORIAL
-
CHAPITRE V
UN SYSTÈME DE FINANCEMENT
QUI NE GARANTIT PAS L'AUTONOMIE LOCALE- I. LA NOUVELLE DONNE DE LA DÉCENTRALISATION
-
II. LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE
CHARGES : THÉORIE ET PRATIQUE
- A. LES PRINCIPES DE LA COMPENSATION
- B. LES AMBIGUÏTÉS D'UN SYSTÈME COMPLIQUÉ
- C. L'ALOURDISSEMENT DES CHARGES NON COMPENSÉES : UN RISQUE POUR LES BUDGETS LOCAUX
- III. LE DÉMANTÈLEMENT DE LA FISCALITÉ LOCALE
-
IV. LES COLLECTIVITÉS LOCALES, VARIABLE
D'AJUSTEMENT DU BUDGET DE L'ETAT
- A. L'ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES CONCOURS DE L'ÉTAT
- B. L'ENVELOPPE NORMÉE : UN " RENDEZ-VOUS MANQUÉ "
- V. LA PÉRÉQUATION EN PANNE
- VI. UN ÉTRANGE MOUVEMENT DE RECENTRALISATION DES FINANCES LOCALES
-
CHAPITRE VI
UN BILAN SECTORIEL-
I. L'AIDE SOCIALE
- A. L'ALTÉRATION PROGRESSIVE DU PRINCIPE DES " BLOCS DE COMPÉTENCE "
- B. LA DÉCENTRALISATION A PERMIS UNE AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE PUBLIQUE DANS LE DOMAINE SOCIAL
- II. LA FORMATION PROFESSIONNELLE
- III. LA SÉCURITÉ
-
IV. L'ÉDUCATION
-
A. LE PARTAGE DES COMPÉTENCES
- 1. L'organisation institutionnelle
- 2. L'organisation financière
- 3. La prise en charge par les collectivites de leurs nouvelles competences.
- B. UN BILAN SATISFAISANT MALGRÉ DES INSUFFISANCES
- C. LA QUESTION DES TRANSPORTS SCOLAIRES
- D. LA PARTICIPATION DES RÉGIONS AU FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
-
A. LE PARTAGE DES COMPÉTENCES
-
V. LA CULTURE
- A. L'INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES A PRIS SON ESSOR AVANT LA DÉCENTRALISATION
- B. LES PRINCIPES RETENUS PAR LES LOIS DE DÉCENTRALISATION
- C. LES FAITS : DYNAMISME ET EFFICACITE DE L'ACTION CULTURELLE DES COLLECTIVITES LOCALES, RETICENCE DE L'ETAT
-
VI. LE SPORT
- A. AVANT LA DÉCENTRALISATION : DÉJÀ UN TERRAIN DE CHOIX POUR L'INITIATIVE LOCALE
- B. LES LOIS DE DÉCENTRALISATION ET LA LOI " SPORT " : LES SILENCES DU LÉGISLATEUR SUR LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
- C. UN DYNAMISME QUI CONFIRME LA PRÉPONDERANCE DES COMMUNES
- D. DES DYSFONCTIONNEMENTS QUI HANDICAPENT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LE DOMAINE DU SPORT
-
VII. LES INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
- A. LA SITUATION ANTÉRIEURE À 1982 : UN CADRE JURISPRUDENTIEL RESTRICTIF
- B. LES LOIS DE DÉCENTRALISATION : PRINCIPES ET LIMITES
- C. LE DISPOSITIF RÉSULTANT DE LA NOUVELLE LÉGISLATION
- D. LE BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF
- E. UN CADRE JURIDIQUE EN DÉCALAGE AVEC LA RÉALITÉ
-
I. L'AIDE SOCIALE
- DEUXIÈME PARTIE
- LES PROPOSITIONS DE LA MISSION D'INFORMATION : POUR UNE RÉPUBLIQUE TERRITORIALE
-
CHAPITRE I
UNE ORGANISATION INSTITUTIONNELLE PLUS EFFICACE-
I. POUR UN ÉTAT TERRITORIAL ADAPTÉ
À LA DÉCENTRALISATION
- A. UN ÉTAT RECENTRÉ SUR SES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
- B. RÉNOVER LA FONCTION DE CONTRÔLE
- C. CHANGER L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT
- D. UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA DÉCONCENTRATION
-
II. ACCOMPAGNER LES MUTATIONS DE L'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE LOCALE
- A. POURSUIVRE LE RENFORCEMENT DE L'INTERCOMMUNALITE SANS REMETTRE EN CAUSE L'IDENTITE COMMUNALE
- B. PROMOUVOIR UNE DOUBLE EXIGENCE D'EFFICACITÉ ET DE SIMPLIFICATION
- C. RENFORCER LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
-
I. POUR UN ÉTAT TERRITORIAL ADAPTÉ
À LA DÉCENTRALISATION
-
CHAPITRE II
DES COMPÉTENCES CLARIFIÉES ET RENFORCÉES-
I. UN PRÉALABLE : UNE AMÉLIORATION DU
CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER D'EXERCICE DES COMPÉTENCES
- A. DES PRINCIPES MIEUX AFFIRMÉS POUR L'EXERCICE DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES
- B. DE NOUVELLES RÈGLES DU JEU POUR L'EXERCICE EN PARTENARIAT DE COMPÉTENCES PARTAGÉES
- C. DES MOYENS INSTITUTIONNELS RENFORCÉS
-
II. UNE RÉPARTITION PLUS RATIONNELLE DES
COMPÉTENCES AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ DE L'ACTION PUBLIQUE
- A. L'ÉDUCATION : TRANSFÉRER LA RESPONSABILITÉ DES BÂTIMENTS UNIVERSITAIRES AUX RÉGIONS
- B. LA FORMATION PROFESSIONNELLE : RENFORCER LA COMPÉTENCE DES RÉGIONS
- C. L'ÉQUIPEMENT : CONFIER AU DÉPARTEMENT L'ENTRETIEN DES ROUTES NATIONALES
- D. L'ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE : DÉMÊLER L'ÉCHEVEAU DES COMPÉTENCES PARTAGÉES ENTRE L'ETAT ET LE DÉPARTEMENT
- E. LA CULTURE : MIEUX ORDONNER UN PAYSAGE CONFUS
- F. LA SÉCURITÉ : OUVRIR DROIT À L'EXPÉRIMENTATION POUR PLACER UNE POLICE TERRITORIALE DE PROXIMITÉ SOUS L'AUTORITÉ DES MAIRES
- G. LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS : RENFORCER LE RÔLE DU DÉPARTEMENT
- H. LES INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES DES COLLECTIVITÉS LOCALES : ADAPTER LE DROIT AUX RÉALITÉS LOCALES
-
I. UN PRÉALABLE : UNE AMÉLIORATION DU
CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER D'EXERCICE DES COMPÉTENCES
-
CHAPITRE III
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES SPÉCIFICITÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE- I. RELEVER LE DÉFI DES 35 HEURES
-
II. ASSOUPLIR LES CONTRAINTES STATUTAIRES ET AFFIRMER LA
SPÉCIFICITÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES
- A. RESPECTER LA LIBERTÉ DE RECRUTEMENT ET DE GESTION DES EMPLOYEURS LOCAUX
- B. AFFIRMER LE POUVOIR DE DÉCISION DES COLLECTIVITÉS LOCALES : POUR UN PRINCIPE DE PARITÉ QUI NE SOIT PAS À SENS UNIQUE
- C. LA FORMATION ET LA MOBILITÉ : POUR UNE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PLUS ATTRACTIVE
- D. LE PRINCIPE D'ADAPTATION ET L'ANTICIPATION DES BESOINS DES COLLECTIVITÉS LOCALES : L'EXEMPLE DE L'INTERCOMMUNALITÉ
-
CHAPITRE IV
UN SYSTÈME DE FINANCEMENT LOCAL RENOVÉ- I. LA FISCALITE LOCALE, CONDITION NÉCESSAIRE DE LA LIBRE ADMINISTRATION
- II. UNE PÉRÉQUATION RENFORCÉE
- III. UNE NOUVELLE DONNE POUR LES CONCOURS DE L'ÉTAT
-
LES PROPOSITIONS DE LA MISSION D'INFORMATION
-
OBSERVATIONS DU GROUPE SOCIALISTE
SUR LES PROPOSITIONS FIGURANT DANS LA MOTION ADOPTÉE
PAR LA MISSION D'INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION - ANNEXES
-
ANNEXE 1
RAPPEL DES PROPOSITIONS DU RAPPORT D'ÉTAPE
DE LA MISSION D'INFORMATION -
ANNEXE 2
LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES
N°
447
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 juin 2000
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la mission commune d'information (1) chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les améliorations de nature à faciliter l'exercice des compétences locales,
Tome I
Par M. Michel MERCIER,
Sénateur.
(1) Cette mission est composée de : MM. Jean-Paul Delevoye, président ; Jacques Bellanger, Joël Bourdin, Paul Girod, vice-présidents ; Robert Bret, Louis de Broissia, Jean-François Picheral, Lylian Payet, secrétaires ; Michel Mercier, rapporteur ; Claude Domeizel, Patrice Gélard, Hubert Haenel, Claude Haut, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Jean-François Humbert, Philippe Marini, Gérard Miquel, Bernard Murat, Philippe Nachbar, Jacques Oudin, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Raincourt, Philippe Richert, Bernard Seillier, Guy Vissac.
|
Collectivités locales. |
|
SOMMAIRE
Pages
MOTION ADOPTÉE PAR LA MISSION D'INFORMATION
17
INTRODUCTION
27
PREMIÈRE PARTIE - LA DÉCENTRALISATION ET L'EFFICACITÉ
DE L'ACTION PUBLIQUE
34
CHAPITRE PREMIER LE CONTEXTE : UNE RÉFORME EFFICACE ET
ADAPTÉE AUX NOUVEAUX DÉFIS SOCIAUX
36
I. LA DÉCENTRALISATION : UNE REDISTRIBUTION DES POUVOIRS AU
SERVICE DE L'EFFICACITE DE L'ACTION PUBLIQUE
36
A. L'EMERGENCE DIFFICILE DE L'IDEE DE DECENTRALISATION
36
1. Un long cheminement
36
a) Une histoire " cahotique "
36
b) Une double dépossession
38
2. Une affirmation progressive
40
a) Un réel mouvement de décentralisation
40
b) Une étape importante : le projet de loi relatif au
développement des responsabilités locales
41
B. LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA DÉCENTRALISATION
42
1. Une nouvelle distribution des pouvoirs dans un Etat unitaire
42
a) Une nouvelle distribution des pouvoirs
42
b) Le maintien des principes de l'Etat unitaire
44
2. La recherche d'une meilleure efficacité de l'action publique
45
a) Un Etat recentré sur ses compétences essentielles
45
b) Une organisation administrative rationalisée
47
3. Une démocratie de proximité
47
a) Un processus de décision proche des citoyens
47
b) Une capacité d'adaptation et d'innovation
48
II. L'AFFIRMATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES COMME DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES DE PREMIER PLAN
49
A. LA PLACE DES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS L'ÉCONOMIE NATIONALE
49
1. Une place significative
50
2. Un facteur de croissance pour l'économie nationale
51
B. L'EFFICACITÉ DE LA GESTION DECENTRALISÉE
53
1. L'assainissement financier
53
2. La sagesse fiscale
58
3. Un excédent budgétaire
62
C. LE DÉVELOPPEMENT DU CONTRÔLE FINANCIER
63
III. DE NOUVEAUX DÉFIS POUR L'ACTION PUBLIQUE
64
A. DE PROFONDES MUTATIONS DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE
64
1. L'évolution démographique
64
a) Le vieillissement de la population française
64
b) Des contrastes territoriaux marqués en matière
démographique
67
2. La mondialisation de l'économie française
70
3. Le risque de fracture civique et sociale
71
a) Les incivilités et la fracture sociale
71
b) La fracture civique
72
c) Les risques d'inégalités que peuvent engendrer les nouvelles
technologies de la communication
74
B. UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE DE L'ACTION PUBLIQUE
74
1. La nécessité croissante d'une gestion de
proximité
74
a) Une cohésion sociale renforcée
74
b) Les nouvelles attentes de la population
76
2. L'insertion des territoires dans l'ensemble européen
79
a) L'exigence d'une structuration efficace des territoires
79
b) La place croissante des politiques communautaires
80
C. LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
81
1. Le rapprochement franco-allemand d'après guerre
81
2. L'affermissement des instruments juridiques et financiers
82
3. Une coopération active dans toutes les zones frontalières
françaises et européennes
83
CHAPITRE II LA COMPLEXITÉ DU PAYSAGE INSTITUTIONNEL DE LA
DÉCENTRALISATION
86
I. L'ÉTAT : UN ACTEUR ESSENTIEL QUI N'A PAS ENCORE
INTÉGRÉ LA LOGIQUE DE LA DÉCENTRALISATION
86
A. LE RÔLE AMBIGU DE L'ÉTAT : CONTRÔLEUR ET ACTEUR DE
LA VIE LOCALE
86
1. l'État, contrôleur de la vie locale
86
a) Les principes : la substitution du contrôle a posteriori à
la tutelle
87
b) Les insuffisances du contrôle de légalité
87
c) Les ambiguïtés du contrôle de légalité
90
d) L'inadaptation des contrôles financiers
92
2. l'État, acteur de la vie locale
96
B. UN ÉTAT QUI N'A PAS ADAPTÉ SON ORGANISATION À LA
DÉCENTRALISATION
98
1. Le bilan mitigé des partages de services
99
a) Les principes retenus par les lois de décentralisation
99
b) Une mise en oeuvre complexe
101
c) Le partage non réalisé : des services en
parallèle sinon en " doublon "
105
2. La déconcentration et la restructuration des administrations
territoriales de l'état sont toujours en chantier
106
a) Les enjeux de la déconcentration
107
b) Un objectif sans cesse réaffirmé
107
c) Une mise en oeuvre laborieuse
110
d) L'insuffisante restructuration des services territoriaux de l'État
114
e) Un pis-aller : la coordination sans réorganisation des services
115
II. UNE ORGANISATION TERRITORIALE EN DEVENIR
117
A. LES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES : L'ABSENCE D'UN
MODÈLE UNIQUE
117
1. Décentralisation et évolution du modèle
fédéral
117
2. Décentralisation et mutation de l'État unitaire
119
3. Régionalisation et décentralisation
121
4. La " dévolution " au Royaume-Uni
122
5. L'Espagne : l'État des autonomies
124
6. L'Italie : en route pour une autonomie toujours plus grande des
régions
124
7. La permanence du modèle allemand
125
B. UNE NOUVELLE DONNE POUR L'ORGANISATION TERRITORIALE : LA MONTÉE
EN PUISSANCE DE L'INTERCOMMUNALITÉ DE PROJET
127
1. Une préoccupation ancienne
127
a) Un remède à l'émiettement communal
127
b) Les principales étapes : une " stratification " des
structures
128
c) Les lignes directrices d'une réforme de
l'intercommunalité : le rôle actif du Sénat
130
2. Une relance récente : la loi du 12 juillet 1999
132
a) Les principaux objectifs
132
b) Un premier bilan encourageant
136
C. DES FACTEURS DE COMPLEXITE POUR L'ORGANISATION TERRITORIALE
138
1. Les ambiguïtés de la politique des pays
139
a) La loi d'orientation du 4 février 1995 : le pays espace de
projet
139
b) La loi du 25 juin 1999 : une procédure plus complexe
140
2. La prolifération des " zonages "
141
a) Le zonage : un outil complexe mais pourtant utile
141
b) Une simplification toujours attendue
145
3. Les mécanismes complexes des interventions communautaires
150
a) Un poids significatif dans la vie locale
150
b) Une mise en oeuvre complexe
151
D. LES SPÉCIFICITÉS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
156
CHAPITRE III LE CADRE DE L'EXERCICE DES COMPÉTENCES LOCALES :
DES BLOCS DE COMPÉTENCES À LA COGESTION
160
I. UNE LOGIQUE INITIALE DÉVOYÉE
161
A. LA LOGIQUE INITIALE
161
1. Une nouvelle conception du rôle de l'Etat dans un cadre
défini par la loi
161
a) Une nouvelle conception du rôle de l'Etat
161
b) Un cadre fixé par la loi
165
2. Des transferts de blocs de compétences en fonction des vocations
dominantes de chaque niveau de collectivité locale
167
a) L'identification des vocations dominantes des différents niveaux
167
b) La détermination de blocs de compétences
169
B. UNE LOGIQUE DÉVOYÉE
170
1. De la confusion...
170
a) La multiplication des formules de cogestion
170
b) Un cadre contraignant pour les collectivités locales
178
2. ... A la recentralisation des compétences
179
a) Des dispositifs coercitifs
179
b) Une présomption inacceptable : l'incapacité des
collectivités locales à appliquer la loi
184
II. UNE LOGIQUE CONTRACTUELLE INÉGALITAIRE
186
A. L'IMPORTANCE CROISSANTE DES TECHNIQUES CONTRACTUELLES
188
1. Les contrats de plan Etat-régions : une enveloppe
financière considérable en partie seulement prise en charge par
l'Etat
188
a) La contractualisation décentralisée, héritière
de " l'ardente obligation " nationale
188
b) Des financements croissants, répartis entre plusieurs partenaires
189
2. Les contrats de ville ou la tentative de rationalisation d'une politique
foisonnante
192
a) Une prolifération à laquelle la contractualisation n'a pas
totalement mis fin
192
b) Une politique partagée
195
3. Les contrats locaux de sécurité : un outil
perfectible
197
a) Une procédure qui couvre une part croissante du territoire
197
b) Une méthodologie perfectible
199
4. Les autres contrats : quelle cohérence globale et quelle
place pour les collectivités territoriales ?
201
B. LA RUPTURE DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES CONTRACTANTS
202
1. Le contrat, vecteur de l'intervention de l'Etat
202
a) La méthode, ou le déséquilibre dans la
négociation du contrat
202
b) Les matières contractuelles, ou le déséquilibre dans le
contenu du contrat
204
2. L'absence de sanction du non respect par l'Etat de ses engagements
206
a) Une exécution défaillante des engagements financiers
206
b) Une relation contractuelle dépourvue de force contraignante ?
210
CHAPITRE IV FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : L'ETAT ÉLABORE
DES RÈGLES INADAPTÉES DONT IL NE SUPPORTE PAS LES
CONSÉQUENCES
213
I. UNE CONSTRUCTION STATUTAIRE LABORIEUSE QUI N'A PAS SUFFISAMMENT PRIS EN
COMPTE LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
214
A. LES PRINCIPES POSÉS EN 1984 : UNITÉ, PARITÉ...
SPÉCIFICITÉ
214
1. L'unité de la fonction publique territoriale
214
2. La parité entre les fonctions publiques
215
3. La spécificité de la fonction publique territoriale
216
B. LA DIFFICILE MISE EN PLACE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
216
II. DES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET RÉGLEMENTAIRES INADAPTÉES
ET RIGIDES
217
A. DES PROCÉDURES TRÈS LOURDES
218
1. Le recrutement et le système du concours
219
2. La formation
220
3. Le déroulement de carrière et la mobilité
220
4. Les incidents de carrière
222
B. DES INSTITUTIONS QUI ONT MONTRÉ LEURS LIMITES
223
1. Le CNFPT
223
2. Les centres de gestion
223
3. La CNRACL : une situation financière inquiétante
224
C. LES RÉMUNÉRATIONS SONT CONTRAINTES AU NOM DU PRINCIPE DE
PARITÉ
225
D. LE RECRUTEMENT DE CONTRACTUELS EST FORTEMENT ENCADRÉ
226
E. L'INADÉQUATION DES STATUTS PARTICULIERS AUX NOUVEAUX BESOINS DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
228
F. LE CAS PARTICULIER DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
228
1. La surrémunération est un frein à l'embauche
228
2. Les indemnités d'éloignement
229
3. L'emploi de non-titulaires
229
III. LES INCERTITUDES QUANT AU VOLUME DE L'EMPLOI PUBLIC TERRITORIAL
230
A. L'EXTENSION DE LA NOTION D'AGENT PUBLIC CRÉE DES CHARGES POUR LES
COLLECTIVITÉS EMPLOYEURS
230
1. La réduction de la possibilité pour les
collectivités de recruter sur des contrats de droit privé
230
2. Une rigidité accrue de la gestion des personnels
231
B. LE RENOUVELLEMENT DES EFFECTIFS
232
CHAPITRE V UN SYSTÈME DE FINANCEMENT QUI NE GARANTIT PAS L'AUTONOMIE
LOCALE
234
I. LA NOUVELLE DONNE DE LA DÉCENTRALISATION
235
A. L'HÉRITAGE DU " PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES
RESPONSABILITÉS LOCALES "
235
B. UN RENFORCEMENT DE L'AUTONOMIE FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS
237
II. LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE CHARGES :
THÉORIE ET PRATIQUE
238
A. LES PRINCIPES DE LA COMPENSATION
239
1. Une compensation intégrale à la date du transfert
239
2. Une compensation constituée au moins pour moitié par des
ressources fiscales
240
B. LES AMBIGUÏTÉS D'UN SYSTÈME COMPLIQUÉ
241
1. Le mode de calcul des compensations ne permet pas une compensation
intégrale
241
a) Le calcul des compensations repose sur la distinction entre
l'évolution théorique et l'évolution réelle des
ressources et charges transférées
241
b) Cette distinction n'a pas permis une compensation intégrale des
charges transférées
243
2. La remise en cause du principe du financement par la fiscalité
246
3. Le régime de compensation est-il respectueux de la libre
administration des collectivités locales ?
249
C. L'ALOURDISSEMENT DES CHARGES NON COMPENSÉES : UN RISQUE POUR LES
BUDGETS LOCAUX
251
1. Les transferts de charges ne concernent pas seulement les domaines
mentionnés par les lois de décentralisation
251
2. Un décalage entre les procédures et les enjeux
financiers
255
III. LE DÉMANTÈLEMENT DE LA FISCALITÉ LOCALE
257
A. UNE FISCALITÉ LOCALE DE PLUS EN PLUS " VIRTUELLE "
257
1. Une marge de manoeuvre fiscale de plus en plus réduite
257
a) La marge de manoeuvre fiscale des collectivités locales ...
257
b) ... se réduit peu à peu
259
2. L'évolution des taux et des bases détermine de moins en
moins l'évolution du produit
260
3. Peut-on encore parler d'impôts directs locaux ?
261
B. LE COÛT DE LA NON RÉFORME
263
1. Des inégalités qui se perpétuent et amènent
l'Etat à supprimer tout ou partie des impôts directs locaux
263
a) Les inégalités " inévitables "
263
b) Les inégalités injustifiables
264
c) La stratégie des gouvernements successifs : payer plutôt
que réformer
267
2. Une charge croissante pour le budget de l'Etat
268
3. Un manque à gagner pour les collectivités locales
271
a) Les modes d'indexation entraînent des manques à gagner
272
b) Les mécanismes d'érosion du montant des compensations
273
c) Les conséquences sur la taxe foncière et la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères
276
IV. LES COLLECTIVITÉS LOCALES, VARIABLE D'AJUSTEMENT DU BUDGET DE
L'ETAT
277
A. L'ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES CONCOURS DE L'ÉTAT
277
1. Les concours de l'Etat : un ensemble
hétérogène
277
a) Les dégrèvements
278
b) Les compensations
278
c) Les dotations de l'Etat
279
2. La réduction de la part des dotations dans l'effort total de
l'Etat
285
B. L'ENVELOPPE NORMÉE : UN " RENDEZ-VOUS MANQUÉ "
286
1. Concilier maîtrise des dépenses publiques et
stabilité des concours aux collectivités locales : une bonne
idée ...
287
a) Maîtriser les dépenses publiques
287
b) Améliorer la prévisibilité de l'évolution des
budgets locaux
288
2. ... qui a été détournée de son objet initial
....
289
3. ... et qui n'a pas modifié la nature des relations
financières entre l'Etat et les collectivités locales
291
V. LA PÉRÉQUATION EN PANNE
292
A. LE CONTRASTE ENTRE LES BESOINS ET LES CREDITS
292
1. Les difficultés de mesurer les écarts de richesse
292
2. Un faible volume de crédits
297
3. La péréquation : du
" saupoudrage " ?
298
B. LA FAIBLESSE DES INSTRUMENTS EXISTANTS
299
1. La DGF des communes est peu péréquatrice
299
a) Les modalités de répartition de la DGF des communes et des
structures intercommunales
299
b) Les crédits consacrés à la péréquation ne
parviennent pas à " décoller "
302
c) L'origine du blocage
305
2. Les fonds nationaux de péréquation
307
a) Des fonds à l'objet de moins en moins défini
307
b) La péréquation finance la péréquation
309
c) Une situation paradoxale
309
3. La péréquation des réductions de crédits
311
a) La réforme de la DGE
311
b) La modulation des baisses de DCTP
313
c) Les compensations d'exonérations fiscales sont-elles
péréquatrices ?
314
C. LES NOUVELLES FORMES DE PÉRÉQUATION
316
1. La péréquation volontaire des ressources fiscales : la
taxe professionnelle unique
316
2. La péréquation forcée des ressources fiscales
317
3. Les contrats de plan sont-ils péréquateurs ?
319
VI. UN ÉTRANGE MOUVEMENT DE RECENTRALISATION DES FINANCES LOCALES
321
A. LA MÉCANIQUE DE LA RECENTRALISATION
321
1. La transformation d'impôts locaux en dotations
budgétaires
322
2. Les concours de l'Etat aux collectivités locales sur la
sellette
323
B. POURQUOI L'ÉTAT RECENTRALISE-T-IL ?
324
1. Améliorer la justice fiscale ?
324
2. Renforcer la péréquation ?
327
3. Maîtriser la dépense publique ?
328
CHAPITRE VI UN BILAN SECTORIEL
330
I. L'AIDE SOCIALE
330
A. L'ALTÉRATION PROGRESSIVE DU PRINCIPE DES " BLOCS DE
COMPÉTENCE "
331
1. La volonté originelle de clarification
331
a) Un principe simple
331
b) L'émiettement structurel du secteur social
333
c) La définition centralisée de l'aide sociale légale
334
d) Une compétence résiduelle de l'Etat aux contours flous
336
2. Des difficultés de mise en oeuvre des compétences
partagées
338
a) La prise en charge des personnes handicapées
338
b) La prise en charge des parents isolés en difficulté
341
c) La judiciarisation de l'aide sociale à l'enfance
342
d) Des COTOREP insuffisamment attentives aux préoccupations des
départements
345
3. De nouvelles formes de " partenariat imposé "
346
a) Le revenu minimum d'insertion (RMI)
347
b) Le logement pour les plus démunis
348
c) Les fonds d'aide aux jeunes (FAJ)
350
4. L'Etat conserve une emprise forte sur des facteurs essentiels
d'évolution de la dépense départementale d'aide
sociale
350
a) Le département ne contrôle pas l'évolution des
rémunérations des personnels sociaux et médico-sociaux
351
b) Le poids des normes
358
B. LA DÉCENTRALISATION A PERMIS UNE AMÉLIORATION DE LA
PERFORMANCE PUBLIQUE DANS LE DOMAINE SOCIAL
359
1. L'amélioration des performances en matière sociale
359
a) Une dépense maîtrisée dans un contexte difficile
359
b) La décentralisation n'est pas un facteur d'aggravation des
inégalités de l'offre sociale
362
c) Les départements ont su développer leurs services sociaux
367
2. Les défis à relever
369
a) Des besoins élevés en matière de renforcement de la
cohésion sociale et de prévention pour la jeunesse
370
b) La question lourde de la dépendance
371
II. LA FORMATION PROFESSIONNELLE
376
A. UN TRANSFERT CLAIR EN APPARENCE
376
1. Les choix de 1983
376
2. L'apprentissage
377
3. La formation professionnelle continue
378
4. La formation professionnelle des jeunes
379
B. UN ETAT OMNIPRÉSENT DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION
381
1. L'Etat conserve en droit et en fait une compétence
considérable
382
2. L'Etat a étendu son rôle d'impulsion en sollicitant des
financements croisés
384
3. La région occupe encore une place restreinte dans le
système de financement de la formation professionnelle
385
III. LA SÉCURITÉ
386
A. UNE COMPÉTENCE LARGEMENT PARTAGÉE
386
1. Un pouvoir étendu du maire en matière de police
386
a) L'objet de la police municipale
386
b) Les limites du pouvoir de police du maire
387
2. L'affirmation du rôle des polices municipales
389
a) L'émergence des polices municipales
389
b) Le nouveau cadre juridique issu de la loi du 15 avril 1999
390
B. LES LIMITES ACTUELLES DE LA POLITIQUE DE PROXIMITE
395
1. Des mesures marquées par de nombreuses incertitudes
396
a) Les contrats locaux de sécurité
396
b) Les emplois de proximité
397
c) Les difficultés rencontrées dans le redéploiement des
personnels vers les zones sensibles
399
2. Un fort sentiment d'insécurité
400
a) Une croissance globale des infractions
400
b) Une aggravation de l'insécurité quotidienne
401
IV. L'ÉDUCATION
402
A. LE PARTAGE DES COMPÉTENCES
403
1. L'organisation institutionnelle
404
a) Le champ d'application des transferts de compétences
404
b) Les nouvelles règles de planification et de programmation des
équipements scolaires
404
c) Le régime des établissements publics locaux d'enseignement
405
d) Les prérogatives conservées par l'Etat
406
2. L'organisation financière
407
a) Un financement partagé
407
b) Des mécanismes spécifiques de compensation.
407
c) Financements conjoints entre collectivités de niveaux
différents.
408
3. La prise en charge par les collectivites de leurs nouvelles
competences.
408
a) Transferts et mises à disposition de personnels.
408
b) L'organisation des services locaux
413
B. UN BILAN SATISFAISANT MALGRÉ DES INSUFFISANCES
413
1. Les insuffisances de la programmation
413
2. Des financements multiples
414
a) Les contributions des communes
414
b) Les concours de l'Etat
414
3. Le remarquable effort des collectivités locales
415
C. LA QUESTION DES TRANSPORTS SCOLAIRES
416
D. LA PARTICIPATION DES RÉGIONS AU FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
418
V. LA CULTURE
419
A. L'INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES A PRIS SON ESSOR AVANT LA
DÉCENTRALISATION
419
B. LES PRINCIPES RETENUS PAR LES LOIS DE DÉCENTRALISATION
421
1. La confirmation des compétences exercées par les
collectivités territoriales dans le domaine culturel
421
2. Des compétences partagées
423
a) Les enseignements culturels
423
b) Les bibliothèques
423
c) Les archives
424
d) Les autres compétences
424
3. Des compétences encadrées
425
4. L'évolution depuis 1983
425
a) Une lente mise en oeuvre des lois de décentralisation
425
b) L'évolution législative
426
5. Les cas particuliers des départements d'outre-mer, puis de la
Corse
427
C. LES FAITS : DYNAMISME ET EFFICACITE DE L'ACTION CULTURELLE DES
COLLECTIVITES LOCALES, RETICENCE DE L'ETAT
427
1. Un dynamisme local avéré
427
a) La prise de conscience de l'importance du développement culturel
local
427
b) La mobilisation de moyens importants
428
c) Des politiques innovantes, adaptées aux besoins locaux
430
2. L'emprise de l'Etat
430
a) L'instrumentalisation des financements croisés
430
b) Les obstacles à la déconcentration
431
VI. LE SPORT
432
A. AVANT LA DÉCENTRALISATION : DÉJÀ UN TERRAIN DE
CHOIX POUR L'INITIATIVE LOCALE
432
1. Développement des équipements
432
2. Création des services municipaux des sports
433
3. Les départements
433
B. LES LOIS DE DÉCENTRALISATION ET LA LOI " SPORT " : LES
SILENCES DU LÉGISLATEUR SUR LES COMPÉTENCES DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
434
1. Le sport : un domaine oublié par les lois de
décentralisation
434
2. La loi sport du 16 juillet 1984
434
3. Les modifications successives de la loi " sport "
435
C. UN DYNAMISME QUI CONFIRME LA PRÉPONDERANCE DES COMMUNES
436
1. Un effort financier considérable
436
2. L'action relative aux équipements et installations sportives
438
a) Action en matière de sécurité
438
b) Les installations sportives
438
3. Un soutien indispensable au mouvement sportif
439
4. Des initiatives pour les nouvelles pratiques sportives
440
D. DES DYSFONCTIONNEMENTS QUI HANDICAPENT LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES DANS LE DOMAINE DU SPORT
440
1. La multiplicité des services extérieurs
compétents
441
2. Normes et responsabilité
441
a) Les normes techniques
442
b) Les règles applicables aux personnels sportifs
442
VII. LES INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES DES COLLECTIVITÉS
LOCALES
443
A. LA SITUATION ANTÉRIEURE À 1982 : UN CADRE JURISPRUDENTIEL
RESTRICTIF
443
B. LES LOIS DE DÉCENTRALISATION : PRINCIPES ET LIMITES
444
C. LE DISPOSITIF RÉSULTANT DE LA NOUVELLE LÉGISLATION
446
1. L'action en faveur du développement économique
446
a) Les aides directes au développement économique
447
b) Les aides indirectes
448
2. La protection des intérêts économiques et sociaux de
la population
449
a) Les aides aux entreprises en difficulté
450
b) Le maintien des services nécessaires à la population
451
c) Les subventions des communes aux entreprises exploitant un cinéma
451
D. LE BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF
452
1. Le développement constant des aides aux entreprises
452
a) Il n'est pas aisé de mesurer l'importance des aides accordées.
453
b) La multiplication des initiatives, parfois au-delà du cadre
légal
455
2. Les interventions économiques des collectivités
territoriale sont-elles efficaces ?
456
E. UN CADRE JURIDIQUE EN DÉCALAGE AVEC LA RÉALITÉ
459
1. Les manquements aux règles
459
2. Les difficultés d'interprétation et de contrôle
460
a) Les incertitudes du cadre juridique résultent tout d'abord du droit
communautaire
460
b) La réglementation nationale est également
génératrice de difficultés
463
DEUXIÈME PARTIE - LES PROPOSITIONS DE LA MISSION D'INFORMATION :
POUR UNE RÉPUBLIQUE TERRITORIALE
466
CHAPITRE I UNE ORGANISATION INSTITUTIONNELLE PLUS EFFICACE
468
I. POUR UN ÉTAT TERRITORIAL ADAPTÉ À LA
DÉCENTRALISATION
468
A. UN ÉTAT RECENTRÉ SUR SES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
468
a) L'État n'a pas le monopole de l'intérêt
général
468
b) L'État doit se désengager des fonctions de gestion
469
B. RÉNOVER LA FONCTION DE CONTRÔLE
470
1. L'État doit veiller à la qualité du contrôle
de légalité
470
a) Sanctionner les défaillances manifestes du contrôle de
légalité
470
b) Renforcer la qualité juridique du contrôle
472
2. La fonction de conseil doit être développée
473
a) Les attentes des élus sont fortes
473
b) Renforcer les capacités d'expertise interne
473
3. Les contrôles financiers
468
C. CHANGER L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT
469
1. Parfaire les partages de services
469
2. Alléger l'organisation territoriale de l'État
470
D. UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA DÉCONCENTRATION
471
1. Dénoncer les ambiguïtés de la
déconcentration
471
a) L'inertie des administrations centrales
471
b) Quels liens entre décentralisation et déconcentration ?
472
2. Redéfinir les rôles respectifs des administrations centrales
et des services déconcentrés
474
3. Promouvoir une véritable " interministérialité
de terrain "
474
4. Renforcer le rôle du préfet comme interlocuteur des
collectivités locales
476
II. ACCOMPAGNER LES MUTATIONS DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE LOCALE
477
A. POURSUIVRE LE RENFORCEMENT DE L'INTERCOMMUNALITE SANS REMETTRE EN CAUSE
L'IDENTITE COMMUNALE
477
1. La commune, cellule de base de la démocratie locale
477
a) Une perception claire par les élus locaux du rôle de
l'intercommunalité
477
b) Une réaffirmation nécessaire de la place des communes
478
2. Un mouvement de rationalisation de l'intercommunalité qui doit
être approfondi
479
a) Des progrès incontestables
479
b) Des améliorations souhaitables
480
3. Vers une élection directe des délégués
intercommunaux ?
483
a) Une question importante pour la démocratie locale...
483
b) ...Dont tous les effets doivent être mesurés
484
B. PROMOUVOIR UNE DOUBLE EXIGENCE D'EFFICACITÉ ET DE SIMPLIFICATION
485
1. L'exigence d'efficacité
486
a) Une identification claire des missions respectives des différents
niveaux
486
b) Encourager les formules de coopération interdépartementale et
interrégionale
490
c) Vers un droit à l'expérimentation institutionnelle ?
491
2. L'exigence de simplification
491
a) Le pays doit rester un espace de projet
491
b) Pour une harmonisation des zonages et une simplification des
procédures qui leur sont attachées
492
C. RENFORCER LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
493
1. Les principaux freins au développement de la coopération
décentralisée
493
2. Promouvoir une politique globale et intégrée dans les
objectifs de l'aménagement du territoire national
494
CHAPITRE II DES COMPÉTENCES CLARIFIÉES ET
RENFORCÉES
497
I. UN PRÉALABLE : UNE AMÉLIORATION DU CADRE JURIDIQUE ET
FINANCIER D'EXERCICE DES COMPÉTENCES
498
A. DES PRINCIPES MIEUX AFFIRMÉS POUR L'EXERCICE DES COMPÉTENCES
TRANSFÉRÉES
498
1. Une compensation intégrale et évolutive des charges
transférées
498
2. Une réelle liberté d'organisation dans la mise en oeuvre
des compétences transférées
501
a) Retrouver l'esprit de la décentralisation
501
b) Quelles voies juridiques pour mieux garantir le respect des
compétences locales ?
502
3. Un droit à l'expérimentation sur la base du volontariat
503
B. DE NOUVELLES RÈGLES DU JEU POUR L'EXERCICE EN PARTENARIAT DE
COMPÉTENCES PARTAGÉES
507
1. Entre l'Etat et les collectivités locales : un partenariat
rééquilibré
507
a) Pour un Etat " contractuel "
507
b) Une nouvelle règle du jeu pour les relations contractuelles entre
l'Etat et les collectivités locales
507
2. Entre collectivités locales : la promotion de la
collectivité chef de file
509
C. DES MOYENS INSTITUTIONNELS RENFORCÉS
512
1. La recherche de formules adaptées pour surmonter les
rigidités du cadre institutionnel
513
2. Le rôle de la gestion déléguée
515
3. Les sociétés d'économie mixte
516
II. UNE RÉPARTITION PLUS RATIONNELLE DES COMPÉTENCES AU
SERVICE DE L'EFFICACITÉ DE L'ACTION PUBLIQUE
519
A. L'ÉDUCATION : TRANSFÉRER LA RESPONSABILITÉ DES
BÂTIMENTS UNIVERSITAIRES AUX RÉGIONS
520
B. LA FORMATION PROFESSIONNELLE : RENFORCER LA COMPÉTENCE DES
RÉGIONS
523
C. L'ÉQUIPEMENT : CONFIER AU DÉPARTEMENT L'ENTRETIEN DES
ROUTES NATIONALES
524
D. L'ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE : DÉMÊLER
L'ÉCHEVEAU DES COMPÉTENCES PARTAGÉES ENTRE L'ETAT ET LE
DÉPARTEMENT
526
1. Clarifier la répartition des compétences
526
2. Revenir à l'esprit des " blocs de compétence "
pour gérer les nouveaux domaines de l'action sociale
527
E. LA CULTURE : MIEUX ORDONNER UN PAYSAGE CONFUS
528
F. LA SÉCURITÉ : OUVRIR DROIT À
L'EXPÉRIMENTATION POUR PLACER UNE POLICE TERRITORIALE DE
PROXIMITÉ SOUS L'AUTORITÉ DES MAIRES
530
1. Une exigence : relever le défi de la délinquance de
proximité
530
2. Mieux associer les élus locaux aux politiques de
sécurité
531
G. LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS : RENFORCER
LE RÔLE DU DÉPARTEMENT
532
1. Le bilan de la départementalisation
532
2. Le financement très contesté des SDIS
534
3. Pour un renforcement du rôle du département
534
H. LES INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES DES COLLECTIVITÉS LOCALES :
ADAPTER LE DROIT AUX RÉALITÉS LOCALES
535
CHAPITRE III POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES
SPÉCIFICITÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
541
I. RELEVER LE DÉFI DES 35 HEURES
541
A. DE TROP NOMBREUSES INCERTITUDES
541
1. L'absence de norme
541
2. Le constat établi par le " rapport Roché "
542
B. UNE MÉTHODE CONTESTABLE
543
1. La méthode réglementaire a été retenue
après l'échec d'un accord-cadre
543
2. Une disposition nationale est-elle nécessaire ?
545
II. ASSOUPLIR LES CONTRAINTES STATUTAIRES ET AFFIRMER LA
SPÉCIFICITÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES
546
A. RESPECTER LA LIBERTÉ DE RECRUTEMENT ET DE GESTION DES EMPLOYEURS
LOCAUX
547
1. Professionnaliser les concours
547
2. Respecter la liberté contractuelle et la liberté de
gestion
548
B. AFFIRMER LE POUVOIR DE DÉCISION DES COLLECTIVITÉS
LOCALES : POUR UN PRINCIPE DE PARITÉ QUI NE SOIT PAS À SENS
UNIQUE
549
C. LA FORMATION ET LA MOBILITÉ : POUR UNE FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE PLUS ATTRACTIVE
549
1. Une formation initiale rénovée
549
2. Une obligation de fidélité ?
550
3. La mobilité et le déroulement de carrière :
récompenser le mérite et les compétences
550
D. LE PRINCIPE D'ADAPTATION ET L'ANTICIPATION DES BESOINS DES
COLLECTIVITÉS LOCALES : L'EXEMPLE DE L'INTERCOMMUNALITÉ
551
CHAPITRE IV UN SYSTÈME DE FINANCEMENT LOCAL RENOVÉ
555
I. LA FISCALITE LOCALE, CONDITION NÉCESSAIRE DE LA LIBRE
ADMINISTRATION
555
A. LA LIBRE ADMINISTRATION NE SE RESUME PAS A LA LIBERTÉ DE
DÉPENSER
556
1. Un modèle possible
556
2. Une solution inadaptée au contexte français
557
B. UN ATOUT À PRÉSERVER
558
1. Un impératif démocratique
559
2. Une nécessité économique
560
3. Une exigence constitutionnelle
562
C. POUR DES IMPÔTS LOCAUX ADAPTÉS ET GARANTIS
CONSTITUTIONNELLEMENT
564
1. Vers une réforme de la Constitution ?
564
2. Des impôts locaux adaptés
565
II. UNE PÉRÉQUATION RENFORCÉE
573
A. LA PÉRÉQUATION EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA
DECENTRALISATION ?
573
1. Les termes du débat
573
2. La péréquation est le corollaire de la
décentralisation
573
B. AMÉLIORER LE CARACTÈRE PÉRÉQUATEUR DE LA DGF
574
1. Modifier l'ordre de répartition des composantes de la
DGF ?
574
2. Dissocier la dotation d'intercommunalité de la DGF des communes
?
575
3. Lier l'évolution de la dotation forfaitaire à celle de la
dotation d'intercommunalité ?
576
C. RATIONALISER LES DISPOSITIFS ACTUELS
577
1. Simplifier les dispositifs actuels ?
577
2. Mieux cibler les dispositifs actuels ?
578
3. Renforcer les moyens des dispositifs actuels ?
579
III. UNE NOUVELLE DONNE POUR LES CONCOURS DE L'ÉTAT
581
A. FIXER DES RÈGLES DU JEU CLAIRES
582
1. Instaurer un véritable rendez-vous triennal
582
2. Associer les collectivités locales aux décisions qui ont
des conséquences sur leurs budgets
583
B. REVOIR LE MODE D'INDEXATION DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT
585
1. Associer les collectivités locales à la croissance
585
a) Quelle progression pour l'enveloppe normée ?
585
b) Quelle progression pour les dotations de fonctionnement et
d'équipement ?
586
2. Le cas particulier de l'indexation des compensations
d'exonérations fiscales
588
LES PROPOSITIONS DE LA MISSION D'INFORMATION
591
OBSERVATIONS DU GROUPE SOCIALISTE SUR LES PROPOSITIONS FIGURANT DANS LA
MOTION ADOPTÉE PAR LA MISSION D'INFORMATION SUR LA
DÉCENTRALISATION
597
ANNEXES
601
ANNEXE 1 RAPPEL DES PROPOSITIONS DU RAPPORT D'ÉTAPE DE LA MISSION
D'INFORMATION
603
ANNEXE 2 LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES
611
MOTION ADOPTÉE
PAR LA MISSION D'INFORMATION
La
mission d'information, commune à cinq commissions permanentes du
Sénat, a été chargée de dresser le bilan de la
décentralisation et de proposer les améliorations de nature
à faciliter l'exercice des compétences locales.
La mission a tout d'abord centré ses réflexions et ses
propositions sur deux sujets de préoccupation prioritaires pour les
élus locaux, qu'elle a traités dans un rapport d'étape
publié en janvier 2000 :
la mission a plaidé pour que la
sécurité de l'environnement juridique des collectivités
locales soit renforcée, et pour que le statut de l'élu soit
rénové.
*
*
*
Parvenue
au terme de ses travaux qui ont duré dix-huit mois,
la mission
présente un
bilan de la décentralisation établi
sous l'angle de l'efficacité de l'action publique,
qu'elle a
décidé de privilégier.
1. La mission considère que la décentralisation est plus
que jamais d'actualité pour relever les défis auxquels l'action
publique est confrontée.
• Conçue et mise en oeuvre, voilà près de
vingt ans, dans un contexte d'épuisement du modèle jacobin, la
décentralisation a redistribué les pouvoirs, les
compétences et les moyens au profit des collectivités
territoriales, dont la région alors érigée en
collectivité de plein exercice. La réforme avait pour principal
objectif de rechercher une meilleure efficacité de l'action publique en
rapprochant la décision du citoyen. La décentralisation a atteint
ses buts. Les collectivités locales se sont pleinement investies dans
les compétences qui leur ont été dévolues, plus
rapidement, plus efficacement et à moindre coût que l'Etat
n'aurait pu le faire. Libérées, les initiatives locales se sont
développées dans tous les domaines ouverts à la
démocratie de proximité. La gestion décentralisée a
fait la preuve de sa vitalité.
• Les collectivités locales se sont affirmées comme
des acteurs économiques de premier plan. Elles occupent une place
significative dans l'économie nationale et leurs investissements, qui
représentent plus des deux-tiers de l'investissement public, constituent
un facteur de croissance avéré. L'assainissement financier et la
sagesse fiscale caractérisent l'efficacité de la gestion
décentralisée. L'excédent budgétaire des
collectivités locales a permis à la France de se conformer aux
critères de Maastricht.
• La démocratie locale reste primordiale pour faire face aux
nouveaux défis qui résultent des grandes tendances de
l'évolution démographique, économique et sociale. Le
vieillissement inéluctable de la population -à l'exception
notable de l'outre-mer-, la mondialisation, le risque d'une fracture civique,
sociale, territoriale, creusent les inégalités et créent
de nouveaux besoins qui appellent des solutions diversifiées. L'action
publique doit s'adapter pour renforcer la gestion de proximité,
préserver la cohésion sociale menacée et répondre
aux nouvelles attentes des citoyens. Il faut aussi mieux insérer les
territoires dans l'ensemble européen.
2. La mission constate la complexité du paysage institutionnel
local, en particulier parce que l'Etat n'a pas encore tiré toutes les
conséquences de la décentralisation. L'organisation
administrative locale est cependant en pleine évolution sous l'effet de
la réforme de l'intercommunalité.
• Le rôle de l'Etat, à la fois contrôleur et
acteur de la vie locale, reste ambigu. Il n'a pas encore adapté son
organisation à la décentralisation. La déconcentration est
toujours en chantier et les élus se plaignent légitimement de ne
pas avoir affaire à un interlocuteur unique.
• La remise en ordre de l'intercommunalité a lancé un
mouvement de mise en commun des compétences de nature à
remédier aux inconvénients de la dispersion communale. Sa
montée en puissance favorisera l'émergence de territoires de
projet et modifiera les relations entre les différents niveaux de
collectivité, sans que l'on puisse encore apprécier l'ampleur de
ces évolutions à venir.
3.
La mission constate que la logique initiale de la
décentralisation, fondée sur une répartition des
compétences par blocs, a été perdue de vue. A la
clarification des compétences s'est substituée une autre logique,
celle de la cogestion, avec pour conséquence la multiplication des
partenariats sous toutes les formes possibles... voire
" impossibles ".
• Cette logique de cogestion aboutit à un dévoiement
des principes de la décentralisation lorsqu'elle se traduit par la
participation croissante des collectivités locales au financement des
compétences de l'Etat, ou par une tendance accentuée à la
recentralisation des pouvoirs dont on trouve des exemples manifestes dans
plusieurs textes de loi récents tels que la loi " exclusions "
et le projet de loi " solidarité et renouvellement urbains ".
• Contractualisation et décentralisation apparaissent
complémentaires dans leur principe, mais parfois antagonistes dans leur
mise en oeuvre. Le contrat est un outil indispensable pour mettre en commun des
moyens destinés à financer -et parfois gérer- des
compétences partagées ou transversales. Le foisonnement de la
contractualisation présente toutefois le risque de contribuer à
la confusion des responsabilités et au manque de lisibilité de
l'action publique. En outre, le contrat doit reposer sur l'équilibre et
la durée. Or, la logique contractuelle est trop souvent
inégalitaire et dénuée de force contraignante pour l'Etat,
qui ne tient pas ses engagements.
4. La mission s'inquiète de l'inadéquation des moyens
à la disposition des collectivités locales.
• S'agissant des
moyens en personnel
,
le cadre juridique
de
la fonction publique territoriale est encore inadapté aux
besoins des collectivités locales
.
La compétence, le dévouement et l'efficacité des
fonctionnaires territoriaux doivent être soulignés et ne sont
nullement en cause. Cependant, les procédures de recrutement et de
formation sont trop lourdes. Les statuts particuliers n'offrent pas aux
collectivités les qualifications nouvelles qui leur seraient
nécessaires. Les quotas et les seuils entravent le déroulement
des carrières. Le bon équilibre n'a pas encore été
trouvé entre le besoin de souplesse des collectivités employeurs
et les rigidités inhérentes au statut protecteur des
fonctionnaires. Les conséquences de la réduction du temps de
travail sont encore très incertaines. Le financement des retraites n'est
pas assuré, la situation de la CNRACL demeurant préoccupante.
• S'agissant des
finances locales
, le bilan de la mission
met en évidence une
tendance à la
remise en cause des
marges d'autonomie financière et fiscale ouvertes aux
collectivités locales par la décentralisation
.
Les principales caractéristiques de l'évolution du système
de financement local -outre son extrême complexité- peuvent
être ainsi résumées :
a) La compensation par l'Etat des charges inhérentes aux transferts
de compétences n'a plus qu'une importance relative alors que les
collectivités locales subissent par ailleurs des charges sur lesquelles
elles n'ont aucune prise et qui ne sont nullement compensées. De
surcroît, à l'inverse du principe de compensation, l'Etat incite
les collectivités locales à financer des dépenses qui
relèvent de ses propres compétences.
b) Les ressources des collectivités locales dépendent de
plus en plus de l'Etat, pourvoyeur de dotations budgétaires dont il
détermine l'évolution, mais aussi premier contribuable local.
c) La part de la fiscalité locale dans les ressources des
collectivités se réduit au fil des réformes,
motivées tantôt par la sauvegarde de l'emploi, tantôt par un
souci de justice sociale, mais également conformes à la
volonté de l'Etat de mieux maîtriser toutes les composantes des
finances publiques. Quelles que soient les justifications avancées, ces
réformes mettent dangereusement en cause la libre administration des
collectivités locales.
d) Les concours de l'Etat aux collectivités locales constituent des
ressources dont la régularité n'est pas véritablement
garantie et dont l'évolution ne tient assez compte ni de leurs charges
réelles ni de la croissance.
e) Les mécanismes de la péréquation
financière, destinée à corriger les
inégalités de richesse, se caractérisent par une
opacité qui empêche d'en mesurer les effets.
*
*
*
Ce
bilan souligne à la fois l'efficacité des collectivités
territoriales et les menaces qui planent sur la
décentralisation
:
• Forcé de s'adapter aux réalités de la
mondialisation dans un cadre européen plus contraignant, l'Etat est
tenté de faire des collectivités locales les instruments de ses
politiques. Il cède trop souvent à la tentation récurrente
de la recentralisation.
• Dans un environnement institutionnel complexe, la confusion des
responsabilités constitue un terrain propice au foisonnement des
initiatives, tout en présentant le risque de contribuer au
découragement des élus et de rendre l'action publique peu lisible
pour les citoyens.
• Malgré les performances de leur gestion financière,
les collectivités locales sont à la merci d'un retournement de
conjoncture. Leurs marges de manoeuvre se resserrent sous l'effet conjoint de
l'alourdissement des charges dont elles n'ont pas la maîtrise, de la
moindre progression de leurs ressources et des atteintes à leur pouvoir
fiscal. Cette évolution met en péril leur capacité
à répondre aux besoins nouveaux.
• L'épuisement des mécanismes de la dotation globale
de fonctionnement, la mise en cause de la fiscalité locale et le
développement des formules contractuelles dans un cadre à la fois
imprécis et déséquilibré témoignent d'un
essoufflement de la décentralisation, préjudiciable à
l'efficacité de l'action publique et à l'approfondissement de la
démocratie de proximité.
*
*
*
Pour
la mission d'information, retrouver l'esprit de la décentralisation est
un impératif
.
Il s'agit de mieux associer les citoyens pour
affronter ensemble les nouveaux défis sociaux et de construire, avec
l'Etat et non contre l'Etat, une République territoriale
rénovée
.
C'est pourquoi
la mission s'est prononcée en faveur d'une relance
vigoureuse et concertée de la décentralisation
, qui passe
par :
•
la définition d'un nouveau contrat de confiance avec
l'Etat, dans le cadre d'une organisation institutionnelle plus efficace ;
• une clarification des compétences, dans le sens d'une
décentralisation renforcée ;
•
des moyens humains mieux adaptés et des marges de
manoeuvre financière préservées, le principe de libre
administration des collectivités locales étant mieux garanti.
1. Considérant qu'un changement d'attitude de l'Etat à
l'égard des collectivités locales est une condition primordiale
pour l'approfondissement de la décentralisation, la mission
préconise :
•
de recentrer l'Etat sur ses missions essentielles
Il appartient avant tout à l'Etat de fixer des règles, d'en
assurer le respect, de garantir les grands équilibres économiques
et financiers, ainsi que la solidarité nationale, mais sans perdre de
vue qu'à la recherche de l'équité, prendre en compte la
diversité reste un impératif.
•
de rénover les fonctions de contrôle
Pour plus d'efficacité, le contrôle de légalité
devrait être à la fois plus sûr et plus adapté
à la réalité locale. L'exercice efficace du contrôle
financier suppose de créer les conditions d'un vrai dialogue entre les
chambres régionales des comptes et les collectivités locales,
dans le cadre de procédures adaptées.
•
de mieux associer les collectivités locales aux
décisions qui les concernent
, en particulier lorsque ces
décisions ont une incidence sur leurs charges ou leurs ressources.
Tel est le cas des négociations salariales dans la fonction publique, de
l'élaboration de normes nouvelles -à Paris ou à Bruxelles-
ou encore de la gestion des fonds structurels européens.
•
de promouvoir une nouvelle approche de la
déconcentration
La déconcentration renforce la décentralisation lorsqu'elle
permet aux élus d'avoir en face d'eux des interlocuteurs
compétents et responsables, capables d'engager l'Etat tout entier. Les
élus locaux souhaitent un interlocuteur unique, qui ne peut être
que le préfet, coordonnateur de
l' " interministérialité ". Pour répondre
à cette attente, il importe de renforcer l'autorité du
préfet sur les services déconcentrés, inscrite de longue
date dans les textes mais pas toujours dans les faits, et de renforcer
également les moyens des préfectures en personnel de
qualité.
La déconcentration a en revanche des effets pervers lorsqu'elle aboutit
à la multiplication des services territoriaux, même pour les
ministères les plus modestes. Il n'est pas nécessaire que chaque
administration centrale dispose d'un service déconcentré à
la fois au niveau régional et départemental.
Mieux vaudrait, pour éviter la multiplication des structures et les
doubles emplois, préjudiciables à l'efficacité de l'action
publique, engager une nouvelle réflexion sur le partage des tâches
avec les collectivités locales.
La décentralisation prendrait alors le relais d'une
déconcentration des pouvoirs trop souvent inopérante sous son
aspect " vertical ", du centre à la périphérie
des administrations de l'Etat.
La gestion des personnels constituant un obstacle -et non des moindres- aux
évolutions structurelles des administrations, la vague de départs
en retraite à échéance prévisible offre à
l'Etat comme aux collectivités territoriales une occasion à ne
pas manquer pour se concerter afin de rationaliser les tâches respectives
et les effectifs de leurs services.
2. Considérant que chaque niveau de collectivité a sa
légitimité, ancrée dans l'histoire administrative et les
réalités de chaque territoire, et convaincue que la
réforme de l'intercommunalité constitue un puissant facteur
d'évolution de l'organisation institutionnelle locale, la mission
préconise :
•
de renforcer l'intercommunalité de projet,
sur la
base du volontariat,
tout en préservant l'identité de la
commune
, cellule de base de la démocratie locale, même si
devait être instaurée le moment venu l'élection au suffrage
universel direct des délégués intercommunaux.
•
de favoriser les coopérations
interdépartementales et interrégionales.
•
de renforcer la coopération
décentralisée.
La mission souhaite également une
harmonisation des zonages
et
une simplification des procédures qui y sont associées. Elle
considère que
le pays doit demeurer un espace de projet
et n'a
pas vocation à devenir un nouvel échelon territorial.
Enfin, elle s'est interrogée sur la reconnaissance d'un
droit
à l'expérimentation institutionnelle
, par une démarche
volontaire, dans un cadre juridique précis de nature à garantir
le caractère unitaire et indivisible de la République.
3. Considérant que l'enchevêtrement des compétences
est un facteur de confusion des responsabilités et nuit à la
lisibilité de l'action publique,
considérant que la clarification est un objectif incontesté qui
doit être poursuivi, entre deux logiques opposées, celle des blocs
de compétences, qui a montré ses limites, et celle du " tout
contrat ", séduisante mais génératrice
d'incertitude
,
la mission préconise :
•
de rationaliser dans la mesure du possible la
répartition des compétences entre l'Etat et les
collectivités locales, conformément à la vocation
principale des différents niveaux de collectivité et en tenant
compte des évolutions observées.
Toute nouvelle décentralisation de compétence devrait être
subordonnée à trois conditions :
- une compensation juste et évolutive des charges
transférées ;
- une liberté réelle d'organisation ;
- l'expérimentation sur la base du volontariat, qui garantit
l'adhésion et préserve l'avenir.
•
de clarifier les règles du jeu pour l'exercice en
partenariat des compétences partagées
Pour les compétences partagées avec l'Etat, la mission appelle de
ses voeux le rééquilibrage d'un partenariat trop inégal.
Elle souhaite que le non-respect de ses engagements par l'Etat fasse l'objet de
sanctions financières.
Pour les compétences partagées entre collectivités
locales, la mission préconise de promouvoir en droit et en fait la
collectivité chef de file, tant pour la mise en oeuvre et le suivi de
contrats d'objectifs cofinancés que pour le pilotage des champs de
l'action publique dans lesquels plusieurs collectivités interviennent
chacune à leur niveau.
•
Pour clarifier les responsabilités dans le sens d'une
décentralisation renforcée, la mission suggère
notamment
:
- de transférer les constructions universitaires à la
région ;
- de confier à chaque collectivité la gestion des personnels
administratifs des établissements d'enseignement qui entrent dans son
domaine de compétences ;
- de confier aux régions la totalité de la
responsabilité de la formation professionnelle ;
- de transférer la construction et l'entretien des routes
nationales aux départements, l'Etat gardant les autoroutes ;
- de transférer à l'Etat les actions départementales
de prévention sanitaire ;
- de répartir les actions en faveur des handicapés par
fonctions et non par établissements : l'hébergement au
département, le travail à l'Etat, les soins à l'assurance
maladie ;
- d'engager une réflexion pour mettre fin à la cogestion du
RMI par l'Etat et le département, en favorisant une plus grande
décentralisation ;
- de reconnaître explicitement aux collectivités locales, et
en particulier aux communes, la responsabilité des établissements
d'enseignement artistique, qu'elles assument déjà, en associant
à cette compétence un financement approprié ;
- d'associer les collectivités locales à l'inventaire,
l'Etat conservant la responsabilité de la conservation du
patrimoine ;
- d'ouvrir droit à l'expérimentation pour placer une police
territoriale de proximité sous l'autorité des maires ;
- de confier aux départements l'organisation des services
d'incendie et de secours.
4. Considérant la nécessité de mieux adapter le
statut des fonctionnaires territoriaux, en conciliant les
spécificités des collectivités employeurs et
l'intérêt des agents, la mission préconise en
particulier :
- d'alléger les modalités de recrutement par concours,
notamment en reconnaissant l'équivalence des diplômes et en
organisant des concours sur titres pour les filières techniques,
sociales et culturelles ; de favoriser la promotion interne, sanction
d'une compétence et validation des acquis professionnels ;
- de créer de nouveaux cadres d'emplois pour répondre aux
besoins en personnels qualifiés, tels que juristes et " nouveaux
métiers " ;
- de préserver la voie du recrutement contractuel, indispensable
élément de souplesse ;
- de poursuivre l'adaptation des quotas d'avancement et des seuils
démographiques ;
- de favoriser la mobilité des agents, au sein de la fonction
publique territoriale et en direction de la fonction publique de l'Etat ;
- de mutualiser la formation initiale des administrateurs territoriaux et
de chercher comment éviter que la charge des formations
complémentaires pèse exclusivement sur la collectivité
" premier employeur ".
5. Considérant que la rénovation du système de
financement local est une impérieuse nécessité et doit
faire l'objet d'une réforme cohérente tendant à garantir
aux collectivités locales des marges de manoeuvre suffisantes, dans le
respect du principe de libre administration, la mission recommande en
particulier :
- de préserver, dans les ressources des collectivités, une
part prépondérante de recettes fiscales
dont elles
puissent adapter l'évolution à leurs besoins ;
- de
moderniser l'assiette
de la taxe d'habitation et de la taxe
professionnelle ;
- d'
étudier comment certains impôts existants pourraient
être remplacés
soit par de nouveaux impôts, soit par la
possibilité pour les collectivités de voter des taux ou des
centimes additionnels aux impôts d'Etat, soit par le transfert de
certains impôts d'Etat ;
- de
clarifier les règles du jeu présidant à la
détermination du montant et de l'évolution des concours
financiers de l'Etat,
afin de mieux prendre en compte les charges subies
par les collectivités locales et de mieux les associer à la
croissance ;
- de
renforcer la dimension péréquatrice de la
répartition des dotations de l'Etat,
plutôt que de multiplier
les mécanismes de péréquation directe entre
collectivités.
Enfin,
le principe constitutionnel de libre administration
serait
renforcé en inscrivant dans la Constitution la garantie de l'autonomie
fiscale des collectivités locales et les principes financiers de la
décentralisation, comme le propose le Président du Sénat,
M. Christian Poncelet.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
La décentralisation a contribué à dessiner le nouveau
visage d'une France plus ouverte, plus moderne, mieux adaptée à
l'évolution d'un contexte économique et social en pleine
mutation, mieux préparée à s'insérer dans une Union
européenne en devenir.
Lorsque le processus de décentralisation est lancé, voilà
bientôt vingt ans, le paysage est encore celui d'un
Etat fortement
centralisé
, marqué par une culture égalitaire,
doté d'une administration organisée pour faire face aux
nécessités de la reconstruction de l'après guerre,
caractérisé par une large extension du secteur public dans une
économie nationale planifiée.
Cependant, les trente glorieuses sont passées. La crise du
pétrole a ébranlé la certitude d'un progrès
économique indéfini, et l'ouverture des frontières a remis
en question la maîtrise par l'Etat de l'économie nationale. Des
politiques contractuelles plus affirmées ont vu le jour.
L'efficacité de l'Etat jacobin s'est érodée
.
Libérer l'initiative, rapprocher la décision du citoyen
paraissent alors des objectifs indispensables au renouveau de l'action publique.
Après les mesures de déconcentration prises dans ces
années soixante au profit des préfets, suivies par la
création des établissements publics régionaux, le rapport
" Vivre ensemble ", résultat des travaux de la commission
Guichard, a ouvert la voie vers une nouvelle répartition des pouvoirs
entre l'Etat et les collectivités locales, lieux de décision
privilégiés pour la mise en oeuvre d'une démocratie de
proximité renforcée. Le dogme de l'égalité, souvent
plus abstraite que réelle, cède le pas devant la reconnaissance
de la capacité des collectivités à mieux faire face que
l'Etat central à la
diversité des situations
. La
décentralisation est en marche.
L'aboutissement de la réforme, réalisée par le
gouvernement de Pierre Mauroy, est le fruit d'une longue gestation à
laquelle le Sénat a pris une part active, en votant en 1980 un projet de
loi relatif au développement des responsabilités locales
présenté par notre collègue Christian Bonnet. Ce texte,
aussi complet qu'ambitieux, ne sera pas examiné par l'Assemblée
nationale. Le socle financier de la décentralisation est cependant en
place avant l'alternance de 1981 : les départements et les communes
ont obtenu le droit de voter le taux de leurs impôts et la dotation
globale de fonctionnement a été créée.
Gaston Deferre, qui succède à Christian Bonnet au
ministère de l'Intérieur, est partisan d'une méthode
progressive. Dès 1982, une première loi fixe le cadre juridique
de la décentralisation. A la hardiesse des nouveaux principes
-suppression de la tutelle
a priori
et transfert des exécutifs
aux présidents d'assemblée- s'ajoute l'érection de la
région en collectivité de plein exercice. La réforme
s'inscrit dans un cadre constitutionnel et dans un cadre territorial
inchangé. Les nouvelles régions prendront la place des
établissements publics régionaux existants.
C'est seulement une fois tracé ce cadre juridique que viendront les
premières lois organisant les transferts de compétences de l'Etat
aux collectivités territoriales. Un édifice législatif
considérable, complété par d'abondants textes
réglementaires, sera patiemment construit -il faudra dix ans pour
attendre un statut de l'élu- et constamment remanié, les
gouvernements successifs balançant entre la volonté de parachever
le processus de décentralisation et la tentation récurrente d'une
recentralisation rampante.
Qu'en est-il aujourd'hui ? L'action de l'" Etat
décentralisé " s'inscrit dans un contexte politique,
économique et social qui a
profondément
évolué
depuis vingt ans. La mondialisation de
l'économie s'est affirmée. L'intégration européenne
s'est renforcée, infléchissant la législation nationale,
créant des normes nouvelles. La France s'est engagée
résolument dans l'Union monétaire.
Avant de faire place à la croissance, stimulée par les nouvelles
technologies, la crise économique a creusé les
inégalités, au détriment des territoires et des individus
les plus fragiles, menaçant la cohésion sociale. Les
mentalités ont évolué vers plus d'individualisme. La
confiance dans la politique s'est affaiblie au même rythme que la
puissance tutélaire des Etats. La médiatisation exige une plus
grande transparence de l'action publique.
Partout dans le monde montent en puissance les pouvoirs locaux, expression de
solidarités territoriales plus affirmées
et remparts
contre la mondialisation, reconnus pour leur capacité d'initiative et
d'adaptation aux besoins exprimés par les citoyens.
La France ne saurait échapper à ce mouvement, même si elle
se distingue par sa forte tradition unitaire. L'Etat veille aux grands
équilibres économiques et financiers, et son rôle de garant
de la solidarité nationale n'est pas contesté. Mais il doit
composer avec les forces économiques et, pris en étau entre
l'intégration européenne et la décentralisation,
résiste à l'érosion de ses pouvoirs et de ses finances.
*
*
*
Le
Sénat, conformément à sa vocation constitutionnelle de
représentant des collectivités territoriales de la
République, a considéré que le moment était venu de
faire le point sur ce qu'est devenue la décentralisation, au travers de
ces bouleversements qui ont sensiblement modifié les moyens d'action de
l'Etat et l'environnement des collectivités locales.
Il a décidé, fin 1998, de mettre en place une mission
d'information, commune à cinq commissions permanentes -Lois, Finances,
Affaires culturelles, Affaires économiques et Affaires sociales- afin de
dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les
améliorations de nature à faciliter l'exercice des
compétences locales.
Cette initiative trouve son origine dans la volonté de M. Christian
Poncelet qui, dès son élection à la Présidence du
Sénat, a souhaité affirmer le rôle de
" veilleur " de la décentralisation de la Haute
Assemblée, et s'est lui-même engagé dans une large
opération de consultation sur le terrain, en organisant des Etats
généraux des élus locaux dans les régions.
Dans le Vaucluse, en Alsace, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Normandie, en
Aquitaine, enfin en Auvergne, les Etats généraux ont permis
d'engager un dialogue fécond avec les élus locaux, les
parlementaires et les représentants de l'Etat, sur des thèmes
aussi divers que la sécurité juridique, l'autonomie
financière des collectivités locales, l'avenir de
l'intercommunalité, les politiques de sécurité publique,
l'aménagement du territoire et la réforme de l'Etat. Les
résultats de cette consultation ont contribué très
utilement aux réflexions de la mission d'information.
Depuis que la mission a engagé ses travaux, voilà dix-huit mois,
plusieurs réformes législatives concernant le paysage
institutionnel local et les relations entre l'Etat et les collectivités
locales ont donné lieu à des débats parlementaires
animés et controversés : sur l'intercommunalité, sur
les finances locales, sur les polices municipales, sur l'aménagement du
territoire, sur la solidarité et le renouvellement urbains, sur
l'adaptation des départements d'outre-mer, pour ne citer que les
réformes les plus importantes.
La mission d'information a bien entendu suivi avec la plus grande attention les
débats législatifs, qui ont alimenté ses réflexions.
De son côté, la mission d'information, qui a tenu 39
réunions pour une durée totale de 72 heures, a
procédé à 75 auditions -ministres, associations
d'élus, personnalités qualifiées- dont on trouvera le
compte rendu résumé dans le tome II du présent
rapport.
*
*
*
Face
à l'ampleur de la tâche dont elle a été investie, la
mission d'information a tout d'abord centré ses réflexions et ses
conclusions sur deux sujets de préoccupation prioritaires pour les
élus locaux. Elle a publié en janvier 2000 un rapport
d'étape dans lequel elle a plaidé pour que la
sécurité de l'environnement juridique des collectivités
locales soit renforcée et pour que le statut de l'élu soit
rénové
1(
*
)
.
Elle ne peut que se féliciter de la traduction de ses conclusions dans
des textes législatifs. Il en est ainsi de la proposition de loi de
notre collègue Pierre Fauchon sur les délits non intentionnels,
définitivement adoptée par le Parlement. Celle de nos
collègues Jacques Oudin et Jean-Paul Amoudry sur les chambres
régionales des comptes, toujours en instance, résulte des
réflexions qu'ils ont conduites dans le cadre d'un groupe de
travail
2(
*
)
, commun aux commissions des Lois et
des Finances, et auxquelles la mission s'est pleinement associée.
Pour dresser un bilan de la décentralisation et en tirer les
conséquences pour l'avenir, objet de ce rapport final, la mission a
choisi de privilégier une approche aussi concrète que
possible : celle de
l'efficacité de l'action publique.
C'est à travers ce prisme que la mission s'est efforcée
d'apprécier dans quelle mesure les principes de la
décentralisation ont été mis en oeuvre et plus ou moins
infléchis, et quelles seraient les
mesures à prendre pour
faciliter l'exercice des compétences locales.
Cette optique de la performance de l'action publique a conduit la mission
à s'engager dans un bilan sectoriel de la décentralisation. Dans
l'impossibilité de couvrir tout le champ de l'action publique, la
mission a focalisé ses analyses sur quelques domaines : l'aide
sociale, compétence de droit commun du département ; la
formation professionnelle, secteur déjà largement investi par la
région ; l'éducation, qui a fait l'objet des transferts de
compétences les plus visibles en matière de construction et
d'entretien des bâtiments scolaires ; les politiques de
sécurité, compétence de l'Etat pourtant largement
partagée ; la culture, peu concernée par les lois de
décentralisation, et le sport, qu'elles ont oublié, domaines dans
lesquels l'initiative des collectivités locales s'est néanmoins
largement déployée ; enfin, les interventions
économiques des collectivités locales, où le droit est
manifestement en décalage avec les faits.
L'impression générale qui s'est dégagée des
consultations auxquelles la mission a procédé est celle de la
performance incontestable des collectivités locales
. Cette
appréciation positive s'accompagne du sentiment diffus, largement
partagé, d'une
complexité ambiante
, certes
inévitable, certes favorable au foisonnement des initiatives, mais
éprouvante pour les élus locaux les moins bien secondés
-ceux des petites communes-,
préjudiciable à la
lisibilité
de l'action publique pour le citoyen et, finalement,
à son efficacité.
Cette complexité est d'abord celle du
paysage institutionnel
, en
particulier parce que l'Etat n'a pas tiré toutes les conséquences
de la décentralisation, ni dans son organisation, ni dans ses modes de
gestion. Elle résulte ensuite de la
confusion des
responsabilités
, conséquence de la logique de cogestion qui
s'est substituée à la logique initiale de la répartition
des compétences par blocs, et s'est traduite par une multiplication des
partenariats. La complexité caractérise aussi le
système de financement local
, qui a fait l'objet
d'aménagements multiples au fil des lois de finances successives et dont
seuls les spécialistes avertis sont en mesure de démêler
l'écheveau. Plus généralement, la
complexité du
droit
contribue au climat d'insécurité juridique,
déjà mis en évidence par la mission dans son rapport
d'étape.
Convaincue que la
décentralisation est plus que jamais
d'actualité pour relever les défis auxquels l'action publique est
confrontée
, la mission d'information s'est inquiétée
d'une tendance récente au
retour de l'Etat
"
tutélaire
", confirmée à travers
plusieurs réformes législatives, qui traduit une
défiance persistante
à l'égard des
collectivités locales. La "
recentralisation
"
de
leurs ressources financières
met en cause leur pouvoir fiscal,
élément substantiel du principe constitutionnel de leur libre
administration.
L'Etat est ainsi tenté de faire des collectivités territoriales,
par la loi ou par le contrat, les
instruments de ses politiques
,
s'éloignant des principes de la décentralisation ou les tournant
à son avantage.
La mission s'est également préoccupée des moyens en
personnels et des marges de manoeuvres financières nécessaires
aux collectivités locales pour faire face aux besoins des citoyens. Les
performances de leur gestion et l'embellie économique récente ne
doivent pas cacher la fragilité d'une situation financière
aujourd'hui saine mais qui reste à la merci d'un retournement de
conjoncture.
*
*
*
Ces
constats ont conduit la mission d'information à préconiser une
vigoureuse relance de la décentralisation qui passe par la
définition d'un
nouveau contrat de confiance avec l'Etat
, une
nouvelle approche de la déconcentration, une clarification des
responsabilités, la rénovation du système de financement
local, afin de construire, avec l'Etat et non contre l'Etat, une
véritable République territoriale
. Car la
décentralisation n'est rien d'autre qu'une réforme de l'Etat,
qu'il faut mener à son terme.
La République territoriale que votre mission appelle de ses voeux ne
remet pas en cause le cadre unitaire de l'Etat, qui distingue la France des
Etats fédéraux, ni le principe d'indivisibilité de la
République. Il s'agit de promouvoir une conception de la
République qui favorise la
territorialisation de l'action
publique
et qui reconnaisse dans les collectivités locales des
partenaires responsables pour contribuer à faire prévaloir
l'intérêt général dans la diversité.
Après l'étape qui a permis de passer d'un Etat jacobin à
un Etat décentralisé, doit émerger un
Etat partenarial
dans le cadre d'une République territoriale
, fondée sur le
triptyque "
liberté d'initiative, diversité,
responsabilité
" des collectivités territoriales.
La proposition dont le Président Poncelet a pris l'initiative, pour
inscrire dans la Constitution la garantie de l'autonomie fiscale des
collectivités locales et les principes financiers de la
décentralisation, afin de conforter le principe constitutionnel de libre
administration, répond pleinement à cet objectif.
*
*
*
L'ensemble des réflexions de la mission d'information
s'inscrit dans le droit fil des travaux précédemment conduits par
le Sénat autour du thème de la décentralisation, qui ont
à maintes reprises trouvé des traductions législatives.
Trois missions d'information communes à plusieurs commissions ont
été créées en 1983, 1984 et 1990
3(
*
)
afin d'apprécier la mise en oeuvre et les
effets de la réforme. Après la mission d'information sur l'espace
rural, a été constituée une mission sur
l'aménagement du territoire dont les travaux ont largement
alimenté la réflexion préliminaire à la loi
d'orientation de 1995
4(
*
)
. Les commissions des
lois et des finances ont mis en place, en leur sein ou conjointement, des
groupes de travail qui se sont penchés sur la responsabilité
pénale des élus locaux (1995)
5(
*
)
,
sur la décentralisation (1996)
6(
*
)
et sur
les chambres régionales des comptes (1998)
7(
*
)
.
La mission a fait oeuvre aussi complète que possible dans le temps qui
lui a été imparti pour atteindre les objectifs qui lui avaient
été fixés. Ses travaux ne sont cependant qu'une nouvelle
étape dans l'accomplissement par le Sénat de sa mission de
" veilleur " de la décentralisation
. La vigilance de la
Haute Assemblée devra rester constante
pour que les analyses
contenues dans le présent rapport et les orientations retenues par la
mission d'information soient suivies d'effet.
D'autres instances se sont également saisies, plus récemment, de
ce thème de la décentralisation. Le Conseil économique et
social vient ainsi d'adopter un avis sur la décentralisation et le
citoyen
8(
*
)
.
Preuve supplémentaire de l'actualité du sujet, le Premier
ministre a jugé nécessaire de mettre en place en novembre 1999,
près d'un an après le début des travaux de votre mission
d'information, une commission sur l'avenir de la décentralisation, dont
il a confié la présidence à notre collègue Pierre
Mauroy.
Votre mission d'information forme le voeu que toutes ces réflexions
contribuent à donner sa pleine portée à la réforme
ambitieuse que constitue la décentralisation, indispensable à
l'efficacité de l'action publique et à l'affirmation d'une
démocratie proche du citoyen.
PREMIÈRE PARTIE
LA DÉCENTRALISATION ET
L'EFFICACITÉ
DE L'ACTION PUBLIQUE
_____
PREMIÈRE PARTIE
LA DÉCENTRALISATION ET
L'EFFICACITÉ
DE L'ACTION PUBLIQUE
Au
travers des nombreuses auditions auxquelles elle a procédé la
mission d'information a cherché à mesurer quelle était la
contribution de la décentralisation à l'efficacité de
l'action publique.
C'est pourquoi, il lui a tout d'abord paru nécessaire de rappeler le
contexte
dans lequel cette grande réforme avait été
conçue et mise en oeuvre ainsi que les différents défis
qu'elle devra affronter dans les années à venir.
Opérant une
redistribution des pouvoirs
dans le cadre de l'Etat
unitaire et favorisant l'émergence d'une
démocratie de
proximité
, la décentralisation a également eu pour
objet de rechercher une
meilleure efficacité de l'action
publique.
En utilisant pleinement les nouvelles compétences qui leur
ont été reconnues, les collectivités locales se sont
affirmées comme des
acteurs économiques de premier plan
.
Elles ont apporté des
réponses adaptées
à
différentes questions de sociétés qui devraient avoir une
place cruciale dans les prochaines années.
Pourtant l'évaluation à laquelle la mission d'information a
ensuite procédé souligne que plusieurs facteurs sont susceptibles
de
mettre en cause
la contribution de la décentralisation
à une meilleure efficacité de l'action publique.
Les travaux de la mission d'information ont mis en évidence la
complexité du paysage institutionnel de la décentralisation,
complexité à laquelle contribue fortement
l'absence
d'adaptation de l'Etat
à la " nouvelle donne " issue des
lois de 1982-1983. Ils ont également fait ressortir le passage d'une
logique de blocs de compétences à une
cogestion
généralisée
et le plus souvent
inégalitaire
dans les relations entre l'Etat et les
collectivités locales.
Ce dévoiement de l'esprit initial de la réforme est
aggravé par l'inadéquation croissante des moyens mis à la
disposition des collectivités locales. Les rigidités excessives
du
statut de la fonction publique territoriale
ne permettent pas de
prendre en compte les spécificités et les besoins des
collectivités locales. Quant au
système de financement
,
les évolutions récentes, contredisant les principes initiaux,
remettent en cause l'autonomie locale et constituent des entraves au
développement des initiatives.
CHAPITRE PREMIER
LE CONTEXTE : UNE RÉFORME EFFICACE ET
ADAPTÉE
AUX NOUVEAUX DÉFIS SOCIAUX
Cherchant à rompre avec une tradition
pluriséculaire,
la décentralisation a opéré une nouvelle distribution des
pouvoirs dont il était attendu une plus grande efficacité de
l'action publique (I).
Dans ce nouveau cadre, les collectivités locales se sont
affirmées comme des acteurs économiques de premier plan (II).
L'action publique devra dans les prochaines années affronter de nouveaux
défis qu'elle ne pourra relever qu'en faisant toute sa place à
une gestion de proximité (III).
I. LA DÉCENTRALISATION : UNE REDISTRIBUTION DES POUVOIRS AU SERVICE DE L'EFFICACITE DE L'ACTION PUBLIQUE
A. L'EMERGENCE DIFFICILE DE L'IDEE DE DECENTRALISATION
1. Un long cheminement
a) Une histoire " cahotique "
Les
travaux préparatoires de la loi du 2 mars 1982 ont bien mis en
évidence que, tout en étant
au coeur du débat
politique
, l'idée de décentralisation a rencontré au
cours de notre histoire institutionnelle de
nombreux obstacles.
Comme le soulignait Charles Eisenmann il n'y a de véritable
décentralisation "
que si et dans la mesure où les
autorités locales reçoivent le pouvoir de poser des règles
ou des normes d'espèce avec la liberté que leur laisse la
législation
sans être soumises à aucune volonté
d'une autorité administrative d'Etat
", si ce n'est en
matière de contrôle de la légalité car "
la
primauté ou simplement le caractère obligatoire de la loi pour
l'autorité administrative ne constitue en aucune façon une
subordination quelconque de l'autorité administrative locale à
l'administration de l'Etat ; elle ne la fait nullement dépendre de
celle-ci ; les interventions de légalité et les pouvoirs
correspondants de l'administration d'Etat ne restreignent point le degré
de décentralisation... puisqu'ils en font simplement respecter la
mesure
"
9(
*
)
.
Mais, en 1976, le rapport "
Vivre ensemble
", établi
par Olivier Guichard, pouvait constater que le
caractère
national
, accusant le centralisme déjà avancé de nos
institutions, avait freiné le développement des
responsabilités locales.
Le même rapport décrivait
trois facteurs
qui ont
joué dans le sens de la centralisation :
- le goût du
recours hiérarchique
qui pousse à en
appeler toujours à une autorité supérieure ;
- le
goût de l'égalité
, qui se traduit par un
glissement insensible de l'égalité vers l'égalitarisme et
l'uniformité ;
- le
goût de la sécurité
, qui conduit à faire
appel à l'Etat jugé mieux placé que quiconque pour assurer
cette sécurité.
Les politiques de décentralisation ont eu, en effet, bien du mal
à s'imposer. Aux premières années de la Révolution
qui ont paru privilégier une certaine volonté
décentralisatrice ont succédé le
centralisme
jacobin
de la Convention puis, après l'intermède du
Directoire, la
centralisation napoléonienne
.
La
Monarchie de Juillet
instaura à nouveau par la loi du 21 mars
1831 pour les communes et par la loi du 22 juin 1833 pour les
départements, l'élection des conseillers municipaux et des
conseillers généraux, supprimée sous le Consulat. La loi
du 18 juillet 1837 reconnut par ailleurs la personnalité civile de la
commune tandis que la loi du 10 mai 1838 opéra implicitement la
même reconnaissance au profit des départements. Ces deux textes
augmentèrent également les compétences des conseils
municipaux et des conseils généraux.
Cette évolution fut mise en cause par le
second Empire
qui a
l'inverse augmenta encore les pouvoirs de l'Etat même si sur son
déclin il dut prendre en compte les aspirations à plus de
liberté locale en reconnaissant aux conseils généraux et
aux conseils municipaux de véritables pouvoirs de décision (lois
du 10 juillet 1866 et du 24 juillet 1867).
Les débuts de la
IIIè République
furent
marqués par des réformes majeures dont certains effets se font
encore sentir. Les lois du 10 août 1871 et du 5 avril 1884
dotèrent respectivement le département et la commune
d'institutions qui ne furent guère modifiées avant la
réforme de 1982.
La loi du 10 août 1871 a prévu que le conseil
général serait désigné sur la base d'un conseiller
général par canton, élu pour six ans, le conseil
général étant renouvelé par moitié tous les
trois ans. Le conseil général pouvait prendre des
décisions sans approbation préalable du préfet mais ne
disposait pas d'un pouvoir de décision sur l'ensemble des affaires
départementales. Il pouvait seulement émettre des voeux sur
toutes les questions économiques et d'administration
générale. En outre, le représentant de l'Etat restait
l'organe exécutif
du conseil général,
compétent pour instruire les affaires et exécuter les
décisions.
La loi municipale du 5 avril 1884 a affirmé le principe de
l'élection de tous les maires par les conseils municipaux et
consacré une véritable
clause générale de
compétences
au profit du conseil municipal qui règle
désormais "
par ses délibérations les affaires de
la commune
".
Si l'on met à part l'acte du 16 novembre 1940 qui instaura la nomination
des conseils municipaux dans les communes de plus de 2 000 habitants et l'acte
du 12 octobre 1940 qui suspendit les conseils généraux, cet
équilibre, pour l'essentiel, prévaudra jusqu'aux lois de
décentralisation.
Après le rétablissement, à la
Libération,
du
système antérieur, la
Constitution du 27 octobre 1946
consacra plusieurs articles aux libertés locales qui affirmèrent
notamment le principe de la libre administration des collectivités
locales dans le cadre de la loi nationale. L'article 89 de la Constitution
ouvrit la voie à de nouvelles réformes. Néanmoins le
projet de loi présenté en 1947 qui prévoyait de
transférer les attributions du préfet a un élu ne put
aboutir.
Le titre XII de la
Constitution du 4 octobre 1958
, entièrement
consacré aux collectivités territoriales, réaffirme le
principe de libre administration des collectivités locales par des
conseils élus.
b) Une double dépossession
Au cours
de cette histoire institutionnelle " cahotique ", les
collectivités locales ont dû lutter contre un
double
phénomène de dépossession
, décrit par notre
ancien collègue Michel Giraud dans le rapport qu'il établit au
nom de votre commission des Lois sur le projet de loi dont fut issue la loi du
2 mars 1982.
En premier lieu, un phénomène de
dépossession
légale
résulta de l'adoption de diverses lois qui, n'ayant
pas les collectivités locales pour objet principal, eurent
néanmoins un effet sur la répartition des compétences
existantes. La plupart du temps, ces modifications aboutirent à un
transfert de compétences des collectivités
décentralisées vers l'Etat. On aboutit de cette façon
à une
" nationalisation "
d'activités
considérées jusque là comme locales. Cette
dépossession répondait au double objectif de
restreindre la
liberté d'action
des collectivités locales et
d'uniformiser les modalités de gestion.
Elle s'exerça dans
de nombreux domaines : budget communal et départemental, gestion du
personnel, coopération, marchés locaux, ordre public,
enseignement, action sanitaire et sociale, urbanisme.
A cette dépossession légale s'ajouta une
dépossession
administrative
. Les administrations de l'Etat prirent, en effet, l'habitude
d'intervenir sous la forme de règlements qui, sans dessaisir, au moins
en théorie, les autorités locales, ont contribué à
limiter leurs pouvoirs
de manière significative. Cette
dépossession administrative s'est manifestée sous diverses
formes : subventions, classification des investissements, concours des
services techniques, règlements-type et normes techniques, classement
qui permet à l'Etat d'imposer ses normes aux collectivités
locales, cartes et schémas (carte scolaire, carte hospitalière,
carte routière).
Le rapport " Vivre ensemble " pouvait ainsi faire en ces termes, en
1976, le constat d'un " Etat gonflé " :
"
La situation d'aujourd'hui, c'est d'abord un Etat qui a
absorbé en lui presque toute la substance administrative.
Au
regard des responsabilités locales, elle est évidemment malsaine.
Mais elle l'est aussi si l'on a le souci de la dignité de l'Etat ou
de
l'efficacité administrative
.
" L'Etat en effet s'est
englué dans le quotidien
. Il est de
plus en plus appelé à entrer dans la
gestion quotidienne
des français : éducation, habitat, santé, etc. Par
lui-même ou par personne interposée, il gère telle prime ou
indemnité, dispense tel avantage. Il sécrète à
cette fin une réglementation détaillée et pointilliste,
à laquelle les fonctionnaires s'accrochent ensuite avec passion.
" Ainsi pris, l'Etat n'a souvent ni le temps ni le recul suffisant pour
jouer le jeu que la collectivité attend de lui : surveiller les
grands équilibres, poser les règles de la vie en
société, en contrôler le respect.
En revanche, il s'est
substitué au rôle normal des collectivités
locales.
"
Ce rapide aperçu historique est
riche d'enseignements
au regard
de la situation actuelle dont votre mission d'information a été
chargée de faire le bilan. Il met, en effet, en évidence, d'une
part, la tentation permanente de l'Etat de
reprendre
de manière
expresse ou insidieuse les compétences reconnues aux
collectivités locales, d'autre part, les conséquences
très négatives
de cette propension de l'Etat sur
l'efficacité de l'action publique.
2. Une affirmation progressive
a) Un réel mouvement de décentralisation
Pour
autant, à la veille des lois de décentralisation, une
série de dispositions adoptées depuis 1958 avaient donné
une
plus grande liberté
aux collectivités locales et
parallèlement accru la
déconcentration
de l'organisation
de l'Etat.
Le mouvement de décentralisation a d'abord concerné
l'allègement des tutelles.
La loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 a ainsi supprimé
l'approbation préalable du budget des communes et réduit de
manière très significative le nombre des
délibérations des conseils municipaux soumises à cette
approbation.
La loi du 5 juillet 1972 a par ailleurs créé la région
qu'elle a érigée en établissement public à vocation
spécialisée. La région fut la principale
bénéficiaire de
l'effort de déconcentration
engagée en particulier à compter de 1964, année de
publication du décret organisant la coordination des services de l'Etat
dans le département suivant des règles renforçant
l'autorité des préfets. La région a également
bénéficié de la déconcentration des crédits
d'investissement public décidée par le décret n°
70-1049 du 13 novembre 1970 qui classait ces investissements en quatre
catégories I, II, III et IV, les conseils régionaux pouvant
émettre un avis sur la répartition des crédits de la
catégorie II.
En 1975, une volonté de procéder à une
réforme
globale
s'est affirmée. Elle a été formalisée
dans un plan de développement des responsabilités des
collectivités locales, lequel s'est traduit par l'adoption de deux
textes législatifs importants : la loi du 3 janvier 1979 instituant
une dotation globale de fonctionnement et la loi du 10 janvier 1980
aménageant la fiscalité directe locale.
En matière
fiscale
et
financière
, la loi du 10
janvier 1980 a permis aux conseils municipaux et aux conseils
généraux de voter directement les taux alors que jusque là
ils ne pouvaient se prononcer que sur des produits. La loi du 3 janvier 1979 a
par ailleurs institué la
dotation globale de fonctionnement
qu'elle a indexée sur la taxe à la valeur ajoutée. Le
système de globalisation a été étendu aux dotations
d'investissement à travers le
fonds de compensation de la taxe
à la valeur ajoutée
destiné à compenser la taxe
à la valeur ajoutée payée par les collectivités
locales sur leurs investissements. La même globalisation a
été prévue en matière de prêt sous la forme
notamment d'un prêt d'équipement courant.
b) Une étape importante : le projet de loi relatif au développement des responsabilités locales
En
adoptant en première lecture, le 22 avril 1980, après quinze mois
de travaux, le projet de loi relatif au développement des
responsabilités locales, présenté au nom du Gouvernement
par notre collègue Christian Bonnet, alors ministre de
l'intérieur, le Sénat a assumé pleinement son rôle
constitutionnel de
représentant des collectivités
territoriales.
Ce projet de loi a marqué une étape importante dans le processus
de décentralisation. Texte complet, il a accru les libertés
locales, prévu de nouveaux moyens pour l'exercice de ces libertés
et déterminé un partage des compétences entre l'Etat, la
commune et le département.
Supprimant les principales entraves aux libertés locales, le projet de
loi reconnaissait une
liberté juridique
aux collectivités
locales en précisant que les décisions des autorités
locales prenaient un caractère exécutoire dès leur
affichage. Le dépôt à la préfecture ou à la
sous-préfecture était maintenu mais uniquement pour permettre au
préfet d'exercer son contrôle de légalité par la
voie du pouvoir d'annulation qui était préservé, à
l'exclusion de tout contrôle d'opportunité. Le nombre de cas
où l'approbation de l'autorité de tutelle était
exigée pour les délibérations des conseils municipaux
était réduit à trois : emprunts et garanties
d'emprunt au-delà de certains seuils d'endettement, traitement et
indemnités des personnels, interventions dans le domaine
économique et social.
Parallèlement le projet de loi
allégeait la tutelle
financière
et prévoyait la
fin de la tutelle
technique
, un processus d'allègement des normes devant être
engagé ainsi que leur codification dans un code des prescriptions
techniques soumis au Parlement et qui serait seul opposable aux
collectivités locales.
Afin de faciliter l'exercice de ces libertés nouvelles, le projet de loi
prévoyait des dispositions relatives aux
mandats locaux
qui
tendaient notamment à accorder un temps suffisant aux salariés du
secteur privé pour exercer leur mandat. Il cherchait également
à améliorer le
statut du personnel
communal, en
renforçant leur qualification, en rapprochant leur statut de celui des
fonctionnaires de l'Etat et en affirmant le rôle des élus
notamment en matière de nomination.
Le titre II du projet de loi comprenait un ensemble de dispositions relatives
à la
clarification des compétences.
Parmi les
compétences transférées à l'Etat figuraient la
justice et la police. Les compétences étaient partagées
selon le principe des blocs de compétences. Tel était en
particulier le cas pour l'action sociale et l'éducation. Ainsi, dans ce
dernier domaine, le département se voyait confier les transports
scolaires et les collèges. L'Etat ne conservait que les lycées et
les universités. Il prenait en charge l'indemnité de logement des
instituteurs. Des
compensations financières
aux transferts de
charges étaient prévues.
Malheureusement, cette importante réforme n'a pu aboutir avant les
échéances électorales de 1981.
Mais, au total, les lois de décentralisation de 1982-1983 sont venues
parachever un mouvement déjà
largement amorcé
au
cours des années précédentes, notamment grâce
à l'impulsion du Sénat.
Ce constat met en évidence qu'en dépit des nombreux obstacles qui
se sont dressés devant elle au cours de notre histoire institutionnelle,
la décentralisation s'est néanmoins imposée comme une
nécessité.
Permettant une distribution des pouvoirs
plus conforme aux exigences démocratiques
, elle constitue
également une forme de mise en oeuvre de l'action publique qui en assure
l'efficacité.
Cette double caractéristique
est au coeur
de la réforme opérée en 1982.
B. LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA DÉCENTRALISATION
1. Une nouvelle distribution des pouvoirs dans un Etat unitaire
a) Une nouvelle distribution des pouvoirs
Une
réflexion sur la décentralisation est indissociable d'une
réflexion sur l'organisation des pouvoirs. Rompant avec le modèle
de l'Etat centralisé, la décentralisation implique, en effet, une
nouvelle distribution des pouvoirs.
Le modèle de
l'Etat centralisé
qui s'est longtemps
imposé dans notre pays repose d'abord sur l'idée selon laquelle
l'Etat est seul à même de
définir l'intérêt
général
et d'
arbitrer
entre celui-ci et les
intérêts particuliers. L'Etat se voit reconnaître un
rôle exclusif pour
structurer
et
coordonner
les
activités de la société. De cette conception du rôle
de l'Etat, découle le
pouvoir de contrôle
a priori
qu'il doit exercer sur toute initiative afin d'assurer la conformité
des initiatives à l'intérêt général et leur
uniformité sur l'ensemble du territoire. En découlent
également le
pouvoir d'arbitrage
qui lui est octroyé afin
de veiller à l'égalité entre les citoyens, ainsi que le
pouvoir d'expertise
qu'exerce territorialement l'administration de
l'Etat.
La décentralisation, au contraire, doit permettre aux
collectivités locales de disposer d'une certaine
liberté de
décision
pour définir les normes de leurs actions et les
modalités de leurs interventions. Elle traduit donc un
nouvel
équilibre
dans la répartition des pouvoirs.
Cette nouvelle conception des rapports entre l'Etat et les collectivités
locales a été remarquablement exprimée par la
Général de Gaulle dans un discours
célèbre (Lyon, le 24 mars 1968) :
"
L'évolution générale porte, en effet, notre pays
vers un équilibre nouveau. L'effort multiséculaire de
centralisation, qui fut longtemps nécessaire pour réaliser et
maintenir son unité malgré les divergences des provinces qui
étaient successivement rattachées, ne s'impose plus
désormais. Au contraire, ce sont les activités régionales
qui apparaissent comme les ressorts de la puissance économique de
demain.
"
La loi du 2 mars 1982 exprime la nouvelle donne que la décentralisation
introduit dans l'organisation des pouvoirs, en tout premier lieu en
transférant le pouvoir exécutif du préfet aux
présidents des conseils général et régional, la
région étant érigée en collectivité locale
de plein exercice. Faisant référence à l'article 72 de la
Constitution, son article premier dispose que "
les communes, les
départements et les régions s'administrent librement par des
conseils élus
". Le même article jette les bases de cette
nouvelle organisation en prévoyant que "
des lois
détermineront la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que la
répartition des ressources publiques résultant de nouvelles
règles de la fiscalité locale et de transfert de crédits
de l'Etat aux collectivités locales, l'organisation des régions,
les garanties statutaires accordées aux personnels des
collectivités locales, le mode d'élection et le statut des
élus, ainsi que les modalités de la coopération entre
communes, départements et régions, et le développement de
la participation des citoyens à la vie locale. "
La loi du 2 mars 1982 traduit ainsi la définition de la
décentralisation que le Premier ministre, notre collègue Pierre
Mauroy, donnait devant l'Assemblée nationale
10(
*
)
:
"
Une France responsable, c'est aussi un pays qui doit désormais
enraciner l'unité de la République dans la diversité et la
responsabilité de ses collectivités locales. Il s'agit donc de
faire disparaître l'image d'une France centralisée à
l'extrême, enfermée dans la rigidité de ses textes, de ses
règlements et de ses circulaires.
"
Plusieurs conséquences résultent de cette nouvelle
répartition des responsabilités. D'abord, les
collectivités locales ne doivent pas se trouver dans une situation de
dépendance
à l'égard des administrations de l'Etat,
étant précisé que la liberté qui leur est reconnue,
en raison du caractère indivisible de la République, concerne
l'
administration
et non la
législation.
En outre,
dès lors qu'elle reconnaît une certaine autonomie de
décision aux collectivités locales, la décentralisation
doit nécessairement se traduire par une acceptation de la
diversité des situations locales.
Enfin, elle induit un
nouveau mode de définition de l'intérêt
général,
lequel n'est plus du ressort exclusif de l'Etat mais
au contraire peut, dans certains domaines, être défini et
porté par les acteurs décentralisés.
Telle qu'elle a été conçue par la loi du 2 mars 1982, la
décentralisation a aussi un effet sur le type de relations qui se
développent entre les collectivités elles-mêmes. Elle
exclut, en effet,
toute hiérarchisation
entre
collectivités.
b) Le maintien des principes de l'Etat unitaire
Tout en
confiant de nouvelles responsabilités aux collectivités locales,
la décentralisation n'a pas remis en cause les principes de l'Etat
unitaire.
D'abord, elle ne reconnaît aux collectivités locales qu'une
compétence d'attribution
. Les lois de 1983 sur les
compétences ont eu pour objet de retirer à l'Etat certaines
compétences pour les confier aux collectivités qui paraissaient
les mieux à même de les exercer. Mais elles n'ont pas
procédé à une refonte globale de la répartition des
compétences. En particulier, elles n'ont pas appliqué dans toute
sa portée le principe de subsidiarité, caractéristique des
Etats fédéraux, qui veut que ne soient confiées au niveau
central que les seules questions qui ne peuvent être traitées de
manière satisfaisante au niveau local.
Ensuite et surtout, là où dans un Etat fédéral les
conflits sur la répartition des compétences sont
réglés par une cour suprême, l'article 72 de la
Constitution confie au délégué du Gouvernement dans les
départements et territoires "
la charge des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect
des lois
".
Comme on le sait, le Conseil constitutionnel a veillé au respect des
prérogatives de l'Etat en considérant que
" si la loi
peut fixer les conditions de la libre administration des collectivités
territoriales, c'est sous la réserve qu'elle respecte les
prérogatives de l'Etat (...) ; que ces prérogatives ne
peuvent être ni restreintes ni privées d'effets, même
temporairement ; que l'intervention du législateur est donc
subordonnée à la condition que le contrôle administratif
prévu par l'article 72 (alinéa 3) permette d'assurer le respect
des lois et, plus généralement, la sauvegarde des
intérêts nationaux auxquels, de surcroît, se rattache
l'application des engagements internationaux contractés à cette
fin
" (décision n° 82-137 DC du 25 février 1982).
Plus généralement, le juge constitutionnel balance dans
l'interprétation du principe de libre administration entre la
liberté
et la
contrainte.
Ainsi les conseils élus des collectivités territoriales doivent
être "
dotés d'attributions effectives
"
(décision n° 85-196 DC du 8 août 1985) ; la loi ne doit
pas imposer aux collectivités locales des
contraintes excessives
(décisions n° 83-168 DC du 20 janvier 1984 ; n°
98-407 DC du 14 janvier 1999) ; de même si le
législateur a le pouvoir "
de déterminer les limites
à l'intérieur desquelles une collectivité territoriale
peut être habilitée à fixer elle-même le taux d'une
imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses, les
règles posées par la loi ne sauraient avoir pour effet de
restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au
point d'entraver la libre administration
" (décisions n°
90-277 DC du 25 juillet 1990 ; n° 98-405 DC du 29
décembre 1998).
Pour autant le principe de libre administration n'interdit pas, selon le juge
constitutionnel, d'imposer des
contraintes
aux collectivités
locales, contraintes qui peuvent s'avérer
très lourdes
et
de nature à
réduire singulièrement leur liberté
de décision.
Ainsi, les collectivités locales peuvent se voir
contraintes par la loi d'agir en partenariat avec l'Etat comme dans le cas du
revenu minimum d'insertion ou encore se voir imposer des dépenses
obligatoires, par exemple pour le financement du logement social, à
condition qu'elles aient un objet et une portée précis, qu'elles
ne soient pas contraires aux compétences propres des
collectivités locales et qu'elles ne heurtent pas à la libre
administration juridique et financière de celles-ci (décision
n° 90-274 du 29 mai 1990).
2. La recherche d'une meilleure efficacité de l'action publique
a) Un Etat recentré sur ses compétences essentielles
Opérant une nouvelle distribution des pouvoirs, la
décentralisation cherche également à promouvoir une
nouvelle conception de l'action publique qui doit en
renforcer
l'efficacité.
En transférant de l'Etat aux collectivités locales un certain
nombre de compétences, elle cherche à définir le niveau
d'administration qui pourra exercer ces compétences
de la
manière la plus efficace.
Cet objectif se traduit dans la méthode adoptée pour
opérer les transferts de compétences. Ces transferts sont, en
effet, définis en fonction
de
la
vocation principale
de
chaque niveau de collectivité. Il s'agit donc bien de rechercher pour
chaque groupe de compétences, quelle est la collectivité qui,
compte tenu notamment de sa dimension géographique, de son
expérience dans le domaine considéré et de ses moyens
matériels et humains, sera la mieux placée pour en exercer la
responsabilité.
En outre, dès lors qu'une collectivité a vocation à
assumer une compétence donnée, le principe retenu est de lui
confier
l'ensemble des attributions
relatives à cette
compétence.
En fixant le principe que les transferts de compétences doivent
être accompagnés des
transferts des ressources
correspondantes
, les lois de décentralisation expriment
l'idée selon laquelle les nouvelles règles relatives aux
compétences ne doivent pas avoir
d'incidences sur les finances
publiques
. En conséquence, l'Etat ne doit pas saisir cette occasion
pour opérer des
transferts de charges
, obligeant les
collectivités locales à augmenter le niveau des
prélèvements obligatoires pour pourvoir assumer ces charges non
ou insuffisamment compensées.
Cette efficacité dans la prise en charge des compétences doit
produire ses effets dans les
missions assumées par l'Etat.
Celui-ci, déchargé d'un certain nombre de tâches
gérées plus efficacement par les collectivités locales,
doit, en effet, pouvoir se consacrer à ses
missions
fondamentales
. Il reste, en particulier, responsable des tâches de
souveraineté : affaires étrangères, défense,
justice, sécurité. Les lois de décentralisation renforcent
son rôle dans ces deux derniers domaines.
L'Etat demeure, en outre, en charge de la définition et de la mise en
oeuvre de la politique, économique et sociale de la nation. Il dispose
seul du pouvoir de réglementation générale.
Cherchant à assurer la pertinence de l'action publique, c'est à
dire l'adéquation entre les formes de l'action administrative et la
nature des problèmes posés, la décentralisation peut ainsi
permettre de promouvoir la
bonne " gouvernance "
, notion qui,
selon la définition donnée devant votre mission d'information par
M. Pierre Calame, président de la Fondation Charles Léopold
Meyer, permet de couvrir à la fois l'organisation des pouvoirs publics
et les rapports entre ces derniers et l'administration, ainsi que la
société civile.
b) Une organisation administrative rationalisée
Cette
bonne " gouvernance " doit également s'exprimer dans la
nouvelle organisation administrative qui résulte des transferts de
compétences de l'Etat vers les collectivités locales.
Ces transferts doivent, en effet, se traduire par la mise à disposition
des collectivités locales des moyens nécessaires à leur
exercice. En conséquence, les services ou parties de services de l'Etat
qui exercent
exclusivement
des compétences désormais
confiées à une collectivité locale doivent être
transférés
à cette dernière. Les autres
services sont mis à disposition des collectivités.
En outre, les transferts de compétences doivent en principe avoir des
conséquences sur l'organisation des administrations de l'Etat qui
continuent à relever de ce dernier.
Il est, en effet, généralement admis qu'il n'y a pas de bonne
décentralisation sans une
déconcentration
parallèle
de l'organisation des services de l'Etat. Les élus locaux, dotés
de nouvelles compétences par les lois de décentralisation,
doivent pouvoir s'adresser au niveau local à un représentant de
l'Etat ayant des
attributions effectives
lui permettant d'engager l'Etat
sans en référer systématiquement à l'échelon
central.
Parce qu'elle est destinée à assurer une plus grande
efficacité de l'action publique, la décentralisation doit donc
également permettre de renforcer l'organisation des administrations de
l'Etat qui,
plus déconcentrées
, doivent être mieux
à même de s'adapter à la diversité et aux
évolutions des situations locales.
3. Une démocratie de proximité
a) Un processus de décision proche des citoyens
Enfin,
la décentralisation a favorisé l'émergence d'une
véritable démocratie de proximité, en rapprochant le
processus de décision des citoyens.
Elle rompt ainsi avec un mouvement pluriséculaire qui avait construit
pour l'essentiel la démocratie et la citoyenneté autour de l'Etat.
Devant votre mission d'information, M. Pierre Calame, président de la
Fondation Charles-Léopold Meyer a fait valoir qu'en France l'idée
était profondément enracinée que l'Etat était du
côté de la raison, tandis que la société civile
était soumise aux émotions : le regard des pouvoirs publics
sur les administrés est donc teinté de paternalisme, l'Etat
mettant en avant sa légitimité, soit à travers la
défense de l'intérêt général, soit au nom
d'impératifs de rationalité technique.
Par le nouveau processus de décision qu'elle met en place, la
décentralisation crée un cadre nouveau qui substitue une
démocratie de citoyens
à une société
d'administrés.
Les
36 000
communes de France - trop souvent présentées
comme un handicap - constituent de précieux foyers de démocratie
locale. Elles contribuent à maintenir des repères de
proximité particulièrement nécessaires dans un monde de
plus en plus ouvert sur l'extérieur. Dès lors que leur existence
se conjugue avec une intercommunalité indispensable à la
rationalisation des compétences, elles peuvent donc constituer un
véritable atout.
Les
500 000
élus locaux jouent un rôle indispensable dans
la gestion des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Ils
assument ainsi une véritable mission de médiateurs sociaux. En
témoignent les nombreuses initiatives des maires pour répondre
aux déchirures du tissu social sous l'effet de la situation
économique ainsi que l'adaptation permanente des conseils
généraux à la diversité des besoins en
matière d'action sociale.
b) Une capacité d'adaptation et d'innovation
Cette
démocratie de proximité permet également de
libérer les initiatives
et ainsi de mieux
adapter le tissu
local
aux nouveaux défis qu'il doit affronter.
En consacrant son 82
è
congrès, qui marquait le passage
à l'an 2000, au thème "
Le maire et
l'innovation
", l'Association des Maires de France a mis en
évidence
l'implication
très forte des élus locaux
dans une démarche qui, considérée comme indispensable dans
la vie des entreprises, s'impose aux collectivités territoriales comme
un moyen de sortir des sentiers battus et d'inventer des réponses
à des situations nouvelles.
Cette capacité d'adaptation des collectivités locales à
une réalité mouvante peut également être
observée dans le domaine des
nouvelles technologies de
l'information.
Dans le souci de rationaliser la gestion locale mais aussi dans une perspective
d'aménagement du territoire et de développement
économique, certaines d'entre elles ont notamment
développé leurs propres
infrastructures de
télécommunications
. Ces infrastructures doivent notamment
leur permettre de mettre des services de télécommunications -
souvent à hauts débits, c'est à dire offrant plus de
possibilités que le réseau téléphonique
traditionnel - à la disposition des services municipaux, voire
d'opérateurs de télécommunications offrant à leur
tour des services aux entreprises et aux citoyens.
Votre mission d'information a déjà eu l'occasion de regretter que
l'Assemblée nationale ayant refusé de suivre le Sénat,
lors de l'examen de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire, les
incertitudes juridiques concernant ces initiatives particulièrement
utiles n'aient pas été levées en dépit de
l'insertion d'un nouvel
article L. 1511-6
dans le code
général des collectivités territoriales qui a tenté
de fixer le droit en la matière
11(
*
)
.
Plus généralement, comme l'avait souligné la mission
sénatoriale d'information sur l'entrée dans la
société de l'information, les collectivités locales sont
entrées dans un " deuxième âge " de
l'informatique, grâce d'importants efforts d'équipements. Ayant
atteint un niveau d'équipements satisfaisant en " informatique de
production ", elles sont entrées dans
l'" informatique
communicante ",
sous l'effet notamment des développements
liés à Internet
12(
*
)
.
En outre, le
câble
constituant un vecteur privilégié
d'accès au réseau mondial, les collectivités locales, dont
certaines se sont impliquées directement dans le développement
des réseaux câblés, peuvent jouer un rôle majeur dans
la concrétisation de la société de l'information.
II. L'AFFIRMATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES COMME DES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE PREMIER PLAN
A. LA PLACE DES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS L'ÉCONOMIE NATIONALE
Les
tentatives de mise en évidence de la place des collectivités
locales dans l'économie nationale se heurtent à des
difficultés d'ordre statistique
13(
*
)
. Ces
difficultés tiennent tout d'abord au fait que les recensements
statistiques, et notamment la comptabilité nationale, ne distinguent pas
toujours les collectivités locales proprement dites de l'ensemble des
administrations publiques locales (APUL). Par ailleurs, si les statistiques du
ministère de l'intérieur et de la direction de la
comptabilité publique isolent les collectivités locales au sens
strict, leur mode de comptabilisation résulte de la synthèse des
comptes et non de leur consolidation, ce qui ne permet pas d'éliminer
les doubles comptes (par exemple les flux entre collectivités).
En outre, la catégorie des APUL retenue par la comptabilité
nationale n'appréhende pas l'ensemble du secteur public local. Sont
ainsi tenus à l'écart les hôpitaux publics ou privés
assurant une mission de service public, les sociétés HLM,
certaines associations et, surtout, les sociétés
d'économie mixte (SEM) ainsi que les entreprises privées ayant
reçu délégation de service public.
Malgré ces difficultés, il est possible de dégager des
tendances.
1. Une place significative
La contribution du secteur public local à l'économie nationale est généralement mise en évidence par le volume des recettes et des dépenses des administrations publiques locales (APUL) dans le produit intérieur brut (PIB).
Les administrations publiques locales (APUL) et le PIB
(en % du PIB)
|
|
1970
|
1975
|
1982
|
1987
|
1992
|
1992
|
1995
|
1998
|
|
1. DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (APU) |
43,7 |
49,2 |
56,9 |
56,3 |
54 |
52,9 |
55,2 |
54,2 |
|
Dépenses de l'Etat |
21,7 |
22,1 |
24,5 |
23,8 |
- |
23,7 |
24,1 |
23,7 |
|
Dépenses des APUL |
6,9 |
8,1 |
9 |
9,5 |
10 |
9,8 |
10 |
9,8 |
|
2 . RECETTES DES APU |
44,6 |
46,8 |
54,4 |
55 |
54,8 |
48,8 |
49,7 |
51,5 |
|
Recettes de l'Etat, dont : |
22,7 |
20,3 |
22,6 |
21,6 |
- |
20,4 |
19,9 |
20,6 |
|
Recettes fiscales de l'Etat |
18,5 |
16,3 |
18,1 |
17,3 |
- |
16,7 |
16,5 |
16,9 |
|
Recettes des APUL, dont : |
6 |
7,2 |
8,2 |
9,4 |
- |
9,3 |
9,8 |
10,2 |
|
Recettes fiscales perçues au profit des APUL * |
3,4 |
4,1 |
4,8 |
5,9 |
6,3 |
5 |
5,5 |
5,8 |
* La
comptabilité nationale regroupe sous cet intitulé le produit de
la fiscalité locale et les prélèvements sur les recettes
de l'Etat au profit des collectivités locales.
Données chiffrées : Rapport économique, social et
financier (PLF 2000), rapport sur les comptes de la Nation de l'année
1993 (PLF 95).
Le
tableau ci-dessus permet de mettre en évidence deux
phénomènes :
-
l'augmentation de la part des administrations publiques locales dans le
produit intérieur brut au cours des trente dernières
années
. Cette part a augmenté fortement entre 1970 et le
milieu des années 80, puis s'est plus ou moins stabilisée
s'agissant des dépenses, tandis que l'augmentation de la part des
recettes locales dans le PIB se poursuit à un rythme ralenti .
-
un rééquilibrage en cours entre la part relative de l'Etat
dans le PIB et celle des administrations publiques locales
. Là
encore, on constate un fort rattrapage entre 1970 et le milieu des
années 70, puis une certaine stabilisation à partir du milieu des
années 80. Ainsi, la part des dépenses de l'Etat dans le PIB
était 3,1 fois supérieure à celle des APUL en 1970, 2,5
fois supérieure en 1987 et 2,4 fois supérieure en 1998. Pour les
recettes, la part de l'Etat dans le PIB était 3,7 fois supérieure
en 1970, 2,2 fois supérieure en 1987 et 2 fois supérieure en 1998.
Dans les deux cas, on constate une coïncidence entre la mise en oeuvre des
transferts de compétences prévus par les lois de
décentralisation et la stabilisation des parts de l'Etat et des
collectivités locales dans le produit intérieur brut.
2. Un facteur de croissance pour l'économie nationale
La
structure des dépenses des administrations publiques locales est
très différente de celle de l'Etat. Elle se caractérise
notamment par une place plus importante accordée à
l'investissement ou, pour employer la terminologie de la comptabilité
nationale, à la formation brute de capital fixe (FBCF).
Ainsi, en 1998, alors que la part des dépenses de l'Etat dans le PIB
était 2,4 fois supérieure à celle des APUL, la FBCF de ces
dernières représentait 2 % du produit intérieur brut
alors que celle de l'Etat s'établissait à 0,5 %, soit un
rapport de 1 à 4 en faveur du secteur local. En 1985, la part dans le
PIB de la FBCF des administrations publiques locales était 5,5 fois
supérieure à celle de la FBCF de l'Etat.
Depuis le début des années 90, environ les
deux tiers de
l'investissement public
sont réalisés par les administrations
publiques locales. En 1997, les dépenses d'investissement
représentaient 34,5 % des dépenses totales des
collectivités locales (communes, départements, régions)
tandis que les dépenses en capital correspondaient à 10,6 %
des dépenses inscrites au budget général de l'Etat.
La formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques
(en millions de francs)
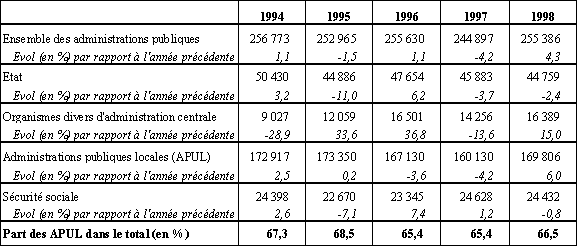
Données chiffrées : rapport sur les comptes de la Nation de
l'année 1998.
L'impact
des variations de l'investissement local sur le produit intérieur brut,
donc sur l'évolution de la richesse nationale, a été
analysé par Jacques Méraud dans une étude portant sur
l'évolution des comptes des administrations publiques locales entre 1959
et 1994 et dont la conclusion est la suivante : "
Dans le cas des
administrations locales, ce sont les variations de l'investissement qui
influent le plus sur la croissance nationale, et cela dans un sens
positif : "
plus l'investissement public local augmente, plus le
PIB est stimulé
". On observe un effet stimulant analogue de
l'investissement des administrations locales sur la productivité et
l'emploi du secteur privé. Il y a là une manifestation
significative de ce qu'on appelle la croissance endogène.
".
Ce résultat est d'autant plus significatif qu'il est constaté sur
l'ensemble de la période étudiée alors que les autres
corrélations mises en évidence par M. Méraud
(" moins le PIB progresse, plus les frais financiers augmentent "
et
" plus le PIB progresse, plus les transferts sociaux
s'accroissent
") tendent à s'affaiblir après 1980. Par
ailleurs, aucune corrélation entre l'évolution du PIB et celle de
l'investissement de l'Etat n'a été mise en évidence.
B. L'EFFICACITÉ DE LA GESTION DECENTRALISÉE
1. L'assainissement financier
La
situation financière des collectivités locales
14(
*
)
n'est pas uniforme. De fortes disparités sont
constatées au sein de chaque catégorie de collectivités,
entre les différentes strates de population et même au sein de
chaque strate. Par conséquent, de même que les excès
constatés ça et là dans les années 80 n'ont jamais
été représentatifs de la situation financière des
collectivités locales, il convient en préambule de rappeler que
le redressement spectaculaire constaté depuis le milieu des
années 90 ne concerne malheureusement pas tous les exécutifs
locaux.
Malgré cette réserve, il est aujourd'hui avéré que,
dix-huit ans après les lois de décentralisation, les
gestionnaires locaux, élus et fonctionnaires territoriaux, ont acquis
une
expertise en matière financière
qui produit des
résultats auxquels l'Etat serait bien en peine d'aboutir.
Cette expertise se manifeste par le caractère de plus en plus
sophistiqué de la gestion financière des collectivités,
notamment en matière de gestion de trésorerie. A ce sujet, il est
frappant de constater que la revendication de la possibilité pour les
collectivités d'émettre des billets de trésorerie à
court terme rencontre un écho grandissant. Dans le même ordre
d'idée, on constate que les collectivités hésitent de
moins en moins à affronter l'épreuve de la notation par des
agences telles que Moody's ou Standard and Poor's, étape obligatoire
pour les collectivités qui veulent pouvoir accéder aux
financements obligataires et aux marchés financiers.
Mais avant tout, l'expertise des collectivités locales se manifeste par
leurs performances en matière budgétaire. Les
collectivités ont mené depuis le milieu des années 90 une
véritable stratégie d'assainissement financier, orientée
autour de deux axes :
la maîtrise des dépenses de fonctionnement
Les dépenses totales des collectivités locales ont
progressé beaucoup moins vite entre 1993 et 1999 (+ 20,5 %) qu'au
cours de la période 1988-1993 (+ 34,8 %)
15(
*
)
. Cette réduction est due en partie à la
forte diminution des dépenses d'investissement, mais également
à une modération des dépenses de fonctionnement (+
23,2 % contre + 36,9 %).
Evolution des dépenses des collectivités locales
(en %)
|
|
1993/1988 |
1999/1993 |
|
1. Dépenses totales |
+ 34,8 |
+ 20,5 |
|
2. Dépenses de fonctionnement |
+ 36,9 |
+ 23,2 |
|
Intérêts |
+ 34,4 |
- 31,3 |
|
Dépenses de fonctionnement hors intérêt, dont : |
+ 37,1 |
+ 29,5 |
|
Frais de personnel |
+ 37,8 |
+ 34,3 |
|
Transferts |
+ 31,9 |
+ 32,2 |
|
Autres (dont achats de biens et services) |
+ 41 |
+ 22,6 |
|
3. Dépenses d'investissement, dont : |
+ 31,6 |
+ 16,1 |
|
Remboursement de dette |
+ 24,8 |
+ 81,7 |
|
Equipement brut |
+ 23,7 |
+ 5,9 |
Données chiffrées : Guide statistique de la fiscalité locale 1999, DGCL. Les données relatives aux exercices 1998 et 1999 sont des estimations.
Le
ralentissement de la progression des dépenses de fonctionnement des
collectivités locales coïncide avec l'amélioration du
contexte macroéconomique et la baisse des taux d'intérêt,
qui ont permis de
réduire spectaculairement les frais financiers des
collectivités locales
. Ainsi, alors que les intérêts de
la dette avaient augmentés de 34 % entre 1988 et 1993, ils ont
enregistré une diminution de 31 % entre 1993 et 1999.
L'évolution de la conjoncture économique ne suffit cependant pas
à expliquer le ralentissement de l'évolution des dépenses
de fonctionnement, ni même la baisse de la charge d'intérêt.
A ce sujet, il convient de souligner que les collectivités locales ont
su s'adapter au mieux au retournement de conjoncture en pratiquant une
politique de
gestion active de leur dette
. Anticipant le mouvement
durable de baisse des taux, "
l'ensemble des collectivités
locales s'est alors engagé, avec les grands établissements
prêteurs, dans un processus de renégociation de dette, afin de
bénéficier, même au prix de pénalités, de la
baisse générale des taux
d'intérêt.
"
16(
*
)
La
réduction des charges d'intérêt aurait donc
vraisemblablement été d'une ampleur moindre si les
collectivités étaient restées passives.
Les autres dépenses de fonctionnement n'ont pas enregistré de
baisse depuis le milieu des années 90. Néanmoins, leur rythme de
progression a ralenti ( + 29,5 % au cours de la période 1993-1999
contre 37,1 % entre 1988 et 1993), à tel point que l'épargne
de gestion des collectivités locales (la différence entre les
recettes et les dépenses de fonctionnement) augmente à un rythme
très élevé depuis 1996 (12 % en 1996, 9,6 % en
1997, 8,3 % en 1998).
L'évolution de la structure des dépenses de fonctionnement montre
que les collectivités auraient pu aller plus loin dans la maîtrise
des dépenses de fonctionnement si elles avaient été
entièrement maîtresses de l'évolution de leurs
dépenses. Le rythme de progression des dépenses que l'on peut
qualifier de " contraintes ", les frais de personnel et les
transferts (qui regroupent les transferts sociaux, mais également les
contingents d'aide sociale ou d'incendie et de secours ou encore les versements
à des structures intercommunales), ne s'est significativement pas
ralenti entre 1993 et 1999. En revanche, les autres dépenses de
fonctionnement, et notamment les achats de biens et services, ont
évolué entre 1993 et 1999 près de deux fois moins vite
qu'au cours de la période précédente (+ 22,6 % contre
+ 41 %).
Il semble donc que les collectivités locales aient compensé
l'augmentation mécanique de certaines de leurs dépenses de
fonctionnement par des économies sur les autres postes de
dépense, notamment l'équipement des services. Cette tendance est
accentuée depuis les accords salariaux de 1998, qui entraînent
à la fois une augmentation en volume des dépenses de personnel et
un accroissement de la part de ces dépenses dans les dépenses de
fonctionnement. Il y a donc éviction de certaines dépenses par
les dépenses de personnel.
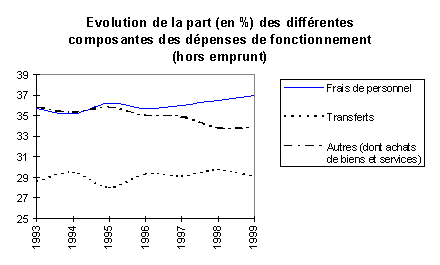
Données chiffrées : Les collectivités locales en chiffres, DGCL, 1999. Les données relatives aux années 1998 et 1999 proviennent des budgets primitifs.
S'agissant des dépenses de personnel, leur forte
progression
ne s'explique pas par l'évolution des effectifs mais par
l'évolution des rémunérations des agents, qui est
déterminée par l'Etat et s'impose aux collectivités
locales. Malgré l'absence de chiffrage précis en ce domaine, le
Crédit local de France a indiqué à la mission qu'il
estimait que les recrutements expliquaient environ un cinquième de
l'augmentation des dépenses de personnel, les quatre autres
cinquièmes étant attribués à l'évolution des
rémunérations.
En tout état de cause, votre rapporteur constate que les frais de
personnel représentaient 22 % des dépenses inscrites dans
les budgets primitifs des collectivités locales pour 1999, mais
40 % des crédits du budget général de l'Etat en 1999.
Le désendettement au détriment des dépenses
d'investissement
Les dépenses d'investissement ont augmenté deux fois moins vite
entre 1993 et 1999 (+ 16 %) qu'au cours de la période 1988-1993 (+
31,6%). Elles ont même enregistré une diminution de 6 % en
1995. Les dépenses d'équipement brut, c'est-à-dire les
dépenses d'investissement hors remboursement de la dette, ont pour leur
part diminué en 1994, 1995 et 1996. Elles n'ont retrouvé leur
niveau de 1993, soit plus de 140 millions de francs, qu'en 1999.
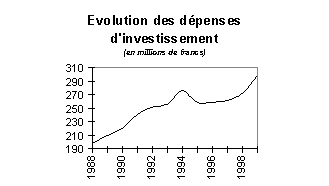
Données chiffrées : Les collectivités
locales en chiffres, DGCL, 1999. Les données relatives aux années
1998 et 1999 proviennent des budgets primitifs
La réduction de l'effort d'équipement des collectivités
locales à partir de 1994 a partiellement été
compensée par le développement des investissements des structures
intercommunales. Toutefois, il apparaît nettement que, à une
époque où la conjoncture économique était
particulièrement détériorée, donc peu propice
à l'investissement, les collectivités locales ont fait le choix
de suspendre leur effort et de se consacrer à
l'assainissement de
leur situation financière
.
Le graphique ci-dessous confirme cette impression. A partir de 1991, la part de
l'équipement brut dans les dépenses d'investissement des
collectivités locales diminue, au profit des remboursements de dette.
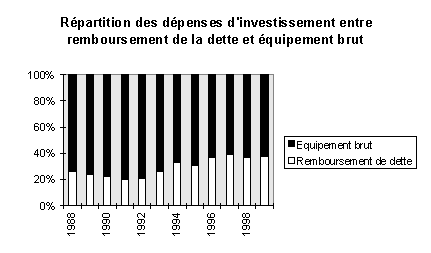
Données chiffrées : Les collectivités locales en chiffres 1999, DGCL. Les données relatives aux exercices 1998 et 1999 proviennent des budgets primitifs.
L'accélération des remboursements de dette a
porté ses fruits et, depuis 1997, les remboursements sont
supérieurs aux emprunts nouveaux. La dette des collectivités
locales est ainsi passée de 556 milliards de francs en 1997 à 549
milliards de francs en 1998. Les estimations pour 1999 prévoyaient une
poursuite du désendettement en 1999, à 539 milliards de francs.
La dette de l'ensemble des administrations publiques locales (APUL) s'est,
quant à elle, stabilisée dès 1996, pour s'établir
à 827 milliards de francs. En points de PIB, la dette des APUL diminue
depuis 1995, contrairement à la dette de l'Etat.
La dette des administrations publiques en points de PIB
(en % du PIB)
|
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Administrations publiques |
55,6 |
57,9 |
60 |
60,3 |
|
Etat |
40,7 |
42,9 |
44,6 |
46,4 |
|
Organismes divers d'administration centrale |
2,8 |
4,2 |
4,5 |
4,3 |
|
Administrations publiques locales |
9,5 |
9,3 |
8,9 |
8,6 |
|
Organismes de sécurité sociale |
2,8 |
1,5 |
2 |
1 |
Source : Projet de loi de finances pour 2000, rapport économique, social et financier.
Au total, force est de constater que, malgré quelques exemples médiatisés de " faillites " de collectivités locales, le processus de décentralisation n'a pas conduit à un " surdendettement " des collectivités locales, au contraire. Le rapport sur les comptes de la nation de l'année 1998, annexé au projet de loi de finances pour 2000, indique en effet que, " entre 1980 et 1998, l'Etat a contribué pour plus de 80 % à la progression du ratio d'endettement public en termes de points de PIB ". Il constate en revanche que " les administrations locales gardent un endettement relativement stable en part de PIB, ce qui réduit leur poids dans l'endettement public de 26 % à 12 % ".
Part relative des différents sous-secteurs dans l'endettement des administrations publiques
(en %)
|
|
1980 |
1998 |
|
Etat |
59,3 |
73,9 |
|
Collectivités locales |
26 |
12,1 |
|
Administrations de sécurité sociale et organismes divers d'administration centrale |
14,7 |
14 |
|
Administrations publiques |
100 |
100 |
Source : Projet de loi de finances pour 2000, rapport sur les comptes de la Nation de l'année 1998
La légère reprise de l'investissement local enregistrée depuis 1997 dans les communes et les départements ne devrait pas remettre en cause le processus de désendettement des collectivités locales. En effet, l'épargne de gestion dégagée par les collectivités locales atteint des niveaux tels qu'une grande partie des nouveaux investissements sont autofinancés.
2. La sagesse fiscale
La place
croissante du secteur public local dans l'économie nationale s'est
accompagnée par un développement du financement de ses
dépenses par la fiscalité :
- en 1970, le montant des dépenses des APUL était 2 fois
supérieur au montant de la fiscalité perçue à leur
profit. Ce rapport s'établissait à 1,8 en 1982. Il était
de 1,6 en 1998 ;
- entre 1988 et 1998, le montant total des recettes des collectivités
locales a progressé de 56 % alors que celui des recettes fiscales a
augmenté de 83 %.
Le poids croissant de la fiscalité
La comptabilité nationale retrace le poids des
prélèvements obligatoires perçus au profit des
administrations publiques locales en points de PIB. Le taux de
prélèvements obligatoires des APUL s'élevait à
3,4 % en 1970, 4,8 % en 1982 et 5,8 % en 1998.
La part dans le PIB de la fiscalité locale en 1998 était 1,7 fois
supérieure à celle de 1970. La part dans le PIB des
prélèvements obligatoires perçus par la
sécurité sociale en 1998 n'est que 1,5 fois supérieure
à celle de 1970. Quand à l'Etat, la part de ses
prélèvements obligatoires dans le PIB en 1998 est
inférieure à celle de 1970.
Part des prélèvements obligatoires (PO) perçus au profit de l'Etat, des APUL et des organismes de sécurité sociale dans les PO de l'ensemble des administrations publiques
(en %)
|
|
1970 |
1982 |
1992 |
1998 |
|
Etat |
52,4 |
42,2 |
39,1 |
38,3 |
|
APUL |
9,6 |
11,2 |
11,7 |
12,9 |
|
Sécurité sociale |
37,3 |
44,3 |
45,9 |
45,8 |
Données chiffrées : Projet de loi de finances pour 2000, rapport économique, social et financier.
S'agissant des collectivités locales proprement dites (communes, départements, régions), la part des recettes fiscales dans leur budget s'accroît de manière continue entre 1988 et 1998 :
Part des recettes fiscales dans les recettes des collectivités locales
(en milliards de francs)
|
|
1988 |
1998 |
|
Recettes totales |
500,2 |
782,4 |
|
Recettes fiscales |
226,6 |
415 |
|
Part des recettes fiscales dans les recettes totales |
45,3 % |
53 % |
Données chiffrées : Les collectivités locales en chiffres 1999, DGCL. Les données de 1998 ne sont que des premières estimations tirées des budgets primitifs
Une
augmentation qui s'explique par la nécessité de financer les
compétences locales
L'augmentation du poids de la fiscalité locale et de la part de la
fiscalité dans les ressources locales s'explique en partie par le fait
que l'Etat a transféré certains impôts aux
collectivités locales afin de leur permettre de financer les
compétences que leur ont conféré les lois de
décentralisation. Le produit de cette fiscalité dite
" transférée " s'élevait à 47,3 milliards
de francs en 1998, soit 11 % des recettes fiscales des
collectivités locales (communes, départements, régions).
Mais surtout,
l'augmentation du poids de la fiscalité locale
s'explique par le fait que l'évolution des dotations de l'Etat ne permet
pas aux collectivités locales de faire face au coût de leurs
compétences, obligatoires ou transférées par les lois de
décentralisation.
En admettant, à la lumière des éléments
évoqués plus haut et notamment des efforts des
collectivités locales pour maîtriser l'évolution de leurs
dépenses de fonctionnement, que l'augmentation du montant des
dépenses des collectivités ne résulte pas d'un laxisme
budgétaire mais de la nécessité d'assumer convenablement
des compétences de plus en plus coûteuses, on constate que
l'évolution des dotations de l'Etat aux collectivités locales (+
47 milliards de francs, soit + 37 %, entre 1988 et 1988) ne suit pas
l'évolution des dépenses des collectivités locales (+ 275
milliards de francs, soit + 54 %, sur la même période).
La fiscalité a donc été utilisée pour
résorber partiellement cet écart, sachant que les
collectivités (contrairement à l'Etat
17(
*
)
) ne peuvent pas financer par l'emprunt leurs
dépenses de fonctionnement. Ainsi les recettes fiscales ont
augmenté de 188 milliards de francs (+ 83 %) entre 1988 et 1998.
Evolution du mode de financement des compétences locales entre dotations et fiscalité
(en milliards de francs)
|
|
1988 |
1998 |
Evol. en volume |
Evol. en % |
|
Dépenses |
500,4 |
781,4 |
+ 275 |
+ 54 |
|
Recettes, dont : |
500,2 |
782,4 |
+ 282,2 |
+ 56 |
|
Recettes fiscales |
226,6 |
415 |
+ 188,4 |
+ 83 |
|
Dotations |
127,7 |
174,7 |
+ 47 |
+ 37 |
|
Autres recettes |
145,9 |
192,7 |
46,8 |
+ 32 |
Données chiffrées : Les collectivités locales en chiffres 1999, DGCL. Les données de 1998 sont des estimations.
La
volonté d'alléger la pression fiscale
Les recettes fiscales des collectivités locales se partagent entre le
produit d'impôts indirects (droits de mutation, vignette, taxe sur
l'électricité, taxe sur les cartes grises, etc.) et
d'impôts directs, les " quatre vieilles " (ou encore
" quatre taxes ") auxquelles s'ajoutent la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères et le versement transport. En 1998, les
" quatre taxes " représentaient près des trois quarts
des recettes fiscales perçues par les collectivités locales et
les structures intercommunales à fiscalité propre
(322 milliards de francs pour un total de 437 milliards).
Depuis 1996, les collectivités locales ont entamé un mouvement de
ralentissement de l'évolution des
taux
des impôts directs
locaux. Alors que les taux avaient augmenté de 3,5 % entre 1995 et 1996,
leur progression a été ramenée à 0,9 % en
1997, 0,6 % en 1998 et 0,5 % en 1999. Le mouvement concerne
l'ensemble des taxes. Ainsi, l'augmentation des taux de taxe d'habitation est
passée de 4,2 % en 1996 à 0,4 % en 1999 tandis que
celle des taux de taxe professionnelle est passée de 3,3 % en 1996
à 0,5 % en 1999.
Le ralentissement de la progression des impôts locaux témoigne
d'une véritable volonté d'alléger la pression sur les
contribuables locaux, et s'accompagne d'un mouvement de ralentissement de
l'évolution des
produits votés
. Pour les quatre taxes,
l'augmentation du produit voté est passée de 4,6 % en 1996
à 0,6 % en 1999.
Par ailleurs, il convient de signaler que, contrairement aux idées
reçues, le développement de l'intercommunalité, n'a pas,
au niveau national, entraîné d'augmentation de la pression fiscale
locale. On constate en effet que
l'augmentation de la part des impôts
perçus par les structures
intercommunales à fiscalité
propre s'est accompagnée d'une
réduction de la part du produit
des quatre taxes bénéficiant aux communes
. La part des
communes et de leurs groupements dans les impôts directs locaux a
même légèrement diminué entre 1988 et 1998. On a
donc assisté à une substitution des groupements aux communes,
sans effet sur le contribuable local
18(
*
)
.
Répartition du produit de la fiscalité directe locale (hors compensations) entre ses différents bénéficiaires
(en %)
|
|
1988 |
1998 |
|
Etat |
6,5 |
7,0 |
|
Taxes annexes |
8,1 |
8,0 |
|
Régions et TSE |
4,3 |
6,7 |
|
Départements |
23,8 |
23,3 |
|
Communes et EPCI
, dont :
|
57,8
|
54,9
|
|
Total |
100,0 |
100,0 |
Source : Annuaire statistique de la direction générale des impôts, 1998.
S'agissant de l'ensemble des administrations publiques locales, le rapport préliminaire de la Cour des comptes sur l'exécution de la loi de finances pour 1999 indique que la part dans le PIB des prélèvements obligatoires des APUL a enregistré une baisse en 1999, pour s'établir à 5,5 points de PIB, après trois années de stabilisation à 5,7 % . Les prélèvements obligatoires perçus par l'Etat ont connu une augmentation en 1999, pour s'établir à 17,8% du PIB, contre 17,2 % en 1998.
3. Un excédent budgétaire
Les
bonnes performances des collectivités locales (maîtrise des
dépenses de fonctionnement, désendettement),
réalisées dans un contexte de fort accroissement des charges, ont
été " récompensées " en 1996 par
l'apparition d'une
capacité de financement des administrations
publiques locales.
Cet excédent budgétaire, sans lequel la France n'aurait pas
satisfait aux
critères de convergence requis par le Traité de
Maastricht pour participer à la monnaie unique
, s'est
confirmé malgré le redémarrage de l'investissement local
à partir de 1997.
En 1999, le rapport préliminaire de la Cour des comptes sur
l'exécution des lois de finances pour 1999 relève que
l'excédent des collectivités locales a enregistré une
augmentation en volume, pour s'établir à 34,6 milliards de francs
contre 27,2 milliards en 1998.
Au cours de son audition par la mission le 8 mars 2000, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie a considéré que
les collectivités locales constituaient un exemple pour l'Etat qui, pour
sa part, "
en est encore à réduire le
déficit
".
Capacité ou besoin de financement des administrations publiques
(en milliards de francs et en % du PIB)
|
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Etat |
-
328,3
|
-
296
|
-
287,4
|
-
259,2
|
|
Organismes divers d'administration centrale |
- 40,5
|
+ 2
|
+ 58,3
|
+ 8,7
|
|
Administrations publiques locales |
-
13,8
|
+
4,8
|
+
22,7
|
+
28
|
|
Administrations de sécurité sociale |
- 52,4
|
- 40,7
|
- 40,6
|
- 9,7
|
|
Total administrations publiques (SEC 95) |
- 434,9
|
- 330,1
|
- 247,1
|
- 232,2
|
Source : Les finances des collectivités locales en 1999, Observatoire des finances locales, 1999. Rapport économique et financier (PLF 2000).
C. LE DÉVELOPPEMENT DU CONTRÔLE FINANCIER
Les lois
de décentralisation ont étendu le champ des compétences
locales en transférant aux collectivités certaines
compétences antérieurement exercées par l'Etat, mais elles
ont également supprimé la tutelle de l'Etat sur les actes des
collectivités territoriales, et notamment la tutelle financière.
Le contrôle financier des collectivités locales a du s'adapter
à cette nouvelle donne de façon à respecter
l'approfondissement des libertés locales ans pour autant perdre de son
efficacité. Il comporte désormais deux volets :
- un contrôle de légalité exercé par le
préfet en application de l'article 72 de la Constitution qui
prévoit que "
dans les départements et les territoires,
le délégué du gouvernement a la charge des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect
des lois
". La suppression de la tutelle a considérablement
affaibli la portée de ce contrôle, qui doit désormais
n'être considéré que comme un filtre, le véritable
contrôle étant exercé a posteriori par les juridictions
financières ;
- un contrôle par une nouvelle catégorie de juridictions
créées par la loi du 2 mars 1982, les chambres régionales
des comptes. Leurs missions sont triples : le jugement des comptes, le
contrôle des actes budgétaire et l'examen de la gestion des
collectivités et des établissement publics locaux.
La création des chambres régionales s'inscrit pleinement dans la
logique de la décentralisation. L'intervention de magistrats
professionnels permet de créer les conditions d'un contrôle plus
rigoureux et approfondi qu'un contrôle par les services de l'Etat, dont
les moyens sont limités. En outre, l'extension des compétences
des chambres à l'examen de la gestion des collectivités, comme le
fait la Cour des comptes s'agissant de la gestion de l'Etat, revient à
prendre acte de l'importance du secteur public local dans l'économie
nationale et répond à la demande citoyenne de renforcement du
contrôle de l'utilisation de l'argent public.
Le rôle et les compétences des chambres régionales n'ont
pas été définis très précisément par
la loi de 1982 et, depuis, dix modifications législatives sont venues
préciser le régime juridique des juridictions financières
locales. L'ensemble des difficultés -votre rapporteur y reviendra- n'a
pas encore été résolu, comme l'a montré le rapport
du groupe de travail commun constitué en 1997 au sein des commission des
finances et des lois de notre Assemblée, dont le président
était Jean-Paul Amoudry et le rapporteur Jacques Oudin
19(
*
)
.
Ce rapport a débouché sur le dépôt d'une proposition
de loi
20(
*
)
, discutée et adoptée
par notre Assemblée le 11 mai 2000. Les préoccupations et les
propositions formulées à cette occasion rejoignent celles de la
mission.
III. DE NOUVEAUX DÉFIS POUR L'ACTION PUBLIQUE
A. DE PROFONDES MUTATIONS DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE
Les bouleversements de la société et de l'économie appellent de nouvelles réponses de la part des politiques publiques
1. L'évolution démographique
a) Le vieillissement de la population française
Si,
contrairement à la situation observée ailleurs en Europe, la
population française continue d'augmenter, la tendance de notre pays au
vieillissement est inéluctable.
Une population en augmentation de deux millions depuis 1990
Au 8 mars 1999, d'après le dernier recensement de l'INSEE, la
population française s'établit à
60.082.000 habitants
, dont 58.416.500 en métropole et
1.665.500 dans les quatre départements d'outre mer. Notre pays compte,
depuis le recensement de 1990, deux millions d'habitants de plus.
La France métropolitaine représente ainsi environ 1 % de la
population mondiale et 16 % de celle de l'Union européenne.
Le nombre des naissances
est estimé
21(
*
)
, pour 1999, à 744.100, chiffre en hausse
-malgré la baisse depuis trois ans du nombre de femmes d'âge
fécond- sous l'effet d'une augmentation, continue depuis 1995, de
l'indicateur conjoncturel de fécondité
22(
*
)
, situé à 1,77 enfant par femme en
1999, contre 1,45 en moyenne pour l'Union européenne.
Parallèlement, l'âge moyen de la première maternité
(29,3 ans en 1998) continue de reculer.
Le nombre de décès
est estimé en 1999 à
541.600, ce qui amène l'
excédent naturel
total de notre
pays, pour cette année, à 202.500 personnes.
La
durée de vie
augmente continûment, gagnant, entre 1998 et
1999, deux mois et demi : l'espérance de vie
23(
*
)
est située à 74,9 années
pour les hommes et 82,3 années pour les femmes.
Le solde migratoire
pour 1999 est, quant à lui, estimé par
l'INSEE à 50.000 personnes, soit une augmentation totale de la
population, si on ajoute à ce solde l'excédent naturel des
naissances sur les décès, de 252.000 personnes.
Cette évolution récente, qui recèle des
éléments positifs -comme l'augmentation de la
fécondité- ne remet toutefois pas en cause
les tendances de
fond
de la démographie française.
La poursuite de la déformation de la structure par âge de la
population française.
Le vieillissement de la population est indéniablement la donnée
majeure des décennies à venir. Si on enregistre encore en France
-contrairement à l'Allemagne et à l'Italie, qui n'assurent leur
croissance démographique, pour leur part, que par l'immigration- un
excédent des naissances sur les décès, l'insuffisance de
la natalité combinée à l'allongement de la durée de
vie se traduisent par
une nette augmentation de la part des personnes
âgées dans la population
. Dès aujourd'hui, en France,
20,3 % de la population
24(
*
)
a 60 ans
ou plus et 1,2 million de personnes a 85 ans ou plus. En 20 ans,
le nombre des personnes très âgées a été
multiplié par 2,4.
L'âge moyen
de la population croît
en conséquence : il est de
38,1 ans
, contre 35 ans
en 1975.
La structure par âge
de la population française continue de
se déformer, comme le montre le graphique suivant, qui fait
apparaître la hausse tendancielle des classes les plus
âgées :
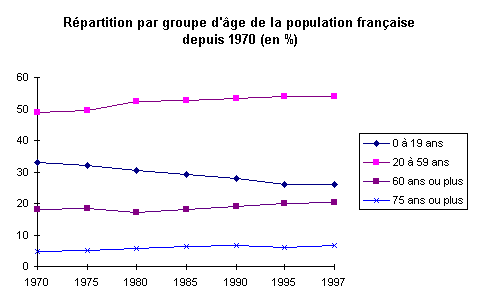
Source : INSEE, " Données sur la situation sanitaire et
sociale en France ", 1999
Champ d'analyse : France métropolitaine.
Comme l'ont mis en avant les personnes auditionnées par votre mission
d'information
25(
*
)
, la courbe du nombre des
naissances et celle du nombre des décès devraient se croiser vers
2030
26(
*
)
, date au-delà de laquelle, hors
prise en compte du solde migratoire,
la population diminuerait
. C'est
vers 2010 que devraient, quant à elles, se croiser les courbes des moins
de 20 ans et des plus de 60 ans, ces classes d'âge devant
être, après cette échéance, plus nombreuses que les
0-19 ans. En conséquence,
l'âge médian
27(
*
)
de la population française, en hausse
depuis 1980, devrait se situer,
en 2050
, d'après les
hypothèses,
entre 42 et 51 ans.
En France, au cours du siècle qui s'ouvre, les plus de 60 ans
seront donc plus nombreux que les moins de 20 ans.
En 2050, ils
pourraient représenter 34 % de la population
28(
*
)
(ils étaient 10 % en 1850), contre
21 % pour les moins de 20 ans et 45 % pour les 20 à
59 ans.
Au-delà de la question, cruciale de l'avenir du système de
retraites, ce sont, plus globalement, la prise en charge de la
dépendance mais aussi
la nature même des services rendus
à la population
qui doivent être redéfinis en fonction
de cette nouvelle donne démographique. Les collectivités
territoriales sont concernées au premier chef par le choc
démographique à venir.
Si la France est globalement touchée par le vieillissement,
l'évolution démographique des territoires n'est pourtant pas
uniforme.
b) Des contrastes territoriaux marqués en matière démographique
La
poursuite d'une urbanisation de plus en plus localisée
En métropole, en retenant les classifications de l'INSEE
29(
*
)
, les populations " urbaines " et
" rurales "
30(
*
)
s'établissent
respectivement, d'après le dernier recensement, à 43 et
15,4 millions de personnes. Ce recensement a confirmé les tendances
observées depuis vingt ans : la croissance démographique des
communes " rurales " (+ 0,51 % par an) est plus forte que
celles des communes urbaines (+ 0,29 % par an). Pour autant, à
l'intérieur du monde " rural ", ce sont
les communes les
plus proches des pôles urbains importants, appartenant à l'espace
" périurbain ", qui absorbent l'essentiel de la croissance,
ainsi que quelques " couloirs de peuplement ". Le Sénat
oeuvre d'ailleurs activement pour la meilleure prise en compte du fait
périurbain
31(
*
)
, même s'il n'est
pas toujours écouté, ses propositions en la matière ayant
été rejetées par le Gouvernement lors des débats
d'aménagement du territoire.
Au contraire, on observe une stagnation de la population des communes rurales
situées à l'écart de la zone d'influence des villes, voire
une dégradation, pour les plus éloignées d'entre elles.
A l'intérieur des unités urbaines, la croissance des communes de
banlieue se ralentit : 0,41 % par an, contre 0,86 % pendant la
période intercensitaire précédente. En revanche, les
communes de plus de 100.000 habitants, dont la population avait
globalement diminué entre 1982 et 1990, retrouvent souvent le chemin de
la croissance, à l'exception de Paris. Les grandes villes les plus
dynamiques sont Nantes, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Lyon,
Orléans et Angers, avec des taux de croissance supérieurs
à 0,7 % par an.
Huit grandes " aires urbaines "
totalisent à elles seules la moitié de l'augmentation de la
population entre 1990 et 1999.
Si la France a donc continué à s'urbaniser, c'est
inégalement, par une densification des grands pôles les plus
dynamiques et de leurs périphéries. Les autres aires dynamiques
se situent le long des littoraux atlantique et méditerranéen, en
Alsace et dans le sillon alpin, ainsi que le long de certains fleuves.
De fortes disparités régionales
En métropole,
huit régions
sur vingt-deux ont vu leur
population progresser, entre 1990 et 1999, plus rapidement que la moyenne
nationale : le Languedoc-Roussillon (+ 0,90 % par an), suivi par
l'Alsace (+ 0,70 %), Provence-Alpes-Côte d'Azur
(+ 0,60 %), Rhône-Alpes, les Pays de la Loire
(+ 0,57 %), Midi-Pyrénées (0,53 %) et enfin la
Bretagne et l'Aquitaine (+ 0,42 %). A l'opposé, la population
a
stagné ou diminué dans cinq régions
: le
Limousin, l'Auvergne, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne et la Lorraine. La
région la plus peuplée reste l'Île-de-France
(10,9 millions d'habitants) devant Rhône-Alpes (5,6 millions),
Provence-Alpes-Côte d'Azur (4,5 millions) et Nord-Pas-de-Calais
(4 millions) ; les régions les moins peuplées sont la
Corse (moins de 300.000 habitants) et le Limousin (environ
710.000 habitants).
Avec
l'Alsace, les régions de l'ouest
(Bretagne, Pays de la Loire
et Poitou-Charentes), sont les seules où la croissance de la population
s'est accélérée entre les périodes intercensitaires
(1982-1990 et 1990-1999), la hausse des entrées par rapport aux sorties
compensant un
excédent naturel en diminution.
Entre 1990 et 1999, les régions du
sud et du sud-est
(Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes)
ont enregistré les plus fortes croissances
(+ 699.000 personnes), Provence-Alpes-Côte d'Azur et
Languedoc-Roussillon se caractérisant par un solde naturel globalement
stable et par un solde des entrées-sorties encore très
élevé, bien qu'en retrait.
Midi-Pyrénées et Aquitaine
sont parmi les régions
ayant attiré le plus de monde (+ 210.000 à elles deux) mais
l'accroissement naturel y reste faible. Dans ces régions, des
disparités importantes existent entre les départements littoraux
et les grandes métropoles (comme Toulouse) et les autres
départements, où la diminution de population est quasiment
générale.
L'Île-de-France
a eu, entre 1990 et 1999, une croissance
inférieure à la moyenne nationale et en forte diminution par
rapport à la période précédente. La proportion de
jeunes y étant importante, elle a le plus fort taux de natalité
régional. Son solde naturel très élevé ne compense
pourtant pas la dégradation du solde des entrées-sorties de la
population (- 518.000 personnes entre 1990 et 1999).
Les régions situées dans un
croissant nord
, de la
Basse-Normandie jusqu'à la Lorraine, ont connu une croissance
démographique ralentie. La fécondité y est
traditionnellement élevée, mais le solde naturel a
diminué, suite aux départ des jeunes adultes, entraînant le
vieillissement de la population.
L'Auvergne et le Limousin
ont perdu 27.000 habitants, soit autant
qu'entre 1982 et 1990, avec un solde naturel qui se dégrade
(- 40.000) mais un solde des entrées-sorties qui s'améliore.
La situation particulière des départements d'outre-mer
Avec 1.665.000 habitants, les DOM représentent, en 1999, 2,8 %
de la population totale. Entre les deux derniers recensements, leur population
a augmenté de 206.400 habitants,
rythme de croissance
(+ 1,5 % par an) quatre fois supérieur à celui de la
métropole
(+ 0,37 % par an). Cette croissance tient
essentiellement -pour 90 %- à un
fort excédent
naturel
entre 1990 et 1999. Cet accroissement n'est cependant pas
uniforme : depuis 1990, le taux de croissance démographique annuel
de la Guyane est de 3,6 %, celui de la Réunion -qui reste, avec
705.100 habitants, le plus peuplé des DOM- d'1,9 % et celui de
chacune des Antilles inférieur à 1 %. Un fort accroissement
démographique est constaté en périphérie des villes.
La mutation de la démographie française -qui suit celle des
principaux pays industralisés- cache donc en réalité des
disparités territoriales fortes.
Si la société se transforme, tel est également le cas de
l'économie, désormais mondialisée.
2. La mondialisation de l'économie française
Fort
développement du commerce international, baisse du coût du
transport, levée des barrières douanières : la
récente et rapide
globalisation des échanges
a durablement
et structurellement marqué l'économie française. Deux
indicateurs simples -le commerce extérieur et les investissements
directs de et vers l'étranger- permettent à eux seuls de prendre
la mesure de
l'ouverture de l'économie française
,
désormais totalement intégrée en premier lieu à
l'Europe et, en second lieu, au reste du monde.
Des échanges avec l'extérieur qui représentent
désormais un quart de l'activité de notre pays.
Alors que le produit intérieur brut français s'est
élevé, en 1999, à 8.469 milliards de francs
32(
*
)
, les exportations françaises ont
représenté la même année 2.166 milliards de
francs et les importations 1.985 milliards de francs, soit une proportion
de respectivement
25,6 % et 23,4 % du PIB
.
En 1999, l'excédent commercial de la France, positif depuis 1992, a
atteint
124 milliards de francs
33(
*
)
et a contribué à placer notre pays dans les tous premiers
mondiaux en matière, notamment, d'agro-alimentaire, d'automobile,
d'aéronautique et d'équipement professionnel.
Si l'Union européenne représente à elle seule les deux
tiers des exportations et des importations françaises, -alors qu'en 1958
cette proportion était d'à peine 30 %
34(
*
)
- les échanges extra-communautaires de la
France, représentent néanmoins quelque 6,6 % du PIB en 1995
(contre une moyenne européenne de 8,6 %).
L'Europe est, devant
les Etats-Unis et devant le Japon, la zone économique la plus ouverte et
la plus tournée vers l'extérieur.
Des investissements transfrontaliers qui se multiplient
Au-delà des seuls échanges commerciaux, l'ouverture de
l'économie française se manifeste par
l'accroissement des
investissements directs étrangers
en provenance et à
destination de notre pays. Ces investissements transnationaux sont en effet
devenus l'un des vecteurs les plus dynamiques de la mondialisation : leur
flux, largement lié à l'accroissement des fusions et acquisitions
transfrontalières, a doublé entre 1996 et 1998, pour passer de
359 à 644 milliards de dollars
35(
*
)
.
D'après la Banque de France, les flux d'investissements directs
étrangers dans notre pays auraient représenté
165,3 milliards de francs en 1998, 239,7 milliards de francs
étant, la même année, directement investis à
l'étranger par des entreprises françaises.
En quelques années, notre économie a donc profondément
changé de nature.
Et sans doute cette évolution n'est-elle
pas terminée, l'avènement des technologies de l'information
amplifiant la mondialisation de l'activité et projetant même,
d'après certains économistes, les pays industrialisés dans
l'ère d'une " Nouvelle économie ", fondée sur le
savoir et ignorante des frontières nationales.
3. Le risque de fracture civique et sociale
L'ensemble des mutations précédemment décrites contribuent à accentuer la " fracture territoriale " entre les différents espaces français. Ces différenciations entre territoires tendent donc plus à se marquer qu'à s'estomper. De surcroît, les évolutions entraînées par l'inégal peuplement des espaces français, et leur intégration différenciée dans la globalisation économique, accentuent les risques de rupture dans l'acceptation de la norme républicaine , mais également dans l'égal accès des citoyens à l'emploi, à la culture et aux nouvelles technologies.
a) Les incivilités et la fracture sociale
Si les
statistiques policières font remonter au milieu des années 1960
l'émergence de la petite délinquance, qui reste alors pour
l'essentiel concentrée sur les dégradations des biens, les
violences contre les personnes croissent fortement depuis 1994. C'est cet
ensemble de faits, d'une gravité très inégale, qu'on a
englobé sous le terme générique
d'"
incivilités
", car ils constituent tous une
agression, symbolique ou réelle, contre les normes inhérentes
à la vie en commun.
Ce phénomène multiforme affecte prioritairement des zones qui se
dérobent, ou sont inadaptées, à l'organisation
territoriale française : quartiers péri-urbains, grands
ensembles immobiliers qui constituent des enclaves spécifiques, et plus
rarement, quartiers centraux délaissés par leurs habitants du
fait de leur vétusté.
Certes, la reprise de l'activité économique constatée
depuis 1998 peut contribuer à intégrer dans le monde du travail,
et donc socialiser, les jeunes adultes qui constituent l'essentiel des auteurs
de ces incivilités.
Mais, faute de formation suffisante et, peut-être, d'une volonté
de se conformer à des modes de vie parfois discrédités, la
reprise économique ne pourra éliminer le chômage dit
" structurel ", communément évalué aux environs
de 8 % de la population active.
Les territoires qui concentrent les difficultés en matière
d'emploi, de sécurité, d'urbanisme et de transports risquent
donc, en dépit des -trop- nombreux dispositifs mis en oeuvre à
leur intention (contrats de ville, contrats locaux de
sécurité...), de demeurer à l'écart de
l'amélioration économique générale, et leurs
habitants d'être, de ce fait, encore plus marginalisés.
Les handicaps étant souvent cumulatifs, les quartiers
" difficiles " concentrent souvent des familles monoparentales, ou au
sein desquelles l'autorité paternelle n'est plus guère ni
assurée ni respectée.
Les enfants issus de ces familles compensent parfois le lien distendu qui ne
les unit plus guère à leurs parents par la constitution de
bandes, qui englobent, ou parfois opposent, les fratries (l'âge
étant alors le facteur dominant de constitution du groupe), et
constituent le creuset de la délinquance. La
diversité
sociale
, qui constitue un facteur d'intégration, régresse
rapidement dans ces quartiers qui finissent par ne regrouper qu'une population
" homogène " par l'exclusion sociale, économique et
culturelle qui la frappe.
b) La fracture civique
Cette
mise à l'écart ne peut qu'accentuer le scepticisme croissant
constaté parmi la population française à l'égard de
l'ensemble des " corps intermédiaires " chargés
d'exprimer ses attentes envers les différents acteurs de la vie
publique, et de transmettre et expliquer les réponses qui leur sont
apportées par les institutions.
Cette indéniable "
fracture civique
", dont les causes
sont multiples -montée de l'individualisme, crise de la
représentation politique, syndicale ou associative, penchant vers
l'appartenance communautaire au détriment du lien républicain-
peut conduire à une forme de
nihilisme social
qui, sous couvert
de stigmatisation des institutions en place réputées incapables
de répondre aux attentes des individus en difficulté, les
éloigne encore plus des lois républicaines.
Différentes initiatives ont été prises pour enrayer ce
phénomène, dont la loi du 10 novembre 1997 relative à
l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les
listes électorales. Plusieurs associations se sont également
mobilisées pour sensibiliser les jeunes citoyens à l'exercice de
leur capacité électorale.
De même, certaines municipalités ont-elles créé des
conseils municipaux associés, constitués soit d'enfants, soit
d'habitants ne possédant pas la nationalité française,
pour les associer à la vie de la cité, et aux décisions
qu'elle requiert.
Toutes ces entreprises vont dans le bon sens, et visent à combattre la
désaffection envers les institutions représentatives que l'on
peut tenter d'évaluer par le
taux d'abstention aux diverses
élections
, sans que ce critère puisse rendre compte, à
lui seul, de ce phénomène
36(
*
)
. Il
reste que le risque profond d'une fracture civique, séparant les
citoyens qui se reconnaissent globalement dans les valeurs essentielles de la
République, et ceux qui les nient, soit de façon implicite, soit
en dénigrant plus ou moins violemment les institutions qui les incarnent
(école, mairie, forces de l'ordre ou de secours, comme les pompiers) ne
doit pas être ignoré, pas plus que la difficulté des
solutions à définir pour y remédier.
c) Les risques d'inégalités que peuvent engendrer les nouvelles technologies de la communication
A ces
différentes inégalités qui pèsent sur la population
française suivant ses lieux d'implantation s'en ajoute actuellement une
nouvelle :
l'inégalité
"
numérique
", c'est-à-dire l'accès
inégal aux nouvelles technologies de l'information qui prennent une
place croissante dans la vie quotidienne. L'accès au
" réseau des réseaux " que constitue l'internet est, en
effet, globalement réservé dans les faits à une
élite urbaine, jeune et financièrement privilégiée.
Des efforts importants ont, certes, été accomplis durant ces dix
dernières années pour équiper les établissements
scolaires -collèges et lycées, et parfois même
écoles primaires- en ordinateurs, et pour familiariser les
élèves à leur utilisation. Mais la maîtrise de ce
nouvel outil de recherche et de communication passe également par sa
présence au domicile familial, ce que ne peuvent se permettre que les
foyers les plus favorisés.
De plus, cette fracture numérique risque de s'aggraver avec le passage,
prévu dans les deux ou trois années à venir, à
l'internet à
"
haut débit
", dont la
technique facilitera la transmission rapide, non plus seulement de
l'écrit, mais des images, et qui devrait ainsi prendre une part
déterminante dans les activités de communication et de gestion
des entreprises. Or les technologies utilisées ne garantissent pas un
égal accès de l'ensemble du pays à ces nouvelles
procédures, les zones urbaines étant plus faciles à
desservir.
B. UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE DE L'ACTION PUBLIQUE
1. La nécessité croissante d'une gestion de proximité
a) Une cohésion sociale renforcée
Les
évolutions démographiques et socio-économiques
décrites ci-dessus constituent de
réelles menaces
pour la
cohésion sociale.
Elles sont donc autant de défis pour l'action publique qui devra
définir les
modes de gestion les mieux adaptés
pour
éviter les déchirures du tissu social.
Votre mission d'information a la conviction que la gestion de
proximité apparaît la plus efficace pour faire face à ces
différents défis.
Ce constat est particulièrement avéré dans le domaine de
l'action sociale
dont la gestion décentralisée a
renforcé les performances. Elle a, en effet, notamment permis
d'accélérer la programmation des équipements nouveaux en
particulier pour les personnes âgées et les personnes
handicapées. Elle a également mieux répondu à
l'exigence accrue des citoyens quant à la capacité de
réaction des services publics aux différents problèmes
sociaux. Elle a enfin contribué à mieux responsabiliser
l'ensemble des acteurs de la filière sociale.
Sur le plan fonctionnel, les départements ont su engager progressivement
depuis 1990 la restructuration de leur action sociale, en partant d'une
approche globale et territorialisée
. Ils ont ainsi
privilégié une logique de projet, conçue autour d'un
concept de " mission ", sur la logique de services. Cette
démarche a tendu à faire coïncider l'intervention des
services départementaux avec les territoires de vie, afin que la
réponse sociale soit mieux adaptée à l'environnement
réel des personnes. Elle s'accompagne d'
expérimentations
de formules diverses, notamment pour l'accueil du public, le traitement des
demandes ou l'accompagnement social.
Or cette même approche devra prévaloir dans les prochaines
années pour prendre en charge les différentes évolutions
socio-économiques.
Le
vieillissement
de la population et le financement des situations de
dépendance, qui auront un impact majeur sur les dépenses d'action
sociale, justifieront une adaptation de l'action publique à
l'environnement réel des personnes âgées et à la
diversité des besoins suscitées par les situations de
dépendance, par exemple le cas des personnes handicapées
vieillissantes qui impliquera l'établissement de
" passerelles " entre les travailleurs sociaux qui s'occupent des
personnes handicapées et ceux qui ont en charge les personnes
âgées afin de trouver une réponse adaptée à
ce nouveau besoin.
Même si elle doit faire toute sa place à l'expression de la
solidarité nationale et au rôle des acteurs
socio-économiques,
l'approche territoriale
paraît la mieux
adaptée. L'intervention des départements a ainsi permis une
meilleure connaissance des besoins des personnes vieillissantes ainsi qu'un
réel développement des services dont elles ont besoin.
Injustement critiquée, la prestation spécifique dépendance
instituée par la loi du 24 janvier 1997 - à la suite d'une
initiative sénatoriale - a permis d'améliorer la perception du
problème de la dépendance ainsi que la prise en charge des
personnes en bénéficiant. Elle a en outre mis fin aux
dérives de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
En ce qui concerne
l'aide sociale à l'enfance
, la
déstabilisation des familles et l'aggravation de la fracture sociale
soulèvent de nouveaux problèmes qui conduisent à
réfléchir sur une intervention accrue des collectivités
locales. L'apparition du chômage de longue durée, la concentration
des difficultés économiques sur des territoires
déterminés ont fragilisé les familles et affaibli les
solidarités de proximité. Parallèlement le modèle
familial s'est transformé, avec notamment une multiplication des
familles monoparentales. Ces phénomènes ne sont pas sans
conséquence sur les dispositifs de protection de l'enfance. Or la
décentralisation se traduit dans ce domaine par une meilleure
évaluation des besoins et des réponses qui doivent leur
être apportées.
Les évolutions démographiques et socio-économiques
dessinent également de nouveaux besoins en matière
d'éducation
. Or comme l'a admis devant votre mission d'information
M. Michel Garnier, directeur de la programmation et du développement au
ministère de l'Education nationale, en matière de programmation
de l'offre d'enseignement, les critères démographiques globaux
sont insuffisants. Ils devraient, selon lui, s'accompagner, dans le cadre d'une
contractualisation avec les établissements, d'une nécessaire
adaptation aux réalités locales.
L'insertion
constitue un autre enjeu qui justifiera des dispositifs plus
décentralisés. L'intervention des collectivités locales
dans la gestion du volet " insertion " du revenu minimum d'insertion
(RMI) a ainsi été
efficace.
Contrairement à
certaines idées reçues et ainsi que l'a rappelé devant la
mission d'information M. Pierre Gauthier, Délégué
interministériel au RMI, dans les domaines qui ont été
transférés aux collectivités locales, les écarts
entre les territoires que les politiques sociales conduites par l'Etat avaient
laissé se creuser, ont eu plutôt tendance à se restreindre.
Les évolutions en matière de
politique de la santé
mettent également en évidence qu'une meilleure efficacité
du système de soins doit être recherchée dans une approche
territorialisée.
Les collectivités locales devront également jouer un rôle
majeur pour éviter une dislocation du
" lien civique "
à laquelle pourraient conduire des évolutions marquées
par la perte des repères traditionnels et par des
phénomènes d'exclusion.
Enfin, cette exigence d'une cohésion sociale renforcée est
particulièrement forte dans les
départements d'outre-mer
,
dont les spécificités ont été relevées par
votre rapporteur. A l'inverse des départements métropolitains,
ces départements comptent, en effet, une population jeune et sont
confrontés à des problèmes très sensibles en
matière d'insertion sociale.
b) Les nouvelles attentes de la population
Outre
une adaptation aux évolutions démographiques et
socio-économiques, les politiques publiques devront répondre aux
nouvelles attentes de la population.
A ce titre, la
culture
constitue d'ores et déjà un enjeu
important. A l'heure de la mondialisation, en effet, la demande
d'identification culturelle
s'accroît.
Les collectivités locales n'ont pas attendu les lois de
décentralisation pour s'investir dans le secteur culturel.
Dès le XIXè siècle, les grandes villes ont
développé leurs équipements culturels, sans subventions
étatiques. Elles ont souvent pris avant 1958 des initiatives culturelles
modernes, notamment en organisant des festivals. Les départements ont
pour leur part, dès les années soixante, géré un
important patrimoine culturel.
Freiné par les besoins de reconstruction après la seconde guerre
mondiale, l'intervention culturelle des collectivités locales s'est
sensiblement renforcé par la suite. Depuis le début de la
Vè République, les collectivités locales se sont
impliquées de manière croissante dans ce secteur. Leur
intervention a connu son plein essor dès le milieu des années
soixante dix. Leur effort financier est ainsi trois fois supérieur
à celui du ministère de la culture et deux fois plus importants
que l'ensemble des dépenses culturelles de l'Etat.
Les élus locaux perçoivent parfaitement le rôle
déterminant de la culture dans le développement local et dans le
renforcement du
sentiment d'appartenance
à un territoire. Toute
centralisation excessive ne peut au contraire que nuire à la
nécessaire promotion de la diversité culturelle qui fait la
richesse de notre pays.
Cette dynamique locale est également nécessaire au renforcement
des
réseaux culturels européens
dont dépend la
vitalité culturelle de l'Europe.
Les nouvelle attentes de la population portent également sur les
nouvelles technologies de l'information
. A l'heure de l'internet,
assurer l'accès de l'ensemble de la population à ces nouveaux
moyens de communication constitue un enjeu majeur pour éviter que la
fracture sociale ne se double d'une " fracture numérique ".
Là encore, comme en témoignent les initiatives prises par un
certain nombre de collectivités locales, la gestion de proximité
doit contribuer à une maillage efficace du territoire national.
L'augmentation du temps libre, qui résulte des évolutions
socio-économiques, constitue un autre facteur que les politiques
publiques ne peuvent ignorer. Dans ce cadre, le développement de la
pratique sportive
occupe une place importante. Ainsi les jeunes consacre
aux activités sportives 75% de leur temps libre. Les
collectivités locales contribuent d'ores et déjà de
manière importante au financement du sport. Elles devront continuer
à jouer un rôle majeur, notamment pour renforcer la fonction
d'intégration sociale du sport et structurer la vie associative.
Les attentes de la population en matière de
sécurité de
proximité
, déjà très sensibles, se renforceront
probablement dans les prochaines années.
La première enquête de " victimisation ", qui s'est
déroulé en 1999, a donné des résultats inattendus.
Devant la mission d'information, M. Alain Bauer, coauteur d'un ouvrage sur les
violences et l'insécurité urbaine, a indiqué que cette
enquête avait mis en évidence que 16,8 millions de faits
étaient subis par la population alors que la police ne recensait que 3,5
millions de crimes et délits.
Les réponses des élus locaux au questionnaire établi dans
le cadre des Etats généraux organisés par le
président Christian Poncelet à Bordeaux, le 17 mars dernier,
ont mis en évidence que le sentiment d'insécurité augmente
en fonction de la taille de la commune. Les élus locaux d'Aquitaine
relient prioritairement la délinquance à la perte des
repères sociaux (citée par 81 % d'entre eux). Si les
atteintes aux équipements publics représentent les manifestations
d'insécurité les plus graves (cités par 47 % des
élus locaux), les incivilités et les effractions de biens
privés arrivent en deuxième position (45 % chacune).
Un constat comparable est effectué par les élus locaux d'Alsace.
45% d'entre eux, interrogés dans le cadre des états
généraux organisés à Strasbourg, le 19 mars 1999,
ont déclaré être confrontés à
l'insécurité dans l'exercice de leurs mandats. La perte des
repères et de l'autorité (citée par 49% d'entre eux) ainsi
que le délitement de la cellule familiale (cité par 38% des
élus) constituent les facteurs essentiels du développement des
phénomènes d'insécurité.
De plus en plus les politiques de sécurité devront être
définies " sur mesure ". Le concept de police de
proximité devra s'accompagner d'une
dimension territoriale
pertinente.
Plus généralement, l'action publique devra prendre en charge les
attentes de la population en matière de
prévention des
risques
. Le rapport d'étape de votre mission d'information
"
insécurité juridique et mandats locaux, deux enjeux
majeurs pour la démocratie locale
" a mis en évidence
que les élus locaux étaient souvent en première ligne pour
répondre à ces attentes quand bien même ils ne disposaient
pas des moyens adaptés ou que les compétences relevaient en
réalité de l'Etat par exemple pour l'élaboration des plans
de prévention des risques. Ces attentes renforcées, qui
conduisent à une application plus systématique du
principe de
précaution
, se manifestent dans un contexte de pénalisation
accrue des rapports sociaux et de recours au juge pénal pour trancher
toute sorte de litiges. Le rapport d'étape en a souligné les
conséquences sur l'action publique locale.
2. L'insertion des territoires dans l'ensemble européen
a) L'exigence d'une structuration efficace des territoires
Les
travaux menés par le Sénat sur l'aménagement du
territoire
37(
*
)
ont parfaitement mis en
évidence que toute dérive vers une recentralisation de l'action
publique ne pourrait avoir que des conséquences néfastes sur la
structuration des territoires et sur la recherche indispensable de la
cohésion territoriale.
L'ouverture des frontières rend indispensable une
structuration forte
des territoires
afin de les mettre en position de capter les flux de
richesses circulant dans l'ensemble communautaire. Dans cette perspective,
c'est bien un
aménagement multipolaire
qu'il convient de
promouvoir. En faisant ce choix, les politiques publiques nationales
permettront une intégration efficace du territoire dans l'Union
européenne.
La mise en oeuvre d'un tel objectif est néanmoins subordonnée
à une claire définition des responsabilités des
différents niveaux d'administration. L'Etat doit être
recentré
dans ses fonctions essentielles et porteur d'un projet
national. Il lui revient de définir une stratégie d'ensemble, de
corriger les déséquilibres financiers entre les
collectivités territoriales et de mettre en place les grandes
infrastructures intellectuelles et de communication. Pour le reste, il doit
déléguer aux collectivités
décentralisées
l'essentiel des actions qu'exige sur le
terrain l'aménagement du territoire, en leur transférant les
moyens financiers et humains.
Ces orientations ont été concrétisées dans la loi
d'orientation du 4 février 1995 qui précise que la politique
d'aménagement et de développement du territoire est conduite par
l'Etat "
en association avec les collectivités territoriales
dans le respect de leur libre administration et des principes de la
décentralisation
" et dans la loi du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, dont l'article
1
er
a repris la même formulation.
Mais cet aménagement multipolaire suppose que
tous les
territoires
soient également pris en compte dans les politiques
d'aménagement du territoire. Le Sénat a, en conséquence,
pu légitimement regretter que les nouvelles orientations retenues par la
loi du 25 juin 1999 aient été marquées par la thèse
selon laquelle la ville serait le lieu privilégié de la
compétitivité internationale alors que les zones rurales seraient
des zones de handicap à compenser et le plus souvent associées
à la question des espaces naturels. Conforter les espaces
périurbains, lutter contre la césure entre ville et campagne,
seront donc autant de défis pour les politiques publiques dans les
prochaines années.
b) La place croissante des politiques communautaires
L'insertion du territoire dans l'ensemble européen est
également marquée par la place croissante des politiques
communautaires qui ont des effets directs sur l'action publique nationale et
locale.
Tel est évidemment le cas de la
politique régionale
européenne
, laquelle représente désormais le
deuxième poste de dépense de l'Union derrière la politique
agricole commune.
Or la France ne tire pas tout le bénéfice de cette politique
régionale, pour différents motifs qui tiennent notamment , votre
rapporteur y reviendra, aux conditions de gestion des crédits
communautaires au plan national.
En outre, les élus locaux ne sont pas toujours bien informés des
" circuits " de financement communautaire. Ainsi, interrogés
dans le cadre des Etats généraux organisés en Auvergne, le
12 mai dernier, 49% des élus de cette région estimaient manquer
des informations nécessaires en matière de financement
européen.
Cette insertion dans l'Union européenne concerne aussi les
départements d'outre-mer.
Après l'adoption en 1989 d'un
programme qui leur était spécifiquement destiné
(POSEIDOM), le traité d'Amsterdam a modifié
l'article
299.2
du traité de Rome en permettant au Conseil de prendre des
"
mesures spécifiques
"
tenant compte des
caractéristiques particulières des régions
ultrapériphériques.
Sans qu'il soit besoin d'insister, on rappellera que c'est également
l'environnement juridique et financier
de l'action publique nationale
qui est désormais de plus en plus influencée par les textes
élaborés au niveau communautaire. Pour ne citer que quelques
exemples particulièrement importants pour l'action des
collectivités locales, on mentionnera le domaine de
l
'environnement
(qualité et assainissement des eaux, gestion des
déchets) et celui des
marchés publics
. Le rapport
d'étape de votre mission d'information a aussi souligné le poids
croissant des
normes techniques
d'origine européenne.
La
fonction publique territoriale
a également été
concernée par le développement de la construction
européenne. La loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 a, en
effet, ouvert certains emplois aux ressortissants communautaires, en vertu de
l'article 39 du traité de Rome relatif à la liberté de
circulation des travailleurs.
La
démocratie locale
n'échappe pas à ces
évolutions. Introduit par le traité de Maastricht,
l'article
19.1
du traité de Rome garantit le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales des citoyens de
l'Union européenne résidant dans un Etat de l'Union dont ils ne
sont pas ressortissants. Les modalités d'exercice de ce droit ont
été précisées dans une directive du Conseil du 19
décembre 1994. Il a par la suite été inscrit dans notre
Constitution (
article 88.3
) et fait l'objet de la loi
organique n° 98-404 du 25 mai 1998.
La mise en place de
l'euro
implique un certain nombre d'adaptations
budgétaires et comptables. Jusqu'en 2002, les collectivités
locales continueront à réaliser la plupart de leurs
opérations en francs avant qu'à cette date leurs
comptabilités ne basculent vers l'euro.
C. LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Les
frontières entre Etat, même fixées de longue date, n'ont
jamais fait obstacle à des solidarités informelles au sein de
bassins de population qui les dépassent.
Ces liens transfrontaliers se sont formalisés après la
deuxième guerre mondiale, d'abord entre les deux rives du Rhin, dont les
habitants avaient particulièrement à coeur de traduire dans les
faits la réconciliation entre la France et l'Allemagne à laquelle
les appelaient le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer.
Mais ce mouvement pionnier s'est progressivement étendu aux autres
régions frontalières françaises, avec l'encouragement
moral et financier de l'Union européenne.
1. Le rapprochement franco-allemand d'après guerre
Amorcée avec l'instauration de jumelages entre communes
(qui
se développera également avec des communes anglaises dans les
régions de l'Ouest de la France), le rapprochement entre les ennemis
d'hier s'opère aussi entre des collectivités de plus grande
envergure, comme l'entité bourguignonne, et le land de
Rhénanie-Palatinat. Une coopération active associe les
intérêts économiques : jumelage des chambres de
commerce et d'industrie de Colmar et Fribourg, ou création de
l'association " Regio Basiliensis " qui réunit des partenaires
économiques d'Alsace et du pays de Bade.
En dépit de la bénédiction officielle donnée par
l'Etat à ces rapprochements, il faut attendre
1983 pour que la France
ratifie la convention signée à Madrid en 1980, sous l'impulsion
du Conseil de l'Europe
; cette convention invite les Etats à
développer ces actions qui transcendent les frontières.
Il est significatif de la réticence étatique française que
la loi du 2 mars 1982 n'ait autorisé ces rapprochements qu'avec
réserve, comme en témoigne le texte de l'article 65,
consacré à ce sujet : "
Le Conseil régional
peut décider, avec l'autorisation du Gouvernement d'organiser, à
des fins de concertation et dans le cadre de la coopération
transfrontalière, des contacts réguliers avec des
collectivités étrangères ayant une frontière
commune avec la région
".
Cependant, ce texte, même restrictif, contenait deux innovations
positives : il fournissait la première base légale à
cette coopération transfrontalière, permettant ainsi la
ratification, un an plus tard, de la convention de Madrid, et désignait
la région comme collectivité qualifiée pour mener cette
coopération.
2. L'affermissement des instruments juridiques et financiers
Tandis
que les initiatives de coopération inter-régionale se
multipliaient avec l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la Belgique,
la loi du 6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République (ATR), renforcée par la loi
d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et le
développement du territoire
, fournissaient des outils juridiques
diversifiés pour guider ces actions. Elles autorisent notamment la
conclusion de conventions entre collectivités territoriales
françaises et étrangères, la création de
groupements d'intérêt public, la participation de
collectivités territoriales étrangères au capital de
sociétés d'économie mixte locales, l'adhésion de
collectivités territoriales françaises à un organisme
public de droit étranger.
Il est précisé que ces formules ne peuvent être
utilisées "
qu'avec des collectivités territoriales comme
partenaires
" (circulaire d'application de la loi " ATR "),
"
dans les limites des compétences [des collectivités
territoriales] et dans le respect des engagements internationaux de la
France
" (loi " ATR ").
A cette évolution de la législation interne s'ajoutent
les
initiatives européennes
: après la création, en
1988, des programmes d'action de coopération transfrontalière
européens,
le traité de Maastricht instaure un Comité
des régions
, consultatif, mis en place en 1994. Ses 222 membres,
nommés pour quatre ans, élisent un Français comme premier
président (M. Jacques Blanc, président de la région
Languedoc-Roussillon)
38(
*
)
.
Cette reconnaissance institutionnelle s'accompagne de
la mise en oeuvre,
à partir de 1990, de l'initiative INTERREG
, dotée de
1 milliard d'écus pour le programme I (1990-1994), portés
à 2,4 milliards d'écus pour INTERREG II (1994-1999),
puis à 4,875 milliards d'euros pour le troisième programme
(2000-2006). Des sommes très importantes ont ainsi été
affectées, sous forme de fonds structurels, aux actions de
coopération transfrontalière.
Le Conseil de l'Europe
, qui a joué un rôle
déterminant dans la promotion de ces actions de coopération,
avant même la mise en place des institutions de la Communauté
économique européenne, a créé dès 1957 une
Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux. Devenue,
en 1994, Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, cette instance
a élaboré une
Charte européenne de l'autonomie
locale
, ainsi qu'un programme spécifique pour les pays d'Europe
centrale et orientale, et s'attache à harmoniser les politiques de
décentralisation des Etats membres.
3. Une coopération active dans toutes les zones frontalières françaises et européennes
Toutes les régions frontalières
françaises
sont engagées dans la coopération avec leurs voisins
.
Ainsi :
•
La région Nord-Pas-de-Calais a créé une
Euro-Région
, structure qui englobe Bruxelles, les Flandres, la
Wallonie et le Comté du Kent.
• Le
Pôle européen de développement
se situe
au carrefour de la Belgique, du Luxembourg et de la France
(
Meurthe-et-Moselle
).
• Sarre-Lor-Lux
constitue une structure tripartite de
coopération entre le Land de Sarre, le Luxembourg et la
Région
Lorraine
.
• La
Conférence tripartite rhénane
s'étend
sur la région du Rhin supérieur, c'est-à-dire
l'
Alsace
, les cantons de Bâle ville et campagne, le
Bade-Wurttemberg et la Rhénanie-Palatinat.
• La
communauté de travail du Jura
rassemble la
France-Comté
et 4 cantons suisses.
• Le
Conseil du Léman
rassemble les
départements
de l'Ain et de la Haute-Savoie
, et 3 cantons suisses limitrophes.
• La communauté de travail des
Alpes occidentales
se
compose des
régions Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Rhône-Alpes
, Ligurie, Piémont, Val d'Aoste et des cantons de
Genève, du Valais et de Vaud.
• La communauté de travail des
Pyrénées
regroupe 4 communautés autonomes du Nord-Est de l'Espagne, Andorre et
les
régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées
.
Ces actions sont soutenues par les instances politiques de l'Union
européenne, et
leur caractère prioritaire a été
rappelé au sommet d'Edimbourg, en 1992
. En plus des programmes
INTERREG précédemment décrits, le Fonds de
développement des économies régionales (FEDER) incite
à la constitution de réseaux-pilotes favorisant l'échange
d'informations entre régions d'Europe.
Ainsi s'est constitué
le programme RECITE
(Regions and Cities of
Europe) qui est
ouvert aux collectivités locales ou régionales
de plus de 50.000 habitants
, et soutient des projets en matière de
développement économique, de technologies de l'information et
d'échanges universitaires. Ce programme a permis la constitution de
projets très divers, comme les réseaux villes et régions
d'industrie automobile (CAR), Finattlantic, tourisme en
Méditerranée, Roc-Nord, qui réunit les deux régions
les plus isolées de la communauté (le Jutland danois et la
Crète), Euroceram pour les pays possédant une industrie de la
céramique ou encore Eurisles, destiné aux îles de la
Communauté.
Cette mise en réseau des collectivités territoriales d'Europe a
conduit la Commission à organiser, en
1993
" Directoria ", première rencontre des directeurs des
autorités locales et régionales
.
Ce foisonnement d'initiatives françaises comme européennes
illustre la vigueur de ces échanges transfrontaliers, dont le contenu
souligne la solidarité européenne au quotidien. Cependant,
beaucoup reste à faire pour accentuer ce mouvement positif.
CHAPITRE II
LA COMPLEXITÉ DU PAYSAGE INSTITUTIONNEL
DE LA
DÉCENTRALISATION
I. L'ÉTAT : UN ACTEUR ESSENTIEL QUI N'A PAS ENCORE INTÉGRÉ LA LOGIQUE DE LA DÉCENTRALISATION
A. LE RÔLE AMBIGU DE L'ÉTAT : CONTRÔLEUR ET ACTEUR DE LA VIE LOCALE
1. l'État, contrôleur de la vie locale
L'
obligation du contrôle
des collectivités
territoriales par l'État a valeur constitutionnelle. Les
prérogatives de l'État figurent en effet au dernier alinéa
de l'article 72 de la Constitution, selon lequel "
le
délégué du Gouvernement a la charge des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect
des lois
".
Le contrôle exercé par le représentant de l'État,
s'il contribue à assurer la prééminence des
intérêts nationaux sur les intérêts locaux et de
faire prévaloir l'unité de l'ordre juridique français,
doit être concilié avec le principe de libre administration des
collectivités territoriales, qui a lui aussi valeur constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a donc été amené à
préciser par sa jurisprudence
39(
*
)
les
limites à ne pas franchir par le législateur en matière de
contrôle des collectivités.
a) Les principes : la substitution du contrôle a posteriori à la tutelle
Le
contrôle de légalité constituait un des volets les plus
importants de la loi du 2 mars 1982
40(
*
)
et la contrepartie de l'autonomie des
collectivités territoriales : la loi transformait la tutelle
a
priori
exercée par le préfet en un contrôle de
légalité
a posteriori
confié au juge administratif,
saisi par le préfet, c'est-à-dire un
contrôle indirect
et juridictionnel
41(
*
)
.
La loi du 22 juillet 1982 a complété celle du
2 mars en précisant les conditions d'exercice du contrôle
administratif : les actes ne deviennent exécutoires qu'à la
double condition d'avoir été publiés et transmis au
représentant de l'État. La loi a dressé la liste des actes
dont la transmission est une condition de caractère exécutoire,
la sanction de la non-transmission étant l'absence de caractère
exécutoire de l'acte.
Le préfet a la possibilité de saisir le tribunal administratif
d'un recours, appelé "
déféré
préfectoral
", dans le délai de deux mois suivant la
transmission de l'acte. Il est tenu d'informer sans délai
l'autorité locale de son intention de saisir le juge et de lui
communiquer toutes précisions utiles sur les illégalités
qu'il a constatées. Cette procédure vise à
limiter le
recours au juge
et à favoriser le dialogue entre la
collectivité et le préfet ; elle tient compte au fait que
nombre d'illégalités ne sont que le résultat d'erreurs
involontaires.
D'autres formes de déférés préfectoraux
existent : suspension d'extrême urgence des actes des
collectivités locales en cas de menace pour une liberté publique
ou individuelle, déféré en matière de
défense nationale, etc. Les sursis à exécution ont
été remplacés par des
suspensions
42(
*
)
, accordées de droit si l'un des moyens
évoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la
légalité de l'acte.
b) Les insuffisances du contrôle de légalité
L'environnement normatif de l'action locale requiert
désormais des capacités développées d'analyse
juridique
43(
*
)
, qui peuvent faire défaut
dans les petites collectivités, voire dans les préfectures et
sous-préfectures chargées du contrôle de
légalité. La complexité des affaires publiques locales
aboutit aujourd'hui à une inflation du nombre d'actes soumis à
transmission obligatoire.
Or, le contrôle de légalité est
quantitativement
insuffisant
. Le nombre global d'actes contrôlés est
très faible et
très inégal d'un département
à l'autre
.
En 1997,
6,1 millions d'actes
ont été transmis aux
autorités chargées du contrôle de légalité.
Celles-ci ont adressé 179.000 observations aux auteurs des actes et
le nombre des déférés devant les tribunaux administratifs
s'est élevé à 1623, soit un
taux de recours contentieux
de 2,6 pour 10.000
44(
*
)
.
Sur dix ans (1986-1996), le nombre d'actes transmis a augmenté de plus
de 50 % alors que le nombre d'observations s'est accru de 91 % et le
nombre de recours déposés, de 11,5 %.
La
répartition par objet des recours
a elle aussi connu une
évolution significative
45(
*
)
, mais les
déférés préfectoraux restent
concentrés
dans un nombre très restreint de domaines
.
Dans de nombreux cas, les préfets se sont désistés
après réformation ou retrait de l'acte entaché
d'illégalité. Le nombre élevé des
désistements après l'engagement des procédures
contentieuses traduit l'efficacité de la concertation par les
préfets en direction des exécutifs locaux après le
dépôt d'un déféré
46(
*
)
.
L'inégalité de l'application du droit d'une
collectivité à l'autre
se manifeste par la diversité
du taux des observations et du taux de recours, mais aussi par la
disparité dans la pratique des transactions et des voies non
contentieuses de règlement des litiges. Certains départements se
caractérisent par l'absence de tout déféré
préfectoral dans l'année, alors que d'autres atteignent ou
dépassent la centaine.
L'exercice du sursis à exécution
concernait en 1997
un
déféré préfectoral sur trois
. Malgré
l'existence des procédures d'urgence,
la lenteur de la justice
administrative
47(
*
)
conduit à un
véritable mépris du droit et à la multiplication des
instances liée à l'utilisation des voies de recours
48(
*
)
.
Comme le souligne le rapport du Gouvernement au Parlement sur le contrôle
a posteriori
des actes des collectivités locales, des
décisions en matière de marchés publics, ou concernant des
autorisations d'occupation du sol, sont rendues après l'exécution
du marché ou la réalisation des travaux. Aussi, la lenteur de la
justice administrative peut-elle aller jusqu'à
rendre parfois
illusoire l'exécution des décisions de justice
.
Les causes de l'insuffisance du contrôle de légalité sont
multiples. Dans son rapport public 1993 intitulé :
" Décentralisation et ordre juridique ", le Conseil
d'État souligne "
l'insuffisance quantitative et qualitative des
moyens des préfectures face à l'explosion du volume des actes
à contrôler, aux glissements continuels des compétences,
aux modifications incessantes des législations de
référence
", voire au "
recul, en
opportunité, des autorités préfectorales devant l'exercice
d'une compétence dont on leur a, un temps, expressément
demandé de ne pas abuser, dont le maniement risque de rendre plus
difficiles leurs relations avec les élus, et dont la jurisprudence
administrative a, de surcroît, implicitement admis quelles
n'étaient pas tenues de faire usage
".
En définitive, il convient de se demander avec le Conseil
d'État
49(
*
)
si "
le champ
dans lequel le contrôle de légalité trouve le plus
clairement sa légitimité
50(
*
)
est
ou non suffisamment couvert par les déférés
préfectoraux
".
c) Les ambiguïtés du contrôle de légalité
(1) Le contrôle de légalité ne vaut pas certification
Dans
l'arrêt Brasseur du 25 janvier 1991, le Conseil d'État a
admis que les préfets n'étaient pas tenus de
déférer aux tribunaux administratifs les actes dont ils avaient
constaté l'illégalité et qu'ils n'avaient pas
réussi à faire modifier par la collectivité. En
conséquence,
le contrôle de légalité n'a aucun
caractère automatique
.
De plus,
l'absence d'observation de la part du contrôle de
légalité n'est pas une garantie de la légalité de
l'acte
. Ainsi, des
poursuites pénales
peuvent être
engagées contre des élus à propos d'actes sur lesquels le
préfet n'avait émis aucune objection. Le contrôle de
légalité est par nature administratif, distinct de
l'appréciation pouvant être portée sur une situation
donnée par le procureur de la République.
(2) Le préfet entre conseil et contrôle.
L'initiative du contrôle de légalité est
confiée à des autorités directement impliquées dans
l'action et la vie locales
et qui sont des partenaires
privilégiés des collectivités locales. Les préfets
sont-ils en mesure de créer une étanchéité parfaite
entre les différents pans de leurs actions ? Il peut se trouver en
pratique des situations paradoxales dans lesquelles l'émission des actes
contrôlés et le contrôle sont juxtaposés.
Considérant que les irrégularités sont souvent le fait
d'une méconnaissance ou d'une maîtrise insuffisante du droit, les
préfectures assurent localement
une mission d'information et de
conseil en direction des exécutifs territoriaux
.
Si
l'assistance à l'élaboration des actes
est
sollicitée par les exécutifs locaux, notamment dans les
collectivités locales qui ne bénéficient pas des moyens
juridiques suffisants, celle-ci ne manque pas de soulever des
objections de
principe tenant au respect de l'autonomie de gestion et de la libre
administration des collectivités locales
.
L'exercice du contrôle de légalité requiert la
participation de l'ensemble des services déconcentrés, compte
tenu de la diversité du champ de compétences des
collectivités locales.
Deux modalités
sont
pratiquées, la délégation du contrôle de
légalité, et la simple consultation des services
déconcentrés.
La
délégation du contrôle
à certains services
se justifie par la spécificité et la technicité de la
matière ; de nombreux préfets délèguent
l'examen des actes d'urbanisme aux directions départementales de
l'équipement et le contrôle des marchés des hôpitaux
aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Les préfets ne se dessaisissent pas de leur pouvoir de décision
et conservent un pouvoir d'évocation sur les avis des directions
départementales. Toutefois, la mise en oeuvre de la
délégation se heurte à des problèmes de
déontologie
. Comme le souligne le Conseil d'État,
"
il est essentiel que ceux des services (DDE en particulier) qui
interviennent pour le compte des collectivités locales comme
conseillers, instructeurs de décisions ou maître d'oeuvre,
ne
puissent être juges et parties
; or un tel partage des
rôles n'est pas toujours facile à opérer
".
La
consultation
des services déconcentrés
compétents par le préfet est la formule la plus courante,
notamment auprès des directions départementales de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou
auprès du réseau du Trésor public. La consultation peut
prendre une forme intégrée, celle des "
pôles de
compétences
". Ceux-ci visent à harmoniser les pratiques
de contrôle et la doctrine administrative des différents
services ; à procéder à des expertises juridiques en
commun sur des dossiers complexes ; à développer la
circulation de l'information entre les services ; à élaborer
des documents d'information à destination des collectivités
locales ; à mettre en place des actions de formation communes aux
agents des différents services ; à définir en commun
des domaines prioritaires pour l'exercice du contrôle de
légalité ; enfin à la détection précoce
des illégalités.
Les pôles de compétences sont présents à titre
expérimental dans une quarantaine de départements, sous une forme
généraliste ou dans les spécialités des
marchés publics ou de l'urbanisme ; ils s'inscrivent dans
l'objectif d'interministérialité du contrôle.
Lors de son audition par la mission, M. Jean-Bernard Auby,
président de l'association française de droit des
collectivités territoriales, a conclu que la fonction des services
déconcentrés était marquée d'une très grande
ambiguïté ; bien que la décentralisation ait fait
évoluer leur mission vers le contrôle et la régulation, ces
services continuent néanmoins à mener des actions dans un grand
nombre de domaines et exerçent une fonction de conseil souvent
demandée par les collectivités de petite taille. Il a
estimé que, compte tenu de cette ambiguïté, le
contrôle de légalité ne pouvait pas fonctionner de
façon satisfaisante.
(3) La dérive vers un jugement en opportunité ?
L'immixtion du juge dans la gestion locale est rendue possible par des procédures comme le " référé pré-contractuel " 51( * ) , qui permet au juge de prononcer l'arrêt d'une procédure de passation d'un marché ou d'une délégation de service public en cours de déroulement, dans l'hypothèse où les règles de publicité et de concurrence n'ont pas été respectées. Le juge peut, en référé et avant que le contrat ne soit conclu, prendre des mesures provisoires ou définitives qui ne sont pas susceptibles d'appel ; il dispose d'un pouvoir d'injonction qu'il fait respecter par des astreintes. Ces prérogatives du juge administratif peuvent avoir pour effet de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'administrateur.
(4) La multiplication des recours au juge administratif
Les insuffisances du contrôle de légalité conduisent à une multiplication des recours directs des citoyens devant les tribunaux administratifs, en particulier les recours à l'initiative d'associations . Le Conseil d'État laisse entendre que " les autorités préfectorales renoncent si fréquemment à faire usage du pouvoir à elles dévolu que la charge d'entreprendre des actions contentieuses dont elles auraient dû assumer le poids s'en trouve reportée sur le citoyen ".
d) L'inadaptation des contrôles financiers
(1) Le contrôle des actes budgétaires
Après le contrôle de légalité, les
actes
budgétaires des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux sont soumis à un contrôle
spécifique, le contrôle budgétaire. Cependant, toutes les
collectivités locales ne sont pas soumises au contrôle des
chambres régionales des comptes : les comptes des communes de moins
de 2000 habitants, dont le montant des recettes ordinaires est inférieur
à deux millions de francs, sont apurés par le
trésorier-payeur général. Ainsi, près de 70.000
organismes
52(
*
)
entrent dans le champ de
compétence des chambres régionales des comptes.
Exercé à l'initiative du préfet, le contrôle
budgétaire
53(
*
)
implique que
l'État, pour garantir la légalité, peut mettre sous
quasi-tutelle budgétaire une collectivité locale
. En effet,
le juge peut procéder à la réformation de l'acte en
cause
54(
*
)
et non pas seulement à son
annulation ou à son retrait comme dans le cas du contrôle de
légalité.
(2) Le contrôle juridictionnel des comptes
La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités locales et de leurs établissements publics. Il s'agit d'un contrôle de régularité obligatoire ; la chambre régionale des comptes règle et apure les comptes par des jugements 55( * ) , que des irrégularités aient été relevées ou non. Le jugement définitif donne décharge au comptable ou éventuellement le met en débet, c'est-à-dire lui impose de reverser une somme à la collectivité. Les jugements définitifs sont susceptibles d'appel devant la Cour des comptes et les arrêts rendus en appel peuvent donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
(3) Le contrôle de gestion : entre régularité et opportunité.
Dernier
volet du contrôle financier, l'examen de la gestion des
collectivités locales par les chambres régionales des comptes
donne lieu à des
observations
56(
*
)
qui, en l'état actuel du droit, sont réputées ne pas faire
grief.
En 1988, le législateur
57(
*
)
a
corrigé la rédaction issue de la loi du 2 mars 1982,
afin que ces observations ne portent pas sur le " bon emploi " des
crédits, mais sur leur "
emploi régulier
" par
les collectivités. En 1990, il a posé le principe de la
communication à l'assemblée délibérante des
observations définitives
58(
*
)
.
Comme le souligne notre collègue M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur
59(
*
)
au nom de la commission
des Lois du Sénat de la proposition de loi tendant à
réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les
procédures applicables devant les chambres régionales des
comptes, dont il est le coauteur avec notre collègue M. Jacques Oudin,
il existe aujourd'hui
un certain malaise
concernant la procédure
d'examen de la gestion.
Les principales critiques
adressées aux interventions des
chambres régionales des comptes sont la médiatisation excessive
des observations provisoires et l'insécurité juridique
liée à
l'absence d'articulation avec le contrôle de
légalité
. De plus, il existe un
décalage
entre
les conditions d'exercice de l'action locale et la perception que peut en avoir
un
contrôle opéré souvent plusieurs années
après
les décisions prises.
La crainte est légitime d'une dérive du contrôle
vers un
contrôle d'opportunité.
L'absence de
critères
fiables et communs
, les limites de la
procédure
contradictoire
, la
divulgation abusive
des lettres
d'observations provisoires,
l'absence de
hiérarchisation
des observations et
l'absence de
procédure de recours
contre les lettres d'observations définitives affaiblissent encore
le contrôle de gestion.
En définitive, compte tenu de ces déficiences, les lettres
d'observations ne peuvent constituer un instrument d'aide à une bonne
gestion.
La perception des contrôles par les élus
Les
" États généraux des élus locaux ",
organisés par M. Christian Poncelet, président du
Sénat, montrent la perception qu'ont les élus locaux du
contrôle de légalité et des contrôles financiers.
• Les États généraux organisés en
décembre 1998 dans le département de
Vaucluse
60(
*
)
montrent que 53 % des élus sont
satisfaits du contrôle de légalité, mais lui reprochent de
ne pas constituer une garantie de sécurité
juridique
: 45 % des élus considèrent qu'il ne
permet pas de prévenir les risques de contentieux, 41 % estiment
qu'il ne remplit pas son rôle d'aide à la décision. Par
ailleurs, 61 % des élus de Vaucluse estiment que le système
actuel de contrôle des chambres régionales des comptes ne garantit
pas suffisamment les droits de la défense.
• Les États généraux des élus locaux de la
région d'
Alsace
61(
*
)
,
organisés en mars 1999, montrent que 62 % des élus d'Alsace
sont satisfaits des modalités du contrôle de
légalité et que 68 % d'entre eux dénoncent
l'inadaptation du contrôle exercé par les chambres
régionales des comptes aux spécificités de la gestion
locale.
• Selon les États généraux organisés en
septembre 1999 dans les départements du
Nord et du
Pas-de-Calais
62(
*
)
,
70 % des
élus portent une appréciation positive sur l'action du juge
administratif. Pourtant, résultat contradictoire, 51 % des
élus considèrent que les jugements administratifs constituent une
source de complexification de l'action publique locale
. Si 64 % des
élus de Nord Pas-de-Calais sont satisfaits du contrôle de
légalité
63(
*
)
que le préfet
exerce sur leurs actes, ils lui reprochent toutefois son caractère
trop contraignant
et son
manque d'impartialité.
83 % des élus locaux de Nord Pas-de-Calais expriment une opinion
favorable sur l'action de la chambre régionale des comptes et 61 %
d'entre eux estiment nécessaire de développer la mission de
conseil et d'alerte des chambres.
2. l'État, acteur de la vie locale
Incarné au niveau local par le préfet et les
services
déconcentrés, l'État exerce des fonctions de
gestion de
la vie locale
, que ce soit dans les domaines où la loi lui a reconnu
une compétence, ou dans les matières censées avoir
été transférées aux collectivités locales
selon la logique des blocs de compétences : malgré la
volonté initiale du législateur, la décentralisation n'a
pas privé l'État de son rôle d'acteur local. Des pans
entiers de l'action publique sont aujourd'hui
" cogérés " : l'aide et l'action sociales,
l'éducation, la culture, la sécurité...
De plus, l'État a été tenté de
récupérer des compétences de gestion, notamment par la
technique contractuelle
64(
*
)
, qui lui permet,
bien que n'étant qu'un financeur parmi d'autres, de conserver de fait la
maîtrise du pilotage du système.
Interrogé par votre rapporteur, qui considérait que
les fonds
structurels avaient été le moyen pour le préfet de
région de reprendre du pouvoir et de recentraliser
,
M. Anastassios Bougas, chef d'unité adjoint à la direction
de la coordination et de l'évaluation (DGXVI) à la Commission
européenne, a confirmé cette analyse et reconnu que cette gestion
des fonds structurels était une spécificité
française.
Comme l'indique la loi d'orientation du 6 février 1992
relative à l'administration territoriale de la République,
les
services déconcentrés de l'État peuvent concourir par leur
appui technique aux projets
de développement économique,
social et culturel
des collectivités territoriales
et de leurs
établissements publics de coopération qui en font la
demande ; une convention définit les conditions de cet appui.
Or, dans certains cas, cette fonction d'appui est assurée par les
mêmes services qui seront chargés, plus tard, au titre du
contrôle de légalité, d'en évaluer la
conformité à la loi. L'
équipement
est sans doute
emblématique des multiples facettes de l'État : la gestion
des routes nationales et l'intervention au bénéfice des communes
relèvent en effet de logiques concurrentes voire contradictoires. Ainsi,
dans les directions départementales de l'équipement (DDE),
certains agents ou services sont partagés entre une fonction de conseil
aux collectivités locales et leur appartenance à une structure
chargée par ailleurs du contrôle de légalité.
Il existe un
conflit d'intérêt potentiel entre le
contrôle et le conseil.
Toutefois, l'ambivalence n'est pas
forcément négative, s'il s'agit d'un organisme collégial
et s'il est possible d'assurer l'étanchéité des fonctions
de conseil et de contrôle exercées par l'État à
l'égard des collectivités locales.
A l'échelon territorial, le préfet incarne cette ambivalence de
l'État. En particulier, il négocie et signe les contrats de plan
et dirige les services déconcentrés chargés de mettre en
oeuvre les politiques nationales correspondant aux attributions reconnues
à l'État par la loi du 7 janvier 1983 relatives
à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'État.
L'institution préfectorale
Le 17
février 2000, date anniversaire de la loi du 28 pluviose an VIII, le
corps préfectoral fêtait son
bicentenaire
. Le préfet
est le seul haut fonctionnaire dont les compétences ont une base
constitutionnelle (article 72 de la Constitution). Sa particularité est
de représenter l'État
65(
*
)
tout en
étant le délégué du Gouvernement
66(
*
)
. Il agit et décide, au nom de
l'autorité de l'État, aux lieu et place et pour le compte du
Gouvernement, en toute validité juridique.
Les préfectures remplissent cinq missions essentielles
67(
*
)
:
- la permanence de l'État et la sécurité : maintien
de l'ordre, protection des personnes et des biens, prévention et
traitement des risques naturels, gestion des crises, mesures non militaires de
défense...
- la réglementation et la garantie des libertés
publiques : nationalité, police administrative, environnement et
urbanisme, notion d'utilité publique, opérations
électorales, entrée et séjour des étrangers,
circulation et sécurité routières, procédures
d'autorisation, coordination interministérielle des politiques
publiques...
- le contrôle administratif des collectivités locales et des
organismes publics : contrôle de légalité,
contrôle budgétaire...
- la conduite et la cohérence des actions de l'État :
direction des services de l'État dans le département ou la
région, mise en cohérence à l'échelon territorial
des politiques des politiques interministérielles, connaissance du
contexte local...
- la rationalisation de la gestion des ressources et des moyens de
l'État : gérer les enveloppes financières
réparties à l'échelon régional ou à
l'échelon départemental, organiser les actions communes à
l'ensemble des services déconcentrés de l'État (patrimoine
immobilier, recrutement, formation, action sociale).
Le préfet est l'unique ordonnateur secondaire des services
déconcentrés des administrations civiles de l'État.
*
Pour ces raisons, l'État ne saurait être un partenaire parmi d'autres pour les collectivités locales . Il est ainsi d'autant plus regrettable que, faute d'une politique affirmée de déconcentration, l'État n'ait pas la capacité d'être, au niveau local, l'interlocuteur fiable que cherchent en lui les collectivités décentralisées 68( * ) .
B. UN ÉTAT QUI N'A PAS ADAPTÉ SON ORGANISATION À LA DÉCENTRALISATION
La
réforme de l'État est au coeur des préoccupations
publiques depuis la seconde guerre mondiale, même si jusqu'en 1958 la
réforme des institutions politiques des IIIème et
IVème Républiques a quelque peu pris le pas sur la
réforme de l'administration
69(
*
)
.
L'institution de la Vème République en octobre 1958
réglait la dimension constitutionnelle de la réforme de
l'État. Dès lors, la modernisation du fonctionnement
administratif de l'État devint un sujet majeur de préoccupation
dans les années 1960. En témoignent la mise en place de la
région comme circonscription administrative de l'État en 1964, de
même que la première initiative en matière de
déconcentration
70(
*
)
, la simplification
du versement des subventions d'investissement de l'État
71(
*
)
, ou les expériences de rationalisation
budgétaire.
La décentralisation a constitué, pour l'État, un choc,
dont il n'a pas encore tiré toutes les conséquences dans la
réorganisation de ses propres services.
1. Le bilan mitigé des partages de services
Première conséquence de la décentralisation pour l'État, les partages de services ont été mis en oeuvre avec difficulté et parfois au mépris des principes retenus par le législateur.
a) Les principes retenus par les lois de décentralisation
Les lois de décentralisation, en même temps qu'elles créaient une rupture institutionnelle, ont posé le principe d'un transfert aux collectivités territoriales des services déconcentrés de l'État nécessaires à l'exercice de leurs nouvelles compétences.
(1) Le partage fonctionnel des services.
La loi du 2 mars 1982 a organisé le transfert, sous l'autorité respective des présidents du conseil général et du conseil régional, des services ou parties de services de la préfecture nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations des assemblées locales ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs désormais dévolus aux nouvelles autorités exécutives de ces collectivités 72( * ) .
(2) Le partage financier
A la
suite de ce partage fonctionnel, un partage financier des services est
intervenu. Le
transfert de charges
correspondant au transfert de
l'exécutif a été organisé par le législateur.
Dans l'attente d'une clarification financière
, restaient à
la charge de l'État les prestations de toute nature qu'il fournissait
pour le fonctionnement des services transférés aux régions
et aux départements ou mis à leur disposition et pour les agents
de ces services. Dans les mêmes conditions, restaient à la charge
des départements et des régions les prestations de toute nature,
y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des
matériels, qu'ils fournissaient pour le fonctionnement des services
déconcentrés de l'État et pour leurs agents
73(
*
)
.
Après cette période transitoire, il convenait de
substituer au
principe du maintien des prestations réciproques
celui du partage
financier, sans transfert de charges
74(
*
)
.
(3) Les principes et les garanties liés aux transferts de services
La loi
du 7 janvier 1983
75(
*
)
fixe les principes
fondamentaux et les modalités des transferts de compétences. A la
date des transferts,
deux garanties essentielles
étaient offertes
aux collectivités locales :
- la transparence des évaluations, grâce à
l'institution de la commission consultative sur l'évaluation des charges
(CCEC), composée exclusivement d'élus locaux ;
- la compensation financière intégrale et concomitante des
charges ainsi transférées.
Les principes des transferts sont codifiés en partie aux
articles
L. 1321-1 et suivants
du code général des
collectivités territoriales :
- le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la
mise à disposition de la collectivité bénéficiaire
des
biens meubles et immeubles
utilisés, à la date de ce
transfert, pour l'exercice de cette compétence
76(
*
)
;
- la mise à disposition des services s'accompagne d'une
mise à
disposition des personnels
77(
*
)
, ceux-ci
disposant dans un délai déterminé d'un droit d'option
entre les deux fonctions publiques ;
- le transfert de compétences prévu par la loi est
accompagné du
transfert
concomitant par l'État aux
communes, aux départements et aux
régions, des
ressources
nécessaires à l'exercice normal de ces
compétences
78(
*
)
;
- tout transfert de compétences de l'État au profit des
départements et des régions s'accompagne du
transfert des
services
correspondants
79(
*
)
;
- les autres services de l'État dans les régions et les
départements qui sont nécessaires à l'exercice des
compétences transférées aux communes, aux
départements et aux régions, sont
mis à la disposition,
en tant que de besoin
, de la collectivité territoriale
concernée
80(
*
)
;
- une
commune
a la possibilité de demander le
concours
des services de l'État, des régions et des
départements
pour l'exercice de ses compétences
81(
*
)
.
Force est de constater que les principes retenus par les lois de
décentralisation sont trop souvent restés lettre morte.
b) Une mise en oeuvre complexe
La naissance de véritables services départementaux et régionaux devait résulter des transferts de compétences. Pourtant, les transferts de services se sont révélés difficiles à mettre en oeuvre et demeurent inachevés à l'heure actuelle.
(1) 1982 : les conventions transférant aux exécutifs locaux l'autorité sur certains services de la préfecture
Le
transfert de l'exécutif départemental ou régional au
président du conseil général ou régional devait
s'accompagner de la mise à disposition par le préfet des services
correspondants
82(
*
)
. Une
convention
devait être conclue en ce sens entre le représentant de
l'État dans le département ou la région et le
président du conseil général ou régional,
approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur.
Signées au printemps 1982 sur la base d'une convention-type
approuvée par décret,
ces conventions ont été
qualifiées de " Yalta administratif "
, dans la mesure
où elles définissaient les compétences, moyens, agents et
locaux restant sous la responsabilité du préfet et ceux soumis
à l'autorité du président de la collectivité
territoriale concernée
83(
*
)
.
En pratique, ce transfert s'est effectué plus par changement
d'étiquettes que par mutation géographique des implantations
immobilières ou des agents affectés aux différentes
tâches considérées. Dans le même bâtiment, la
" préfecture ", au moins au départ, les agents sont
restés sur place, seules les structures de commandement et les lignes de
rattachement hiérarchiques étant modifiées.
(2) La mise à disposition des services techniques ne devait être que transitoire
Le
principe d'une
mise à disposition globale des services
extérieurs
de l'État, posé dans la loi du
2 mars1982, indique que la mise à disposition, en tant que de
besoin, des services extérieurs de l'État est
de droit dans la
limite des compétences dévolues
à la
collectivité territoriale. Elle s'exerce dans le
cadre
contractuel
au moyen d'une
convention
signée par le
préfet et le président du conseil général ou
régional.
En pratique, ces mises à disposition ont posé des
difficultés de deux ordres :
- un chef de service extérieur de l'État se retrouvait à
la fois placé sous l'autorité hiérarchique du
préfet et " globalement " mis à la disposition d'un
président élu à la tête d'une collectivité
territoriale. Pour le président du conseil général ou
régional, comment affirmer concrètement son autonomie, surtout
peu de temps après la définition de celle-ci, en recourant
à l'aide de fonctionnaires de l'État placés sous la
responsabilité hiérarchique du préfet ?
- les fonctionnaires d'une même direction se voyaient commandés
tantôt par le préfet, tantôt par le président du
conseil général ou régional, et devaient pratiquer en
permanence un " dédoublement fonctionnel " entre les missions
assumées au nom de l'État, sous l'autorité
hiérarchique du préfet, et les tâches effectuées
pour le compte du président du conseil général ou
régional.
C'est pourquoi
ce système de mises à disposition globales ne
devait être que transitoire
, l'objectif affiché par les lois
de décentralisation étant celui de la
partition des
services
.
Mais la lenteur de la mise en oeuvre de cette partition des services
extérieurs de l'État, la faiblesse numérique des
personnels transférés aux collectivités territoriales
lorsque cette partition s'est réalisée, et les difficultés
liées au droit d'option des agents, ont abouti à la
pérennisation du dispositif de mise à disposition globale des
services de l'État.
(3) L'inégale partition des services
Bien que
le principe de structuration administrative retenu pour l'avenir soit celui de
la partition des services
84(
*
)
, les
réalisations en la matière sont très inégales.
•
Les
partages de services ont été
effectivement mis en oeuvre
pour :
- les préfectures de département et de région ;
- les directions départementales de
l'action sanitaire et
sociale
(DDASS) en 1985-1986. Cette partition s'est effectuée
lentement mais sans difficultés majeures. Elle a abouti dans chaque
département à la création de deux directions
départementales, l'une pour les compétences étatiques,
l'autre pour les compétences du conseil général ;
- les services centraux des directions départementales de
l'équipement mis à disposition et les services maritimes ;
- les services des archives et des bibliothèques
départementales de prêt.
• Le
" partage impossible " des services
techniques déconcentrés de l'équipement
illustre les
obstacles à la partition des services. Celle-ci est en partie due aux
difficultés d'organiser les transferts de personnels correspondants.
Une première disposition
85(
*
)
,
restée lettre morte, prévoyait à la fois une partition des
services ou parties de services en fonction de la répartition des
compétences, et la création d'une conférence du parc des
ponts et chaussées coprésidée par le préfet et le
président du conseil général.
Puis, a été retenue en 1987 une solution qui sauvegarde
beaucoup plus les intérêts de l'État que ceux du
département
86(
*
)
. Il s'agissait du
transfert des parties de services qui intéressent le
département
87(
*
)
, sans que les
subdivisions territoriales ne soient transférées aux conseils
généraux, en vertu du principe retenu par le législateur
selon lequel
ne devaient pas être
transférées au département ou à la
région les parties de services dont les communes auraient besoin pour
assumer correctement leurs compétences
. Ainsi, les subdivisions
territoriales restaient simplement mises à disposition du conseil
général en tant que de besoin. Pour la gestion du parc des ponts
et chaussées, deux organismes
88(
*
)
ont
été créés, seul celui présidé par le
préfet ayant une importance significative.
La mise en oeuvre concrète de ce dispositif réglementaire n'a
pas été homogène sur l'ensemble du territoire. En
conséquence,
la " non-partition " de la direction
départementale de l'équipement concentre tous les défauts
du dispositif :
- le principe de la loi du 7 janvier 1983, selon lequel la
mise à disposition des services de l'État au profit des
collectivités locales ne devait être que temporaire, n'a pas
été respecté ;
- le décret de 1987 ne fait pas référence au droit
d'option des agents défini par le législateur, compromettant
ainsi la réalisation ultérieure de tout partage de services.
Après que les lois de finances pour 1990 et 1991 eurent fixé
les modalités de recours des départements aux activités
industrielles et commerciales des DDE, le dispositif, expérimenté
dans onze départements, a été
généralisé par la loi du
2 décembre 1992
89(
*
)
.
Celle-ci avait deux objectifs principaux : elle organisait la mise
à disposition des départements du parc et des subdivisions
territoriales sous forme conventionnelle
90(
*
)
; elle clarifiait les relations
financières entre l'État et les départements en
matière d'équipement et de fonctionnement.
Compromis entre des positions initiales opposées
, cette loi a
permis de maintenir l'unité du parc de l'équipement,
défini comme "
un élément du service public de la
DDE
" et d'éviter un démantèlement de cette
direction départementale. Elle permet aussi à l'État de
rester activement présent sur l'ensemble du territoire national.
Cependant, elle est
incontestablement en contradiction avec l'esprit et la
lettre de la loi du 7 janvier 1983.
c) Le partage non réalisé : des services en parallèle sinon en " doublon "
La
faiblesse des réalisations en matière de partition des services
contraste avec l'ampleur et la diversité des compétences
transférées.
En effet, les services de l'État
après la décentralisation ont davantage été
" amputés " de leurs prérogatives que recomposés
dans un objectif d'efficacité... L'État a conservé les
fonctionnaires affectés à des compétences pourtant
transférées aux collectivités territoriales. Aucune
partition de services ne semble actuellement envisagée, alors que
certaines compétences transférées n'ont à ce jour
donné lieu à aucune réorganisation des services de
l'État :
- la mise en oeuvre des lois de décentralisation n'a
entraîné
aucun partage de services entre les communes et
l'État
;
- la répartition des compétences
en matière
scolaire
ne s'est accompagnée d'aucun partage de services. Les
rectorats, les inspections académiques et les services techniques et
administratifs chargés du fonctionnement et de l'équipement des
collèges et des lycées sont demeurés des services
d'Etat ; le personnel qui y est affecté est resté
d'Etat ;
- de même, les services dépendant du ministère de la
Culture n'ont pas été partagés avec la région
pourtant compétente en matière culturelle ;
- les
directions départementales de l'Agriculture et de la
forêt
(DDAF) n'ont donné lieu qu'à un partage
très limité, l'État conservant dans les DDAF d'État
les services chargés de l'équipement rural et de
l'aménagement foncier dotés des agents les plus
compétents, tandis que les conseils généraux peuvent
estimer n'avoir reçu que des attributions et des moyens illusoires ;
- si la partition de la délégation régionale à la
formation professionnelle
(DRFP) s'est correctement
déroulée, elle est toutefois peu significative, dans la mesure
où les conseils régionaux se sont quant même trouvés
dans l'obligation, pour assurer leur nouvelle compétence, de constituer
des services propres en recrutant le personnel nécessaire.
L'incertitude a été entretenue par la prorogation des
dispositions transitoires
91(
*
)
. En particulier,
le délai dans lequel devait être achevée la
procédure de réorganisation des services extérieurs de
l'État a été prorogé d'un an, de même que la
période au cours de laquelle les fonctionnaires exerçant leurs
fonctions dans un service transféré pouvaient opter pour le
maintien de leur statut ou demander à relever du statut de la fonction
publique territoriale.
Les collectivités locales ont ainsi dû créer leurs
propres services, parallèlement à ceux de l'État, dont les
effectifs n'ont pas été diminués pour autant. Le
coût de ce double système d'administration a pu être
présenté par le journal
Le Monde
par la formule :
"
un moins un égale deux
"
92(
*
)
.
En définitive, la politique de partition des services est à la
fois inefficace et inachevée. Les découpages opérés
se sont rarement révélés fonctionnels ;
l'enchevêtrement des compétences entre l'État et les
collectivités territoriales est déroutant pour les citoyens qui
ne savent plus à quelle direction administrative s'adresser.
2. La déconcentration et la restructuration des administrations territoriales de l'état sont toujours en chantier
L'importance stratégique des services
déconcentrés doit être soulignée : 96 %
des deux millions d'agents de l'État travaillent au sein de son
administration territoriale. Celle-ci gère les deux tiers des
crédits inscrits au budget de l'État et prend les trois quarts
des décisions concernant les usagers.
La déconcentration peut être verticale, lorsqu'elle consiste
à responsabiliser les services extérieurs de l'État, ou
horizontale, quand elle accroît le rôle du préfet en
matière de coordination de ces services, à l'exemple des
décrets du 10 mai 1982.
a) Les enjeux de la déconcentration
Comme
l'indique l'adage selon lequel "
on peut gouverner de loin mais on
n'administre bien que de près
", la décentralisation
supposait la capacité de l'État à définir ce qui
est véritablement d'essence nationale. Elle devait s'accompagner d'une
modification profonde de l'organisation, des motivations et des méthodes
de travail des services extérieurs de l'État.
La déconcentration, qui consiste à transférer des
attributions de l'échelon central aux autorités de l'État
implantées dans les circonscriptions administratives, fut le
maître mot employé pour définir la réforme de
l'administration française de 1958 à 1981 ; elle constituait
alors
un correctif technique et un palliatif de l'absence de
décentralisation
.
Il s'agissait pour l'État de se rapprocher du lieu d'application des
politiques
93(
*
)
. Déconcentrer a
consisté à mieux répartir les actions remplies par les
administrations de l'État entre le niveau national de conception de ces
actions et le niveau territorial d'exécution, sans remettre en cause la
compétence de l'État dans ces domaines.
b) Un objectif sans cesse réaffirmé
Dès 1982, la déconcentration a été
présentée comme le " deuxième pilier " de la
décentralisation et son indispensable contrepartie. Gaston Defferre
affirmait alors qu'il était "
souhaitable qu'à chaque
niveau de décentralisation corresponde un niveau de
déconcentration aussi fort
".
Toutefois, les décrets du 10 mai 1982, relatifs aux
attributions des commissaires de la République dans les
départements et les régions, visent davantage à renforcer
les pouvoirs des représentants de l'État sur les services
déconcentrés qu'à leur transférer des
compétences en provenance de l'échelon central.
La politique de
renouveau du service public
, définie par la
circulaire du Premier ministre Michel Rocard du
23 février 1989, qui proposait " le développement
des responsabilités par une déconcentration plus
poussée " et la modernisation de la gestion administrative, ne peut
être présentée comme une véritable mesure
d'accompagnement de la décentralisation. Dès lors, la question de
la déconcentration restait centrale lors des débats
législatifs relatifs à l'administration territoriale de la
République en 1992.
(1) La reconnaissance de la dimension territoriale de l'État.
Deux
textes publiés en 1992
reconnaissent la dimension territoriale
de l'État :
- la loi d'orientation n° 92-125 du
6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République place sur un pied d'égalité services de
l'État et collectivités territoriales en indiquant que
"
l'administration territoriale de la République est
assurée par les collectivités territoriales et par les services
déconcentrés
94(
*
)
de
l'État
" ;
L'intervention du législateur peut surprendre au regard de la
répartition constitutionnelle entre pouvoir réglementaire et
domaine de la loi. Comme le Sénat l'avait souligné, la
déconcentration relève de la compétence du Gouvernement.
Force est de constater que l'appel au législateur traduit
l'incapacité de l'État à réformer ses propres
structures ;
- le décret n° 92-604 du
1
er
juillet 1992 portant charte de la
déconcentration décline le principe selon lequel "
la
déconcentration est la règle générale
de
répartition des attributions et des moyens entre les différents
échelons des administrations civiles de l'État
". La
déconcentration devient le droit commun.
Le décret portant charte de la déconcentration allait très
loin en limitant le champ d'intervention des administrations centrales et des
services à compétence nationale aux "
seules
missions
95(
*
)
qui présentent un
caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne
peut être déléguée à un échelon
territorial
". De plus, la circonscription départementale
devait être l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques
nationale et communautaire.
(2) L'affirmation du principe de subsidiarité
La loi
d'orientation sur l'administration territoriale de la République marque
une rupture radicale
avec les pratiques antérieures de la
déconcentration. Elle introduit une
innovation juridique
essentielle
: le
principe de subsidiarité.
Elle
ajoute que "
les missions qui intéressent les relations entre
l'État et les collectivités territoriales, sont confiées
aux services déconcentrés
".
La charte de la déconcentration réaffirme l'autorité et le
pouvoir de direction du préfet sur les différents services
déconcentrés. Elle étend les compétences des
préfets en les chargeant de
négocier les contrats
conclus
au nom de l'État avec les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, alors qu'auparavant ils se bornaient bien
souvent à signer des accords dont le contenu avait été
arrêté à l'échelon central.
(3) La volonté de rendre la déconcentration irréversible
La
réforme des services centraux et territoriaux de l'État
constituait à nouveau un volet important du plan de réforme de
l'État à l'automne 1995. L'objectif affiché est celui d'un
double resserrement : resserrement des administrations centrales en termes
de structures et d'effectifs ; resserrement des administrations
territoriales autour du préfet pour conduire les politiques
interministérielles.
Le Gouvernement dirigé par M. Alain Juppé avait souhaité
rendre le processus de déconcentration irréversible
, en
affirmant la compétence de droit commun du préfet et en faisant
des services déconcentrés non plus les
" exécutants " mais les " opérateurs " des
politiques publiques.
Aussi le
décret du 15 janvier 1997
prévoyait-il
la compétence du préfet pour les décisions administratives
individuelles prises au titre des 4.200 régimes d'autorisation
existants. Un "
dispositif anti-remontée
",
d'importantes délégations budgétaires globalisées,
un allégement du contrôle financier central, la
déconcentration géographique de 10 % des effectifs des
administrations centrales accompagnaient cette réforme. Au
1
er
janvier 1998,
73 % des décisions
individuelles
avaient été prises selon une procédure
déconcentrée.
Plusieurs mesures ont été arrêtées à la suite
des orientations fixées par la
circulaire du Premier ministre du
26 juillet 1995
relative à la préparation et
à la mise en oeuvre de la réforme de l'État et des
services publics :
- création d'un fonds pour la réforme de l'État
96(
*
)
;
- accentuation de la déconcentration de la gestion des personnels,
déconcentration de la procédure de mise à disposition des
fonctionnaires
97(
*
)
;
- approfondissement de la déconcentration des crédits
d'intervention et engagement dans la voie de la globalisation des
crédits par une réduction du nombre d'articles
budgétaires, réforme du contrôle financier local
98(
*
)
;
- renforcement de la capacité d'action du préfet dans le domaine
immobilier, notamment par l'institution à son profit d'une
procédure d'avis conforme pour les projets immobiliers des services de
l'État dans son département
99(
*
)
;
- simplification des régimes d'autorisation et de déclaration
administrative préalable
100(
*
)
;
- reconnaissance du préfet comme autorité de droit commun pour
prendre des décisions administratives individuelles entrant dans le
champ des compétences des administrations civiles de
l'État
101(
*
)
.
Les vingt-six décrets des 19 et 24 décembre 1997
déconcentrent environ six cents procédures qui
représentent par an plusieurs milliers d'actes administratifs.
Le
préfet de département détient désormais une
compétence de principe en matière de décisions
individuelles
. Les exceptions, limitativement admises au profit des
ministres ou d'autres autorités (préfet de région,
recteurs d'académie...), doivent être expressément
prévues par un décret en Conseil d'État et soumises au
Conseil des ministres s'il s'agit de retenir une compétence à
l'échelon central.
c) Une mise en oeuvre laborieuse
La
décentralisation devait amener
"
un
jacobinisme
rénové
"
, voire
"
rationalisé
" ou
"
apprivoisé
"
102(
*
)
.
Mais l'État n'a pas tiré toutes les conséquences de la
décentralisation, de la territorialisation de l'action publique et de
l'affirmation en 1992 du principe de subsidiarité... au point que la
déconcentration apparaît aujourd'hui comme " une
révolution permanente "
103(
*
)
.
Comme l'indiquait déjà le " rapport Guichard ",
l'État est partout présent tout en étant faible et souvent
absent quand on appelle son intervention. Certains commentateurs
évoquent même "
une multiplication pathétique de
gadgets et d'opérations d'étiquetage, qui n'ont de
réformes administratives que le nom
"
104(
*
)
.
Même après la relance de la réforme de l'État par le
Gouvernement de M. Alain Juppé en 1995,
le " chantier " du
pilotage des services territoriaux, clé de la déconcentration,
est largement intact
105(
*
)
.
Ce constat est très largement partagé. A titre d'exemple,
M. Marc Censi, président de l'Assemblée des districts
et communautés de France, entendu par la mission, a souligné que
la déconcentration n'avait pas beaucoup progressé et il a
regretté qu'il faille trop souvent remonter jusqu'à
l'administration centrale pour régler des problèmes locaux.
M. Jean Auroux, président de la Fédération des
maires de villes moyennes, a lui aussi observé que les services
déconcentrés continuaient à faire remonter à Paris
la prise de décisions même sur des problèmes secondaires.
(1) Les pouvoirs des préfets s'exercent sur un périmètre limité
La
question des limites du pouvoir de direction du préfet, véritable
enjeu de la déconcentration, reste entière. Le
" périmètre administratif " sur lequel s'exerce ce
pouvoir
laisse de côté des pans entiers de l'action
publique
et de nombreux satellites de l'État. L'autorité du
préfet sur les différents services extérieurs de
l'État est très inégalement affirmée. Ainsi, les
services de l'emploi, ceux de l'éducation nationale, les services
financiers ou encore les architectes des bâtiments de France
échappent traditionnellement à l'autorité du
préfet
.
En ce sens, M. Jean-Pierre Raffarin, président de
l'Association des régions de France, a regretté que tous les
services de l'État ne soient pas subordonnés à
l'autorité du préfet, en particulier dans le domaine de
l'éducation où l'absence d'autorité hiérarchique du
préfet sur le recteur conduit à des dysfonctionnements.
Comme le souligne la DGAFP
106(
*
)
, les
conditions, au plan local, d'un traitement interministériel des
problèmes ne sont pas toujours remplies, alors même que des
politiques publiques aussi essentielles que l'aménagement du territoire,
l'emploi ou la politique de la ville concernent une dizaine de services
déconcentrés.
Bien que chaque ministère ait mis en place une commission chargée
d'élaborer des propositions de déconcentration
107(
*
)
, les administrations centrales ont été
assez réticentes à s'engager dans la voie des regroupements
fonctionnels des services territoriaux. En pratique, les contradictions
internes de l'État central ne manquent pas d'être
répercutées à l'échelon local.
(2) La déconcentration de la gestion des personnels est incomplète
La
gestion de la fonction publique de l'État s'effectue à un double
niveau : le niveau central mène l'organisation
générale et la répartition des postes, et l'échelon
déconcentré gère certaines catégories
d'agents
108(
*
)
d'un bout à l'autre de la
chaîne ou assure certains actes de gestion
élémentaires
109(
*
)
.
La déconcentration des actes matériels de gestion des corps de
catégorie A reste à mettre en oeuvre, de même que la
gestion des ressources humaines : formation, appréciation des
compétences et des qualifications disponibles, etc.
La répartition parfois aléatoire des compétences entre
l'État et les collectivités locales et la concurrence entre corps
et ministères sont autant d'obstacles à franchir. Les partisans
de la gestion nationale mettent en avant l'argument selon lequel les
gestionnaires déconcentrés se sentiraient propriétaires de
leurs agents, ne seraient matériellement pas en mesure de
rééquilibrer les recrutements en fonction des besoins et des
contraintes démographiques et géographiques.
Ces modes de pensée expliquent que les résultats de
l'interministérialité au plan local soient mitigés :
les possibilités récemment ouvertes de " mises à
disposition croisées " ne sont quasiment pas utilisées.
(3) La déconcentration de la gestion des crédits
Dans le
domaine des crédits de fonctionnement, le mouvement de
déconcentration est déjà largement engagé. Mais les
crédits d'investissement, après le décret du 13 novembre
1970, sont encore trop souvent gérés au niveau central. Deux
mesures méritent d'être soulignées :
- le décret n° 99-896 du 20 octobre 1999
110(
*
)
devrait mettre en oeuvre le principe de
déconcentration en matière de décisions de l'État
relatives aux investissements publics. Il inverse la règle en faisant du
maintien du pouvoir de décision central l'exception ;
- au 1
er
janvier 2000, une expérience de
globalisation des moyens de fonctionnement
des préfectures
a été lancée dans quatre préfectures (Doubs,
Finistère, Isère, Seine-Maritime). Les préfets
concernés bénéficient d'une délégation
globale de l'ensemble de leurs moyens de personnel et de fonctionnement dans
une enveloppe globale fongible. Cette expérimentation devrait engager
les quatre préfectures concernées à réaliser les
réformes de structures et de procédures devenues indispensables.
Elle pourrait être généralisée en cas de
succès.
(4) La politique immobilière de l'État : " volonté de déconcentrer, tentation de recentralisation "
Aujourd'hui, le patrimoine immobilier de l'État est mal
connu
et mal géré. Or, selon le rapport d'activité de
l'Inspection générale de l'administration (IGA), les dispositions
relatives à la déconcentration de la politique immobilière
de l'État
111(
*
)
sont restées
insuffisantes et n'ont pas résolu les questions de long terme, comme la
stratégie d'implantation des services de l'État, l'acquisition ou
la cession de biens immobiliers.
Malgré la mise en place d'une Commission interministérielle de la
politique immobilière (CIPI) auprès du secrétariat
général du Gouvernement, les ministères ont
continué leur propre politique immobilière sans véritable
pilotage interministériel. Les administrations centrales ont
été encouragées en ce sens, notamment par une circulaire
du Premier ministre en date du 21 février 1992 selon laquelle
chaque ministère est pleinement responsable de son parc immobilier.
Cette juxtaposition permanente de deux logiques, l'une horizontale et l'autre
verticale, ne facilite pas la conduite sur le terrain de la politique
immobilière de l'État. Pour y remédier, six
départements pilotes
112(
*
)
ont
mené en 1995 une expérience de "
pôles de
compétences immobilières
" sous forme d'un travail
interministériel en réseau
113(
*
)
.
Malgré des résultats positifs au plan local, et le décret
du 13 février 1997 prévoyant qu'aucune opération
immobilière intéressant un ou plusieurs services
déconcentrés de l'État ne peut être engagée
sans l'accord exprès du préfet, l'IGA déplore
l'insuffisance de l'information des préfets par les administrations
centrales et la multiplication des initiatives ministérielles dans le
domaine immobilier, pouvant signifier à plus ou moins brève
échéance
l'échec de la déconcentration de la
politique immobilière de l'État.
d) L'insuffisante restructuration des services territoriaux de l'État
La
réorganisation des services déconcentrés de l'État
est d'autant plus nécessaire que leur partition dans les années
1980 n'a pas été complète, que la charte de la
déconcentration du 1
er
juillet 1992 est censée leur
donner un rôle essentiel pour l'avenir dans l'accomplissement des
missions de l'État, et que les élus locaux veulent trouver
à leur niveau des interlocuteurs habilités à
négocier et à engager valablement l'État.
L'effort de restructuration des administrations de l'État entrepris
depuis la décentralisation est trop limité. En témoigne
le nombre beaucoup trop élevé des directions sur le même
territoire
: plus d'une vingtaine de services déconcentrés se
côtoient dans chaque département.
Devant l'inaction des administrations centrales,
le législateur a
été amené à plusieurs reprises à demander
à l'État de réorganiser son administration
territoriale ; cette intervention du législateur en dehors du
domaine de la loi traduit l'incapacité de l'État à
réformer ses propres structures.
Ainsi, la loi d'orientation n° 95-115 du
4 février 1995 pour l'aménagement et le
développement du territoire prévoyait que les services
déconcentrés de l'État, placés sous
l'autorité du préfet, devaient faire l'objet dans un délai
de dix-huit mois de "
regroupements fonctionnels
favorisant leur efficacité, leur polyvalence et leur présence sur
le territoire
". Ces regroupements devaient être
opérés dans le cadre d'un schéma de réorganisation
des services de l'État, précisant les niveaux d'exercice des
compétences de l'État et les adaptations de leurs implantations
territoriales
114(
*
)
.
Une
circulaire du Premier ministre en date du 24 octobre 1995
a demandé aux préfets de région et de
département :
- de rechercher les
regroupements
entre les directions régionales
et départementales dépendant d'une même administration dans
les départements chefs-lieux de région ;
- d'examiner les possibilités de mutualiser entre plusieurs
départements tout ou partie des fonctions ou des services des directions
départementales d'un ministère :
création de
directions interdépartementales
;
- de chercher à regrouper des services exerçant des missions
voisines ou complémentaires ;
- de proposer la gestion interministérielle de certains moyens
matériels, immobiliers, financiers et humains ;
- de confier à un chef de service un rôle horizontal de
coordination et d'animation.
Les réformes de structure sont restées très partielles. Le
seul regroupement significatif reste celui des directions du travail et de
l'emploi avec l'administration de la formation professionnelle. Aucune mesure
structurelle n'a été prise pour remédier à
l'émiettement de l'administration de l'État. Au contraire, de
nouveaux ministères ont procédé à leur implantation
territoriale (commerce extérieur, environnement) et de plus anciens
l'ont renforcée en coiffant leurs directions départementales de
directions régionales (agriculture et forêt).
Comme le conclut l'IGA, "
la méthode de l'expérimentale
en matière de réorganisation des services trahit ici sa
fragilité ;
en l'absence d'une volonté politique ou d'un
consensus clairement affirmés, elle est impuissante à surmonter
les oppositions au changement
".
e) Un pis-aller : la coordination sans réorganisation des services
(1) L'abandon de la réforme des structures territoriales de l'État
Il
semblerait que les réformes de structures ne figurent plus au rang des
priorités de l'actuel Gouvernement et soient délaissées,
au profit de solutions moins exigeantes.
En effet, le comité interministériel à la réforme
de l'État du 13 juillet 1999, estimant qu'une démarche
tendant à une
recomposition fonctionnelle des services
se
heurtait à des rigidités statutaires et rencontrait de nombreux
obstacles structurels,
a renoncé
à cette
réorganisation, préférant explorer d'autres voies.
(2) Des dispositifs de coordination multiples et peu ambitieux
Après l'abandon des expériences de recomposition
des
services déconcentrés, l'élaboration des
"
programmes pluriannuels de modernisation
", en application
de la circulaire du Premier ministre du 3 juin 1998, a donné
lieu à un rapport de synthèse en juillet 1999... dont le
contenu ne paraît pas constituer une relance de la réforme de
l'administration territoriale de l'État.
En effet, certains sujets majeurs n'ont absolument pas été
abordés par les programmes
115(
*
)
:
la politique immobilière de l'État, les formations
interministérielles, les enveloppes de crédits, le resserrement
de la nomenclature budgétaire, la simplification des dispositifs
d'intervention de l'État...
Les actions envisagées par le Gouvernement sont les suivantes :
- le "
projet territorial de l'État dans le
département
", qui doit constituer une démarche
collective associant tous les services déconcentrés de
l'État dans le but d'élaborer une stratégie commune et de
définir une organisation optimale ;
- en 1998-1999, l'accent a été plus particulièrement mis
sur le développement des " nouvelles technologies de l'information
et de la communication " dans le cadre du programme gouvernemental pour
l'entrée de la France dans la société de l'information.
Ainsi, les préfectures sont le pivot de la mise en place des
systèmes d'information territoriaux
(SIT), c'est à dire la
mise en réseau informatique des services de l'État autour d'une
messagerie et de bases de données communes à plusieurs
services ;
- les décrets n° 99-895 et n° 99-896 du 20
octobre 1999 confient aux préfets la compétence pour fixer
l'organisation des services déconcentrés placés sous leur
autorité ;
-
la promotion de
l'interministérialité
, consistant
en la direction par le préfet des services déconcentrés de
l'ensemble des ministères, est censée améliorer la
cohésion de l'administration territoriale. Elle n'est toutefois qu'un
pis-aller, destiné à
masquer le manque d'ambition en ce qui
concerne le regroupement des administrations
;
- la constitution de
pôles de compétences
entre des
administrations civiles déconcentrées pour mener à bien
des actions communes, qui rencontre un certain succès dans les domaines
à forte interministérialité (gestion de l'eau par
exemple) ;
- enfin, la loi d'orientation pour l'aménagement et de
développement durable du territoire du 25 juin 1999 encadre la
constitution des
maisons des services publics
mettant en commun dans un
cadre conventionnel des moyens de l'État, des collectivités
territoriales, des établissements publics et des organismes
chargés d'une mission de service public.
II. UNE ORGANISATION TERRITORIALE EN DEVENIR
A. LES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES : L'ABSENCE D'UN MODÈLE UNIQUE
Il est
classique de distinguer en Europe les
Etats fédéraux
,
comme l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, la Russie et la Suisse, des
Etats unitaires
comme la France, le Royaume-Uni, les pays scandinaves,
la Grèce, l'Irlande, le Portugal et les nouvelles démocraties
d'Europe centrale et orientale.
Cependant, une distinction trop rigoureuse entre ces deux formes
étatiques tend à exclure des pays comme l'Italie, qualifié
"
d'Etat régional
", et l'Espagne, qualifié
"
d'Etat des autonomies
" (la Belgique, quant à elle, a
opté définitivement pour le fédéralisme
après une lente évolution).
En outre, la mise en oeuvre de réformes décentralisatrices, d'un
côté, le mécanisme d'intégration centralisatrice de
Bruxelles, de l'autre, ont rendu moins nette la distinction entre Etats
unitaires et Etats fédéraux et l'Europe d'aujourd'hui est
marquée par une
diversification croissante des formes
étatiques
et un
rapprochement sensible des diverses organisations
territoriales
.
On assiste presque partout au renforcement d'une tendance toujours plus nette
à la régionalisation. Cependant, force est de constater
l'absence d'un modèle unique
, auquel l'organisation territorial
française serait invitée à se conformer.
1. Décentralisation et évolution du modèle fédéral
Il y a
Etat fédéral quand deux principes essentiels sont
respectés.
le principe d'autonomie qui exige que les composantes de l'Etat
fédéral, elles-mêmes des Etats, conservent la
liberté de fixer leur propre statut et de définir leur
politique ;
le principe de participation qui veut que les composantes puissent participer
à l'expression de la volonté fédérale à
travers leur représentation dans les institutions de la
fédération.
D'autre part, l'une des grandes différences entre l'Etat
fédéral et l'Etat unitaire réside dans le fait que la
répartition des compétences
entre le niveau
fédéral et les niveaux fédérés
résulte d'un
pacte initial
: la Constitution. Ces
compétences devraient être exclusives, mais la tendance
générale des constitutions européennes est le
développement de
compétences concurrentes
.
Par exemple, Länder et fédération ont des compétences
propres en Allemagne, mais elles sont limitées (police, enseignement,
organisation des collectivités locales pour les Länder, affaires
étrangères, défense, monnaie, commerce, douanes, postes...
pour la fédération). Le plus grand nombre des compétences
sont concurrentes.
Autre exemple : en Suisse, l'article 3 de la Constitution confère
au canton une compétence de principe ; la fédération
reçoit des compétences exclusives pour lesquelles la
fédération reçoit le droit de fixer les principes,
l'application étant laissée aux cantons.
On assiste donc au développement du
fédéralisme
coopératif
. En outre, les pactes initiaux se sont trouvés
affectés à la fois par la pratique et par les conséquences
de la construction européenne.
C'est ainsi qu'en
Allemagne
se sont multipliées les
instances
associant les Länder et la fédération
(et
s'efforçant de fonctionner selon la règle de
l'unanimité) : conférence des ministres de
l'éducation, des ministres-présidents, comité allemand de
la recherche... Cette politique a permis une certaine uniformisation des
règles en matière judiciaire, en matière de police et de
fonction publique. Le système de
péréquation des
ressources
fournit également un excellent exemple de
coopération. De plus, la loi constitutionnelle du 12 mai 1969 a
introduit le concept de "
tâches communes de la
fédération et des Länder
" en matière
économique, financière et éducative entre autres.
Voilà pourquoi, de modèle de conciliation entre l'unité et
la diversité, l'Etat fédéral a évolué en
pratique vers davantage d'uniformité et un renforcement des pouvoirs des
fédérations. A cette évolution, trois grands facteurs ont
contribué : l'utilisation intensive par la fédération
des pouvoirs qui lui étaient réservés par la Constitution,
la jurisprudence des cours constitutionnelles et les révisions du pacte
fondateur lui-même.
D'autre part, la ratification du traité de Maastricht qui entraîne
une nouvelle extension des politiques communes ne pouvait que susciter des
réactions des Etats à l'intérieur de
fédérations qui risquaient de se voir privés de pans
entiers de leurs compétences ou voir l'exercice de celles-ci
étroitement contrôlé sans avoir pu être
associés aux discussions préalables sur les transferts de
souveraineté. Le problème était d'autant plus sensible en
Allemagne qu'en l'absence d'administration fédérale
générale, c'est aux Länder qu'allait incomber l'application
des nouvelles règles communautaires. Lors de la ratification du
Traité, les Länder ont échangé leur approbation
contre une révision de la constitution posant que les transferts de
souveraineté à venir ne pourraient se faire sans
l'accord du
Bundesrat à la majorité des deux tiers
.
2. Décentralisation et mutation de l'État unitaire
Aucun
Etat européen ne correspond aujourd'hui à la version classique de
l'Etat unitaire dont la France jacobine et napoléonienne fut le symbole
et le modèle.
Les structures traditionnelles de l'Etat unitaire ont été
affectées par un double mouvement qui tend à redonner au
marché un certain nombre de fonctions que l'Etat s'était
appropriées
mais aussi à transférer des pouvoirs de
décision au plus près du citoyen
. Ce dernier mouvement de
renforcement de l'autonomie locale connaît des fortunes diverses selon
les pays : décentralisation en France, recentralisation au
Royaume-Uni sous la pression des difficultés budgétaires, retour
aux libertés municipales et décentralisation dans les nouvelles
démocraties d'Europe centrale et orientale pour démanteler les
anciennes structures totalitaires.
La diversification est donc aussi l'apanage des Etats unitaires
. Au
Royaume-Uni, les règles du gouvernement local varient de l'Angleterre au
Pays de Galles, et du Pays de Galles à l'Ecosse. Au sein même d'un
Etat unitaire coexistent des composantes entretenant avec lui des relations
plus ou moins étroites qui vont parfois au-delà de la
décentralisation et jusqu'à l'autonomie et donc conduisent
à une forme de préfédéralisme. Au Portugal, les
Açores et Madère possèdent un statut adopté par
l'Assemblée de la République mais élaboré par les
assemblées législatives régionales qui disposent donc d'un
vrai pouvoir législatif certes limité.
Le développement de l'autonomie locale et régionale
(c'est-à-dire toutes les réformes de décentralisation) a
lui-même beaucoup contribué à changer la physionomie de
l'Etat unitaire.
Outre la grande décentralisation française de 1982-1985, objet
même de ce rapport, on relève le même esprit de
réforme au Luxembourg (loi communale du 13 décembre 1988), au
Portugal (1984-1991), en Grèce (1986-1990), au Danemark (1988), en
Suède (1992), en Norvège (1992) et aux Pays-Bas (1994). Ces
réformes ont façonné une espèce de droit commun de
l'autonomie locale en Europe, droit consacré par une convention du
Conseil de l'Europe sur l'autonomie locale et régionale en vigueur
depuis 1988 et signée par 23 pays. Les nouvelles démocraties
d'Europe centrale et orientale s'y réfèrent aujourd'hui pour
mettre en place leur organisation territoriale.
Cette évolution décentralisatrice se caractérise par les
traits suivants :
- adoption de systèmes de répartition des compétences par
la loi (France) ;
- transformation des procédures de tutelle vers des systèmes de
contrôle juridictionnel (France, Portugal, Suède) ;
- réduction du nombre de domaines dans lesquels les autorités
centrales peuvent exercer un contrôle d'opportunité (Danemark,
Finlande, Norvège, Pologne).
Mais, paradoxalement, même si la décentralisation traduit un
degré d'autonomie inférieur au fédéralisme,
elle
est souvent mieux assurée dans les Etats unitaires que dans les Etats
fédéraux ou autonomiques
. En effet, dans ces derniers Etats,
le statut des collectivités locales, la détermination des
conditions d'exercice et l'exercice lui-même de la tutelle
relèvent du législateur fédéré plus proche.
De même, l'appartenance a
un Etat fédéral
n'entraîne pas pour les collectivités locales une situation
financière plus avantageuse
. L'objectif d'assurer l'autonomie de
décision par l'octroi aux entités subétatiques
d'impôts propres et localisés est à peine
réalisé au niveau des Etats fédérés
eux-mêmes. La plupart des ressources des Länder allemands par
exemple proviennent d'impôts partagés. Les impôts propres
n'assurent qu'un montant très faible des ressources budgétaires
(moins de 10 %). Il n'est guère surprenant que les
collectivités locales ne soient pas mieux traitées à cet
égard que les Etats fédérés. Seule la Suisse assure
une répartition équilibrée de l'impôt entre les
trois niveaux et les communes suisses perçoivent une part plus
importante de l'impôt sur le revenu que la fédération
elle-même.
Le critère de la forme de l'Etat, lorsqu'on veut apprécier le
degré réel de décentralisation, apparaît donc de
moins en moins déterminant.
En outre, certains Etats unitaires se sont lancés dans une
expérience " régionaliste "
qui les rapproche
des Etats fédéraux.
Les choses se passent comme si les Etats unitaires poussés vers le
fédéralisme (ou en tout cas un degré très abouti de
décentralisation) refusaient d'opter pour la forme
fédérale déclarée et s'en tenaient à une
situation hybride. Le
Royaume-Uni
, après l'Italie, l'Espagne et
la Belgique, est le dernier en date de cette catégorie nouvelle d'Etats
régionalistes puisqu'en effet, le processus de
" dévolution " au profit du Pays de Galles et de l'Ecosse
vient d'aboutir avec le rétablissement des parlements gallois et
écossais dans leurs anciens droits.
Le premier exemple dans cette catégorie hybride est celui de
l'Italie
, république une et indivisible, qui reconnaît et
favorise les autonomies locales. L'Etat italien apparaît comme un Etat
unitaire au sein duquel semblent admis des éléments d'autonomie
politique et juridique au profit de divisions territoriales appelées
régions.
Quant à la
constitution espagnole
, elle reconnaît et
garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des
régions qui composent l'Espagne. Les régions sont invitées
à se déclarer " communautés autonomes ". Deux
régimes d'autonomie leur sont offerts : immédiate pour les
" nationalités historiques " de l'Espagne et après un
délai de cinq ans pour les autres. Le pouvoir législatif de ces
régions autonomes n'est subordonné qu'à la constitution et
le contrôle exercé par l'Etat est purement juridictionnel. La
répartition des compétences est favorable aux communautés
qui disposent de toutes les compétences sauf celles attribuées
explicitement à l'Etat.
3. Régionalisation et décentralisation
Il faut
partir d'une constatation : en Europe, il existe presque toujours un
niveau différent de celui de la collectivité territoriale de
base, mais il est rarement appelé région. La
régionalisation présentée comme une
nécessité de la construction européenne implique-t-elle
nécessairement la création d'un niveau supplémentaire qui
serait le troisième ? Ou la transformation du deuxième
niveau existant en une entité encore plus autonome ?
Ces questions couvrent un débat sur la taille idéale du niveau
intermédiaire, sur l'identité culturelle de l'entité ainsi
créée, sur le degré d'autonomie à accorder à
ces entités et donc sur l'unité de l'Etat pour les pays de
tradition unitaire, (et surtout les nouvelles démocraties soucieuses
d'éviter un éclatement centrifuge et tous les pays comptant de
fortes minorités).
D'autre part, le débat sur la régionalisation en Europe semble ne
pas prendre en compte certaines réalités de la
décentralisation comme la coopération existant entre les
collectivités locales de base : l'intercommunalité en France
et aux Pays-Bas ou les " fédérations " en Finlande.
La régionalisation, qui aujourd'hui semble être
considérée comme un moyen de mise en oeuvre d'un certain
degré d'autonomie territoriale par rapport à l'Etat, avait au
départ une connotation économique et relevait plus
précisément de la mission d'aménagement du territoire. Il
s'agissait de trouver un échelon de décision suffisamment vaste,
sans être celui de l'Etat central, pour répondre aux
nécessités de l'aménagement de l'espace.
Ce n'est qu'ensuite qu'apparaissent la culture et l'identité (en effet,
le découpage régional souvent artificiel quand il existait ne
s'appuyait que rarement sur un territoire historique). La région en
Europe est présentée maintenant comme un moyen d'affirmer la
diversité des cultures négligées jusque là par les
Etats centralisateurs.
L'idée a pris corps en Europe qu'il est nécessaire de disposer de
véritables collectivités régionales et locales autonomes
et administrées par des élus, expression de la
décentralisation. La région est donc devenue un niveau de
décentralisation au même titre que la commune, mais elle doit
être suffisamment vaste pour exercer des tâches
d'aménagement de développement économique, social et
culturel et de coordination et suffisamment proche pour demeurer sous le
contrôle des citoyens.
Une telle approche paraît suffisamment souple pour permettre à
chaque Etat de déterminer la structure de collectivités
territoriales qui lui semble répondre le mieux à son histoire et
à sa dimension
.
Mais aujourd'hui nous ne pouvons pas mettre sur le même plan les
régions à forte autonomie politique des Etats
fédérés et régionalisés et les niveaux
intermédiaires qui en tiennent lieu dans les Etats unitaires. Il faut
donc distinguer entre les collectivités de troisième niveau
appartenant à un Etat fédéral ou régional et les
régions telles qu'elles viennent d'être définies,
c'est-à-dire le meilleur niveau intermédiaire possible entre les
communes et l'Etat.
On voit donc qu'
il
n'y a pas de modèle unique en Europe
.
Toutefois, on présentera ici l'évolution récente de quatre
pays voisins (le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne).
4. La " dévolution " au Royaume-Uni
Il n'est
pas dans la tradition britannique de cultiver l'uniformité. Le
Royaume-Uni, malgré son nom, n'a jamais considéré que
l'union et l'unité passaient par la standardisation des territoires, qui
d'ailleurs sont chacun héritier d'une longue histoire
particulière. Pourtant, ce pays s'est engagé dans une
extraordinaire
réforme décentralisatrice
depuis 1999,
réforme qui porte là-bas le nom de " devolution " et
qui
renforce l'échelon intermédiaire entre l'Etat et la
commune
. L'unité du pays repose sur la couronne et on juge que son
organisation administrative peut varier au gré des
nécessités historiques sans l'ébranler.
Au Royaume-Uni, le transfert de pouvoirs et de compétences
étatiques au profit de collectivités infra-nationales se fait par
la seule volonté du Parlement qui adapte ce transfert en fonction de
chaque territoire. Les exigences d'autonomie des Ecossais, des Gallois et des
Irlandais ont conduit à une régionalisation d'un genre
inclassable qui conduit le pays au bord du fédéralisme.
La Grande-Bretagne continue à se classer elle-même
parmi les
Etats unitaires
, mais le pays se dit " multinational " et
reconnaît l'existence de quatre " nations-régions " en
son sein : l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord.
(Mais ne faudrait-il pas ajouter les Iles anglo-normandes et l'Ile de Man qui
ont leur propre Parlement ?).
La " dévolution " britannique se traduit par un
transfert
du pouvoir de décision
en matière économique, sociale
et culturelle du Parlement vers une assemblée régionale
élue au suffrage universel qui est dotée, à cet effet, de
moyens politiques et administratifs importants.
L'Ecosse
, qui a conservé depuis 1706 son système
judiciaire et sa religion presbytérienne, est désormais
dotée d'institutions politiques qui lui sont propres :
- un exécutif dont le chef est nommé par la Reine sur proposition
du Président de l'Assemblée régionale
écossaise ;
- un Parlement composé de 129 députés élus pour 4
ans (et autorisés à cumuler leur mandat avec celui de
député aux Communes).
L'Ecosse jouit désormais d'un pouvoir législatif et d'une
compétence générale d'administration (santé,
enseignement primaire et secondaire, formation professionnelle, aide sociale et
logement, développement économique et transports, justice et
police, environnement, agriculture, pêche, forêt, sports, culture,
administration locale). Cela a pour conséquence que la
législation écossaise peut être amenée à
modifier des lois britanniques pour une application en Ecosse. Les dotations de
l'Etat nécessaires à l'accomplissement de ces tâches
nouvelles restent décidées à Westminster
(c'est-à-dire par l'Etat central).
Le
Pays de Galles
a obtenu, quant à lui, non pas le pouvoir
législatif mais le pouvoir réglementaire. La commission
exécutive du Parlement gallois s'apparente au bureau d'un conseil
général français. Les pouvoirs transférés au
Pays de Galles (peu nombreux à ce stade) feront l'objet d'une
dévolution progressive.
En mettant en place ce programme de " dévolution ", le
Royaume-Uni s'est engagé dans une logique de changement qui va dans le
sens de la régionalisation souhaitée par Bruxelles, mais elle le
fait en respectant l'héritage de l'Histoire en s'appuyant sur de
très anciennes divisions du territoire.
5. L'Espagne : l'État des autonomies
L'État espagnol est fondé sur le
principe de
l'autonomie territoriale
. Le territoire est organisé en communes,
provinces et communautés autonomes. Il y a dix-sept communautés
autonomes en Espagne qui possèdent des compétences très
variables et inégales (comme c'est le cas désormais en
Grande-Bretagne).
Ces communautés autonomes se rangent cependant en deux
catégories : celles qui disposent de la pleine autonomie et celles
dont l'autonomie est progressive. Comme en Angleterre, les communautés
autonomes respectent les divisions historiques du territoire.
6. L'Italie : en route pour une autonomie toujours plus grande des régions
L'Italie
était déjà sur la voie de la régionalisation mais
la dernière réforme institutionnelle de 1999 augmente de
manière considérable les
pouvoirs des régions
. En
effet, les vingt régions qui composent l'Italie (cinq sont
déjà autonomes : Sardaigne, Sicile, Val d'Aoste,
Frioul-Vénétie Julienne, Trentin-Haut-Adige) vont pouvoir
décider de leur forme de gouvernement et bénéficier d'une
large autonomie financière et fiscale. L'Etat italien ne conservera
à terme que la politique extérieure, la défense,
l'économie, la monnaie et la sécurité.
En avril 2000, les présidents de région ont été
élus pour la première fois au suffrage universel ; ils
disposent désormais de pouvoirs étendus qui font d'eux de
véritables gouverneurs de " régions-Etats "
. Ils
ont pour mission d'écrire la constitution de leur région et de
choisir le mode de scrutin pour les prochaines élections
régionales.
Comme dans le cas anglais et dans le cas espagnol, la régionalisation de
l'organisation italienne conduit à une situation institutionnelle
relativement complexe.
7. La permanence du modèle allemand
L'Allemagne est régulièrement
présentée
comme modèle parfait de l'organisation territoriale non tant pour le
découpage du territoire que pour son système fiscal local.
L'Allemagne est constituée de
seize Etats
fédéraux
: les Länder, qui disposent de certains
attributs de souveraineté (gouvernement, pouvoir législatif,
appareil judiciaire). Chaque Land comprend une assemblée
délibérante élue au suffrage universel à la
proportionnelle et un organe exécutif élu pour la durée de
la législature par l'assemblée et dirigée par un
ministre-président. Les Länder disposent de compétences
exclusives (police, culture, système scolaire, organisation des
collectivités locales) et de compétences partagées avec la
Fédération (droit civil, droit fiscal, justice, gestion de la
fonction publique, transports...).
Les Länder ont
deux niveaux de collectivités locales
:
les communes et les arrondissements. Les communes ont une compétence
générale pour toutes les affaires locales tandis que les
arrondissements se chargent des tâches communales qui dépassent
les possibilités des communes. Ce sont les Länder qui exercent la
tutelle étatique
sur leurs collectivités cependant
très autonomes. Le système est basé sur un principe de
coopération et de consensus et il est caractérisé par
l'accomplissement de tâches communes et le financement croisé des
opérations.
Les recettes des Länder et des collectivités locales sont
définies dans le cadre global de la répartition des finances
publiques entre les différents niveaux.
Les collectivités locales allemandes ne jouissent donc que d'une
autonomie fiscale limitée
: elles collectent toutefois des
impôts qui leur sont propres mais pour la plus grande partie, leurs
recettes proviennent d'impôts communs partagés entre les trois
niveaux.
Le partage des impôts s'opère selon des
dispositifs de
péréquation
qui prennent
deux formes
:
- une
péréquation dite " horizontale ",
qui
constitue un mécanisme de solidarité entre les entités de
même niveau (communes ou Länder). La péréquation
horizontale en faveur des communes s'opère à partir de ressources
tirées de la redistribution par le Land aux communes de 15 % du produit
de l'impôt sur le revenu acquitté par leurs contribuables, dont le
revenu imposable dépasse un certain seuil. Chaque Land définit
librement les modalités de la péréquation entre les
communes de son territoire, à condition toutefois de respecter certains
principes comme la nécessaire prise en compte des écarts de
capacité financière et de besoins financiers entre les communes.
- une
péréquation dite " verticale "
, qui
intervient d'une part du Bund vers les Länder, d'autre part des
Länder vers leurs communes. Chaque Land est tenu d'accorder aux communes
de son territoire un pourcentage du produit des impôts partagés
qu'il reçoit du Bund, selon des modalités qu'il détermine
lui-même.
Lors de l'unification allemande, ce système de péréquation
n'a pas pu être appliqué immédiatement à l'ex-RDA,
les écarts de richesse entre les deux zones étant trop
importants. Un système transitoire a alors été mis en
place pour quatre ans, les Länder de l'Ouest conservant leur mode de
péréquation, les autres bénéficiant des ressources
du Fond de l'Unité Allemande.
Enfin, des subventions d'investissement sont accordées par le Bund et
les Länder pour le financement de projets précis
considérés comme prioritaires par ces derniers.
*
* *
Quels
enseignements peut-on tirer de cette analyse comparée en ce qui concerne
l'organisation territoriale française ?
S'il existe des différences d'approche décentralisatrice d'un
pays à l'autre, elles se justifient par la forme institutionnelle de
chaque Etat et par son histoire. On peut ainsi distinguer quatre
catégories de pays :
1° - Les Etats unitaires, où les pouvoirs octroyés aux
échelons locaux le sont par la loi et non par la Constitution (Danemark,
Finlande, Grèce, Irlande, Luxembourg, Suède).
2° - Les Etats unitaires décentralisés, où les droits
des collectivités locales sont en grande partie garantis par la
Constitution (Pays-Bas, Royaume-Uni).
3° - Les Etats régionalisés, où la
décentralisation va jusqu'à l'autonomie législative
(Italie, Espagne).
4° - Les Etats fédéraux, où l'échelon
intermédiaire a forme d'Etat et jouit de sa propre Constitution
(Allemagne, Belgique, Autriche).
De ces comparaisons et de cette classification, il ressort que la France jouit
d'un modèle de décentralisation tempérée. Son
organisation territoriale ne s'éloigne de la moyenne que sur un
point : le nombre de communes apparaît très
élevé (36 750) mais cet inconvénient peut être
pallié par les progrès de l'intercommunalité.
B. UNE NOUVELLE DONNE POUR L'ORGANISATION TERRITORIALE : LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'INTERCOMMUNALITÉ DE PROJET
Le renforcement de la coopération intercommunale constitue une préoccupation ancienne qui a néanmoins pris une nouvelle dimension avec la montée en puissance récente de l'intercommunalité de projet . Cette " nouvelle donne " aura nécessairement des conséquences sur l'organisation territoriale , sans que l'on puisse encore en évaluer précisément la portée.
1. Une préoccupation ancienne
a) Un remède à l'émiettement communal
Le
développement des structures de coopération intercommunale s'est
réalisé dans un contexte de
très fort
émiettement communal
.
L'échec des tentatives de regroupement communal
L'histoire administrative, depuis 1789, a été marquée par
différentes tentatives de regroupement communal.
Devant
l'Assemblée Constituante
, Thouret, Sièyès et
Condorcet plaidèrent pour la création de quelque 6.500 grandes
municipalités. Mirabeau défendit au contraire la transformation
en communes des 44.000 paroisses de l'Ancien Régime. Il fut, en
définitive décidé de créer une municipalité
dans chaque ville ou paroisse, le nombre total étant cependant
réduit de 44.000 à 38.000. Différents projets
cherchèrent à remettre en cause cette organisation
administrative. Il s'agissait de refondre les circonscriptions afin de
réduire le nombre des communes.
La
Constitution de l'an III (1795),
pour sa part, distingua trois
catégories de communes selon leur taille, et créa des
municipalités de canton regroupant les communes de
moins de 5.000
habitants. L'échec de cette tentative pesa fortement sur les nouveaux
projets de regroupements élaborés au XIXème siècle.
Il fallut attendre la Vème République pour que de nouvelles
solutions globales soient recherchées.
Entre 1958 et 1970
, différents textes ont ainsi cherché
à favoriser des regroupements avec des résultats très
limités : 298 fusions intéressant 635 communes sur un total de
37.708 (en 1968) furent réalisées pendant cette période.
Une nouvelle impulsion au regroupement communal résulta de la
loi du
16 juillet 1971
sur les
fusions
et
regroupements
de
communes.
Cependant, en dépit des incitations prévues par cette loi, le
nombre des fusions entre 1972 et 1978 est resté limité à
897, intéressant 2.217 communes, alors que les plans
départementaux, établis en application de la loi, concernaient
10.143 communes. Depuis 1978, certaines communes fusionnées ont, par
ailleurs, choisi de faire le chemin inverse et de retrouver leur
liberté.
b) Les principales étapes : une " stratification " des structures
L'échec des tentatives de regroupement communal a rendu d'autant plus nécessaire le développement des formules de coopération intercommunale. Avant l'adoption de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le " paysage " de l'intercommunalité était néanmoins marqué par une " stratification " des structures.
Une " stratification " des structures de coopération intercommunale
La
loi du 22 mars 1890
créa le syndicat de communes,
établissement public qui permet d'adapter la gestion communale, soit aux
nécessités techniques (électrification, adduction d'eau),
soit à certaines activités qui, par leur nature, débordent
les limites territoriales des communes (transport, urbanisme, assainissement).
Un
décret du 20 mai 1955
institua les syndicats mixtes qui
permettent aux communes et départements de s'associer entre eux, ainsi
qu'avec des établissements publics locaux.
L'ordonnance du 5 janvier 1959
a autorisé la création de
syndicats à vocation multiple (SIVOM). Comme leur nom l'indique, ces
syndicats peuvent être chargés de plusieurs missions: adduction
d'eau, lutte contre l'incendie, construction et gestion d'installations
sportives, de locaux scolaires, de crèches, de maisons de retraite ou
encore, transports de personnes.
La
loi du 5 janvier 1988
a institué un " syndicalisme
à la carte " en permettant à une commune de n'adhérer
à un syndicat que pour une partie seulement des compétences
exercées par celui-ci.
Dans le but de répondre au problème posé par les
agglomérations, l'ordonnance du 5 janvier 1959 institua, pour sa part,
les districts urbains. Cette formule, plus intégrée que les
syndicats de communes, fut ensuite étendue aux zones rurales par la
loi du 31 décembre 1970.
La
loi du 31 décembre 1966
a créé la
communauté urbaine, forme très intégrée de
coopération destinée à répondre aux
problèmes posés par les grandes agglomérations.
La loi du 31 décembre 1966 a créé d'office quatre
communautés urbaines dans des grandes agglomérations (Bordeaux,
Lille, Lyon et Strasbourg). Huit autres agglomérations se sont
dotées de cette structure de coopération (Cherbourg, le
Creusot-Montceau-les-Mines, Dunkerque, Le Mans, Brest, le grand Nancy, Arras et
Alençon).
Les syndicats d'agglomération nouvelle - qui ont résulté
de la
loi du 13 juillet 1983
-, ont été instaurés
pour répondre aux besoins des villes nouvelles créées dans
les années soixante-dix. Neuf villes nouvelles existent dont cinq en
région parisienne.
En créant deux nouvelles structures -les communautés de communes
et les communautés de villes-, la
loi du 6 février 1992
d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République, a entendu axer la coopération intercommunale sur le
développement économique et l'aménagement de l'espace.
A la veille de la loi du 12 juillet 1999, la coopération intercommunale
connaissait un dynamisme réel. En outre, l'intercommunalité
à fiscalité propre avait connu un véritable essor.
Au 1er janvier 1999, on dénombrait
1 680
établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
regroupant 19 065 communes, soit une population totale de 34,4 millions
d'habitants, dont 12 communautés urbaines, 1 654 communautés de
communes et districts et 9 syndicats d'agglomération nouvelle.
Cependant, la répartition sur le territoire des groupements à
fiscalité propre était assez inégale. En outre, comme
l'avait parfaitement mis en évidence le rapport établi par notre
collègue Daniel Hoeffel, au nom du groupe de travail de votre commission
des Lois sur la décentralisation, présidé par M. Jean-Paul
Delevoye,
116(
*
)
la
multiplication des
structures
s'est accompagnée d'une
très grande
complexité du régime juridique et financier
, chaque
catégorie étant dotée de règles spécifiques.
La coopération intercommunale -avec environ 18 000 structures pour
36 771 communes existantes- a donc largement reproduit le
phénomène de dispersion auquel elle doit pourtant essayer de
remédier.
En outre, les formules spécifiques à l'intercommunalité en
milieu urbain
n'ont pas connu le succès escompté
(seulement cinq communautés de villes ont été
créées : Aubagne, la Rochelle, Sicoval, Flers, Cambrai).
Sur le plan des compétences, les fonctions d'aménagement et de
développement n'ont été que récemment mises au
premier plan, notamment avec la création des communautés de
communes.
Les incitations financières -notamment le bénéfice de la
DGF dès la première année de fonctionnement du groupement-
ont, en outre, suscité de très fortes tensions dans la
répartition de la DGF.
La réforme opérée par la loi du 31 décembre
1993 a cherché à remédier à cette situation en
favorisant une réelle intercommunalité de projet sur la base d'un
coefficient d'intégration fiscale. Le poids du financement de
l'intercommunalité continue néanmoins à peser fortement
sur la DGF.
Sur le plan fiscal, l'unification des taux de taxe professionnelle doit
permettre de réduire les concurrences entre communes pour attirer les
entreprises.
Or le nombre d'établissements dotés de la taxe professionnelle
unique restait encore faible avant l'entrée en vigueur de la loi de 12
juillet 1999 qui a entendu promouvoir la taxe professionnelle
d'agglomération : au 1er janvier 1999, seulement
98
établissements publics de coopération intercommunale
étaient soumis à ce régime fiscal sur
1680
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
c) Les lignes directrices d'une réforme de l'intercommunalité : le rôle actif du Sénat
Les lignes directrices d'une réforme du régime de la coopération intercommuanle avaient été clairement énoncées dans le rapport du groupe de travail sur la décentralisation, constitué au sein de votre commission des Lois.
Les conclusions du groupe de travail sur la décentralisation
Le
groupe de travail sur la décentralisation de votre commission des Lois
avait fait de la simplification de la coopération intercommunale une
priorité en vue de l'adaptation des structures territoriales. Il avait
ainsi retenu trois
principes essentiels
de nature à satisfaire
cet objectif :
•
une réduction significative du nombre des catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale
Le groupe de travail avait recommandé la
réduction
du
nombre de catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale de même que la
simplification
du
régime juridique de ces établissements publics à partir
des deux logiques auxquelles répond la coopération
intercommunale, à savoir une logique de gestion et une logique de
projet. A cette fin, il avait jugé possible la
fusion des districts
et des communautés de communes
. Compte tenu de l'échec des
communautés de villes
, le groupe de travail avait
préconisé leur fusion avec les communautés de communes. Il
avait, enfin, envisagé l'évolution des
agglomérations
nouvelles
vers des formules de droit commun.
•
l'unification des règles applicables à partir d'un
" tronc commun
"
Le groupe de travail avait considéré que l'unification juridique
pourrait être
systématisée
par la définition
d'un corpus de règles qui formeraient le "
tronc
commun
" du régime applicable à tous les
établissements publics de coopération intercommunale. Ce tronc
commun serait complété par des règles spécifiques
à chaque catégorie et par différentes options que les
élus pourraient, le cas échéant, utiliser.
Cette solution devait approfondir la démarche déjà
engagée lors de l'élaboration du
code général
des collectivités territoriales
. Le groupe de travail avait, en
outre, entendu privilégier, dans le cadre de ce régime juridique
unifié, l'idée d'une
évolution progressive des
compétences
selon les besoins constatés par les élus
eux-mêmes.
•
Une évolution du régime financier et fiscal qui
favorise une véritable intercommunalité de projet en sanctionnant
la coopération purement circonstancielle et qui réduise les
concurrences abusives entre les communes en matière de taxe
professionnelle.
Afin d'encourager une
véritable intercommunalité de projet, le
groupe de travail avait considéré que
la mesure de
l'intégration fiscale à travers le coefficient
l'intégration fiscale devait aboutir à prendre en compte les
seuls transferts effectifs de compétences entre les communes et leurs
groupements.
Ecartant toute idée d'uniformisation des taux de la taxe professionnelle
au niveau national, le groupe de travail avait, par ailleurs, souhaité
le développement de la
taxe professionnelle
d'agglomération
, outil essentiel pour assurer une solidarité
locale et réduire les concurrences abusives entre les communes.
Les orientations retenues par le groupe de travail de la commission des Lois
avaient en grande partie été reprises dans l
e projet de loi relatif au développement de la
coopération intercommunale déposé au Sénat le
22 avril 1997.
Le
projet de loi relatif au développement
de la coopération
intercommunale
Ce
projet de loi qui a fait suite à des réflexions approfondies,
menées notamment dans le cadre du " pré-rapport relatif
à l'intercommunalité " établi par la Direction
générale des collectivités locales, poursuivait
trois
objectifs principaux
•
La simplification du paysage institutionnel
Ce premier objectif se traduisait par la fusion au sein d'une même
catégorie des districts, des communautés de communes et des
communautés de villes. Une option fiscale au profit de la taxe
professionnelle d'agglomération était ouverte à ces
établissements publics. Des dispositions transitoires étaient
prévues pour la création de cette catégorie unique.
•
La promotion de la taxe professionnelle d'agglomération
La taxe professionnelle unique faisait l'objet de mesures spécifiques,
sans que l'adoption de ce régime fiscal soit systématisé.
Ainsi, les communautés urbaines, créées après 1992,
se voyaient reconnaître la faculté d'opter pour une taxe
professionnelle
unique. La règle de lien entre les taux d'imposition était
assouplie. Les groupements dotés d'une taxe professionnelle
d'agglomération étaient autorisés à instituer une
fiscalité additionnelle sur les impôts-ménages.
•
La correction des critères de répartition de la
dotation globale de fonctionnement
Cette correction était destinée à mieux apprécier
l'intégration effective des groupements et à mieux
répartir la dotation globale des groupements à taxe
professionnelle unique en leur étendant le coefficient
d'intégration fiscale.
2. Une relance récente : la loi du 12 juillet 1999
a) Les principaux objectifs
La loi
du 12 juillet 1999, à laquelle le Sénat a apporté sa
pleine contribution et dont le texte résulte des travaux de la
commission mixte paritaire, réunie sous la présidence de M.
Jacques Larché, a repris en bonne partie les conclusions de ces travaux
antérieurs, notamment quant à l'objectif de simplification du
régime juridique de la coopération intercommunale.
•
Une rationalisation des structures intercommunales
La loi du 12 juillet 1999 a cherché à rationaliser le
" paysage " de la coopération intercommunale.
Au 1er janvier 2002, il n'existera plus que trois structures à
fiscalité propre : les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération et les communautés de
communes. La loi favorise, en outre, la transformation des syndicats
d'agglomération nouvelle.
L'esprit de la réforme est donc d'aboutir à une meilleure
spécialisation des structures. La communauté urbaine constitue la
forme la plus intégrée destinée aux grandes
agglomérations. La communauté d'agglomération doit
s'adresser davantage aux communes de taille moyenne. La communauté de
communes, dont la création n'est subordonnée à aucun seuil
démographique, a vocation à concerner le milieu rural.
A côté de ces structures à fiscalité propre, les
syndicats de communes (à vocation unique ou multiple) et les syndicats
mixtes doivent continuer à prendre en charge une intercommunalité
de services.
•
L'harmonisation des règles de fonctionnement
Conformément aux suggestions qui avaient été retenues par
le groupe de travail de votre commission des Lois sur la
décentralisation, la loi définit
un "
tronc
commun
" de règles applicables à l'ensemble des
catégories d'établissements publics de coopération
intercommunale
(
chapitre V du titre 1er
).
On notera, parmi ces règles communes, le
rôle reconnu au
représentant de l'Etat
tant pour prendre l'initiative que pour
apprécier l'opportunité de créer une structure
intercommunale (
article 35
). Conformément aux travaux du
Sénat, le pouvoir d'initiative du représentant de l'Etat a
néanmoins été subordonné à l'avis
préalable de la commission départementale de la
coopération intercommunale. Cet avis est réputé
négatif s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois.
Par ailleurs, les conditions de
désignation des
délégués intercommunaux
sont désormais plus
rigoureuses, seule la désignation de délégués
choisis
parmi les conseillers municipaux
étant autorisée,
une dérogation étant admise pour les syndicats de communes
(
article 36
). Cependant, l'idée de
faire désigner
les délégués intercommunaux au suffrage universel
direct
n'a pas été retenue par la législateur.
•
La promotion de l'intercommunalité en milieu urbain
Afin de répondre aux besoins du milieu urbain, la loi du 12 juillet 1999
crée une nouvelle catégorie, la
communauté
d'agglomération
, destinée aux ensembles
d'au moins 50
000
habitants organisés autour d'une commune centre de
15 000
habitants ou d'une commune chef lieu de département.
La communauté d'agglomération est dotée de
compétences obligatoires considérées comme
stratégiques pour le développement urbain (développement
économique, aménagement de l'espace) et la cohésion
urbaine (équilibre social de l'habitat, politique de la ville). Elle
exerce des compétences étendues en matière d'urbanisme
(création et réalisation de zones d'aménagement
concerté lorsque celles-ci sont d'intérêt communautaire).
Elle doit en outre opter pour des compétences qui concernent la mise en
place de réseaux techniques (voirie, assainissement et eau), les
équipements (culturels et sportifs), les services urbains (ordures
ménagères) et l'environnement. Elle est obligatoirement soumise
au régime fiscal de la
taxe professionnelle unique
. Elle
bénéficie d'un forte incitation financière puisque lui est
attribuée, pendant cinq ans et dès la première
année de création, une dotation par habitant au titre de la
dotation globale de fonctionnement d'un montant de
250 francs en moyenne.
Afin de mieux hiérarchiser les différentes formules de
coopération, la loi prévoit de relever le seuil
démographique pour la création des communautés urbaines
qui est désormais fixé à 5600 000 habitants (contre
20.000 habitants auparavant).
Les communautés urbaines existantes -au nombre de douze dont quatre
créées d'office par la loi du 31 décembre 1996- sont
maintenues dans le cadre juridique en vigueur, la possibilité leur
étant néanmoins ouverte de passer dans le nouveau régime
prévu par la loi.
La loi du 12 juillet 1999 a prévu que les nouvelles
communautés urbaines devront exercer l'ensemble des compétences
obligatoires et optionnelles des communautés d'agglomération.
Les communautés urbaines qui se créeront ou qui seront issues de
la transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale préexistant à compter de la date de publication de
la loi (le 13 juillet 1999) seront obligatoirement soumises au
régime fiscal de la
taxe professionnelle unique.
Celles qui ont été constituées avant cette date
bénéficieront d'un délai allongé, comme l'avait
souhaité le Sénat, jusqu'au 1
er
janvier 2002,
pour opter pour la taxe professionnelle unique à la majorité
simple de leurs membres.
Cependant, la perception de la taxe professionnelle unique n'interdira pas aux
communautés urbaines de percevoir un complément de ressources
sous la forme d'une fiscalité additionnelle.
•
Un aménagement du régime des communautés de
communes
Etendant aux communautés de communes la règle qu'elle applique,
par ailleurs, aux communautés d'agglomération et aux
communautés urbaines, la loi précise qu'elles devront
désormais être d' "
un seul tenant et sans
enclave ".
Les communautés de communes ayant opté pour la taxe
professionnelle unique doivent désormais obligatoirement prendre en
charge l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt
communautaire.
Sous certaines conditions, les communautés de communes ayant opté
pour la taxe professionnelle unique, peuvent bénéficier d'une
dotation globale de fonctionnement majorée (175 francs par habitant).
Les
conditions requises pour le versement d'une DGF
majorée à une
communauté de communes
Outre
l'obligation d'avoir opté pour la
taxe professionnelle unique
,
les conditions portent à la fois sur les
seuils de population
et
sur les
compétences
exercées.
Ne peuvent bénéficier de cette DGF majorée que les seules
communautés de communes dont la population est supérieure
à 3.500 habitants.
En outre, lorsque la population de la communauté de communes est
supérieure à 50.000 habitants, elle ne doit pas inclure de
communes centre de plus de 15.000 habitants. Sur la proposition du
Sénat, la loi vise également la commune chef-lieu de
département.
Outre ces critères de population, les communautés de communes
concernées, doivent exercer au moins
quatre
des cinq groupes de
compétences traduisant un fort niveau d'ntégration.
Un
premier groupe
concerne le
développement
économique
avec l'aménagement, l'entretien et la gestion de
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou
touristique qui sont d'intérêt communautaire ainsi que des actions
de dévelopement économique.
Dans un
deuxième groupe
relatif à
l'aménagement
de l'espace
communautaire, figurent l'élaboration de schémas
directeur et de secteur, l'aménagement rural et les zones
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire.
Un
troisième groupe
de compétences porte sur la
création ou l'aménagement et l'entretien de la voirie
d'intérêt communautaire.
Un
quatrième groupe
concerne le
logement social
d'intérêt communautaire et l'action, par des opération
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées. A la demande du Sénat, ce groupe de
compétences a été substitué à l'eau et
l'assainissement.
Enfin, un
cinquième et dernier groupe
de compétences est
relatif à l'élimination et à la valorisation des
déchets ménagers
.
L'éligibilité à la DGF majorée est constatée
par arrêté préfectoral à la date à laquelle
la communauté de communes remplir l'ensemble des conditions
énoncées ci-dessus.
Un arrêté préfectoral devrait établir, avant le
31 décembre de l'année de publication de la loi, la liste
des communautés de communes existantes qui remplissaient d'ores et
déjà ces conditions.
Les nouvelles communautés de communes auront le choix entre deux
régimes fiscaux : la fiscalité additionnelle avec ou sans
taxe professionnelle de zone (le recours à cette dernière formule
étant néanmoins soumis à une condition de seuil de
population calquée sur celle applicable aux communautés
d'agglomération) ; la
taxe professionnelle unique
.
Les communautés de communes soumises au régime de la taxe
professionnelle unique pourront opter pour une
fiscalité mixte
et
percevoir, en conséquence, le produit d'une fiscalité
additionnelle à la fiscalité sur les ménages.
b) Un premier bilan encourageant
Le
premier bilan de mise en oeuvre de la loi du 12 juillet 1999 est
encourageant.
Au 31 décembre 1999,
51 communautés d'agglomération
ont été constituées. Elles regroupent plus de 6 millions
d'habitants et 763 communes.
Sept grandes métropoles régionales
ont constitué
des communautés d'agglomération avec d'autres communes (Amiens,
Chalons-en-Champagne, Clermont-Ferrand, Dijon, Poitiers, Rennes, Rouen).
Vingt et un chefs lieux de département
ont effectué la
même démarche (Agen, Angoulême, Aurillac, Belfort,
Chambéry, Chartres, Châteauroux, Evreux, La Rochelle, Le Puy,
Périgueux, Rodez, Saint-Brieuc, Grenoble, Montauban, Niort, Pau,
Quimper, Tarbes, Tours et Troyes).
Sept
communautés d'agglomération sont des créations
ex nihilo
. Elles rassemblent
829 921
habitants qui
n'étaient pas regroupés dans des structures à
fiscalité propre. Les autres communautés d'agglomération
résultent de la transformation d'établissements publics de
coopération intercommunale préexistants :
25
sont
issues d'un district,
15
d'une communauté de communes,
4
d'une communauté de villes.
L'analyse des compétences transférées aux
communautés d'agglomération met en évidence qu'outre les
compétences qui leur sont confiées à titre obligatoire,
elles exercent également des compétences significatives dans la
gestion de services, notamment dans le domaine de l'environnement et des
déchets ménagers.
Compétences optionnelles des communautés d'agglomération
|
Compétence transférée |
Nombre de communautés d'agglomération exerçant cette compétence à titre optionnel |
|
Voirie |
39 |
|
Eau |
16 |
|
Assainissement |
35 |
|
Environnement et ordures ménagères |
44 |
|
Equipements culturels et sportifs |
40 |
On
dénombre par ailleurs
130 communautés de communes
à
taxe professionnelle unique réunissant les conditions pour
bénéficier d'une
DGF bonifiée. Deux communautés
urbaines
(Arras et Dunkerque) ont opté pour la taxe professionnelle
unique.
Au total, l'intercommunalité à fiscalité propre a
sensiblement progressé d'une année sur l'autre comme en
témoignent les tableaux ci-dessous.
Les groupements à fiscalité propre au 1 er janvier 1999
|
|
Communautés urbaines |
syndicats d'agglomération nouvelle |
districts, communautés de villes et
communautés de
communes
|
Total |
|
|
population
|
4,5 |
0,7 |
3,4 |
24,4 |
33,137 |
|
nombre de groupements |
12 |
9 |
98 |
1 562 |
1 681 |
|
nombre de communes |
309 |
51 |
980 |
17 787 |
19 127 |
|
taille moyenne des groupements
|
379,1 |
80,7 |
34,6 |
15,7 |
19,7 |
Source : Direction générale des collectivités locales.
Les groupements à fiscalité propre au 1 er janvier 2000
|
|
communautés d'agglomération |
communautés urbaines |
syndicats d'agglomération nouvelle |
districts, communautés de villes et
communautés de
communes
|
Total |
|
|
population
|
6,1 |
4,6 |
0,7 |
5,2 |
20,3 |
37 |
|
nombre de groupements |
51 |
12 |
9 |
236 |
1 541 |
1 849 |
|
nombre de communes |
763 |
309 |
51 |
2 363 |
17 870 |
21 356 |
|
taille moyenne des communes (en milliers d'habitants) |
119,3 |
385,9 |
79,4 |
22,1 |
13,2 |
20 |
Source : Direction générale des
collectivités locales.
Le rôle croisant des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre s'est traduit dans leurs
budgets qui s'élevaient à quelque
55 milliards de francs
en 1997.
Ce réel développement de l'intercommunalité de projet peut
être un facteur important d'évolution de l'organisation
territoriale. D'une part, la question du mode de désignation des
délégués intercommunaux déjà soulevée
lors des travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999, ne manquera
pas d'être de nouveau posée dans les prochaines années, au
fur et à mesure que le poids des structures intercommunales dans le
paysage local s'accroîtra.
D'autre part, se posera la question de leurs relations avec les communes et
avec les collectivités départementales et régionales, le
renforcement de l'intercommunalité devant être un facteur de
plus grande efficacité
de l'action publique.
Il s'agira donc d'avoir une vision claire des missions confiées aux
différents niveaux d'administration locale, afin que
l'intercommunalité soit un
facteur de clarification
et non pas
source d'une nouvelle complexité dans notre organisation territoriale.
C. DES FACTEURS DE COMPLEXITE POUR L'ORGANISATION TERRITORIALE
Plusieurs facteurs de complexité pour l'organisation territoriale méritent d'être relevés. Ils tiennent aux ambiguïtés de la politique des pays, à la prolifération des " zonages " et aux mécanismes complexes des interventions communautaires.
1. Les ambiguïtés de la politique des pays
a) La loi d'orientation du 4 février 1995 : le pays espace de projet
La
reconnaissance des pays dans la loi du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire avait
été fondée sur cinq principes directeurs qui,
conformément au souhait du Sénat, privilégiaient la
souplesse
et faisaient du pays un périmètre pertinent pour
la mise en oeuvre de
projets de développement
sans qu'il puisse
s'agir de créer un nouvel échelon d'administration locale.
Reconnu comme
outil essentiel de la politique d'aménagement et de
développement du territoire,
le pays devait , selon
l'article
23
de la loi, exprimer la communauté d'intérêts
économiques et sociaux et, le cas échéant, les
solidarités réciproques
entre la ville et l'espace rural.
Le pays était fondé sur la
libre adhésion
des
collectivités locales désireuses de travailler ensemble autour
d'objectifs partagés et de définir, en concertation avec les
autres acteurs concernés, un projet commun de développement.
Reposant sur la volonté locale, la création du pays était
simplement constatée par la commission départementale de la
coopération intercommunale , l'autorité administrative se bornant
à
publier
la liste et le périmètre des pays.
Ces derniers devaient exprimer
une cohésion géographique,
culturelle, économique ou sociale fondée sur une
réalité spatiale
. Ils ne devaient donc en aucun cas
constituer une nouvelle structure ajoutant à la complexité de
l'organisation territoriale.
Le législateur de 1995, soucieux d'affirmer pleinement la
libre
initiative locale,
avait écarté du dispositif toute formule
contraignante de coopération intercommunale dans le cadre du pays.
L'élaboration d'un projet de développement devait se fonder sur
un diagnostic du territoire concerné permettant de concevoir des
objectifs de développement et des actions inscrites dans la
durée. Il devait permettre aux collectivités territoriales, en
concertation avec les acteurs socioprofessionnels,
d'agir autrement
que
dans les cadres traditionnels à partir d'un projet global qui transcende
les logiques sectorielles, fédère des financements multiples et
mobilise les différents acteurs pour sa mise en oeuvre.
Mais tel que conçu par le législateur de 1995, le pays
n'avait
pas la personnalité juridique.
Il constituait un espace pertinent
pour concevoir un projet global, lequel devait ensuite être porté
par les collectivités parties prenantes au projet.
Lancée sur ces bases en 1995, l'opération de préfiguration
a mis en évidence l'intérêt et la richesse du partenariat,
expressément prévu par la loi du 4 février 1995, qui a
permis de mobiliser au mieux les compétences au service de projets
communs de développement.
Les élus locaux ont joué un rôle prépondérant
dans l'initiative des projets. Les départements et les régions -
déjà très engagés dans des politiques de
développement local avant même l'émergence des pays - ont
pu jouer un rôle d'impulsion appréciable. La participation active
des acteurs socio-économiques doit également être
relevée.
Au total, conçu de manière souple et en fonction des
réalités locales, le pays devait permettre de
fédérer des objectifs
et de
démultiplier des
financements. Quelque 200 pays seraient en cours d'organisation sur le
territoire national.
b) La loi du 25 juin 1999 : une procédure plus complexe
Il est
malheureusement à craindre que les modifications introduites par la loi
du 25 juin 1999, contre l'avis du Sénat, ne conduisent à une
formalisation excessive de nature à mettre en cause la souplesse voulue
à l'origine par le législateur et de conférer aux pays une
position ambiguë
dans l'organisation territoriale.
C'est ainsi que les pays doivent désormais faire l'objet d'une
reconnaissance administrative.
Un
périmètre
d'étude
doit être
arrêté par le
préfet après avis conforme de la conférence
régionale de l'aménagement et du développement du
territoire et après avis simple de la commission départementale
de la coopération intercommunale et des préfets de
départements et de régions. Un
périmètre
définitif
est ensuite établi après l'adoption de la
charte du pays.
Le pays est obligatoirement doté d'un
conseil de
développement
composé des représentants des milieux
socio-professionnels et associatifs.
Par ailleurs, pour conclure un contrat particulier au contrat de plan, les pays
devront se constituer en
groupement d'intérêt public de
développement local
, sauf s'ils sont déjà
organisés en établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre intégrant l'ensemble
des communes inscrites dans le périmètre.
Le défaut de publication du décret d'application, plus d'un an
après l'entrée en vigueur de la loi, semble malheureusement
confirmer que ces modifications risquent d'être source d'une
plus
grande complexité.
2. La prolifération des " zonages "
a) Le zonage : un outil complexe mais pourtant utile
Une
indéniable source de complexité de l'action publique
De longue date, la mise en oeuvre des politiques publiques s'est
appuyée, dans notre pays, sur la délimitation d'espaces
géographiques particuliers -ou " zones "-, en fonction de
critères propres à chacun des objectifs poursuivis.
Le territoire français a ainsi été successivement
découpé en de multiples zonages qui ont, bien entendu, des
incidences et des significations diverses, mais qui contribuent, globalement,
à
complexifier l'action publique
, en aboutissant à un
" brouillage " des interventions en matière
d'aménagement du territoire. Le groupe de travail de la Commission des
lois sur la décentralisation
117(
*
)
relevait déjà cette complexité, qui intervient, en outre,
dans un contexte d'obsolescence du régime juridique des interventions
économiques des collectivités locales, préjudiciable
à l'efficacité de l'action publique en matière de
développement économique.
Partant de ce constat, et estimant qu'"
à partir de ces
différents zonages, se sont progressivement accumulés des
mécanismes et des procédures dont la cohérence
échappe de plus en plus aussi bien aux élus locaux qu'aux
entreprises
"
118(
*
)
, le Premier
ministre a chargé M. Jean Auroux, en avril 1998, de la rédaction
d'un rapport
119(
*
)
établissant le bilan
de ces zonages et proposant une réforme d'ensemble tendant à leur
harmonisation et à leur simplification.
Ce rapport officiel dresse un constat sévère de la
complexité du découpage en zones du territoire
français : "
Le découpage de notre territoire est
devenu
si extraordinairement complexe
qu'il échappe
désormais à la connaissance, voire à la
compréhension du citoyen " moyen " qui ne se reconnaît
plus dans les institutions qu'il finance et qui devraient être à
son service. (...) Les élus, les décideurs et plus
généralement les acteurs économiques ont le sentiment
fondé de trouver dans le découpage évoqué ci-dessus
plus d'entraves et d'obstacles que d'encouragements et de
facilités
pour entreprendre et créer des emplois. (...) Il
n'est pas normal en effet que l'on compte de 40 à
60 découpages administratifs divers dans chacune de nos
régions : il y a là un gisement manifeste
d'économies, de cohérence et de modernisation de l'Etat,
attendues par la population dans sa vie quotidienne.
"
Le rapport dresse un inventaire " à la Prévert ",
reproduit à la page suivante, des zonages existants, qui montre le
foisonnement des différents découpages territoriaux :
La longueur de cette liste est, à elle seule, particulièrement
éloquente
, même si, comme le reconnaît l'auteur du
rapport lui-même, il n'est pas forcément significatif de mettre
sur le même plan districts scolaires, cantons ou zones d'intervention des
fonds structurels communautaires.
En outre, pour la mise en oeuvre de certaines politiques -on pense notamment
à l'aménagement du territoire-
la légitimité
d'un zonage territorial reste incontestable.
Un outil pourtant parfois utile dans son principe
La définition des zonages a reposé sur
des logiques diverses,
à l'intérêt inégal
, dont on peut dresser la
typologie suivante
120(
*
)
, en fonction des
objectifs poursuivis :
-
les zonages
"
institutionnels
" :
Sont classés dans cette catégorie des découpages
territoriaux aux incidences bien distinctes puisqu'y figure l'organisation
territoriale de notre pays, fixée par la Constitution et par la loi
(collectivités territoriales et leurs structures de coopération),
qui fonde notre organisation politique et dont la légitimité est
sans commune mesure avec celle d'autres zonages ou découpages divers de
l'action administrative (zonages sociaux ou éducatifs, par exemple)
à la légitimité faible et à l'intérêt
réduit. Le rapport Auroux considère d'ailleurs que ce dernier
type de zonage est "
particulièrement
proliférant
", chaque administration, voire chaque service,
développant sa propre cartographie d'intervention.
-
les zonages
"
prescriptifs
" :
Certains zonages résultent d'une réglementation tendant à
organiser ou protéger l'espace : ainsi en est-il des zonages
urbanistiques (schémas directeurs, plan d'occupation des sols...) ou
environnementaux, qui tendent à se multiplier (ZNIEFF
121(
*
)
, ZICO
122(
*
)
, zones
de la loi " Montagne " ou de la loi " Littoral ", sans
parler des quelque 1.000 sites envisagés pour constituer des zones
spéciales de conservation des espèces ou des habitats, en vertu
de la directive européenne du 21 mai 1992 -dite directive
" Natura 2000 "-).
NOMBRE
ET TYPES DE ZONAGES ADMINISTRATIFS DANS LA RÉGION
RHÔNE-ALPES
EN 1998
|
NOMBRE |
ZONAGES |
DATE DE CRÉATION |
|
12 |
Chambres de commerce et d'industrie |
1702 |
|
292 |
Trésoreries |
1804 |
|
12 |
Caisses d'allocations familiales |
1918 |
|
62 |
Régions agricoles |
1946 |
|
172 |
Unités urbaines |
1952 |
|
147 |
Groupements de communes à fiscalité propre |
1959 |
|
24 |
Centres des impôts fonciers |
1960 |
|
87 |
Centres des impôts |
1960 |
|
22 |
Périmètres de transports urbains |
1960 |
|
2 |
Académies et 46 contrats scolaires |
1965 |
|
5 |
Parcs naturels régionaux |
1967 |
|
2 |
Parcs naturels nationaux |
1967 |
|
37 |
Réserves naturelles |
1967 |
|
58 |
Agences locales pour l'emploi |
1970 |
|
544 |
Codes postaux |
1972 |
|
18 |
Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme |
1973 |
|
4 |
Zones défavorisées de montagne |
1975 |
|
11 |
Secteurs sanitaires |
1977 |
|
76 |
Bassins d'emplois |
1979 |
|
40 |
Bassins d'habitat régionaux |
1980 |
|
20 |
PAIO 123( * ) et 35 missions locales |
1982 |
|
3 |
Zones d'aménagement du territoire |
1982 |
|
1931 |
Zones
naturelles d'intérêt écologique,
|
1982 |
|
27 |
Zones d'emplois |
1983 |
|
30 |
Bassins de formation |
1984 |
|
1 |
Périmètre à neige |
1985 |
|
3 |
Zones Objectifs 2 |
1989 |
|
1 |
Zone objectif 5b |
1989 |
|
34 |
Zones d'emploi formation |
1989 |
|
57 |
Commissions locales d'insertion |
1989 |
|
42 |
Zones touristiques |
1990 |
|
207 |
Bassins de vie |
1992 |
|
49 |
Contrats globaux de développement |
1993 |
|
2 |
Territoires ruraux de développement prioritaire |
1994 |
|
4 |
Zones à risques naturels majeurs |
1995 |
|
40 |
Aires urbaines |
1996 |
Source : Rapport Auroux précité
.
-
les zonages " de projet " :
Le rapport Auroux classe, notamment, les pays et les parcs naturels
régionaux dans la catégorie des zonages fondés sur la mise
en oeuvre d'un projet commun à plusieurs acteurs locaux, qui se
rassemblent pour une action déterminée, en dehors de toute
délimitation en fonction de critères préétablis. On
pourrait également classer dans cette catégorie les
" projets d'agglomérations " définis par
l'article 26 de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire.
-
les zonages " d'intervention économique "
:
Ces zonages sont des périmètres d'intervention de certaines
politiques publiques, définis en fonction de critères
statistiques et servant de champ d'application à des mesures
particulières telles que l'octroi de subventions, d'allégements
d'impôts et ou de charges sociales, en fonction de critères
d'éligibilité déterminés.
Ces zonages d'intervention économiques sont le fondement, au niveau
national, de la
politique d'aménagement du territoire
et, au
niveau communautaire, de la
politique structurelle européenne
,
destinée à promouvoir la cohésion territoriale de l'Union
européenne (les " fonds structurels ", qui représentent
plus du tiers du budget de la communauté, soit le deuxième poste
de dépense après la politique agricole commune.).
La logique qui sous-tend ces zonages est celle de la
discrimination
positive
qui vise à donner plus à ceux qui ont moins, de
façon à leur permettre de rattraper leur retard de
développement économique. Cette discrimination constitue une
exception au principe d'égalité, reconnue tant par le Conseil
Constitutionnel que par le Conseil d'Etat. Elle repose en effet sur une
logique de correction, au nom de l'intérêt
général, d'inégalités de fait
. C'est dans le
même esprit que le droit européen autorise les aides publiques
à certains territoires fragiles, (dites aides d'Etat à
finalité régionale), bien que les aides publiques soient dans
leur principe contraires au principe de libre concurrence posé par le
traité instituant la Communauté européenne, dans la mesure
où le marché intérieur n'est pas suffisamment
homogène et où le retard de développement constitue, en
lui-même, un facteur de distorsion de la concurrence, auquel il importe
de remédier.
En dépit de leurs imperfections, voire de leurs effets pervers (effet de
" bord " aux confins des zones éligibles, complexité,
superposition, stigmatisation des territoires concernés...),
les
principes qui fondent les zonages d'intervention économique ne sont
remis en cause
ni au niveau national
, comme l'a montré la
récente discussion de la loi précitée d'aménagement
du territoire, qui a maintenu et complété les zonages
124(
*
)
français définis par l'article 42
de la loi d'aménagement du territoire du 4 février
1995 ;
ni au niveau européen
, ces derniers faisant l'objet
de la négociation actuelle sur les fonds structurels (et notamment la
carte des sites français éligibles à l'objectif 2) et de
celle sur les aides d'Etat à finalité régionale (carte de
la prime à l'aménagement du territoire).
Ils répondent en effet à un impératif
d'efficacité de la politique d'aménagement du territoire, qui
nécessite des périmètres d'intervention ciblés,
concentrés et limités dans leur durée.
Si la prolifération des zonages d'intervention est -c'est certain-
préjudiciable à la clarté de l'action publique, c'est donc
plus dans leurs modalités actuelles que dans leur principe qu'ils semble
devoir être remis en cause.
Il paraît en effet difficile de
penser une politique d'aménagement du territoire qui ne s'appuierait pas
sur une discrimination territoriale.
Pour autant, il serait illusoire de penser pouvoir faire l'économie
d'une réflexion sur l'harmonisation et la simplification des zonages
d'intervention.
b) Une simplification toujours attendue
La
réforme des zonages communautaires : restriction ou
simplification ?
Tant dans la perspective du nouvel élargissement de l'Union
européenne que face à la nécessité d'établir
la programmation financière des actions communautaires sur la
période 2000-2006, la politique agricole commune et la politique
structurelle européenne ont été réformées,
à compter du 1
er
janvier 2000, au terme d'un processus
ouvert en juillet 1997 par la communication "
Agenda 2000
" de
la Commission, et abouti au sommet de Berlin en mars 1999.
Compte tenu de leur importance pour l'Union et pour la France, ces deux
réformes ont, d'ailleurs, fait l'objet d'analyses approfondies de la
part de votre Haute assemblée
125(
*
)
.
A cette occasion, les
zonages communautaires des fonds structurels ont
été révisés
. Mais il semble que le souci de
maîtrise budgétaire de l'enveloppe de ces fonds ait
été un motif de réforme au moins aussi puissant que le
souci de simplification -ou plutôt de concentration- des zonages.
-
La réforme du zonage de la PAT
A partir du 1
er
janvier 2000, parallèlement
à l'instauration d'une nouvelle génération de fonds
structurels, la Commission européenne a imposé dans toute
l'Europe une révision de la carte des " aides à
finalité régionale ", qui permet, en France, à l'Etat
d'attribuer, dans les zones éligibles, la prime à
l'aménagement du territoire (PAT), mais aussi aux collectivités
locales, d'accorder, si elles le souhaitent, des exonérations de taxe
professionnelle pendant cinq ans, des aides à l'immobilier d'entreprise
et des taux majorés d'aide à l'investissement pour les petites et
moyennes entreprises.
Afin d'harmoniser les zonages des aides à finalité
régionale au niveau européen, la Commission européenne a
fixé
un certain nombre de règles communes à respecter
pour l'élaboration de la nouvelle carte
, négociée
entre les Etats-membres et la Commission (Direction générale de
la concurrence).
Tout d'abord, la proportion de la population couverte, qui était de
39,9 %, soit 23,1 millions d'habitants, passerait à 34 %,
soit 20,2 millions d'habitants. Cette diminution de 12 % s'accompagne
d'une clause tendant à éviter la discontinuité du
zonage : toutes les zones isolées de moins de
100.000 habitants seront comptabilisées pour
100.000 habitants. La Commission européenne impose, en outre, que
toutes les zones retenues dans la carte le soient sur la base de
critères quantitatifs justifiables. Pour cela, au maximum
cinq critères statistiques doivent être utilisés,
à l'exclusion de tout critère qualitatif.
Pour élaborer sa proposition
126(
*
)
de
zonage, le Gouvernement français s'est appuyé sur les
critères suivants :
- parmi les zones d'emplois dont la richesse est inférieure
à la moyenne
127(
*
)
, ont
été retenues celles qui ont un
taux de chômage
supérieur à la moyenne (11,3 % en 1998) ou qui connaissent
une
décroissance de leur population
(diminution de plus de
1,2 % entre 1990 et 1995). 143 zones d'emploi correspondant à
15,3 millions d'habitants ont ainsi été
sélectionnés ;
- à ces zones ont été ajoutés des
sites en
restructuration
économique
: zones où de fortes
suppressions d'emplois ont été décidées depuis 1996
et où l'importance de certains secteurs industriels sensibles, comme la
construction automobile, les chantiers navals, le textile, les industries de
défense, est particulièrement marquée. Ces sites ont
été sélectionnés lorsqu'ils présentent un
taux de chômage de plus de 10 %. 19 zones, comptant
3,7 millions d'habitants, ont ainsi été
ajoutées ;
- pour " utiliser " la marge de manoeuvre restante, par rapport
au quota de population éligible fixé par Bruxelles, le
Gouvernement a retenu 2 critères complémentaires conduisant
à intégrer les zones
perdant leur
éligibilité
à l'objectif 1 des fonds structurels
(Corse et Hainaut, ainsi que des sites à taux de chômage
particulièrement élevé (13,9 %) et concernés par
des fermetures dans le secteur des
mines et de l'énergie
.
Il n'est pas évident que le nouveau zonage retenu permettra une
réelle clarification de l'action publique, même si les objectifs
poursuivis par la réforme engagée par la Commission
étaient de définir plus objectivement les secteurs
concernés et de renforcer la concentration géographique et donc
la " lisibilité " de la carte des aides.
La perte
d'éligibilité pourrait, en revanche, s'avérer être
un handicap pour certains territoires fragiles
. Dans cette perspective, et
au-delà du seul zonage, c'est une réforme d'ensemble de la PAT,
tendant à la rendre plus accessible aux territoires fragiles (et aux
petits projets) que votre Haute Assemblée réclame, votre
Commission des Affaires économiques jugeant de longue date
128(
*
)
les seuils d'éligibilité à
cette prime trop élevés.
-
La réforme de la carte des zones éligibles aux fonds
structurels
Si l'objectif 3 de la politique structurelle européenne relatif au
" développement des ressources humaines
" a vocation
à concerner l'ensemble du territoire de l'Union européenne, les
deux autres s'adressent au contraire à certaines zones prioritaires qui
doivent, afin de pouvoir prétendre à un financement communautaire
de leurs projets de développement, avoir été
préalablement sélectionnées. Tel est le cas de
l'objectif 1 des fonds structurels européens
(" régions en retard de développement
", qui ne
concerne plus, en France, pour la période 2000-2006, que les
départements d'outre-mer) et de l'objectif 2
(" régions en reconversion économique et
sociale
") pour lequel une nouvelle carte des zones
éligibles vient d'être établie, pour la période
2000-2006
129(
*
)
, conformément au nouveau
règlement européen relatif à la politique structurelle
communautaire
130(
*
)
.
Cette réforme a conduit à une
réduction de la
proportion de la population concernée
: la population
éligible à l'objectif 2 au niveau communautaire ne doit pas
dépasser 18 % du total européen, et la population
française éligible est fixée à
18.568.000 habitants, ce qui représente, certes, une proportion
(33 %) supérieure à la moyenne communautaire, mais
également une diminution d'un quart par rapport à la
précédente période de programmation
131(
*
)
.
La France bénéficiera, au titre de l'objectif 2, de plus de
36 milliards de francs de financements européens entre 2000 et
2006
. Le règlement communautaire a fixé les conditions que
doit remplir la carte française des zones éligibles et des
circulaires ministérielles
132(
*
)
ont
précisé ces critères, qu'il serait fastidieux de
développer ici trop longuement.
Notons toutefois que 50 % de la population doit être située
dans des départements considérés comme
" admissibles " au regard de critères identifiant une
fragilité industrielle ou rurale par rapport à des moyennes
communautaires définies par la Commission : les départements
à caractère
industriel
doivent, à la fois, avoir
connu entre 1995 et 1997 un taux de chômage supérieur à
10,7 %, un taux d'emploi industriel au moins égal à la
moyenne de l'Union pendant un an au moins depuis 1985 et un déclin de
cet emploi depuis l'année retenue.
De leur côté, les départements de type
rural
doivent
réunir au moins deux conditions sur les quatre suivantes :
avoir eu, en 1996, une densité de population inférieure à
100 habitants au kilomètre carré ; avoir eu un emploi
agricole au moins égal au double de la moyenne de l'Union pendant un an
depuis 1985 ; avoir connu un déclin démographique entre 1985
et 1996 ; avoir subi un taux de chômage supérieur à
10,7 % entre 1995 et 1997.
A l'intérieur ou en dehors des départements théoriquement
admissibles (pour 50 % au plus de la population nationale éligible
dans ce dernier cas), peuvent être proposées des
zones urbaines
en difficulté
répondant à au moins un des cinq
critères suivants : un taux de chômage de longue durée
supérieur à 5,2 % ; un niveau élevé de
pauvreté ; une situation environnementale
dégradée ; un taux de criminalité
élevé ; un faible niveau d'éducation. Ces
critères peuvent être appliqués à l'échelle
d'un quartier.
Au rang des
autres zones
pouvant être proposées, figurent
les zones contiguës à un département éligible si
elles réunissent elles-mêmes les conditions
d'éligibilité similaires à celles de la zone de
" rattachement ". Les zones confrontées ou menacées par
un niveau élevé de chômage résultant d'une
restructuration en cours ou prévue d'une ou plusieurs activités
déterminantes dans les secteurs agricoles, industriels ou les services
font également partie des territoires potentiellement éligibles.
La proposition de zonage française, élaborée après
une large consultation nationale et locale, a été formellement
approuvée par la Commission en février 2000.
Là encore, malgré la diminution de 7 à 3 du nombre
d'objectifs de la politique structurelle, et donc du
nombre de zonages
attachés à ces objectifs
, la réforme de cette
cartographie européenne ne constitue qu'un progrès relatif en
matière de lisibilité de l'action publique.
Vers une refonte des zonages nationaux ?
Malgré des critiques parfois vives -et, dans certains cas, injustement
sélectives, concernant notamment les zones franches urbaines
133(
*
)
- et les nombreuses propositions formulées par
le rapport précité de M. Jean Auroux, comme cela vient
d'être dit, la récente discussion de la loi
134(
*
)
d'aménagement du territoire n'a pas remis en
cause, au moins dans leur existence législative, les zonages
établis successivement par la loi d'orientation d'aménagement du
territoire précitée du 4 février 1995 et par le
pacte de relance pour la ville de 1996
135(
*
)
.
Entre refus idéologique et pragmatisme, le Gouvernement semble balancer.
Il affirme d'un côté sa volonté de réformer ces
zonages, mais s'empresse de ne pas le faire. La réforme des cartes
d'éligibilité européennes a, un temps, servi à
justifier sa position ambivalente. Mais sa contradiction de fond apparaît
toutefois de façon patente en certaines circonstances.
Ainsi, lors de la discussion du projet de loi d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire, le
Gouvernement s'était-il opposé à l'adoption d'un
amendement de la commission spéciale du Sénat prorogeant jusqu'en
2006 certaines exonérations fiscales et sociales pour les entreprises
créées dans les zones de revitalisation rurales, jugeant
nécessaire un préalable "
bilan de l'application du
dispositif de chaque type de zone, pour réfléchir aux
aménagements nécessaires, plutôt que de proroger dans la
précipitation
un dispositif qui doit être repensé dans
sa globalité
"
136(
*
)
Le Gouvernement proposait pourtant, quelques mois plus tard, sans que le
préalable " bilan d'ensemble ", -s'il existe !- n'ait
été porté à la connaissance du Parlement, dans le
projet de loi de finances, de proroger ces mêmes exonérations
-jusqu'en 2004 toutefois-.
Ce ralliement -ou revirement ?- aussi tardif
qu'implicite, ne peut que recueillir l'assentiment de votre mission
d'information.
Sur proposition du Gouvernement, le législateur a même
créé, dans la loi du 25 juin 1999, une nouvelle
catégorie de zones, les " régions
ultrapériphériques françaises ".
Reste donc inscrite dans la loi l'existence des zones d'aménagement
du territoire, des zones de revitalisation rurale, des territoires ruraux de
développement prioritaire, des zones urbaines sensibles, des zones de
redynamisation urbaine, des zones franches urbaines et des régions
ultrapériphériques françaises.
Mais, au-delà de l'existence même des zonages, c'est surtout la
complexité des procédures
qui leur sont liées qui
contribuent à la lourdeur de l'action publique. Cette critique est
traditionnellement formulée, en particulier, à l'encontre de la
politique structurelle européenne.
3. Les mécanismes complexes des interventions communautaires
a) Un poids significatif dans la vie locale
L'apport
financier de l'Europe à la politique française
d'aménagement du territoire est très important. Ainsi,
d'après le fascicule budgétaire récapitulatif (le
" jaune ") sur l'aménagement du territoire, si les
crédits du ministère en charge de cette action
s'élèveront, en 2000, à 1,9 milliard de francs en
dépenses ordinaires et crédits de paiement
137(
*
)
,
cette somme est sept fois inférieure
à celle
(13,8 milliards de francs)
que l'Union
européenne allouera la même année à notre pays au
titre de la politique structurelle
(objectifs 1, 2 et 3 :
12,4 milliards de francs ; soutien transitoire des zones sortant de
l'éligibilité : 1,2 milliard de francs ;
instrument financier pour la pêche : 0,2 milliard de francs).
L'Europe est donc devenue un acteur d'aménagement du territoire plus
important que le ministère français en charge de cette politique,
ce qui revient à dire que l'Etat a laissé à l'Union
européenne le soin d'assurer financièrement sa mission de
cohésion territoriale.
Il est d'ailleurs couramment estimé que les
fonds européens
financent environ
un tiers des contrats de plan Etat-régions
,
l'Etat et les collectivités locales participant également, pour
chacun d'entre eux, à hauteur d'un tiers à leur financement.
D'ailleurs,
le principe " d'additionnalité "
138(
*
)
,
qui régit la mise en oeuvre des fonds
structurels, interdit que les crédits communautaires ne se substituent
purement et simplement aux dépenses de même nature de l'Etat
membre : tout financement européen doit ainsi trouver un
complément au moins égal au montant au sein de l'Etat-membre,
souvent appelé " contrepartie nationale ".
Cette règle a pour effet d'associer très étroitement les
deniers -et donc les instances- communautaires aux différents projets de
développement économique des territoires.
La prégnance de l'Europe dans la vie locale est ainsi assurée,
au-delà même de son impact, déjà important, en
termes réglementaires ou normatifs, par sa participation
financière aux projets locaux. Aussi est-il particulièrement
important, pour les nombreux territoires concernés, que les
mécanismes d'intervention communautaires soient simples et lisibles. Tel
n'a pas été, jusqu'à présent, le cas, même
si, pour la situation française, les torts apparaissent comme
étant relativement partagés entre la Commission européenne
et les cofinanceurs nationaux.
b) Une mise en oeuvre complexe
Une
piètre consommation des enveloppes communautaires
Alors qu'elle représente pour notre pays un enjeu financier
conséquent, la politique structurelle européenne y est mal
utilisée : après avoir obtenu, au terme de
négociations ardues, la mise à disposition d'une certaine masse
de financements, la France peine paradoxalement à les consommer en temps
et en heure !
Insuffisante réflexion stratégique préalable, lacune de la
programmation locale, pénurie de projets dans les zones
éligibles, procédures d'instruction, de programmation et de
contrôle déficientes, circuits financiers complexes, absence de
contreparties nationales : les
motifs invoqués ne manquent
pas
et expliquent sans doute collectivement que le délai moyen de
mandatement des fonds se soit élevé, pour la période de
programmation passée, à 18 mois en moyenne
139(
*
)
et que la France ait figuré au rang des
Etats-membres ayant le moins complètement consommé leur enveloppe
structurelle. Cette sous-exécution varie suivant les objectifs, mais
elle est bien réelle. Elle a d'ailleurs conduit la Commission à
proposer, lors de la récente réforme des fonds structurels, un
"
dégagement d'office
" des sommes non engagées
pour pénaliser les Etats-membres n'ayant pas consommé leur
enveloppe, et, au contraire, l'allocation d'une "
réserve de
performance
" à mi-parcours, volant financier non
attribué à l'origine mais destiné à encourager les
"
bons élèves
".
Dans son rapport officiel sur l'efficacité de la politique structurelle
européenne
140(
*
)
, M. Pierre Trousset a
dressé le constat suivant des insuffisances de la mise en oeuvre, en
France, de la politique structurelle européenne pour la période
1994-1999 :
-
le diagnostic initial,
par le territoire concerné, de sa
situation économique et sociale est parfois insuffisant ;
les
documents stratégiques de programmation
141(
*
)
des projets (documents uniques de programmation,
DOCUP) sont lacunaires car souvent élaborés à la
hâte, dans le cadre d'un partenariat trop réduit ;
-
les relations
entre l'échelon régional et
départemental ne sont clairement définies ni au sein de
l'organisation de l'Etat ni en ce qui concerne les collectivités
locales ;
- le principe européen de
" partenariat "
dans la
programmation et le suivi des interventions communautaires a alourdi et
formalisé les procédures, même s'il a été
inégalement appliqué ;
- la
Commission européenne
a elle-même fait preuve
d'un certain manque de zèle. Le rapport estime qu' "
Il n'est
pas rare qu'un
délai de 12 à 18 mois
s`écoule entre
la décision du comité de suivi et sa validation par la
Commission, même s'il s'agit d'une simple modification de
mesure " ;
- les
contreparties nationales
en provenance de l'Etat, des
collectivités ou de financeurs privés ont parfois
été difficiles à mobiliser, soit qu'elles n'aient pas
été prévues dans les budgets, soit qu'elles aient
été inexistantes dans les zones les plus fragiles, ou que la
lourdeur des procédures ait joué comme un facteur dissuasif pour
la présentation de projets ;
En outre, ce rapport indique que
les circuits financiers
sont
particulièrement lourds :
-
du coté communautaire
:
la procédure
de " division par tranches " des engagements financiers et la
subordination de l'ouverture de nouveaux crédits à la
certification, par l'Etat membre, d'un certain pourcentage de dépenses
engagées sur la tranche précédente génère
des
retards de paiement
;
- du côté national :
les crédits des fonds
structurels sont d'abord budgétairement rattachés, par le
truchement de fonds de concours, aux crédits des différents
ministères concernés (agriculture, intérieur, emploi,
solidarité, outre-mer...). Les
délais moyens de rattachement
varieraient de 36 à 42 jours
suivant l'instrument financier
concerné. Dès lors, ces crédits sont
" banalisés " et suivent les règles communes à
l'ensemble de la procédure budgétaire nationale. En particulier,
les
crédits non consommés
au terme de
l'année
142(
*
)
doivent être
reversés par les ordonnateurs secondaires pour n'être
rétablis que dans le cadre de l'exercice suivant (3 à 4 mois plus
tard).
En outre, la délégation des crédits des administrations
centrales aux ordonnateurs secondaires que sont les Préfets
apparaît comme particulièrement
lente
, elle engendrerait un
retard supplémentaire de
1 à 3 mois
.
Le rapport estime que le délai de la phase d'engagement est de
4
à 6 mois
et celle de la phase de mandatement de
2 à 4
mois
-même si le délai de paiement, une fois le titre de
dépenses transmis par l'ordonnateur, n'est quant à lui que de 11
jours en moyenne-
.
La lourdeur d'un tel système est patente.
Concluant ces développements, le rapport Trousset indique que
" la longueur des délais (...) résulte du système
budgétaire français et des
choix politiques qui ont
été faits par les autorités françaises
, sans
oublier les retards considérables résultant d'une mauvaise
pratique de la programmation (...) Il est certain que les décalages
considérables existant entre les sommes déléguées
par la Commission et les montants délégués aux
ordonnateurs secondaires (...) mettent en évidence
un impact
important de trésorerie au profit de l'Etat qui explique peut-être
en partie le schéma de rattachement financier retenu ".
Le rapport estime ainsi qu'en février 1998, 5 milliards de francs du
FEDER
143(
*
)
étaient
" transitoirement " disponibles dans les caisses de l'Etat !
Un représentant de la Direction Générale XVI de la
Commission européenne, auditionné par votre mission
d'information
144(
*
)
faisait quant à lui
état, pour la période 1994-1998, d'un retard dans l'engagement
des crédits du FEDER alloués à la France de l'ordre de
10,9 % de l'enveloppe totale de la période concernée.
Une réponse de la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement à une question écrite
145(
*
)
fait quant à elle apparaître, au
1
er
juin 1999, un taux de réalisation effectif des projets
programmés de seulement 40 %.
Ces indicateurs divers pointent tous
l'inefficacité du système
français de consommation des crédits communautaires
.
La récente réforme a toutefois été l'occasion d'un
effort de rationalisation de ces circuits, même s'il aurait pu être
plus poussé de la part de l'Etat français.
Une complexité bruxelloise en voie de résorption ?
Le règlement précité sur les fonds structurels du
21 juin 1999 a visé à simplifier les procédures
d'octroi des crédits communautaires, au travers :
- d'une simplification des règles d'engagement communautaire des
crédits ;
- d'un rôle accru du comité de suivi, qui se voit investi du
pouvoir d'adopter ou de modifier " le complément de
programmation " des actions financées ;
- d'un dégagement automatique des crédits d'une tranche qui
ne seront pas consommés dans les deux ans de leur octroi ;
- de la possibilité ouverte par le règlement de confier la
mise en oeuvre et la gestion d'une partie des interventions à un
organisme intermédiaire ou à une collectivité, dans le
cadre d'une convention avec l'autorité de gestion.
Cet effort communautaire de simplification et de décentralisation de la
politique structurelle n'a sans doute pas été assez
accompagné au niveau français, l'Etat ne souhaitant pas se
départir de son rôle d'interlocuteur privilégié des
instances européennes et de " distributeur " de la manne
communautaire, il est vrai largement plus abondante que ses propres
crédits d'aménagement du territoire.
Une insuffisante décentralisation française des
procédures de gestion
Alors que la lourdeur des circuits français est identifiée comme
l'un des principaux obstacles à la mise en oeuvre de la politique
structurelle dans notre pays, et que le règlement communautaire ouvrait
la voie à un raccourcissement des procédures par une
décentralisation accrue,
l'Etat ne s'est finalement engagé que
très prudemment dans la délégation aux
collectivités de la gestion de cette politique
.
Trois principaux changements
146(
*
)
ont ainsi
été apportés par rapport à la
précédente période de programmation :
- les comités de suivi et de programmation seront, de droit,
co-présidés par les Préfets de régions et les
présidents de Conseils régionaux
, même si le
Préfet de région reste l'autorité responsable de la
gestion des crédits des fonds structurels ;
- le recours à la
procédure de la " subvention
globale "
, qui permet aux Conseils régionaux, aux autres
collectivités ou établissements publics, en fonction de leurs
domaines de compétences, de se voir confier par l'Etat la
responsabilité de la mise en oeuvre des programmes est possible, mais
sera d'emblée limité, en vertu d'une circulaire
ministérielle, à
25 % du programme
concerné
;
- un dispositif de
suivi informatisé
de la
réalisation des programmations devrait renforcer la transparence de leur
gestion. Il devrait être accessible aux partenaires de l'Etat et
permettre de suivre l'état d'avancement des dossiers de demande d'aide.
L'administration
147(
*
)
estime en outre que les
nouvelles dispositions relatives à la gestion financière des
fonds structurels par l'Etat, qui ont été arrêtées
par le Gouvernement en septembre 1999, permettront que les délais
d'instruction des dossiers et les délais de versement des crédits
communautaires aux bénéficiaires finals ne dépassent pas
trois mois.
Il s'agit plus d'une évolution -qu'il faudra juger à
l'expérience- que d'une véritable révolution,
l'Etat
restant le principal interlocuteur
de la Commission et des
collectivités locales pour la mise en oeuvre de la politique
structurelle.
Cette situation,
pénalisante pour les collectivités
territoriales
françaises, est très différente de celle
qui prévaut dans d'autres Etats-membres, comme l'a montré
l'audition, par votre mission d'information, d'un représentant de la
Commission européenne. Ainsi un rapport de la Commission sur la mise en
oeuvre du principe de "
partenariat
" -c'est-à-dire sur
l'association de partenaires autres que les Etats à la gestion des fonds
structuels- met en évidence le gradient européen suivant
d'association des collectivités locales à la politique
régionale communautaire :
- dans certains Etats, le poids des autorités régionales
dans la mise en oeuvre de la politique structurelle est
fort.
Il s'agit
des Etats fédéraux ou " régionaux " :
Allemagne, Italie, Espagne notamment ;
- dans d'autres, il est
modéré
(Autriche, Belgique,
Danemark, France, Pays-Bas) ;
" en amélioration "
(Grèce, Portugal, Royaume-Uni, Suède) ou au contraire
inexistant
(Luxembourg et Irlande).
D'après l'analyse de la Commission, en France, la tendance est à
la
diminution de la pondération de l'échelon local
. En
outre, les autorités déconcentrées
bénéficieraient, à l'inverse des collectivités
décentralisées, d'un regain d'influence. On assisterait donc
à une
recentralisation déconcentrée
de la mise en
oeuvre de cette politique communautaire.
Votre Haute assemblée avait, d'ailleurs, pressenti la réticence
de l'Etat à favoriser tout dialogue direct entre les
collectivités territoriales et Bruxelles, puisqu'à l'occasion de
l'adoption de sa résolution sur la réforme de la politique
structurelle, le Sénat mettait l'exécutif en garde contre toute
tentative de "
renationalisation
" de la politique
structurelle et l'engageait vivement à une décentralisation
accrue de cette action. A cet égard, le Sénat estimait que
l'expérience méthodologique, dans les années 1980, de la
mise en oeuvre décentralisée des programmes destinés aux
régions méditerranéennes aurait pu être poursuivie
et approfondie. La suite des événements a montré que les
craintes du Sénat n'étaient pas sans fondement.
D. LES SPÉCIFICITÉS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
La
décentralisation dans les départements d'outre-mer soulève
des questions spécifiques, distinctes de la problématique
métropolitaine.
Ces quatre départements
148(
*
)
,
Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, s'inscrivent aujourd'hui dans
le même cadre institutionnel, défini par l'article 73 de la
Constitution
lequel prévoit que : "
Le
régime législatif et l'organisation administrative des
départements d'outre mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation
nécessitées par leur situation particulière
".
Ils sont intégrés à l'Union européenne en tant que
" régions ultrapériphériques
149(
*
)
".
Le principe de l'assimilation législative interdisant de conférer
aux départements d'outre-mer une "
organisation
particulière
" au sens de l'article 74 de la Constitution
qui concerne les territoires d'outre mer, des
régions
monodépartementales
ont été instituées (loi du
31 décembre 1982) et les aménagements à la
répartition des compétences entre les différentes
collectivités prévalant en métropole ont été
limités.
La coexistence d'un département et d'une région sur un
même territoire a aujourd'hui montré ses limites.
Le rapport
150(
*
)
établi à la
demande du Premier ministre par MM. Claude Lise, sénateur de
la Martinique, et Michel Tamaya, député de la
Réunion, fait état d'un "
enchevêtrement
dommageable des compétences "
et de situations
d'
interventions concurrentes des deux collectivités
dans les
mêmes domaines.
En effet, la création des régions d'outre-mer en 1982, sur la
base du modèle métropolitain, a engendré un transfert
important de compétences du départements vers la
région
151(
*
)
. Or, compte tenu de leur
engagement antérieur, les départements ont parfois
été tentés ou contraints de maintenir leur action dans un
domaine normalement transféré.
C'est pourquoi le " rapport Lise-Tamaya " souligne que le
redécoupage des blocs de compétence, en particulier entre le
département et la région, est une étape nécessaire,
mais devra être suivi d'un contrôle plus strict du respect, par les
collectivités, de leur champ de compétences.
Le " rapport Lise-Tamaya " dénonce
l'inachèvement de
la décentralisation
dans les départements d'outre-mer
.
Alors que les collectivités locales d'outre-mer, fortement
sollicitées et appelées à faire face à une
situation économique et sociale profondément
dégradée, ont été contraintes de développer
leurs interventions, les textes n'ont que très faiblement adapté
l'organisation et les compétences de ces collectivités.
Le régime juridique applicable aux départements d'outre-mer est
actuellement en cours de débat au Parlement : le
projet de loi
d'orientation pour l'outre-mer
répond en partie aux
préoccupations des élus d'outre-mer, notamment en tendant
à favoriser la coopération régionale
décentralisée et en proposant un approfondissement de la
décentralisation.
• Il existe
une volonté unanime de développer la
coopération régionale décentralisée
, par
exemple en matière de contrôle de l'immigration, de justice,
d'enseignement ou de culture. Les conseils généraux ou
régionaux aspirent à négocier directement, avec les
États voisins, sans devoir passer nécessairement par la
métropole et par l'intermédiaire des diplomates du Quai d'Orsay.
Or, la coopération décentralisée est actuellement
limitée par la compétence exclusive de l'État en
matière de relations avec les États étrangers, qui
interdit en principe aux collectivités territoriales de signer un accord
avec un État voisin, même dans des domaines relevant de leurs
compétences.
Selon le projet de loi d'orientation,
l'action internationale
de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
dans leur
environnement régional
se traduira en particulier par la
possibilité, pour un conseil général ou régional,
de demander aux autorités de la République d'autoriser son
président à négocier des accords internationaux avec les
États (ou organismes régionaux) voisins.
•
L'approfondissement de la décentralisation
passe
par la
généralisation de la consultation
des conseils
généraux et régionaux d'outre-mer sur les projets de
textes les concernant (lois, ordonnances, décrets comportant des
dispositions d'adaptation de leur régime législatif et de leur
organisation administrative, actes communautaires), le
transfert de
compétences
actuellement exercées par l'État et
l'aménagement des
finances locales
.
De plus, un des enjeux majeurs du développement économique des
départements d'outre mer réside dans la
décentralisation de la gestion des crédits
européens
152(
*
)
.
Comme l'indique votre commission des Lois
153(
*
)
, ces aménagements sont bienvenus mais
limités dans la mesure où
ils n'ouvrent pas réellement
la voie à une évolution différenciée
. Celle-ci,
à la suite d'une mission d'information
154(
*
)
dans les départements d'outre mer, a
souligné les limites de la départementalisation conçue
comme un modèle unique. La prise en compte de l'identité de
chaque population et l'adaptation des lois et réglementations
métropolitaines aux réalités locales sont plus que jamais
nécessaires, mais doivent être conciliées avec le besoin
d'une certaine stabilité institutionnelle favorable au
développement économique. Afin de respecter l'identité
culturelle de chaque département, il convient de faire du
"
cousu main
", selon l'expression de notre collègue M.
José Balarello, rapporteur du projet de loi d'orientation pour
l'outre-mer.
Or, force est de constater que les perspectives d'évolution
institutionnelle prévues par le projet de loi d'orientation sont
très controversées :
• la
bi-départementalisation de la Réunion
,
qui pourrait se justifier au regard des impératifs démographiques
et d'aménagement du territoire, ne suscite pas l'adhésion de
l'ensemble des élus réunionnais et de la population ;
• la
création d'un Congrès dans les
régions d'outre-mer monodépartementales
fait partie des
propositions du " rapport Lise-Tamaya ". Composé des
conseillers généraux et des conseillers régionaux, le
Congrès aurait vocation à délibérer de toute
proposition relative à l'évolution institutionnelle et à
la répartition des compétences. Le Gouvernement pourrait ensuite
déposer un projet de loi prévoyant la consultation des
populations intéressées sur les propositions d'évolution
institutionnelle formulées par le Congrès.
Constatant que le projet de Congrès a suscité l'avis
défavorable de six des huit assemblées locales concernées
et que la procédure envisagée est particulièrement lourde,
le Sénat, suivant sa commission des Lois, n'a pas approuvé la
création d'un congrès en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Il
s'est en outre opposé au projet de bidépartementalisation de la
Réunion.
CHAPITRE III
LE CADRE DE L'EXERCICE DES COMPÉTENCES
LOCALES :
DES BLOCS DE COMPÉTENCES À LA
COGESTION
La
clarification des compétences apparaît depuis plusieurs
années comme l'une des priorités pour conférer à la
décentralisation sa pleine efficacité.
La mission sénatoriale sur l'aménagement du territoire en avait
fait l'un des grands axes de ses propositions
155(
*
)
. Plus récemment, le groupe de travail de
votre commission des Lois avait souligné que la
confusion
actuelle des compétences constituait l'un des obstacles à
l'approfondissement de la décentralisation
156(
*
)
.
L'article 65 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire avait
expressément prévu une telle clarification dans le cadre d'une
loi portant révision des lois des 7 janvier et 22 juillet 1983.
Cette loi devait répartir "
les compétences de
manière à ce que chaque catégorie de collectivités
territoriales dispose de
compétences homogènes
"
et prévoir que "
tout transfert de compétence est
accompagné d'un transfert des personnels et des ressources
correspondant
". La même loi devait également
définir
" les conditions dans lesquelles une collectivité
pourra assumer le rôle de
chef de file
pour l'exercice d'une
compétence ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs
collectivités territoriales
". Elle devait, enfin,
déterminer les conditions dans lesquelles une
"
collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir
confier une compétence susceptible d'être exercée pour le
compte d'une autre collectivité territoriale.
"
Ces orientations n'ont à ce jour pas eu de traduction
législative. Pourtant la situation actuelle contribue à l'image
brouillée de la décentralisation. Dans un contexte national
où le
poids excessif des prélèvements obligatoires
pèse sur les contribuables, ces derniers sont en droit d'être de
plus en plus exigeants sur l'utilisation des deniers publics. Ils sont
également en droit d'identifier clairement "
qui fait
quoi
" dans le paysage institutionnel local.
En transférant des blocs de compétences aux collectivités
locales, les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 avaient poursuivi un double
objectif
d'efficacité
et de
simplification.
Or, cette
logique initiale a été progressivement
dévoyée
, très largement du fait de l'Etat qui a
utilisé des
politiques partenariales pour faire financer ses propres
compétences par les collectivités locales.
Le
contrat
a constitué un
instrument privilégié
pour développer des actions communes entre l'Etat et les
collectivités locales. La technique contractuelle est loin d'être
inconciliable avec les principes de la décentralisation. Elle peut
même être très efficace pour favoriser les synergies entre
les actions menées dans un même domaine par des
collectivités libres et responsables. Malheureusement, c'est une
logique contractuelle inégalitaire
qui a prévalu, l'Etat
utilisant le contrat pour associer les collectivités locales à
des politiques relevant de sa propre responsabilité sans pour autant
partager la compétence.
I. UNE LOGIQUE INITIALE DÉVOYÉE
A. LA LOGIQUE INITIALE
1. Une nouvelle conception du rôle de l'Etat dans un cadre défini par la loi
a) Une nouvelle conception du rôle de l'Etat
La
décentralisation est d'abord une
réflexion sur l'Etat
lui-même.
La question du transfert des compétences en est une
illustration particulièrement frappante.
Cette question soulève, en effet, d'abord le problème de la
place des collectivités locales dans l'Etat.
Votre rapporteur a déjà eu l'occasion d'observer que
l'idée même de décentralisation n'a émergé
que
difficilement
dans notre pays. L'existence des collectivités
territoriales n'a été consacré que tardivement par les
textes constitutionnels, puisque la notion de " collectivités
territoriales " n'apparaît pour la première fois que dans le
titre VIII du projet de Constitution du 19 avril 1946. Si elle consacre elle
aussi l'existence des collectivités territoriales, la Constitution du 4
octobre 1958 le fait de manière assez elliptique, ce qui peut expliquer
que la portée exacte des dispositions du titre XII, relatif aux
collectivités territoriales, et plus particulièrement l'article
72 qui affirme le principe de libre administration par des conseils élus
et dans les conditions prévues par la loi, fassent l'objet
d'interprétations divergentes
.
Ce contexte constitutionnel peut expliquer que la place des
collectivités territoriales par rapport à l'Etat n'ait pas
reçu de
réponses claires
avant les lois de
décentralisation et qu'elle demeure, depuis cette date,
insuffisamment précisée.
Or l'idée même d'une répartition des compétences
suppose, non pas une opposition, mais un partage ou plus
précisément une
division des rôles
entre l'Etat et
les collectivités locales.
Dans cette répartition des rôles, l'Etat a une position
privilégié puisqu'il dispose de la "
compétence de
la compétence
". A travers le pouvoir législatif et le
pouvoir exécutif, il exerce
à titre exclusif
la
responsabilité de répartir les compétences. Il
définit également les moyens d'exercice de ces compétences.
Certes, les collectivités locales ne sont pas totalement exclues de
l'élaboration des principales règles qui les concernent mais leur
participation n'est que
partielle
. Constitutionnellement, elles y
participent à travers le
Sénat qui les représente
.
Cependant le Gouvernement peut
passer outre à l'opposition du
Sénat
en demandant à l'Assemblée nationale de se
prononcer en lecture définitive, quand bien même les
matières concernées intéressent
directement
les
compétences et les moyens de fonctionnement des collectivités
locales. Les prérogatives importantes reconnues au pouvoir
exécutif dans la procédure législative lui permet en outre
de faire prévaloir la position de l'Etat sur les demandes des
collectivités locales. Il peut enfin imposer à ces
dernières de nouvelles contraintes en usant de son pouvoir
réglementaire autonome.
Cette situation met en évidence la
position ambiguë de
l'Etat
, tout à la fois chargé de définir les
règles de la répartition des compétences et acteur public
directement intéressé à cette répartition.
Comme l'avait parfaitement souligné notre collègue Paul Girod
dans le rapport qu'il établit au nom de votre commission des Lois sur la
loi du 7 janvier 1983, le mot
Etat
peut en effet recevoir deux
acceptions différentes, qu'il importe de distinguer au regard de la
répartition des compétences.
Dans une première acception, l'Etat est synonyme des pouvoirs publics
donc de l'ensemble des organes par lesquels s'exprime constitutionnellement
la volonté nationale
. A ce titre, il est fondé
à définir les règles qui régissent les
collectivités territoriales. Cette première acception est
exprimée dans le deuxième alinéa de l'article 72 de la
Constitution qui dispose que les collectivités territoriales
"
s'administrent librement par des conseils élus
et dans les
conditions prévues par la loi
".
Mais dans une seconde acception qui paraît prévaloir
- même si elle n'est pas exclusive de la première - dans
l'idée d'une
répartition des compétences entre l'Etat
et les collectivités locales
, le mot
Etat
désigne
l'ensemble des administrations
qui dépendent de l'autorité
centrale, à quelque niveau que s'exerce la compétence qui leur a
été consentie. Il vise donc un ensemble d'administrations qui le
cas échéant peuvent se trouver
en concurrence
avec les
administrations locales pour
l'attribution d'une compétence.
Notre collègue Paul Girod avait résumé cette double
acception, en distinguant l'Etat-République et
l'Etat-collectivité.
Tout l'enjeu est de veiller à ce que le partage des compétences
selon les règles de l'Etat, producteur de normes, ne soit pas
faussé par l'Etat acteur public local.
Or la période antérieure à la décentralisation
avait précisément été marquée par une forme
de
concurrence
entre l'Etat et les collectivités locales.
Reconnues comme personnes morales de droit public, ces dernières ont
participé, comme partenaires à part entière, à
l'administration du territoire. Elles ont fait face de manière efficace
aux besoins exprimés par la population, jouant un rôle
d'innovation que l'Etat ne pouvait plus assumer. Elles ont à cette fin
pleinement utilisé la " clause générale " de
compétences qui leur avait été reconnue.
L'Etat parvint néanmoins pendant toute cette période à
avoir une
emprise croissante
sur l'action publique locale.
Concurrencé dans son rôle
d'acteur public local
par les
collectivités locales qui, à travers la " clause
générale " de compétences, pouvaient agir dans la
plupart de ses domaines d'intervention, il eut recours à son
pouvoir
de tutelle
qui lui permit d'" ajuster ", selon ses propres
vues , les compétences des collectivités locales. Il
s'appuya, pour ce faire, sur le caractère assez imprécis des
textes " fondateurs " de 1871 et 1884, qui autorisaient toutes les
adaptations sans conférer aux collectivités de moyens de
défense.
L'esprit de la décentralisation est précisément de
rompre avec ces pratiques, à partir d'une nouvelle vision du rôle
de l'Etat et de la place des collectivités locales.
Le rapport " Vivre ensemble " avait parfaitement résumé
cette nouvelle vision, en soulignant que
" la décentralisation
est
un parti pris sur l'Etat
" et qu'"
une
démocratie locale authentique a besoin d'un Etat qui en soit un,
c'est à dire qui ne soit pas tout
".
157(
*
)
Cherchant à déterminer une liste des fonctions de l'Etat, le
même rapport soulignait que "
vouloir limiter le champ d'action
directe de l'Etat, c'est opter pour une conception qui met l'accent sur
l'adaptation des décisions aux cas particuliers
, sur la
vigilance des citoyens
et la
responsabilité politique des
élus
; c'est accepter une certaine marge d'erreur,
d'irrationalité et laisser aux citoyens le soin de redresser par le jeu
de la responsabilité des élus ;
c'est opter en faveur du
contrôle politique des citoyens contre le contrôle technique
tutélaire des fonctionnaires.
"
Pour définir les fonctions de l'Etat, le rapport proposait plusieurs
critères. En premier lieu, un
principe de subsidiarité
devait conduire à rechercher toujours le
niveau adéquat
d'exercice des compétences. Le niveau supérieur ne devrait
être appelé à intervenir que dans les cas où les
niveaux inférieurs ne pourraient pas exercer eux-mêmes les
compétences correspondantes. En vertu de ce principe, l'Etat devrait
donc
déléguer
aux collectivités locales tous les
pouvoirs qu'elles sont en mesure d'exercer.
En deuxième lieu, un
critère de simplicité
devait,
selon le rapport, conduire à confier à l'Etat ou aux
collectivités des
fonctions complètes
. Si un partage des
rôles était maintenu à l'intérieur d'une même
fonction, l'attribution de compétence devrait porter sur des
chaînes de décision cohérentes.
A compter de ce rapport, la question de la répartition des
compétences est devenu un
thème prioritaire
des
débats intéressant les collectivités locales. Il fit
l'objet de plusieurs débats au Sénat, notamment dans le cadre du
projet de loi relatif au développement des responsabilités
locales qui faisait une priorité de la recherche de plus de
simplicité
et de
clarté.
La nouvelle répartition des compétences
initiées par
les lois de 1983 a par la suite poursuivi
trois objectifs
principaux,
qui recoupent très largement les axes retenus par
les réflexions et travaux antérieurs :
• une
simplification,
afin que la décision soit
rapprochée du citoyen et que sa mise en oeuvre soit opérée
au moindre coût ;
•
une
meilleure organisation des services publics
, par
une suppression de l'imbrication des réglementations, des
autorités et des financements croisés considérés,
à l'époque, comme générateurs
d'irresponsabilité ;
• une
plus grande liberté
, la dévolution de
compétence devant permettre une définition du service mieux
adaptée aux réalités locales, la suppression de nombreux
contrôles et avis préalables devant autoriser une économie
de temps et donc une plus grande disponibilité des élus pour
l'action.
Le soubassement philosophique de cette démarche est bien l'idée
de
subsidiarité
qui tend à laisser le maximum de
responsabilité aux communautés les plus proches de l'homme et
à ne transférer au niveau supérieur que les tâches
qui ne peuvent être utilement accomplies aux niveaux inférieurs.
b) Un cadre fixé par la loi
La
décentralisation ne peut avoir de portée véritable que si
les collectivités locales bénéficient de garanties
suffisantes sur la procédure selon laquelle le contenu de leur
"
libre administration
" sera défini.
Les règles relatives à la libre administration doivent être
fixées à un niveau suffisant pour qu'il ne puisse y être
porté atteinte par quiconque, en particulier par l'Etat acteur public
local.
Cette définition des règles applicables s'opère dans un
cadre constitutionnel qui doit lui-même concilier deux principes. D'un
côté, la Constitution affirme que la souveraineté
appartient au peuple dans son ensemble.
L'Etat en est l'expression et le
garant.
Il dispose, en conséquence, d'un
droit
d'évocation
illimité qui pourrait s'opposer à toute
limitation de ses pouvoirs.
La France demeure un Etat unitaire. L'indivisibilité de la
République est consacrée par l'article 1er de la Constitution.
Nos institutions restent, en outre, fondées sur l'article 3 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que
"
le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
l'autorité qui n'en émane expressément.
" Le
Conseil constitutionnel a tiré toutes les conséquences de ce
principe, également affirmé à l'article 3 de la
Constitution, en déclarant non conforme la notion de " peuple
corse " (
décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991
).
Mais d'un autre côté, la Constitution reconnaît
l'
existence des collectivités territoriales
qui - à
l'instar des personnes et des associations qui existent indépendamment
de l'Etat - doivent pouvoir s'administrer librement.
La Constitution concilie ces deux principes, non sans une certaine
ambiguïté. Son article 72 dispose, en effet, que "
les
collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils
élus et dans les conditions prévues par la loi.
"
Ces conditions sont précisées à l'article 34 qui disposent
que "
la loi détermine les principes fondamentaux des
collectivités locales, de leurs
compétences
et de leurs
ressources.
"
Or, jusqu'aux lois de 1983, très peu de compétences avaient
été à proprement parler définies par la loi. La
répartition des compétences reposait sur la combinaison de la
" clause générale " de compétences, reconnue aux
communes et aux départements, et de la pratique de la tutelle qui
permettait à l'Etat d'ajuster au coup par coup les compétences
locales.
La notion
d'affaires locales
auxquelles renvoyaient en fait les lois
" fondatrices " de 1871 pour le département et 1884 pour la
commune n'avait en pratique pas prémuni les collectivités locales
contre les
transferts de charges
.
Clarifier les ressources et les charges entre les collectivités locales
et l'Etat avait donc constitué une demande pressante et légitime
des élus locaux. Le rapport " Vivre ensemble " avait ainsi
clairement affirmé que "
seule la loi
peut
intervenir pour déplacer entre l'Etat et les collectivités
locales les responsabilités et les moyens de les exercer.
"
Cette orientation était conforme à la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, lequel avait progressivement renforcé la
compétence du législateur. Il avait ainsi affirmé cette
compétence pour créer ou supprimer des ressources locales
(
décision n° 68-35 DC du 30 janvier 1968
) ou encore pour
transférer à l'Etat des compétences jusque là
exercées par une collectivité locale (
décisions
n°
70-63 L du 9 juillet 1970 et n° 71-70 L du 23 avril
1971
).
Après avoir consacré la valeur constitutionnelle du principe de
libre administration, sans se référer d'ailleurs à une
disposition constitutionnelle précise (
décision n° 79-104
DC du 23 mai 1979
), le Conseil constitutionnel a par la suite veillé
au respect de ce principe par le législateur au cas par cas. Il a en
particulier précisé qu'il impliquait que chaque
collectivité territoriale "
dispose d'un conseil élu
doté
d'attributions effectives
.
" (
décisions
n° 85-196 DC du 8 août 1985 et n° 87-241 du 19 janvier
1988
).
Le Conseil constitutionnel a également considéré que le
législateur ne peut "
méconnaître la
compétence propre des collectivités territoriales
" en
mettant à leur charge des obligations financières qui ne seraient
pas "
définies avec précision quant à leur objet
et à leur portée
" (
décision n° 90-274 DC
du 29 mai 1990
). Il ne peut imposer aux collectivités territoriales
des
contraintes excessives
(
décisions n° 83-168 DC
du 20 janvier 1984
et
n° 98-407 DC du 15 janvier 1998
). Il ne
peut rester
en-deçà de sa compétence
en renvoyant
à une convention conclue entre collectivités territoriales le
soin de fixer les conditions d'exercice des compétences
(
décision n° 95-358 DC du 26 janvier 1995
).
En outre, les règles posées par la loi ne sauraient avoir pour
effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités
territoriales au point
d'entraver la libre administration
(
décisions n° 90-277 DC du 25 juillet 1990 et
n° 98-405 DC du 29 décembre 1998
). Dans le même esprit,
si une péréquation peut être mise en oeuvre par
prélèvement sur les ressources des collectivités, ce
prélèvement ne saurait avoir pour conséquence
"
d'entraver la libre administration des collectivités
territoriales concernées et doit être défini avec
précision quant à son objet et à sa
portée
" (
décision n° 91-291 DC du 6 mai
1991
).
Les lois de compétence de 1983 ont donc logiquement tiré les
conséquences du principe constitutionnel de libre administration.
2. Des transferts de blocs de compétences en fonction des vocations dominantes de chaque niveau de collectivité locale
a) L'identification des vocations dominantes des différents niveaux
Comme
l'avait parfaitement observé notre collègue Paul Girod,
rapporteur de la loi du 7 janvier 1983, au nom de votre commission des Lois,
les textes de 1983 n'ont pas été des textes de
" répartition " des compétences.
L'article premier de la loi du 2 mars 1982 avait certes précisé
que "
des lois détermineront la
répartition
des
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat ".
Mais en réalité la loi du 7 janvier 1983, comme la loi du 22
juillet 1983 qui l'a complétée, n'a pas eu pour objet de
redéfinir les compétences de chacun des niveaux de
collectivités locales. Elle ont plus modestement cherché à
définir quelle collectivité serait la mieux à même
de se substituer à l'Etat pour mettre en oeuvre une compétence
déterminée.
Il s'est donc agi de
transférer
aux collectivités locales
des attributions jusque là exercées par l'Etat, donc de
réduire le champ d'intervention de ce dernier, mais pas de
procéder à une redistribution des compétences entre
régions, départements et communes.
Ces textes ouvraient également un changement de perspective, très
peu de dispositions postérieures aux lois de 1871 et 1884 ayant
énuméré de manière précise les attributions
des collectivités territoriales.
La question de la décentralisation avait, en effet, été
davantage posée en termes de
libertés locales
que de
compétences locales. Cette caractéristique peut expliquer que
l'allégement progressif des tutelles, source d'une plus grande
liberté, ait été recherché en priorité avant
des questions plus pratiques comme les moyens de mettre en oeuvre les
attributions locales.
Les compétences locales s'étaient donc organisées autour
de la
compétence générale
reconnue aux
collectivités locales mais aussi - comme votre rapporteur l'a
déjà indiqué - d'une intervention croissante de
l'Etat, par le biais de la tutelle , dans la définition des affaires
locales.
Sortir de ce flou de la détermination des compétences impliquait
la recherche de
critères opérationnels
permettant de
désigner la collectivité la mieux à même d'exercer
une compétence jusque là exercée par l'Etat.
Cette recherche conduisait à s'interroger sur l'existence
d'affaires
locales.
Or l'absence de critères objectifs ne pouvait que conduire
à considérer que ce critère était en
réalité " introuvable ".
En outre,
l'intérêt local
avait lui-même
été remis en cause sous l'impact de différents facteurs
qui continuent à produire des effets dans le contexte actuel : le
souci
d'égalité
qui incitait l'Etat à adopter des
réglementations uniformes ; la
solidarité
et les
impératifs de l'aménagement du territoire qui motivaient
l'interventionnisme économique et social de l'Etat.
L'intérêt local était ainsi largement
soumis à la
volonté de l'Etat
et pouvait évoluer
au gré des
circonstances
comme l'illustre l'exemple des routes. Alors que la loi du 16
avril 1930 avait décidé le classement dans la voirie nationale de
40 000 kms de routes et chemins appartenant à la voirie
départementale et communale, la loi de finances pour 1972
rétrocéda la totalité du réseau national secondaire
au département.
Les notions
d'affaires locales
ou
d'intérêt local
ne
constituant pas des critères suffisants pour déterminer les
compétences, c'est une
approche pragmatique
qui fut
privilégiée à partir des
vocations dominantes
de
chaque niveau.
Ces vocations dominantes peuvent schématiquement être
présentée comme suit
158(
*
)
:
• la
commune
doit avoir la maîtrise du sol, c'est
à dire l'essentiel des compétences dans le domaine de
l'urbanisme, et exercer la responsabilité des équipements de
proximité ;
• le
département
assume une mission de solidarité
et de péréquation, par la gestion des services d'aide sociale et
par une redistribution entre les communes ;
• la
région
voit son rôle de réflexion et
d'impulsion renforcé en matière de planification,
d'aménagement du territoire et plus généralement d'action
économique et de développement. A ce titre, elle reçoit la
compétence de droit commun en matière de formation
professionnelle.
L'Etat devait pour sa part conserver les grandes fonctions de
souveraineté : affaires étrangères, défense et
la responsabilité des grands équilibres économiques
b) La détermination de blocs de compétences
Cette
idée de confier à chaque niveau des blocs de compétences
n'était pas entièrement nouvelle. Comme votre rapporteur l'a
indiqué précédemment, le rapport " Vivre
ensemble " avait pour sa part préconisé de confier à
l'Etat ou aux collectivités des "
fonctions
complètes
" ou, à défaut, si un partage des
rôles était maintenu à l'intérieur d'une même
fonction, l'attribution de "
chaînes de décision
cohérentes
".
Telle qu'elle ressort de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1983
-désormais codifié à
l'article L. 1111-4
du code
général des collectivités territoriales-, cette
méthode des blocs de compétence a pour conséquence que
"
la répartition des compétences entre les
collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du
possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et
celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux
régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi
que les ressources correspondantes soient affectées
en
totalité
soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux
départements, soit aux régions.
"
Cependant ces transferts de compétences ainsi conçus ne sauraient
se traduire par une
tutelle
d'une collectivité sur l'autre.
L'article L. 1111-3
du code général des
collectivités territoriales précise expressément que
"
la répartition des compétences entre les communes, les
départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces
collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous
quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles
".
L'article L. 1111-4
dispose expressément que
" les
décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de
refuser une aide financière à une autre collectivité
locale ne peut avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une
tutelle, sous quelque forme que ce soit sur celle-ci
. "
Le principe retenu a par ailleurs été celui d'un transfert
à droit constant
, les collectivités locales devant en
conséquence appliquer les réglementations correspondant à
l'exercice des compétences par l'Etat. En outre les compensations
financières des transferts de compétences ont été
calculées à partir des engagements de l'Etat au moment du
transfert, sans que - votre rapporteur y reviendra -soient pris en compte
l'état des biens transférés et les besoins réels
dans le domaine considéré.
B. UNE LOGIQUE DÉVOYÉE
En
dépit de ses imperfections, la logique initiale des lois de
décentralisation avait le mérite d'offrir un nouveau cadre pour
l'action respective de l'Etat et des collectivités locales, de nature
à clarifier l'action publique et d'en renforcer l'efficacité
Or cette logique a été largement dévoyée. Le
schéma initial de répartition des compétences a
évolué vers une
confusion des compétences.
Dans la
période la plus récente, plusieurs dipositifs ont mis en
évidence un mouvement de
recentralisation des compétences.
1. De la confusion...
a) La multiplication des formules de cogestion
S'il
avait conçu les transferts de compétences à partir des
vocations dominantes de chaque niveau, le schéma initial des lois de
1983 n'était pas pour autant parfaitement
rigoureux.
Il laissait
subsister de nombreux domaines où en pratique plusieurs niveaux
étaient susceptibles d'intervenir.
Le principe d'un transfert par blocs de compétences en fonction des
vocations dominantes de chaque niveau a été difficile à
respecter, la plupart des domaines étant
partagés.
Ainsi, pour
l'éducation
, l'Etat a-t-il conservé la
pédagogie, le recrutement, la gestion et la rémunération
des personnels enseignants, chaque niveau de collectivité se voyant
attribuer la responsabilité d'un niveau d'enseignement pour
l'investissement et le fonctionnement : l'école primaire à
la commune, le collège au département, le lycée à
la région et l'université à l'Etat.
Dans d'autres domaines tels que la
culture
ou le
logement
, tous
les niveaux sont appelés à intervenir dans un cadre qui n'assure
pas l'articulation de leurs actions respectives.
En outre, la logique des blocs de compétences n'a pas été
exclusive de
politiques partenariales
entre les différents
niveaux, ce qui a favorisé la complexité du cadre d'exercice des
compétences.
Le domaine de l'aménagement du territoire en constitue une illustration
frappante.
L'aménagement du territoire : une compétence partagée
L'article L. 110
du code de l'urbanisme énonce
que
" le territoire est le patrimoine commun de la Nation. Chaque
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre
de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de
gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des
milieux naturels et des paysages et de promouvoir l'équilibre entre les
populations résidant en zones urbaines et rurales, les
collectivités locales
harmonisent
, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs
décisions d'utilisation de l'espace.
"
L'article L. 1111-2
du code général des
collectivités territoriales précise par ailleurs que les
communes, les départements et les régions "
concourent
avec l'Etat à l'administration et à
l'aménagement du territoire, au développement économique,
social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de
l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.
"
En vertu de ces textes, chaque niveau de collectivité a donc vocation
à exercer des compétences dans le domaine de l'aménagement
du territoire. Le principe d'un
partenariat
est, en outre, clairement
posé. Aux collectivités s'ajoutent les structures intercommunales
à fiscalité propre (communautés urbaines,
communautés d'agglomération, communautés de communes), qui
exercent à titre obligatoire des compétences en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique.
Le législateur a par ailleurs reconnu une mission spécifique
à l'Etat qui est responsable de la définition et de la conduite
"
de la politique économique et sociale ainsi que de la
défense de l'emploi
" (
article L. 2251-2
du code
général des collectivités territoriales).
Enfin, si une priorité régionale avait à l'origine
été inscrite dans la loi en matière d'aides aux
entreprises (article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982), cette
priorité était fragile et n'a pas résisté aux
réalités locales.
Au demeurant, était-il envisageable d'ignorer le rôle de certaines
collectivités dans un domaine aussi essentiel que l'aménagement
du territoire ?
Utilisant pleinement leur
compétence générale
, les
collectivités locales ont elles-mêmes eu tendance à sortir
du cadre strict des compétences qui leur ont été
transférées pour répondre aux besoins sociaux ou prendre
des initiatives en faveur des territoires. Telle est aussi la dynamique de la
décentralisation : laisser l'initiative locale s'exprimer
librement, sous le contrôle des citoyens.
Les
financements " croisés "
, longtemps
dénoncés comme source de complexité et de confusion, sont
apparus souvent
indispensables,
par exemple pour réaliser des
équipements dont le coût ne pourrait être assumé par
une seule collectivité.
La clarification recherchée par les lois de 1983 n'a ainsi pas atteint
parfaitement son but. Mais pouvait-il en être autrement ?
Le schéma des blocs de compétences constituait une construction
rationnelle et pragmatique bâtie autour d'une certain nombre de principes
qui recueillaient un consensus. Ces principes devaient permettre de canaliser
une
dynamique
que la décentralisation est censée impulser
à l'action publique locale.
Mais cette construction avait surtout le mérite de promouvoir une
philosophie pour le partage des compétences : un Etat
recentré sur ses fonctions essentielles, laissant aux
collectivités locales le soin de gérer toute une série de
missions jusque là assumées par lui.
Or l'Etat n'a pas respecté ce schéma. Il a au contraire de plus
en plus
sollicité les collectivités locales
pour qu'elles
contribuent au
financement de ses propres compétences
.
Le rapport du groupe de travail présidé par M. François
Delafosse sur les relations financières entre l'Etat et les
collectivités locales avait, en 1994, proposé une typologie du
partenariat qui distinguait :
• les
contrats de plan Etat-régions
, qui sont apparus
avec les lois de décentralisation et des réforme des
procédures de planification ;
• les
procédures conventionnelles en dehors des contrats de
plan
, procédures très variables recouvrant notamment le
schéma université 2000, les conventions de développement
culturel, la participation des collectivités lcoales au financement
d'infrastructures pour le compte de la SNCF (matériel, gares,...) ou la
prise en charge des dépenses relatives aux lignes
régionales ;
• les
politiques partenariales se situant en dehors du processus
conventionnel classique
, telles que la politique du RMI sur laquelle votre
rapporteur reviendra plus longuement ;
• des
politiques contractuelles liées à la nouvelle
répartition des compétences ou à une approche
conventionnelle des transferts
, par exemple dans le domaine de la formation
professionnelle.
Le rapport pour 1999 de la commission consultative sur l'évaluation des
charges observe que "
les dépenses des collectivités
locales liées à la mise en oeuvre de politiques
définies par l'Etat
représentent
un coût
croissant
. "
Ces dépenses peuvent, selon le rapport, être regroupées en
deux catégories la participation à des
politiques
menées en partenariat avec l'Etat
, en particulier les contrats de
plan Etat-région, qui font l'objet de développements
spécifiques ci-dessous, et les
charges nouvelles,
lesquelles
recouvrent les dépenses résultant de législations ou
réglementations de portée générale s'imposant aux
collectivités locales comme aux personnes publiques ou privées
(par exemple, les dispositifs relatifs à la neutralisation de l'amiante
dans les bâtiments), celles liées à des prescriptions
européennes ou nationales destinées à répondre
à des exigences d'intérêt général pour des
équipements ou l'exercice de compétences locales (par exemple
pour la gestion des déchets), les charges issues de la transposition
directe ou indirecte aux collectivités locales de décisions
prises par l'Etat (revalorisation des rémunérations des
fonctionnaires ou des minimas sociaux, notamment).
Le législateur a lui-même tendu à privilégier des
formules de cogestion
au détriment d'une plus grande
clarté de l'action publique. Tel fut en particulier le cas pour la mise
en oeuvre du RMI et pour la politique d'aide au logement des personnes
défavorisées.
Les lois des 1 er décembre 1988 et du 29 juillet 1992 relatives au RMI
La loi
n° 88-1088 du 1
er
décembre 1988 bat en
brèche le principe du transfert de blocs de compétences
institué par la loi de décentralisation en mettant en place un
ensemble complexe de compétences cogérées assorties d'un
dispositif financier contraignant pour les départements.
Le RMI repose sur l'articulation entre un revenu minimum et une obligation pour
le bénéficiaire de s'engager dans des actions visant à
assurer son insertion sociale et professionnelle.
Le volet relatif à l'insertion -le " I " du RMI- repose sur la
cogestion des décisions les plus importantes.
L'article 34 de la loi susvisée dispose ainsi que
" le
représentant de l'État dans le département et le
président du conseil général conduisent
ensemble et
contractuellement
l'action d'insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, avec le concours des
autres collectivités territoriales et des autres personnes morales de
droit public ou privé, notamment les associations, concourant à
l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion "
.
L'élément central de la politique d'insertion est le
programme
départemental d'insertion
(PDI) annuel qui, aux termes de
l'article 36, évalue les besoins à satisfaire, recense les
actions d'insertion déjà mises en place, évalue les moyens
supplémentaires à mettre en oeuvre, estime les besoins de
formation des personnels et "
définit les mesures
nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites
ou envisagées dans le département
".
Le champ du PDI peut être élargi "
à l'ensemble de
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des
actions en faveur de l'insertion ".
Or, le PDI est élaboré et adopté par le
conseil
départemental d'insertion
(CDI) dont les membres sont
nommés conjointement
par le président du conseil
général et par le préfet. Afin de souligner encore le
régime de la " cogestion ", l'article 35 prévoit
que le CDI est
coprésidé
par le préfet et par le
président du conseil général ou leur
délégué.
A l'échelon inférieur, la cogestion est également à
l'oeuvre dans le fonctionnement des
commissions locales d'insertion
(CLI) qui déclinent sur leur territoire les compétences des CDI,
animent la politique locale d'insertion et approuvent les contrats d'insertion
signés par les bénéficiaires de l'allocation
(art. 42-1). Là encore, ce sont le préfet et le
président du conseil général qui
nomment conjointement
les membres des CLI
, soit en désignant leurs propres
représentants, soit en choisissant d'un commun accord des
représentants des communes ou des " forces vives " locales
(système éducatif, institutions, entreprises, associations).
La cogestion institutionnelle n'a pas toujours suscité la dynamique
attendue, sans doute parce qu'elle est apparue imposée par
l'extérieur plutôt qu'animée par des initiatives communes.
La Cour des comptes, dans son rapport public de 1995, soulignait que le
rôle des CDI relevait
" plus de l'information que de la
décision lorsque leur intervention se réduit à avaliser
les propositions préparées par le services de l'Etat et du
département "
.
Chaque PDI devait donner lieu, aux termes de l'article 39, à la
signature d'une convention définissant les conditions, notamment
financières, de mise en oeuvre du PDI. Là encore, la Cour des
comptes, à l'occasion d'une enquête réalisée sur
20 départements en 1993, constatait l'absence d'une telle
convention dans 10 départements sur 20, faisant allusion à
l'attitude réservée des conseils généraux.
A la cogestion vient s'ajouter un mécanisme de
mobilisation
forcée des crédits départementaux
. L'article 38
de la loi précitée dispose ainsi que
" pour le
financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion
et des dépenses de structure correspondantes, le département est
tenu d'inscrire annuellement un crédit égal au moins à
20 % des sommes versées au cours de l'exercice
précédent par l'Etat dans le département au titre de
l'allocation de RMI "
. Le taux précité a
été porté à 17 % par la loi instituant la
couverture maladie universelle (CMU).
Cette obligation d'inscription des crédits est accompagnée d'un
report automatique des crédits non consommés d'une année
sur l'autre. L'article 41 prévoit ainsi que
" le montant
des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses,
constaté au compte administratif, est reporté
intégralement sur les crédits de l'année
suivante "
.
En l'absence d'affectation ou de report des crédits, le préfet
est habilité à mettre en oeuvre la procédure d'inscription
d'office d'une dépense obligatoire prévue à
l'article 52 de la loi du 2 mars 1982 ; toutefois, cette
procédure n'a jamais été mise en oeuvre dans cette
hypothèse.
La nature des dépenses pouvant être financées par le
département est entendue strictement. Lorsqu'une action d'insertion
financée par le conseil général concerne plusieurs types
de publics, la quote-part sur les " 20 % " est calculée
au prorata de la part des bénéficiaires du RMI dans
l'action ; il faut, par ailleurs, que le lien entre les actions et les
bénéficiaires du RMI soit clairement établi.
Les dépenses d'assurance personnelle pour les
bénéficiaires du RMI non couverts au titre de l'assurance maladie
et maternité, prises en charge par les départements avant
l'instauration de la CMU, n'étaient pas considérées comme
des dépenses d'insertion et, à ce titre, ne pouvaient être
imputées sur les crédits d'insertion. La seule exception
autorisée était la prise en charge de l'aide médicale
fournie aux bénéficiaires dans la limite de 3 % des
crédits départementaux d'insertion.
Même si le PDI peut être étendu à l'ensemble des
actions d'insertion et de lutte contre l'exclusion dans un département,
la loi précise expressément que les crédits obligatoires
au titre de l'article 38 doivent rester affectés aux
bénéficiaires du RMI.
Cette absence de souplesse a souvent fait l'objet de critiques de la part des
responsables des conseils généraux. Ainsi, à l'initiative
de notre collègue, M. Jean Delaneau, une proposition de loi a
été adoptée par le Sénat en mars 1998
(n° 91, 1997-1998) afin d'autoriser l'imputation des dépenses
départementales consacrées à la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion, dans la limite de 10 %, sur le quota des
crédits départementaux d'insertion. Cette proposition
raisonnable, qui avait reçu un avis défavorable du Gouvernement,
n'a jamais été mise en discussion à l'Assemblée
nationale.
Il est à noter que le taux de consommation des crédits
départementaux d'insertion n'a fait qu'augmenter pour atteindre
97 % en 1995, témoignant ainsi de la volonté d'agir des
départements malgré des débuts difficiles.
Enfin, il faut rappeler que la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992
portant adaptation du RMI a confirmé le principe de la cogestion et a,
en outre, institué le
Fonds d'aide aux jeunes
(FAJ)
financé par l'Etat et le département, la participation de ce
dernier devant être
" au moins égale
"
à celle de l'Etat.
L'emprise croissante de l'Etat sur les collectivités
locales
en matière d'habitat et d'urbanisme
au début des
années quatre-vingt-dix
La loi
du 7 janvier 1983 laissait une relative autonomie à la commune pour
définir ses propres options en matière d'habitat et de logement.
Certes, aux termes de l'article 77 de la loi précitée, les
régions disposaient d'une compétence financière de droit
commun pour attribuer des subventions en complément des aides de l'Etat
ou de leur propre initiative, afin d'améliorer la qualité de
l'habitat des quartiers et des logements existants ou l'équipement de
terrains à bâtir.
Mais, aucune collectivité ne pouvant exercer de tutelle sur une autre,
les communes disposaient d'une compétence réelle pour
définir leurs priorités en matière d'habitat (art. 76) et
établir un programme local de l'habitat (PLH) ayant pour fonction de
déterminer les
" opérations prioritaires et notamment les
actions en faveur des personnes mal logées ou
défavorisées "
(art. 78). De nombreuses communes se
doteront d'un PLH (plus de 300) alors que ce document n'avait pas de
caractère obligatoire.
Au début des années 90, se fondant sur la lutte contre les
exclusions par le logement, le Gouvernement mettra en place divers
mécanismes afin d'asseoir son intervention dans un contexte où la
crise de financement du logement social et l'insuffisance du financement par
l'Etat des prêts locatifs aidés (PLA) génèrent de
fortes tensions sur le marché locatif pour les personnes modestes ou en
difficulté.
•
•
La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en oeuvre du droit au logement
présentée par M. Louis
Besson, institue
une forme de cogestion
entre le préfet et le
président du conseil général dans le domaine du logement
pour les personnes défavorisées.
Un plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées
(PDALPD)
doit être élaboré par l'Etat et par le
département : il récapitule les mesures qui doivent
permettre aux personnes en difficulté d'accéder à un
logement indépendant ou de s'y maintenir : en particulier, le
PDALPD
" analyse les besoins et fixe par bassin d'habitat
les
objectifs à atteindre en matière de logement
notamment
(...)
par la création d'une offre supplémentaire de
logements et
la mise en place d'aides spécifiques ".
Le plan est complété par un
mécanisme financier
spécifique
-le fonds de solidarité pour le logement (FSL)-
destiné à accorder des aides financières aux locataires ou
aux candidats locataires.
De même que les fonds d'aide aux jeunes qui seront institués en
1992, les FSL sont
financés à parité par l'Etat et le
département
, ce dernier étant tenu de compléter le
niveau de la subvention déléguée par l'Etat à
partir de la dotation annuelle inscrite chaque année en loi de finances.
Un autre instrument est mis en place en vue de favoriser l'attribution de
logements locatifs sociaux du secteur des HLM aux personnes et familles
défavorisées : le
protocole d'occupation du patrimoine
social
(POPS) doit ainsi fixer des objectifs d'accueil de personnes en
difficulté dans le parc social "
lorsque la situation
l'exige
". Il est conclu entre le préfet, les
représentants des collectivités territoriales et des organismes
d'HLM
" à l'initiative d'au moins deux des
partenaires ".
Lorsqu'un POPS, demandé par le préfet, n'est pas conclu en six
mois, celui-ci peut désigner les ménages devant être
impérativement logés par les organismes d'HLM, ces
désignations s'imputant sur les droits à réservation du
préfet dans le département (
art. L. 441-2 du code de
la construction et de l'habitation dans la rédaction issue de
l'article 15 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
).
•
•
La loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville
(LOV)
va imposer à certaines
catégories de communes des contraintes particulières en
matière de gestion de leur habitat.
Dès son article premier, la loi précitée met l'accent sur
le principe du retour à l'intervention de l'Etat en matière
d'équilibre de l'habitat : "
afin de mettre en oeuvre le
droit à la ville, les communes, les autres collectivités
territoriales et leurs groupements, l'Etat et leurs établissements
assurent à tous les habitants des villes des conditions de vie et
d'habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à
éviter ou à faire disparaître les phénomènes
de ségrégation
".
L'article 3 ajoute que
" la réalisation de logements
sociaux est d'intérêt national et que les communes ou leurs
groupements doivent
(...)
permettre la réalisation de ces
logements "
.
Afin de garantir les objectifs, la LOV impose la réalisation d'un
programme local de l'habitat
(PLH) ainsi qu'une
norme quantitative de
réalisation de logements sociaux
à certaines
catégories de communes. Il s'agit de celles qui sont comprises dans une
agglomération de plus de 200.000 habitants, dont la proportion de
logements sociaux ne dépasse pas 20 % et dont le taux
d'allocation-logement ne dépasse pas 18 % par rapport au nombre de
résidences principales.
Les communes concernées doivent impérativement établir
dans un cadre intercommunal un programme local de l'habitat définissant
pour cinq ans
" les objectifs et principes d'une politique visant
à répondre aux besoins en logements "
.
Le préfet joue un rôle important dans cette
procédure : il est chargé de transmettre aux communes
" toutes informations utiles " ainsi que "
les objectifs
locaux à prendre en compte
" en matière de
diversité de l'habitat et de répartition équilibrée
des différents types de logements : le préfet peut
éventuellement adresser des demandes motivées de modification
à l'EPIC. L'aide financière de l'Etat en matière d'habitat
et d'action foncière est conditionnée par l'adoption du PLH.
Au vu du PLH, les communes concernées doivent en outre s'engager
à procéder aux actions foncières et aux acquisitions
immobilières nécessaires pour réaliser un nombre minimal
de logements sociaux en fonction du nombre de logements. Une
pénalité financière est prévue en cas de
non-respect de l'objectif sous forme d'une contribution communale
représentant 1 % de la valeur locative imposée au titre de
la taxe foncière. La procédure, extrêmement lourde,
s'avérera difficile à mettre en oeuvre.
Par ailleurs, en l'absence de PLH, le préfet peut exercer par
substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain dans la
commune.
b) Un cadre contraignant pour les collectivités locales
Or le
cadre de cette cogestion est apparu contraignant pour les collectivités
locales et peu respectueux de leur liberté de décision.
Comme l'attestent les deux exemples exposés ci-dessus, les
dispositifs législatifs
ont soit imposé aux
collectivités locales des actions conditionnées par les
décisions de l'Etat, soit ménagé à ce dernier la
faculté de faire prévaloir son point de vue.
Le contrat, instrument privilégié de la cogestion, s'est
développé dans un cadre inégalitaire, au détriment
des collectivités locales. Votre rapporteur exposera, ci-dessous, de
manière plus détaillée cette
logique contractuelle
inégalitaire
.
Au total, cette déviation de la logique initiale s'est traduite par une
intervention accrue de l'Etat
là où il aurait dû se
recentrer sur ses fonctions essentielles et par un
encadrement plus
strict
des conditions d'exercice des compétences locales, là
où l'initiative et la responsabilité des acteurs publics locaux
auraient dû prévaloir.
Cette situation n'est pas satisfaisante au regard de
l'efficacité de
l'action publique
, laquelle exige une meilleure définition du
rôle respectif des différents acteurs. Elle n'est pas non plus
satisfaisante pour le
citoyen
et le
contribuable local
qui sont
en droit d'identifier les responsables des actions publiques et de
connaître précisément quelle est la destination de la
contribution qui leur est demandée.
Des dispositifs plus récents aggravent cette situation en favorisant une
véritable recentralisation des compétences.
2. ... A la recentralisation des compétences
a) Des dispositifs coercitifs
A des
dispositifs organisant la cogestion des compétences dans un cadre
inégalitaire assurant la prédominance de l'Etat, s'ajoutent
désormais des dispositifs qui n'hésitent pas à permettre
une recentralisation des compétences au profit d'un Etat qui serait seul
à même d'assurer la bonne exécution de la loi.
Votre rapporteur prendra l'exemple des dispositions prévues par la loi
de lutte contre les exclusions, par la loi relative à l'accueil et
à l'habitat des gens du voyage et par la loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains.
La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
La loi
d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte
contre les exclusions a fait l'objet d'un large accord au sein des deux
assemblées. Il reste que le Sénat, par la voix de son rapporteur,
M. Bernard Seillier, avait souligné que les dispositifs prévus
par le texte s'éloignaient souvent de l'esprit de la
décentralisation.
La loi renforce les pouvoirs des préfets en matière de
politique de l'habitat
.
Tout d'abord, les mécanismes d'attribution des logements sociaux sont
révisés afin de faciliter l'accès au logement des
ménages aux ressources modestes ou défavorisés, en donnant
une autorité plus grande au préfet en ce domaine.
Au dispositif à caractère contractuel des protocoles d'occupation
du patrimoine sociale (POPS) est substitué un mécanisme
institutionnel et réglementaire : la conférence
intercommunale du logement (CIL).
Ces dernières sont inspirées des conférences communales du
logement qui avaient été rendues obligatoires pour toutes les
communes comprenant sur leur territoire une ou plusieurs zones urbaines
sensibles par la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 portant mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville
. Présidée par le
maire, ou en cas de carence par le préfet, la conférence
communale devait élaborer une charte communale des attributions de
logement en vue d'améliorer l'équilibre résidentiel et
veiller à son application. Les conférences pouvaient être
constituées au niveau intercommunal à la libre initiative des
communes concernées.
A l'inverse, les conférences prévues par la loi du 29 juillet
1998 sont exclusivement intercommunales et leurs prescriptions sont plus
précises.
En effet, la CIL est chargée d'établir la charte intercommunale
du logement (CIL) définissant la répartition des objectifs
départementaux quantifiés d'accueil des personnes
défavorisées dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin
d'habitat relevant de l'organisme intercommunal.
L'Etat à travers l'action des préfets joue un rôle
essentiel à tous les échelons de la procédure de
constitution de la conférence. Il délimite le contour des bassins
d'habitat et donc le périmètre intercommunal de la CIL autour des
communes dotées d'une zone urbaine sensible ou comportant un parc de
logements sociaux représentant plus de 20 % des résidences
principales ; l'Etat est représenté au sein de la CIL au
sein de laquelle les maires des communes concernées sont réunis
avec les bailleurs sociaux, les représentants des associations d'aide au
logement et les organismes collecteurs du " 1 %
logement " ; le préfet préside la CIL en cas de carence
du maire président ; le préfet transmet à la CIL
l'objectif quantifié d'accueil des personnes défavorisées
dans le bassin d'habitat qu'il a négocié préalablement au
niveau départemental avec les organismes d'HLM à charge
pour la CIL d'en assurer la " déclinaison " locale ;
enfin, en cas de refus de constitution de la CIL ou de carence de celle-ci, le
préfet peut prononcer lui-même les attributions en relations avec
les organismes HLM intéressés.
Par ailleurs, dans le domaine de l'habitat, la loi institue une nouvelle
procédure de
réquisition de logements vacants
depuis plus
de 18 mois, entièrement sous le contrôle du représentant de
l'Etat
En matière de renforcement de la
cogestion
, la loi prévoit
des contraintes plus précises en matière de gestion des fonds
spécifiques à financement paritaire obligatoire que sont le Fonds
de solidarité pour le logement (FSL) et le Fonds d'aide aux jeunes
(FAJ).
De plus, concernant la
formation professionnelle
, on notera le
rôle d'impulsion joué par l'Etat auprès des régions
en faveur de la formation des jeunes de 16 à 25ans confrontés
à un risque d'exclusion professionnelle à travers la mise en
oeuvre du programme " trajet d'accès à l'emploi "
(TRACE).
Enfin, confirmant le principe de la cogestion en matière sociale, le
texte prévoit un nouveau comité
paritaire coprésidé par le préfet et le
président du conseil général : le comité
départemental de coordination des politique de prévention et de
lutte contre l'exclusion.
La loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
Cherchant à remédier aux insuffisances du
dispositif
issu de la loi du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au
logement, la loi donne une nouvelle définition du schéma
départemental d'accueil des gens du voyage, institue des commissions
consultatives départementales, précise les obligations des
communes et prévoit des dispositions financières destinées
à faciliter la réalisation et la gestion des aires d'accueil. Il
renforce parallèlement les moyens à la disposition des maires
pour faire cesser le stationnement illicite.
Plusieurs de ses dispositions peuvent être rapprochées - au moins
dans leur inspiration - de celles qui figuraient dans la proposition de loi
adoptée par le Sénat, le 6 novembre 1997. Elles s'en
démarquent néanmoins, pour certaines d'entre elles, par un
caractère
contraignant
voire
coercitif
qui n'est pas
conforme au principe du
partenariat
entre l'Etat et les
collectivités locales, qui doit animer la prise en charge de l'accueil
des gens du voyage.
L'article premier
de la loi prévoit que le schéma
départemental sera élaboré
conjointement
par le
représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général, après
avis
des conseils
municipaux des communes concernées et d'une commission consultative
départementale. Il devra ensuite être approuvé par le
représentant de l'Etat et par le président du conseil
général dans un délai de
dix-huit mois
à
compter de la publication de la loi. Passé ce délai, le
représentant de l'Etat pourra
approuver seul
le document, lequel
fera l'objet d'une publication.
L'article 3
de la loi reconnaît au représentant de l'Etat
un
pouvoir de substitution
dans le cas où une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale n'aurait pas
rempli les obligations mises à sa charge par le schéma
départemental. Ce pouvoir de substitution pourra être
exercé
après mise en demeure
restée sans effet
pendant
trois mois
. Le représentant de l'Etat pourra alors
acquérir les terrains
nécessaires,
réaliser les
travaux d'aménagement
et
gérer les aires d'accueil
au
nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale défaillant.
Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement
correspondantes seront considérées comme des
dépenses
obligatoires
pour les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale, lesquels deviendront de plein droit
propriétaires
des aires, à dater de l'achèvement
des aménagements.
Le Sénat s'est opposé fermement
à ces
dispositions, adoptées en lecture définitive par la seule
Assemblée nationale.
Comme l'a parfaitement souligné notre
collègue le président Jean-Paul Delevoye, rapporteur de ce texte
au nom de la commission des Lois, le
rôle dévolu aux
collectivités locales
ne pouvait être conçu et mis en
oeuvre que dans le respect des principes de la décentralisation qui en
font des acteurs pleinement responsables dans le cadre des compétences
qui leur sont dévolues par la loi.
Peut-on encore considérer que les collectivités locales sont
dotées d'"
attributions effectives
", si l'Etat peut se
passer de leur accord dans le domaine de compétences que la loi leur
attribue, de manière exclusive ou conjointement avec l'Etat, en
approuvant seul le schéma départemental ou en exerçant un
pouvoir de substitution pour la réalisation des aires d'accueil ?
De telles mesures coercitives traduisent une interprétation
erronée de l'article 72 de la Constitution. Elles ne peuvent que nourrir
des
contentieux
et des
tensions
auxquelles le législateur
doit précisément avoir pour objectif de mettre un terme.
Si l'Etat considérait que les collectivités locales
n'étaient pas en mesure d'assurer la prise en charge de l'accueil des
gens du voyage, il lui revenait d'en tirer toutes les conséquences, en
prenant en charge directement et de manière exclusive cette mission.
Le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains
Le titre
II
du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,
intitulé "
Conforter la politique de la ville
"
rassemble notamment des
" dispositions relatives à la
solidarité entre les communes en matière d'habitat
"
(
articles 25 à 34
).
Il fixe un objectif de
20% de logements locatifs sociaux
pour chaque
commune de plus de
3 500
habitants (1 500 habitants en Ile-de-France)
comprise, au sens du recensement général de la population, dans
une agglomération de
plus de 50.000
habitants avec au moins une
commune centre de
plus de 15 000
habitants.
Un
prélèvement automatique
sera opéré sur
les ressources fiscales des communes ne satisfaisant pas à cet objectif.
Ce prélèvement sera proportionnel au nombre de logements
manquants par rapport au seuil de 20 % (1 000 francs par logement). Il ne
pourra excéder 5 % du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune. Seront néanmoins exonérées
du prélèvement prévu par le projet de loi les communes
bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et sur le
territoire desquelles on recense déjà 15 % de logements
sociaux. En outre, les communes pourront
déduire
du
prélèvement le montant des dépenses exposées pour
atteindre l'objectif. Pour les communes disposant de ressources
financières élevées, le texte prévoit une
progressivité
de la pénalité en fonction du
potentiel fiscal
.
Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes
compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de
la réalisation de logements sociaux et lorsque cette communauté
est dotée d'un programme local de l'habitat,
le montant du
prélèvement sera versé à la communauté
.
Il sera utilisé pour financer des acquisitions foncières et
immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux. A
défaut, le montant du prélèvement sera versé
à un
établissement public foncier
et, à
défaut d'établissement public foncier, à un
fonds
d'aménagement urbain
affecté aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale pour des
actions foncières et immobilières en faveur du logement social.
Le projet de loi précise que si une commune appartient à une
structure intercommunale compétente en matière de programme local
de l'habitat, c'est celui-ci qui fixera l'objectif de réalisation de
logements sociaux de cette commune, par périodes triennales. L'objectif
de logements à construire pour chaque période triennale est
calculé à partir de la différence entre l'objectif de 20%
à atteindre et le stock de logements sociaux recensés sur le
territoire de la commune. L'objectif de réalisation
sur trois ans
ne peut être inférieur
à 15
% du nombre de logements
manquants, ce qui permettra d'atteindre l'objectif final
en vingt ans.
Un
bilan
devra être établi à l'issue de chaque
période triennale par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
programme local de l'habitat. Ce bilan sera communiqué au conseil
départemental de l'habitat. Si, au vu de ce bilan, il apparaît que
les engagements en matière de constructions de logements sociaux n'ont
pas été tenus, le préfet, après avis du conseil
départemental de l'habitat, prendra un
arrêté
motivé constatant la
carence
de la commune. A compter de cet
arrêté, le prélèvement opéré sur les
ressources fiscales de la commune sera
doublé
, sans pouvoir
excéder 10% du montant des dépenses réelles de
fonctionnement.
En outre, l'Etat pourra
se substituer
aux communes défaillantes.
Il passera une convention avec un organisme pour la construction ou
l'acquisition-réhabilitation de logements sociaux en vue de la
réalisation de l'objectif fixé par la loi. Si l'Etat verse une
subvention foncière, une
dépense égale
sera mise
à la charge de la commune, qui s'ajoutera au montant du
prélèvement majoré. L'Assemblée nationale a rendu
obligatoire
l'intervention du préfet qui ne disposera plus, en
conséquence, d'un pouvoir d'appréciation en fonction du contexte
local.
Comme l'a souligné le Sénat, sur les rapports de nos
collègues MM. Louis Althapé, au nom de la commission des Affaires
économiques, saisie au fond, Pierre Jarlier, au nom de la commission des
Lois, et Jacques Bimbenet, au nom de la commission des Affaires sociales,
saisies pour avis, l'ensemble de ce dispositif privilégie une
démarche coercitive
, traduisant une
suspicion
marquée
à l'égard des collectivités locales. Il
ne prend pas en compte la
diversité
des situations locales. Il
prévoit des dispositions qui ne peuvent s'accorder avec la
logique de
la décentralisation
. Il omet la responsabilité que doit
assumer l'Etat pour apporter les
financements nécessaires
. Il
ignore les difficultés auxquelles certaines communes déjà
très urbanisées sont confrontées pour consacrer des
espaces constructibles
aux logements sociaux. Il méconnaît
le " parcours résidentiel " aboutissant à
l'accession sociale à la propriété
.
Le
Sénat
a, pour sa part, adopté un dispositif
privilégiant le
périmètre des établissements
publics de coopération intercommunale
pour apprécier la
réalité des efforts des communes en faveur du logement social.
Il a prévu la mise en oeuvre de l'obligation de disposer de 20 % de
logements sociaux par rapport aux résidences principales s'appuierait
sur la prise en compte des besoins à partir d'un
diagnostic
des
territoires concernés. Ce diagnostic serait réalisé dans
le cadre des schémas de cohérence territoriale et des plans
locaux d'urbanisme. Ce diagnostic se traduirait dans les
objectifs
retenus par ces documents d'urbanisme ainsi que dans la
programmation
prévue par les programmes locaux de l'habitat.
Les structures intercommunales joueraient un
rôle majeur
pour
mettre en oeuvre ces différents objectifs, dans le cadre des
compétences qui leur ont été confiées par le
législateur. A cette fin, elles s'engageraient dans un
contrat
d'objectifs
avec l'Etat, afin d'assurer une
démarche
partenariale
. Il reviendrait à l'Etat de définir, dans ce
cadre, les financements qu'il compte assurer.
C'est dans ce cadre
territorial
et
contractuel
ainsi
défini que seraient envisagées une
contribution
des
communes et établissements publics de coopération intercommunale
ne respectant pas l'objectif fixé par le législateur et, le cas
échéant, des
pénalités conventionnelles
lorsque les engagements conventionnels n'auraient pas été
respectés.
Le Sénat a, en revanche, supprimé les dispositions du projet de
loi prévoyant un prélèvement sur les recettes fiscales
communales et permettant au représentant de l'Etat de se substituer aux
communes.
Le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement
urbains sera définitivement adopté par le Parlement à
l'automne 2000.
b) Une présomption inacceptable : l'incapacité des collectivités locales à appliquer la loi
L'esprit
de la décentralisation est bien de promouvoir un Etat recentré
sur ses compétences essentielles, laissant aux collectivités
locales le soin de prendre en charge les autres domaines de compétences.
Ce choix est un
pari sur l'efficacité
de la gestion
publique : parce que les compétences sont exercées au niveau
adéquat, elles sont gérées da la manière la plus
efficace.
C'est aussi un
pari démocratique
: l'Etat tutélaire
accepte que le processus de décision se rapproche du citoyen et que les
décisions publiques prises par des collectivités de
proximité puisse être soumises à un contrôle plus
effectif de la part de ce dernier.
Ce double pari suppose l'acceptation d'un triptyque "
liberté
d'initiative, diversité, responsabilité
" qui doit
être au coeur de l'action publique locale. Dès lors que ce
triptyque n'est plus respecté, c'est l'esprit même de la
décentralisation qui est remis en cause.
Respecter cette règle du jeu constitue une
exigence forte pour
l'Etat.
Le rapport " Vivre ensemble " avait parfaitement
exprimé la portée d'une telle exigence en faisant valoir que
même pour des compétences partagées entre l'Etat et les
collectivités locales, ces dernières devaient disposer d'une
certaine
marge d'appréciation
et que le niveau de service devait
dépendre de l'appréciation localement portée par les
élus et jugée par les électeurs. Le rapport en concluait
que "
même pour des compétences partagées, et
guidées par l'Etat,
le rôle dominant sera celui des
institutions locales.
"
159(
*
)
Or les dispositifs les plus récents témoignent que l'Etat accepte
de moins en moins de s'inscrire dans cette " nouvelle donne " que
constitue la décentralisation.
L' " Etat contractuel à la française " cède
progressivement la place au retour d'un Etat tutélaire qui non seulement
dicte aux collectivités locales ce qu'elles doivent faire mais s'arroge
aussi le pouvoir de se substituer à elles quand il estime qu'elles ne
remplissent pas correctement les obligations qu'il a lui-même
définies.
Ce faisant, l'Etat reproduit les travers qui avaient été
précisément dénoncés au moment des lois de
décentralisation.
Il n'est pas inutile de relever que les motivations avancées à
l'appui de cette nouvelle posture sont le plus souvent les mêmes que
celles qui avaient fondé la démarche de l'Etat dans les
années qui avaient précédé la
décentralisation.
Le souci d'assurer
l'égalité
de traitement des citoyens
sur tout le territoire justifierait l'édiction de
dispositifs
uniformes
au niveau national, l'Etat devant disposer de moyens de
contrainte pour s'assurer que les collectivités se conforment bien
à ce schéma unique.
Or paradoxalement, imposant cette règle d'uniformité aux
collectivités locales, l'Etat n'hésite pas à s'en
dispenser pour la mise en oeuvre de ses propres actions territoriales.
Peut-on dire, par exemple, que l'Etat assure l'égalité de
traitement des citoyens sur toutes les parties du territoire en matière
de sécurité ?
Ce positionnement de l'Etat exprime également une conception, que votre
mission d'information entend fermement dénoncer, selon laquelle l'Etat
serait seul à pouvoir
définir l'intérêt
général
et à en être le
garant
sur
l'ensemble du territoire.
Or collectivités publiques à part entière, disposant de la
légitimité démocratique et soumises au contrôle des
citoyens, les collectivités locales
sont également en charge
de l'intérêt général.
Il n'est donc pas acceptable qu'avant même l'adoption de nouveaux
dispositifs leur imposant des obligations spécifiques, elles soient
soupçonnées de ne pas vouloir les appliquer.
Votre mission d'information entend dénoncer fermement ce mauvais
procès fait aux collectivités locales.
Le recours à la loi pour imposer aux collectivités locales,
malgré l'opposition du Sénat, qui en vertu de la Constitution en
assure la représentation, des dispositifs contraignants
éloignés de l'esprit de la décentralisation, remet par
ailleurs en cause l'idée communément partagée lors de
l'adoption des lois de répartition des compétences, selon
laquelle l'inscription des " règles du jeu " dans la loi
constituait une garantie pour les collectivités.
II. UNE LOGIQUE CONTRACTUELLE INÉGALITAIRE
"
Lieu après lieu, depuis quelques
décennies,
le panorama des méthodes des politiques publiques s'est, de fait,
modifié progressivement en France (...).
De tous côtés,
des changements diversifiés semblent aller dans un même
sens : la négociation plus explicite de l'action publique et la
multiplication des contrats dans les politiques publiques
".
C'est en ces termes qu'un récent ouvrage, au titre explicite :
"
Gouverner par contrat
"
160(
*
)
résume
l'essor récent des
procédures contractuelles
dans le champ de l'action publique. Ni la
liberté contractuelle des personnes publiques, ni le principe de la
contractualisation entre ces personnes ne sont d'ailleurs des nouveautés
juridiques.
La contractualisation n'est pas par essence contraire à la
décentralisation. Elle peut au contraire apparaître comme
son
corollaire naturel et indispensable
. Le lien contractuel implique, en
effet, la
liberté
et
l'égalité
des parties,
au contraire de la tutelle, relation verticale de subordination. Il est, dans
ce sens, la condition et la manifestation de l'émancipation des
collectivités territoriales et l'expression même d'une nouvelle
organisation des pouvoirs.
Contractualisation et décentralisation seraient, dans cette optique,
comme les deux faces d'une même médaille, l'une étant
l'expression du nouvel ordre juridique institué par l'autre
.
C'est donc bien plutôt
dans ses modalités que dans son principe
que le procédé contractuel peut remettre en cause certains
des acquis de la décentralisation.
L'ampleur prise par le phénomène contractuel -pour ne pas dire sa
prolifération récente-, particulièrement dès qu'il
s'agit d'associer, dans des actions communes, l'Etat et les
collectivités locales, n'est en effet pas sans conséquences sur
l'équilibre de la décentralisation, tant en raison de la
nouvelle répartition
de fait
des compétences -ou
plutôt de leur financement- que la contractualisation induit, qu'à
cause de
l'asymétrie
des relations
contractuelles
entre les parties.
Cette multiplication des instruments conventionnels s'est, par ailleurs,
accompagnée de leur
banalisation
: un récent article
de doctrine
161(
*
)
mettait ainsi en
lumière "
une sorte de mode contemporaine qui habille du terme
" contrat " des procédures de concertation, qui
présupposent ou expriment des accords de volonté de la part des
personnes publiques, mais qui n'entraînent par elles-mêmes
aucun
effet juridiquement obligatoire
. (...). Les illustrations actuelles du
phénomène ne manquent pas, du " caractère
platonique " des contrats de plan Etat-régions aux très
récents contrats locaux de sécurité ".
Cette
évolution a parfois porté préjudice aux
collectivités locales qui se sont ainsi vues privées du recours
qu'implique une véritable relation contractuelle.
A. L'IMPORTANCE CROISSANTE DES TECHNIQUES CONTRACTUELLES
Parmi les procédures contractuelles, les contrats de plan Etat-régions figurent sans doute, par l'importance des sujets traités et par la masse des financements engagés, au premier rang en termes d'impact sur l'équilibre de la décentralisation française.
1. Les contrats de plan Etat-régions : une enveloppe financière considérable en partie seulement prise en charge par l'Etat
a) La contractualisation décentralisée, héritière de " l'ardente obligation " nationale
Depuis
leur institution par les lois de décentralisation, et en particulier par
la loi
162(
*
)
du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification, qui dispose que "
l'Etat peut
conclure
avec les collectivités territoriales, les
régions, les entreprises publiques ou privées et
éventuellement d'autres personnes morales, des
contrats de plan
comportant des engagements réciproques des parties ",
en vue de
l'exécution du plan de la Nation,
quatre générations de
contrats de plan Etat-régions se sont succédées.
Ces contrats de plan, initialement conçus comme une application du plan
national, ont progressivement été, méthodologiquement et
juridiquement,
disjoints de la planification nationale
, à
laquelle ils ont survécu, au point d'être aujourd'hui le principal
instrument stratégique du développement territorial de notre
pays. Le dernier exercice de planification nationale remonte en effet au
Xème plan (1989-1993). La loi précitée
d'aménagement du territoire du 25 juin 1999 a, en outre,
supprimé le " schéma national d'aménagement et de
développement du territoire ", document de synthèse des
divers schémas sectoriels d'aménagement du territoire, qui aurait
dû être adopté par la voie législative
163(
*
)
. Votre Haute assemblée a vivement
regretté la suppression de cet outil, démocratiquement
délibéré, de mise en cohérence de la politique
d'aménagement du territoire, à son sens indispensable.
b) Des financements croissants, répartis entre plusieurs partenaires
Quelques
chiffres permettront de prendre la mesure de l'importance des contrats de plan,
mais aussi de
l'engagement financier respectif des différents
partenaires
.
La première génération de contrats de plan a couvert la
période quinquennale de 1984 à 1988, la deuxième celle de
1989 à 1993, la troisième génération devait
s'appliquer aux années 1994 à 1998, mais a en
réalité été unilatéralement prolongée
par l'Etat et s'est achevée en 1999. Au cours de ces trois
périodes,
les engagements financiers de l'Etat ont
fortement
augmenté en volume,
puisqu'ils sont passés, pour l'ensemble
des régions métropolitaines, de 41,9
164(
*
)
à 56,6 puis à 77,3 milliards de
francs. Ils ont cependant
diminué en valeur relative
, leur part
ayant évolué de 59,9 % à 55,4 %, puis à
52,1 % du montant total des contrats, du fait de l'engagement croissant
des autres partenaires.
En moyenne annuelle, d'après le rapport public 1998 de la Cour des
Comptes, qui a analysé l'exécution de la troisième
génération de contrats de plan, ces crédits ont
représenté pour l'Etat 18,6 % ou 15,5 % des
autorisations de programme civiles ouvertes en loi de finances initiale, selon
que l'on retient une période de cinq ou six ans ; la proportion est
beaucoup plus forte dans certains secteurs, comme celui des routes (62 %).
L'apport global des régions
, d'un montant de
71,3 milliards de francs
pour la troisième
génération, n'est que très légèrement
inférieur à celui de l'Etat. Si l'on fait abstraction de la
situation exceptionnelle de l'Ile-de-France, où la contribution de la
région est de plus du double de celle de l'Etat (23,2 contre
11,2 milliards de francs), la part des autres régions est de
42 % en moyenne.
Lors de leur 69
e
Congrès, en octobre dernier, consacré
aux politiques contractuelles, les départements indiquaient par ailleurs
avoir participé à hauteur de
18 milliards de francs
au financement des contrats de plan 1994-1999.
A ces crédits s'ajoutent des fonds européens, ainsi que les
contributions des
autres partenaires
(communes, établissements
publics locaux...),
qui portent le total des participations locales à
un niveau supérieur à celui de l'Etat.
Lors de la récente table ronde
165(
*
)
sur
les contrats de plan Etat-régions organisée par la
Délégation du Sénat à l'aménagement du
territoire, M. Michel Delebarre, président du Conseil
régional Nord-Pas-de-Calais, développait un exemple
particulièrement révélateur du poids financier respectif
des différents contributeurs à certaines actions du contrat de
plan entre l'Etat et cette région.
Pour les crédits consacrés aux
routes nationales
-qui
relèvent d'une compétence de l'Etat- ce dernier soulignait que la
part de l'Etat était rarement consommée en totalité et
que, de surcroît, bien souvent, la contribution du co-contractant
régional était appelée avant la sienne. Il estimait que
cette méthode "
donne aux collectivités territoriales,
à la région en particulier, un sentiment un peu curieux. [...]
Parfois, nous assurons un peu
la trésorerie de l'Etat
dans la
mise en oeuvre des crédits routiers.
"
M. Delebarre poursuivait : "
sur les crédits routiers,
27 % sont une contribution de la région, 27,5 % du
département, il y a une contribution de l'intercommunalité et une
autre de la commune. L'Etat récupère la TVA sur l'ensemble.
Je
me suis demandé s'il ne gagnait pas de l'argent sur la mise en oeuvre
des routes !
Je reconnais que l'image est caricaturale, mais c'est une
mise en oeuvre un peu curieuse. Reconnaissons-le. "
Cet exemple illustre, d'ailleurs, nombre de
défauts
méthodologiques
de la contractualisation Etat-régions
(transfert de charges ; brouillage des compétences ;
inexécution des engagements pris ; inégalité
contractuelle...) qui seront plus longuement développés
ci-après.
En comptabilisant la participation des diverses parties, les contrats de
plan mettent en jeu des sommes importantes.
C'est ainsi un montant, considérable, de
220 milliards de
francs
166(
*
)
-soit plus du triple de la
première génération- qu'auront mobilisé les
contrats de plan pour la période 1994-1999.
Pour la nouvelle génération de contrats
, portant sur la
période 2000 à 2006, l'engagement de l'Etat devrait
s'élever à
120 milliards de francs
167(
*
)
,
pour une participation des régions
estimée à
110 milliards de francs
, à laquelle
s'ajoutent les contributions des autres collectivités. Rappelons que
l'enveloppe des fonds structurels devrait, quant à elle
représenter, sur la période, environ
100 milliards de
francs
de financements pour notre pays.
A ce propos, toujours lors de la table ronde sur les contrats de plan
organisée par la Délégation à l'aménagement
du territoire du Sénat, le Président du Conseil régional
Nord-Pas de Calais faisait observer que des crédits communautaires
avaient parfois financé des engagements pris par l'Etat dans le cadre
des contrats de plan. Il estimait ainsi : "
Il n'est pas pensable
que les premiers (les crédits communautaires) viennent se substituer aux
seconds (les fonds de l'Etat) dans certaines opérations. Or, dans les
années passées, combien d'opérations avons-nous vu
engagées avec
une absence de crédits d'Etat et des
crédits européens présentés comme étant la
contrepartie d'Etat ?
Nous souhaitons que la lecture de l'addition des
crédits européens soit très précise, très
transparente et très lisible
".
Force est de constater que l'Etat n'est donc qu'un financeur parmi d'autres,
bien qu'il conserve de fait la maîtrise du pilotage du système
.
S'agissant des seules dotations de l'Etat pour la prochaine
génération, leur répartition a été
arrêtée, en novembre dernier, de la façon suivante :
CONTRATS DE PLAN 2000-2006 :
MONTANT
DE LA
CONTRIBUTION DE L'ETAT
|
|
En
millions
|
en
francs
|
|
Alsace |
3 440 |
1 989 |
|
Aquitaine |
4 794 |
1 652 |
|
Auvergne |
3 937 |
3 012 |
|
Bourgogne |
3 293 |
2 046 |
|
Bretagne |
6 000 |
2 067 |
|
Centre |
4 040 |
1 658 |
|
Champagne Ardenne |
2 409 |
1 796 |
|
Corse |
1 631 |
6 371 |
|
Franche Comté |
4 177 |
3 744 |
|
Ile de France |
19 895 |
1 821 |
|
Languedoc Roussillon |
5 001 |
2 181 |
|
Limousin |
3 033 |
4 272 |
|
Lorraine |
6 302 |
2 730 |
|
Midi Pyrénées |
6 387 |
2 506 |
|
Basse Normandie |
3 777 |
2 659 |
|
Haute Normandie |
4 054 |
2 281 |
|
Pays de la Loire |
4 726 |
1 468 |
|
Picardie |
3 012 |
1 623 |
|
Poitou Charentes |
3 750 |
2 290 |
|
PACA |
8 095 |
1 801 |
|
Rhône Alpes |
9 063 |
1 609 |
|
Total métropole |
121 293 |
2 076 |
|
Guadeloupe |
1 284 |
3 046 |
|
Guyane |
1 221 |
7 762 |
|
Martinique |
1 119 |
2 933 |
|
Réunion |
2 016 |
2 859 |
|
Total DOM |
5 640 |
3 386 |
|
Total métropole + DOM |
126 933 |
2 113 |
En ce
qui concerne la part relative des différents ministères dans ces
crédits contractualisés, trois d'entre eux représentent
plus des deux tiers de l'enveloppe totale :
l'équipement
(38,4 % du total),
l'éducation nationale
(17,9 %),
et
l'agriculture
(8,8 %).
Malgré leur masse financière et leur importance
stratégique, les contrats de plan Etat-régions ne sont pas les
seuls instruments juridiques de partenariat entre les collectivités
locales et l'Etat. Au contraire, les autres formes contractuelles ont eu
tendance à se multiplier. Cette prolifération devrait même
connaître, avec la récente loi d'aménagement du territoire,
une accélération.
2. Les contrats de ville ou la tentative de rationalisation d'une politique foisonnante
a) Une prolifération à laquelle la contractualisation n'a pas totalement mis fin
La
politique de la ville, par nature interministérielle, concerne en outre,
du fait de la multiplicité des sujets -sécurité,
éducation, équipement, habitat, économie et emploi,
justice...- un grand nombre d'acteurs, au premier rang desquels figurent les
collectivités territoriales, en association avec l'Etat.
Depuis 20 ans, chacun s'accorde sur la nécessité d'une
globalisation
de cette politique ; aussi a-t-elle été
l'un des lieux privilégiés du développement d'abord de
partenariats divers, puis d'une contractualisation plus systématique
entre les différentes collectivités impliquées.
A compter du milieu des années 1970, les éléments d'une
"
politique de la ville
" se sont progressivement mis en
place, réalisant la synthèse de plusieurs actions
dispersées. Avec la création d'un ministère de la ville en
1991 et le vote de la loi d'orientation pour la ville, la même
année, la politique de la ville a acquis un statut, confirmé par
la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville de
1996
168(
*
)
, de politique transversale,
cohérente et, d'ailleurs, non partisane.
Afin de lutter contre la dégradation de cités HLM, les pouvoirs
publics ont, dès 1977, créé un groupe de travail
interministériel " habitat et vie sociale " (HVS). Ce groupe
eut pour mission de financer une partie de l'aménagement de cinquante
sites de banlieues et d'y réaliser un accompagnement social.
Malgré la prise de conscience qu'elle a suscitée, cette
première tentative de décloisonnement de la politique des
banlieues ne prit pas assez en compte l'environnement des quartiers et ne
permit pas une implication suffisante des habitants, ni des élus locaux.
En outre, elle était soumise à une procédure
administrative assez rigide.
C'est la raison pour laquelle, en 1981, la Commission pour le
développement social des quartiers fut créée afin d'agir
sur les causes de la dégradation des quartiers, de faire des habitants
des acteurs du changement et d'associer les collectivités à ces
opérations.
A compter de 1984, l'instrument de la politique de la ville fut le
comité interministériel des villes
, placé sous la
présidence du Premier ministre.
En 1988, l'Etat renforça la coordination de ce qui était
désormais la " politique de la ville ". Un décret
n° 88-1015 du 25 octobre 1988 créa le
Conseil
national des villes et du développement urbain
; un
Comité interministériel des villes
et du
développement social urbain
; une
Délégation interministérielle à la ville
(DIV).
En 1990, un
ministère de la ville
, confié à un
ministre d'Etat, fut créé afin de coordonner les initiatives.
Parallèlement au lancement de programmes nationaux, le Comité
interministériel des villes s'appuya sur des
programmes
territoriaux
, dans le cadre de
conventions
signées à
l'échelon des quartiers et de la ville : conventions ville-habitat,
contrats de ville, programmes d'aménagement concerté du
territoire (ou PACT urbains).
Dès son rapport d'information sur la politique de la ville de
1992
169(
*
)
, le Sénat constatait
l'éparpillement de cette politique
et estimait que
"
malgré l'apparence trompeuse du vocabulaire, la politique de
la ville n'existe pas et n'est que l'accumulation d'actions
dispersées
".
Pourtant était parue, en 1989 une circulaire
170(
*
)
du ministre de l'équipement et du
délégué interministériel à la ville à
l'adresse des préfets
" relative au développement de la
politique contractuelle avec les collectivités locales "
. Cette
circulaire, estimant que la politique de la ville concerne tous les aspects de
la vie quotidienne, invitait les services de l'Etat à
systématiser la contractualisation de sa mise en oeuvre et indiquait que
les actions à développer devaient être, pour l'essentiel,
définies et mises en oeuvre dans un cadre contractuel, avec des contenus
diversifiés adaptés aux réalités locales et
négociées à l'échelon local. "
Le cadre
contractuel résulte de la nature des problèmes posés, qui
nécessitent un traitement global, et de la superposition sur un
même territoire de compétences et de responsabilités
multiples
".
D'après ce texte, étaient invités à
contractualiser, outre l'Etat et les collectivités locales, les
bailleurs sociaux et privés, le mouvement associatif et
" l'ensemble des acteurs qui font la ville "
, terme au
demeurant peu explicite. Cette circulaire précisait enfin -si on peut
dire, compte-tenu de l'imprécision du propos !- que ces conventions
devaient "
prendre en compte "
les engagements
déjà souscrits dans les contrats de plan au titre du
développement social des quartiers et qu'elles pourraient conduire
à des
" contrats de ville "
à vocation plus
exhaustive.
Ce texte estimait que les collectivités territoriales
" devaient "
, dans ce cadre
, " contribuer activement
aux opérations d'investissement -aménagement urbain,
équipements, transports-
,
mais aussi et surtout aux actions
permettant l'amélioration de la vie quotidienne "
.
Il était toutefois fort opportunément rappelé que la
faculté de contracter devait "
naturellement "
rester
facultative, et ne pouvait résulter que d'une volonté
commune ! C'est bien le moins...
D'abord expérimentés dans 13 sites pilotes,
les contrats de
ville
ont été généralisés à
compter de 1994. Fondés sur une approche globale (habitat,
aménagement urbain, éducation, santé, prévention,
développement économique), ils sont censés traduire
l'élaboration d'un programme local commun aux différentes
parties, de durée quinquennale, pour le développement et la
réhabilitation des quartiers.
Mais leur généralisation n'a pas entièrement
gommé le caractère foisonnant et presque brouillon de la
politique de la ville
. Qu'on en juge plutôt : sans parler de la
problématique de l'articulation entre contrats de ville, contrats
d'agglomération, contrats de pays et contrats Etats-régions, qui
sera abordée ci-après, la politique de la ville
" bénéficie " à elle seule de
3 procédures contractuelles jusqu'à présent
distinctes
: les contrats de ville, les programmes
d'aménagement concertés du territoire (PACT urbains) et les
" conventions de sortie " des opérations de quartiers du
Xème plan. Ces procédures contractuelles s'accompagnent par
ailleurs de programmes divers, tels les grands projets urbains
171(
*
)
, par exemple.
L'essor de la contractualisation a donc été parallèle
non seulement à celui de la politique de la ville
mais aussi,
serait-on tenté de dire, à la complexité de cette
dernière.
En ce qui concerne les contrats de ville, ils ont été reconduits
et pérennisés. Alors que les crédits qu'y a
consacré l'Etat pour la période 1994-1999 se sont
élevés à 10,4 milliards de francs, cette enveloppe
devrait être de 17,4 milliards de francs pour les contrats de ville
devant être signés pour la période 2000-2006
172(
*
)
.
Il existait, fin 1999, 308 contrats de ville, concernant 934 communes et
1.310 quartiers. Trois cents contrats devraient être signés
pour la période 2000-2006. Une circulaire
173(
*
)
du premier ministre sur les contrats de ville de la
période 2000-2006 a récemment réaffirmé la place
qu'ils sont, à son sens, appelés à avoir, indiquant que
"
le contrat de ville sera la procédure de contractualisation
unique pour la politique de la ville
".
Un effort de clarification
de cette politique semble pourtant demeurer nécessaire
, ne serait-ce
que pour préciser l'articulation des différents contrats.
Malgré l'apparente clarté du postulat de la
prééminence du contrat de ville comme instrument contractuel de
cette politique, la même circulaire -relativisant ainsi l'apparente
simplicité du dispositif- indique en effet que :
- les contrats de ville, conclus pour la même période que les
contrats de plan, et n'ayant pas le même champ d'application
géographique, " déclinent " les priorités de ces
derniers pour la politique de la ville ;
- les contrats de ville " en agglomération " ont vocation
à " s'insérer " dans les futurs contrats
d'agglomération ;
- ils peuvent également être intégrés aux
futurs " contrats de pays " ;
- ils doivent servir de " cadre naturel " à la discussion
des conventions en vigueur dans le champ du développement social urbain,
notamment celles concernant l'habitat, le désenclavement des quartiers,
la sécurité, l'éducation, l'environnement, la culture,
l'intégration, l'emploi et le développement économique, la
santé et la lutte contre les toxicomanies, la jeunesse et les sports, la
lutte contre l'exclusion et mettant en oeuvre les conventions prévues
par l'article 156 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions.
La longueur de la liste de ces procédures est
édifiante !
b) Une politique partagée
Même s'il a parfois tendance à se présenter
comme l'unique financeur de la politique de la ville, l'Etat est en
réalité accompagné -voire précédé-
dans son action par d'autres partenaires. Au-delà du principe d'une
participation possible de divers acteurs -tels que les caisses d'allocations
familiales, les offices HLM, les chambres de commerce et d'industrie, les
caisses d'assurance maladie, les associations-, c'est bien l'engagement
-financier notamment, mais pas seulement,- des
collectivités
locales
qui s'avère particulièrement déterminant.
L'annexe budgétaire récapitulant l'effort financier
consacré à la politique des villes estime ainsi à
3,8 milliards de francs pour 2000 la contribution des collectivités
territoriales, somme importante s'agissant d'une politique de solidarité
et de cohésion nationale et qui concerne, par définition, des
communes aux ressources fiscales peu abondantes
174(
*
)
.
La répartition de sa prise en charge financière, illustrée
dans le graphique suivant, montre d'ailleurs le poids non seulement des
collectivités, mais aussi de l'Europe ou d'autres acteurs comme la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) :
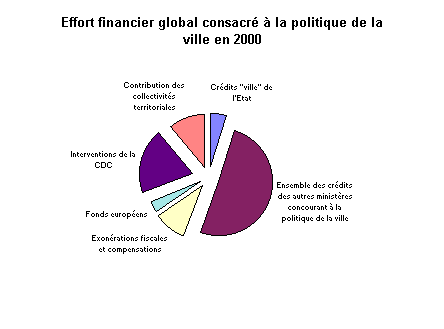
Source : annexe budgétaire jaune sur la politique de la ville du
projet de loi de finances pour 2000.
La participation des acteurs non étatiques, et en particulier des
collectivités, est donc tout sauf anecdotique. Elle est à la
mesure de l'engagement de ces dernières pour l'emploi et la
cohésion sociale. Elle doit s'accompagner, en contrepartie,
d'une
véritable reconnaissance de leur rôle
.
La récente circulaire du premier ministre rappelle d'ailleurs aux
services de l'Etat que l'appui apporté par le
conseil
régional
aux contrats de ville en constitue un élément
déterminant et que les
conseils généraux
"
doivent être pleinement associés à l'ensemble du
processus
". Le premier ministre "
souhaite que soit
proposée à chaque conseil général la signature
d'une convention particulière sur la politique de la ville,
parallèlement au volet du contrat de plan Etat-région relatif
à la politique de la ville
,
convention particulière qui
pourra s'accompagner de la signature par les conseils généraux
des contrats de ville. A ce niveau également, les
compétences
propres
des conseils généraux devront être
sollicitées, qu'il s'agisse en particulier de l'action sociale (aide
sociale à l'enfance, fonctionnement des circonscriptions de travail
social, protection maternelle et infantile, prévention
spécialisée, actions d'insertion liées au revenu minimum
et au logement des plus démunis) ou de la gestion des
collèges
".
Il est assez révélateur de la nature de la contractualisation
actuelle que le chef du Gouvernement ait jugé utile de rappeler à
ses services de telles évidences...
L'association des départements à la signature des contrats de
ville figure explicitement à l'article 27 de la loi
précitée d'aménagement du territoire qui dispose qu'en
application des contrats de plan Etat-régions, l'Etat et la
région peuvent conclure avec les communes ou les groupements de communes
un contrat de ville.
La liste des procédures contractuelles ne s'arrête pas aux
contrats de ville : parmi celle-ci, et au-delà d'une multitude de
conventions diverses et des contrats déjà cités, on ne
peut passer sous silence la récente émergence des contrats locaux
de sécurité.
3. Les contrats locaux de sécurité : un outil perfectible
a) Une procédure qui couvre une part croissante du territoire
Les
grandes lignes de la politique des " contrats locaux de
sécurité " (CLS) ont été définies lors
d'un colloque tenu à Villepinte en octobre 1997 sur le
thème : "
Des villes sûres pour des citoyens
libres
". Depuis, deux circulaires
175(
*
)
sont venues déterminer le cadre de
l'organisation et du fonctionnement de ces contrats.
La "
Rencontre nationale des CLS
", tenue au mois de septembre
1999
176(
*
)
a permis de réaliser un
premier bilan de leur mise en place
et de dénombrer 292 CLS,
alors que 433 étaient, à cette date, en cours de
négociation. Ce sont donc au total plus de 700 contrats qui
seraient signés ou sur le point d'être conclus, dont plus de la
moitié concerne les 26 départements considérés
comme " très sensibles " par le ministère de
l'intérieur, où 80 % des faits de délinquance sont
constatés. Les CLS recouvrent, d'après le bilan dressé
à cette occasion, 429 communes situées en " zone
police ", dont la population est de 13 millions d'habitants, soit
45 % de la population de cette zone. En outre, les CLS en cours de
préparation portent sur 406 communes, comportant 10 millions
d'habitants, soit 35 % de la population située en " zone
police ".
C'est donc au total 80 % de la population de la zone
dont la sécurité est confiée à la police nationale
qui est concernée par la mise en oeuvre d'un CLS.
Le principe du CLS, exprimé dans la circulaire du
28 octobre 1997, est le suivant : la sécurité,
estime le Gouvernement, "
ne peut pas être l'affaire des seuls
services de la police et de la gendarmerie nationale
", d'autant que
le sentiment d'insécurité "
ne résulte pas
seulement du bon exercice de leurs missions "
. Il dépend de
nombreux autres facteurs : cohésion sociale, conscience civique,
qualité de la vie urbaine qui relèvent, pour une part, des
compétences des collectivités territoriales
, mais aussi
des "
initiatives émanant de la société
elle-même
". "
C'est pourquoi il convient d'organiser un
partenariat actif et permanent
avec tous ceux qui, au plan local, sont
en mesure d'apporter une contribution à la sécurité,
notamment
les maires
et les acteurs de la vie sociale
".
Les CLS, qui concernent, en général, une commune ou un groupement
de communes, comportent deux volets (prévention de la délinquance
et conditions d'intervention de la police et de la gendarmerie) et visent
à mobiliser les acteurs, à optimiser leur action et à
améliorer l'efficacité de leurs relations et de leur
répartition des tâches.
Ils sont élaborés conjointement par le préfet, le
procureur de la république et le ou les maires concernés, en
association avec le recteur d'académie. Ils sont signés par les
trois premiers ainsi que,
" s'il y a lieu, par le recteur
d'académie, le président du conseil régional et le
président du conseil général ".
Parmi les principales actions à entreprendre dans la cadre d'un CLS
figurent des objectifs aussi larges que :
-
l'apprentissage de la citoyenneté
et l'enseignement de la
morale civique ;
- la promotion d'une solidarité et d'une
sûreté de
voisinage
;
- le soutien aux actions locales de
prévention
à
l'égard des jeunes en voie de marginalisation ;
- la
non discrimination
à l'embauche ;
- la prévention des
toxicomanies
, des violences urbaines,
des
phénomènes de bandes
;
- la prévention de la
délinquance
et de la violence
aux abords des
établissements scolaires
et la prévention
de la violence en milieu scolaire ;
- la prévention de la
récidive
, l'aide aux victimes,
la
médiation pénale
;
- l'aide à la génération adulte dans ses fonctions
d'autorité et d'éducation
à l'égard des
jeunes ;
- la prise en compte de la sécurité dans la politique
d'urbanisme
;
- la fixation d'objectifs en termes de
présence des forces de
police et de gendarmerie
, d'accueil du public, de recueil et de suivi des
plaintes.
L'Etat s'est initialement engagé, pour la mise en oeuvre des CLS,
à créer des "
emplois de
proximité
" : adjoints de sécurité
auprès de la police nationale et agents locaux de médiation
sociale.
Si le principe des CLS est celui d'une approche globalisée et non plus
sectorielle du problème de l'insécurité, qui permet en
théorie de proposer un traitement complet de cette question, force est
de reconnaître que leur mise en oeuvre s'est heurtée à un
certain nombre d'obstacles et a généré des
dysfonctionnements.
b) Une méthodologie perfectible
Une
évaluation
177(
*
)
de la mission
interministérielle d'évaluation des CLS ainsi que les rencontres
nationales des CLS organisées en septembre 1999 ont permis de mettre en
évidence les
principaux défauts méthodologiques de ces
contrats
.
On peut, notamment, citer l'insuffisance des diagnostics de
sécurité initiaux, le problème du rythme de recrutement,
mais aussi de la définition du rôle et de la qualification des
agents locaux de médiation sociale. Par ailleurs, il semble que certains
parquets, insuffisamment impliqués lors de la conclusion des contrats,
n'aient en outre pas eu les moyens de fournir, qualitativement et
quantitativement, la nouvelle réponse qui était attendue d'eux,
sans parler des difficultés inhérentes à l'organisation
territoriale des services de l'Etat -on pense notamment à la carte
judiciaire des parquets des mineurs, mais aussi à la
nécessité d'un redéploiement des forces de police et de
gendarmerie-.
Les co-contractants de l'Etat n'ont pu, en outre, qu'être
déçus par la
modestie de l'effort supplémentaire en
termes de moyens
que ce dernier a été prêt à
consentir dans le cadre de la conclusion des CLS, à tel point que
M. Jean-Pierre Sueur, président de l'Association des maires de
grandes villes de France, déclarait
178(
*
)
à propos du CLS de la ville d'Orléans,
dont il est le maire : "
Je ne signerai le contrat que lorsque
j'aurai obtenu de la part de l'Etat des policiers supplémentaires dans
les quartiers difficiles, dont les missions seront redéfinies et
orientées vers une police de proximité. L'Etat ne peut pas
défendre le statu quo concernant ses moyens dès lors qu'il signe
un CLS avec une collectivité
".
Bien plus,
les départements
, quoique
compétents
notamment en matière de protection de l'enfance et de prévention
spécialisée, deux thèmes pourtant essentiels des
contrats locaux de sécurité,
ont souvent été
écartés
de leur négociation et de leur signature.
Le rôle du département en matière de prévention
spécialisée est défini à l'article 45 du code
de la famille et de l'aide sociale :
"
Art. 45. Dans les lieux où se manifestent des risques
d'inadaptation sociale, le département participe aux actions visant
à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion
ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Ces actions
comprennent :
1° Des actions tendant à permettre aux intéressés
d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
2° Des actions dites de prévention spécialisée
auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture
avec leur milieu ;
3° Des actions d'animation socio-éducatives.
"
Cette situation, pour le moins paradoxale pour une démarche qui se veut
globale et partenariale et, sans aucun doute, contraire à
l'efficacité de l'action publique, a d'ailleurs motivé la
rédaction d'une deuxième circulaire
interministérielle en date du 7 juin 1999, dans laquelle il
est expressément disposé que :
"
Le partenariat avec les collectivités locales devra rechercher
à
associer plus étroitement les conseils
généraux
et notamment leurs services chargés de l'aide
sociale à l'enfance et de la prévention
spécialisée, ainsi que les
conseils régionaux
pour
ce qui concerne la formation
".
La circulaire insiste, quelques paragraphes plus loin :
"
Les préfets examineront avec les présidents de conseils
généraux de quelle manière le développement des
actions de terrain de la prévention spécialisée peut
contribuer à la réalisation des objectifs figurant dans les
contrats locaux de sécurité
".
Juste retour des choses dans un domaine où la contractualisation,
loin d'avoir accompagné la décentralisation, en avait au
contraire quelque peu nié les avancées !
4. Les autres contrats : quelle cohérence globale et quelle place pour les collectivités territoriales ?
Il
serait fastidieux de prétendre ici dresser la liste exhaustive de
l'ensemble des autres procédures contractuelles entre
collectivités publiques.
Trois types de contrats méritent toutefois d'être cités. Il
s'agit, d'abord, des " contrats de pays ", ensuite des
" contrats d'agglomération " et, enfin, des " contrats de
parcs naturels régionaux ".
Une circulaire du premier ministre
179(
*
)
puis
-dans un ordre chronologique quelque peu surprenant car inverse à la
hiérarchie des normes- la loi précitée du 25 juillet
1999, ont en effet ouvert, sous certaines conditions, la
possibilité
aux pays
180(
*
)
et aux
agglomérations
181(
*
)
de conclure des
" contrats particuliers " -terme au demeurant peu clair- en
application du contrat de plan Etat-région. De même, les parcs
naturels régionaux
se sont vu ouvrir la faculté de
contractualiser avec l'Etat et une ou plusieurs régions
182(
*
)
.
C'est en 2003, échéance fixée pour la révision
à mi-parcours des fonds structurels et des contrats de plan
Etat-régions, que devrait être achevée cette
contractualisation " particulière " une fois les
différentes " chartes " de ces structures adoptées.
Outre les dangers, en termes d'incohérence et d'inefficacité, que
ce foisonnement laisse redouter,
la reconnaissance législative d'une
capacité contractuelle
à des structures qui ne sont pas des
niveaux d'administration en tant que tels ne peut que laisser perplexe. Elle
contribuera sans doute à diluer et brouiller encore un peu plus le
dialogue contractuel entre l'Etat et les collectivités locales,
déjà biaisé par une certaine asymétrie des
partenaires.
B. LA RUPTURE DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES CONTRACTANTS
" Le système de relations contractuelles entre
collectivités publiques actuellement en vigueur est, il est vrai,
davantage placé
sous le signe des rapports de force, et d'une
certaine opacité
, que sous celui du droit et de la transparence.
[...] Il faut [...] éviter que le partenariat ne se traduise par
l'assujettissement des partenaires les plus faibles
". C'est en
ces termes que le Conseil d'Etat, dans son rapport public de 1993
consacré au thème "
Décentralisation et ordre
juridique
" caractérisait l'équilibre -ou plutôt
le déséquilibre- contractuel entre l'Etat et les
collectivités locales.
Il n'est en effet pas douteux que, tant par sa méthode que du fait des
matières traitées, la contractualisation a entraîné
des transferts de charges aux dépens des collectivités et
favorisé une certaine recentralisation. En outre,
l'égalité des parties, qui doit présider, par nature, aux
relations contractuelles, s'est, dans bien des cas, avérée
largement illusoire.
1. Le contrat, vecteur de l'intervention de l'Etat
Au-delà du principe égalitaire du contrat, qui sous-entend la libre adhésion des parties, chacun s'accorde 183( * ) à reconnaître le déséquilibre de fait , en faveur de l'Etat, des relations contractuelles avec les collectivités locales. Tant la méthode que les matières contractuelles ont contribué à fausser la logique égalitaire du principe conventionnel.
a) La méthode, ou le déséquilibre dans la négociation du contrat
Les
contrats entre les collectivités et l'Etat -et singulièrement les
contrats de plan Etat-régions- sont en réalité le fruit
d'une
négociation inégale
entre les partenaires. L'Etat
édicte en effet les principes d'intérêt
général auxquels devront se conformer les collectivités
territoriales : ainsi, par exemple, les " noyaux durs "
définis préalablement par l'Etat comme ses priorités pour
les contrats 1994-1998, lors du Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) de Mende, en 1993, ont-il
singulièrement encadré la négociation avec les
régions.
Plus récemment, la circulaire
184(
*
)
du
premier ministre relative à l'élaboration des contrats de plan
Etat-régions pour la période 2000-2006 a fixé
l'architecture de ces contrats, défini le calendrier et le point de
départ de leur négociation : l'élaboration d'un
document relatif à "
la stratégie de l'Etat dans la
région
" ! L'Etat a fixé -notamment au CIADT
d'Arles en juillet 1999- les priorités des contrats de plan et, via les
mandats de négociation des préfets, les enveloppes
ministérielles et régionales de crédits.
Des premières analyses de la négociation récente laissent
à penser que son centre de gravité s'est déplacé,
par rapport à la précédente génération, vers
le préfet de région, ce qui laisserait supposer une tendance
à la
centralisation déconcentrée
du processus.
Votre délégation à la planification vient de rendre ses
conclusions sur la méthode de négociation
185(
*
)
.
Ce
pilotage méthodologique
par l'Etat n'est certes pas absolument
illégitime, concernant un outil d'aménagement du territoire -et
donc de péréquation nationale-. Il résulte probablement,
outre d'une disproportion des moyens, et, parfois, d'une certaine attitude des
services de l'Etat, sans doute également d'un souci de cohérence
d'ensemble de l'action territoriale de l'Etat. L'incapacité
répétée de l'Etat à remplir les objectifs
fixés à la planification décentralisée, mise en
lumière par le rapport précité de la Cour des Comptes,
contredit toutefois quelque peu cette lecture optimiste.
Reste que cette prééminence est sans doute également la
conséquence d'une
insuffisance du système politique et
juridique français
, non seulement rétif à penser
l'intérêt général en dehors de l'Etat, mais en outre
imprégné de la notion d'acte unilatéral, comme le faisait
remarquer devant votre mission d'information le professeur Jean-Marie
Pontier
186(
*
)
.
Corroborant cette analyse, une récente étude publiée dans
les cahiers de la décentralisation
187(
*
)
estime que
" L'Etat se voit le plus souvent confier le rôle
d'édicter les principes relevant de l'intérêt
général auxquels les collectivités devront se conformer.
(...) L'Etat conserve ainsi
un rôle directeur
de coordination en
fixant les grandes lignes des politiques à mener avec les
collectivités (...) Cette analyse (...) souligne
l'inégalité sous-jacente entre l'Etat et les
collectivités,
qui se situent dans des registres de
légitimité différents, semblant ainsi donner raison
à ceux qui voient dans
la contractualisation un nouveau moyen pour
l'Etat d'intervenir dans les affaires locales. "
Il semble que ce " dirigisme " méthodologique ait en outre
conduit à écarter de la négociation certains partenaires,
et, singulièrement,
les départements.
Ainsi, alors que, d'après le rapport précité de la Cour
des comptes, la participation financière à la
génération 1994-1999 des partenaires autres que l'Etat et la
région (départements, villes ou établissements publics
locaux) a pu s'élever de 40 % à plus de 110 % (en
Alsace) du montant des crédits régionaux, ces derniers n'ont
pourtant pas été associés de façon satisfaisante
à leur signature. Une enquête menée à l'occasion du
dernier congrès de l'assemblée des départements de France,
réalisée de mars à octobre 1999, révélait
ainsi que si 77 % des départements avaient établi un
document stratégique en vue de la conclusion du contrat de plan et si
71 % des conseils généraux comptaient demander à
être signataires des contrats de plan, les deux tiers (65 %)
n'avaient pas été associés directement à la
discussion entre le préfet et le président du conseil
régional
. D'après cette enquête, alors que 41 %
des départements avaient déjà demandé à
être signataires des contrats de plan, seuls 16 % avaient
reçu une réponse positive de principe du préfet.
L'implication stratégique et financière des départements
dans les contrats de plan contraste donc singulièrement avec le peu de
cas qui semble parfois être fait d'acteurs essentiels -sauf lorsqu'il
s'agit d'apporter de substantiels compléments de financement !-.
Interrogeant à l'automne dernier le Gouvernement
188(
*
)
sur les causes de
" cette volonté
manifeste d'absence de prise en compte de la réalité
départementale "
dans la négociation, et souhaitant que
les départements soient associés comme partenaires à part
entière et
" non pas seulement comme des commanditaires
financiers "
, notre collègue Alain Dufaut avait obtenu une
réponse qui, pour être, favorable dans son principe, n'en
était pas moins en contradiction avec la réalité parfois
observée sur le terrain.
b) Les matières contractuelles, ou le déséquilibre dans le contenu du contrat
Il est
peu contestable que les procédés contractuels aient parfois servi
à transférer sur le budget des collectivités locales des
dépenses afférentes aux compétences... de l'Etat !
Dans son rapport précité, la Cour des Comptes, relevant que pour
la génération de contrats de plan 1994-1999, les participations
locales, régions comprises, s'étaient élevées
à un niveau supérieur à celui de l'Etat, jugeait cet
état de fait "
paradoxal puisque les principales actions
inscrites aux contrats concernent
des domaines qui sont de la
responsabilité de ce dernier
: les infrastructures de
communication (surtout les routes nationales) et la formation-recherche
(principalement universitaire), pour 42,4 et 22,3 % des interventions
cumulées de l'Etat et des régions ".
Ainsi non seulement l'Etat dirige-t-il la procédure mais oriente-t-il le
contenu des contrats pour que ces derniers portent sur ses propres
compétences ou sur des domaines de compétences partagées.
La génération de contrats en cours de signature n'échappe
pas à cette règle qui, au contraire, s'accentue, avec
l'élargissement de la contractualisation à des thèmes
nouveaux tels que la justice ou la coopération internationale.
Le contrat est ainsi devenu un outil de transfert de charges, permettant en
quelque sorte à l'Etat de contourner l'interdiction posée
à
l'article L.1611-1
du code général des
collectivités territoriales, suivant lequel :
" aucune
dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public
à caractère national ne peut être imposée
directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à
leurs groupements qu'en vertu de la loi "
.
Trois exemples sont à cet égard particulièrement
éloquents, et suffisamment connus pour être ici trop longuement
développés. Il s'agit du financement des
routes
nationales,
des
plans universitaires
successifs
" Université 2000 " et " Université
troisième millénaire " (U3M) ou encore de la
sécurité publique
, pour lesquels les
procédés contractuels ont permis à l'Etat de trouver
auprès des collectivités locales des financements qu'il
était incapable de mobiliser seul.
Cette instrumentalisation des contrats permet, en quelque sorte, une relecture
de la répartition -en fait mais non en droit- des compétences.
Celle-ci n'est pas modifiée, loin de là ;
l'Etat
n'abandonne en effet aucune de ses compétences
. En revanche, il
choisit d'en confier contractuellement l'exécution, en
réalité
le financement
, aux régions et aux autres
collectivités. Le contrat de plan permet alors une redistribution
temporaire, renégociable, du financement des compétences
étatiques. Il vient atténuer la rigidité de la
répartition législative des compétences. On peut alors
affirmer, à la suite du professeur Laurence Lalliot
189(
*
)
, que
" le contrat de politiques publiques
devient ainsi une alternative à la répartition législative
des compétences.
Pour l'Etat, il a l'avantage de la souplesse, pour
les collectivités locales, l'inconvénient de la
précarité et de l'incertitude ".
2. L'absence de sanction du non respect par l'Etat de ses engagements
Partenaire parfois plus dirigiste que réellement contractuel, l'Etat a en outre eu tendance à ne pas respecter les engagements auxquels il avait souscrit.
a) Une exécution défaillante des engagements financiers
Soulignons tout d'abord la difficulté
méthodologique
de l'évaluation de l'exécution des crédits des contrats de
plans puisque, comme le relève la Cour des Comptes dans son rapport
précité, en raison de l'insuffisance des dispositifs de suivi, le
bilan d'exécution rendu public par le Gouvernement revêt un
caractère largement " illusoire " et ne rend pas compte du
degré de réalisation concrète des projets. En d'autres
termes, relève la Cour, lorsque l'Etat annonce que, à la fin de
1997, le " taux de réalisation " des contrats est de
66,5 %, cela signifie que cette proportion de crédits a
été soit affectée ou engagée au niveau national,
soit déléguée aux préfets. Mais, indiquent les
magistrats financiers, "
nul ne peut connaître le montant total
et exact des crédits délégués et encore moins
mandatés ou payés "
Il est néanmoins certain que
des décalages importants existent, dus, d'après le même
rapport, à l'insuffisante préparation de certains dossiers, aux
enquêtes publiques qu'il faut parfois refaire, ainsi qu'à la
complexité de la mobilisation simultanée des financements
croisés, y compris européens.
Mais ces retards d'exécution sont en grande partie imputables à
la lenteur d'engagement et d'exécution des crédits de l'Etat.
Un rythme d'engagement des crédits inférieur à celui
des cocontractants régionaux
Force est de constater, à la suite de la Cour des Comptes, que les
piètres taux d'exécution des contrats tiennent
en grande
partie à l'insuffisance des moyens financiers mis en place chaque
année par l'Etat
.
Pour la génération 1994-1999,
seule la prolongation d'un an de la durée des contrats a permis un
rattrapage du taux d'exécution puisque seulement deux tiers des
crédits d'Etat avaient été délégués
à la fin de 1997 aux préfets de région. La Cour des
Comptes indique dans son rapport public que la direction des routes estimait
par ailleurs, à la fin de 1998, à 70 % le taux d'engagement
des crédits, au lieu de 85 %, et qu'à ce rythme, il aurait
fallu près de huit ans pour réaliser des programmes qu'il
était prévu d'achever en cinq ans. On constate aussi que les
crédits régionaux sont mis en place plus rapidement que ceux
de l'Etat.
La Cour des Comptes estime que, même si celui-ci doit
rester en mesure d'adapter la dépense publique à la conjoncture
économique nationale, "
il est regrettable qu'il honore ses
engagements avec tant de difficultés ".
Elle estime en outre
que le principe de
l'annualité budgétaire
et la pratique
de la
régulation des crédits
apparaissent, à cette
occasion, comme des moyens, couramment et parfois
abusivement
utilisés, de remettre en question des décisions et des arbitrages
gouvernementaux antérieurs.
La Cour relève également des retards dans la
délégation annuelle des crédits de la part de plusieurs
ministères, auprès desquels les préfets de région
doivent réitérer leurs interventions pour obtenir que les
engagements signés soient respectés.
Une prolongation unilatérale de la durée des contrats
Chacun se souvient de la décision unilatérale de l'Etat de report
d'une année de la date d'échéance des contrats de plan de
la précédente génération, finalement fixée
au 31 décembre 1999. Cette mesure, arrêtée en
1996, a été confirmée par le CIAT du
15 décembre 1997.
Dans une circulaire du 19 septembre 1996, adressée aux
préfets de région par le ministre de l'aménagement du
territoire, de la ville et de l'intégration, plusieurs raisons avaient
été avancées pour la justifier :
- la nécessité d'attendre le renouvellement des conseils
régionaux en 1998, pour que les assemblées issues du scrutin
puissent approuver les nouveaux plans régionaux ;
- le désir de prendre en compte le schéma national et les
schémas régionaux d'aménagement et de développement
du territoire prévus par la loi d'orientation précitée du
4 février 1995 ;
- le souci -au demeurant légitime- de mettre la période
contractuelle en adéquation avec celle des programmes d'emploi des fonds
structurels.
Cette décision -prise puis assumée par deux gouvernements
successifs- contraire, dans son principe, au procédé contractuel,
a d'ailleurs eu un retentissement à la mesure de la légitime
indignation des collectivités locales. Bien qu'aucun recours
juridictionnel n'ait été déposé, certains articles
de doctrine
190(
*
)
estiment d'ailleurs patente
l'illégalité de cette décision.
Toute révision unilatérale serait en effet exclue par le
décret n° 82-32 du 21 janvier 1983 relatif aux
contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des
personnes morales autres que les entreprises publiques et privées. Son
article 7 définit la procédure d'adoption, et donc par
parallélisme, de renégociation, du contrat de plan par
signature conjointe des deux parties.
La rédaction du
décret ne recèle aucune ambiguïté en la
matière et les contrats de plan en ont repris le principe de
procédure.
Le procédé unilatéral retenu par l'Etat lui a, certes,
évité de mener de front plusieurs dizaines de révisions
contractuelles, dans lesquelles, de surcroît, il aurait pu se heurter
à des demandes parallèles de renégociation d'autres
clauses. Juridiquement et politiquement, la technique employée
apparaît toutefois pour le moins contestable et, en tous cas, contraire
aux principes de la décentralisation.
Les engagements de la génération en cours seront-ils mieux
exécutés ?
Votre mission d'information ne tient pas à faire à l'Etat de
procès d'intention. Pour autant, et malgré les déclaration
rassurantes à cet égard de certains membres du Gouvernement, qui
tendraient à faire espérer que les anciennes pratiques sont
révolues -Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement déclarant
191(
*
)
"
je ne veux pas qu'on émette de la fausse monnaie "
-
on ne peut que se monter sceptique tant, par le passé, a
été
constante la tendance de tous les gouvernements à
ne pas tenir en temps et en heure les engagements pris.
Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter au rapport d'information
rédigé,
en avril 1992
, par notre collègue Georges
Mouly au nom de la Délégation du Sénat pour la
planification
192(
*
)
, sur les contrats de plan
Etat-régions des générations 1984-1988 et 1989-1993,
dont les thèmes sont toujours d'actualité
:
importance des financements des régions ; méthodologie de
négociation qui font de ces contrats des " contrats
d'adhésion " ; transferts de charges de l'Etat vers les
collectivités locales ;
mauvaise exécution des
engagements
dans certains domaines...
L'annualité budgétaire : prétexte ou
alibi ?
Le principe de l'annualité budgétaire, posé par l'article
2 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 juillet 1959 relative
aux lois de finances, est souvent invoqué à l'appui de la
thèse d'une impossibilité non pas politique, mais juridique ou
technique, d'exécution d'engagements par nature pluriannuels.
Il est certain que les règles de comptabilité publique
représentent par certains côtés un obstacle technique
quotidien à la consommation des crédits. L'annualité
budgétaire figure d'ailleurs également dans le droit des
collectivités locales (
articles L. 1612-1
et
L.1612-2
du
code général des collectivités territoriales).
Concrètement, elle impose une programmation des dépenses par
exercice et induit une remise en cause annuelle qui fait qu'aucun intervenant
n'est
ex ante
réellement assuré que son cocontractant
tiendra ses engagements. Un certain nombre de projets sont ainsi suspendus
chaque année, le temps pour les ministères de connaître
leurs crédits et pour les collectivités de voter leur budget. En
outre, la consommation effective des crédits, une fois ceux-ci
théoriquement disponibles, dépend de la
célérité des différentes délégations
et mandatements, d'autant plus problématique qu'il s'agit de
cofinancements.
Mais ces obstacles sont-ils réellement dirimants ?
Plusieurs propositions
193(
*
)
ont
déjà été formulées pour améliorer
techniquement les processus de consommation de crédits, fondées
notamment sur le recours accru aux autorisations de programme, par nature
destinées aux opérations pluriannuelles, la simplification des
circuits ou l'amélioration du suivi de la consommation des
crédits.
En outre, les contrats de plan ne sont pas, au regard de l'annualité
budgétaire, dans une situation différente de celle de
l'ensemble des contrats pluriannuels
conclus par l'Etat ou par une
collectivité. Les solutions jurisprudentielles applicables à ces
contrats, en cas d'inexécution des engagements, pourraient donc
logiquement leur être appliquées, comme l'indique l'article
précité du professeur Laurence Lalliot :
"
Dès lors que l'exécution d'un contrat s'étale
sur plusieurs années, et on pense naturellement aux opérations
importantes en matière de travaux publics, le contractant s'expose
à cette incertitude : changement de majorité,
difficultés particulières rencontrées par la
collectivité, abandon des programmes, sont autant d'hypothèses
qui peuvent donner lieu à une réduction, voire à une
suppression des financements attendus.
Ce cas de figure n'étant donc
nullement marginal, il a déjà donné lieu à de
nombreuses décisions jurisprudentielles d'où il ressort que la
personne publique défaillante s'expose à engager sa
responsabilité contractuelle :
le motif tiré de
l'insuffisance des ressources publiques ne saurait la dégager de son
obligation contractuelle de paiement ".
De ce point de vue, l'auteur
relève toutefois la singularité de certains contrats de plan qui
contiennent parfois
des clauses qui tendent à limiter les effets de
cette responsabilité contractuelle
,
les deux parties prenant
soin de mentionner que le respect de l'obligation de payer reste
subordonné à l'engagement budgétaire préalable des
moyens correspondants.
Cette analyse montre toutefois
l'absence d'incompatibilité de
principe entre l'annualité budgétaire et contractualisation
pluriannuelle
et
accrédite le sentiment -d'ailleurs
partagé par la Cour des Comptes- que la comptabilité publique
sert, dans bien des cas, de prétexte à un retard d'engagement des
crédits.
Lors de son audition devant la mission d'information, le professeur
Jean-Bernard Auby indiquait d'ailleurs ne pas bien comprendre l'argument de
l'annualité budgétaire derrière lequel se réfugie
à son sens l'Etat, estimant que ce principe ne l'empêchait pas
"
de passer, tous les jours, des contrats qui l'engagent au-delà
du 31 décembre de l'année
considérée
". Il poursuivait : "
si l'Etat
fait des travaux destinés à accueillir le ministère des
finances et si le contrat doit se réaliser sur 18 mois, l'Etat est
engagé sur 18 mois et s'il ne respecte pas son engagement, les
entreprises qui sont en face lui feront payer des indemnités. Pourquoi
la même logique ne s'appliquerait-elle pas dans les rapports avec les
collectivités locales ? "
La question mérite, en effet, d'être posée. Elle
implique, au préalable, de réfléchir à la nature
même de l'engagement contractuel.
b) Une relation contractuelle dépourvue de force contraignante ?
Les
contrats de plan -et avec eux les CLS, les contrats de ville et l'ensemble des
procédés contractuels visés ci-dessus- sont-ils de simples
engagements moraux
dépourvus d'effets juridiques ?
Soulignons d'abord que la capacité contractuelle de l'Etat et des
collectivités territoriales ne fait pas de doute. Les
collectivités ont une personnalité juridique pleine et
entière qui leur permet, notamment, de contracter.
Il existe même un certain nombre de dispositions générales
en ce sens au sein du code général des collectivités
territoriales, qui dispose que "
les collectivités territoriales
peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles met
à disposition d'une autre ses services et ses moyens afin de lui
faciliter l'exercice de ses compétences
" (art. L.5111-1). Pour
les régions, le Code est plus précis encore puisque celles-ci
"
peuvent passer des conventions avec l'Etat, ou avec d'autres
collectivités territoriales ou leurs groupements, pour mener avec eux
des actions de leur compétence
" (art. L.4111-2). Ce principe
général du droit à la contractualisation a d'ailleurs
été rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° DC 83-160 du 16 juillet 1983, à
propos de la convention fiscale passée entre l'Etat et la
Nouvelle-Calédonie, où il a estimé qu'"
aucun
principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce
que l'Etat passe des conventions avec les diverses collectivités
territoriales de la République telles que les communes, les
départements, les régions ou les territoires
d'outre-mer
".
D'ailleurs, le Conseil d'Etat a reconnu la
nature contractuelle
des
contrats de plan, malgré leur contenu parfois seulement
" programmatique ", dans sa décision d'assemblée du
8 janvier 1988,
Ministre chargé du plan et de
l'aménagement du territoire contre communauté urbaine de
Strasbourg
.
Dans cette décision, le juge a même ouvert la possibilité
d'une
action en responsabilité contractuelle
d'une partie envers
l'autre :
" Considérant que la méconnaissance des stipulations d'un
contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant,
la
responsabilité
d'une partie vis-à-vis de son cocontractant,
ne peut être utilement invoquée comme moyen de
légalité à l'appui d'un recours pour excès de
pouvoir formé à l'encontre d'une décision
administrative ; que ni les dispositions précitées de la loi
du 29 juillet 1982, ni aucune autre disposition législative n'ont
entendu conférer à la stipulation dont s'agit du contrat de plan
passé entre l'Etat et la région Alsace une portée autre
que celle d'une
stipulation contractuelle
(...) "
Si les contrats de plan sont bien des contrats et donc peuvent, en cas de
violation d'une stipulation conventionnelle, engager la responsabilité
du contractant défaillant, et s'ils ne sont, pour ce motif, pas
dépourvus de toute force contraignante, le Conseil d'Etat a toutefois
jugé, dans son arrêt du 25 octobre 1996
Association
Estuaire Ecologie
, qu'ils n'emportent, par eux-mêmes,
"
aucune conséquence directe quant à la
réalisation effective des actions ou opérations
"
qu'ils prévoient.
En l'espèce, une association avait formé un recours pour
excès de pouvoir à l'encontre des décisions, prises par le
préfet et le président du conseil régional des
Pays-de-la-Loire, de signer un contrat de plan entre la région et
l'Etat, qui comportait un programme n° 11 prévoyant l'extension
d'une zone portuaire. Cette décision était contestée par
l'association en tant qu'acte détachable du contrat et, par suite,
susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Dans ce cas, la recevabilité du recours n'est admise que dans la mesure
où l'acte fait grief. Il doit produire des effets juridiques de nature
à affecter la personne qui le conteste. Etait-ce le cas en
l'espèce ? Autrement dit, le contrat de plan produit-il des effets
juridiques suffisants pour que la décision de le signer puisse faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ?
En première instance, le Tribunal administratif de Nantes avait
jugé, le 23 mars 1995, la requête irrecevable. Saisi en
appel, le Conseil d'Etat a considéré que le contrat de plan
n'emporte en lui-même aucun effet juridique direct, pas plus qu'il ne
porte suffisamment atteinte aux intérêts défendus par
l'association pour lui donner qualité pour agir : dès lors,
la requête de l'association est irrecevable.
De cette décision, très largement commentée, a souvent
été tirée la conclusion que ces contrats, passés
entre l'Etat et les collectivités locales, étaient totalement
dépourvus de force juridique.
D'après cette interprétation, et compte-tenu des
développements qui précèdent sur la méthode
employée, les matières concernées et les taux
d'exécution des engagements pris, on conçoit dès lors le
danger que peut représenter pour l'autonomie des collectivités
une telle procédure contractuelle !
Certains observateurs vont jusqu'à dénoncer, par le biais du
processus contractuel, la
résurgence d'une tutelle de
l'Etat
: "
l'essor contractuel marque le passage d'une
contrainte imposée (l'acte unilatéral) à une contrainte
consentie (le contrat). Il ne signifie pas pour autant un déclin de la
tutelle étatique
"
194(
*
)
.
Pour autant, reste -juridiquement au moins, même si sa mise en oeuvre est
politiquement plus délicate- ouverte la voie de
la mise en cause de
la responsabilité contractuelle
d'une partie défaillante par
son contractant, qui pourrait constituer un moyen de
rééquilibrage de la relation contractuelle. D'autres solutions,
notamment législatives, peuvent être envisagées pour
renforcer l'égalité des parties
et préciser les
sanctions applicables
en cas d'inexécution des stipulations
contractuelles.
Par ailleurs, l'insuffisante identification des responsabilités
réciproques dans la mise en oeuvre du contrat et la lourdeur
d'opérations nécessairement conjointes sont des motifs de blocage
qu'il ne faut pas sous-estimer. A cet égard,
l'instauration d'une
" collectivité chef de file ",
désignant une des
institutions signataires comme responsable de tel ou tel projet, permettrait
sans doute aux procédures contractualisées de franchir une
étape décisive.
CHAPITRE IV
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
L'ETAT
ÉLABORE DES RÈGLES INADAPTÉES DONT IL NE SUPPORTE PAS LES
CONSÉQUENCES
Une
décentralisation plus achevée ne peut à l'évidence
être atteinte sans l'implication et le travail des agents des
collectivités locales. La mission d'information tient à souligner
la qualité, la richesse et le professionnalisme des agents territoriaux
qui ont su se mobiliser au service de la décentralisation.
Les effectifs de la fonction publique territoriale s'élèvent
à
1,46 million d'agents
en 1996, contre 1,84 million dans la
fonction publique de l'État et 847.000 dans la fonction publique
hospitalière. La fonction publique territoriale représente ainsi
35,2 % de l'ensemble des effectifs de la fonction publique
française.
De 1980 à 1996, les effectifs des agents territoriaux ont
augmenté de 36 %, cette augmentation étant de 14 % pour
la fonction publique de l'État et 21 % dans la fonction publique
hospitalière. Cette différence tient à la jeunesse
relative de la fonction publique territoriale, créée il y a seize
ans.
Près de 30 % des personnels des collectivités territoriales
ou de leurs établissements publics sont des agents contractuels. Cette
proportion élevée provient en partie du fait que les transferts
de compétences de l'État aux collectivités territoriales
n'ont pas donné lieu aux transferts nécessaires de
personnels ; les collectivités ont donc dû faire face dans
l'urgence à des besoins nouveaux.
Alors que les élus locaux devraient avoir à leur disposition les
moyens humains, matériels, financiers et leur permettant de mettre en
oeuvre les politiques publiques locales dans l'intérêt
général, force est de constater que les règles
régissant la fonction publique territoriale à l'heure actuelle ne
remplissent pas les
impératifs d'efficacité et de
souplesse.
La création de la fonction publique territoriale, très
récente comparée à celle de la fonction publique
d'État, n'a pas suffisamment pris en compte les besoins
spécifiques des collectivités locales (I). La construction
statutaire est aujourd'hui caractérisée par des dispositions
statutaires et réglementaires inadaptées et rigides (II),
aggravées par les incertitudes croissantes concernant le volume de
l'emploi public territorial (III).
I. UNE CONSTRUCTION STATUTAIRE LABORIEUSE QUI N'A PAS SUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Les lois
de décentralisation
195(
*
)
prévoyaient la mise en place d'un statut de la fonction publique
territoriale. Il s'agissait de lutter contre l'
extrême
diversité et la précarité
caractérisant
la situation des agents des collectivités locales et de doter les
collectivités locales de moyens humains à la mesure de leur
récente liberté de gestion et de leurs nouvelles
compétences. Dès 1978, notre collègue M. Christian Bonnet,
alors ministre de l'Intérieur, avait élaboré des
dispositions législatives en ce sens.
Trois textes essentiels fondent en 1983-1984 le nouveau statut de la fonction
publique territoriale : la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la
formation des agents de la fonction publique territoriale.
Ces lois tendent à créer une fonction publique unique tout en
reconnaissant deux versants paritaires et spécifiques. Elles constituent
un profond bouleversement de la situation statutaire des personnels des
collectivités locales.
Malgré les principes équilibrés affirmés par le
législateur en 1984, la construction statutaire, longue et difficile,
s'est en partie écartée du principe fondamental de
spécificité des collectivités locales.
A. LES PRINCIPES POSÉS EN 1984 : UNITÉ, PARITÉ... SPÉCIFICITÉ
1. L'unité de la fonction publique territoriale
Premier principe affirmé par le législateur en 1984, l'unité de la fonction publique signifie que fonctionnaires de l'Etat et fonctionnaires des collectivités locales sont soumis à des règles communes en ce qui concerne leurs droits et obligations. Elle se traduit par l'existence d'un statut commun pour l'ensemble des personnels communaux, départementaux et régionaux, l'institution d'un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, la création de centres communs de gestion (centre national et centres départementaux) et l'organisation d'une formation commune à tous les agents des collectivités.
2. La parité entre les fonctions publiques
Le
principe de parité
signifie l'égalité de traitement
entre fonctionnaires de l'Etat et fonctionnaires territoriaux. Il se manifeste
en 1983-1984 principalement
196(
*
)
par :
- l'adoption du titre premier du statut général de la fonction
publique, définissant les droits et obligations communs aux trois
fonctions publiques ;
- l'affirmation du principe de
mobilité
197(
*
)
entre les fonctions publiques (mise à
disposition
198(
*
)
lors de la constitution des
corps, détachement, intégration, concours interne, tour
extérieur, changement de corps) ;
- la mise en place d'une parité des rémunérations,
principales et accessoires.
Le principe de parité entre les fonctions publiques, s'il a pour
fondement légitime de donner une référence pour la
détermination des droits et l'attribution d'avantages aux agents
publics, présente de nombreux effets pervers, en particulier la
quasi-impossibilité pour une collectivité territoriale de
récompenser les efforts de productivité et les mérites
individuels de ses agents
; de plus, les comparaisons
opérées entre corps de l'État et cadres d'emplois de la
fonction publique territoriale soulèvent des difficultés
pratiques et n'est pas adaptée aux spécificités des
collectivités locales.
3. La spécificité de la fonction publique territoriale
La
reconnaissance de la
spécificité des collectivités
locales
devait être la contrepartie de l'uniformisation
découlant des deux principes précédents, unité et
parité. Le législateur devait donc concilier les garanties
accordées aux agents et le principe de la libre administration des
collectivités locales.
Afin de tenir compte de l'existence de
50.000 employeurs locaux
,
les structures de gestion de la fonction publique territoriale et les
prérogatives reconnues à chaque collectivité pour la
gestion de son personnel distinguent la " territoriale " de la
fonction publique de l'État.
B. LA DIFFICILE MISE EN PLACE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
La
construction statutaire de la fonction publique territoriale devait être
effective en quatre années, mais ne s'est achevée qu'en
août 1994 avec la publication par voie réglementaire des derniers
statuts particuliers prévus par le législateur.
Le retard pris dans l'achèvement des statuts particuliers
tient
en grande partie aux difficultés politiques inhérentes à
la gestion de la fonction publique, chaque majorité gouvernementale
ayant à coeur de rendre les règles relatives à la fonction
publique territoriale conformes à sa conception de la
décentralisation et de la plus ou moins grande liberté qu'elle
souhaite reconnaître aux collectivités locales.
En effet, le Conseil constitutionnel a admis dès le
20 janvier 1984 que
la gestion des personnels constituait un
élément de l'application du principe constitutionnel de la libre
administration des collectivités territoriales
. En
conséquence, le droit de la fonction publique territoriale ne peut
être édicté que par le législateur. C'est pourquoi
plus de vingt lois sont venues modifier profondément ou partiellement la
loi statutaire du 26 janvier 1984.
Toutefois, les mesures réglementaires très nombreuses sont elles
aussi à l'origine de l'allongement considérable du délai
de la construction statutaire.
La loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, dite " loi
Galland ", modifiant les dispositions relatives à la fonction
publique territoriale, a permis de mieux adapter certaines des solutions
retenues par la loi du 26 janvier 1984. Elle a donné l'occasion au
Sénat d'affirmer sa conception de la fonction publique territoriale :
- il n'y a pas de contradiction entre l'adaptation de la fonction publique
territoriale à la grande diversité des collectivités
locales, et son rattachement pour l'essentiel aux principes
généraux de la fonction publique ;
- l'unicité du statut de la fonction publique territoriale est elle
aussi compatible avec les adaptations nécessaires à la
diversité des collectivités ;
- la distinction du grade et de l'emploi, fondement du système de la
carrière, est confirmée ; le retour au système de
l'emploi n'est donc pas envisagé ;
- les obligations des fonctionnaires territoriaux en terme de secret et de
discrétion professionnels ou de discipline doivent être
affirmées ;
- un recrutement direct pour certains emplois doit être possible ;
- il faut renforcer le principe de mobilité des fonctionnaires entre les
différentes collectivités locales.
S'agissant de la mobilité entre les deux fonctions publiques de l'Etat
et des collectivités territoriales, la comparabilité entre les
corps, fortement contestable, a été abandonnée à
l'initiative du Sénat, qui a substitué au système rigide
et inadapté des " corps comparables " celui des
"
cadres d'emplois
", plus souple et plus conforme au principe
de spécialité des collectivités territoriales ;
- enfin, l'existence de statuts particuliers nationaux, regroupant les
fonctionnaires titulaires de grades donnant vocation à occuper les
mêmes emplois, n'est pas remise en cause.
Ces positions ont été réaffirmées lors du
débat préparatoire à la loi n° 94-1134 du
27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives
à la fonction publique territoriale, adoptée à
l'initiative de notre collègue M. Daniel Hoeffel, alors ministre
délégué à l'aménagement du territoire et aux
collectivités locales. Il s'agit de la dernière loi à
avoir modifié en profondeur le statut des agents territoriaux.
II. DES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET RÉGLEMENTAIRES INADAPTÉES ET RIGIDES
La
parité entre les fonctions publiques ne devrait s'entendre que s'il
existe une comparabilité entre les missions exercées par les
fonctionnaires de l'État et par ceux des collectivités
territoriales. Or, la spécificité du pouvoir local implique que
ces tâches ne soient pas identiques.
Le rapport remis en octobre 1992 par M. Jacques Rigaudiat, conseiller
référendaire à la Cour des comptes, pour une modernisation
de la fonction publique territoriale, en arrive au même constat :
"
il convient de respecter la spécificité des
collectivités locales afin de leur donner la souplesse nécessaire
à la mise en place de politiques modernes de personnel, adaptées
aux réponses que les élus locaux doivent apporter aux attentes de
nos concitoyens
".
Pourtant, les atteintes portées à l'autonomie des
autorités locales ont été multiples ; elles ont
été dénoncées par le Sénat dès
1984
199(
*
)
. En effet, la contradiction possible
entre le principe de parité entre les fonctions publiques et le principe
de spécificité des collectivités territoriales a
été " résolue " par une nette
prédominance du premier sur le second.
La transposition du modèle de la fonction publique de l'Etat, en
particulier la gestion collective qu'elle implique, entraîne des
contraintes et des rigidités inutiles dans la gestion des personnels
territoriaux.
L'inadaptation des règles de la fonction publique territoriale se
traduit par a lourdeur des procédures (A) et les limites des
institutions (B), mais aussi les contraintes pesant sur les
rémunérations au nom du principe de parité (C),
l'encadrement du recrutement contractuel (D), l'inadéquation des statuts
particuliers aux nouveaux besoins des collectivités locales (E), ces
problèmes étant parfois exacerbés dans les
départements d'outre-mer (F).
A. DES PROCÉDURES TRÈS LOURDES
Les élus locaux sont souvent confrontés aux rigidités du statut 200( * ) , alors que la diversité des statuts et des métiers constitue une richesse de la fonction publique territoriale qui devrait être préservée.
1. Le recrutement et le système du concours
Le
recrutement de personnes compétentes en nombre suffisant est essentiel
pour les collectivités locales, dans la mesure où l'Etat a
tendance à leur transférer sans cesse de nouvelles
responsabilités.
L'entrée dans la fonction publique territoriale s'effectue
en
principe par concours,
afin de respecter les principes
d'égalité d'accès aux emplois publics et de transparence.
Toutefois, les exceptions
201(
*
)
se multiplient
à la base et au sommet de la hiérarchie. La
spécificité de la fonction publique territoriale a conduit
à développer les
concours sur titres
, plutôt que de
systématiser les concours sur épreuves, et au système des
"
concours de réserve
". S'il permet de donner toute
liberté de choix à l'autorité chargée de recruter,
ce système a abouti à la multiplication des
"
reçus-collés
" : tous les lauréats
des concours ne sont pas nommés et ils perdent ainsi le
bénéfice du concours.
Le rapport sur le recrutement, la formation et le déroulement de
carrière des agents territoriaux, remis en mai 1998 par
M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil
d'Etat, met en évidence le caractère
" déconcertant " de l'organisation des concours, lié
à l'enchevêtrement des compétences entre le Centre national
de la fonction publique territoriale et les centres de gestion, à la
multiplicité des mesures de publicité des concours, voire aux
illégalités parfois constatées dans les nominations aux
emplois supérieurs.
Les principales critiques émises par ce rapport à l'encontre du
recrutement par concours sont les suivantes :
- la procédure de recrutement est excessivement longue, il
s'écoule entre trop de temps entre la déclaration de vacance d'un
poste par une collectivité territoriale et le moment où le
recrutement devient possible. Ce délai a été
institué afin de favoriser la promotion interne.
- il existe une contradiction entre l'existence d'un statut national et le
caractère local du recrutement. La
centralisation
excessive de
l'organisation des concours génère un coût financier
important ;
- le
manque de transparence
et de coordination dans l'organisation
des concours, souvent dénoncé, est préjudiciable autant
aux candidats qu'aux collectivités employeurs ;
- de nombreux agents territoriaux confirmés ne peuvent
accéder au grade supérieur en raison de l'
inadaptation de
certaines épreuves
du concours au contexte professionnel.
2. La formation
La
formation est inhérente au système de la carrière. Elle
permet de préparer les futurs fonctionnaires aux tâches de service
public. Or, elle suscite de nombreux mécontentements.
En particulier, un agent qui vient d'être recruté par une
collectivité ne peut prendre poste immédiatement. La
contradiction entre les besoins immédiats des employeurs et la
formation initiale des fonctionnaires, organisée après leur
recrutement
, est une source majeure de dysfonctionnements.
La plupart des fonctionnaires suivent une formation en deux temps : une
formation initiale préalable à la titularisation et une formation
d'adaptation à l'emploi après la titularisation. Quant aux
administrateurs, leur formation initiale a lieu après réussite au
concours, avant la nomination dans une collectivité territoriale.
De plus, l'effort de formation des collectivités territoriales peut
sembler insuffisant au regard de celui de l'Etat ; il représente
1 % de la masse salariale dans les collectivités locales contre 3
à 6 % pour l'Etat employeur. Ces chiffres traduisent en partie la
difficulté qu'éprouvent les collectivités locales à
trouver une offre de formation adaptée à leurs besoins.
3. Le déroulement de carrière et la mobilité
La
gestion des fonctionnaires est décentralisée
, dans la mesure
où chaque collectivité ou établissement détient la
maîtrise de la création des emplois, du recrutement et de la
gestion des agents.
La " loi Galland " du 13 juillet 1987 a institué les
cadres d'emplois
,
qui constituent une spécificité
de la fonction publique territoriale par rapport aux
corps
de la
fonction publique de l'État. Chaque collectivité crée les
cadres d'emplois dont elle a besoin et les gère librement ; ces
cadres d'emplois ne sont pas hiérarchisés entre les niveaux
départemental, régional ou national comme le sont les corps
d'Etat. Nomination, titularisation, affectation, mutation, promotion et
procédure disciplinaire relèvent de la seule décision de
l'autorité territoriale.
Le
système de la carrière
202(
*
)
signifie que la suppression d'un emploi ne peut
entraîner le licenciement du fonctionnaire qui l'occupe : celui-ci
reste rattaché par son grade au cadre d'emplois dont il
relève ; il a
droit à occuper un autre emploi
.
Le système de la carrière est relativement facile à mettre
en oeuvre pour l'Etat qui est employeur unique. Mais la multiplicité des
employeurs territoriaux complique singulièrement la tâche dans la
fonction publique territoriale, notamment pour les petites
collectivités :
quid
de la petite commune qui
délègue un service public local, supprime les emplois
correspondants et se voit obligée d'offrir aux fonctionnaires
concernés d'autres emplois ? La
mutualisation du droit à
la carrière
a constitué une réponse (voir
infra
, les incidents de carrière).
Le système de la carrière ménage une certaine
mobilité géographique ou inter-collectivité
, en
raison de l'existence de seuils démographiques
203(
*
)
, de quotas de promotion au sein des cadres d'emplois
ou entre les cadres d'emplois, ou des positions statutaires comme le
détachement, la mise à disposition, la disponibilité.
Institués par la voie réglementaire, les
seuils
démographiques
sont imposés pour le recrutement de certains
agents, afin d'assurer la parité entre les déroulements de
carrière malgré la diversité des collectivités.
Ils restreignent la possibilité pour les collectivités
territoriales de reconnaître le mérite de leurs agents et les
responsabilités effectivement exercées. Ils constituent une
contrainte forte qui
méconnaît la réalité des
communes qui se situent en deçà des seuils démographiques
mais connaissent une expansion forte
. Ils pénalisent les
collectivités petites et moyennes qui, ne pouvant promouvoir leurs
agents, sont condamnées à voir partir les plus
expérimentés d'entre eux vers les grandes collectivités.
Le
système des quotas de promotion interne et de promotion de
grade
limite la proportion des agents d'un cadre d'emplois susceptibles de
bénéficier d'un avancement. Il transpose dans les
collectivités locales les pyramidages statutaires en vigueur dans la
fonction publique de l'État. Il paraît à bien des
égards incompréhensible et générateur de pesanteur
administrative et d'inégalités entre collectivités.
La mobilité au sein de la fonction publique territoriale est
entravée par certaines dispositions inadaptées, comme
l'interdiction de la mobilité entre filières au sein de la
même collectivité
.
Quant à la mobilité entre fonctions publiques, elle est quasiment
inexistante des administrations territoriales vers l'Etat, en raison d'une
absence de volonté politique et du corporatisme caractérisant
certains corps d'Etat.
4. Les incidents de carrière
Lorsqu'un fonctionnaire se trouve
privé
d'emploi
, il
est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale
s'il relève de la catégorie A et par le centre de gestion s'il
relève des catégories B ou C. La loi impose toutefois des
règles contraignantes à la collectivité qui supprime un
emploi : obligation de garder en surnombre le fonctionnaire
intéressé pendant une année, versement au centre de
gestion ou au CNFPT d'une contribution dégressive, etc. En contrepartie,
le fonctionnaire ne peut refuser plus de trois offres d'emplois sous peine de
licenciement.
La " décharge de fonctions "
204(
*
)
, rebaptisée "
fin de
détachement sur un emploi fonctionnel
" en 1994, désigne
la possibilité pour une collectivité territoriale de se
séparer d'un fonctionnaire occupant un emploi dit
" fonctionnel ", c'est à dire l'un des emplois de
responsabilité désignés dans la loi
205(
*
)
. Le fonctionnaire déchargé de ses
fonctions peut demander à être pris en charge par le Centre
national de la fonction publique territoriale
206(
*
)
ou à bénéficier d'une
indemnité de licenciement.
La principale critique adressée au système de prise en charge des
fonctionnaires momentanément privés d'emploi consiste en
l'absence de responsabilisation des différents acteurs
.
B. DES INSTITUTIONS QUI ONT MONTRÉ LEURS LIMITES
La
fonction publique territoriale est dotée d'institutions visant à
assurer une cohérence dans l'application des règles statutaires
par les 80.000 employeurs potentiels d'agents territoriaux.
Outre le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui
remplit une fonction consultative auprès du Gouvernement et une mission
d'étude et de traitement statistique, il s'agit du centre national de la
fonction publique territoriale, des centres de gestion et de la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales.
1. Le CNFPT
Le
Centre national de la fonction publique territoriale, établissement
public à compétence nationale, regroupe toutes les
collectivités et leurs établissements qui emploient au moins un
agent.
A la fois organe d'aide à la gestion et organe de formation, il organise
les concours des catégories A et B, gère la bourse nationale de
l'emploi, prend en charge les fonctionnaires de catégorie A
privés d'emploi, assure la conception, la programmation et la mise en
oeuvre de toutes les actions de préparation aux concours et examens, de
formation initiale, de formation d'adaptation à l'emploi, de formation
continue et de formation personnelle. Les collectivités locales versent
1 % de leur masse salariale au CNFPT au titre de ces actions de formation.
Fort contesté, le CNFPT se voit reprocher un mode de fonctionnement
très centralisé ; le manque d'autonomie de ses
échelons déconcentrés ; la diversité de ses
missions, éclatées entre la formation et la gestion ; ainsi
que des erreurs de gestion, aggravant le ressentiment à l'égard
de la charge financière obligatoire qu'il constitue pour les
collectivités locales.
2. Les centres de gestion
Les
centres de gestion regroupent obligatoirement les communes et
établissements publics communaux employant moins de
350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet.
L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et
établissements.
Les centres de gestion, dont l'implantation est départementale,
gèrent la bourse de l'emploi, prennent en charge les fonctionnaires des
catégories B et C privés d'emploi, organisent des concours et
examens professionnels et peuvent dispenser des actions de formation. L'absence
de réelle coordination des actions des centres départementaux de
gestion est préjudiciable aux collectivités qui ont recours
à leurs services.
3. La CNRACL : une situation financière inquiétante
Comme
l'ensemble du régime de retraite par répartition, le
régime spécial des agents de la fonction publique territoriale
est pénalisé par une évolution démographique
préoccupante. Pourtant, la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales (CNRACL) a initialement été
excédentaire, avant que les mécanismes de solidarité
auxquels elle participe, notamment la surcompensation, ne réduise ses
marges financières jusqu'à engendrer des problèmes de
trésorerie inquiétants.
La CNRACL comptait 2,9 actifs affiliés pour un retraité en
1997, 2,7 pour un en 1998 et
2,6 actifs pour un retraité en
1999
. La dégradation du rapport démographique va persister,
en raison de l'augmentation de 3,5 % par an du nombre de retraités,
due à l'allongement de l'espérance de vie et à
l'arrivée des classes d'âge nombreuses à l'âge de la
retraite, alors que le nombre d'actifs n'augmente que de 1 % par an,
à savoir 2 % dans la fonction publique territoriale et une stagnation
dans la fonction publique hospitalière.
La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales
207(
*
)
est
contributeur net
au
titre des deux mécanismes de solidarité.
En 1999, la
compensation a coûté 5,3 milliards de francs aux
collectivités territoriales employeurs et la surcompensation
5,5 milliards.
Au total, la CNRACL contribue à hauteur de
19 milliards de francs
, soit 30 % de ses emplois.
Après des recettes exceptionnelles en 1997, une série de mesures
adoptées en octobre 1999 se sont donné pour objectif de financer
la Caisse à hauteur de 6 milliards de francs : l'augmentation
de la cotisation employeur et la diminution progressive du taux
d'appel
208(
*
)
, c'est-à-dire le taux de
surcompensation. Si la situation financière de la CNRACL peut être
considérée comme rétablie jusqu'en 2001, de nouvelles
solutions doivent être trouvées pour l'avenir. Les titularisations
prévues par le protocole d'accord récemment conclu pour les
hôpitaux publics devraient générer 10.000 cotisants
supplémentaires à l'horizon 2001. L'équilibre des comptes
de la CNRACL en 2002 pourrait être atteint par ce moyen.
C. LES RÉMUNÉRATIONS SONT CONTRAINTES AU NOM DU PRINCIPE DE PARITÉ
Les
dispositions statutaires et réglementaires régissant la fonction
publique territoriale ne donnent pas lieu à une concertation suffisante
avec les employeurs locaux chargés de les appliquer.
La principale illustration en est la politique des rémunérations
dans la fonction publique. Au nom des principes d'unité et de
parité entre fonctions publiques, l'État définit la valeur
du point fonction publique par des négociations avec les syndicats de
fonctionnaires, sans inviter les élus locaux à participer
à ces négociations.
En conséquence, les élus se voient imposer des dépenses de
personnel considérables, qui atteignent 36 % des dépenses de
gestion des collectivités locales, en hausse sensible (+6,7 % en 1999).
Ces charges, sur lesquelles les collectivités locales n'ont pas de
prise, ont été aggravées par les effets du protocole
salarial du 10 février 1998.
Pourtant, le législateur a entendu redonner aux collectivités
locales une certaine marge de manoeuvre en matière de
compléments de rémunérations
.
En effet, le principe de parité entre les fonctions publiques,
défini à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984,
ménage le pouvoir indemnitaire des assemblées locales
209(
*
)
. Cependant, le décret d'application n'a
été publié que le 6 septembre 1991. Aussi, entre
la loi de janvier 1984 et le décret de septembre 1991, les
collectivités ont versé des primes à leurs agents dans la
plus grande incertitude juridique. Dans le même temps, le
législateur a autorisé le maintien des avantages collectivement
acquis avant 1984 (article 111 de la loi statutaire), par exception au
principe de parité.
Le Gouvernement fait valoir qu'un décret du
26 décembre 1997, créant une indemnité
d'exercice de missions des préfectures, permet aux collectivités
territoriales qui souhaitent le transposer de servir en pratique des
indemnités supérieures à celles versées par
l'État à ses agents (dans la mesure où l'État ne
verse pas les indemnités maximales), tout en restant dans le cadre du
principe de parité entre les fonctions publiques.
Deux difficultés subsistent malgré la réponse ainsi
apportée par voie réglementaire :
- les collectivités territoriales qui avaient créé des
indemnités après 1984, en raison de l'incertitude juridique
liée à l'absence de décret d'application, sont
inquiétées par les chambres régionales des comptes alors
que la carence est le fait du pouvoir réglementaire ;
- les élus locaux n'ont aucune certitude que cette indemnité
d'exercice de missions des préfectures sera maintenue dans la
durée.
D. LE RECRUTEMENT DE CONTRACTUELS EST FORTEMENT ENCADRÉ
Les
collectivités territoriales emploient 3
86.000 agents
non-titulaires
(hors contrats emploi-solidarité) dont 43.000
relèvent de la catégorie A
210(
*
)
, 54.000 de la catégorie B et 284.000 de
la catégorie C (enquête annuelle de l'INSEE, chiffres au
31 décembre 1996).
Or, le recrutement d'agents contractuels par les collectivités
territoriales est soumis à des règles cumulatives strictes,
issues de la fonction publique de l'État : une
délibération de l'assemblée locale doit procéder
à la création d'emploi ; il ne doit pas exister de corps de
fonctionnaires apte à assurer les fonctions correspondantes ; pour
les emplois de catégorie A,
la
nature des fonctions
ou
les
besoins du service
doivent justifier le recours à un
contractuel.
Toutefois, certains cas ouvrent, dans la fonction publique territoriale, la
possibilité de recourir à l'emploi contractuel :
- pour assurer le remplacement momentané de titulaires exerçant
leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un
congé maladie, d'un congé de maternité, etc. ;
- pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour
une durée maximale de six mois ;
- dans les petites communes, pour pourvoir des emplois permanents à
temps non complet correspondant à 31 h 30 de travail par semaine au
maximum ;
- pour certaines tâches déterminées : assistantes
maternelles agréées, contrats emploi-solidarité, emplois
jeunes, etc.
Le pouvoir d'appréciation des juges
est considérable pour
déterminer si les besoins du service justifient le recours à
l'emploi contractuel. Ce rôle des juges est renforcé par une
jurisprudence récente du Conseil d'État. Par un arrêt
" Ville de Lisieux "
211(
*
)
du
30 octobre 1998, celui-ci a admis le
recours des tiers à
l'encontre des contrats de recrutement des agents non titulaires
. Cet
arrêt pourrait aboutir à une systématisation regrettable
des recours à l'encontre des actes des collectivités locales,
dans un domaine particulièrement sensible.
M. Didier Lallement, directeur général des collectivités
locales au ministère de l'Intérieur, s'exprimant devant la
mission, a reconnu les difficultés d'interprétation actuelles
concernant le recrutement de personnels sous contrat à durée
déterminée pour l'exercice d'une activité qui ne
relève pas d'un cadre d'emploi statutaire.
Mais en réponse, le Gouvernement envisage des négociations sur
la
résorption de l'emploi précaire
dans la fonction
publique.
Une " nouvelle vague de titularisations " semble se profiler,
alors que les collectivités territoriales recourent
précisément aux non-titulaires pour retrouver en pratique une
certaine capacité d'adaptation aux nouveaux besoins que les statuts
particuliers ne peuvent satisfaire.
E. L'INADÉQUATION DES STATUTS PARTICULIERS AUX NOUVEAUX BESOINS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Les
besoins des collectivités locales en personnel qualifié sont
accrus par les attentes des concitoyens. Or, les " nouveaux
métiers " appellent de
nouvelles compétences qui ne
trouvent pas encore leur place dans les statuts particuliers
. De plus,
certaines fonctions anciennes sont remises en cause du fait de
l'évolution des contraintes pesant sur les collectivités. Tel est
le cas notamment des emplois de direction et de la fonction de juriste
territorial.
S'agissant des emplois supérieurs de la fonction publique territoriale,
M. Didier Duraffourg, président du syndicat national des
secrétaires généraux et des directeurs
généraux des collectivités locales, entendu par la
mission, a estimé
insuffisante la définition statutaire des
emplois de direction
des collectivités territoriales, celle-ci se
contentant d'indiquer que les secrétaires généraux
étaient chargés, sous l'autorité du maire, de diriger
l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation. Il a
regretté qu'en l'absence de clarification législative ou
réglementaire, une abondante jurisprudence tende de plus en plus
à définir les responsabilités des titulaires de la
direction générale.
La définition par voie réglementaire des statuts particuliers de
la fonction publique territoriale trouve ainsi sa limite lorsque celui-ci n'est
pas en mesure de s'adapter avec la réactivité nécessaire
aux évolutions des métiers et des compétences.
F. LE CAS PARTICULIER DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
1. La surrémunération est un frein à l'embauche
La surrémunération des fonctionnaires outre-mer, régie par la loi du 3 avril 1950, désigne l'application au traitement des fonctionnaires d'un coefficient multiplicateur fixé à 40 % en Guadeloupe, Guyane et Martinique et 53 % à la Réunion. Lors de la mission d'information 212( * ) de la commission des Lois du Sénat dans les départements d'outre-mer, les maires ont souligné le poids très lourd des rémunérations des fonctionnaires pour les finances communales et la difficulté, voire l'impossibilité, de titulariser les nombreux contractuels en raison du coût élevé du régime de rémunération applicable aux titulaires. Cette situation conduit en outre à interdire toute nouvelle embauche aux collectivités locales, qui de ce fait ne peuvent plus jouer le rôle de soutien à l'emploi qu'elles remplissaient autrefois.
2. Les indemnités d'éloignement
L'État commence à réexaminer le
coût des
rémunérations de la fonction publique outre-mer... pour ses seuls
agents. En effet, tandis que le " rapport Lise-Tamaya " avait
préconisé le plafonnement de l'indemnité
d'éloignement attribuée aux agents de catégorie A en
service en métropole et recevant une affectation dans les
départements d'outre-mer, lors du débat sur le projet de loi
d'orientation pour l'outre-mer en juin 2000, l'Assemblée nationale,
approuvée par le Sénat
213(
*
)
, a
invité le Gouvernement à
supprimer les indemnités
d'éloignement
allouées aux fonctionnaires de l'État
affectés dans les départements d'outre-mer en application du
titre premier du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953
portant aménagement du régime de rémunération des
fonctionnaires de l'État en service dans les départements
d'outre-mer
214(
*
)
.
Ces indemnités d'éloignement, instituées à
l'origine en raison des difficultés liées à la longueur
des voyages et aux conditions de vie matérielles dans les
départements d'outre-mer à cette époque, n'apparaissent
plus justifiées. Cependant, le débat sur le coût des
rémunérations dans la fonction publique territoriale ultramarine
reste ouvert.
3. L'emploi de non-titulaires
Selon un
rapport de l'Inspection générale de l'administration, les
effectifs non titulaires dans les départements d'outre-mer
représentent environ 30.000 personnes, soit 68,3 % des agents
employés par les collectivités locales.
L'hétérogénéité caractérise leur
situation juridique.
En particulier, à la Réunion, les 11.600
journaliers
communaux
, embauchés sans aucun statut, demandent aujourd'hui leur
intégration dans la fonction publique territoriale. Compte tenu de la
surrémunération de 53 %, le coût de cette
titularisation est évalué à un milliard de francs pour les
communes. L'association des maires de la Réunion propose donc de
définir un statut particulier pour les journaliers communaux et de
reclasser ces personnels sur la base des rémunérations de la
fonction publique métropolitaine.
L'IGA a dénoncé " l'indulgence " de l'État, qui
a laissé se développer l'emploi local non statutaire sans rien
entreprendre pour promouvoir une solution spécifique et homogène.
Tout en écartant, pour des raisons budgétaires, la titularisation
des agents en place, l'IGA propose de doter les agents non titulaires d'un acte
formel d'engagement, de définir des principes rigoureux pour les
recrutements futurs, d'instituer des éléments de paritarisme et
de mieux organiser la carrière de ces personnels.
S'il paraît inopportun de titulariser les agents contractuels sur la base
des rémunérations des titulaires, en raison d'un coût
financier très lourd, la définition d'un véritable statut
des contractuels devra être examinée.
III. LES INCERTITUDES QUANT AU VOLUME DE L'EMPLOI PUBLIC TERRITORIAL
Deux phénomènes majeurs subordonnent le volume de la masse salariale des collectivités locales sans que celles-ci n'en maîtrisent l'évolution : il s'agit de l'extension par l'État de la notion d'agent public (A) et des impératifs démographiques induisant à terme un besoin de renouvellement des effectifs (B).
A. L'EXTENSION DE LA NOTION D'AGENT PUBLIC CRÉE DES CHARGES POUR LES COLLECTIVITÉS EMPLOYEURS
1. La réduction de la possibilité pour les collectivités de recruter sur des contrats de droit privé
Les
incertitudes liées à la
définition même
d'agent public
sont en partie à l'origine de l'inflation des
dépenses de personnel : aux augmentations d'effectifs doit
être ajouté le développement des emplois
" parapublics ".
Les augmentations d'effectifs ne seraient pas critiquables si elles
résultaient des seuls choix des employeurs locaux, confrontés aux
exigences nouvelles de leurs concitoyens. Mais elles résultent de
politiques menées par l'État, dont les conséquences
financières, qui n'ont pas été évaluées,
pèsent sur les décisions locales.
En particulier, la solution retenue par la " jurisprudence
Berkani "
215(
*
)
, à savoir
l'extension considérable de la
notion d'agent public
, a
été imposée par la loi du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
malgré l'avis très défavorable du Sénat,
représentant constitutionnel des collectivités locales.
La loi impose ainsi aux collectivités territoriales le recrutement
contractuel de leurs agents non-titulaires sous un
régime de droit
public
et pour une
durée indéterminée
. Les
agents déjà en fonctions disposeront d'un droit d'option entre un
contrat de droit privé et le passage au " contrat de droit public
à durée indéterminée ". Mais, à
l'avenir, les collectivités locales n'auront plus le choix du mode de
recrutement de leurs agents de catégorie C entrant dans le champ
d'application de la loi.
2. Une rigidité accrue de la gestion des personnels
Lors du
débat parlementaire, le Sénat
216(
*
)
s'était inquiété des conditions
dans lesquelles ces contrats de droit public à durée
indéterminée pourront être conclus, gérés et
rompus le cas échéant. Il avait donc supprimé cette
disposition, contraire au principe de libre administration des
collectivités territoriales.
De plus, il avait attiré l'attention du Gouvernement sur les
difficultés particulières des agents non titulaires occupant
plusieurs emplois permanents à temps non complet au regard du principe
d'interdiction du cumul des activités et des rémunérations
dans le secteur public
.
Lors de son audition devant la mission, interrogé sur la
" jurisprudence Berkani " du Tribunal des conflits,
M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil
d'État, auteur du rapport sur le recrutement, la formation et le
déroulement de carrière des agents territoriaux, s'est
demandé si cette jurisprudence ne contraindrait pas le Gouvernement
à proposer " un statut des contractuels ", tout en soulignant
la
contradiction fondamentale entre le statut et le contrat.
Force est de constater que la " simplification " censée
être apportée par la " jurisprudence Berkani " est
sérieusement battue en brèche par l'existence d'exceptions non
négligeables, au premier rang desquelles les emplois jeunes
217(
*
)
.
La mission d'information renvoie aux travaux en cours du groupe de travail de
la commission des Affaires sociales du Sénat sur l'avenir des emplois
jeunes, présidé par notre collègue Alain Gournac. Elle
constate que la perspective de leur intégration dans la fonction
publique territoriale suscite l'inquiétude légitime des
employeurs territoriaux, en raison du coût financier d'une telle
mesure.
B. LE RENOUVELLEMENT DES EFFECTIFS
Les
départs à la retraite des agents publics vont atteindre des
proportions jamais égalées : d'ici à 2012, la
moitié des agents civils de l'État vont partir à la
retraite ; la proportion est plus faible dans la fonction publique
territoriale mais reste significative.
En ce qui concerne les prévisions de départs à la
retraite
218(
*
)
, il convient de distinguer d'une
part, la fonction publique de l'État
219(
*
)
et la fonction publique hospitalière,
où le problème est majeur et immédiat, d'autre part la
fonction publique territoriale, où le problème du remplacement se
pose avec un peu moins d'urgence. Toutefois, deux correctifs doivent être
apportés : le corps des administrateurs territoriaux est
vieillissant ; la faiblesse des données statistiques disponibles
empêche de mesurer avec précision l'ampleur du renouvellement
à venir.
L'âge moyen des agents de la fonction publique territoriale est de
43 ans et celui des administrateurs de 50 ans, appelant dans les huit
prochaines années le remplacement de la moitié des
administrateurs.
Les
départs massifs à la retraite
des agents publics
doivent être anticipés. Le remplacement des agents sortants ne
doit pas être automatique mais permettre à chaque
collectivité de redéfinir l'affectation des personnels en
fonction des besoins du service public Les départs à la
retraite nécessitent l'institution d'une véritable politique de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
,
fondée sur un diagnostic des besoins à moyen terme. En fonction
des besoins, la reconversion éventuelle
des agents doit
être encouragée. La GPEC doit permettre de définir les
actions de formation et les programmes de recrutement pour les dix ou quinze
ans à venir, voire d'envisager les réformes législatives
adéquates.
En effet, en l'état actuel des textes, il est peu probable que les
collectivités locales employeurs disposent des outils statutaires leur
permettant de faire face aux besoins en personnel qualifié que vont
générer ces départs. L'ampleur du phénomène
devrait conduire à
s'interroger sur les adaptations à apporter
au statut
.
CHAPITRE V
UN SYSTÈME DE FINANCEMENT
QUI NE GARANTIT PAS
L'AUTONOMIE LOCALE
La
décentralisation n'a pas bouleversé l'architecture du
système de financement local. Elle a confirmé le partage des
ressources entre fiscalité directe et dotations de l'Etat, tout en
procédant à certaines réformes de nature à
renforcer l'autonomie financière des collectivités locales (I).
Depuis, les liens entre les collectivités locales et les contribuables
locaux se sont progressivement distendus, tout d'abord en raison de la prise en
charge croissante des impôts locaux par l'Etat, puis par la
réduction de l'assiette des impôts locaux ou de la capacité
des collectivités à en voter le taux (III).
L'accroissement de la prise en charge par l'Etat de la fiscalité locale
s'est accompagnée d'une politique restrictive en matière de
dotations budgétaires, les concours de l'Etat aux collectivités
locales évoluant moins vite que, d'une part, le coût des
compétences qui leur ont été transférées et,
d'autre part, que les dépenses obligatoires que l'Etat met à leur
charge (II). L'absence de vision d'ensemble et la logique strictement
budgétaire qui régissent les relations financières entre
l'Etat et les collectivités locales conduisent à penser que les
finances locales sont la variable d'ajustement du budget de l'Etat (IV).
Malgré les déclarations d'intention, le poids des ressources
consacrées à la péréquation reste modeste. Les
quelques avancées se traduisent par des mécanismes de
redistribution des ressources entre collectivités plutôt que par
une amélioration du caractère péréquateur des
concours de l'Etat (V).
Au total, le contrôle par l'Etat des ressources locales s'accroît,
au point de remettre en cause la capacité des collectivités
locales à s'administrer librement (VI).
I. LA NOUVELLE DONNE DE LA DÉCENTRALISATION
A. L'HÉRITAGE DU " PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES RESPONSABILITÉS LOCALES "
La
décentralisation, en matière de finances locales, n'a pas
commencé en 1982.
Le 8 avril 1978 a débuté au Sénat, en première
lecture, la discussion de deux projets de lois
220(
*
)
dont l'objet était de refondre le
système de financement des collectivités locales. Ces textes
constituaient, selon l'expression du ministre de l'intérieur de
l'époque, le premier acte de la mise en oeuvre d'un "
plan de
développement des responsabilités locales
"
destiné à définir de "
nouveaux rapports entre
l'Etat et les collectivités locales
". Ce plan était
porté par le ministre de l'intérieur, notre collègue M.
Christian Bonnet.
Le projet du gouvernement de M. Raymond Barre comportait trois volets. D'une
part, il s'agissait d'aller au bout de la tradition française de
financement des collectivités locales par la fiscalité, en
conférant aux collectivités la possibilité de voter les
taux des impôts directs qu'elles perçoivent.
D'autre part, il était prévu de moderniser le principal concours
financier de l'Etat en transformant le versement représentatif de la
taxe sur les salaires en une dotation globale de fonctionnement, dotée
de mécanismes de répartition péréquateurs.
Une fois ces deux étapes franchies, il était envisagé,
dans un troisième temps, d'élaborer un texte destiné
à "
d'une part, donner aux collectivités locales une
plus grande liberté dans l'exercice de leurs compétences ;
d'autre part, transférer vers elles un certain nombre de
compétences aujourd'hui assumées par l'Etat.
".
Les
principales orientations du " projet Bonnet " présenté
au Sénat
le 8 novembre 1978
-
"
aucune norme ne pourra être imposée par l'Etat à
une collectivité locale à l'occasion notamment de l'octroi de tel
ou tel concours financier. Seule la loi pourra le faire.
" ;
- "
en matière financière, les collectivités
locales disposeront d'une liberté totale, sous réserve, bien
entendu, chacun le comprendra, que leur budget soit équilibré et
que leur ratio d'endettement ne dépasse pas un certain seuil. Dans la
même perspective d'allégement des tutelles, l'étude du
principe d'une certaine globalisation des subventions spécifiques
d'équipement est activiement poussée
" ;
- "
introduire plus de clarté dans les rapports entre l'Etat et
les collectivités locales, alléger les procédures et
assurer, au niveau le plus convenable, la solution de certains problèmes
par le transfert d'un certain nombre de compétences
" ;
- "
créer des blocs de compétences exclusives mettant
fin, dans toute la mesure du possible, aux compétences croisées,
sources de dilution des responsabilités
" ;
- "
chaque fois que des compétences seront
transférées aux départements ou aux communes, jugés
mieux à même de les assurer, les ressources correspondantes seront
transférées du budget de l'Etat à celui des
collectivités locales.
"
Cette démarche a été menée à son terme, par
deux gouvernements successifs. La loi de finances pour 1979 a supprimé
le versement représentatif de la taxe sur les salaires, qui a
été remplacé par la dotation globale de fonctionnement
issue des dispositions de la loi du 3 janvier 1979. Cette dotation a
conservé le caractère de prélèvement sur les
recettes de l'Etat, réaffirmant ainsi le principe d'un financement des
collectivités locales par la fiscalité.
La loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité
directe locale constitue aujourd'hui le socle des règles applicables en
matière de vote des taux des impôts directs locaux par les
collectivités locales. Elle a également jeté les bases des
mécanismes de péréquation des ressources fiscales en
créant le fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle (FNPTP).
Le troisième volet du plan Bonnet, celui relatif à la
répartition des compétences entre l'Etat et les
collectivités locales, a été repris dans ses grandes
lignes par la majorité issue des élections de 1981, et par le
gouvernement de notre collègue M. Pierre Mauroy.
A cette occasion, il n'a pas été procédé à
un réexamen d'ensemble des charges des collectivités locales et
des recettes qui permettent de les financer . Les charges nouvelles ont
été isolées et financées par des ressources
spécifiques. Pour respecter la tradition française, ces
ressources sont principalement fiscales, l'Etat transférant certains
impôts aux collectivités, et peuvent être
complétées par des dotations budgétaires .
B. UN RENFORCEMENT DE L'AUTONOMIE FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS
Le
symbole de la décentralisation en matière de finances locales est
le vote des taux de leur fiscalité directe par les exécutifs
locaux. Auparavant, les collectivités ne votaient que des produits et
les services fiscaux se chargeaient d'en déduire les taux correspondants.
La consécration du pouvoir fiscal des collectivités locales a
constitué une étape nouvelle dans la mise en oeuvre du principe
de libre administration affirmé à l'article 72 de la Constitution
de 1958
221(
*
)
et à ouvert la voie aux
innovations résultant des lois de décentralisation.
En s'inspirant de la formulation de l'article 72, l'article premier de la loi
du 2 mars 1982 dispose que "
les communes, les départements et
les régions s'administrent librement par des conseils
élus
". Plusieurs dispositions traduisent concrètement
la réaffirmation de ce principe :
- les actes budgétaires deviennent exécutoires de plein droit.
Ils restent toutefois soumis à un contrôle budgétaire
exercé par le préfet, qui ne peut saisir les nouvelles chambres
régionales des comptes que si un budget à été
voté ou exécuté en déséquilibre, si une
dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou si
un budget n'a pas été adopté dans les délais. Pour
le reste, les collectivités votent librement leurs budgets ;
- le principe du vote des taux a été étendu aux
impôts transférés aux collectivités locales en
contrepartie des transferts de compétence
222(
*
)
. Depuis l'ordonnance n° 86-1243 du
1
er
décembre 1986 relative à la liberté des
prix et de la concurrence, les collectivités peuvent également
fixer librement les tarifs des services publics (sauf en matière de
transport urbain et de cantines scolaires) ;
- après la dotation globale de fonctionnement, les subventions
d'équipement font également l'objet d'une tentative de
globalisation à travers la création de la dotation globale
d'équipement (DGE) ;
- les élus locaux ordonnateurs peuvent réquisitionner leur
comptable s'il refuse de payer une dépense ou de percevoir une
recette ;
- les régimes de contrôle et d'approbation préalable en
matière d'emprunt ont été supprimés, même si
les emprunts ne peuvent toujours servir à rembourser d'autres dettes.
Les restrictions en matière financières ont progressivement
été levées mais le processus est toujours en cours, de
manière résiduelle. Par exemple, la loi du 26 décembre
1999 relative à la prise en compte des résultats du recensement
dans les dotations de l'Etat aux collectivités locales a supprimé
l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur pour les
emprunts obligataires à l'étranger.
II. LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE CHARGES : THÉORIE ET PRATIQUE
Les
collectivités locales ont été diversement
concernées par les transferts de compétences opérés
au cours des années 80 :
- les transferts aux
communes
portent sur les compétences des
services communaux d'hygiène et de santé, le mode de calcul des
contingents d'aide sociale, la participation des communes aux dépenses
d'enseignement, l'organisation des transports scolaires, les
bibliothèques municipales, l'élaboration des documents
d'urbanisme et la délivrance des autorisation d'utilisation du sol, et
les ports de plaisance. Avant leur transfert, l'exercice de ces
compétences coûtait à l'Etat
1,4 milliard de francs
par an ;
- les transferts aux
départements
portent sur l'action sociale et
la santé, la planification scolaire, la construction,
l'équipement et le fonctionnement des collèges (loi du 22 juillet
1983 et du 25 janvier 1985), les transports scolaires (loi du 22 juillet 1983),
les bibliothèques départementales (loi du 22 juillet 1983), les
ports et les cultures marines. Avant leur transfert, l'exercice de ces
compétences coûtait à l'Etat
44,8 milliards de
francs
par an.
- les transferts aux
régions
portent sur la formation
professionnelle et l'apprentissage (loi du 7 janvier 1983, loi du 23 juillet
1987, loi quinquennale du 20 décembre 1993, loi du 19 décembre
1989), la construction, l'équipement et le fonctionnement des
lycées, des établissements d'éducation spéciale,
des écoles de formation maritime et aquacole et des lycées
d'enseignement agricole, les ports fluviaux et les voies navigables
(optionnel), les aides au renouvellement et à la modernisation de la
pêche côtière et les aides aux entreprises de culture
marine. Avant leur transfert, l'exercice de ces compétences
coûtait à l'Etat
14,1 milliards de francs
par an.
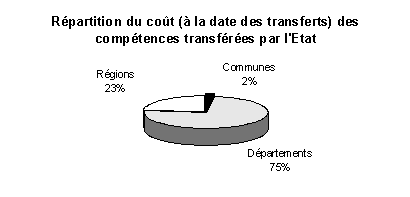
Les transferts de compétences réalisés en application des
lois de décentralisation reposent sur un
principe clair
: le
transfert simultané aux collectivités des ressources
nécessaires à l'exercice de ces compétences
.
A. LES PRINCIPES DE LA COMPENSATION
1. Une compensation intégrale à la date du transfert
Le code
général des collectivités territoriales détermine
les règles applicables en matière de compensation
financière des transferts de compétences, et notamment que :
- "
tout accroissement net des charges résultant des transferts
de compétences
(...)
est accompagné du
transfert
concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux
régions
des ressources nécessaires à l'exercice
normal
de ces compétences
" (article L. 1614-1) ;
- "
ces ressources sont équivalentes aux dépenses
effectuées,
à la date du transfert
, par l'Etat au titre
des compétences transférées et évoluent chaque
année, dès la première année, comme la dotation
globale de fonctionnement.
Elles assurent la compensation intégrale
des charges transférées
" (article
L. 1614-1) ;
- "
toute charge nouvelle incombant aux collectivités du fait de
la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles
relatives à l'exercice des compétences transférées
est compensée
" (article L. 1614-2) ;
- "
le montant des dépenses résultant des accroissements
et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité
par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis
d'une
commission présidée par un magistrat de la Cour
des
comptes et comprenant des
représentants de chaque catégorie de
collectivités
concernées
" (article L. 1614-3)
Cette commission a vu le jour sous le nom de " commission consultative sur
l'évaluation des charges ". Outre le magistrat de la Cour qui la
préside, elle est composée de huit représentants des
communes, quatre représentants des conseils généraux et
quatre représentants des conseils régionaux. Son
secrétariat est assuré par la direction générale
des collectivités locales du ministère de l'intérieur.
2. Une compensation constituée au moins pour moitié par des ressources fiscales
Le code
général des collectivités territoriales définit
également les modalités de la compensation :
- "
les charges
(...)
sont compensées par le transfert
d'impôts d'Etat
(...)
et, pour le
solde
, par l'attribution
d'une dotation générale de décentralisation
"
(article L. 1614-4) ;
- "
les transferts d'impôts d'Etat représentent
la
moitié au moins
des ressources attribuées par l'Etat
à l'ensemble des collectivités locales
" (article
L. 1614-5) ;
- "
les
pertes de produit fiscal
résultant, le cas
échéant, pour les départements ou les régions, de
la modification, postérieurement à la date des transferts
impôts et
du fait de l'Etat
, de l'assiette ou des taux de ces
impôts sont
compensées intégralement
,
collectivité par collectivité
(...)
par des attributions
de dotation de décentralisation
" (article L. 1614-5).
Les impôts d'Etat transférés aux collectivités
locales par l'article 99 de la loi du 7 janvier 1983 ont
été :
- pour les départements : d'une part, la taxe sur les
véhicules à moteur (vignette) et, d'autre part, les droits
d'enregistrement et la taxe de publicité foncière exigibles sur
les mutations à titre onéreux (droits de mutation) ;
- pour les régions : la taxe sur les certificats d'immatriculation
des véhicules à moteur (cartes grises).
La loi de 1983 a exclu le financement par la fiscalité des
compétences transférées aux communes.
B. LES AMBIGUÏTÉS D'UN SYSTÈME COMPLIQUÉ
1. Le mode de calcul des compensations ne permet pas une compensation intégrale
a) Le calcul des compensations repose sur la distinction entre l'évolution théorique et l'évolution réelle des ressources et charges transférées
Le mode
de calcul des compensations retenu par les lois de décentralisation
repose sur un postulat de départ ambigu, et à l'origine de la
grande complexité du système.
Il part en effet du principe
que, à compter du transfert de compétence, le coût de leur
exercice pour les collectivités locales n'augmentera pas plus vite que
la dotation globale de fonctionnement
(DGF). Comme pour confirmer le bien
fondé de cette approche, le code général des
collectivités territoriales ajoute que les montants ainsi
calculés "
assurent la compensation intégrale des charges
transférées
".
Or, comme il a été choisi d'assurer principalement la
compensation des transferts de compétences par la dévolution aux
collectivités locales d'impôts d'Etat, dont l'évolution du
produit est totalement déconnectée de celle de la DGF, un
écart apparaît entre le montant théorique des ressources
transférées aux collectivités et leur montant réel,
qui résulte de l'évolution des bases des impôts
transférés. De même, rien n'assure que le coût
réel des compétences transférées soit
équivalent à leur coût théorique, résultant
de l'indexation sur la DGF du coût de la compétence au moment du
transfert.
En outre, il est important de rappeler que,
en 1983, la DGF était
indexée sur l'évolution du produit de la taxe sur la valeur
ajoutée
, qui est l'un des impôts au rendement le plus
dynamique. Depuis 1990, les modalités d'indexation de la DGF ont
été modifiées à de nombreuses reprises, dans un
sens moins favorable que l'indexation sur la TVA. Par ailleurs, le mode de
calcul de cette dotation doit désormais prendre en compte les
opérations de " recalage de la base " et de
régularisation de son montant, dans les conditions prévues aux
articles L. 1613-1
et
L. 1613-2
du code général des
collectivités territoriales.
La complexification du mode de calcul de la DGF s'est accompagnée d'une
réduction de son rythme d'évolution. Par conséquent, s'il
était concevable en 1983 de lier l'évolution de la compensation
des transferts de compétences à une dotation dont le montant
évoluait en fonction du produit d'un impôt assis sur les
transactions et l'activité économique, la pertinence de ce lien
n'apparaît plus aussi nettement aujourd'hui.
Le tableau ci-dessous confirme que les écarts, tant en dépenses
qu'en recettes, entre les montants théoriques et les montants
réels s'accentuent depuis l'entrée en vigueur des lois de
décentralisation, et que les montants théoriques sont toujours
inférieurs aux montants réels.
Financement des transferts de compétences : écarts entre théorie et pratique
|
|
1984 |
1990 |
1996 |
|
Départements |
|
|
|
|
Coût théorique/coût réel des compétences transférées |
0,94 |
0,89 |
0,73 |
|
Produit théorique/produit réel de la fiscalité transférée |
0,98 |
0,62 |
0,86 |
|
Régions |
|
|
|
|
Coût théorique/coût réel des compétences transférées |
0,93 |
0,44 |
0,46 |
|
Produit théorique/produit réel de la fiscalité transférée |
0,78 |
0,46 |
0,40 |
Données chiffrées : Commission consultative sur l'évaluation des charges, rapport au Parlement, 1999.
Les
écarts entre les montants réels et les montants théoriques
ont conduit la commission consultative sur l'évaluation des charges
(CCEC) à élaborer une double comptabilisation :
- d'une part, la CCEC a mis en place un
suivi de l'évolution
théorique des transferts de charge
, par l'analyse de
l'évolution théorique du coût des compétences (qui
détermine le " droit à compensation " des
collectivités locales) et le suivi du " produit
théorique " de la fiscalité transférée et de
l'évolution de la dotation générale de
décentralisation (DGD), qui est la seule variable de ce système
dont l'évolution réelle est la même que son
évolution théorique, c'est-à-dire le taux de progression
de la DGF.
Contrairement aux dispositions du code général des
collectivités territoriales, la DGD ne finance pas seule le
" solde " entre le coût des compétences et le produit de
la fiscalité transférée. Elle est complétée
par une DGD spécifique au financement de la formation professionnelle et
par deux dotations d'équipement, la dotation régionale
d'équipement scolaire (DRES) et la dotation départementale
d'équipement des collèges (DDEC). Ces deux dernières
dotations ne sont d'ailleurs pas indexées sur la DGF mais sur
l'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations
publiques ;
- d'autre part, la CCEC assure le suivi des
évolutions
réelles
du coût des compétences
transférées et du produit de la fiscalité
transférée. Toutefois, elle ne le fait que " pour
information ", l'ensemble du système d'évaluation des
transferts de charges reposant sur les évolutions fictives.
Il arrive cependant que le réel et le fictif se recoupent. Ainsi,
l'
article L. 1614-4
du code général des
collectivités territoriales prévoit que si le produit fictif de
la fiscalité transférée se révèle
supérieur au coût théorique des compétences
transférées, il est procédé à un
prélèvement sur le produit
réel
de la
fiscalité transférée, d'un montant égal à la
différence entre les deux montants
théoriques
.
b) Cette distinction n'a pas permis une compensation intégrale des charges transférées
Pour les
gestionnaires locaux, il est surtout important que l'évolution
réelle des recettes transférées soit
en
adéquation avec l'évolution du coût réel des
compétences.
Il ressort du tableau ci-dessous que
les recettes transférées
augmentent beaucoup moins vite que les charges transférées
.
Ainsi, alors que les charges transférées étaient 1,4 fois
supérieures aux recettes transférées en 1987, elles
étaient 2 fois supérieures en 1996. Entre ces deux dates, le
coût des compétences transférées a augmenté
de 111 % alors que les recettes transférées n'ont
augmenté que de 39,6%.
Evolution des recettes et des dépenses
transférées par les lois de décentralisation
(en millions de francs)
|
|
1987 |
1996 |
Evol. en % |
|
Recettes
|
44.583
|
62.258
|
39,6
|
|
Dépenses
|
62.563
|
132.423
|
111,6
|
|
Coût des compétences transférées / recettes transférées |
1,4 |
2,1 |
|
*
Source : Commission consultative sur l'évaluation des charges,
rapport au Parlement , 1999.
** Source : Les collectivités locales en chiffres, DGCL,1999.
En
réalité, l'écart entre l'évolution des
dépenses et des recettes n'est pas aussi important. En effet, les
départements assumaient déjà 52 % des dépenses
d'aide sociale et 62 % des dépenses de transport scolaire
dès avant le transfert des ces compétences. En sens inverse, les
régions percevaient déjà 35 % du produit de la taxe
sur les cartes grises avant le transfert de cet impôt.
Par conséquent, pour avoir une idée de l'évolution de
l'adéquation entre l'évolution des recettes et des
dépenses, il faut prendre en compte uniquement l'évolution des
recettes et des dépenses que les collectivités ont acquis au
moment des lois de décentralisation :
- pour les départements, il faut établir le montant de ce que la
CCEC appelle les " dépenses de référence ", en
déduisant du coût des compétences transférées
la fraction de ces compétences qu'ils exerçaient avant le
transfert ;
- pour les régions, il faut établir le montant des
" recettes de référence ", en ne prenant en compte que
l'évolution de la fraction du produit de la taxe sur les cartes grise
antérieurement perçue par l'Etat.
Même avec cette méthode, il apparaît que les compensations
ont été défavorables aux collectivités locales, du
moins aux départements et aux régions
223(
*
)
:
-
la compensation des transferts de charges aux départements
Entre 1985 et 1994, les départements ont globalement
bénéficié du mode de compensation des transferts de
charges. Toutefois, à partir de 1991,
le poids des dépenses
d'action sociale s'est accru
, notamment sous l'effet de la montée en
puissance des dépenses de revenu minimum d'insertion (qui n'ont pas
donné lieu à compensation), et, dans le même temps, le
rendement des impôts transférés a décru. Depuis
1995, le coût des compétences transférées est
supérieur aux recettes transférées.
Le ratio coût des compétences transférées/ressources
transférées est passé de 1,26 en 1989 à 0,89 en
1996.
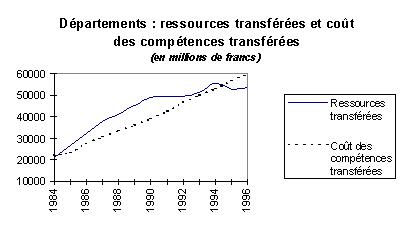
Source : Commission consultative sur l'évaluation des charges, rapport au Parlement, 1999.
Ce résultat global masque toutefois d'importantes disparités territoriales . La tableau ci-dessous retrace, pour l'année 1996, le rapport entre le montant réel des ressources transférées et le coût réel des compétences transférées pour chacun des départements métropolitains. Lorsque le ratio est supérieur à 1, le montant des ressources transférées est supérieur à celui des charges :
Départements : ressources transférées/coût réel des compétences transférées en 1996
|
1,02 à 1,81 |
Hautes-Alpes (05) ; Aude (11) ; Cantal (15) ; Charente-Maritime (17) ; Corrèze (19) ; Corse (20) ; Côtes d'Armor (22) ; Indre-et-Loire (37) ; Loire-Atlantique (44) ; Lozère (48) ; Haute-Marne (52) ; Meurthe-et-Moselle (54) ; Haute-Saône (70) ; Yonne (89) ; Territoire de Belfort (90) ; Corse du Sud ; Haute Corse ; Paris |
|
0,93 à 1,02 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) ; Calvados (14) ; Charente (16) ; Cher (18) ; Creuse (23) ; Dordogne (24) ; Drôme (26) ; Gard (30) ; Ille-et-Vilaine (35) ; Jura (39) ; Haute-Loire (43) ; Lot (46) ; Lot-et-Garonne (47) ; Meuse (55) ; Morbihan (56) ; Moselle (57) ; Orne (61) ; Pyrénées-Atlantiques (64) ; Seine-Maritime (76) ; Deux-Sèvres (79) ; Haute-Vienne (87) ; Vaucluse (84) ; Vosges (88) |
|
0,89 à 0,93 |
Allier (03) ; Ardèche (07) ; Ardennes (08) ; Aveyron (12) ; Hérault (34) ; Indre (36) ; Landes (40) ; Manche (50) ; Nièvre (58) ; Hautes-Pyrénées (65) ; Bas-Rhin (67) ; Saône et Loire (71) ; Yvelines (78) ; Vendée (85) |
|
0,82 à 0,89 |
Alpes-Maritimes (06) ; Côte d'Or (21) ; Doubs (25) ; Eure (27) ; Finistère (29) ; Gers (32) ; Gironde (33) ; Isère (38) ; Loir-et-Cher (41) ; Loire (42) ; Marne (51) ; Nord (59) ; Oise (60) ; Pas-de-Calais (62) ; Rhône (69) ; Sarthe (72) ; Savoie (73) ; Somme (80) ; Tarn et Garonne (82) ; Val de Marne (94) |
|
0,57 à 0,82 |
Ain (01) ; Aisne (02) ; Ariège (09) ; Aube (10) ; Bouches-du-Rhône (13) ; Eure-et-Loir (28) ; Haute-Garonne (31) ; Loiret (45) ; Puy-de-Dôme (63) ; Maine-et-Loire (49) ; Mayenne (53) ; Pyrénées-Orientales (66) ; Haut-Rhin (68) ; Haute-Savoie(74) ; Seine (75) ; Seine-et-Marne (77) ; Tarn (81) ; Var (83) ; Vienne (86) ; Essonne (91) ; Hauts-de-Seine (92) ; Val d'Oise (95) |
Source : commission consultative sur
l'évaluation des
charges, rapport au Parlement, 1999.
-
la compensation des transferts de charges aux régions
Contrairement aux départements, les régions ont toujours
été pénalisées par le mode de compensation des
compétences transférées, sauf en 1984 et 1985. Par
ailleurs, le ratio coût des compétences
transférées/ressources transférées n'a cessé
de se dégrader, passant de 0,96 en 1986 à 0,66 en 1996.
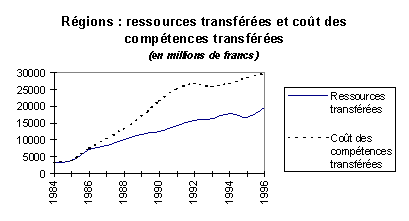
Source : Commission consultative sur l'évaluation des charges,
rapport au Parlement, 1999
A la différence des départements,
toutes les régions
sont " pénalisées " par le système de
compensations
puisque, en 1996, les dépenses
transférées étaient supérieures aux recettes
transférées dans l'ensemble des régions
métropolitaines :
Régions : ressources transférées/coût réel des compétences transférées en 1996
|
Alsace |
0,95 |
Champagne-Ardenne |
0,81 |
Midi-Pyrénées |
0,74 |
|
Aquitaine |
0,62 |
Franche-Comté |
0,71 |
Nord-Pas-de-Calais |
0,74 |
|
Auvergne |
0,66 |
Haute-Normandie |
0,49 |
Pays-de-la-Loire |
0,50 |
|
Basse-Normandie |
0,70 |
Ile-de-France |
0,66 |
Picardie |
0,60 |
|
Bourgogne |
0,73 |
Languedoc-Roussillon |
0,64 |
Poitou-Charentes |
0,60 |
|
Bretagne |
0,68 |
Limousin |
0,69 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
0,78 |
|
Centre |
0,47 |
Lorraine |
0,92 |
Rhône-Alpes |
0,55 |
Source : Commission consultative sur l'évaluation des charges, rapport au Parlement, 1999.
2. La remise en cause du principe du financement par la fiscalité
Le
premier alinéa de l'
article L. 1614-5
du code
général des collectivités territoriales prévoit que
"
au terme de la période visée à l'article 4
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée
[3 ans],
les transferts d'impôts d'Etat représentent la moitié au
moins des ressources attribuées par l'Etat à l'ensemble des
collectivités locales
".
La rédaction de cet alinéa appelle trois remarques
préalables :
- tout d'abord, la référence à un délai de trois
ans peut-être interprétée de deux manières. Au
premier abord, il peut être compris que la loi accorde un délai de
trois ans pour satisfaire l'obligation d'un financement des compétences
transférées constitué pour moitié au moins par des
ressources fiscales.
La commission consultative sur l'évaluation des charges semble retenir
une interprétation différente. Dans son rapport au Parlement de
1999, elle indique en effet qu' "
il peut être
observé qu'à l'issue du processus de transferts de
compétences dans les délais prescrits à l'article 4 de la
loi du 7 janvier 1983, c'est-à-dire dans un délai maximum de
trois ans après son entrée en vigueur, le principe de l'article
L. 1614-5 a été respecté.
". Cette
interprétation est sujette à caution car on se demande pourquoi
le législateur aurait pris la peine d'apporter cette précision si
la règle ne devait s'appliquer que pendant une période
très courte
224(
*
)
;
- il est précisé que la proportion de 50 % de ressources fiscales
s'applique "
à l'ensemble des collectivités
locales
", et non à chacune des catégories de
collectivités locales. Cette rédaction est cohérente avec
le choix de financer exclusivement par dotations budgétaires les
transferts de compétences en direction des communes. Elle implique donc
que les départements ou les régions pourraient être
financés majoritairement par des dotations budgétaires si, au
total, les ressources fiscales représentent plus de 50 % des
crédits transférés à l'ensemble des
collectivités ;
- l
'article L. 1614-5
ne précise pas si le pourcentage de
50 % s'applique aux recettes théoriques ou aux recettes
réelles des collectivités. Néanmoins, compte tenu du
fonctionnement du dispositif de compensation, on peut penser qu'il s'agit du
produit théorique.
L'analyse de la structure des recettes transférées montre que la
règle de 50% n'est plus respectée depuis 1988 s'agissant des
recettes théoriques. Pour les recettes réelles, la règle
était encore respectée en 1998, dernière année
avant le début du processus de réduction des taux des droits de
mutation.
Part des ressources fiscales dans les ressources transférées
(en %)
|
|
1984 |
1988 |
1992 |
1998 |
1999 |
|
Produit théorique |
|
|
|
|
|
|
Départements |
58,4 |
59,6 |
59,5 |
59,2 |
51,2 |
|
Régions |
41,5 |
18,4 |
18,3 |
15,5 |
13,3 |
|
Ensemble des collectivités |
55,3 |
49,7 |
49,6 |
47,6 |
40 |
|
Produit réel |
|
|
|
|
|
|
Départements |
58,7 |
74,5 |
74,5 |
65,4 |
- |
|
Régions |
57,7 |
37,6 |
40,7 |
40,5 |
- |
|
Ensemble des collectivités |
57,6 |
64,8 |
64,3 |
66,2 |
- |
Données chiffrées : Commission consultative sur l'évaluation des charges, rapport au Parlement, 1999
L'écart entre les deux séries de chiffres
figurant
dans le tableau précédent s'explique surtout par le fait que
l'assiette réelle des impôts transférés a
évolué beaucoup plus rapidement que le taux de progression de la
DGF sur lequel est indexé le produit théorique. Par ailleurs, le
produit théorique de la taxe sur les cartes grises
transférée au région a été sous
évalué en 1983, au moment du transfert, contribuant ainsi
à minorer la part de la fiscalité dans les ressources
théoriques des régions.
Au delà du respect du seuil de 50 % prévu par le code
général des collectivités territoriales, la
réduction de la part des ressources fiscales dans les ressources
transférées témoigne du fait que, passée la
première vague des transferts de compétences,
le financement
budgétaire des transferts, conçu au départ comme un solde,
est progressivement devenu la norme
:
-
les nouveaux transferts n'ont pas donné lieu à des
transferts de fiscalité mais à des majorations de dotation
générale de décentralisation (DGD)
. Ainsi, pour ne
citer que les exemples ayant de fortes implications financières, le
transfert aux régions de la compétence en matière de
formation professionnelle intervenu en 1985 a eu pour effet de réduire
de 41 % à 21 % la part de la fiscalité dans les ressources
théoriques transférées des régions et de 60 %
à 38 % la part de la fiscalité dans les ressources réelles
transférées. De même, la régionalisation de la
compétence ferroviaire se traduit par des majorations de DGD ;
-
l'assiette et le taux des impôts transférés sont
progressivement réduits
. Dès 1998, l'élargissement de
l'assiette de la taxe à l'essieu perçue par l'Etat a eu pour
conséquence de réduire le produit de la vignette, malgré
la mise en place d'une compensation dont ne connaît pas encore les
modalités définitives.
De manière plus significative, le gouvernement a entrepris, depuis la
loi de finances pour 1999, une politique de réduction et d'unification
des taux des droits de mutation qui, outre qu'elle a supprimé au passage
le pouvoir des départements de voter les taux de ces impôts, a
entraîné une diminution importante de la part de la
fiscalité dans les ressources transférées. Il s'en suivra
également un ralentissement de l'évolution du montant des
ressources transférées, puisque les départements perdent
une recette fortement soumise aux aléas du marché immobilier mais
qui évoluait globalement plus vite que la DGD, à laquelle la
compensation a été intégrée.
3. Le régime de compensation est-il respectueux de la libre administration des collectivités locales ?
Dans son
rapport au Parlement de 1997, la commission consultative sur
l'évaluation des charges estime que "
le raisonnement tendant
à mettre au regard des dépenses effectivement engagées
dans les domaines des compétences transférées les concours
de l'Etat est peu convaincant au regard des principes de la
décentralisation et des revendications des collectivités locales
en matière de décentralisation et d'autonomie
".
Elle ajoute qu'il n'est "
pas possible, sauf à
méconnaître les principes de la décentralisation, de
considérer qu'une dépense réalisée localement doit
être entièrement couverte par une dotation de transfert
".
A l'appui de ces affirmations, elle constate que :
- les compensations étaient intégrales à la date du
transfert ; l'augmentation du coût des compétences
résulte de décision des collectivités, qui ont
été libres "
de décider, postérieurement,
des dépenses supplémentaires, ce qu'elles ont d'ailleurs
fait
" ;
- le choix de compenser les transferts de compétences par des transferts
d'impôts a permis "
aux nouvelles collectivités
compétentes, en raison du dynamisme de l'assiette et de la
liberté de fixation des taux d'imposition qui leur était
accordée, d'adapter ces ressources transférées à
leurs besoins
".
- la comparaison de l'évolution des charges et des ressources
transférées relève d'une analyse "
historiquement
erronée
" qui "
méconnaît la logique
institutionnelle née de la décentralisation et le poids des
charges supportées par la collectivité indépendamment des
transferts de charges résultant de la décentralisation
".
Un tel raisonnement n'apparaît pas totalement recevable pour au moins
quatre raisons :
-
il
part du principe que les collectivités auraient dû
assurer les compétences transférées de manière
identique à celle dont l'Etat les exerçait
antérieurement.
Dans cette logique, les collectivités locales
n'auraient jamais pu, voire dû, réaliser de leur propre initiative
les efforts qu'elles ont faits en matière par exemple, de
rénovation, d'entretien et d'équipement des établissements
scolaires.
Cette conception est pourtant encore à l'oeuvre en 2000 puisque le
montant de la compensation versée aux régions en contrepartie de
la régionalisation de la compétence ferroviaire,
généralisée par le projet de loi relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains examiné par le Parlement
au printemps 2000, a été calculé à partir d'une
étude réalisée six ans plus tôt par un cabinet
privé et ne tient pas compte des besoins d'investissement que les
régions devront satisfaire. Pour la première fois, une
compensation ne sera donc même pas intégrale à la date du
transfert ;
-
il juge conforme au principe de libre administration que le transfert de
compétences antérieurement assumées par l'Etat puisse se
traduire par une réduction de la marge de manoeuvre des
collectivités dans l'exercice de leurs compétences
" traditionnelles "
, ce qui est le cas puisque le coût des
compétences transférées n'est plus couvert par montant des
ressources transférées.
En pratique, entre 1987 et 1996, la part des dépenses liées
à l'exercice des compétences transférées dans les
dépenses totales des collectivités locales s'est accrue, passant
de 13,5 % à 17,8 %. Dans le même temps, la part des
ressources transférées dans les ressources totales des
collectivités se réduisait, passant de 9,5 % à
8,3 %. L'exemple de la régionalisation de la compétence
ferroviaire illustre également ce phénomène, puisque les
collectivités devront financer la rénovation des
équipements sur leurs " ressources propres " ;
-
la CCEC est sélective dans son invocation du principe de libre
administration
et de l'esprit des lois de décentralisation. Elle
n'insiste par exemple jamais sur l'échec de la globalisation des
dotations de compensation des transferts de compétence, pourtant au
coeur de l'idée décentralisatrice. Ainsi, en 2000, outre que la
DGD est encore une accumulation de concours particuliers, l'ensemble des
crédits n'y sont pas rassemblés puisqu'il subsiste deux dotations
d'équipement, une dotation spécifique à la formation
professionnelle et des crédits inscrits au ministère de la
culture.
Toutefois, compte tenu de la pratique de l'Etat en matière d'indexation
des dotations, cette entorse aux principes de la décentralisation reste
préférable à une fusion de l'ensemble des dotations,
puisque les deux dotations d'équipement bénéficient d'une
indexation plus favorable que la DGD.
- la justification de l'absence de compensation intégrale des transferts
de charges par l'accroissement des autres charges supportées par la
collectivité nationale constitue un
aveu de taille
:
les
collectivités locales sont donc bel et bien, dans l'esprit des
administrations de l'Etat, la variable d'ajustement des finances publiques.
C. L'ALOURDISSEMENT DES CHARGES NON COMPENSÉES : UN RISQUE POUR LES BUDGETS LOCAUX
1. Les transferts de charges ne concernent pas seulement les domaines mentionnés par les lois de décentralisation
Comme
l'indique la commission consultative sur l'évaluation des charges dans
son rapport au Parlement de 1997, "
la question des charges nouvelles
supportées par les collectivités locales indépendamment
des transferts de compétences constitue désormais le centre des
préoccupations financières des élus locaux. La
stabilisation des budgets locaux et de la fiscalité locale ne peut aller
sans une stabilisation des charges. Or, les collectivités locales
enregistrent des charges nouvelles sur lesquelles elles n'ont parfois aucune
prise
".
La CCEC, dans son rapport au Parlement de 1999, a entrepris d'établir
une typologie de ces charges nouvelles non compensées :
Les " charges nouvelles " des collectivités locales
La
commission consultative sur l'évaluation des charges, dans son rapport
au parlement de 1999, distingue trois catégories de "
charges
nouvelles
", en précisant que cette notion est
"
généralement employée pour qualifier des
transferts non compensés
" :
1. Les charges résultant des législations ou
réglementations de portée générale s'imposant aux
collectivités comme aux autres personnes publiques ou
privées.
Ces charges ont généralement pour origine un objectif de
sécurité qui s'impose aux propriétaires de biens
immobiliers.
Le patrimoine des collectivités locales entre dans le champ
d'application de diverses législations ou réglementations qui
peuvent représenter des coûts importants.
Trois réglementations récentes, peuvent, à cet
égard, être mentionnées :
- le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la
protection de la population contre les risques sanitaires liés à
une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis qui oblige
tous les propriétaires de bâtiments collectifs à effectuer
certaines opérations en vue de rechercher, d'enlever ou de neutraliser
dans leurs constructions la présence d'amiante dans les flocages ou
calorifugeages ;
- les décrets n° 94-699 du 10 août 1994 et n° 96-1136 du
18 décembre 1996 fixant les exigences et les prescriptions de
sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;
- le décret n° 96-495 du 4 juin 1996 sur les exigences de
sécurité des cages de buts de football, de handball, de hockey
sur gazon et en salle et des paniers de basket qui impose au
propriétaire un entretien régulier des équipements,
l'établissement d'un plan précisant la périodicité
des visites de vérification et d'entretien ainsi que la tenue d'un
registre comportant les dates et résultats des contrôles.
2. Les charges liées à des prescriptions européennes
ou nationales destinées à répondre à des exigences
d'intérêt général pour des équipements ou
l'exercice de compétences des collectivités locales.
Ces charges correspondent aux échéances européennes et
nationales imposées pour la mise aux normes de services publics locaux.
Deux domaines représentent actuellement des enjeux financiers
considérables : la collecte et l'élimination des
déchets, d'une part et l'eau et l'assainissement, d'une part.
Pour la gestion des déchets, la loi n° 92-646 du 12 juillet 1992 a
prévu l'interdiction à compter du 1
er
juillet 2002 de
la mise en décharge brute de déchets et la valorisation de 75 %
des emballages ménagers à cette même date. Sa mise en
oeuvre représente un coût financier estimé à 60
milliards de francs d'investissements sans compter les coûts
d'élimination des déchets, c'est à dire leur collecte et
leur traitement, qui passeraient de 100 francs la tonne à un montant
compris entre 300 francs et 600 francs la tonne.
Le rapport de l'Observatoire des finances locales pour 1999, établi par
notre collègue Joël Bourdin, précise qu'en 1998, 85 % des
communes qui ont instauré une taxe ou une redevance
générale, le produit moyen par habitant de celles-ci est
respectivement de 380 et de 243 francs. Par ailleurs, la taxe ne suffit
généralement pas à assurer l'intégralité du
financement du service d'élimination et de traitement des ordures
ménagères de sorte qu'il est souvent procédé
à un abondement budgétaire.
Dans le second secteur, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et la directive
européenne n° 91-271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines, conduisent à la réalisation
d'investissements importants d'ici à 2005.
Le rapport de M. Tavernier " la fiscalité au secours de
l'eau " (AN n° 1807 du 22 septembre 1999) fait ressortir que les
collectivités locales sont à l'origine de plus de 85 % de la
dépense publique dans ce secteur, soit 75,7 milliards de francs en 1997.
L'augmentation globale de la facture d'eau moyenne, de 1991 à 1997,
s'est élevée à 61 % avec des évolutions
différentes pour chacun de ses éléments soit + 29 % pour
la fourniture d'eau, + 58 % pour l'assainissement (principalement du fait de la
directive communautaire de 1991) et + 241 % pour les redevances des agences.
3. Les charges issues de la transposition aux collectivités locales
de diverses décisions.
Certaines décisions prises par l'État et sur lesquelles les
collectivités ont peu ou pas de prise ont des conséquences
financières pour celles-ci.
Il en est ainsi des revalorisations de rémunérations qui, en
application du principe de parité avec la fonction publique d'Etat, sont
transposées à la fonction publique territoriale.
Cette transposition des réformes ou des accords salariaux concernant la
fonction publique d'Etat a un impact financier d'autant plus sensible que les
frais de personnel correspondent à un poste de dépenses
important, en particulier pour les communes.
Le rapport précité de l'Observatoire des finances locales
relève un regain de croissance des frais de personnel des
collectivités du fait principalement des effets du protocole salarial du
10 février 1998 qui a prévu, d'une part, des majorations des
traitements des agents de la fonction publique territoriale et, d'autre part,
une revalorisation des bas salaires. Sur trois exercices, de 1998 à
2000, le coût serait de 9,5 milliards de francs.
Par ailleurs, les collectivités locales doivent prendre en compte,
notamment dans le cadre de leur politique sociale, l'effet de la revalorisation
des minima sociaux.
Ainsi, toute révision du montant du revenu minimum d'insertion (RMI) a
des conséquences financières directes sur les budgets des
départements. Elle se traduit par une augmentation des crédits
destinés au financement des actions d'insertion dont l'article 38 de la
loi du 1
er
décembre 1988 a prévu l'inscription
obligatoire.
Le montant du plafond de ressources pour bénéficier de certaines
prestations d'aide sociale est souvent défini par
référence à des allocations dont le montant est
fixé par l'Etat. Tel est notamment le cas de l'aide à domicile
des personnes âgées dont le bénéfice est
conditionné à des ressources inférieures au minimum
vieillesse. Toute majoration de l'allocation de référence a des
effets sur le public éligible à l'aide sociale
départementale
. "
Les observations de la CCEC sur ces nouvelles charges imposées aux
collectivités locales peuvent être complétées par
deux remarques :
-
les ressources des collectivités locales évoluent moins vite
que leurs charges nouvelles
. La principale ressource de fonctionnement des
communes et des départements est la dotation globale de fonctionnement
(DGF). Or, pour les trois années d'application de l'accord salarial du
10 février 1998, la DGF a augmenté nettement moins vite que le
surcoût provoqué par cet accord
225(
*
)
.
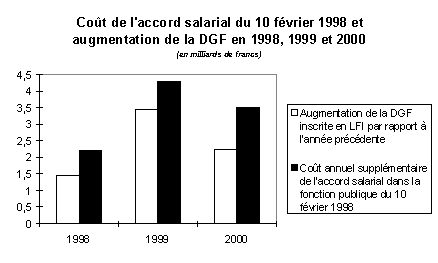
Données chiffrées : lois de finances, rapport sur les
rémunérations dans la fonction publique (PLF 99).
Le surcoût induit par le financement des charges non compensées
peut aboutir à une augmentation de la pression fiscale sur les
contribuables locaux. Ainsi, depuis 1993, le produit de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères a progressé de
près de 7 milliards de francs, le produit de cette taxe augmentant
chaque année de plus de 5 % ;
-
l'Etat incite fortement les collectivités locales à financer
des dépenses qui relèvent de ses compétences
,
notamment en matière d'enseignement supérieur, avec le plan U3M,
et en matière de voirie, notamment dans le cadre des plans
Etat-régions. Lors de son audition par la mission le 8 mars 2000, notre
collègue Jean-Pierre Fourcade, président du comité des
finances locales, a observé qu'à partir de 1987, l'Etat avait
refusé de financer des dépenses qu'il prenait en charge
auparavant, en matière de santé, de construction de routes ou de
travaux sur les bâtiments universitaires.
Les procédures contractuelles permettent par ailleurs à l'Etat
d'orienter les dépenses des collectivités locales tout en se
désengageant financièrement. En effet, la part de l'Etat dans des
contrats représentant des sommes de plus en plus élevées
diminue depuis le début des années 80, comme l'a relevé le
rapport Chérèque de 1998
226(
*
)
,
sans que la marge de manoeuvre des régions pour déterminer le
contenu des contrats se soit véritablement accrue.
2. Un décalage entre les procédures et les enjeux financiers
Malgré l'importance des enjeux financiers liés
aux
transferts de charges non compensés, les décisions à
l'origine de ces charges ne donnent pas lieu à concertation :
- elles échappent, en droit ou en fait, au contrôle
parlementaire
. En droit, lorsqu'elles relèvent du pouvoir
réglementaire. C'est le cas en matière de normes techniques, en
matière de rémunération des agents mais également
de taux de cotisation à la caisse nationale des agents des
collectivités locales (CNRACL). En 2000, les taux des cotisations
" employeurs " ont augmenté, provoquant un coût
supplémentaire de 550 millions de francs pour les collectivités
locales. Le Parlement n'est donc pas en mesure d'influencer la prise de
décision.
En fait car, lorsque de telles dispositions résultent de textes
législatifs, les études d'impact annexées aux projets de
loi sont souvent insuffisantes, comme l'illustre l'exemple de la loi 96-369 du
3 mai 1996 relative à la départementalisation des services
d'incendie et de secours. Le coût de la réforme s'avère
très supérieur aux 11,6 milliards de francs initialement
envisagés. Entre 1998 et 1999, le montant des contributions
demandées aux collectivités locales a progressé de
11 % ;
-
il n'existe pas de procédure de consultation des
collectivités locales
, mise à part, parfois, l'organisation
d'un débat au sein
du comité des finances locales.
Cette procédure n'est d'ailleurs pas exempte d'effets pervers pour les
collectivités locales, comme en témoigne l'exemple des mesures de
redressement financier de la CNRACL décidées à la fin de
l'année 1999. Le comité des finances locales, suivant les
recommandations du groupe de travail qu'il avait constitué sur le sujet,
s'était prononcé en faveur d'une augmentation conjointe des
cotisations " employeurs " et " employés ". Le
gouvernement a finalement décidé de n'augmenter que les
cotisations " employeurs ", mais s'est targué d'agir
conformément aux recommandations du comité.
La loi n° 95-9 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire du 4 février 1995 a souhaité
pallier le manque de concertation dans l'élaboration des
décisions ayant des conséquences financières sur les
collectivités locales par une amélioration de l'information
disponible. Dans ce but, elle a modifié l'
article L. 1613-3
du
code général des collectivités territoriales, dont la
rédaction actuelle prévoit désormais que :
- la commission consultative sur l'évaluation des charges réalise
chaque année un bilan du coût réel des compétences
transférées ;
- la CCEC réalise également un bilan des transferts de charges
non prévus par les lois de décentralisation, "
même
lorsque le législateur a expressément prévu en ces
matières de déroger au principe de la compensation
intégrale
" ;
- le bilan comprend en annexe un "
état de la participation des
collectivités locales à des opérations relevant de la
compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes
intéressant les collectivités locales
".
Ces dispositions n'ont reçu qu'une application partielle. Le premier
rapport de la CCEC en application de l
'article L. 1613-3
du code
général des collectivités territoriales n'est paru qu'en
1997. Il n'a reçu de suite qu'en 1999
227(
*
)
. Par ailleurs, aucun de ces deux rapports ne
comporte d'annexe relative à la participation des collectivités
locales à des opérations relevant de la compétence de
l'Etat.
L'absence de vision d'ensemble de l'évolutions des charges des
collectivités locales
, notamment au regard de l'évolution de
leurs ressources, contribue à
dégrader la qualité du
dialogue
entre les collectivités et l'Etat en encourageant un
véritable " jeu non coopératif " : à chaque
nouveau transfert, les collectivités locales se transforment en effet en
" lobbyistes " soucieux de préserver leurs
intérêts financiers, l'Etat, ayant beau jeu de discréditer
les prétentions maximalistes d'élus locaux peu économes
des deniers publics.
Ce mode de fonctionnement contribue également à encourager une
pratique contraire à l'esprit de la décentralisation, celle des
concours spécifiques
. En effet, l'absence de vision d'ensemble
permet à l'Etat de présenter les problèmes un par un,
conduisant ainsi les collectivités à fragmenter leurs
revendications. L'Etat peut alors consentir à octroyer un concours
spécifique pour résoudre un problème donné, comme
il l'a par exemple fait récemment en créant une sous-dotation au
sein de la dotation globale d'équipement (DGE) des départements
destinées au financement des services départementaux d'incendie
et de secours (SDIS).
III. LE DÉMANTÈLEMENT DE LA FISCALITÉ LOCALE
A. UNE FISCALITÉ LOCALE DE PLUS EN PLUS " VIRTUELLE "
1. Une marge de manoeuvre fiscale de plus en plus réduite
a) La marge de manoeuvre fiscale des collectivités locales ...
La marge
de manoeuvre fiscale des collectivités locales se définit comme
la
capacité des collectivités d'influencer le montant de leurs
recettes fiscales en votant les taux de leurs impôts
. Plus les
impôts considérés représentent une part importante
des recettes des collectivités locales, plus la marge de manoeuvre
fiscale est grande.
La part des recettes fiscales correspondant à des impôts dont les
collectivités locales votent les taux, rapportée aux recettes
totales hors emprunt des collectivités locales françaises, est
importante comparée à celles des autres pays de l'Union
européenne. En 1995, une étude réalisée par le
Crédit local de France faisait apparaître que, au sein de l'Union
européenne, seules les collectivités suédoises avaient une
marge de manoeuvre fiscale (60 %) supérieure à la situation
des collectivités françaises (54 %).
En revanche, les modalités du vote des taux par les collectivités
locales françaises correspondent aux pratiques en vigueur dans l'Union
européenne. Il apparaît en effet que, plus la possibilité
de voter les taux s'applique à une fraction importante des recettes
fiscales des collectivités locales, plus la liberté de voter les
taux est encadrée :
- la
Belgique
, les
Pays-Bas
et la
Grande-Bretagne
accordent une liberté totale en matière de vote des taux, mais
les impôts concernés représentent moins de la moitié
des recettes fiscales des collectivités ;
- à l'inverse, au
Danemark
et en
Italie
, les
collectivités votent les taux de la plupart des impôts qu'elles
perçoivent, mais leur liberté en matière de vote des taux
est encadrée par des mécanismes de plafonnement des taux.
- l'
Allemagne
a le régime le plus restrictif puisque les
collectivités locales supportent un encadrement des taux alors que le
impôts concernés ne représentent qu'une faible part de
leurs recettes fiscales. A l'inverse, en
Espagne
, les
collectivités votent librement les taux d'impôts qui
représentent près de 60 % de leurs recettes fiscales totales.
La situation de la France s'apparente à celle du Danemark et de
l'Italie. Le produit des quatre taxes directes locales représentait en
1999 environ
70 % du total des recettes fiscales des
collectivités
.
Cependant, la liberté des collectivités locales de voter les taux
de leurs impôts connaît des
limites
.
Tout d'abord, l'
article 1636 B septies
du code général des
impôts prévoit, d'une part, que "
les taux des taxes
foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne
peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté
l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble
des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen
constaté au niveau national s'il est plus élevé
"
et, d'autre part, que "
le taux de la taxe professionnelle voté
par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe
constaté l'année précédente au niveau national pour
l'ensemble des communes
".
L'
article 1636 B sexies
dispose aussi que le taux de la taxe
professionnelle acquittée par les entreprises ne peut pas augmenter
plus, ou baisser moins, que le taux de la taxe d'habitation ou, s'il est
inférieur, le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation
et des taxes foncières.
Les collectivités locales n'utilisent pas toujours la possibilité
de faire varier librement les taux de leurs impôts directs qui leur a
été conférée par la loi du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, et continuent
souvent, comme auparavant, à faire varier l'ensemble des taux dans les
mêmes proportions.
Décisions prises en 1999 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en matière de vote des taux
|
|
Communes |
EPCI |
|
Variation dans les mêmes proportions |
31.263 |
943 |
|
Variation différenciée |
5.198 |
172 |
|
Total |
36.678 |
1.710 |
Source : Direction générale des impôts
Le vote
par les différents niveaux de collectivités de taux qui
s'appliquent à une même assiette aboutit parfois à annuler
l'effet pour les contribuables des baisses de taux décidées par
une collectivité.
Ainsi, en 1999, 6,3 % des communes ont diminué les taux de leurs
quatre taxes mais cela s'est traduit dans seulement 3,5 % des communes par
une baisse des taux globaux. Dans 73,9 % des communes, il y a eu
simultanément stabilisation ou augmentation des taux communaux et des
taux globaux. Dans 19,7 % des communes, il y a eu diminution des taux
globaux alors que les communes ne diminuaient pas les leurs, notamment en
raison de la baisse de leurs taux par dix départements et trois
régions.
Si les collectivités locales sont contraintes en matière de
fixation des taux, elles utilisent largement leur capacité de prendre
des délibérations pour accorder aux contribuables locaux des
exonérations
. En matière de taxe d'habitation, 6.894
communes ont décidé en 1999 un abattement général
à la base de 15 %, alors même que le code général
des impôts accorde déjà des exonérations et des
dégrèvements très larges pour les contribuables modestes.
En matière de taxe professionnelle, 10.372 communes,
67 départements et 14 régions ont opté pour
l'exonération de taxe professionnelle en cas de création
d'entreprises industrielles dans les zonages d'aménagement du
territoire. A l'inverse, très peu de communes utilisent leur
possibilité de revenir sur des exonérations accordées par
la loi (seulement 18 ont supprimé l'exonération de taxe
professionnelle dans les zones de revitalisation rurales).
Ces données méritent d'être soulignées car elles
témoignent du fait que les collectivités utilisent les
facultés qui leurs sont accordées en matière de
fiscalité, quand bien même les exonérations qu'elles
accordent ne font pas l'objet d'une compensation financière de la part
de l'Etat.
b) ... se réduit peu à peu
La part
des recettes fiscales correspondant à des impôts dont les
collectivités votent les taux dans leurs recettes totales hors emprunt
s'élevait à 54 % en 1995. Cette proportion est aujourd'hui
inférieure car, en raison de la conjonction de plusieurs
phénomènes, la marge de manoeuvre fiscale des
collectivités locales françaises tend à se réduire :
La suppression de certains impôts
L'article 53 de la loi de finances pour 1993 a supprimé les parts
régionales et départementales de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.
L'article 29 de la loi de finances pour 1999 a supprimé la taxe
additionnelle régionale aux droits de mutation à titre
onéreux, soit plus de 10 % des recettes fiscales totales des
régions.
La loi de finances rectificative pour 2000 supprime la part régionale de
la taxe d'habitation, soit près de 15 % de leurs recettes fiscales
totales et 22 % du produit des quatre taxes.
En deux ans, la suppression de deux impôts perçus par les
régions a réduit d'environ 25 % le montant total des
recettes fiscales des régions.
La suppression de la possibilité de voter les taux
L'article 29 de la loi de finances pour 1999 a réduit le taux des droits
de mutation à titre onéreux des départements sur les
locaux à usage professionnels et, de fait, a supprimé leur
capacité à voter les taux de cet impôt.
L'article 9 de la loi de finances pour 2000 a poursuivi la réforme de
1999 en unifiant les taux départementaux des droits de mutation à
titre onéreux sur les locaux d'habitation.
En matière de vote des taux par les collectivités locales, les
évolutions constatées en métropole contrastent avec celles
de l'outre-mer. A compter de l'entrée en vigueur de la loi d'orientation
pour l'outre-mer discutée au Parlement au printemps 2000, l'Etat
transférera les droits sur les tabacs aux départements
d'outre-mer, ainsi que le vote de leurs taux.
Les taux votés s'appliquent à des bases réduites
L'article 44 de la loi de finances pour 1999 a supprimé la fraction de
l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires, soit environ un
tiers de l'assiette d'un impôt dont le produit représente environ
la moitié du produit des quatre taxes directes locales. Avec cette
réforme, un sixième du pouvoir fiscal des collectivités
locales est en voie de disparition.
2. L'évolution des taux et des bases détermine de moins en moins l'évolution du produit
Le
produit perçu par les collectivités locales est en partie
acquitté par les contribuables et en partie par l'Etat, par le biais des
dégrèvements. Toutefois, la montée en puissance des
compensations, et notamment depuis la suppression de la part
" salaires " de la taxe professionnelle, aboutit à
déconnecter l'évolution des ressources locales liées
à la fiscalité locale de l'évolution du produit fiscal
proprement dit.
A cet égard, il est intéressant de constater que, dans son
tableau récapitulatif de l'évolution des produits, des bases et
des taux d'imposition des quatre taxes directes locales, le bulletin
statistique de la direction générale des collectivités
locales présente maintenant les résultats en deux colonnes :
une colonne " produit fiscal " et une colonne " produit
fiscal+compensation ". Pour 1999, le " produit fiscal " des
quatre taxes a augmenté de 0,7 % tandis que le " produit
fiscal + compensation " a progressé de 4,2 %.
Pour les communes, le produit des quatre taxes a augmenté de 0,6 %
alors que le produit " quatre taxes + compensations de taxe
professionnelle " a augmenté de 4 %. S'agissant de la seule
taxe professionnelle des communes, l'année 1999, première
année de la disparition progressive de la part " salaires ",
est caractérisée par les évolutions suivantes :
L'évolution en 1999 des taux, des bases et du produit
de la taxe professionnelle perçue par les communes
|
Taux |
+ 0,5 % |
|
Bases " fiscales " |
- 2,1 % |
|
Bases " fiscales " + exonérations |
+ 3,8 % |
|
Produit |
- 2,2 % |
|
Produit + compensation |
+ 4,8 % |
Source : Bulletin d'informations statistiques, DGCL, n° 32, octobre 1999.
3. Peut-on encore parler d'impôts directs locaux ?
Jusqu'à ces dernières années, il
était
aisé d'identifier le produit des impôts directs locaux, qui
correspondait au produit perçu par les collectivités locales,
qu'il soit acquitté par les contribuables ou par l'Etat, qui prend en
charge les dégrèvements. Les compensations étaient d'une
nature différente, distinctes des ressources fiscales. Elles font
d'ailleurs l'objet de notification, comme les dotations de l'Etat, et ne sont
pas inscrites en recettes fiscales dans les budgets locaux.
Aujourd'hui,
les compensations ne sont plus un phénomène
marginal
. Leur montant a été multiplié par 13 depuis
1983 et par 3,3 depuis 1987 et s'établit en 2000 (en tenant compte de la
suppression de la part régionale de la taxe d'habitation), à
66,4 milliards de francs, soit près de 20 % du montant total
du produit de la fiscalité directe locale, 345,4 milliards de
francs. Le caractère massif du remplacement de recettes fiscales locales
par des compensations se traduit par un
brouillage de la ligne de partage
entre fiscalité et compensations.
Par exemple, en 1999, les régions ont comptabilisé dans leur
budget la compensation de la suppression de la taxe additionnelle
régionale aux droits de mutation à titre onéreux comme des
recettes fiscales, de sorte que l'analyse de leurs comptes administratifs ne
permet pas de faire apparaître une diminution de la part de leurs
recettes fiscales dans leurs recettes totales.
De même, la suppression de la part " salaires " de la taxe
professionnelle, soit un tiers de l'assiette de cet impôt, a remis en
cause la fiabilité du principal indicateur de richesse des
collectivités locales, le potentiel fiscal. Celui-ci se
définissait en effet par l'application aux bases des " quatre
taxes " du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
Or,
avec la suppression de la part " salaires " de la taxe
professionnelle, les écarts relatifs entre le potentiel fiscal des
collectivités ont été bouleversés
car toutes
n'avaient pas la même proportion de bases " salaires " sur leur
territoire. En conséquence, les collectivités dans lesquelles les
bases " salaires " étaient importantes ont vu leur potentiel
fiscal augmenter, au détriment de celles dans lesquelles la part des
bases " salaires " était moins importante.
La modification des écarts relatifs de potentiel fiscal ayant des
conséquences sur l'éligibilité aux différentes
dotations de solidarité versées par l'Etat, ainsi que sur le
montant des attributions de ces dotations, la loi du 28 décembre 1999
relative à la prise en compte du recensement général de
population de 1999 dans la répartition des dotations de l'Etat aux
collectivités locales a modifié la définition du potentiel
fiscal des communes et des départements en y intégrant la
compensation de la suppression de la part " salaires ", afin de
neutraliser les effets de la réforme de la taxe professionnelle.
Cette évolution améliore à court terme la fiabilité
de cet indicateur. A moyen terme, en figeant les écarts, elle en
réduit la pertinence. En effet, en majorant le produit total pris en
compte, l'intégration des compensations limitera l'effet sur le
potentiel fiscal des augmentations et des diminutions de bases.
En tout état de cause, peu à peu, l'expression
" fiscalité locale " tend à devenir un terme
générique qui englobe non seulement le produit des impôts
locaux mais également les compensations, qui ne sont pourtant plus des
recettes fiscales puisque leur montant n'évolue ni en fonction des taux,
ni des bases des impôts locaux.
B. LE COÛT DE LA NON RÉFORME
1. Des inégalités qui se perpétuent et amènent l'Etat à supprimer tout ou partie des impôts directs locaux
a) Les inégalités " inévitables "
Les
impôts directs locaux sont sources d'inégalités, entre
collectivités, en raison de l'inégale répartition des
bases sur le territoire
228(
*
)
, et entre
contribuables, parce que les taux sont généralement plus
élevés là où les bases sont peu importantes.
Ces inégalités, si elles traduisent la nécessité
d'un renforcement de la péréquation, sont le reflet de la
diversité des territoires
et la
contrepartie du principe
d'autonomie fiscale
des collectivités locales.
Les
taux et les bases des communes et de leurs groupements en
1999
|
|
Taux |
Bases
|
|
Taxe
d'habitation
|
13,52
|
|
|
Foncier bâti
|
17,17
|
5.588
|
|
Foncier non bâti
|
40,77
|
210
|
|
Taxe
professionelle
|
14,36
|
11.472
|
Source : guide statistique de la fiscalité
directe
locale, DGCL, 1999.
L'inégale répartition de la richesse fiscale sur le territoire
n'est pas un défaut propre aux impôts directs locaux. Les
écarts constatés entre les taux ou les bases des impôts
directs locaux, de l'ordre de un à deux ou de un à trois, se
retrouvent en matière d'impôt sur le revenu.
Produit par habitant de l'impôt sur le revenu
(en millions de francs)
|
Alsace |
4.923 |
Ile de France |
9.670 |
|
Aquitaine |
4.217 |
Languedoc-Roussillon |
3.588 |
|
Auvergne |
3.572 |
Limousin |
3.740 |
|
Basse-Normandie |
3.431 |
Lorraine |
3.446 |
|
Bourgogne |
4.030 |
Midi-Pyrénées |
3.946 |
|
Bretagne |
3.677 |
Nord - Pas de Calais |
3.219 |
|
Centre |
4.232 |
PACA |
4.903 |
|
Champagne-Ardennes |
4.226 |
Pays de Loire |
3.461 |
|
Corse |
3.274 |
Picardie |
4.007 |
|
Franche Comté |
3.509 |
Poitou-Charentes |
3.613 |
|
Haute-Normandie |
3.971 |
Rhône-Alpes |
4.600 |
Population de 1999, impôt sur le revenu perçu en
1998.
Données chiffrées : INSEE, Ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie
b) Les inégalités injustifiables
L'assiette de la taxe d'habitation
L'assiette de la taxe d'habitation, qui repose sur les valeurs locatives, est
la plus fréquemment mise en cause en raison de son obsolescence. Selon
les dispositions des
articles 1516
et
1518
du code
général des impôts, les valeurs locatives doivent
être révisées tous les six ans, actualisées tous les
trois ans et revalorisées chaque année au moyen de coefficients
forfaitaires. Ces dispositions ne sont pas appliquées. Si elles sont
revalorisées chaque année en loi de finances, les valeurs
locatives n'ont été actualisées qu'une fois, en 1980, et
n'ont pas été révisées depuis 1970.
L'évolution des bases de la taxe d'habitation ne prend donc pas en
compte l'évolution des loyers, qu'elle est pourtant censée
refléter.
Pour remédier aux inconvénients de l'assiette de la taxe
d'habitation, la loi du 30 juillet 1990 a posé le principe d'une
révision générale des bases
de cet impôt. Les
travaux de révision ont été lancés, et les frais
d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur le produit des
impôts locaux ont été majorés pour les financer.
L'article 68 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire du 4 février 1995 prévoit que
"
les résultats de la révision générale des
évaluations cadastrales seront incorporés dans les rôles
d'imposition au plus tard le 1
er
janvier 1997
". Le
comité des finances locales a délibéré pour fixer
les conditions dans lesquelles cette réforme pourrait être
réalisée sans transferts de charges excessifs entre
collectivités. Le Gouvernement avait annoncé son intention de
procéder à la réforme dans le cadre de la loi de finances
rectificative pour 1998, mais a renoncé au dernier moment.
Aujourd'hui, le Gouvernement, dans le rapport sur la taxe d'habitation remis au
Parlement en application de l'article 28 de la loi de finances pour 2000,
considère que les travaux de simulation réalisés à
partir des résultats de la révision des bases de 1990
"
ont mis en évidence que cette réforme conduit à
des transferts entre contribuables, insatisfaisants, tant sur le plan de
l'efficacité économique que sur le plan de la justice
sociale
". La mise en oeuvre de la révision de 1990 est donc
" enterrée ". Pour l'avenir, le Gouvernement précise
que "
la garantie de l'autonomie des collectivités locales, le
traitement équitable des contribuables locaux sur le territoire national
et le recours à un dispositif simple d'actualisation dans le temps
devront guider toute nouvelle approche de la modernisation de l'assiette de la
taxe d'habitation
".
La révision des bases entraînerait sans doute des transferts entre
contribuables pas toujours conformes à l'objectif de justice
sociale
229(
*
)
. Il n'en demeure pas moins que,
selon le rapport du Gouvernement, "
du fait du vieillissement des
valeurs locatives, la répartition de l'impôt entre contribuables
est devenue de plus en plus inéquitable. L'évolution des valeurs
locatives diverge en effet de plus en plus des réalités
économiques. Il en résulte des transferts
" cachés " et injustifiés entre les contribuables des
quatre taxes et entre contribuables d'une même taxe
230(
*
)
".
L'assiette de la taxe professionnelle
La taxe professionnelle a été créée par la loi du
29 juillet 1975 pour remplacer la patente, seize ans après
l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui en fixait
le principe.
L'assiette du nouvel impôt reposait sur la valeur locative des
immobilisations et 20 % de la valeur des salaires bruts versés par
l'entreprise. Afin d'éviter d'éventuels transferts de charges
entre collectivités et entre redevables à l'occasion du
changement de régime, le nouvel impôt a été
" calibré " dans le but de respecter les équilibres
antérieurs.
Pour stabiliser le montant des cotisations, donc des ressources, des
collectivités locales, la fraction de l'assiette reposant sur les
immobilisations a été établie en fonction de bases
indiciaires et fictives. La valeur locative des terrains et des locaux est
déterminée de la même manière que celle retenue pour
le calcul de la taxe foncière sur les propriétés
bâties tandis que les équipements et les biens mobiliers sont pris
en compte à hauteur de 16 % de leur valeur d'acquisition,
indépendamment de l'éventuelle dégradation du patrimoine
de l'entreprise.
Malgré le choix d'une assiette indiciaire, l'entrée en vigueur
du nouvel impôt s'est traduite par des bouleversements dans le montant
des cotisations acquittées, si bien que, depuis vingt-cinq ans, le
régime de la taxe professionnelle est régulièrement
modifié dans le but soit de garantir les ressources locales, soit
d'alléger le poids de l'impôt pour les redevables.
Dès 1976, les bases ont fait l'objet d'un écrêtement pour
limiter les augmentations de cotisations. En 1982 , la part des salaires
prise en compte dans l'assiette a été réduite de 20
à 18 %, avant d'être supprimée en 1999. Le lissage de
la prise en compte des immobilisations dans l'assiette décidé en
1982, ainsi que la réduction pour embauche et investissement
créée en 1988, ont tenté de limiter les
conséquences de l'évolution du patrimoine ou de la masse
salariale sur le montant des cotisations. Le plafonnement des cotisations
à hauteur d'un certain pourcentage de la valeur ajoutée de
l'entreprise à partir de 1979 et l'abattement général de
16 % décidé en 1986 permettent également de freiner
l'augmentation des cotisations, tandis que, à l'inverse, la cotisation
minimum créée en 1980 avait pour objet de garantir un certain
niveau de recettes aux collectivités locales.
Le bilan du " pilotage à vue " de la taxe professionnelle
pendant plus de deux décennies est contrasté
. S'il a
procuré aux collectivités locales une ressource dynamique et
stable
231(
*
)
tout en limitant l'augmentation
des cotisations, cet équilibre n'a pu être atteint qu'au prix d'un
effort budgétaire important de l'Etat et du maintien de fortes
inégalités entre contribuables. Le mode de calcul de l'assiette
et les divers mécanismes d'exonération et de
dégrèvement conduisent à exonérer, en 1997, 1,5
million d'entreprises. Le nombre de redevables payant effectivement la taxe
professionnelle s'élève à 2,1 millions. Au total,
10 % des entreprises acquittent 80 % du produit de la taxe
professionnelle. La charge de l'impôt reste en outre inégalement
répartie entre les secteurs d'activité.
Au total, le Conseil des impôts a considéré dans son
rapport de 1997 que "
si la nature d'un bon impôt est
d'être large dans son assiette, modéré dans son taux,
proportionné aux capacités contributives des contribuables,
compréhensible par ces derniers et aisément recouvrable par
l'administration, force est de reconnaître que la taxe professionnelle ne
répond aujourd'hui à aucune de ces conditions
".
c) La stratégie des gouvernements successifs : payer plutôt que réformer
La
modification de l'assiette des impôts locaux est un exercice
périlleux politiquement. Même lorsque les conséquences
d'une réforme peuvent être positives dans leur globalité,
son entrée en vigueur reste conditionnée par ses
conséquences sur les situations individuelles, qui doivent être
examinées attentivement afin d'éviter l'apparition de nouvelles
injustices. Ainsi, dans son commentaire de l'article 6 du projet de loi de
finances rectificative pour 2000 relatif à la réforme de la taxe
d'habitation
232(
*
)
, le rapporteur
général de la commission des finances de l'Assemblée
nationale justifie le report de l'entrée en vigueur de la
révision des bases cadastrales de 1990, en évoquant par exemple
les conséquences néfastes que présenterait le nouveau
dispositif sur les communes de Nantes et de Tulle.
Les déclarations d'intention en matière de réforme des
impôts locaux sont rarement suivies d'effet. Par exemple :
- la loi du 30 juillet 1990 sur la révision des évaluations
cadastrales avait posé le principe, confirmé par l'article 33 de
la loi du 26 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre économique et
financier, du remplacement de la taxe d'habitation perçue par les
départements par la création d'une taxe départementale sur
le revenu. Un an après, le statu quo prévalait et la mise en
oeuvre de cette innovation était " reportée " par la
loi du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions fiscales ;
- l'article 14 de la loi du 10 janvier 1980, dans sa rédaction en
vigueur, prévoit que "
la taxe professionnelle aura pour base la
valeur ajoutée
". L'article 13 de cette loi prévoit que
l'assiette de la taxe professionnelle s'applique "
jusqu'à
l'année au titre de laquelle elle sera assise sur la valeur
ajoutée
".
Confrontés à des intérêts contradictoires, les
gouvernements successifs ont préféré financer par le
budget de l'Etat des allégements d'impôts locaux plutôt que
de mettre en oeuvre des réformes plus globales :
- pour limiter les injustices de l'assiette de la taxe d'habitation, le
législateur, au fil des ans, a mis en place des dispositifs
d'exonérations et de dégrèvements en faveur des
contribuables défavorisés. En 1999, les collectivités
locales ont perçu 71,4 milliards de francs au titre de la taxe
d'habitation mais seulement 60,2 milliards de francs ont été
acquittés par les contribuables de cette taxe, la différence,
soit 11,2 milliard de francs selon les estimations de la loi de finances pour
1999, étant à la charge de l'Etat par le biais des
dégrèvements. Par ailleurs, l'Etat a versé
7,2 milliards de francs au titre de la compensation des
exonérations de taxe d'habitation.
- en matière de taxe professionnelle, l'Etat se substitue en 2000 aux
contribuables de cet impôt à hauteur de 45,8 milliards de
francs s'agissant des dégrèvements. Le coût du seul
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'élève
à près de 40 milliards de francs. En outre, l'Etat verse aux
collectivités locales 22,8 milliards de francs au titre de la
compensation de la suppression de la part " salaires " de la taxe
professionnelle et 11,8 milliards de francs au titre de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle, qui compense notamment l'abattement
général de 16 % sur les bases décidé en 1986.
Il convient d'ajouter à ces sommes la prise en charge par l'Etat de
certaines des exonérations décidées par les divers
dispositifs d'aménagement du territoire, par exemple les
exonérations en zone de revitalisation rurale, dont le coût
estimé pour 2000 s'élève à 172 millions de
francs.
La prise en charge par l'Etat d'une part croissante de la fiscalité
locale est préoccupante non seulement au regard du principe de
l'autonomie fiscale des collectivités locales, mais également du
point de vue de l'équilibre des finances publiques.
2. Une charge croissante pour le budget de l'Etat
L'Etat
devient contribuable local par deux voies :
-
la prise en charge des dégrèvements
. Dans ce cas de
figure, le produit perçu par les collectivités locales ne change
pas. Il y a seulement un transfert de l'impôt local des contribuables
locaux vers l'Etat donc le contribuable national.
Le coût pour l'Etat des dégrèvements est passé de
18,3 milliards de francs en 1988 à 63 milliards de francs en
2000. Cette augmentation s'est effectuée par palliers. Entre 1989 et
1990, leur coût est passé de 18,7 milliards de francs
à 26 milliards de francs. Entre 1992 et 1995, il est passé
de 31,2 milliards de francs à 53,4 milliards de francs. Afin
de freiner cette croissance, la loi de finances pour 1996 a instauré un
gel du taux pris en compte pour la calcul du dégrèvement à
son niveau de 1995. En conséquence, à compter de 1996, toute
augmentation du taux de taxe professionnelle décidée par les
collectivités locales se traduit par un alourdissement de la cotisation
des contribuables, et non par un accroissement de la prise en charge par
l'Etat. Malgré cette disposition, le coût des
dégrèvements a continuer de progresser, mais à un rythme
moins soutenu.
Après avoir augmenté de 70% entre 1991 et 1995, le coût des
dégrèvements a progressé de " seulement "
21 % entre 1996 et 2000. La loi de finances pour 2000 évalue
à 63 milliards de francs le coût des dégrèvements en
2000, dont 45,8 milliards de francs pour la taxe professionnelle et à
12,3 milliards de francs pour la taxe d'habitation. La loi de finances
rectificative pour 2000 met un place un dispositif de gel du taux pris en
compte pour la prise en charge par l'Etat des dégrèvements de
taxe d'habitation à son niveau de 2000.
-
le versement aux collectivités locales de compensations
d'exonérations accordées aux contribuables ou de la suppression
de tout ou partie d'un impôt local. Les principales compensations sont la
dotation de compensation de la taxe professionnelle, qui compense notamment
l'abattement forfaitaire sur les bases de taxe professionnelle
décidé dans la loi de finances pour 1987, le
prélèvement sur les recettes de l'Etat qui finance la plupart des
exonérations de taxe d'habitation et de taxes foncières et,
dorénavant, les compensations de la suppression de la part
" salaires " de la taxe professionnelle de la réforme des
droits de mutation à titre onéreux.
Les compensations ont connu un rythme de progression moins soutenu que celui
des dégrèvements jusqu'à la fin des années 90.
Alors que leur montant était comparable à celui des
dégrèvements en 1990 (24,4 milliards de francs contre
26 milliards de francs), il est devenu très nettement
inférieur jusqu'en 1998 (29,7 milliards de francs contre
58,9 milliards de francs). Entre 1996 et 1998, le montant des
compensations a même régressé car la DCTP, devenue la
variable d'ajustement de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux
collectivités locales, a commencé à diminuer
d'année en année.
Depuis 1998 et le début du processus en cours de suppression progressive
des impôts locaux, le montant des compensations augmente de
manière très rapide. Il est passé de 29,7 milliards
de francs en 1998 à 60,6 milliards de francs dans la loi de
finances pour 2000,
soit un doublement en deux ans.
La part des compensations dans le total des concours de l'Etat aux
collectivités locales (dotations, compensations,
dégrèvements) est passée de 12,6 % en 1995 à
20,7 % en 2000, tandis que celle des dotations a diminué de
66,4 % à 60,4 % et celle des dégrèvements est
restée stable, à environ 20 %.
En 2000, l'Etat consacre 37,8 milliards de francs de plus aux
collectivités locales qu'en 1998, soit autant que l'augmentation totale
des ses concours entre 1992 et 1998. Au sein de ces crédits, seuls
2,8 milliards de francs ont été consacrés à
l'augmentation de ses dotations aux collectivités locales.
30,8 milliards de francs sont consacrés à l'augmentation des
compensations et 4,1 à l'augmentation du coût des
dégrèvements
233(
*
)
.
Part de l'augmentation des nouvelles compensations d'exonérations fiscales dans l'augmentation des concours de l'Etat aux collectivités locales (hors dégrèvements)
|
1999 |
2000 |
|
68,8 % |
71,2 % |
Données chiffrées : Lois de finances.
L'augmentation du coût pour l'Etat des collectivités locales
est donc sans commune mesure avec l'augmentation des ressources des
collectivités qui en résulte, et se traduit par une augmentation
des dépenses structurelles du budget général.
La stratégie actuelle de remplacement des impôts locaux par des
subventions aboutit donc à rigidifier la structure des dépenses
publiques et à rogner les marges de manoeuvre budgétaires en
créant des dépenses nouvelles pour lesquelles l'Etat s'engage sur
une très longue durée.
Coût de la prise en charge par l'Etat de la fiscalité directe locale
(en millions de francs)
|
|
1988 |
2000 |
Evol. en francs |
Evol. en % |
|
COMPENSATIONS |
|
|
|
|
|
Contrepartie de l'exonération d'impôt foncier (chapitre 41-51) |
|
|
|
|
|
Contrepartie de l'exonération de taxes sur les propriétés non bâties (chapitre 41-51) |
- |
|
|
|
|
Application de l'article 3 de la loi du 10 janvier 1980 (chapitre 41-21) |
|
|
|
|
|
Compensation aux départements des réductions de taxe de publicité foncière (chapitre 41-23) |
|
|
|
|
|
Dotation de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales immobilières (chapitre 41-55) |
|
|
|
|
|
Compensation aux départements de la baisse des droits de mutation (DGD) |
|
|
|
|
|
DCTP (prélèvement sur recettes) |
18.807 |
11.899 |
- 6.908 |
- 37 % |
|
Exonérations fiscalité locale (prélèvement sur recettes) |
|
|
|
|
|
Suppression de la part salariale de la TP (prélèvement sur recettes) |
|
|
|
|
|
Total compensations |
22.441 |
60.605 |
+ 38.165 |
+ 170 % |
|
DÉGRÈVEMENTS |
|
|
|
|
|
Dégrèvements (chapitre 15-01) |
18.301 |
63.000 |
+ 44.699 |
+ 244 % |
|
TOTAL |
40.742 |
123.605 |
+ 82.864 |
203 % |
Source : Lois de finances
3. Un manque à gagner pour les collectivités locales
A la
différence des dégrèvements, le montant des compensations
n'évolue pas en fonction des bases ou des taux votés par les
collectivités locales, mais en fonction de mécanismes
d'indexation qui peuvent être regroupés en deux
catégories :
-
la prise en compte de l'évolution des bases avec un gel des taux
à la date d'entrée en vigueur de la mesure
.
Cette solution a par exemple été retenue par l'article 21 de la
loi de finances pour 1992 qui a transformé en exonérations
certains dégrèvements de taxe d'habitation et par l'article 9 de
la loi de finances pour 1993 qui a supprimé les parts régionales
et départementales de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties. Ce mécanisme permet à
l'Etat d'assumer le coût de la mesure qu'il décide, à la
date de sa décision.
-
l'indexation du montant de l'exonération accordée au
contribuable à la date d'entrée en vigueur de la mesure sur le
taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement
(DGF).
Cette solution a été retenue par l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 pour la calcul de la compensation de la suppression de la
part " salaires " de la taxe professionnelle et par l'article 29 de
la loi de finances pour 1999 pour compenser la suppression de la part
régionale des droits de mutation à titre onéreux. Elle
s'applique également, de fait, à la compensation des
réductions d'assiette et de taux des impôts dévolus au
financement des compétences transférées, qui sont
intégrées dans la dotation générale de
décentralisation (DGD), elle-même indexée sur la DGF. La
loi de finances rectificative pour 2000 prévoit un dispositif de ce type
pour la compensation de la suppression de la part régionale de la taxe
d'habitation.
a) Les modes d'indexation entraînent des manques à gagner
Le
principe des compensations n'est pas en lui-même source de manque
à gagner pour les collectivités locales. Il arrive en effet que,
certaines années, les compensations versées soient
supérieures au produit qui aurait résulté du jeu normal
des bases et des taux.
Toutefois, tendanciellement, les indexations retenues pour les compensations
sont
défavorables
aux collectivités locales :
- pour les compensations qui évoluent en fonction des bases
réelles et des taux de l'année d'entrée en vigueur de la
mesure, il y a manque à gagner dès que les taux de l'année
en cours sont supérieurs aux taux de l'année d'entrée en
vigueur de la mesure ;
- pour les compensations indexées sur la DGF, il y a manque à
gagner dès lors que les bases (ou le produit) de l'impôt
augmentent plus vite que le taux d'évolution de la DGF.
Le tableau ci-dessous compare l'évolution du produit de la part
régionale de la taxe d'habitation et le taux d'évolution de la
DGF sur lequel sera indexée la compensation de la suppression de cet
impôt. En quatre ans, l'indexation sur la DGF n'aurait été
favorable
qu'une seule fois
aux régions.
Evolution comparée de la DGF et de la part régionale de la taxe d'habitation
(en %)
|
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Taux d'évolution de la DGF * |
+ 1,68 |
+ 1,26 |
+ 1,38 |
+ 2,78 |
+ 0,82 |
|
Taux d'évolution du produit voté de la part régionale de la taxe d'habitation |
+ 6,87 |
+ 1,61 |
+ 2,62 |
+ 2,48 |
- |
* Le taux d'évolution retenu pour l'indexation des compensations est le taux après " recalage " et " régularisation " du montant de la DGF. A titre exceptionnel, en 2000, la compensation de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle a été indexée sur l' " indice de la DGF " calculé en ajouté 50 % du taux de croissance du PIB au taux d'évolution des prix.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995 relative à la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, a considéré que, dès lors qu' " un mécanisme de compensation de la perte de recettes " était prévu, le législateur pouvait édicter des exonérations de fiscalité locale " sans qu'elles aient pour effet de restreindre les ressources des collectivités locales au point d'entraver leur libre administration. " Il ressort de cette formulation que le Conseil a implicitement considéré que les mécanismes de compensation d'exonération aboutissaient à restreindre les ressources des collectivités locales.
b) Les mécanismes d'érosion du montant des compensations
En
raison de la déconnexion entre l'évolution des compensations et
celles des bases d'imposition, il n'est pas possible pour les
collectivités locales de se prévaloir d'un quelconque
" dû " au titre des compensations. Leur montant peut à
tout moment être modifié par la loi.
Dès lors, il est
tentant pour l'Etat, à la recherche d'économies
budgétaires, de réduire le montant des compensations.
Dans la première moitié des années 90, la situation des
finances publiques était particulièrement tendue et le montant du
déficit de l'Etat croissait d'année en année. L'Etat a
donc recherché des moyens de freiner la progression de l'ensemble de ses
dépenses, et notamment de ses concours financiers aux
collectivités locales. Les compensations n'ont pas échappé
à ce mouvement et les
dispositifs dits de
"
réfaction
" ont fait leur apparition.
Le principe des réfactions est le suivant : lorsqu'une
exonération au titre d'un impôt local était
décidée, une compensation était versée aux
collectivités concernées. Toutefois, pour limiter le coût
des compensations, il était prévu que le montant des
compensations serait réduit lorsque le montant des recettes fiscales
d'une collectivité augmenterait dans des proportions jugées
suffisamment importantes pour que la collectivité puisse se passer d'une
partie de la compensation.
Les réfactions permettent donc de " rogner " petit à
petit le montant des compensations versées aux collectivités dont
les recettes fiscales sont dynamiques.
Les dispositifs de réfaction des compensations d'exonérations de fiscalité locale
L'article 53 de la loi de finances pour 1993 fixe les modalités de la
compensation aux départements et aux régions de la suppression
des parts régionales et départementales de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties.
Cette compensation est calculée en multipliant les bases de cet
impôt constatées pour l'exercice en cours par le taux de 1992 pour
les régions et de 1993 pour les départements.
Le montant de la compensation versée aux départements et aux
régions fait l'objet d'une réfaction. Le montant de cette
réfaction est égal à 1 % du montant du produit des
" quatre taxes " perçu par un département ou une
région multiplié par le rapport entre le potentiel fiscal du
département ou de la région et le potentiel moyen des
départements ou des régions. Par conséquent :
- si le potentiel fiscal du département ou de la région est
supérieur au potentiel fiscal moyen, le montant de la réfaction
est inférieur à 1 % du produit des quatre taxes. S'il est
supérieur, la réfaction est également supérieure
à 1 % du produit des quatre taxes ;
- plus le produit des quatre taxes est élevé, plus le montant de
la réfaction est élevé.
L'article 54 de la loi de finances pour 1994 définit les
modalités de calcul de la réfaction appliquée aux
attributions de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).
Si le produit de taxe professionnelle perçu par une collectivité
a été multiplié entre 1987 et l'année en cours par
un coefficient compris entre 1,2 et 1,8, les attributions de DCTP sont
diminuées de 15 % . Si ce coefficient est compris entre 1,8 et 3,
la réfaction est de 35 %. Si le coefficient est supérieur
à 3, la réfaction est 50 %.
Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 fixe les
modalités de compensation aux collectivités locales de la
réduction pour embauche et investissement (REI).
Cette compensation fait également l'objet d'une réfaction, qui
s'élève à 2 % du produit des quatre taxes perçu par
la collectivité. Certaines collectivités,
déterminées en fonction d'indicateurs proches des critères
d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine,
sont exonérées de réfaction.
Le choix de transformer la dotation de compensation de la taxe
professionnelle (DCTP) en variable d'ajustement de l'enveloppe normée
des concours de l'Etat aux collectivités locales a permis de
réduire de manière beaucoup plus efficace le montant des
compensations versées aux collectivités locales.
La DCTP est une dotation qui, depuis 1987, regroupe plusieurs compensations
d'exonérations de taxe professionnelle, notamment l'abattement
général de 16 % sur les bases décidé par la loi de
finances pour 1987 et la réduction de 20 % à 18 % de la part
des salaires prise en compte dans l'assiette de la taxe professionnelle,
décidée en 1982.
La loi de finances pour 1996 a créé
l'enveloppe normée
des concours de l'Etat aux collectivités locales
dans le but de
fixer un plafond à l'effort financier en faveur des collectivités
locales. L'enveloppe normée rassemble la plupart des dotations de l'Etat
aux collectivités, au premier rang desquelles la DGF. Chacune des
composantes de l'enveloppe évolue en fonction d'une indexation qui lui
est propre et, si la progression qui en résulte est supérieure au
taux de progression fixé pour l'enveloppe normée, l'ajustement
est réalisé par la diminution du montant d'une dotation
chargée de jouer le rôle de variable d'ajustement. La DCTP a
été choisie pour remplir cette fonction. En conséquence,
et alors que les bases que la DCTP était censée compenser ont
augmenté, le montant de la DCTP est passé de 17,6 milliards de
francs en 1996 à 11,8 milliards de francs en 2000, soit un gain de 5,8
milliards de francs pour l'Etat.
L'exemple suivant illustre l'ensemble des points évoqués
ci-dessus : la compensation versée à un conseil
général au titre de l'abattement de 16 % sur les bases de taxe
professionnelle évolue non seulement beaucoup moins vite que les bases
réelles de taxe professionnelle (premier manque à gagner) mais,
de surcroît, son montant diminue depuis 1995 en raison des
mécanismes de réfaction et, surtout, de la transformation de la
DCTP, qui compense l'abattement de 16 %, en variable d'ajustement de
l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités
locales (deuxième manque à gagner).
Manque à gagner provoqué par les modalités de compensation de l'abattement de 16 % sur les bases de la taxe professionnelle dans un département de 1,5 million d'habitants
(en milliers de francs)
|
|
1987 |
1990 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2000 |
|
Bases abattues à 16 % |
2217764 |
2778386 |
3600203 |
3898090 |
4139012 |
4162059 |
4141720 |
|
Taux de TP (en %) |
4,02 |
4,07 |
4,14 |
4,52 |
4,86 |
5,14 |
5,19 |
|
Produit résultant des bases abattues |
89155 |
113080 |
149048 |
176194 |
201156 |
213930 |
214955 |
|
Compensation |
88930 |
104163 |
108703 |
91885 |
88585 |
73415 |
51683 |
|
Différence (manque à gagner) |
225 |
8917 |
40345 |
84309 |
112571 |
140515 |
163272 |
|
% du manque à gagner dans le produit potentiel |
0,25 |
8,56 |
37,12 |
91,75 |
127,08 |
191,40 |
315,20 |
|
Manque à gagner par rapport à n-1 (en %) |
|
56,05 |
38,68 |
18,66 |
4,81 |
11,15 |
16,20 |
Source : Conseil général
Ce département reçoit en 2000 51,6 millions de francs au titre de la compensation de l'abattement de 16 % sur les bases de taxe professionnelle alors que, si ces bases n'avaient pas été abattues, elles lui auraient rapporté 214,9 millions de francs.
c) Les conséquences sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
La
multiplication des exonérations de taxe professionnelle et de taxe
d'habitation s'est traduite depuis le début des années 90 par une
montée en puissance de la part de la taxe foncière sur les
propriétés bâties dans les ressources fiscales des
collectivités locales.
Alors que les taux de cet impôt ont augmenté à peine plus
rapidement que ceux de la taxe d'habitation, le produit de la taxe
foncière sur les propriétés bâties a crû
nettement plus vite que celui de la taxe d'habitation, au point de lui
être supérieur depuis 1992.
Evolution du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation depuis 1990
(en millions de francs)
|
|
1990 |
1992 |
1998 |
|
Taxe d'habitation |
46.955 |
48.127 |
68.569 |
|
Foncier bâti |
45.462 |
54.060 |
82.981 |
Source : les collectivités locales en chiffre, DGCL, 1999.
Lors de
son audition par la mission, M. Alain Guengant, professeur à
l'université de Rennes a craint que le recours à cet impôt
ne se heurte un jour à l'absence de révision des bases et a
jugé qu'une telle éventualité constituerait une menace
pour la fiscalité directe locale.
En outre, depuis 1990, la part de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, assise sur les mêmes bases que la taxe
foncière sur les propriétés bâties, dans le produit
total des quatre taxes est passée de 4,4 % à 5,2 %.
IV. LES COLLECTIVITÉS LOCALES, VARIABLE D'AJUSTEMENT DU BUDGET DE L'ETAT
A. L'ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES CONCOURS DE L'ÉTAT
1. Les concours de l'Etat : un ensemble hétérogène
Les
concours financiers de l'Etat aux collectivités locales regroupent les
dotations versées aux collectivités locales, les compensations
d'exonérations de fiscalité locale et la prise en charge par
l'Etat de dégrèvements d'impôts locaux.
La majorité de ces crédits n'est pas inscrite en dépense
du budget général mais prend la forme de
prélèvements sur les recettes de l'Etat
. Cette
particularité s'explique par le fait que les sommes concernées
servent à couvrir des charges qui incombent aux collectivités
locales et non à l'Etat. Lorsqu'ils figurent au budget
général, les concours de l'Etat aux collectivités locales
sont éparpillés entre différents fascicules
budgétaires, principalement les charges communes et l'intérieur,
mais aussi l'emploi et la solidarité et la culture.
a) Les dégrèvements
Les
dégrèvements d'impôts locaux pris en charge par l'Etat sont
retracés au chapitre 15-01 du budget des charges communes. Ils font
partie du produit fiscal perçu par les collectivités locales et,
à l'inverse des dotations, ne font pas l'objet d'une notification
spécifique aux collectivités locales.
Leur montant est individualisé dans les documents budgétaires
depuis 1988 seulement. Depuis 1995, le coût pour l'Etat de chacune des
quatre taxes directes locales est également identifié. Depuis la
loi de finances pour 1998, ces documents indiquent également le montant
des admissions en non valeur correspondant aux impôts directs locaux.
Leur coût est passé de 18,3 milliards de francs en 1988 à
63 milliards de francs en 2000, dont 45,8 milliards de francs pour la taxe
professionnelle, 12,3 milliards de francs pour la taxe d'habitation
234(
*
)
, 2,4 milliards de francs pour les taxes
foncières et 2,5 milliards de francs pour les admissions en non
valeur.
b) Les compensations
Les
compensations sont techniquement des dotations. Elles ne font pas partie du
produit fiscal des collectivités locales et leur sont notifiées
comme les autres dotations.
Leur montant a doublé depuis 1998, passant de 29,7 milliards de francs
à 60,6 milliards de francs.
Jusqu'en 1998, le principal poste de compensations était le
prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la
compensation d'exonérations relatives à la fiscalité
locale, qui regroupe les exonérations de taxe d'habitation pour 7,5
milliards de francs en 2000, les exonérations de taxe sur le foncier
bâti pour 1,4 milliard de francs (dont celles prévues par le pacte
de relance pour la ville), les exonérations de taxe sur le foncier non
bâti pour 2,1 milliards de francs, les exonérations
accordées en Corse, les exonérations dans les zones de
revitalisation rurale pour 172 millions de francs et les exonérations de
droits de mutation de fonds de commerce pour 50 millions de francs.
Les crédits correspondants s'élevaient à
11,9 milliards de francs en 1998. Ils venaient s'ajouter à la
dotation de compensation de la taxe professionnelle (17,3 milliards de francs)
et à diverses compensations d'exonérations inscrites au budget du
ministère de l'intérieur, pour 495 millions de francs.
Un nouveau prélèvement sur les recettes de l'Etat a
été créé en 1999 pour financer la compensation de
la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle, dont le montant
s'élève à 22,8 milliards de francs en 2000. Par ailleurs,
la suppression de la taxe régionale sur les mutations à titre
onéreux s'est traduite par l'inscription d'environ 5 milliards de francs
au budget du ministère de l'intérieur. La réforme des
droits de mutation perçus par les départements a pour sa part
abouti à majorer la dotation générale de
décentralisation (DGD) de 7,9 milliards de francs en 2000. Ces
crédits, bien qu'intégrés à une dotation de l'Etat,
peuvent néanmoins légitimement être
considérés comme des compensations.
Evolution du montant des compensations depuis 1992
(en millions de francs)
|
|
1992 |
1998 |
2000 |
|
Diverses compensations inscrites au budget du ministère de l'intérieur |
2.120 |
495 |
240 |
|
Compensations aux régions des pertes de recettes fiscales immobilières |
- |
- |
- |
|
DCTP |
22.138 |
17.343 |
11.899 |
|
Exonérations relatives à la fiscalité locale |
6.500 |
11.900 |
12.578 |
|
Suppression de la part " salaires " de la TP |
- |
- |
22.850 |
|
TOTAL |
24.405 |
29.738 |
52.701 |
|
TOTAL (y compris compensation aux départements de la réforme des droits de mutation) |
- |
- |
60.605 |
Données chiffrées : lois de finances.
c) Les dotations de l'Etat
Les
dotations de l'Etat aux collectivités locales relèvent de trois
catégories, les dotations de compensation des charges
transférées et les dotations au sens strict, qui sont
elles-mêmes partagées entre dotations de fonctionnement et
dotations d'équipement.
Le montant total des dotations s'élève à 176,6 milliards
de francs en 2000. Il a progressé de 40 % depuis 1990.
La part de chacune des trois catégories dans le total des dotations est
relativement stable depuis l'entrée en vigueur des transferts de
compétences prévus par les lois de décentralisation,
environ 15 % pour les dotations de compensation de compétences
transférées, 70 % pour les dotations de fonctionnement et
environ 15 % pour les dotations d'équipement.
Les dotations de compensation des charges transférées
Dans l'esprit des lois de décentralisation, les dotations de
compensation des charges transférées étaient
appelées à rester marginales. Le principe posé en 1982 et
repris à l'article L. 1614-4 du code général des
collectivités territoriales était celui du financement des
compétences transférées par des transferts d'impôt,
le solde étant compensé par la voie budgétaire.
Des impôts à fort rendement, notamment la vignette et les droits
de mutation, ont été transférés aux
départements et aux régions. Leur produit s'établit
à plus de 40 milliards de francs (47,1 milliards de francs en 1998, 41,7
milliards de francs prévus pour 2000), soit 1,5 fois plus que le montant
des dotations de compensation, qui s'élève en 2000 à 28,1
milliards de francs.
Toutefois, depuis les transferts initiaux, aucun impôt nouveau n'a
été transféré aux collectivités locales et
l'ensemble des ajustements ont été opérés par la
voie budgétaire, par l'intermédiaire de la dotation
générale de décentralisation. Récemment, la
réforme des droits de mutation perçus par les départements
réalisée par les lois de finances pour 1999 et 2000 s'est
traduite par une majoration du montant de la DGD (de 3,3 milliards de francs en
1999 et de 4,6 milliards de francs en 2000 ) tandis que la recentralisation de
la compétence d'aide médicale prévue par la loi du 28
juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle a conduit
à réduire le montant de la DGD de 9,1 milliards de francs. Ces
mouvements internes à la DGD expliquent la diminution de
32 milliards de francs à 28,1 milliards de francs du montant
total des dotations de compensation entre 1999 et 2000.
Contrairement au principe posé par l'article L. 1614-4 du code
général des collectivités territoriales, l'ensemble des
compensations versées par l'Etat au titre des compétences
transférées ne sont pas regroupées dans la DGD,
gérée par le ministère de l'intérieur. Il subsiste
des crédits inscrits au budget du ministère de l'emploi (la
" DGD-formation professionnelle ") et de la solidarité et au
budget du ministère de la culture (les " crédits
Culture "). Par ailleurs, deux dotations d'équipement, la dotation
départementale d'équipement des collèges et la dotation
régionale d'équipement scolaire, sont inscrites au titre VI du
budget du ministère de l'intérieur.
Les dotations de compensation des charges transférées
( en millions de francs)
|
|
1985 |
1992 |
2000 |
|
DGD |
8.762 |
14.525 |
13.718 |
|
DGD Corse |
- |
- |
1.311 |
|
DGD-Formation professionnelle |
- |
2.990 |
7.964 |
|
DDEC |
- |
1.279 |
1.719 |
|
DRES |
- |
2.585 |
3.464 |
|
TOTAL* |
8.762 |
21.379 |
28.176 |
* Il
conviendrait d'ajouter à ce total les crédits
transféré en gestion du ministère de la culture vers la
DGD, dont le montant s'établit à 909 millions de francs dans la
loi de finances pour 2000.
Données chiffrées : lois de finances
La DGD
et ses satellites sont indexées sur le taux d'évolution de la
dotation globale de fonctionnement. Cependant, cette indexation ne permet pas
d'anticiper l'évolution de leur montant, qui dépend
également, et de plus en plus, de leur périmètre.
Les deux dotations d'équipement sont indexées sur le taux
d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations
publiques.
Les dotations de fonctionnement
Il existe six dotations de fonctionnement versées par l'Etat aux
collectivités locales, dont le montant varie du simple (108 millions de
francs pour le reversement à la Corse du produit de la taxe
intérieur sur les produits pétroliers) au centuple (112 milliards
de francs pour la dotation globale de fonctionnement). Le montant total des
dotations de fonctionnement versées en 2000 s'élève
à 119,1 milliards de francs, soit 38 % de plus qu'en 1990.
A elle seule, la dotation globale de fonctionnement (DGF), représente
94% de cette masse. Elle évolue en fonction de modalités
complexes, fixées aux
articles L. 1613-1
et
L. 1613-2
du code général des collectivités territoriales :
- l'indice de progression de la DGF est "
égal à la somme
du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix
à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de
versement et de la moitié du taux d'évolution du produit
intérieur brut de l'année en cours, sous réserve que
celui-ci soit positif
" ;
- toutefois, pour obtenir le montant de la DGF au titre d'une année, il
ne suffit pas d'appliquer cet indice au montant de la DGF de l'année
précédente. Il faut au préalable procéder au
" recalage " du montant de la DGF de l'année en cours,
c'est-à-dire recalculer son montant en fonction des derniers indices
économiques connus. C'est à ce nouveau montant qu'est
appliqué l'indice prévu à l'
article
L. 1613-1
;
- ensuite, s'il s'avère que, au titre d'un exercice, le montant
versé aux collectivités s'est révélé
supérieur à ce qu'il aurait dû être si l'indice avait
été calculé à partir des indicateurs de prix et de
PIB définitifs, il faut retrancher le trop perçu du montant de la
DGF. Cette opération s'appelle la " régularisation " du
montant de la DGF.
Les opérations de recalage et de régularisation ont souvent
joué dans un sens défavorable aux collectivités locales
depuis leur entrée en vigueur au milieu des années 90, le taux de
progression de la DGF se révélant inférieur à
l'indice défini par le code général des
collectivités territoriales. Toutefois, ces dispositifs peuvent jouer
dans les deux sens. En 2001 et 2002, le taux réel d'évolution de
la DGF sera vraisemblablement supérieur à l'indice de la DGF.
Les taux de progression de la DGF
(en %)
|
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001* |
2002* |
|
Taux d'évolution de la DGF |
+ 1,68 |
+ 1,26 |
+ 1,38 |
+ 2,78 |
+ 0,82 |
+ 3,02 |
+ 3,22 |
|
Indice
de la DGF
|
+ 3,55 |
+ 1,95 |
+ 2,40 |
+ 2,75 |
+ 2,05 |
+ 2,70 |
+ 2,40 |
* estimations
Source : Direction générale des collectivités locales
Les
modalités d'indexation de la DGF jouent un rôle de plus en plus
important, car elles déterminent l'évolution d'un nombre de plus
en plus grand de concours de l'Etat aux collectivités locales :
- au sein des dotations de fonctionnement versées aux
collectivités locales, la dotation spéciale instituteurs (2,3
milliards de francs en 2000) et la dotation élu local (276 millions de
francs en 2000) sont indexées sur le taux d'évolution de la
DGF ;
- la DGD et ses " satellites " sont également indexées
sur la DGF ;
- de plus en plus, les compensations d'exonérations fiscales sont
indexées sur la DGF. Depuis 1999, cette indexation a été
retenue pour compenser la suppression de leurs droits de mutation des
régions, la suppression de la part " salaires " de la taxe
professionnelle et, à compter de 2001, la suppression de la part
régionale de la taxe d'habitation.
Par conséquent, lorsque la DGF progresse faiblement, un volume
désormais considérable de crédits en supporte les
conséquences. En 2000, sur 230 milliards de francs environ versés
par l'Etat aux collectivités locales au titre des dotations et des
compensations, 165 milliards de francs étaient indexés sur le
taux de progression de la DGF. Compte tenu du faible taux de progression de la
DGF en 2000 (0,8 %), la loi de finances pour 2000 a disposé que,
par dérogation, la compensation de la suppression de la part
" salaires " de la taxe professionnelle évoluerait en fonction
de l'indice prévu à l'
article L. 1613-1
(2,05 %)
et non en fonction du taux réel d'évolution de la DGF.
Les dotations de fonctionnement comprennent également les dotations de
l'Etat aux deux fonds nationaux de péréquation, le fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et le fonds
national de péréquation (FNP).
L'Etat verse à chacun de ces fonds une dotation dont le montant
évolue en fonction du taux d'évolution des recettes fiscales de
l'Etat,
" net des remboursements et dégrèvements et des
prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des
évaluations de la loi de finances initiale, et corrigé le cas
échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes
liés à des transferts de compétence aux
collectivités territoriales, à d'autres personnes morales
publiques ainsi qu'aux communautés européennes "
. Une
correction de ce type est intervenue en 2000 pour tenir compte du transfert
à la sécurité sociale du produit d'une partie des droits
sur les tabacs, ce qui a abouti à un taux d'indexation de - 0,3 %
des dotations aux FNPTP et FNP, alors même que, à structure
constante, les recettes fiscales de l'Etat augmentaient fortement.
Par ailleurs, l'Etat reverse au FNPTP la fraction du produit de la taxe
professionnelle acquittée par la Poste et France Télécom
qui correspond à la différence entre le montant perçu au
titre d'une année et le montant de ce produit en 1994.
Les dotations de fonctionnement versées aux collectivités locales
( en millions de francs)
|
|
1985 |
1992 |
2000 |
|
DGF |
66.107 |
92.225 |
112.036 |
|
Dotation spéciale instituteurs |
- |
3.321 |
2.353 |
|
Dotation élu local |
- |
- |
276 |
|
TIPP Corse |
- |
- |
108 |
|
FNPTP |
4.203 |
807 |
3.575 |
|
FNP |
- |
- |
827 |
|
TOTAL |
70.310 |
96.353 |
119.175 |
Données chiffrées : lois de finances
Les
dotations d'équipement
Les dotations d'équipement, dont le montant s'élève en
2000 à 29,2 milliards de francs, représentent environ 20 %
des dotations de l'Etat hors compensation des charges transférées.
Chacune des trois dotations de l'Etat présente des
spécificités, qui les distinguent des dotations classiques que
sont les dotations de fonctionnement.
Deux d'entre elles, le fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée (FCTVA) et le produit des amendes de police, n'évoluent
pas en fonction de taux d'indexation fixés par la loi. Ce sont des
dotations " à guichet ouvert ", dont le montant est
déterminé respectivement par l'évolution du montant des
investissements des collectivités locales et par le montant des amendes
de police dressées sur le territoire des communes
bénéficiaires.
La dotation globale d'équipement des communes et des départements
est indexée sur le taux d'évolution de la formation brute de
capital fixe des administrations publiques. Depuis la réforme de cette
dotation dans la loi de finances pour 1996
235(
*
)
, la DGE n'est plus vraiment une dotation puisque ce
sont les préfets qui décident de son attribution.
Les dotations d'équipement versées aux collectivités locales
(en millions de francs)
|
|
1985 |
1992 |
2000 |
|
DGE |
3.570 |
5.433 |
5.415 |
|
FCTVA |
10.808 |
21.100 |
21.820 |
|
Amendes de police |
391 |
950 |
2.040 |
|
TOTAL |
14.769 |
27.483 |
29.275 |
Données chiffrées : lois de finances
Les
crédits des différents ministères et comptes
spéciaux du Trésor
La logique de la décentralisation aurait voulu que les concours de
l'Etat aux collectivités locales soient progressivement
globalisés au sein de dotations libre d'emploi pour les
collectivités locales.
Cette évolution n'a pas eu lieu et, plutôt qu'à une
globalisation, on a assisté depuis vingt ans à une augmentation
du nombre de dotations.
L'éclatement des concours financiers de
l'Etat entre différentes dotations, dont le taux de progression peut
être modifié en fonction de la conjoncture, permet d'éviter
une réflexion globale sur l'adéquation entre le montant des
dotations de l'Etat et l'évolution des charges des collectivités
locales
.
Malgré tout, les dotations représentent un progrès par
rapport aux subventions, dont le versement aux collectivités locales est
à la discrétion des administrations de l'Etat. Dans le
" jaune " budgétaire relatif à l'effort financier de
l'Etat en faveur des collectivités locales, les subventions sont
comprises dans le champ de l'effort financier de l'Etat.
En 2000, les subventions de fonctionnement s'élèveraient
5,4 milliards de francs et les subventions d'investissement à 7,1
milliards de francs. Ce montant n'est pas négligeable. Il est, par
exemple, supérieur à celui de la DGE.
Les concours financiers des collectivités locales à l'Etat
Les flux
financiers entre l'Etat et les collectivités locales ne sont pas
à sens unique.
Le rapport remis au premier ministre en 1994 par le groupe de travail sur les
relations financières entre l'Etat et les collectivités locales
présidé par M. François Delafosse, recense les flux
financiers des collectivités locales vers l'Etat, en insistant notamment
sur :
- les fonds de concours versés par les collectivités locales et
qui abondent le budget de l'Etat en cours d'exercice : leur montant
s'établissait à 7,3 milliards de francs en 1993. Il était
de 5,8 milliards de francs en 1999 ;
- le versement par la CNRACL de compensations et de surcompensations aux autres
régimes de retraite. En 1999, le coût de ces versements
s'élevait à 19,8 milliards de francs, dont 10,8 à la
charge des collectivités locales et 8,9 à la charge des
hôpitaux ;
- les participations au financement d'opérations de l'Etat qui ne
prenent pas la forme de fonds de concours et qui, de ce fait, peuvent
difficilement être évaluées en termes financiers
(financement de bibliothèques, laboratoires ou équipements
universitaires, infrastructures dont l'Etat est maître d'ouvrage).
2. La réduction de la part des dotations dans l'effort total de l'Etat
Le
tableau ci-dessous permet de mettre en évidence trois séquences
dans l'évolution de la structure des concours de l'Etat aux
collectivités locales depuis la fin des années 80 :
- entre 1988 et 1992, les crédits consacrés à la prise en
charge de la fiscalité locale (compensations et
dégrèvements) ont augmenté à un rythme très
soutenu (+ 55 %), mais les dotations de l'Etat également (+
28 %) ;
- entre 1992 et 1996, les taux de progression de ces deux postes ont
été réduits de presque moitié. En volume, les
dotations ont augmenté plus que les compensations et les
dégrèvements, de 19,9 milliards de francs contre 17,3 milliards
de francs.
- entre 1996 et 2000, le taux de progression des dotations a été
à nouveau divisé par deux tandis que le taux de progression des
compensations et des dégrèvements passait de + 28 % à +
44 %. En volume, les compensations et dégrèvements ont
augmenté trois fois plus que les dotations, de 35,2 milliards de francs
contre 11,4 milliards de francs.
Evolution des concours de l'Etat aux collectivités locales depuis 1988
(en millions de francs)
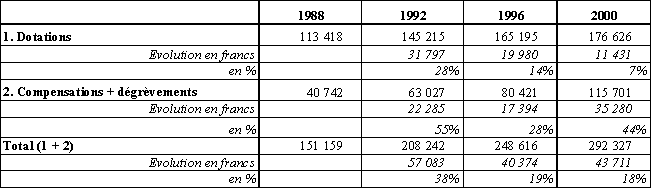 Données chiffrées : lois de
finances
Données chiffrées : lois de
finances
En 1996, les dotations représentaient 66,6 % des concours de l'Etat aux collectivités locales, les compensations 12,6 % et les dégrèvements 20,9 %. En 2000, les dotations sont passées à 57,7 %, les compensations à 20,7 % et les dégrèvements à 21,6 %.
B. L'ENVELOPPE NORMÉE : UN " RENDEZ-VOUS MANQUÉ "
L'article 32 de la loi de finances pour 1996 a regroupé
la
dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le
logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle et au fonds national de
péréquation, la dotation élu local, la dotation globale
d'équipement, la dotation générale de
décentralisation, la dotation de décentralisation pour la
formation professionnelle, la dotation générale de
décentralisation pour la Corse, la dotation départementale
d'équipement des collèges, la dotation régionale
d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe
professionnelle (hors réduction pour embauche et investissement) au sein
d'un "
ensemble
".
Cet "
ensemble
", connu désormais sous le nom
d'enveloppe normée
des concours de l'Etat aux
collectivités locales, comprend toutes les dotations de fonctionnement
et d'investissement de l'Etat (à l'exception du fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée et des amendes de police), ainsi
qu'une compensation d'exonérations fiscales, la dotation de compensation
de la taxe professionnelle.
L'enveloppe normée évolue en fonction d'un taux d'indexation
indépendant du taux d'évolution de chacune de ses composantes.
Entre 1996 et 1998, les modalités d'indexation de l'enveloppe
normée ont pris le nom de "
pacte de
stabilité
". De 1999 à 2001, le pacte a
été remplacé par le "
contrat de croissance et de
solidarité
".
Lors de l'examen par le Sénat du texte qui allait devenir
l'article 32 de la loi de finances pour 1996, le président de la
commission des finances de l'époque, le Président Christian
Poncelet, déclarait : "
Voilà quatre ans, c'est
à cette même tribune que j'ai lancé la formulation de
" pacte de stabilité financière ". Je me réjouis
qu'elle soit aujourd'hui reprise par le Gouvernement. Pourtant, je
n'hésite pas à le dire, je ne reconnais pas mon enfant. Il est
quelque peu défiguré. Je crains que le rendez-vous tant attendu
ne soit un rendez-vous manqué.
"
236(
*
)
Que s'est-il passé ?
1. Concilier maîtrise des dépenses publiques et stabilité des concours aux collectivités locales : une bonne idée ...
a) Maîtriser les dépenses publiques
Les
concours de l'Etat aux collectivités locales ont augmenté
à un rythme très rapide depuis le début des années
80. Ils ont été multipliés par deux entre 1988 et 2000,
passant de 151,1 milliards de francs à 292,3 milliards de francs.
L'évolution d'une telle masse de crédits se doit d'être
suivie avec attention, notamment en période de rareté de la
ressource budgétaire.
Jusqu'au milieu des années 90, il n'existait pas de pilotage d'ensemble
des concours de l'Etat aux collectivités locales, et l'Etat se
contentait de mettre en place des dispositifs destinés à limiter
l'augmentation du montant de ses concours :
- en matière de dotations, les modes d'indexation des enveloppes
était sujets à des révisions fréquentes. Par
exemple, le mode d'indexation de la dotation globale de fonctionnement a
été revu à plusieurs reprises, en fonction de la situation
budgétaire de l'Etat
237(
*
)
. De
même, en 1994, il a été décidé de
procéder à une réfaction du taux de compensation du fonds
de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, dont la seule
justification était la recherche d'économies
budgétaires
238(
*
)
. La réforme de
la DGE en 1995 obéissait à la même logique.
- s'agissant des compensations d'exonérations d'impôts locaux, les
ingénieux mécanismes de réfaction inventés entre
1991 et 1995 ont déjà été
présentés
239(
*
)
. Le coût
des dégrèvements de taxe professionnelle a pour sa part
été contenu par le gel à son niveau de 1995 du taux retenu
pour calculer la fraction des cotisations à la charge de l'Etat :
depuis 1995, toutes les augmentations de taux de taxe professionnelle sont
à la charge des entreprises et non de l'Etat
240(
*
)
.
Ces dispositifs ponctuels ont été mal vécus par les
élus locaux car ils étaient ressentis comme
arbitraires
.
De plus, ils n'ont pas permis de freiner significativement l'augmentation du
coût pour l'Etat des concours financiers aux collectivités
locales.
L'idée d'un " pacte de stabilité financière "
pluriannuel avait donc pour but de créer les
conditions d'une
approche globale
en matière de concours aux collectivités
locales, afin que l'Etat puisse prévoir de manière fiable quelle
serait l'évolution de ses dépenses en faveur collectivités
locales et, le cas échéant, procéder à des
ajustement concernant ses autres postes de dépenses de manière
à respecter une norme globale d'évolution des dépenses
publiques.
b) Améliorer la prévisibilité de l'évolution des budgets locaux
Le
début des années 90 marque l'apparition d'une forte demande de
stabilité financière chez les élus locaux, pour lesquels
l'élaboration de leurs budgets devenait de plus en plus difficile en
raison de la multiplication de mesures imprévues qui se traduisaient par
des dépenses nouvelles, sans que les recettes ne soient modifiées
à due concurrence. La première moitié de la
décennie a ainsi été marquée par des majorations du
taux de cotisation employeur à la caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales (CNRACL) et du forfait hospitalier, par
la prolifération des normes en matière d'environnement et de
sécurité ou encore par la prise en charge par les
collectivités de dépenses relevant de la compétence de
l'Etat, notamment dans le cadre du plan Université 2000. Le rapport
" Delafosse ", remis au Premier ministre en 1994, lançait le
débat sur les transferts de charges " rampantes ".
Parallèlement à cette pression sur les dépenses, les
concours de l'Etat aux collectivités locales étaient soumis
à des fluctuations fréquentes. Le taux d'indexation de la DGF a
été modifié quatre fois entre 1990 et 1995.
En matière fiscale, le Président Poncelet insistait, lors de la
discussion au Sénat du projet de loi de finances pour 1996, sur les
conséquences néfastes sur les budgets locaux "
des
ruptures de contrat
", des "
entorses aux principes de la
compensation
", de la "
suppression des remises en cause des
règles du jeu
[découvertes
], chaque année, lors de
l'examen des articles du projet de loi de finances
".
2. ... qui a été détournée de son objet initial ....
Le pacte
de stabilité issu de l'article 32 de la loi de finances pour 1996, comme
le contrat de croissance et de solidarité prévu par l'article 57
de la loi de finances pour 1999, organisent, pour une période de trois
ans, le
plafonnement du montant total des dotations comprises dans
l'enveloppe normée.
Chacune de ces dotations, à l'exception de la dotation de compensation
de la taxe professionnelle (DCTP), continue d'évoluer en fonction du
taux d'indexation qui est le sien. De son côté, l'enveloppe
normée évolue en fonction d'un mode d'indexation qui lui est
propre. La DCTP joue le rôle de variable d'ajustement du
dispositif : son montant est égal à la différence
entre le montant total de l'enveloppe normée et le montant de la somme
des différentes dotations qui la composent.
Les taux d'indexation retenus pour l'enveloppe normée reflètent
la situation macroéconomique du pays. En 1996, en période de
basse conjoncture, l'indexation retenue était le taux d'évolution
des prix. En 1999, l'amélioration de la situation économique a
permis de prendre en compte une fraction du taux de croissance du produit
intérieur brut (PIB) dans le taux d'indexation de l'enveloppe
normée. Cette fraction s'établit à 20% pour 1999, 25 %
pour 2000 et 33 % pour 2001.
Ce mécanisme ne permet pas d'atteindre l'objectif de stabilité
financière recherché par les élus locaux :
- malgré son caractère pluriannuel, il ne permet pas de
remédier à l'imprévisibilité de l'évolution
des concours de l'Etat aux collectivités locales. Comme le soulignait le
rapporteur général de la commission des finances, notre
collègue Alain Lambert, "
l'évaluation a priori de leur
DCTP par les collectivités devient rigoureusement
impossible
"
241(
*
)
. De même, les
dotations indexées sur le taux d'évolution de la DGF
restent
soumises aux conséquences sur ce taux des mécanismes de recalage
et de régularisation, qui le rendent totalement
imprévisibles
. Les dotations de l'Etat aux fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle et au fonds national de
péréquation, indexées sur l'évolution des recettes
fiscales nettes de l'Etat sont également tributaires des modifications
du périmètre du budget général ;
- il remet en cause le principe de la compensation des exonérations
d'impôts locaux en transformant la DCTP en
variable
d'ajustement
;
- il aboutit à une
perte de recettes pour les collectivités
locales
. En effet, tant que l'augmentation du montant total de l'enveloppe
normée reste inférieure à celle de l'ensemble des
dotations qui composent l'enveloppe (à l'exception de la variable
ajustement), l'Etat réalise des économies puisque l'écart
entre les deux progressions se traduit par une baisse de la DCTP. Ce
phénomène s'explique par le fait que, pour le calcul de
l'enveloppe normée, la principale dotation qui la compose, la DGF,
évolue en fonction d'un indice qui prend en compte l'évolution
des prix et 50 % du taux de croissance du produit intérieur brut. La DGF
augmente plus vite que l'enveloppe normée, ce qui se traduit par une
baisse de la DCTP ;
- il repose sur une
logique purement budgétaire
et, comme le
faisait remarquer le président Poncelet, ne s'étend pas
"
à l'ensemble des flux financiers entre l'Etat et les
collectivités locales
". Alors que les élus locaux
attendaient principalement la création d'un
lien entre
l'évolution de leurs charges et celle des dotations de l'Etat
, le
dispositif proposé en 1996 et repris en 1999 laisse de côté
cette question. Il ne tient aucun compte de l'évolution des charges
locales et ne s'interroge pas sur l'efficacité et le caractère
adapté ou non des dotations de l'Etat aux collectivités locales.
Au contraire, l'ensemble des dotations de fonctionnement et d'investissement
sont maintenues en l'état, le seul changement résidant dans le
régime de la DCTP, qui devient la
dotation
"
sacrifiée
".
La création de l'enveloppe normée s'apparente donc surtout
à une nouvelle astuce destinée à réduire le montant
des compensations versées aux collectivités locales
. De fait,
le montant de la DCTP inscrit en loi de finances est passé de
19,1 milliards de francs en 1995 à 11,8 milliards de francs en
2000.
Comme le soulignait le Président Poncelet dès 1995, le dispositif
de l'enveloppe normée "
reflète avant tout, une fois de
plus, la volonté du Gouvernement d'utiliser les concours qu'il verse aux
collectivités locales comme la variable d'ajustement de son propre
budget
".
3. ... et qui n'a pas modifié la nature des relations financières entre l'Etat et les collectivités locales
L'utilisation d'expressions telles que " pacte de
stabilité " et " contrat de croissance et de
solidarité " ne traduit pas la réalité du
fonctionnement du mécanisme de l'enveloppe normée depuis 1996.
Notre collègue député Didier Migaud, lors de la discussion
du projet de loi de finances pour 1996, soulignait ainsi : "
Le
pacte, c'est quoi ? C'est un accord, une convention, un contrat. Encore
faut-il qu'il y ait plusieurs personnes et que les autres aient exprimé
un accord ! Le mot " pacte " ne s'applique donc pas du tout
à ce que vous nous proposez
: il s'agit en fait d'une
décision unilatérale de l'Etat
.
"
242(
*
)
La création de l'enveloppe normée n'a pas permis de créer
les conditions d'un
débat constructif entre l'Etat et les
collectivités locales
:
- l'Etat, en choisissant d'appliquer à l'enveloppe des taux d'indexation
tellement restrictifs qu'ils sont par avance intenables, a marqué sa
volonté de ne pas rompre avec la
pratique des " rallonges "
accordées au coup par coup
, et dont la médiatisation permet
d'occulter le fait que leur montant est sans rapport avec l'évolution
des charges des collectivités locales. Dans la loi de finances pour
2000, année qui a connu le plus d' " abondements
extérieurs "
243(
*
)
à
l'enveloppe normée, leur montant s'est établi à
1,35
milliard de francs
. A titre de comparaison, le surcoût pour
l'année 2000 du seul accord salarial dans la fonction publique du 10
février 1998 s'élève à
3,5 milliards de
francs
;
- à l'inverse, les collectivités locales sont placées
en position de faiblesse
. Elles sont à la merci du
bon vouloir
de l'Etat
en matière budgétaire et présentent, chaque
année à l'occasion de la discussion budgétaire, l'image
peu flatteuse d'un lobby dépensier contraint de quémander des
subventions supplémentaires.
L'incompréhension entre le financeur et les bénéficiaires
de l'enveloppe normée provient principalement de l'importance des
baisses de DCTP supportées par les collectivités locales, dont
l'ampleur apparaît choquante, arbitraire voire injustifiée puisque
les baisses sont les plus élevées lorsque la DGF augmente
beaucoup, c'est-à-dire en période de forte croissance
économique.
Pour cette raison, à l'occasion de l'examen des projets de loi de
finances pour 1999 et 2000, le Sénat a porté la fraction du taux
de croissance du PIB pris en compte pour le calcul de l'enveloppe normée
à 50 %
244(
*
)
. En alignant le taux
de croissance de l'enveloppe normée sur celui de sa principale
composante, la DGF, ce dispositif permettait, pour un coût
budgétaire limité, une quasi stabilisation du montant de la DCTP.
L'objectif de plafonnement du montant des concours de l'Etat était
respecté sans pour autant aboutir forcément à
réduire le montant de la DCTP. La Haute Assemblée n'a pas
été suivie sur ce point par le Gouvernement et la majorité
de l'Assemblée nationale.
V. LA PÉRÉQUATION EN PANNE
A. LE CONTRASTE ENTRE LES BESOINS ET LES CREDITS
1. Les difficultés de mesurer les écarts de richesse
La
mesure des écarts de développement et de richesse entre les
différentes parties du territoire se heurte à de
nombreuses
difficultés
.
Une première difficulté provient de la
détermination du
périmètre des territoires pris en compte
. Les écarts
au sein d'une même commune, d'un même département et, a
fortiori, d'une même région peuvent être importants.
Une deuxième difficulté résulte du
choix des
indicateurs retenus pour déterminer les écarts
. Ces
indicateurs peuvent être des données économiques, telles
que le produit intérieur brut par habitant, le revenu par habitant ou le
taux de chômage. Les zonages d'aménagement du territoire et les
zonages européens privilégient ce type de critères.
Les critères peuvent également être fiscaux. Le
ministère de l'intérieur calcule le potentiel fiscal des
différentes collectivités, qui permet de comparer leurs bases
fiscales par habitant
245(
*
)
, et l'effort
fiscal, qui mesure la pression fiscale locale pesant sur les contribuables
d'une collectivité
246(
*
)
. Ces
indicateurs sont pris en compte pour le calcul des dotations de l'Etat aux
collectivités locales. Ils sont parfois combinés, pour
l'élaboration d'" indices synthétiques ", avec des
données économiques et sociales, telles que la longueur de
voirie, le nombre d'élèves, la proportion de logements sociaux ou
le nombre de bénéficiaires d'aides au logement.
La combinaison de plusieurs critères au sein d'indices
synthétiques a pour but de permettre de
saisir de manière
globale la situation d'une collectivité
. Néanmoins,
aucun
des instruments existant aujourd'hui n'apporte de garantie de fiabilité
totale
. Par exemple, l'indice qui détermine
l'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine
(DSU) prend en compte le potentiel fiscal, les bénéficiaires
d'aide au logement, le revenu par habitant et la proportion de logement
sociaux. Malgré le grand nombre de critères, de nombreuses
communes, pourtant manifestement défavorisées, ne sont pas
éligibles à cette dotation car les personnes
défavorisées résidant sur leur territoire occupent
habitent des logements privés relevant du " parc social de
fait " plutôt que des logement sociaux au sens strict.
Différentes techniques pour cibler les territoires prioritaires
Les
critères
d'éligibilité à la prime
d'aménagement du territoire
après la réforme de
1999 :
- parmi les zones dont le revenu net imposable moyen par foyer fiscal est
inférieur à la moyenne nationale, ont été
retenues : (1) les zones dont le taux de chômage au 31
décembre 1998 était supérieur à la moyenne
nationale et (2) les zones dont le déclin démographique entre
1990 et 1995 est supérieur à 1,2 % ;
- parmi les zones présentant un risque industriel (importance d'emplois
industriels sensibles, nombre d'emplois ayant fait l'objet d'une
décision ou d'une annonce de restructuration depuis 1996), ont
été retenues celles dont le taux de chômage est
supérieur à 10 % ;
- les zones perdant l'éligibilité à l'ancien objectif 1
des fonds structurels européens ;
- les franges de certaines grandes agglomérations confrontées
à un taux de chômage supérieur à 13,9 % (Marseille,
Montpellier, Bordeaux, Rouen, Amiens).
Les critères de
l'objectif 2 des fonds structurels
après
la réforme de 1999 :
- pour moitié, la population régionale vivant dans les zones
d'emplois industriel ou rural dégradé (taux de chômage et
taux d'emploi industriel supérieurs à la moyenne communautaire et
pertes d'emplois industriels depuis six ans, densité de population
inférieure à 100 habitants au kilomètre-carré ou
taux d'emploi agricole supérieur au double de la moyenne de l'Union et
déclin démographique ou chômage inférieur à
la moyenne) ;
- pour un quart, la population régionale habitant dans une zone urbaine
sensible ;
- pour un quart, la population régionale habitant dans une zone de
revitalisation rurale.
Les
zonages d'aménagement du territoire
:
- les
zones de revitalisation rurale
comprennent les communes
appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaires
situées soit dans les arrondissements dont la densité
démographique est inférieure ou égale à 33
habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la
densité démographique est inférieure ou égale
à 31 habitants au kilomètre carré, dès lors que ces
arrondissements ou cantons satisfont également l'un des trois
critères suivants : le déclin de la population totale ;
le déclin de la population active ; un taux de population active
agricole supérieur au double de la moyenne nationale. Elles comprennent
également les communes situées dans les cantons dont la
densité démographique est inférieure ou égale
à cinq habitants au kilomètre carré ;
- les
zones de revitalisation urbaine
appartiennent aux ZUS et sont
confrontées à des difficultés particulières
appréciées en fonction d'un indice établi à partir
de la population du quartier, de la proportion de jeunes de moins de 25 ans, de
la proportion de jeunes sortis du système scolaire sans diplôme,
du potentiel fiscal des communes intéressées ;
- les
zones franches urbaines
sont un sous ensemble des ZRU
caractérisé par un taux de chômage supérieur
à 13,5 %, un pourcentage de jeunes de moins de 25 ans supérieur
à 36 %, un pourcentage de non diplômés supérieur
à 29 % et un potentiel fiscal communal inférieur à 3.800
francs. En outre, la commission européenne a imposé à la
France que les zones franches urbaines ne regroupent pas plus de 1 % de la
population totale.
L'indice synthétique qui détermine l'éligibilité
à la
DSU
tient compte du potentiel fiscal (45 %), de la
proportion de logements sociaux (15 %), du nombre de
bénéficiaires d'aides au logement (30 %) et du revenu par
habitant (10 %)
Pour avoir une idée vraiment fine de la richesse d'un territoire, il
peut sembler opportun de
considérer ses ressources au regard des
charges des collectivités
qui le composent. En effet, les
territoires les plus riches sont parfois également ceux qui doivent
assumer
les charges
les plus
importantes
. Telle fut la
démarche du Sénat lors de l'examen de la loi d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire n° 95-9 du 4
février 1995 dont l'article 68, adopté à son
initiative, prévoit que "
l'ensemble des ressources, hors
emprunt, des collectivités territoriales et de leurs groupements, au
sein d'un même espace régional, fait l'objet d'un calcul
cumulé. Ces ressources comprennent les concours de toute nature
reçus de l'Etat, les recettes de péréquation provenant de
collectivités territoriales extérieures à l'espace
considéré, les bases de calcul de l'ensemble des ressources
fiscales multipliées pour chaque impôt ou
taxe par le taux
ou le montant unitaire moyen national d'imposition à chacun de ces
impôts ou de ces taxes, les produits domaniaux nets de la région,
des départements qui composent celle-ci, des communes situées
dans ces départements et de leurs groupements.
Les ressources ainsi calculées, rapportées, par an, au nombre des
habitants de l'espace régional considéré, sont
corrigées afin de tenir compte des charges des collectivités
considérées et de leurs groupements.
"
L'objectif de cette disposition était de réaliser,
"
à compter du 1
er
janvier 1997, une
péréquation financière
(...)
entre les espaces
régionaux de métropole
", les ressources de chaque
région, pondérées par ses charges, ne pouvant
"
être supérieures à 80 p. 100 ni excéder
120 p. 100 de la moyenne nationale par habitant des ressources des
collectivités territoriales et de leurs groupements.
"
Les difficultés posées par l'évaluation de la richesse
d'une région apparaissent dans le tableau ci-dessous. Même si
certaines régions sont généralement dans les
premières places pour chacun des indicateurs sélectionnés
tandis que d'autres sont plus souvent moins bien placées,
les
critères ne jouent jamais de manière unilatérale
.
Ainsi, on constate que la région de Haute-Normandie cumule le PIB par
habitant le plus élevé après la région
Ile-de-France avec le 19
ème
rang des régions
métropolitaines en matière de taux de chômage. Le Limousin
bénéficie du taux de chômage le plus faible après
l'Alsace mais se classe au 21
ème
rang pour le PIB par
habitant et supporte la plus forte pression fiscale des régions de
métropole.
Les mêmes difficultés sont rencontrées à
l'intérieur de chaque région, voire de chaque
département.
|
Régions |
PIB/hab. 1996 |
|
|
Part des prestations sociales dans le revenu disponible brut des ménages 1996 (en %) |
Potentiel fiscal 2000
|
Effort
fiscal 2000
|
|
Alsace |
136.312 (3) |
7,9 (1) |
57,1 (2) |
32,6 (5) |
477,14 (3) |
0,96 (6) |
|
Aquitaine |
119.828 (7) |
13,4 (16) |
45,5 (12) |
37,2 (11) |
386,56 (12) |
1,04 (8) |
|
Auvergne |
108.501 (18) |
11,3 (6) |
43,8 (17) |
38,5 (15) |
365,56 (15) |
1,27 (13) |
|
Basse Normandie |
115.300 (12) |
12,1 (11) |
44,5 (14) |
36 (2) |
414,58 (7) |
1,48 (20) |
|
Bourgogne |
117.220 (11) |
11,8 (10) |
48,6 (7) |
38,6 (16) |
394,54 (11) |
0,98 (7) |
|
Bretagne |
111.964 (15) |
11,5 (7) |
44,4 (15) |
36,5 (10) |
343,06 (20) |
1,26 (12) |
|
Centre |
118.660 (9) |
11,7 (9) |
50,9 (4) |
37,5 (13) |
403,80 (9) |
1,34 (15) |
|
Champagne Ardennes |
122.015 (5) |
12,8 (14) |
47,9 (9) |
35,4 (7) |
408,60 (8) |
1,18 (9) |
|
Corse |
106.350 (20) |
13,5 (17) |
38,7 (22) |
47,1 (22) |
342,41 (21) |
0,86 (3) |
|
Franche Comté |
120.172 (6) |
10,3 (3) |
48,4 (8) |
36,5 (9) |
424,71 (6) |
1,29 (14) |
|
Haute Normandie |
137.351 (2) |
14,8 (19) |
50,2 (5) |
37 (4) |
461,52 (4) |
1,41 (18) |
|
Ile de France |
207.278 (1) |
10,9 (4) |
64,4 (1) |
30 (1) |
670,58 (1) |
0,58 (1) |
|
Languedoc Roussillon |
101.553 (22) |
17,2 (22) |
41,4 (21) |
43,4 (20) |
360,71 (18) |
1,34 (16) |
|
Limousin |
105.392 (21) |
9,7 (2) |
43,7 (18) |
44,2 (21) |
341,85 (22) |
1,75 (22) |
|
Lorraine |
114.976 (13) |
11,6 (8) |
46,4 (11) |
39,1 (17) |
401,69 (10) |
0,87 (4) |
|
Midi Pyrénées |
113.068 (14) |
12,2 (12) |
44,3 (16) |
39 (3) |
364,68 (16) |
1,52 (21) |
|
Nord - Pas de Calais |
110.783 (16) |
16,3 (21) |
42,5 (20) |
41,4 (19) |
361,56 (17) |
1,40 (17) |
|
Pays de Loire |
118.104 (10) |
12,6 (13) |
44,7 (13) |
35,6 (8) |
374,11 (14) |
1,21 (10) |
|
Picardie |
109.835 (17) |
13,7 (18) |
47,8 (10) |
37,3 (12) |
383,62 (13) |
1,46 (19) |
|
Poitou Charentes |
108.006 (19) |
13,2 (15) |
42,7 (19) |
38,3 (14) |
348,24 (19) |
1,25 (11) |
|
PACA |
119.211 (8) |
16 (20) |
48,9 (6) |
39,7 (18) |
442,59 (5) |
0,80 (2) |
|
Rhône Alpes |
130.178 (4) |
11,2 (5) |
51,4 (3) |
35,2 (6) |
483,32 (2) |
0,96 (5) |
Entre parenthèses : rang de classement de " richesse ". Source : INSEE, DGCL.
2. Un faible volume de crédits
Les
instruments financiers de la péréquation peuvent être
rangés dans
trois catégories
:
- la
dotation globale de fonctionnement
(DGF). Premier concours de
l'Etat aux collectivités locales, l'enveloppe de la DGF des communes est
divisée en deux sous-dotations, la dotation forfaitaire et la dotation
d'aménagement. La vocation de la dotation d'aménagement est de
bénéficier aux communes " défavorisées "
et aux structures intercommunales. Elle est elle-même divisée en
trois enveloppes : la dotation d'intercommunalité versée aux
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre, la dotation de solidarité urbaine
(DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR). La DGF des
départements est elle aussi partagée entre une dotation
forfaitaire et une dotation de péréquation ;
- les
fonds de péréquation
. L'inégale
répartition des bases de taxe professionnelle sur le territoire est la
première cause d'inégalité de richesse entre
collectivités. Par conséquent, la création de la taxe
professionnelle en 1975 s'est accompagnée de la création de fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
(FDPTP) qui ont pour but, lorsqu'il existe dans une commune un
établissement dit " exceptionnel ", c'est-à-dire dont
les bases par habitant sont supérieures à deux fois la moyenne
nationale des bases par habitant, de répartir le produit correspondant
aux bases supérieures à deux fois la moyenne nationale entre les
autres communes du départements. Ces fonds sont gérés par
les conseils généraux.
Les fonds départementaux, qui redistribuent entre des
collectivités des recettes de taxe professionnelle, ont ensuite
été complétés par la création de fonds
nationaux de péréquation, qui versent des attributions aux
communes mal dotées en bases fiscales. Le fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) est issu de
l'article 6 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité directe locale. Il a été scindé par la
loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire du 4 février 1995, dont l'article 70 crée le fonds
national de péréquation (FNP).
- les
mécanismes de solidarité financière entre
collectivités
. Le fonds de solidarité des communes de la
région Ile-de-France (FSRIF), la dotation de fonctionnement minimale
(DFM) des départements et le fonds de correction des
déséquilibres régionaux (FCDR) prélèvent une
partie des recettes fiscales de collectivités " riches " pour
les redistribuer, en fonction de critères fixés par la loi,
à des collectivités moins " favorisées ".
L'ensemble de ces instruments représente un
montant très
limité au regard de l'ensemble des ressources des collectivités
locales
. Les transferts de l'Etat ayant une vocation
péréquatrice s'élèvent en 2000 à 18,5
milliards de francs, soit 10,4 % du montant total des dotations de l'Etat.
Les FDPTP ont redistribué en 1999 moins de 3 % du produit de la taxe
professionnelle perçu par les communes 2,9 milliards de francs sur 97,8
milliards de francs).
Les crédits de la péréquation en 2000
(en millions de francs)
|
Péréquation nationale |
Solidarité entre collectivités |
||
|
DSU métropole. |
3.618 |
FSRIF 726 |
726 |
|
DSR métropole |
593 |
FCDR393 |
393 |
|
FNPTP (pertes de bases) |
919 |
DFM 875 |
875 |
|
FNPTP (pertes de DCTP) |
892 |
|
|
|
FNP |
3.815 |
FDPTP (en 1998) |
2.929 |
|
Dotation de péréquation de la dotation d'intercommunalité |
5.077 |
|
|
|
1 ère part de la dotation de péréquation de la DGF des départements |
3.607 |
|
|
|
TOTAL |
18.521 |
TOTAL |
4.675 |
Données chiffrées : Ministère de l'intérieur
3. La péréquation : du " saupoudrage " ?
Les instruments financiers de la péréquation sont nombreux , leur fonctionnement est complexe et le montant de leurs ressources est limité . A ces trois défauts s'ajoutent des critères d'éligibilité larges , qui conduisent à répartir des enveloppes réduites entre de nombreux bénéficiaires.
Les bénéficiaires de la péréquation en 2000
|
|
Nombre de bénéficiaires (hors garantie) |
Dotation moyenne par habitant
|
Dotation maximale par habitant
|
Dotation minimum par habitant
|
|
DSR " bourgs-centres " |
4.043 |
71 |
139 |
0,8 |
|
DSR " péréquation " |
33.644 |
51 |
1.531 1 |
10 |
|
FSRIF (entre 5 et 10.000 habitants) |
19 |
172 |
316 |
31 |
|
FSRIF (plus de 10.000 habitants) |
122 |
220 |
429 |
34 |
|
DSU (entre 5 et 10.000 habitants) |
102 |
154 |
284 |
72 |
|
DSU (plus de 10.000 habitants) |
686 |
154 |
607 |
26 |
|
FNP (total) |
17.619 |
113 |
1.506 2 |
8 |
|
FNP " part principale " |
17.619 |
88 |
1.056 3 |
8 |
|
FNP " majoration " |
15.981 |
35 |
576 4 |
12 |
1
Seules 11 communes perçoivent plus
de 600
francs par habitant.
2
Seules 6 communes perçoivent plus de 350 francs par
habitant.
3
Seules 6 communes perçoivent plus de 300 francs par
habitant.
4
Seules 4 communes perçoivent plus de 65 francs par
habitant.
Source : Direction générale des collectivités locales
B. LA FAIBLESSE DES INSTRUMENTS EXISTANTS
1. La DGF des communes est peu péréquatrice
a) Les modalités de répartition de la DGF des communes et des structures intercommunales
La
structure actuelle de la DGF a été conçue pour renforcer
progressivement le poids de la péréquation dans la masse totale
des crédits. Avant 1993, la DGF était partagée en une
dotation de base, une dotation de compensation et une dotation de
péréquation.
En 1993, ces trois sous-dotations ont été fusionnées en
une seule dotation forfaitaire et une nouvelle sous-dotation à vocation
péréquatrice, la dotation d'aménagement, a
été créée. Elle regroupe la dotation
d'intercommunalité
247(
*
)
, la dotation de
solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.
L'objectif de cette réforme était de maintenir à toutes
les communes une dotation égale à son montant de 1993 et, pour
les années suivantes, d'accorder à la dotation
d'aménagement une part croissante des crédits
supplémentaires.
Pour atteindre cet objectif la répartition de la DGF s'effectue de la
manière suivante :
- la masse totale des crédits à répartir est
définie par la loi de finances ;
- le comité des finances locales décide quelle proportion de
l'augmentation de la masse il va accorder à la dotation forfaitaire.
Cette proportion peut varier entre 50 % et 55 %. En d'autres termes,
la dotation forfaitaire bénéficie au minimum de la moitié
des crédits supplémentaires au titre d'une année, et au
maximum de 55 % des crédits supplémentaires ;
|
Architecture de la dotation globale de fonctionnement |
|
Evolution |
|
|
|
|
|
|
|
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT |
|
Taux de
la DGF :
|
|
|
|
|
|
|
|
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES DEPARTEMENTS |
|
Taux de
la DGF :
|
|
|
|
|
|
|
|
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES ET GROUPEMENTS |
|
Taux de
la DGF :
|
|
|
|
|
|
|
|
DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES |
|
Taux : de 50 % à 55 % du taux de la DGF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Différence entre DGF des communes et groupements et dotation forfaitaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En fonction de la population regroupée et de la dotation par habitant |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Différence entre dotation d'aménagement et dotation des groupements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Croissance de la DSU et de la DSR entre 45 % et 55 % du solde |
|
|
|
|
|
|
QUOTE-PART
|
QUOTE-PART
|
|
Montants de la DSU et de la DSR pondérés par le rapport entre la population outre-mer et la population nationale |
|
|
|
|
|
|
DSU METROPOLE |
DSR METROPOLE |
|
DSU ET DSR diminuées des quotes-parts |
- une
fois défini le montant de la dotation forfaitaire, le solde constitue le
montant de la dotation d'aménagement. Au sein de cette dotation , le
comité des finances locales fixe ensuite le montant de la dotation
d'intercommunalité ;
- une fois établi le montant de la dotation d'intercommunalité,
le solde des crédits disponibles est réparti entre la DSU et la
DSR.
Par conséquent,
la DGF étant une enveloppe fermée, la
DSU et la DSR jouent le rôle de variable d'ajustement
. Plus la
dotation forfaitaire augmente, et moins la dotation d'aménagement
augmente. Au sein de la dotation d'aménagement, plus la dotation
d'intercommunalité augmente, et moins la DSU et la DSR augmentent (elles
peuvent même diminuer).
b) Les crédits consacrés à la péréquation ne parviennent pas à " décoller "
La
réforme de la DGF de 1993 a permis de faire passer la part de la
dotation d'aménagement dans la masse totale des crédits de la DGF
des communes de 5,8 % en 1993 à 8,3 % en 1995. En 1995, des
simulations réalisées par la direction générale des
collectivités locales envisageaient que la dotation d'aménagement
pourrait représenter 15,7 % de la DGF des communes en 2000. Ces
simulations tablaient sur un taux de croissance de la DGF de 3,5 % par an,
qui aurait permis d'atteindre un montant de 98,9 milliards de francs en
2000.
En fait, le montant total de la DGF des communes et des groupements
s'élève en 2000 à 93,4 milliards de francs,
soit 5
milliards de moins que prévu
. Ce montant n'a pu être atteint
que parce que la masse de la DGF résultant des mécanismes
d'indexation de cette dotation fait l'objet de majorations par les lois de
finances. Le montant qui résulte de la seule évolution
" naturelle " de la DGF n'est que de 91,5 milliards de francs.
La part de la dotation d'aménagement dans ce total n'est que de
11,5 %. En tenant compte des majorations dont bénéficie la
DGF, qui ne concernent que la dotation d'aménagement, la part de la
dotation d'aménagement passe à 13 %.
La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité
rurale sont particulièrement pénalisées par les
modalités actuelles de répartition de la DGF :
- la progression de la dotation d'intercommunalité aboutit à
stabiliser la part de la DSU et de la DSR au sein de la dotation
d'aménagement :
La répartition " spontanée " de la dotation d'aménagement
|
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Partage
(en %) de la dotation d'aménagement entre EPCI et DSU-DSR
résultant des mécanismes de répartition (
hors
abondements
) :
|
57,8
|
59,1
|
57
|
55
|
58,5
|
Données chiffrées : Comité des finances locales
- en conséquence, la part des crédits de la DSU et de la DSR résultant des mécanismes de répartition de la DGF plafonne à 5 % du total :
Evolution de la part de la DSU et de la DSR dans le total de la DGF
(en millions de francs)
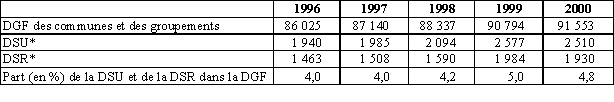
* Les montant retenus sont les montants hors contributions et hors abondements
budgétaires.
Données chiffrées : Comité des finances locales.
Lors de
son audition par la mission le 8 mars 2000, M. Alain Guengant, professeur
à l'université de Rennes, a estimé que "
le mode
répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) permettait de
corriger 40 % des écarts de potentiel fiscal, mais que ce taux
n'avait pas augmenté depuis de nombreuses années
".
Les gouvernements successifs ont tenté de limiter les
conséquences des mécanismes de répartition de la DGF sur
la DSU et la DSR par deux moyens :
- la
modification des règles applicables
: afin de limiter
l'augmentation de la dotation forfaitaire liée à la prise en
compte des résultats du recensement, la loi du 28 décembre 1999
relative à la prise en compte des résultats du recensement
général de 1999 dans la répartition des dotations de
l'Etat aux collectivités locales a prévu que les augmentations de
population constatées en 1999 seraient intégrées au calcul
des attributions de dotation forfaitaire en trois ans, de manière
à éviter une augmentation brutale de la dotation forfaitaire, et
donc une réduction à due concurrence du montant de la DSU et de
la DSR ;
- l'
augmentation
des crédits disponibles
: en
théorie, la DGF est une enveloppe fermée, ce qui signifie que
lorsque le montant de l'une de ses composantes augmente, cela se traduit par
une réduction symétrique du montant des autres composantes. Afin
de limiter les conséquences du jeu de la répartition à
enveloppe fermée, le montant des dotations de solidarité fait
l'objet de majorations par des crédits extérieurs à la
DGF. La première majoration de ce type a été
décidée par l'article 73 de la loi d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire du 4
février 1995, qui a prévu que les crédits
" libérés " par l'extinction progressive de la DGF de
la région Ile-de-France viendraient abonder la dotation de
fonctionnement minimale des départements, la DSU et la DSR.
Depuis,
le recours aux abondements extérieurs s'est
multiplié
. Pour les années 1999 à 2001, le contrat de
croissance et de solidarité prévoit une majoration de 500
millions de francs de la DSU. La loi de finances pour 2000 a majoré la
masse totale de la dotation d'aménagement de 200 millions de francs, la
DSU de 500 millions de francs et la DSR " bourgs-centres " de 150
millions de francs supplémentaires. En outre, pour limiter l'impact du
développement de l'intercommunalité sur la DSU et la DSR, la loi
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale a prévu que les nouvelles
communautés d'agglomération ne seraient pas financées par
les crédits " classiques " de la DGF, mais par des
crédits supplémentaires qui abonderaient le montant de la
dotation d'intercommunalité.
Les majorations du montant des dotations de solidarité permettent de
limiter les effets de la répartition sur la DSU et la DSR.
L'évolution de la DGF et de ses composante avant et après prise en compte des contributions et abondements budgétaires
(en %)
|
|
1999 |
2000 |
|
DGF
totale
|
+ 2,7 |
+ 0,8 |
|
Après abondements et contributions |
+ 3,2 |
+ 2 |
|
Dotation de solidarité urbaine
|
+ 23 |
- 2,6 |
|
Après abondements et contributions |
+ 44,9 |
+ 14,0 |
|
Dotation de solidarité rurale
|
+ 24,5 |
- 2,7 |
|
Après abondements et contributions |
+ 24,8 |
+ 6,1 |
Données chiffrées : Lois de finances, Comité des finances locales
Cependant, les majorations ne permettent pas de modifier la
structure de la répartition de la DGF, qui reste dominée par le
poids de la dotation forfaitaire
. Sept ans après l'entrée
en vigueur de la réforme de 1993, la répartition de la DGF en
2000, en tenant compte des abondements dont ont bénéficié
les dotations de solidarité, produit le résultat suivant :
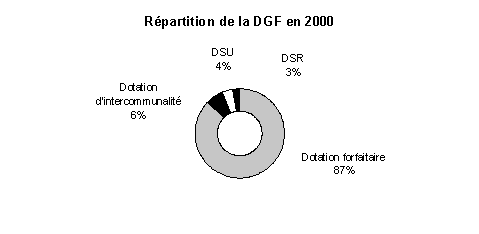
Complexité et péréquation
Le
recours à des abondements extérieurs pour augmenter le montant
des dotations de solidarité constitue depuis 1998 une
source de
complexification
des modalités de répartition de la DGF, qui
sont désormais
plus opaques que jamais
. Par exemple, en 2000, le
montant de la dotation d'aménagement qui résulte des
mécanismes de répartition de la DGF s'élève
à 10.215 millions de francs alors que la somme du montant de ses
composantes (dotation d'intercommunalité, DSU et DSR)
s'élève à 12.084 millions de francs.
Néanmoins, compte tenu de l'architecture d'ensemble du système de
répartition de la DGF,
la complexité semble devenue le prix
à payer pour atteindre les objectifs recherchés
.
En 2000, la DSU a été majorée de 500 millions de francs
supplémentaires et la fraction " bourgs-centres " de la DSR a
été majorée de 150 millions de francs. Ces
opérations ont permis à la DSU de progresser de 14 % et
à la DSR " bourgs-centres " d'augmenter de 24,9 %.
A la demande de votre rapporteur, le ministère de l'intérieur a
simulé quel aurait été le taux de progression de ces deux
dotations si, au lieu de les abonder respectivement de 500 millions de
francs et de 150 millions de francs la masse totale des crédits à
répartir entre elles avait fait l'objet d'un abondement global de 650
millions de francs. Dans ce cas de figure, la DSU aurait augmenté de
9,7 % au lieu de 14 %, et la DSR " bourgs-centres " de
seulement 2,2 % au lieu de 24,9 %.
c) L'origine du blocage
La part de la dotation d'aménagement dans le total de la DGF des communes aurait pu être plus élevée si le comité des finances locales avait choisi, chaque année, de favoriser le plus possible la dotation d'aménagement au détriment de la dotation forfaitaire. Le comité peut en effet choisir d'accorder entre 50 % et 55 % du taux de croissance de la DGF à la dotation forfaitaire. Or, au cours des cinq dernières années, il n'a choisi de limiter à 50 % la progression de la dotation forfaitaire qu'une fois, en 1996. Plus les dotations de solidarité bénéficient d'abondements dans le cadre des lois de finances, et plus le comité des finances locales choisit de privilégier la dotation forfaitaire.
Evolution de la part de l'augmentation de la DGF consacrée à la dotation forfaitaire par le comité des finances locales
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
50 % |
52 % |
53 % |
54 % |
55 % |
Source : Comité des finances locales
Cette
situation s'explique par plusieurs raisons :
- l'ensemble des communes doit faire face à des augmentations de
charges, de personnel surtout, qui conduisent le comité à faire
en sorte que la principale dotation de fonctionnement, la dotation forfaitaire,
évolue à un rythme convenable
;
- compte tenu des critères d'éligibilité à la
dotation de solidarité urbaine, certaines communes ne sont pas
éligibles à cette dotation alors même qu'elles ne peuvent
pas être considérées comme favorisées.
Une
progression trop faible de la dotation forfaitaire les pénaliserait
durement
;
- depuis 1996, la répartition de la DGF entre dotation forfaitaire et
dotation d'aménagement doit prendre en compte les effets du
système de l'" enveloppe normée " des concours de
l'Etat aux collectivités locales, qui aboutissent à une baisse
annuelle du montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
(DCTP). Pour certaines communes, notamment celles qui ne sont pas
éligibles à la DSU ou la DSR, les baisses annuelles de DCTP sont
parfois supérieures aux augmentations de DGF. Par conséquent,
afin de ne pas handicaper plus ces communes,
le comité des finances
locales est contraint de garantir une progression minimale de la dotation
forfaitaire.
Autrement dit, les taux de progression de l'enveloppe
normée retenus par le pacte de stabilité et de croissance, puis
par le contrat de croissance et de solidarité, ont contribué
à
freiner le développement de la péréquation au
sein de la DGF.
En tout état de cause, même si le comité des finances
locales favorisait chaque année au maximum la dotation
d'aménagement au détriment de la dotation forfaitaire,
l'équilibre général ne s'en trouverait pas
fondamentalement modifié. En 2000, l'affectation à la dotation
forfaitaire de 50 % du taux de croissance de la DGF aurait aboutit
à majorer la dotation d'aménagement de seulement 32 millions de
francs. En 1999, le gain pour la dotation d'aménagement aurait
représenté 1,2 milliard de francs. Ces montants sont à
comparer avec le montant total de la dotation forfaitaire, qui
s'élève à plus de 80 milliards de francs.
L'incapacité de la dotation d'aménagement à
accroître sa part dans le montant total de la DGF des communes provient
en réalité de la règle selon laquelle la dotation
forfaitaire bénéficie d'au moins la moitié de la
croissance du montant de la DGF.
2. Les fonds nationaux de péréquation
a) Des fonds à l'objet de moins en moins défini
Lorsque
l'article 6 de la loi du 10 janvier 1980 a institué un fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), son objet
était clair. La rédaction, en vigueur, de cet article
prévoit que "
les ressources du fonds sont versées aux
communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la
moitié de la moyenne nationale et dont les impôts sur les
ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale
ramenées à l'habitant dans leur groupe démographique. Les
attributions allouées à ce titre sont déterminées
en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la
moyenne nationale, du montant des bases de taxe professionnelle par
habitant.
"
Il s'agissait donc de verser à certaines communes
" pauvres " (dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur à la moyenne nationale) des attributions
destinées à compenser leur faible richesse en bases de taxe
professionnelle (leur montant est proportionnel à l'écart de
leurs bases par habitant par rapport à la moyenne nationale).
Aujourd'hui, il n'y plus un fonds mais deux. L'article 70 de la loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire du 4 février 1995 a transformé l'ancienne
première part de la deuxième fraction du FNPTP en un fonds
à part entière, le fonds national de péréquation
(FNP) régi par les dispositions de l'
article 1648 B bis
du code
général des impôts.
En 2000, les dépenses totales de ces deux fonds s'élèvent
à 6.862 millions de francs. Elles étaient destinées
à :
- verser des compensations aux communes qui enregistrent d'une année sur
l'autre une perte de base de taxe professionnelle importante (919 millions
de francs/FNPTP) et à celles qui connaissent des difficultés
financières importantes (3 millions de francs de
francs/FNPTP) ;
- verser des attributions aux communes dont le potentiel fiscal est faible et
l'effort fiscal élevé en métropole (3.610 millions de
francs/FNP) et outre-mer (101 millions de francs/FNP) ;
- compenser aux collectivités locales les exonérations de taxe
professionnelle dans les zones de revitalisation rurale (58 millions de
francs/FNP) et dans les zonages créés par le pacte de relance
pour la ville (342 millions de francs/FNPTP) ;
- compenser les pertes de dotation de compensation de la taxe professionnelle
(DCTP) enregistrées par les communes éligibles à la DSU et
à la DSR " bourgs-centres ", les communes éligibles
à la DSR " péréquation " et dont le potentiel
fiscal est inférieur à 90 % de la moyenne de leur strate et les
groupements dont une ou plusieurs communes sont éligibles à la
DSU ou à la DSR " bourgs-centres ", à hauteur de la
proportion que représentent les habitants de ces communes dans la
population totale du groupement (892 millions de francs/FNPTP) ;
- verser une compensation à un fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle dont les ressources ont
diminué de plus du quart à la suite d'un changement d'exploitant
(34 millions de francs/FNP) ;
- financer la dotation de développement rural, la DDR (740 millions
de francs/FNPTP) ;
- financer l'augmentation de la fraction " bourgs-centres " de la
dotation de solidarité rurale prévue à l'article 65 de la
loi de finances pour 2000 (150 millions de francs / FNPTP).
Il ressort de cette énumération que :
- l'idée initiale de compensation des inégalités de
richesse en base de taxe professionnelle a progressivement été
remplacée tout d'abord par la
compensation des pertes de bases de
taxe professionnelle
(13 % des dépenses en 2000), puis par la
compensation des inégalités de richesse fiscale en
général
(54 % des dépenses totales en 2000) ;
- plus de 20 % des crédits du FNPTP et du FNP sont utilisés
pour financer d'autres dispositifs péréquateurs (les
exonérations dans les zonages d'aménagement du territoire, les
pertes de DCTP, les FDPTP, la DSR) ;
- 10 % des crédits des deux fonds (25 % des dépenses du seul
FNPTP) sont consacrés à la DDR, qui n'est pas une dotation
péréquatrice.
b) La péréquation finance la péréquation
Le
financement par le FNPTP et le FNP d'autres dispositifs
péréquateurs ne s'est pas accompagnée d'une augmentation
symétrique de leurs moyens. Il en résulte deux
conséquences :
- l'Etat peut mettre en oeuvre de nouvelles mesures péréquatrices
(exonérations dans les zonages d'aménagement du territoire,
compensations de baisse de DCTP, compensations à un FDPTP, majoration de
la dotation de solidarité rurale) sans accroître le montant total
de son effort financier en faveur de la péréquation ;
- une réduction des crédits disponibles pour le FNP.
Le FNP est dépendant financièrement du FNPTP. Sa principale
ressource est constituée du " solde " du FNPTP,
c'est-à-dire de la différence entre les ressources du FNPTP et
ses dépenses.
Plus les dépenses du FNPTP sont
élevées, moins le solde reversé au FNP est important
.
En 1999, la décision de financer par le FNPTP la compensation des pertes
de DCTP s'est traduite par une dépense supplémentaire de 769
millions de francs, donc une baisse d'autant du solde reversé au FNP. En
2000, la compensation des baisses de DCTP coûte 892 millions de francs,
auxquels il convient d'ajouter les 150 millions de francs
prélevés pour financer la dotation de solidarité rurale.
Cette baisse des ressources du FNP n'a été que partiellement
compensée puisque les ressources de ce fonds n'ont été
majorées que de 150 millions de francs. Le manque à gagner pour
1999 s'élève donc à 419 millions de francs en 1999 et
à 892 millions de francs en 2000.
c) Une situation paradoxale
Le
décalage entre l'évolution des recettes et des dépenses du
FNPTP et du FNP place ces fonds en
situation très délicate sur
le plan financier
alors que, d'une part, les crédits des fonds
augmentent et que, d'autre part, des crédits qui pourraient
légitimement être affectés à ces fonds continuent
d'être versés au budget général de l'Etat.
Jusqu'en 2000, les manques à gagner provoqués par l'augmentation
des dépenses étaient relativement " indolores " pour
les fonds car le montant total de leurs ressources continuait à
croître dans des proportions supérieures aux manques à
gagner, notamment en raison de l'affectation au FNPTP d'une fraction croissante
du produit de la fiscalité locale de France Télécom.
En 2000, les ressources des deux fonds s'élèvent à 6.862
millions de francs contre 6.493 millions de francs en 1999, soit une
augmentation de 6,5 %. Pourtant, malgré cette augmentation de 369
millions de francs, les crédits du FNP n'augmentent que de 0,2 %
et, une fois prélevées les sommes destinées à
financer les exonérations en zone de revitalisation rurale, les
crédits disponibles pour financer la plus péréquatrice des
missions du FNPTP et du FNP, les attributions aux communes à faible
potentiel fiscal et à forte pression fiscale, affichent une baisse de
0,2 %.
Les situations de ce type pourraient être évitées si les
ressources en principe dévolues au FNPTP n'étaient en partie
perçues par l'Etat.
L'
article 1648 A bis
du code général des impôts
prévoit que le FNPTP est alimenté par "
le produit de la
cotisation de péréquation de la taxe professionnelle
prévue à l'article 1648 D
". Depuis 1983, cette
cotisation est acquittée par les entreprises situées dans les
communes où le taux global de taxe professionnelle est inférieur
aux taux global moyen constaté l'année précédente.
Son produit s'établissait à 1,1 milliards de francs en 1987,
à 2,7 milliards de francs en 1992 et à 5,1 milliards de francs en
1999.
Seule une partie du produit de la cotisation de péréquation
bénéficie aux collectivités locales, par
l'intermédiaire du FNPTP. Deux dispositions ont en effet
détourné une partie du produit vers le budget de l'Etat :
- l'article 31 de la loi de finances pour 1989 a majoré les taux de la
cotisation et prévu que, à compter de 1990, le produit de ces
majorations serait "
reversé au budget de l'Etat par le fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle
".
Entre 1990 et 1998, près de 40 % du produit de la cotisation de
péréquation a ainsi été affecté au budget de
l'Etat ;
- l'article 44 de la loi de finances pour 1999, dans le cadre des mesures de
financement de la réforme de la taxe professionnelle, a
procédé à une nouvelle majoration des taux de la
cotisation de péréquation, au profit du budget de l'Etat.
Désormais, plus de la moitié du produit de la cotisation de
péréquation (2.850 millions de francs en 1999, pour en produit
total de 5.160 millions de francs) alimente le budget de l'Etat et ne sert
pas à financer la péréquation.
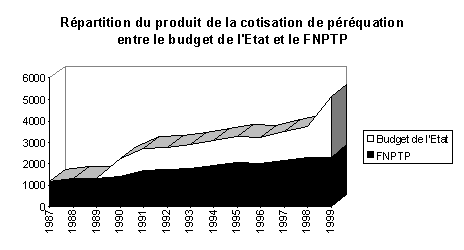
Pour mémoire, il convient de rappeler que le FNPTP
bénéficie également de la
fraction du produit de la
fiscalité locale acquittée par France Télécom et La
Poste
correspondant à la différence entre le montant
acquitté par ces établissements en 1994 et le produit
acquitté au cours de l'année n-1. Cette fraction
s'élève en 2000 à 2 milliards de francs. La fraction
conservée par le budget général s'élève
à environ 4,8 milliards de francs.
3. La péréquation des réductions de crédits
Un
nouveau débat se fait jour en matière de
péréquation :
faut-il considérer comme de la
péréquation des mesures destinées à dispenser de
réduction de crédits les collectivités locales
défavorisées
?
Les trois exemples suivants, la réforme de la dotation globale
d'équipement (DGE), la modulation des baisses de dotation de
compensation de la taxe professionnelle (DCTP) et la réduction
progressive du montant des compensations d'exonération fiscale
versées aux collectivités locales, ont en commun de
procéder à une réduction du montant d'un concours de
l'Etat aux collectivités locales.
Dans les trois cas, la baisse n'a pas été appliquée
uniformément à l'ensemble des collectivités. Les
collectivités " défavorisées " ont
été épargnées, l'ensemble de l'effort étant
supporté par les collectivités " riches ".
a) La réforme de la DGE
La
dotation globale d'équipement (DGE) a été
créée par l'article 103 de la loi du 2 mars 1982 afin de se
substituer progressivement aux subventions spécifiques.
Après plusieurs modifications, le régime de la DGE fonctionnait
en 1995 à partir d'une division en deux " parts ". La
première part constituait la dotation "globale " proprement dite et
ses crédits étaient répartis entre les communes de plus de
10.000 habitants en fonction d'un taux de concours forfaitaire. La
deuxième part, réservée aux petites communes et aux
petites structures intercommunales, constituait une entorse au principe de la
globalisation. Ses crédits étaient attribués par une
commission en fonction de la nature des projets.
La loi de finances pour 1996 a considéré qu'il convenait, dans le
cadre de la péréquation, de concentrer les crédits de la
DGE sur l'équipement des très petites communes et structures
intercommunales (moins de 2.000 habitants) et sur les communes et
structures intercommunales de taille moyenne mais dont le potentiel fiscal est
faible (moins de 20.000 habitants avec un potentiel fiscal inférieur
à 1,3 fois la moyenne nationale).
En réalité, cette opération était
destinée à réaliser des économies
budgétaires puisque la réforme de la DGE ne s'est pas traduite
par un accroissement de l'effort en faveur des communes les moins
favorisées mais par la suppression des crédits
antérieurement consacrés aux communes de plus de 10.000
habitants.
En 1996, les derniers crédits de la première part de la DGE
s'élevaient à 821 millions de francs et ceux de la
deuxième part à 2.199 millions de francs, soit un total de 3.020
millions de francs. L'année suivante, le total de la DGE des communes
n'était plus que de 2.404 millions de francs. Sur les 821 millions de
francs de l'ancienne première part, seuls 205 millions de francs ont
été réorientés vers les communes
défavorisées.
Prévue à l'origine pour améliorer la
péréquation, la réforme de la DGE des communes en 1996 a
permis à l'Etat de réaliser 616 millions de francs
d'économies au détriment des communes.
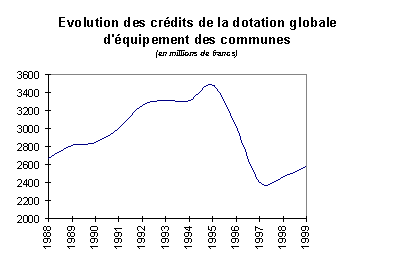
b) La modulation des baisses de DCTP
Depuis
que les dotations de l'Etat aux collectivités locales sont inscrites
dans le cadre plus vaste de l' " enveloppe normée ", la
dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) joue le rôle
de
variable d'ajustement
de cette enveloppe. Si les dotations autres que
la DCTP qui composent l'enveloppe augmentent plus vite que cette
dernière, son montant diminue. Ainsi, depuis 1996, le montant de la DCTP
a diminué d'un tiers, passant de 17,6 milliards de francs en 1996
à 11,8 milliards de francs en 2000.
Le contrat de croissance et de solidarité, qui s'applique de 1999
à 2001 en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi de finances
pour 1999, prévoit que les baisses de DCTP enregistrées par les
communes éligibles à la DSU et à la DSR, par les
départements éligibles à la dotation de fonctionnement
minimale (DFM) et par les régions éligibles au fonds de
correction des déséquilibres régionaux (FCDR) sont
limitées à 50 % de la baisse théorique.
Cette disposition ne constitue pas un " cadeau " de l'Etat aux
collectivités défavorisées. Son coût est nul pour
l'Etat puisque la limitation des baisses de certaines collectivités se
traduit par une augmentation des baisses supportées par les autres
collectivités. Ainsi, en 1999, le montant total de la DCTP a
baissé d'environ 16% mais, en raison de l'exonération de
50 % de la baisse des collectivités défavorisées, les
collectivités " non exonérées " ont
accusé une baisse de près de 25 %.
Si le principe des réductions de DCTP peut être jugé
contestable, il n'en demeure pas moins que le choix d'alléger le poids
des baisses supportées par certains par une aggravation des baisses
subies par d'autres s'inscrit incontestablement dans une logique de
péréquation
248(
*
)
. Les
collectivités " riches " assument l'effort dont sont
dispensées les collectivités
" défavorisées ".
En revanche, le caractère péréquateur du
" deuxième volet " des exonérations de baisse de DCTP
est plus discutable. Les lois de finances pour 1999 et pour 2000
prévoient que les communes éligibles à la DSU et à
la DSR " bourgs-centres ", les communes éligibles à la
DSR " péréquation " dont le potentiel fiscal est
inférieur à 90 % de la moyenne de leur strate et les
groupements dont une ou plusieurs communes membres sont éligibles
à la DSU ou à la DSR " bourgs-centres " sont
remboursées par le fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle (FNPTP) de leur baisse de DCTP, ce qui, pour les communes
au moins
249(
*
)
, revient à les
exonérer totalement de baisse. Le coût de la prise en charge par
le FNPTP des exonérations de baisse de DCTP réduit le montant des
crédits disponibles pour financer le reste des missions du FNPTP, et en
particulier le montant des crédits transférés par le fonds
au fonds national de péréquation (FNP).
En conséquence, l'exonération totale de baisse de DCTP des
communes éligibles à la DSU et à la DSR a
été réalisée par un prélèvement sur
les ressources du FNP, principal instrument de péréquation en
faveur des petites communes.
c) Les compensations d'exonérations fiscales sont-elles péréquatrices ?
En 2000,
l'Etat consacre
68,7 milliards de francs
250(
*
)
à la compensation aux collectivités
locales d'exonérations fiscales décidées par des
dispositions législatives. Lorsque la part " salaires " de la
taxe professionnelle aura totalement disparu, en 2004, les compensations
devraient représenter
plus de 100 milliards de francs.
Le montant des compensations versées par l'Etat aux collectivités
locales, à la différence des dégrèvements,
n'évolue pas comme les bases et les taux des impôts locaux. Les
compensations ne sont plus des ressources fiscales. Elles évoluent en
fonction de deux types d'indexation, soit une indexation qui prend en compte
l'évolution réelle des bases en gelant le taux à la date
d'entrée en vigueur de l'exonération, soit en indexant le montant
exonéré à la date d'entrée en vigueur de la mesure
sur le taux d'évolution de la DGF. Avec le temps,
le montant des
compensations devient donc totalement déconnecté de la
réalité des bases et des taux des collectivités
.
Les compensations ainsi calculées sont fréquemment
évoquées dans les débats relatifs à la
péréquation, qu'elles soient assimilés à des
dispositifs péréquateurs, ou qu'elles soient
considérées comme ayant vocation à financer la
péréquation :
- les compensations, indexées sur la DGF, sont présentées
comme péréquatrices car, si elles privent les
collectivités locales du produit qui aurait résulté
d'éventuelles augmentations des bases ou des taux, elles garantissent
aux collectivités dont les bases diminuent un certain niveau de
ressources. Cette argumentation a été utilisée par le
ministre de l'économie et des finances lors de la discussion des
dispositions du projet de loi de finances pour 1999 relatives aux
modalités de compensation de la part " salaires " de la taxe
professionnelle ;
- les compensations sont parfois évoquées comme ayant vocation
à financer la péréquation car, compte tenu de la
déconnexion entre leur montant et les bases des collectivités,
leur fondement originel et, partant, leur légitimité tendent
à disparaître peu à peu. L'expérience de la DCTP
montre qu'il est possible de détourner des compensations de leur objet
initial pour financer d'autres priorités. De même, l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 prévoit que, à compter de 2004, la
compensation de la suppression de la part " salaires " de la taxe
professionnelle disparaîtra et les crédits correspondant seront
intégrés à la DGF.
Le rapport " La France de l'an 2000 " remis au Premier ministre en
1994 appelait d'ailleurs à "
regrouper l'ensemble des
compensations dans un fonds de péréquation à vocation
nationale
".
Les compensations et leur mode de calcul constituent surtout un moyen pour
l'Etat de réduire le coût budgétaire des
exonérations qu'il décide.
L'indexation sur la dotation
globale de fonctionnement permet de ne prendre en compte ni l'évolution
des bases, ni celle des taux, et de faire évoluer les montants en
fonction du taux d'évolution de la DGF, qui est la plupart du temps
inférieur
251(
*
)
.
En outre, le montant des compensations versées fait l'objet de
réfactions en fonction de l'évolution du produit de l'impôt
concerné, ou de du produit " quatre taxes ", qui continue
à être perçu par la collectivité. Par
conséquent,
plus le produit perçu augmente, plus le montant de
la compensation diminue
. Ces dispositifs de réfactions,
inventés entre 1992 et 1994, lorsqu'il fallait à tout prix
réduire les dépenses de l'Etat, ne doivent pas être
considérés comme péréquateurs car les pertes des
collectivités les plus riches ne se traduisent pas par une augmentation
des ressources des plus défavorisés. Ils entraînent donc
une
perte nette de ressources pour les collectivités locales.
C. LES NOUVELLES FORMES DE PÉRÉQUATION
1. La péréquation volontaire des ressources fiscales : la taxe professionnelle unique
Depuis
plusieurs années, il est admis que la façon la plus efficace de
réduire les écarts de richesse au sein d'un même espace de
développement est de partager le produit de l'impôt dont
l'assiette est la plus dynamique mais également la plus
inégalement répartie
252(
*
)
.
Dans cette perspective, la nouvelle forme de structure intercommunale
destinée au milieu urbain, la communauté de villes, avait
été dotée par la loi d'orientation du
6 février 1992 du régime fiscal de la
taxe
professionnelle unique
, qui consiste à transférer à la
structure intercommunale la perception de la taxe professionnelle
antérieurement perçue par les communes membres, et d'appliquer un
taux unique
sur l'ensemble du territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Ce régime fiscal est péréquateur car il permet aux
communes riches en taxe professionnelle de partager cette ressources avec
celles qui ont des bases moins importantes, mais qui contribuent
néanmoins au dynamisme économique d'ensemble, notamment en
assument les "
charges de centralité
".
Les communautés de villes, notamment en raison de la rigidité de
leur statut, n'ont pas rencontré le succès escompté. En
revanche, le régime fiscal de la taxe professionnelle unique a
été adopté par un nombre significatif de groupements
ruraux. La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale a relancé la mise
en place de la taxe professionnelle unique en milieu urbain, avec la
création de la formule des communautés d'agglomération et
en milieu rural avec la mise en place d'une incitation financière pour
certaines communautés de communes qui adoptent ce régime fiscal.
La marge de progression de cette forme de péréquation que
constitue la mutualisation du produit de la taxe professionnelle sur un
ensemble économique cohérent reste importante puisque, en 1999,
sur 634,7 milliards de francs de bases de taxe professionnelle du secteur
communal, seuls 44,5 milliards de francs, soit 7 %, étaient
imposées sous le régime de la taxe professionnelle unique.
2. La péréquation forcée des ressources fiscales
Les
mécanismes de prélèvement sur les ressources fiscales des
collectivités locales constituent
une forme d'entorse au principe de
libre administration des collectivités locales
. Toutefois, la
mutualisation des ressources fiscales fait désormais partie des
solutions permettant d'améliorer la péréquation.
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle (FDPTP)
ont été créés afin de
mieux répartir entre les communes riveraines d'un
" établissement exceptionnel ", une centrale nucléaire
par exemple, le produit de cette fiscalité exceptionnelle. Les FDPTP
sont alimentés, en application des dispositions de l'
article 1648
A
du code général des impôts, par
l'écrêtement des bases
des communes sur le territoire
desquelles se trouve un établissement dont les bases, rapportées
au nombre d'habitant de la commune, excèdent deux fois et demi les bases
de taxe professionnelle constatées au niveau national. Les sommes ainsi
perçues, 2.733 millions de francs en 1998, sont réparties par le
ou les conseils généraux qui gèrent le FDPTP entre les
communes pour lesquelles la présence de cet " établissement
exceptionnel " occasionne des charges (les communes
" concernées ") et les communes les moins riches (les communes
" défavorisées ").
Le régime des FDPTP comporte des
avantages
. Il permet notamment
une
péréquation au plan local
, la gestion par les conseils
généraux permettant plus de souplesse que l'application de
critères d'éligibilité mécaniques. L'article 40 de
la loi de finances rectificative pour 1999 prévoit que le Gouvernement
doit établir un rapport étudiant les modalités de mise en
oeuvre d'un écrêtement assis non sur les bases des
établissements exceptionnels mais sur l'ensemble des bases par habitant
des communes elles-mêmes. Une telle évolution permettrait
d'accroître les ressources des FDPTP d'environ 1,2 milliard de francs
selon les estimations du ministère de l'intérieur. Elle
obligerait cependant à revoir entièrement les critères de
répartition des fonds puisque, en l'absence de référence
à un établissement exceptionnel, il ne serait plus possible de
distinguer les communes " concernées ". La réforme
envisagée porte donc en germe un changement de nature profond des FDPTP.
Le fonds de solidarité des communes de la région
Ile-de-France (FSRIF)
prévu à l'
article L. 2531-12
du
code général des collectivités territoriales a
été créé afin d' "
améliorer
les conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des
charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population
sans disposer de ressources fiscales suffisantes
". La
région Ile-de-France se caractérise en effet par des
écarts importants en matière de bases fiscales, que le
très faible développement de l'intercommunalité dans cette
région, notamment à taxe professionnelle unique, ne contribue pas
à résorber. Il a donc été décidé
d'alimenter le FSRIF "
par des prélèvements sur les
ressources fiscales des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale de la région Ile-de-France
".
Le premier prélèvement concerne les communes dont le potentiel
fiscal est supérieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen des
communes de la région. Le deuxième prélèvement,
créé par l'article 95 de la loi du 12 juillet 1999, concerne
les communes et les établissement publics de coopération
intercommunale faisant application de la taxe professionnelle de zone dont les
bases totales d'imposition à la taxe professionnelle excèdent
3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle.
Le mécanisme de solidarité financière entre
régions, le fonds de correction des déséquilibres
régionaux (FCDR)
,
prévu à l'
article L.
4332-4
du code général des collectivités
territoriales, est également financé par
prélèvement sur les recettes fiscales des régions
contributrices, qui sont les régions dont le potentiel fiscal par
habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant et dont le
taux de chômage est inférieur au taux de chômage national.
En revanche,
le mécanisme de solidarité financière
entre départements
prévu à l
'article L. 3334-8
du code général des collectivités territoriales est
financé par un prélèvement non pas sur les recettes
fiscales des départements contributeurs mais sur leurs attributions de
DGF.
Le Conseil constitutionnel a fixé des limites à la pratique des
prélèvements opérés par l'Etat sur les ressources
de certaines collectivités au bénéfice d'autres
collectivités. Dans sa décision du 6 mai 1991 relative au fonds
de solidarité des communes de la région Ile-de-France
253(
*
)
, il a précisé que ce type de ponction
ne peut être opérée "
qu'à titre
exceptionnel et ne doit concerner qu'une partie de l'impôt local ;
il doit être défini avec précision quant à son objet
et à sa portée ; il ne doit pas avoir pour
conséquence d'entraver la libre administration des collectivités
concernées
".
3. Les contrats de plan sont-ils péréquateurs ?
Les
contrats de plan pourraient constituer un
instrument efficace de
péréquation
. Si le montant des enveloppes accordées
à chaque région était déterminé de
manière inversement proportionnelle à la richesse des
régions, les actions financées par les contrats pourraient
contribuer au rattrapage des régions les moins riches.
Dans son rapport public de 1998, la Cour des comptes a constaté que les
précédentes générations ne remplissaient pas cet
objectif :
" La décision a été prise en CIAT, au début
de l'année 1993, de moduler la contribution de l'Etat aux
troisièmes contrats de plan sur la base de critères objectifs
permettant d'aider davantage les régions les moins favorisées. Il
s'agissait de s'affranchir de la règle implicite selon laquelle l'Etat,
jusqu'alors, apportait autant que les régions, favorisant ainsi celles
qui faisaient un effort financier plutôt que celles qui avaient le plus
de besoins.
Les régions métropolitaines ont ainsi été
classées en trois groupes, en fonction de trois
éléments : le potentiel fiscal par habitant en 1992 ;
la moyenne du taux de chômage au cours des années 1990, 1991 et
1992 ; la variation de l'emploi entre 1984 et 1991. Par rapport aux
contrats précédents, leurs enveloppes financières devaient
être majorées, selon ce classement, de 23,5 %, 14,1 % et
9,4 % en francs courants, l'Ile-de-France devant avoir, pour sa part, une
dotation réduite de 10 %.
Cette décision n'a pas été respectée.
(...)
A deux exceptions près (Picardie et Nord-Pas-de-Calais) les
régions ont obtenu une majoration supérieure à celle qui
avait été annoncée ; que la dotation de
l'Ile-de-France a été elle aussi augmentée ; que
chacun des trois groupes s'est vu attribuer en moyenne à peu près
la même augmentation (42 % pour le premier, 38 % pour chacun
des deux autres) et, surtout, que le classement relatif des régions a
été complètement bouleversé. "
Le tableau ci-dessous compare les attributions par habitant accordées
par la nouvelle génération de contrats de plan avec le potentiel
fiscal par habitant en 2000 de chacune des régions.
Plus le potentiel
fiscal d'une région est élevé et plus, du point de vue de
la péréquation, le montant de son attribution par habitant
devrait être faible
:
Comparaison du montant par habitant accordé à chaque région au titre des contrats de plan 2000-2006 et du potentiel fiscal des régions
|
Régions |
Enveloppe des contrats de plan 2000-2006 en francs par habitant* |
Potentiel fiscal 2000*
|
|
Alsace |
1.721 (14) (20)** |
477,14 (3) |
|
Aquitaine |
1.633 (15) (11) |
386,56 (12) |
|
Auvergne |
2.043 (8) (8) |
365,56 (15) |
|
Basse Normandie |
2.491 (4) (16) |
414,58 (7) |
|
Bourgogne |
1.533 (18) (12) |
394,54 (11) |
|
Bretagne |
2.050 (7) (3) |
343,06 (20) |
|
Centre |
1.477 (20) (14) |
403,80 (9) |
|
Champagne Ardennes |
1.796 (13) (15) |
408,60 (8) |
|
Corse |
6.371 (1) (2) |
342,41 (21) |
|
Franche Comté |
1.974 (9) (17) |
424,71 (6) |
|
Haute Normandie |
1.835 (12) (19) |
461,52 (4) |
|
Ile de France |
1.386 (22) (22) |
670,58 (1) |
|
Languedoc Roussillon |
1.977 (10) (5) |
360,71 (18) |
|
Limousin |
3.027 (2) (1) |
341,85 (22) |
|
Lorraine |
2.321 (5) (13) |
401,69 (10) |
|
Midi Pyrénées |
2.198 (6) (7) |
364,68 (16) |
|
Nord - Pas de Calais |
2.519 (3) (6) |
361,56 (17) |
|
Pays de Loire |
1.415( 21) (9) |
374,11 (14) |
|
Picardie |
1.623 (17) (10) |
383,62 (13) |
|
Poitou Charentes |
1.958 (11) (4) |
348,24 (19) |
|
PACA |
1.628 (16) (18) |
442,59 (5) |
|
Rhône Alpes |
1.480 (19) (21) |
483,32 (2) |
* entre
parenthèses, rang de classement (par ordre décroissant).
** entre parenthèses et en italique, rang de classement théorique
si les enveloppes des contrats de plan avaient été
attribuées de manière inversement proportionnelle au potentiel
fiscal.
Il ressort de ce tableau que, dans deux régions, les attributions par habitant accordées correspondent à l'inverse du rang de classement de ces régions en terme de potentiel fiscal. Dans treize régions, les contrats de plan sont plus généreux que n'aurait pu le laisser supposer le rang de classement en fonction du potentiel fiscal et dans sept régions les contrats de plan sont moins généreux que n'aurait pu le laisser supposer le potentiel fiscal.
VI. UN ÉTRANGE MOUVEMENT DE RECENTRALISATION DES FINANCES LOCALES
Les
relations entre l'Etat et les collectivités locales sont marquées
par une tendance accentuée à la recentralisation des
pouvoirs
254(
*
)
. Les finances locales
n'échappent pas à ce mouvement.
En matière de finances locales, la recentralisation se traduit par un
contrôle accru de l'Etat sur les ressources des collectivités
locales
. Ce contrôle est rendu possible par la transformation
d'impôts locaux en dotations dont l'Etat maîtrise le montant et le
taux d'évolutions.
Le coût pour l'Etat de cette politique de transformation d'impôts
en dotations est très élevé. Entre 1998 et 2000, les
dépenses de l'Etat consacrées au remplacement de ressources
locales par des ressources budgétaires ont augmenté de plus de 30
milliards de francs.
Dès lors, il est nécessaire de se demander pour quelles raisons
l'Etat consacre autant de moyen à réduire l'autonomie
financière des collectivités locales.
A. LA MÉCANIQUE DE LA RECENTRALISATION
Les
finances locales n'ont jamais vraiment été
décentralisées. Certains chantiers n'ont pas été
ouverts. Comme le souligne notre collègue député
Jean-Pierre Balligand, "
les collectivités locales doivent
pouvoir tabler sur des marges de manoeuvre réelles : progrès
de la gestion patrimoniale et consolidation des comptes, politique tarifaire
repensée, liberté d'emprunts, mobilisation de la
trésorerie, possibilité de constituer de réserves, de
disposer du produit de la ristourne des frais de révision des bases de
TP, etc. Il serait temps que l'Etat considère les collectivités
locales comme des partenaires majeurs (et non en condition de
minorité).
"
255(
*
)
Toutefois, les évolutions actuelles marquent un
recul par rapport
à l'équilibre issu des lois de décentralisation
, qui
repose sur le partage du financement local entre des impôt dont les
collectivités votent les taux et des dotations versées par
l'Etat.
1. La transformation d'impôts locaux en dotations budgétaires
La
réduction de la part des impôts dans les recettes totales des
collectivités locales est une tendance ancienne. Le principal concours
de l'Etat aux collectivités locales, la DGF, était, à
l'origine, la
compensation de la suppression d'un impôt local.
Cette tendance avait été mise en sommeil avec l'entrée en
vigueur des lois de décentralisation. A bien des égards, la loi
du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe
locale peut d'ailleurs être considérée comme la
première loi de décentralisation. La loi du 2 mars 1982
prévoit que les nouvelles compétences transférées
devront être financées par des ressources fiscales, les dotations
budgétaires n'intervenant que pour le solde.
La fiscalité
locale est donc un élément constitutif de la
décentralisation à la française
.
Pourtant, depuis la fin des années 80, et depuis 1998 surtout,
le
pouvoir fiscal des collectivités locales s'érode
. Les
départements ne perçoivent plus la taxe foncière sur les
propriétés non bâties et ne votent plus les taux des droits
de mutation à titre onéreux. Les régions ne
perçoivent plus la taxe foncière sur les propriétés
non bâties, la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre
onéreux ni, à compter de 2000, la taxe d'habitation. En 2004,
lorsque la part salariale de la taxe professionnelle aura disparu, l'ensemble
des collectivités locales sera privé du tiers du produit de cet
impôt, qui représente environ la moitié de leurs ressources
fiscales.
Pour les régions, catégorie de collectivités la plus
touchée, la part de la fiscalité dans les ressources totales est
passée de 55 % en 1995 à 47 % en 1999 et
s'établira à 40 % après la suppression de la part
régionale de la taxe d'habitation.
La disparition des recettes fiscales fait l'objet de
compensations
versées par l'Etat
. Ces compensations sont organisées selon
des modalités généralement fixées par les lois de
finances. Leur régime peut être
changé à tout
moment
si le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée
nationale, qui a le dernier mot en matière législative, le
souhaitent.
Il n'existe pas de " droit à compensation "
pour les collectivités locales
, comme l'ont montré les
nombreuses modifications qu'ont subi les mécanismes de compensation
existant aujourd'hui, et en particulier la dotation de compensation de la taxe
professionnelle (DCTP), dont le montant diminue d'année en année.
Les évolutions actuelles placent donc les collectivités
locales en situation de dépendance financière par rapport
à l'Etat. Elles maîtrisent de moins en moins l'évolution de
leurs ressources.
2. Les concours de l'Etat aux collectivités locales sur la sellette
A la
lecture des décisions du Conseil constitutionnel relatives aux
différents textes organisant le remplacement d'impôts locaux par
des dotations de l'Etat, on pourrait penser que le remplacement d'une ressource
fiscale par une ressource budgétaire ne change rien ou presque pour les
collectivités locales. Par exemple, dans sa décision n°
98-405 DC du 29 décembre 1998 relative à la loi de finances pour
1999, le Conseil constitutionnel a considéré que le remplacement
de la part salariale de la taxe professionnelle par une compensation n'avait
pas pour effet "
de diminuer les ressources globales des
collectivités locales
". Dès lors que les compensations
évolueraient à un rythme satisfaisant, la disparition des
impôts locaux serait donc neutre pour les collectivités locales.
Cette analyse se heurte à la pratique de l'Etat qui, au contraire, situe
ses relations avec les collectivités locales dans le cadre d'un
rapport de force
. Les suppressions d'impôts locaux n'ont pas
seulement pour objet d'accorder aux contribuables des baisses d'impôt,
mais tendent également à affirmer un
droit de regard de l'Etat
sur les recettes des collectivités locales
.
Le rapport du Gouvernement pour le débat d'orientation budgétaire
pour 2001 permet de dissiper les éventuels doutes sur la
réalité du mouvement de recentralisation. Loin d'être
rassurant pour les collectivités locales, ce document souligne que les
transferts de l'Etat aux administrations publiques locales "
augmentent
plus vite que la dynamique générale des
dépenses
", laissant entendre que les collectivités
locales coûtent trop cher à l'Etat et freinent ses efforts de
maîtrise des dépenses publiques. Au cours de son audition par la
mission le 8 mars 2000, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie avait également souligné que les concours de l'Etat
aux collectivités locales était l'un des postes
budgétaires qui augmentait le plus.
Dès lors, la mécanique, et la finalité, de la
recentralisation apparaissent clairement :
- dans un premier temps, l'Etat a supprimé des impôts locaux et
les a remplacés par des compensations qui lui ont permis de
contrôler une part plus grande des ressources locales
, au prix
d'un effort budgétaire conséquent ;
- dans un deuxième temps, oubliant que l'augmentation de ses transferts
aux collectivités résulte de sa décision de remplacer des
ressources fiscales par des dotations budgétaires, l'Etat " enfonce
le clou " et
stigmatise le coût des dépenses en faveur des
collectivités locales, comme pour préparer le terrain à
une éventuelle réduction de leur montant.
Plus que jamais, l'Etat mène le jeu et, loin de considérer les
collectivités locales comme des partenaires, laisse planer
l'ambiguïté
sur ses orientations en matière
financière, sans jamais vraiment préciser ce qu'il compte faire
de ses pouvoirs accrus.
B. POURQUOI L'ÉTAT RECENTRALISE-T-IL ?
Quel est l'intérêt pour l'Etat de contrôler l'évolution des recettes des collectivités locales ? Pourquoi consacrer autant de moyens financiers à la réduction de l'autonomie financière des collectivités locales ?
1. Améliorer la justice fiscale ?
La
transformation d'impôts locaux en dotations de l'Etat présente au
moins un avantage : elle allège d'autant la charge fiscale pesant
sur les contribuables et, ce faisant, permet de remédier aux injustices
qui résultent de l'inadaptation des bases des impôts locaux.
Alléger la pression fiscale ?
Ce point a été mis en avant par le Gouvernement à
l'occasion des débats sur la suppression de la part salariale de la taxe
professionnelle et sur la suppression de la part régionale de la taxe
d'habitation.
Quoi qu'il en soit, la volonté du gouvernement de réduire le
poids des prélèvements obligatoires n'apparaît pas
clairement à la lumière de l'évolution du taux global de
prélèvements obligatoires depuis 1997. Le taux de pression
fiscale est en effet passé de 44,8 % du produit intérieur
brut en 1996 à 44,9 % en 1997 et 1998, avant d'atteindre un pic
historique en 1999 avec 45,7 %.
S'agissant de la fiscalité des entreprises, l'allégement de taxe
professionnelle dont bénéficient les entreprises a
été " compensé " par la mise en place de
multiples nouveaux prélèvements :
Récapitulation des mesures prises depuis 1997 au
détriment
des moyennes et grandes entreprises.
|
MUFF 1997 : |
Imposition de certaines plus-values à long terme au taux normal de l'IS et instauration d'une contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés (fixée à 15 % pour 1997 et 1998 et à 10 % pour 1999) pour les entreprises de plus de 50 millions de francs de chiffre d'affaires ; |
|
|
=> surcroît de recettes : 23,1 MdsF en 1997, 1 7,4 MdsF en 1998 et 12,4 MdsF en 1999 |
|
LFI 1998 : |
- Augmentation des tarifs de l'imposition forfaitaire annuelle pour les entreprises de plus de 50 millions de francs de chiffre d'affaires ; |
|
|
=> surcroît de recettes : 200 MF |
|
|
- Limitation de la déductibilité des provisions pour renouvellement ; |
|
|
=> surcroît de recettes en 1998 : 4 MdsF |
|
|
- Suppression de l'avantage fiscal lié à la provision pour fluctuation des cours. |
|
|
=> surcroît de recettes en 1998 : 1 MdF |
|
LFI 1999 : |
- Quadruplement en trois ans du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle (0,35 % en 1998, 1 % en 1999, 1,5 % en 2001) ; |
|
|
=> surcroît de recettes en 1999 : 700 MF |
|
|
- Rétablissement (au taux de 2,5 %) de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes versés par une filiale à sa mère ; |
|
|
=> surcroît de recettes en 1999 : 4,5 MdsF |
|
|
- Diminution du taux de l'avoir fiscal de 50 à 45 % pour les personnes morales ne bénéficiant pas du régime fiscal des mères et filiales ; |
|
|
=> surcroît de recettes en 1999 : 1 MdF |
|
|
- Augmentation des tarifs de l'imposition forfaitaire annuelle pour les entreprises de plus de 50 millions de francs de chiffre d'affaires ; |
|
|
=> surcroît de recettes en 1999 : 500 MF |
|
PLF 2000 : |
- Doublement de la fraction imposable des dividendes versés par une société fille à sa mère (quote-part de frais et charges de 5 %) ; |
|
|
=> surcroît de recettes prévu pour 2000 : 4,2 MdsF |
|
|
- Diminution du taux de l'avoir fiscal de 45 à 40 % pour les personnes morales ne bénéficiant pas du régime fiscal des mères et filiales ; |
|
|
=> surcroît de recettes prévu pour 2000 : 1,5 MdF |
|
PLFSS 2000 : |
Institution d'une contribution sociale de 3,3 % sur les bénéfices des sociétés (CSB) affectée au " fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale " ; |
|
|
=> surcroît de recettes attendu pour 2000 : 4,2 MdsF |
|
|
- Création d'un taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) |
|
|
=> surcroît de recettes attendu pour 2000 : 3,6 MdsF |
Source : Commission des finances, Rapport général, Tome I, projet de loi de finances pour 2000.
Remédier à l'inadaptation de l'assiette des impôts
locaux ?
Le Gouvernement n'a jamais précisé pourquoi il avait
décidé d'alléger le poids pour les contribuables des
impôts locaux plutôt que celui d'impôts d'Etat, voire de la
fraction du produit des impôts locaux qu'il perçoit au titre des
frais d'assiette de dégrèvement.
Il a cependant justifié la suppression de la part salariale de
l'assiette de la taxe professionnelle et de la part régionale de la taxe
d'habitation par la volonté de remédier aux inconvénients
liés à l'assiette de ces impôts.
La réforme de la taxe professionnelle a été
présentée comme une réforme destinée à
favoriser l'emploi. En effet, malgré l'existence d'une réduction
pour embauche et investissement, la cotisation de taxe professionnelle des
entreprises augmentait lorsque des emplois étaient créés.
Cependant, dans son rapport au Président de la République de
1997, le Conseil des impôts remarquait que la taxe professionnelle
n'était pas l'impôt qui était le plus de nature à
décourager les créations d'emploi : "
l'ordre de
grandeur du prélèvement opéré par la taxe
professionnelle sur le coût du travail (environ 2 %) est sans
rapport avec celui opéré par le prélèvement
fiscalo-social total sur le travail salarié. En d'autres termes, lorsque
le travail doit supporter 100 F d'impositions
256(
*
)
, à peine 2 F relèvent de la taxe
professionnelle (...) La taxe professionnelle pesant davantage sur le
capital que sur le travail et représentant un prélèvement
limité sur ce dernier facteur n'apparaît donc pas comme un vecteur
pertinent d'une politique d'abaissement du coût du travail.
"
257(
*
)
.
La réforme de la taxe d'habitation opérée par la loi de
finances rectificative pour 2000 a été présentée
comme la volonté d'alléger le poids d'un impôt injuste pour
les contribuables les plus défavorisés. Cet objectif a surtout pu
être atteint par la refonte des dégrèvements de taxe
d'habitation, qui a permis d'exonérer totalement de cet impôt
l'ensemble des contribuables dont le revenu est proche du revenu minimum
d'insertion et qui a porté de 7,7 millions à 8,7 millions le
nombre de contribuables dont la cotisation est proportionnelle au revenu.
La suppression de la part régionale de la taxe d'habitation est surtout
une mesure favorable aux contribuables qui ne sont pas éligibles aux
mécanismes de dégrèvements et d'exonération et qui
verront leur impôt baisser quand même. De plus, un
allégement uniforme de taxe d'habitation de même ampleur aurait pu
être atteint, comme l'a proposé le Sénat, par une
réduction des frais d'assiette et de recouvrement perçus par
l'Etat sur le produit des impôts locaux.
2. Renforcer la péréquation ?
La
suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle comme
la suppression de la part régionale régionale de la taxe
d'habitation ont permis au Gouvernement de faire valoir que le remplacement
d'un impôt par une dotation constituait une forme de
péréquation en remédiant partiellement aux injustices
liées à l'inégale évolution des bases sur le
territoire :
- lors de la discussion au Sénat des dispositions relatives à la
suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle, le
secrétaire d'Etat chargé du budget a considéré
que : "
Ce dispositif, il est vrai, introduit un mécanisme
implicite de péréquation. Cela veut dire qu'une commune qui, par
malheur, perdrait de la taxe professionnelle, parce qu'une grande entreprise
fermerait ses portes ou parce qu'elle réduirait le nombre de ses
salariés, verrait sa compensation stabilisée. Au détriment
de qui, me demanderez-vous ? D'autres communes qui connaissent une
progression très rapide de leurs investissements et de la main d'oeuvre
percevront, effectivement, avec le dispositif proposé par le
Gouvernement, un peu moins
"
258(
*
)
;
- lors de la discussion au Sénat des dispositions du projet de loi de
finances rectificative pour 2000 relatives à la suppression de la part
régionale, la secrétaire d'Etat chargée du budget a
estimé que "
le dispositif que le Gouvernement propose n'est pas
défavorable à la majorité des régions, qu'il ne
l'est peut-être qu'à celles qui, en effet,
bénéficient d'un potentiel fiscal supérieur à la
moyenne nationale
"
259(
*
)
.
Au cours de son audition par la mission le 8 mars 2000, notre collègue
Jean-Pierre Fourcade, président du comité des finances locales, a
estimé que la prise en charge par l'Etat de la fiscalité locale
résultait surtout d' "
une tendance naturelle des
fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances, qui
semblaient difficilement admettre les conséquences financières de
la pluralité des collectivités locales et
préféraient l'instauration de règles de répartition
uniformes sur le plan national à une adaptation locale des règles
nationales
".
3. Maîtriser la dépense publique ?
Lorsque
la France transmet chaque année à la commission européenne
son programme pluriannuel des finances publiques, tous les comptes des
administrations publiques sont agrégés. Au niveau
européen, l'appréciation portée sur les performance de la
France en matière de finances publiques ne distingue pas entre les
comptes de l'Etat, de la sécurité sociale ou des
collectivités locales.
Cette nouvelle donne conduit l'Etat à s'intéresser d'encore
plus près à l'évolution du solde des administrations
publiques locales, qui est aujourd'hui positif alors que celui de l'Etat est
négatif.
La logique de la consolidation des comptes a par exemple conduit le ministre de
l'économie et des finances, lors de son audition par la mission le 8
mars dernier, à juger légitime de faire financer par les
collectivités locales des dépenses qui relèvent pourtant
de l'Etat, puisque la situation budgétaire des collectivités
locales est meilleure que celle de l'Etat. Ainsi, il a justifié le choix
du Gouvernement de ne compenser aux collectivités locales que la
moitié des pertes de DCTP dues au succès des communautés
d'agglomération (250 millions de francs sur 497 millions de francs) en
expliquant que "
le déficit de l'Etat s'élevait encore
à 206 milliards de francs, tandis que les collectivités locales
dégageaient, pour leur part, un excédent
budgétaire
".
Poussée à son terme, cette logique constitue une
désincitation à la bonne gestion financière puisqu'elle
revient à considérer que, compte tenu des bons résultats
financiers des collectivités locales, l'Etat serait fondé
à réduire les recettes ou accroître les dépenses
locales.
Cette logique pourrait également expliquer la volonté de l'Etat
de contrôler l'évolution des ressources locales. L'obligation de
rendre des comptes au niveau européen conduit l'Etat à souhaiter
maîtriser l'ensemble des facteurs qui ont un impact sur le solde global
des administrations publiques. En contrôlant l'évolution des
ressources locales, il devient possible pour l'Etat d'influer indirectement sur
le niveau de leurs dépenses et donc, le cas échéant, de
" fermer le robinet des recettes " afin d'éviter un
dérapage des dépenses.
Un tel raisonnement, d'inspiration jacobine, repose sur l'idée que les
exécutifs locaux seraient d'irréductibles dépensiers alors
que l'Etat serait vertueux. Rien n'est moins sûr. Les dépenses des
collectivités locales augmentent surtout en raison des charges nouvelles
qui résultent de décisions prises par l'Etat et qui s'imposent
à elles, ainsi que, dans une moindre mesure, de la reprise de
l'investissement. L'Etat pour sa part décide de l'ensemble de ses
charges, à l'exception des intérêts de la dette, et
pourtant ne parvient pas à maîtriser l'évolution de ses
dépenses, comme le relève la Cour des comptes dans son rapport
préliminaire sur l'exécution des lois de finances pour 1999, dans
lequel elle souligne que "
si l'augmentation en volume des
dépenses devait se poursuivre à ce rythme, le succès des
efforts de maîtrise des dépenses affichés dans le programme
pluriannuel des finances publiques se trouverait compromis
".
*
Il
ressort de l'analyse des différents aspects des finances locales depuis
les lois de décentralisation les éléments suivants :
- les transferts de compétences opérés par les lois de
décentralisation ne se sont pas accompagnés du transfert des
ressources correspondantes ;
- l'Etat préfère supprimer peu à peu les impôts
directs locaux plutôt que de les moderniser ;
- l'Etat détermine de manière unilatérale
l'évolution de ses concours financiers aux collectivités locales,
en fonction d'une logique budgétaire qui ne tient pas compte de
l'évolution des charges des collectivités locales ;
- les dispositifs de péréquation manquent d'ambition ;
- l'ensemble de ces éléments conduit à rendre les budgets
locaux de plus en plus tributaires des décisions de l'Etat.
CHAPITRE VI
UN BILAN SECTORIEL
La
mission s'est attachée à présenter un bilan de la
décentralisation par grands secteurs. Dans l'impossibilité de
couvrir tout le champ de l'action publique, elle a focalisé ses analyses
sur sept domaines :
- l'aide sociale, compétence de droit commun du département
(I) ;
- la formation professionnelle, secteur déjà largement
investi par la Région (II) ;
- les politiques de sécurité, compétence de l'Etat
pourtant largement partagée (III) ;
- l'éducation, qui a fait l'objet des transferts de
compétences les plus visibles en matière de construction et
d'entretien des bâtiments scolaires (IV) ;
- la culture, peu concernée par les lois de décentralisation
(V) et le sport (VI), qu'elles ont oublié, domaines dans lesquels
l'initiative des collectivités locales s'est néanmoins largement
déployée ;
- enfin, les interventions économiques des collectivités
locales, où le droit est manifestement en décalage avec les
réalités (VII).
I. L'AIDE SOCIALE
De
même que l'Etat, les collectivités locales sont impliquées
dans la lutte contre les exclusions : à côté du
rôle joué par les communes ou leurs groupements dans la politique
de la ville ou de celui assumé par les régions pour
améliorer l'insertion professionnelle des jeunes, les
départements tiennent une place éminente dans la mesure où
les lois de décentralisation leur ont confié la gestion des
prestations d'aide sociale.
Il convient d'évoquer les divers aspects de l'évolution du
régime juridique de l'aide sociale avant de dresser le bilan de l'action
décentralisée en ce domaine.
A. L'ALTÉRATION PROGRESSIVE DU PRINCIPE DES " BLOCS DE COMPÉTENCE "
Le
principe des blocs de compétence cohérents et homogènes,
qui souffrait dès l'origine de quelques concessions dans le domaine
social, a été particulièrement mis à mal dans ce
secteur pour trois raisons : tout d'abord, les services de l'Etat ont trop
souvent tenté de tirer parti des zones de conflits potentiels avec les
collectivités territoriales.
Ensuite, la mise en place des nouveaux instruments de lutte contre la
pauvreté et les exclusions a permis le retour aux mécanismes de
cogestion ; enfin, les départements ne disposent que d'une
influence trop réduite sur les paramètres extérieurs
d'évolution de leurs coûts.
1. La volonté originelle de clarification
Parmi
les diverses compétences transférées,
la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983
portant transferts en
matière d'action sociale et de santé
-qui
bénéficiait du lent travail de maturation opéré
lors de la préparation du
projet de loi pour le développement
des responsabilités des collectivités locales
en 1979- est
sans doute celle qui a appliqué avec le plus de fidélité
la théorie des " blocs de compétence ".
Il est vrai que le
régime antérieur
issu du
décret du 29 novembre 1953,
qui substituait la notion d'aide
sociale -plus moderne et plus respectueuse de la dignité de l'individu-
à celle d'assistance sociale, elle-même issue des grandes lois
sociales de la Troisième République, avait poussé à
l'extrême le principe des
financements croisés
.
Les décrets d'application du
17 novembre 1954
et du
21 mai 1955
prévoyaient ainsi que les décisions en
matière d'aide sociale, dont la mise en oeuvre relevait des directions
départementales de l'action sanitaire et sociale (DDASS), étaient
financées par l'Etat, les départements et les communes suivant
des
clés de financement complexes
: selon les domaines,
l'Etat prenait à sa charge le tiers, les deux tiers ou les quatre
cinquièmes des dépenses, les collectivités locales
supportant le solde ; le partage entre les départements et les
communes était lui-même calculé différemment selon
les secteurs d'intervention et aboutissait à la fixation de contingents
communaux représentant en moyenne 10 % des dépenses d'aide
sociale.
a) Un principe simple
En
réponse à ce système centralisé et
déresponsabilisant, la loi du 22 juillet 1983 oppose un principe
originellement simple : le département -échelon suffisamment
proche des besoins locaux mais cependant assez vaste pour assurer une certaine
cohérence territoriale- est doté d'une
compétence de
droit commun
en matière
d'aide sociale légale
et en
matière de
prévention sanitaire
.
Concernant l'aide sociale, le département est devenu ainsi
responsable :
- de
l'aide médicale
jusqu'au 1
er
janvier
2000, date à laquelle cette compétence a été
à nouveau transférée soit aux organismes d'assurance
maladie, soit à l'Etat dans le cadre de la loi
n° 99-641 du
27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle
(CMU) ;
- de
l'aide sociale à l'enfance
, qui recouvre notamment les
dépenses relatives aux placements d'enfants en établissement ou
en milieu ouvert ;
- de
l'aide aux personnes handicapées adultes
, à
savoir l'aide à domicile, les frais d'hébergement en
établissement ou dans une famille d'accueil et les dépenses
liées à l'allocation compensatrice pour tierce personne
(ACTP) ;
- de
l'aide aux personnes âgées
comprenant la prise en
charge des
frais d'hébergement
en maison de retraite, en
unité de long séjour ou en logement-foyer ou chez un particulier,
l'aide ménagère
ou l'allocation représentative de
services ménagers, ainsi que la prise en charge des repas servis dans
les foyers restaurants.
Depuis la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, le département
assure également la prise en charge de la
prestation
spécifique dépendance
(PSD) versée sous conditions de
ressources, destinée à couvrir l'aide dont la personne
âgée dépendante a besoin, à son domicile ou en
établissement pour l'accomplissement des actes essentiels de sa vie.
Dans le champ sanitaire, le département a reçu la
responsabilité :
- de la
protection sanitaire de la famille et de l'enfance
;
- de la lutte contre les
" les fléaux sociaux "
(prophylaxie de la
tuberculose
et des
maladies sexuellement
transmissibles
) ;
- du
dépistage
précoce des
affections
cancéreuses
et de la surveillance après traitement des
anciens malades ;
- enfin, des actions de
lutte contre la lèpre
.
A ce titre, le département finance les centres de la
protection
maternelle et infantile
(PMI), la formation et l'agrément des
assistantes maternelles, les services départementaux de
vaccination
et enfin les
dispensaires antivénériens
ou
antituberculeux
.
Aux termes de la loi du 22 juillet 1983, le département est
doté d'une compétence générale
, l'Etat ne
conservant qu'une compétence résiduelle dans certains domaines
limitativement énumérés par la loi soit dans des domaines
financés par la sécurité sociale, soit pour des
prestations faisant appel à la solidarité nationale.
La logique des blocs de compétences se heurtait néanmoins,
dès l'origine, à de multiples obstacles tenant à
l'histoire du secteur, à la nature juridique de l'aide sociale
légale et à certaines contraintes empiriques.
b) L'émiettement structurel du secteur social
La
compétence de droit reconnue au département dans le domaine
social et médico-social ne signifie pas que celui-ci détienne une
autorité juridique sur un système hiérarchique
uniformisé : le conseil général joue, en
réalité d'abord, un
rôle d'impulsion et de
coordination
auprès de multiples intervenants dont il assure le
financement.
Pour des raisons historiques, l'action sociale a souvent reposé sur les
initiatives louables prises à titre privé par des institutions
caritatives ou des associations de parents d'enfants handicapés.
Utilisant comme support juridique le statut d'association, de fondation, les
institutions privées sont aujourd'hui ainsi près de 90.000
à intervenir en matière d'action sanitaire et sociale selon le
Centre national de la vie associative
.
Un autre élément historique tient à
la place de la
commune
qui a joué la première un rôle en
matière de prise en charge des indigents ou de gestion des hospices.
Avec les lois de 1982, les communes n'ont reçu aucune attribution
nouvelle mais ont continué à exercer leurs compétences
traditionnelles à travers des établissements publics
ad
hoc
mais aussi les
centres communaux d'action sociale
(CCAS) :
ces derniers ont pour vocation d'assurer une mission globale de
prévention et de développement social,
d'instruire les
demandes d'aide sociale
et d'exercer éventuellement les
compétences déléguées à la commune par le
département. Au demeurant, les communes se sont naturellement
impliquées dans le développement social urbain et l'insertion des
personnes au chômage en recourant aux formules de contrats aidés
par l'Etat (contrats emploi-solidarité ou contrats emplois
consolidés).
Corollaire de ce rôle historique de l'échelon municipal, la
participation financière de la commune aux dépenses sociales
départementales a été maintenue sous forme de
contingents communaux
jusqu'au 1
er
janvier 2000, date de
leur suppression par la loi relative à la couverture maladie universelle.
En raison du transfert de la compétence d'aide médicale et de la
difficulté de mesurer la part relative des dépenses
correspondantes dans le montant du contingent communal, l'article 13 de la
loi du 27 juillet 1999 susvisée a prévu en effet la
suppression complète des contingents communaux d'aide sociale, assortie,
pour des raisons de neutralité financière, d'une réduction
à due concurrence du montant de la
dotation globale de
fonctionnement
(DGF) que verse l'Etat aux communes et d'une augmentation de
la DGF départementale.
Comme l'a souligné M. Pierre Gauthier, directeur de l'action
sociale, lors de son audition, l'émiettement du secteur social et
médico-social, qui est un phénomène ancien, peut
générer des dysfonctionnements et peut faire parfois perdre en
productivité et en efficacité.
c) La définition centralisée de l'aide sociale légale
Il
importe de souligner que le transfert de compétence ne porte que sur
l'aide sociale légale. Il ne concerne pas les prestations
d'action
sociale facultative
que peuvent créer les communes et les
départements, ni les interventions des
régimes de
sécurité sociale
, ni les subventions de l'Etat au titre de
ses programmes d'action sociale.
Il convient en effet de distinguer les notions d'aide sociale et d'action
sociale.
L'aide sociale
légale concerne l'ensemble des
prestations dont les conditions d'attribution sont fixées par la loi
pour l'ensemble des résidents.
L'action sociale publique, entendue au sens large, recouvre l'aide sociale
légale mais aussi
l'action sociale facultative
qui relève
de la libre initiative des collectivités locales mais aussi de l'Etat,
des organismes de sécurité sociale ou encore des institutions
privées.
Comme le rappellent les auteurs de doctrine
260(
*
)
, la construction juridique de l'action sociale est
beaucoup plus fuyante que celle de l'aide sociale :
" elle ne
constitue donc pas un ensemble homogène d'interventions ou de
prestations, ni même de services (...), elle n'est pas non plus
enfermée dans une définition précise. Elle ne constitue
pas, pour ses promoteurs, une obligation mais une simple
faculté ".
L'aide sociale, en revanche, constitue une
obligation pour la
collectivité publique et un droit pour l'individu
.
L'article 124
du code de la famille et de l'aide sociale (CFAS)
dispose clairement que
" toute personne résidant en France
bénéficie, si elle remplit les conditions légales
d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont
définies par le présent code "
.
Suivant les définitions classiques, l'aide sociale est un droit
alimentaire
(qui répond à un besoin vital),
subjectif
(accordée sur demande en fonction de situations
caractéristiques) et
subsidiaire
(versée si la personne ou
ses obligés alimentaires ne peuvent faire face à ses besoins).
Autrement dit,
" l'aide sociale hérite de la très vieille
fonction de l'assistance de dispenser des ressources subsidiaires à tous
ceux dont l'existence ne peut pas être assurée sur la base du
travail ou de la propriété "
261(
*
)
.
En effet, aide sociale ou action sociale sont, en tout état de cause,
des prestations ou des actions qui se délivrent
" sans
contrepartie requise de leur bénéficiaire, selon un principe de
solidarité nationale médiatisé par la puissance publique,
à la différence des dispositifs de prévoyance et
d'assurance sociale qui eux reposent sur une contribution des
assurés "
.
Le caractère obligatoire de l'aide sociale légale a des
conséquences importantes pour des collectivités locales
décentralisées qui n'ont pas juridiquement " la
compétence de leur compétence " :
l'Etat conserve
son pouvoir de réglementation générale et fixe le taux
minimum des prestations d'aide sociale légale et les conditions
légales minimales d'accès à celle-ci
.
La fixation du " corpus " de l'aide sociale légale constitue
une prérogative de l'Etat qui s'appuie pour préparer les textes
réglementaires sur la
Direction de l'action sociale
du
ministère de l'emploi et de la solidarité, laquelle
apparaît à bien des égards comme une structure
administrative originale par rapport à nos voisins européens.
En effet, une telle structure administrative, qui se justifie dans un Etat
décentralisé mais unitaire, n'a pas de raisons d'être dans
un Etat fédéral doté de collectivités autonomes ni
dans les Etats où l'aide sociale est confiée à des
communes institutionnellement et historiquement très fortes.
Du point de vue des collectivités locales décentralisées,
le dispositif juridique actuel présente l'inconvénient de laisser
à l'Etat une marge de manoeuvre non négligeable pour
jouer des
ambiguïtés
entre l'action sociale facultative et l'aide sociale
obligatoire.
S'agissant de l'aide médicale
, avant la mise en place de la CMU,
certains départements avaient prévu, dans les barèmes
d'aide sociale légale, des conditions de ressources avantageuses pour
toutes les personnes pour lesquelles la prise en charge du forfait journalier
et le ticket modérateur n'étaient pas de droit
262(
*
)
. Le dispositif de la CMU, en mettant un place la
couverture maladie complémentaire gratuite, a prévu que les
départements, en contrepartie du transfert de charges, connaîtrait
une diminution de leur DGF
" d'un montant égal aux
dépenses consacrées à l'aide médicale en 1997
diminué de 5 % ".
Mais, le transfert financier, imposé par la loi, a porté aussi
bien sur les dépenses qui avaient été engagées par
les départements au titre de leurs obligations légales minimales,
que sur les dépenses qui avaient été engagées
de
leur propre initiative
et à titre facultatif.
Une analyse analogue pourrait être conduite à propos de la
prestation spécifique dépendance (PSD). Le texte de la loi
n° 97-60 du 24 janvier 1997 ne prévoit pas de montant
minimum de la prestation, laissant planer une confusion sur le point de savoir
si celle-ci est une prestation d'action sociale nouvelle
sui generis
ou
bien une prestation d'aide sociale légale.
Le Gouvernement, pour sa part, a choisi de mettre l'accent sur
l'édiction nécessaire de ce montant minimum, mettant ainsi en
avant le caractère " d'aide sociale légale " de la
prestation sans pour autant proposer de compensation financière de cette
redéfinition des charges.
d) Une compétence résiduelle de l'Etat aux contours flous
La
compétence résiduelle de l'Etat est définie par
l'article 35 de la loi du 22 juillet 1983.
Cet article dispose que demeurent à la charge de l'Etat au titre de
l'aide sociale :
- les cotisations d'assurance maladie des adultes handicapés ;
- l'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent
le service national ;
- l'allocation simple aux personnes âgées ;
- les frais afférents à l'interruption volontaire de
grossesse ;
- l'allocation différentielle aux adultes handicapés
(AAH) ;
- les frais d'hébergement, d'entretien et de formation
professionnelle des personnes handicapées dans les établissements
de rééducation professionnelle mentionnés à
l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
- les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail
(CAT) ;
- les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des
personnes sans domicile de secours ;
- les mesures d'aide sociale -pour les personnes accueillies en centres
d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)-, en
matière de logement, d'hébergement et de réadaptation
sociale.
L'exposé des motifs de la loi susvisée expliquait cette
énumération en soulignant que l'Etat devait conserver un nombre
limité de prestations : celles qui relèvent de la
solidarité nationale, celles dont les bénéficiaires ne
peuvent être rattachés avec certitude à une
collectivité territoriale et enfin celles dont le montant est lié
automatiquement à des prestations de sécurité sociale.
La circulaire d'application du 4 novembre 1983 a effectué une
distinction entre les prestations dont le financement est lié à
la sécurité sociale, les prestations faisant appel à la
solidarité nationale et les prestations de subsistance.
Comme l'indique le rapport public de la Cour des comptes de 1995
263(
*
)
, les critères de détermination du
champ de compétences de l'Etat apparaîssent parfois fondés
sur des critères largement énigmatiques, sinon de pure
opportunité.
S'agissant des rapports entre la
sécurité sociale
et
l'assurance maladie
, on peut retenir que ce ne sera qu'avec la loi de
finances rectificative du 11 juillet 1986 que les départements
prendront finalement en charge les cotisations d'assurance personnelle, des
réticences ayant été exprimées sur ce point en
1983. La loi relative à la CMU a mis fin, de fait, à cette prise
en charge, permettant ainsi une certaine clarification.
En revanche, l'intervention du département dans le domaine sanitaire,
s'agissant en particulier du dépistage du cancer ou de la tuberculose,
soulève du point de vue des interrogations, compte tenu de la
compétence éminente de l'Etat en matière de politique
sanitaire.
A la limite, il eut été plus justifié de confier au
département une compétence en matière de santé
scolaire, dans le fil de la compétence générale qui lui
est reconnue en matière de protection de l'enfance, sachant que sur ce
point les déficiences constatées rendent très difficile
l'évaluation juste du transfert de charge.
Le critère de la
solidarité nationale
a rendu
particulièrement complexe les partages dans le secteur de l'aide sociale
aux personnes handicapées.
La sécurité sociale est restée logiquement
compétente sur les
maisons
d'accueil
spécialisées
(MAS) qui reçoivent les personnes les
plus lourdement handicapées nécessitant des soins médicaux
constants et intensifs.
Par ailleurs, le maintien des centres d'aide par le travail (CAT) et des
ateliers protégés dans le domaine de compétence de l'Etat
a été justifié par la volonté de donner une valeur
de priorité nationale à l'insertion professionnelle des
handicapés.
Enfin, l'Etat a conservé dans son domaine de compétence les
dépenses d'aide sociale pour les personnes sans domicile de secours
ainsi que les dépenses d'aide sociale des personnes recueillies dans les
centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Dès le départ, la compétence de l'Etat dans le domaine de
l'aide sociale, bien que résiduelle en droit, était loin
d'être résiduelle en fait ; assise sur des critères
empiriques, elle a justifié le maintien de services extérieurs de
l'Etat étoffés.
Ceci explique notamment qu'une répartition des compétences
apparemment simple ait ouvert la voie à des " incidents de
frontière ".
2. Des difficultés de mise en oeuvre des compétences partagées
a) La prise en charge des personnes handicapées
•
Les régimes juridiques des différents établissements pour
personnes handicapées formant un véritable puzzle qui peut
générer des conflits.
Il convient de rappeler pour mémoire que la prise en charge des
enfants handicapés
est financée par l'assurance maladie de
la sécurité sociale et par l'Etat à travers le budget de
l'Education nationale.
Concernant les
adultes handicapés
, les structures
d'hébergement (foyers de vie, foyers d'accueil, foyers occupationnels)
sont financ ées par les départements tandis que les
dépenses des MAS réservées aux handicaps les plus lourds
sont financées par l'assurance maladie de la Sécurité
sociale et que les structures de réinsertion professionnelle, telles que
les CAT et les ateliers protégés, sont financées
principalement par l'Etat -même si les frais d'hébergement, hors
activités socio-éducatives, incombent au département.
Depuis 1986, il existe en outre des
foyers à double tarification
(FDT) dont le financement est assuré par le département pour
les frais afférents à l'hébergement et par l'assurance
maladie pour la prise en charge des soins.
De fait, les compétences et les obligations de financement respectives
de l'Etat et des départements ont été effectuées
essentiellement en fonction des catégories d'établissements
sociaux et médico-sociaux. Or, la frontière entre eux reste
souple. Ainsi, devant la pénurie de certaines catégories
d'établissements et en l'absence de critère précis du
handicap,
les personnes handicapées sont orientées autant en
fonction du nombre de places disponibles que de l'évaluation du
handicap.
Cette situation est particulièrement préjudiciable aux
départements du fait du retard pris depuis longtemps par l'Etat en
matière de construction de MAS. Ainsi, dans son rapport public de
1993
264(
*
)
, la Cour des comptes estimait que
les personnes atteintes d'un handicap lourd (polyhandicapées ou
affectées d'un retard mental profond et sévère)
étaient placées autant dans des structures prévues pour ce
type de prise en charge que dans des foyers d'hébergement relevant des
départements. Dans certains cas, ces personnes sont même parfois
hébergées dans des structures pour personnes âgées.
Enfin, le système de tarification des FDT, établissements
créés par simple circulaire, pose des problèmes car le
" forfait-soins " pris en charge par l'assurance maladie est
plafonné à 45 % du prix de journée total. En cas de
dépassement, les départements sont fortement sollicités
pour prendre en charge la différence.
• S'agissant des adultes handicapés relevant des structures
d'aide par le travail, la prise en charge de droit des frais
d'hébergement par le département est souvent utilisée par
les gestionnaires d'établissement comme
variable
d'ajustement
pour pallier la couverture incomplète des
dépenses d'insertion professionnelle insuffisamment financées par
l'Etat.
En effet,
l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale
distingue, s'agissant des établissements d'aide par le travail, d'une
part, les frais concernant l'entretien et l'hébergement de la personne
handicapée et, d'autre part, les charges de fonctionnement de
l'activité sociale de l'établissement, (...) liées
à l'activité de caractère professionnel, ainsi que les
frais de transport collectif. Or l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22
juillet 1983 ne met à la charge de l'Etat, au titre de l'aide sociale,
que les "
frais de fonctionnement
" des CAT : sur le
terrain, la distinction entre les catégories de dépenses est en
pratique peu aisée à faire et les départements ont
beaucoup de mal à dresser le bilan exact des dépenses de
fonctionnement imputables à l'activité du CAT. Le risque
d'imputation erronée ou contestable de certains types de dépense
est bien présent.
Cela apparaît d'autant plus regrettable que les conséquences sont
différentes du point de vue des règles de
récupération de l'aide sociale.
L'article 168
précité dispose ainsi que les frais
d'hébergement des personnes handicapées sont à la charge
des intéressés et subsidiairement, de l'aide sociale ; mais
que les frais de fonctionnement des ateliers sont pris en charge sans qu'il
soit tenu compte des ressources des intéressés.
• L'Assemblée des départements de France (ADF)
souligne le développement, au cours de ces dernières
années, d'institutions " situées entre les CAT et les
MAS " -souvent dénommées foyers occupationnels, foyers
promotionnels, centres d'adaptation, d'accueil de jour ou sections annexes de
CAT-, dont les dépenses ont été mises à la charge
des départements du fait d'une interprétation restrictive de la
notion de travail protégé, en l'absence de texte
législatif confiant explicitement cette compétence aux
départements.
• Un autre point de litige entre l'Etat et les départements
porte sur le financement des
auxiliaires de vie
. Ces personnels,
très utiles pour les personnes handicapées, ont été
créés par simple circulaire à partir de 1981 et
financés par subventions forfaitaires annuelles de l'Etat dans le cadre
d'une convention conclue entre le préfet et l'organisme promoteur. Comme
le rappelle le rapport public de la Cour des comptes, lors de la
décentralisation, ce service n'a été rattaché
explicitement ni au département dans la liste des prestations
légales d'aide sociale qui lui incombent, ni à l'Etat au titre de
l'article 34 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée.
Du fait de l'absence de revalorisation de l'effort de financement de l'Etat,
les personnes intéressées par la création de nouveaux
postes d'auxiliaires se sont naturellement tournées vers les
départements pour lesquels les moyens financiers n'avaient nullement
été transférés.
Il convient de noter que le plan triennal relatif aux personnes
handicapées du 25 janvier dernier fait état de la création
de nouveaux postes d'auxiliaires de vie, les départements étant
à nouveau invités à financer de manière
complémentaire ce poste de dépenses en cas d'insuffisance de
personnels sur le terrain.
• La mise en oeuvre de
l'amendement " Creton "
et
ses difficultés illustrent également la complexité des
relations entre l'Etat et les collectivités locales
décentralisées.
L'article 22 de la loi du 13 janvier 1989 (
art. 6-I bis
de la loi du 30 juin 1975
) a prévu qu'un enfant
handicapé accueilli dans un établissement
spécialisé pour enfant pourrait être maintenu dans celui-ci
au-delà de l'âge réglementaire de 20 ans
jusqu'à ce qu'une place se libère dans une structure pour
adultes.
Il est prévu dans ce cas que la décision fixant le maintien
" s'impose à l'organisme ou à la collectivité
compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de
soins dans l'établissement pour adultes désigné par la
COTOREP "
.
Ce système, qui devait conduire à une responsabilisation
financière des organismes chargés de l'offre de places dans les
établissements pour handicapés adultes, a entraîné
une multiplication des situations conflictuelles. D'une part, le dispositif en
ne prenant pas en compte les frais afférents à l'insertion
professionnelle a écarté
de facto
la mise en jeu de la
responsabilité financière de l'Etat en cas d'insuffisance de
places en CAT. Par ailleurs, les départements ont souvent
été amenés à contester les critères sur
lesquels les CDES et les COTOREP ont considéré qu'un jeune adulte
maintenu en institut médico-éducatif (IME) relevait d'un simple
hébergement par le département, et non pas d'un accompagnement
médicalisé en MAS.
En définitive, contrairement aux intentions initiales, l'amendement
" Creton " a conduit à un " embouteillage " dans les
instituts médico-éducatifs (IME) du fait du maintien des jeunes
adultes dans ces institutions au détriment des enfants handicapés
qui nécessitaient ce mode de prise en charge.
L'édiction de la circulaire ainsi que l'effort engagé par l'Etat
pour créer de nouvelles places en MAS ont contribué à
apaiser les tensions. Il reste que la question des règles de prise en
charge des frais n'a pas fait l'objet d'une clarification législative.
b) La prise en charge des parents isolés en difficulté
Les
centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
constituent des institutions sociales et médico-sociales qui jouent un
rôle particulier en matière de réinsertion de personnes en
difficulté. L'approfondissement de la crise de l'emploi dans les
années 80, conjugué au développement du nombre des
familles monoparentales, a souvent entraîné des
phénomènes d'exclusions pour des mères en charge de jeunes
enfants.
Aux termes de la loi du 30 juin 1975, les CHRS peuvent assurer avec ou sans
hébergement, tout ou partie des missions suivantes :
" l'accueil, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation
à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des personnes
ou des familles en détresse ".
Les CHRS développent largement les activités d'accueil, notamment
d'écoute et d'orientation, aux côtés des missions plus
classiques d'hébergement. Dans ce cadre, ils sont souvent conduits
à recevoir des mères isolées avec de jeunes enfants et
réclament à ce titre une contribution au conseil
général.
Conformément à la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, le
département a une mission générale de protection de la
famille et de l'enfance et à ce titre, il lui revient d'assurer
"
la prise en charge des femmes enceintes et des mères
isolées avec des enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un
soutien matériel et psychologique
".
La difficulté en l'espèce est que le département est
conduit à assumer financièrement les conséquences de
décisions prises par des établissements financées
essentiellement par l'aide sociale de l'Etat : les départements ne
sont pas autorisés à coordonner leur action avec l'ensemble de
celle des services de protection maternelle et infantile.
Il a été demandé aux préfets, par voie de
circulaire, de passer des accords avec les présidents de conseils
généraux permettant de régler les questions de
financement, l'objectif étant d'éviter les séparations
familiales et d'assurer dans une même structure l'accueil de la
mère et de l'enfant. L'article 134 de la loi relative à la
lutte contre les exclusions incite les établissements relevant de la
compétence de l'Etat et du département à rechercher des
solutions évitant la séparation des membres d'une même
famille.
Au-delà du souci légitime d'éviter la séparation de
la mère et des enfants, la difficulté est de savoir si ces
familles à la dérive parfois sans domicile connu relèvent
bien d'un hébergement au titre de la protection de l'enfance
financé par le département ou si le placement ne relève
pas plutôt en priorité des structures ayant vocation à
jouer un rôle d'adaptation sociale.
Il semble que certains préfets aient systématiquement
renvoyé le financement de l'accueil des mères avec enfants
isolés vers les structures de la protection de l'enfance pour des
raisons apparemment purement budgétaires, afin d'alléger le
coût des prises en charge dans les CHRS déjà très
sollicités.
c) La judiciarisation de l'aide sociale à l'enfance
Si le
département est seul responsable du financement des mesures d'aide
sociale à l'enfance, le dispositif prévu par la loi de 1983
instaure néanmoins un
partage original des
compétences
: en effet, les décisions de placement en
établissement ou en famille d'accueil ainsi que les mesures d'assistance
éducative peuvent être décidées aussi bien par les
services du conseil général que par le juge des enfants. Le
président du conseil général a une compétence
liée quant à l'admission des enfants confiés à ses
services.
La protection de l'enfance intervient suivant une
gradation de moyens en
fonction de la difficulté des situations.
Les services de l'ASE peuvent tout d'abord prévenir les risques courus
par les enfants au sein d'une famille lorsque les conditions d'existence de
celle-ci peuvent mettre en danger la santé, la sécurité ou
la moralité des enfants : les services de l'ASE peuvent donc
accorder des secours financiers, assurer l'intervention d'une travailleuse
familiale ou d'une aide ménagère ou encore prendre une mesure
d'assistance éducative : soit une mesure d'action éducative
en milieu ouvert (AEMO), soit une mesure de placement temporaire en
établissement. Dans tous les cas, les décisions de l'ASE sont
prises en accord avec les parents.
Lorsque la situation familiale apparaît très
dégradée, ou lorsque le danger pour l'enfant devient effectif
seul le juge des enfants, intervenant en matière civile ou en
matière pénale, peut prendre des décisions remettant en
cause l'exercice de l'autorité parentale.
Le juge peut ainsi ordonner des mesures d'assistance éducative sur la
base de l'article 375 du
Code civil
"
si la santé, la
sécurité, la moralité d'un mineur non
émancipé sont en danger, ou si les conditions de son
éducation sont gravement compromises
" : il peut s'agir
d'AEMO, voire d'une mesure de placement si l'enfant doit être
retiré de son milieu familial. L'exécution de ces mesures
judiciaires et leur financement est à la charge du département.
En cas d'actes de délinquance, le juge tranche au pénal, sur la
base de l'ordonnance du 2 février 1945, le juge peut prendre deux types
de mesures : soit des mesures "
éducatives
",
-"
de protection, d'assistance, de surveillance et
d'éducation
"-, qui sont sensiblement les mêmes que
celles prévues au titre de l'assistance éducative, et qui sont
assurées et financées en pratique par le service
départemental de l'ASE ; soit des mesures de placement du mineur
délinquant dans un établissement ou une structure
appropriée financée alors par le budget de l'Etat au titre de la
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Enfin, il convient de rappeler que le financement de l'accueil des enfants
admis en qualité de pupilles de la Nation et du service des tutelles
d'Etat sur les mineurs est à la charge du département.
L'examen des populations accueillies en établissement, ou
bénéficiant d'une mesure d'AEMO, montre la part croissante des
décisions d'origine judiciaire.
Au début des années
80, le nombre de placement en établissement d'origine judiciaire
s'élevait à 60 % ; ce taux passe à 71 %,
voire 75 % dans certaines départements, dans les années 90.
Il est observé une tendance à la baisse des placements
décidés directement par les services de l'ASE (de 50.000 par an
en moyenne dans les années 80 à 34.000 par an dans les
années 90) en raison notamment de la diminution du nombre de pupilles de
l'Etat due aux progrès de la contraception et au développement
des aides aux familles monoparentales. Dans le même temps, les placements
d'origine judiciaire se maintiennent continûment à niveau
élevé, de l'ordre de 72.000 par an. Parallèlement, sur les
mesures d'AEMO en cours, le taux de mesures décidées par le juge
passe de 66 % en 1982 à plus de 70 % dix ans plus tard :
Les mesures décidées par le juge (mesures d'AEMO ou de placement)
le sont pour une durée sensiblement plus longue que celles
décidées par l'ASE.
La part croissante prise par les populations relevant d'une décision
judiciaire traduit en fait, selon les services de conseils
généraux, une
tendance des juges à renvoyer vers l'ASE
des jeunes qui relèveraient plus de l'éducation surveillée
que de l'assistance éducative
.
De fait, l'évolution des missions et du fonctionnement des services de
la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) gérés par l'Etat
est préoccupante.
Malgré l'effort récent de planification, de renforcement et de
redéploiement engagé par le ministère de la justice, les
départements constatent que leurs services sont de plus en plus
sollicités, en l'absence d'autres réponses pertinentes, pour
accueillir des jeunes ayant, par ailleurs, commis des actes de
délinquance.
Les efforts annoncés avec la création notamment des unités
éducatives renforcées, sont loin de pouvoir satisfaire le besoin
croissant de prise en charge éducative lourde de mineurs
délinquants : cela conduit les magistrats dans un certain nombre de
situations à pallier le manque de places en institutions de la PJJ par
des prises en charge au titre de l'assistance éducative.
Ce phénomène de " judiciarisation " de la protection de
l'enfance préoccupe légitimement les responsables des
départements car il est moins le reflet d'une évolution des
situations des familles en difficulté que d'une dérive des
pratiques professionnelles.
En effet, " la judiciarisation " ne semble pas correspondre à
une aggravation effective de la situation des jeunes concernés mais
à une dérive dans les pratiques de certains acteurs du
système de protection de l'enfance, préoccupés de
" se protéger " contre toute erreur d'évaluation du
risque encouru par un mineur et des conséquences pénales qui en
découlent.
L'insuffisance de la prévention administrative et le manque de
concertation dans les décisions de placement contribuent à
restreindre l'autonomie des départements.
Elle conduit à affaiblir la responsabilité des parents, à
restreindre les libertés individuelles et à réduire le
champ des actions de prévention, tout en alourdissant les charges qui
pèsent sur les budgets départementaux.
Près de 20 ans après la mise en place d'une formule originale
de compétences partagées par les lois de 1982, les parties
prenantes sont placées en situation de
" défiance
"
, comme le soulignait M. Jean-Jacques
Andrieux, directeur général de
l'Union nationale des
associations de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes
(UNASEA) au cours de son audition.
d) Des COTOREP insuffisamment attentives aux préoccupations des départements
Instituée par la loi du 30 juin 1975, les
commissions
techniques d'orientation et de reclassement professionnel
(COTOREP) jouent
un rôle décisif pour évaluer la nature et la gravité
du handicap et décider des modalités appropriées de prise
en charge des personnes victimes d'un handicap physique ou mental.
Les COTOREP ont tout d'abord pour attribution de se prononcer sur la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de classer
l'intéressé en fonction de ses capacités professionnelles
puis de l'orienter professionnellement soit vers le milieu ordinaire de
travail, soit vers une formation, soit vers le milieu protégé
(centres d'aide par le travail ou atelier protégé). Tel est
l'objet de l'activité de la première section des COTOREP qui
concerne les relations des personnes handicapées avec le monde du
travail.
La deuxième section des COTOREP est compétente pour instruire les
demandes d'attribution des aides financières. Elle décide du taux
d'invalidité de la personne handicapée, de l'attribution des
allocations en espèces, à savoir l'allocation aux adultes
handicapés et l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et
de l'admission éventuelle de la personne dans un établissement
spécialisé lorsque le handicap est incompatible avec toute
activité professionnelle (maison d'accueil spécialisé ou
autre).
La composition des COTOREP s'efforce d'instaurer un équilibre entre les
parties prenantes administratives, médicales ou associatives. Il est
à noter que la présence des conseils généraux a
été renforcée depuis le décret du 6 mai 1995.
Les décisions prises par les COTOREP n'associent pas réellement
le financeur qu'est le département, qui demeure néanmoins
lié par les décisions de ces commissions. En effet, les COTOREP
ont vocation à évaluer le handicap, à se prononcer sur le
principe des allocations et à désigner l'établissement
habilité à accueillir la personne handicapée.
La composition des COTOREP
Les
COTOREP sont composées de 20 membres nommés pour trois ans
renouvelables par le préfet. Elles comprennent :
- 3 conseillers généraux ainsi que 3 suppléants,
élus par l'Assemblée dont ils font partie ;
- 4 personnes proposées par la Direction départementale du
travail et de l'emploi et de la fonction publique (DDTEFP) dont au moins un
représentant de l'ANPE et un médecin du travail ;
- 2 personnes désignées par le président du conseil
général, dont un médecin, et 2 personnes
désignées par le préfet, sur proposition du Directeur
départemental de l'action sanitaire et sociale (DDASS) et de la
DDTEFP ;
- 4 représentants des organismes d'assurance maladie et
d'allocations familiales ;
- 2 personnes choisies par le préfet, sur proposition de la DDASS
et de la DDTEFP, parmi les personnes présentées par les
organismes gestionnaires des CAT, ateliers protégés et centres de
rééducation professionnelle, ainsi qu'une personne choisie par le
président du conseil général parmi les organismes
gestionnaires de foyers d'hébergement pour personnes
handicapées ;
- 2 personnes choisies par le préfet sur proposition de la DDTE et
de la DDASS parmi les personnes présentées par les associations
représentatives des personnes handicapées ;
- 1 personne choisie par la DDTE parmi les personnes
présentées par les organisations syndicales ;
- 1 personne qualifiée choisie parmi les personnes
présentées par les organisations syndicales de salariés
les plus représentatives.
Le président de la COTOREP est désigné, soit par le
préfet parmi les membres de la commission, soit à la demande du
préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel la commission a son siège. Une circulaire du 25 mai
1984 précise, sur ce point, que la présidence devrait être
confiée alternativement à la DDASS et à la DDT.
Enfin, il faut citer le problème du transport des personnes
handicapées qui peut être effectué par ambulance sur
décision de la COTOREP, les frais de transport étant mis alors
à la charge du département.
Le président du conseil général, qui se prononce sur la
prise en charge de la prestation, demeure lié par les décisions
de la COTOREP. Il ne peut contester ni l'évaluation de la situation du
demandeur, ni son orientation vers l'établissement choisi.
3. De nouvelles formes de " partenariat imposé "
Avec la loi du 1 er décembre 1988, le choix a été fait du retour à une forme de cogestion en matière d'insertion des titulaires du RMI. Ce choix a été confirmé et amplifié en 1990 avec l'instauration des fonds départementaux de solidarité pour le logement (FSL) et en 1992 pour la mise en place des fonds d'aide aux jeunes (FAJ).
a) Le revenu minimum d'insertion (RMI)
A
rebours de la logique initiale des blocs de compétence, la loi du
1
er
décembre 1988 relative au RMI a imposé, au
titre de la lutte contre l'exclusion sociale, de nouvelles formes de
partenariat entre Etat et collectivités locales prévoyant des
procédures de financement et de décision conjointes.
Ainsi, la mise en place des commissions locales d'insertion et des commissions
départementales d'insertion, l'élaboration du programme
départemental d'insertion, l'agrément de certains organismes
d'accueil passent-ils par une
décision conjointe du préfet et
du conseil général
.
Par ailleurs, le département est tenu d'inscrire dans son budget un
crédit au moins égal à 20 % des sommes versées
au cours de l'exercice précédent par l'Etat au titre de
l'allocation attribuée à des personnes résidant dans le
département.
Le rapport sur l'évaluation du RMI de mars 1992
265(
*
)
a analysé clairement les conséquences
du nouveau dispositif au regard des principes de 1982 :
" Le RMI a
aussi contredit l'esprit des lois de décentralisation en pratiquant
d'abord une certaine inversion des compétences : l'Etat verse une
allocation qui n'est pas étrangère à l'aide sociale, et le
département est invité à intervenir dans le soutien
à l'insertion -qui passe surtout par l'emploi, compétence
revenant à l'Etat-. Surtout, il est en contradiction avec la
théorie des " blocs de compétence " en mettant en
oeuvre une compétence cogérée, l'insertion, dans laquelle
l'Etat est un partenaire " obligé " du Conseil
général, alors que l'objectif d'autonomie des différentes
collectivités -avec son corollaire : " qui décide
paie "- était essentiel dans les lois de
décentralisation "
.
Dans le même sens, le rapport public de la Cour des comptes de 1995
souligne que le financement des dépenses liées à
l'insertion s'est
" écarté des principes posés par
la loi de décentralisation "
en établissant
" un
lien automatique et forfaitaire "
entre les finances
départementales et le montant des dépenses supportées par
l'Etat au titre de l'allocation : "
ce lien est d'autant plus
dérogatoire que les départements ne sont pas associés
à la décision d'attribution de l'allocation et que le montant et
les conditions d'attribution du RMI sont fixés par voie
réglementaire "
.
Dans l'analyse qu'elle a réalisée près de dix ans
après la création du dispositif de la loi du
1
er
décembre 1988, l'ADF met en évidence le
" manque de clarté et de lisibilité "
du
système avec une demande forte d'une clarification des
compétences et des responsabilités de chacun.
La croissance élevée du nombre de bénéficiaires
constatée de 1988 à 1999 est allée de pair avec une
banalisation du dispositif
par rapport à ses objectifs initiaux
et au public originellement visé.
L'ADF regrette le taux d'insertion trop faible des bénéficiaires,
malgré la mobilisation de plus en plus importante des
départements, ainsi que la difficulté d'instruire de
manière pertinente des contrats individualisés et annuels. Le
dispositif d'insertion cogéré fait apparaître une
absence de coordination
entre les multiples acteurs de la prise en
charge.
Le département est ainsi trop souvent placé dans la situation
paradoxale d'être impliqué au coeur des difficultés de
l'insertion sur le terrain, tout en ayant des moyens et des prérogatives
trop réduits pour jouer un rôle véritablement efficace. La
" cogestion " demande au département de jouer un rôle de
" partenaire actif " sans pour autant lui confier les outils
nécessaires pour faire face, au plus près, aux besoins
d'insertion et en en ne lui permettant pas de devenir un véritable
" chef de file ".
Le secteur de l'insertion fait intervenir les départements dans un
secteur d'intervention où l'Etat dispose d'une large maîtrise des
instruments de la formation professionnelle, de la politique de l'emploi et de
la politique du logement social. Les relations avec les partenaires
institutionnels, avec l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) notamment, sont
souvent difficiles.
En conclusion, on peut se demander si la cogestion n'est pas un frein
plutôt qu'un accélérateur pour l'insertion.
b) Le logement pour les plus démunis
L'Etat a
toujours entendu restrictivement l'article 35 de la loi du 22 juillet
1983 qui a mis à sa charge les mesures d'aide sociale en matière
de logement, d'hébergement et de réadaptation prévues par
le code de la famille et de l'aide sociale : il a fait valoir que ce
dispositif visait exclusivement le financement des CHRS.
La progression du nombre de personnes exclues du logement et de sans abri ont
rendu nécessaire une programmation des capacités d'accueil
d'urgence pour les personnes les plus démunies.
La loi n° 90-449 du 31 mai 1990, visant à la mise en oeuvre
du droit au logement
, dite " loi Besson ", a érigé
le principe du droit au logement en
" un devoir de solidarité
pour l'ensemble de la Nation "
et a institué le principe d'une
" aide de la collectivité pour les personnes qui connaissent des
difficultés particulières pour se loger "
, a fixé
des dispositifs d'action spécifique pour mobiliser les acteurs tant
nationaux que locaux.
Le département a été retenu comme échelon pertinent
pour évaluer les besoins et programmer les actions de la politique du
logement pour les personnes défavorisées
dans une logique de
cogestion
.
La loi crée
le plan départemental pour le logement des
personnes défavorisées
(PDALPD
)
, élaboré
conjointement par le préfet et par le président du Conseil
général, qui détermine les catégories de personnes
à prendre en charge ainsi que les objectifs à atteindre,
notamment par la centralisation des demandes de logement et la création
d'une offre supplémentaire de logements.
Par ailleurs, dans chaque département ont été
institués des
Fonds de solidarité pour le logement
(FSL)
destinés à verser des aides financières aux personnes et
aux familles en difficulté pour l'accès à un logement ou
pour le maintien dans les lieux ainsi qu'à assurer le financement de
mesures d'accompagnement social.
Ces fonds présentent la particularité d'être
financés à parité par l'Etat et par les
départements, ces derniers étant tenus d'abonder les fonds au
même niveau que les crédits délégués par le
Préfet. Les crédits consacrés par l'Etat aux FSL ont connu
une progression rapide : ils sont passés de 150 millions de
francs dans le budget pour 1991 à 548 millions de francs dans le
budget pour 2000. Les départements sont tenus d'abonder le montant
inscrit en lois de finances à parité en complétant les
enveloppes déléguées.
Les FSL ont fait l'objet de diverses critiques, les objectifs préventifs
du FSL ont été perdus de vue, conduisant celui-ci à
devenir un instrument de garantie financière pour les bailleurs et
notamment les bailleurs sociaux. Par ailleurs, il a été
regretté l'apparition d'une certaine confusion entre la notion
" d'accompagnement social ", dont la mise en oeuvre relèverait
de la responsabilité des bailleurs ou des associations, et la notion de
" suivi social " nécessitant l'intervention appropriée
d'un professionnel qualifié du secteur social. Enfin, les délais
et coûts de gestion du dispositif par les caisses d'allocations
familiales (CAF) ont donné lieu à des reproches dans de nombreux
départements.
La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
dans ses dispositions relatives à l'accès au logement,
a
cependant pérennisé les FSL en confirmant le principe de
cogestion
initié dans la loi du 31 mai 1990.
Le rôle de coordination du PDALPD triennal est souligné. Celui-ci
intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour
l'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri introduit par la
loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.
De même, les FSL, pour lesquels l'Etat s'engage à un effort
supplémentaire qui devra être accompagné par les
départements, font l'objet de diverses mesures correctrices et de
précision. La possibilité d'ériger les FSL en groupement
d'intérêt public, présidé alternativement par le
préfet et par le président du conseil général,
permet d'asseoir l'existence de ces organismes qui peuvent ainsi
acquérir la personnalité morale.
c) Les fonds d'aide aux jeunes (FAJ)
Créés par la loi n° 92-722 du
29 juillet 1992 portant adaptation de la loi relative au revenu minimum
d'insertion (RMI), les FAJ ont pour objet de délivrer des aides
financières directes et temporaires aux jeunes âgés de 18
à 25 ans pour une durée limitée.
De même que pour les FSL, le financement est assuré à
parité par l'Etat et par le département, la participation de ce
dernier devant au moins être égale à celle de l'Etat.
De même que pour l'accès au logement,
la loi relative à
la lutte contre les exclusions
confirme la mission des FAJ dans l'esprit de
la
" cogestion obligatoire ".
Le montant de la participation
de l'Etat est de 285 millions de francs dans le budget 2000.
La loi précitée dispose que les jeunes relevant du programme
TRACE qui rencontrent des difficultés matérielles, notamment de
logement, bénéficient de l'accès au FAJ durant les
périodes " interstitielles " où ils ne
bénéficient pas d'une rémunération au titre d'un
stage, d'un contrat de travail ou d'une autre mesure dans le cadre des actions
d'accompagnement personnalisé.
4. L'Etat conserve une emprise forte sur des facteurs essentiels d'évolution de la dépense départementale d'aide sociale
Qu'il s'agisse des efforts de revalorisations des rémunérations des personnels des établissements sociaux et médico-sociaux ou de la fixation des normes applicables au secteur, l'Etat dispose d'une large influence sur des facteurs qui conditionnent l'évolution de la dépense locale.
a) Le département ne contrôle pas l'évolution des rémunérations des personnels sociaux et médico-sociaux
Les
dépenses de personnel représentent un poste important de la
dépense sociale départementale : selon l'estimation
réalisée par l'ADF au début de l'année
2000
266(
*
)
, les rémunérations des
personnels représentaient 27,5 milliards de francs, soit environ
18 % de la dépense brute d'aide sociale.
Comme l'avait souligné le rapport public de la Cour des comptes de 1995,
la dépense de personnel joue un rôle prépondérant
dans l'évolution de frais d'hébergement en établissement
qui représentent plus de la moitié des dépenses directes
d'aide sociale :
les trois quarts de la dotation versée aux
établissements sociaux et médico-sociaux
par les
départements
couvrent des dépenses de personnels.
Les personnels des institutions gérées par les associations sont
des personnels de droit privé relevant de conventions collectives
passées avec des fédérations d'employeurs.
La convention collective du 15 mars 1966 de la
Fédération
267(
*
)
des
syndicats
nationaux d'employeurs des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées à but non lucratif
(SNAPEI,
SNASEA, SOP) concerne 180.000 salariés environ.
La convention collective du 31 octobre 1951 "
des établissements
privés d'hospitalisation et de soins, de cure et de garde à
domicile à but non lucratif
", dite convention FEHAP,
s'applique principalement aux établissements sanitaires privés
participant au service public hospitalier, mais aussi de manière
significative aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Sur ce seul champ, 70.000 salariés sont
concernés.
Compte tenu du caractère public du financement des associations dans le
secteur social et médico-social, les avenants aux conventions
collectives ne peuvent être appliqués qu'après une
procédure d'agrément spécifique faisant intervenir la
puissance publique : l'article 16 de la loi n° 75-355 du
30 juin 1975 dispose que les conventions collectives de travail dans le
secteur social ou sanitaire à but non lucratif
" ne prennent
effet qu'après agrément donné par le ministre
compétent, après avis d'une commission où sont
représentés des élus locaux et dans les conditions
fixées par voie réglementaire "
.
Composition de la commission d'agrément
Le
décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à
l'agrément des conventions collectives de travail, des conventions
d'entreprise ou d'établissement et des accords de retraite applicables
aux salariés des établissements et services à
caractère social ou sanitaire à but non lucratif
fixe la
composition de la commission d'agrément de la manière
suivante :
- deux représentants du ministre chargé de la santé et de
l'action sociale ;
- un représentant du ministre chargé de la sécurité
sociale ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- deux représentants du ministre chargé de l'économie, des
finances et du budget :
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- trois présidents de conseil général
désignés par l'assemblée des présidents de conseils
généraux de France ou leurs suppléants ;
- deux maires désignés par l'association des maires de France ou
leurs suppléants.
Le président de la commission est désigné parmi les
membres de celle-ci par le ministre chargé de la santé et de
l'action sociale.
Le ministre chargé de la solidarité joue donc un rôle
clé pour la mise en oeuvre d'accords salariaux passés entre les
représentants des salariés et les employeurs mais dont le
financement sera assuré, en pratique, par les départements.
• Or, les conditions dans lesquelles ont été
agréés les accords dits " Durieux-Durafour " en 1992
ont montré que
la procédure ne garantissait pas de certains
dérapages.
La Cour des comptes rappelle que c'est par une simple circulaire du
ministère de la santé, en date du 29 décembre 1991,
et par deux décrets du 2 janvier 1992, que la décision a
été prise d'étendre aux agents du secteur social et
médico-social le bénéfice du protocole sur
l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels de la
fonction publique hospitalière de novembre 1991.
Par ailleurs, les avenants aux conventions collectives conclus en mars 1992 ont
d'abord fait l'objet d'un refus d'agrément en août 1992, avant
d'être finalement agréés par une décision du
20 avril 1993 à effet rétroactif.
La Cour des comptes relève à l'époque que les
décisions ministérielles ont été prises
" sans que les services du ministère soient capables d'estimer
l'incidence des mesures ainsi accordées sur les finances
départementales "
et sans connaître non plus
" la
marge de manoeuvre budgétaire des départements "
.
La mise en oeuvre des accords " Durafour " va influer largement sur
la hausse de la dépense sociale départementale qui a atteint plus
de 8 % par an en moyenne entre 1992 et 1993. L'impact rétroactif de
la mesure n'a pas peu contribué à alourdir le coût.
• Il convient également de rappeler que
les hausses
incompressibles de coût intervenaient dans un contexte où les
départements n'étaient pas aptes à imposer des normes
globales d'évolution aux dépenses des établissements
.
La tarification au " prix de journée " des dépenses des
établissements, qui a été en vigueur jusqu'en juillet
1999, ne permettait pas aux départements de donner force opposable aux
taux d'évolution préconisés par eux au moment de
l'agrément annuel du budget de l'établissement.
Dans la mesure où les commissions de la tarification sanitaire et
sociale ne considéraient pas, dans leur jurisprudence, que les normes
d'évolution des dépenses fixées par les
départements revêtaient un caractère opposable, les
établissements étaient à même de contester avec
succès au contentieux les budgets initialement notifiés afin
d'obtenir que les départements couvrent par une rallonge
budgétaire les dépassements constatés. Une certaine
déresponsabilisation des parties prenantes en a résulté.
Ce dispositif présentait en outre des effets pervers importants dans des
structures, telles que les CAT, faisant coexister une prise en charge
financée par l'Etat, dans le cadre d'un régime de dotation
globale, et une prise en charge des frais d'hébergement financée
par l'aide sociale départementale sans dotation globale opposable.
Depuis le 1
er
janvier 2000, le caractère opposable du
taux directeur d'évolution des enveloppes de financement du secteur
social et médico-social a été imposé par le
législateur, que les établissements soient financés par
l'assurance maladie, par l'Etat ou par les départements.
Certes, l'effet de la transposition du protocole " Durafour " devient
maintenant moins perceptible et, comme le fait remarquer M. Pierre
Gauthier, directeur de l'action sociale, l'évolution du point d'indice
de rémunération dans le secteur social et médico-social
est demeuré modeste au cours des années qui ont suivi ; il
reste que les départements vont devoir faire face à des
risques croissants de dérive
dans un contexte où la
pyramide des recrutements réduit leurs marges de manoeuvre en
matière d'évolution des dépenses de personnel.
(a) Le glissement vieillesse technicité (GVT)
La masse
des rémunérations des personnels sociaux et médico-sociaux
évolue non seulement en fonction des mesures catégorielles ou
générales d'augmentation du pouvoir d'achat mais également
en fonction des mesures d'ancienneté et de promotion appliquées
individuellement à chacun des salariés concernés.
Ce phénomène est connu sous le nom de
glissement-vieillesse-technicité
(GVT), qui se compose :
-
d'un effet de carrière
(ou GVT positif), qui retrace
l'incidence positive sur la masse salariale des avancements et promotions dont
bénéficient régulièrement les fonctionnaires ;
-
d'un effet de noria
(ou GVT négatif) qui traduit
l'incidence généralement négative sur la masse salariale
du jeu des entrées-sorties.
Or, s'agissant du secteur social et médico-social, dans lequel les
conventions collectives ont été mises en place en 1951 et 1966,
le recrutement est relativement jeune : du fait de la pyramide des
âges, les départs à la retraite, générateurs
de GVT négatif, sont actuellement relativement peu nombreux alors que le
vieillissement des effectifs entraîne, en revanche, un important effet de
GVT positif.
L'effet GVT génère donc nécessairement une hausse
mécanique et inéluctable du salaire moyen par tête dans le
secteur social et médico-social.
Toute revalorisation des rémunérations salariales interviendrait
donc dans un " paysage salarial " dont l'arrière-plan fait
déjà apparaître des tendances inévitables à
la hausse.
(b) Les revalorisations spécifiques de rémunération
Les
employeurs et plusieurs syndicats représentatifs des personnels relevant
de la convention SNAPEI de 1966 ont conclu, le 21 avril 1999, un avenant
visant à revaloriser le statut du personnel d'encadrement. Cet accord
prévoit des revalorisations salariales et des modifications du
régime indemnitaire visant notamment à combler le retard apparu
par rapport aux cadres techniques et administratifs, aux cadres chefs de
service ou aux cadres de direction régis par la convention collective
FEHAP de 1951.
Cet avenant, qui fait suite à un précédent avenant du
6 mai 1997 qui n'avait pas été agréé,
répond à une
demande forte des personnels concernés
alors même que des difficultés de recrutement se font parfois
sentir sur le terrain.
L'accord d'avril 1999 n'a jusqu'ici pas fait l'objet d'un agrément,
même si, au cours d'une réunion de concertation en février
2000, le ministère a fait savoir qu'il n'émettrait pas
d'objections " sur le principe "
de l'agrément de
l'avenant " cadres ".
Un agrément s'inscrit en perspective d'évolution pour les
prochaines années. Mais le facteur essentiel de changement réside
sans doute dans la mise en oeuvre des 35 heures.
(c) La mise en oeuvre du passage aux 35 heures
La
loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail
invite les partenaires
sociaux à négocier une réduction du temps de travail par
la mise en place d'un dispositif d'aide financière.
Au moment du vote de la loi, une question aurait pu se poser sur le point de
savoir s'il était opportun d'étendre le champ de la
réduction du temps de travail au secteur " non
concurrentiel " : le Gouvernement, et sa majorité à
l'Assemblée nationale, ont tranché en indiquant clairement dans
la loi que la réduction du temps de travail pouvait être mise en
oeuvre "
dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord de
branche agréés en application de l'article 16 de la loi du
30 juin 1975
" c'est-à-dire dans le secteur social et
médico-social.
Le passage aux 35 heures hebdomadaires des salariés du secteur
social et médico-social ne s'effectue pas dans les mêmes
conditions que pour les salariés des entreprises du secteur
concurrentiel : le secteur associatif se caractérise par un certain
émiettement des structures
qui ne facilite pas les
réorganisations d'emploi du temps. Par ailleurs, les aides et les
services à la personne qui sont prédominants dans
l'activité du secteur médico-social, s'effectuent à
des
rythmes et des horaires réguliers
qui ne peuvent être
profondément modifiés. Enfin, la prise en charge d'une même
personne peut s'effectuer dans des
structures sociales et
médico-sociales différentes
, ce qui soulève des
problèmes d'harmonisation des horaires et de coordination des prises en
charge.
Dans le secteur sanitaire et social, la réduction du temps de travail
est donc une réforme complexe où il faut réussir à
conjuguer le maintien de la qualité des soins et des prestations, le
respect des attentes des personnels, la réponse aux besoins des
organisations et la maîtrise des coûts nécessaire à
l'équilibre des comptes sociaux.
Le dispositif de réduction du temps de travail est naturellement
complexe dans le secteur social et médico-social puisqu'il fait
intervenir :
-
un accord de branche
, en date du 1
er
avril 1998,
conclu au niveau de l'UNIFED qui porte sur l'organisation de la
flexibilité dans l'organisation du travail sans entrer dans les
détails de la durée du travail ou des compensations
salariales ;
- des accords au niveau des
conventions collectives
concernées, à savoir la convention du 15 mars 1966 (SNAPEI,
SNASEA, SOP), la convention du 31 octobre 1951 (FEHAP), la convention de la
Fédération des centres de lutte contre le cancer et la convention
de la Croix-Rouge française ;
Il est à noter que les gestionnaires de ces conventions collectives ont
fait le choix de négocier rapidement les accords en anticipant sur la
baisse de la durée légale au 1
er
janvier 2000 afin de
permettre aux services et établissements de ne pas être mis en
situation de payer des heures supplémentaires.
- des
accords au niveau de chaque association gestionnaire
déclinés le cas échéant, au niveau des divers
établissements de l'association.
La
mise en place du dispositif s'est avérée
particulièrement lourde
en pratique, puisque le ministère de
l'emploi et de la solidarité a décidé en janvier 1999
d'écarter l'idée d'un agrément automatique des accords
locaux faisant référence aux avenants passés dans le cadre
des conventions collectives et de demander que
chacun des accords
locaux
, c'est-à-dire près de 3.000 accords d'entreprises ou
d'associations, soit
soumis à agrément ministériel
après passage devant la Commission nationale d'agrément. Compte
tenu des masses de documents en jeu et de l'ampleur de la tâche,
l'instruction des accords locaux a été déconcentrée
au niveau des DDASS.
Les départements entreront au cours des prochaines années dans
une période d'incertitude
car la mise en oeuvre de la
réduction du temps de travail ne pourra s'effectuer à coût
constant que si un certain nombre de conditions sont réunies.
Comme l'a analysé -dans son avis budgétaire annuel
268(
*
)
- notre collègue M. Jean Chérioux,
qui a longtemps présidé la commission des Affaires sociales de
l'Assemblée des présidents de conseils généraux
(APCG), les accords collectifs de branche sont apparemment
équilibrés mais leur réussite suppose de tenir un certain
nombre de paris.
L'accord conclu par le SNAPEI par exemple, prévoit que la
modération salariale, assortie des aides légales, permettra de
financer les embauches supplémentaires rendues nécessaires par la
réduction du temps de travail.
Cet accord prévoit :
- un gel de la valeur du point et des mesures catégorielles en 1999
et 2000,
- une suspension à durée indéterminée de la
majoration familiale de traitement pour les naissances à venir.
Pour les associations qui, compte tenu de la durée actuelle du travail,
se situent au-dessus de 6 % d'embauches compensatrices ou de 10 % de
réduction du temps de travail, il est ouvert la possibilité de
conclure des accords d'établissements prévoyant la neutralisation
des progressions de carrière sur un an, deux ou trois ans, en tant que
de besoin. Ce mécanisme revient en quelque sorte à neutraliser
l'effet du glissement GVT sur une durée temporaire, les promotions
à l'ancienneté reprenant leur cours, sans rattrapage
rétroactif, au-delà de la période de gel.
Pour les départements,
la réduction du temps de travail ne
peut s'opérer de manière neutre que si trois paris
réussissent
:
- que les accords locaux d'établissement respectent les
équilibres de financement organisés par les avenants aux
conventions collectives :
il importe d'éviter tout
dérapage
, avec l'accord plus ou moins tacite des
collectivités locales intéressées, au moment de la
définition des engagements initiaux ;
- que les salariés des établissements adhèrent, au
cours des trois prochaines années, à
l'effort de
modération salariale
qui leur sera demandé,
- que les embauches compensatrices puissent s'intégrer efficacement
dans la
nouvelle organisation des rythmes de travail
des travailleurs
sociaux, sans diminution de la qualité du service aux usagers : en
cas de dysfonctionnement persistant, les départements seraient fortement
sollicités pour financer des emplois supplémentaires.
Le rappel des divers éléments qui concourent à la
détermination de l'évolution des dépenses de personnel
dans le secteur social et médico-social, illustre bien la
relative
situation d'impuissance
dans laquelle se trouvent placés les
départements financeurs
, qui ne jouent qu'un rôle consultatif
parmi d'autres catégories employeurs au sein de la commission nationale
d'agrément, et se retrouvent sous la double contrainte du " fait
accompli " résultant des accords passés entre employeurs et
représentants du personnel et du pouvoir d'arbitrage revenant en
définitive à l'Etat.
Aussi, les conseils généraux souhaitent que les partenaires
sociaux présentent à la Commission nationale d'agrément
une étude détaillée sur le coût prévisionnel
des mesures négociées par type de financeurs à partir d'un
échantillon représentatif d'établissements sociaux et
médico-sociaux.
Elle a souhaité, par ailleurs, la mise en place d'un système
d'évaluation du coût réel constaté des avenants et
accords agréés, assorti éventuellement d'un dispositif
permettant le report de la mise en application de certaines mesures d'une
année sur l'autre, en cas de dérapage manifeste.
b) Le poids des normes
•
Les normes techniques
L'incidence financière des nouvelles normes techniques,
régulièrement renouvelées, est un problème
récurrent pour les collectivités territoriales qui sont rarement
associées à leur élaboration.
La dépense départementale d'aide sociale en 2000 comprend
154 milliards de francs de dépenses de fonctionnement mais aussi
95 milliards de francs de dépenses d'équipement dont
39 milliards de francs de dépenses directes.
Ces dépenses d'investissement sont en hausse de 7,7 % par rapport
à l'année précédente. L'ADF rappelle à cet
égard l'effet inflationniste de la multiplication des normes de
sécurité et environnementales.
La question du respect des normes d'équipement est
particulièrement sensible dans les maisons de retraite dont les
pensionnaires sont particulièrement vulnérables en cas
d'accident. Les élus locaux ne peuvent donc que respecter à la
lettre les nouvelles normes qui sont imposées même si leur
utilité n'est pas démontrée.
•
Les normes de moyens
A côté des dépenses d'investissement, l'Etat peut parfois
être tenté d'imposer des normes en termes de moyens plutôt
que de définir des critères objectifs. Tel est le cas en
particulier en matière de protection maternelle et infantile (PMI).
Les décrets d'application de la
loi du 18 décembre 1989
relatifs à la PMI
ont été promulgués en
incluant des normes de moyens.
Si les départements reconnaissent que plusieurs des observations
relatives à la définition des missions du service et aux
obligations de transmission ont été prises en compte, un
désaccord persistant existe sur le principe même de la
définition de normes de moyens.
Il est ainsi prévu des normes minimales pour les consultations de
planification familiale et les consultations prénatales et infantiles.
La définition de telles normes ne tient pas compte
d'éléments aussi importants que l'état sanitaire de la
population du département,
son caractère plus ou moins
urbanisé ou encore le nombre et la dispersion des consultations
hospitalières et des praticiens libéraux.
En ignorant ces données, la mise en oeuvre de telles normes risque
d'aboutir à des décisions arbitraires ne tenant pas compte de la
réalité et des enjeux d'une politique départementale de
protection maternelle et infantile.
L'imposition de normes pour les sages-femmes et les puéricultrices
s'inscrit à tort dans la même démarche qui
privilégie la définition des moyens au détriment de la
fixation des objectifs d'une politique de PMI.
Les normes risquent de perdre beaucoup de signification s'il n'est pas tenu
compte de la réalité des missions et des tâches
confiées aux personnels concernés.
B. LA DÉCENTRALISATION A PERMIS UNE AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE PUBLIQUE DANS LE DOMAINE SOCIAL
1. L'amélioration des performances en matière sociale
a) Une dépense maîtrisée dans un contexte difficile
La
dépense d'aide sociale a fortement augmenté au cours des
15 dernières années. La dernière étude de
l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée
(ODAS) réalisée sur un échantillon
représentatif de 29 départements métropolitains
relative à l'évolution des dépenses nettes d'aide
sociale
269(
*
)
montre que celle-ci serait
passée de 38,4 milliards de francs à 82,8 milliards de
francs en 1999. Elles représentent 60 % environ des dépenses
de fonctionnement des départements.
Ce chiffre doit être complété, pour être exhaustif,
par celui des contingents communaux d'aide sociale qui représentent la
participation des communes à l'effort d'aide sociale
départementale. Les contingents représentaient, en 1999, 12,2
milliards de francs. Il convient de rappeler que ce dispositif de financement
croisé est supprimé à compter de l'exercice 2000 du fait
de l'entrée en vigueur de la CMU.
Cette évolution est à la fois subie et voulue : subie parce
que la persistance de la crise au cours des années 80 et la
montée de l'exclusion ont entraîné, à travers la
mise en place du RMI, à partir de 1988, une forte progression des
dépenses d'insertion et d'aide médicale ; elle est aussi
volontaire parce que les départements ont engagé un effort
d'amélioration du taux d'équipement, notamment en faveur des
personnes handicapées, pour assurer un rattrapage des retards
constatés.
Face à la forte progression des dépenses, force est de constater
que les budgets départementaux ont su absorber sans choc majeur une
profonde modification des contours des publics et des dépenses d'aide
sociale : ils ont su également répondre avec rapidité
aux besoins des personnes traditionnellement accueillies dans les structures
d'aide sociale notamment les personnes handicapées.
DEPENSES NETTES D'AIDE SOCIALE DEPARTEMENTALE 1984-1999
(France métropolitaine)
|
(en milliards de francs) |
1984 |
1989 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Aide sociale à l'enfance |
15,0 |
16,8 |
23,9 |
24,9 |
25,9 |
27,1 |
27,8 |
|
Aide sociale en direction des personnes âgées |
8,7 |
9,3 |
13,1 |
13,5 |
13,1 |
12,3 |
11,7 |
|
Aide sociale en direction des personnes handicapées |
6,2 |
7,7 |
12,8 |
13,5 |
14,1 |
15 |
15,8 |
|
Aide médicale |
2,0 |
2,6 |
6,4 |
6,3 |
6,9 |
7,2 |
7,7 |
|
Charges d'insertion des bénéficiaires du RMI |
|
0,2 |
3 |
3,2 |
3,5 |
4 |
4,2 |
|
Autres dépenses |
6,5 |
8,7 |
13,8 |
14,2 |
14,8 |
15,4 |
15,6 |
|
Dépense nette totale |
38,4 |
45,3 |
73 |
75,6 |
78,3 |
81 |
82,8 |
Source lettre de l'ODAS avril 2000
Les
travaux de l'ODAS auquel il sera fait référence permettent
d'effectuer une analyse comparative des dépenses sur les données
les plus récentes.
Les résultats de l'ODAS sont établis à partir de
données rassemblées auprès d'un échantillon
représentatif de 29 départements.
Par convention, les dépenses observées sont les
dépenses nettes d'aide sociale
: elles tiennent compte des
recettes directes correspondantes, avant déduction du contingent
communal, afin d'offrir une photographie la plus réaliste possible de
l'effort des collectivités publiques concernées.
Les données relatives aux bénéficiaires de l'aide sociale
départementale sont issues de l'enquête "
Aide
sociale
" de la
Direction de la recherche, des études, des
évaluations et des statistiques
(DREES) du ministère de
l'emploi et de la solidarité
270(
*
)
.
•
L'aide sociale à l'enfance
représente presque,
avec 28 milliards de francs en 1999, le
premier poste de dépenses de
l'aide sociale départementale
.
Entre 1995 et 1999, ces dépenses augmentent de 4 % par an en
moyenne, soit sensiblement plus que l'inflation.
Comme le souligne l'ODAS, cette augmentation tient pour beaucoup à
l'accroissement de la masse salariale des personnels des
établissements et des assistantes maternelles.
De surcroît, le
coût moyen d'un placement a fortement augmenté (150.000 francs par
an en 1998 contre 87.000 francs en 1989) en raison du renforcement de
l'encadrement dû à la difficulté croissante de la prise en
charge des enfants en danger.
Enfin,
l'augmentation du nombre d'enfants accueillis
joue
également un rôle. Certes, le nombre d'enfants placés
augmente peu : il passe de 134.000 en 1989 à 135.109 en 1992 et
à 138.063 en 1999. La relative stabilité des placements de 1989
à 1992 semble due à la mise en place du RMI qui a
contribué à stabiliser les ressources des familles en
difficulté. Mais, en revanche, le nombre d'actions éducatives en
milieu ouvert ou à domicile augmente sensiblement : celles-ci
passent de 112.777 en 1992 à 127.684 en 1996, soit une hausse de
13,22 %. Cette progression montre la volonté des
départements et de leur service d'aide à l'enfance d'assurer un
maintien de l'enfant dans son environnement.
•
L'aide sociale aux personnes âgées
représente
11,7 milliards de francs
en 1999 alors que son
montant ne dépassait pas 8,7 milliards de francs en 1984.
Plusieurs phénomènes se conjuguent, compliqués au
demeurant par les conséquences de la phase transitoire
consécutive à la mise en place de la prestation spécifique
dépendance.
Il apparaît que le nombre de bénéficiaires des
aides
ménagères
(66.600 en 1999 contre 101.016 en 1992) diminue
régulièrement en raison de l'élévation du niveau de
vie des personnes âgées : le coût total de l'aide
ménagère passe donc de 1,5 milliard de francs en 1989 et en 1992
à 1 milliard de francs environ en 1999.
Le nombre de personnes âgées accueillies en établissement
ou chez des particuliers (accueil familial) est lui aussi plutôt sur une
pente descendante : il passe de 133.900 en 1992 à 123.000 en 1999
en raison de l'augmentation du niveau de vie des personnes âgées
mais aussi du fait que l'entrée en établissement s'effectue en
moyenne à un âge de plus en plus avancé. Il reste que les
dépenses augmentent encore fortement passant de 4,8 milliards de
francs en 1984 à 5,7 milliards de francs en raison du coût
plus élevé de la prise en charge de personnes devenues de plus en
plus dépendantes.
Le facteur essentiel de progression des dépenses proviendra donc de
l'augmentation de l'aide au maintien à domicile par le biais du
versement de l'ACTP aux personnes âgées de plus de 60 ans :
les dépenses vont tripler de 1984 à 1996 passant de
1,8 milliard de francs à 5,3 milliards de francs.
A compter de 1997, ces dépenses diminueront en raison de l'institution
de la PSD, les données demeurant toutefois difficiles à analyser
en raison du caractère récent de la prestation.
•
L'aide sociale aux personnes handicapées
connaît
également une progression non négligeable : elle
représente 15,8 milliards de francs en 1999 contre
6,2 milliards de francs en 1984.
Le première phénomène est celui de l'augmentation
modérée mais régulière du nombre de places en
établissement (79.300 en 1999 contre 69.091 en 1992). La modernisation
des établissements et de leurs conditions de vie explique une
progression du coût de l'hébergement. 12,5 milliards de
francs en 1999 contre 4 milliards de francs en 1984, soit un
quasi-triplement. Ce phénomène recouvre une diversification des
modes de prise en charge : le nombre de places d'accueil de jour a
triplé en passant de 3.116 en 1992 à 8.600 en 1999 ; les
bénéficiaires de l'aide ménagère ou d'auxiliaires
de vie atteint 12.800 en 1999 au lieu de 6.970 en 1992.
La part de l'ACTP aux personnes de moins de 60 ans représente une
dépense de 3,3 milliards de francs en 1999 (90.342
bénéficiaires).
•
Les dépenses d'insertion
constituent le poste de
dépenses d'aide sociale qui a connu la progression la plus
spectaculaire : ces dépenses qui étaient quasi-inexistantes
en 1984, avec 2 milliards de francs, atteignent en 1999
11,9 milliards de francs. Le RMI mis en place en 1988, loin
d'atténuer la charge des départements, a en réalité
été un puissant facteur d'accélération des
dépenses puisqu'il a permis une meilleure identification des personnes
et familles en difficulté et qu'il a généré
l'ouverture d'un certain nombre de droits connexes (prise en charge des
dépenses de cotisation d'assurance personnelle et de l'aide
médicale). Les dépenses d'aide médicale qui vont
être transférées à l'assurance maladie à
compter du 1
er
janvier 2000, représentaient
7,7 milliards de francs en 1999.
b) La décentralisation n'est pas un facteur d'aggravation des inégalités de l'offre sociale
Selon
une idée reçue, communément répandue, la
décentralisation aurait pour effet de
renforcer les
inégalités
en matière de réponse sociale sur le
territoire. En raison des inégalités de potentiel fiscal entre
les départements, les citoyens auraient droit à un traitement
différencié selon leur localisation.
Cette approche est simplificatrice à l'excès : la
réalité est qu'il existe des disparités en matière
d'équipement pour personnes âgées et pour personnes
handicapées sur le territoire, mais que
celles-ci étaient
bien
antérieures à la décentralisation
. Elles
tiennent notamment à des raisons historiques et aux conditions dans
lesquelles l'initiative privée s'est manifestée sur le terrain.
Ainsi, les initiatives des collectivités locales et des associations a
été le principal moteur de la création
d'établissements pour enfants handicapés au cours des
années 50 et 60. Ces initiatives, qui se sont poursuivies au niveau des
structures pour adultes, n'étaient pas nécessairement
coordonnées et n'avaient donc pas de raison d'aboutir à une
densité égale d'un département à l'autre.
•
La gestion centralisée n'est pas une garantie
d'homogénéité
Au-delà des diversités historiques, il apparaît qu'une
gestion centralisée ne garantit nullement une
homogénéisation des prestations et des structures sur l'ensemble
du territoire national.
La Cour
des comptes relevait, dans son
rapport de 1996, que les disparités géographiques existaient
avant la décentralisation en matière sociale.
De surcroît, il existe également des disparités importantes
dans les domaines du secteur social et médico-social dont l'Etat a
conservé la gestion. Ainsi, le taux d'équipement en CAT,
financés sur le budget de l'Etat, varie de un à deux suivant les
départements.
S'agissant de l'implantation des
maisons d'accueil
spécialisé
(MAS) financées par l'assurance maladie, M.
Pierre Gauthier, directeur de l'action sociale, rappelait que le taux
d'équipement variait de un à cinq selon les départements.
Il est vrai qu'il s'agit d'établissements créés par la loi
du 30 juin 1975 dont l'implantation demeure relativement récente.
L'examen de la densité de places en MAS rapportées à la
densité par habitant fait apparaître des écarts encore plus
importants : certains départements comptent 0,25 place de MAS
pour 1.000 habitants alors que, pour d'autres, ce taux atteint 7,52.
Mais surtout il est frappant de constater
qu'une prestation non
contributive,
telle que l'AAH, dont le financement est assuré par
l'Etat et
dont les règles d'attribution sont fixées
uniformément sur tout le territoire national, fait également
apparaître d'importantes disparités départementales,
ce
qui est pour le moins paradoxal.
L'enquête IGF/IGAS de janvier 1999 sur les dysfonctionnements de
l'allocation aux adultes handicapés avait mis en évidence que les
taux d'attribution de l'AAH variaient de 1,14 % à 0,78 % en
1996 selon les départements, les taux étant
particulièrement élevés dans la partie la plus rurale du
grand ouest et plus faible dans la région parisienne. Le rapport
soulignait l'influence de facteurs tels que la plus ou moins forte
capacité d'accueil des handicapés et de la richesse imposable.
Une analyse plus récente
271(
*
)
portant
sur un échantillon représentatif de 24 départements montre
qu'à la fin de 1998, le taux d'allocation de l'AAH pour 1.000 habitants
de 25 à 49 ans variait de 8 à 48,
soit dans un rapport de
1
à 6
.
Les disparités ne s'expliquent pas seulement en raison des
différences de profil des demandeurs qui se présentent à
chaque COTOREP. C'est ainsi qu'interviennent également " la
pression de la demande " (nombre de dossiers à traiter) et la
situation locale en matière de chômage et de minima sociaux.
(a) La décentralisation a permis un effort de rattrapage en matière d'équipements pour personnes handicapées adultes ou âgées
•
Les études sur l'évolution des disparités
départementales en matière d'aide sociale qui sont
nécessairement des études lourdes nécessitant un certain
recul, ne portent que sur la période qui s'étend jusqu'à
1993, soit les dix premières années de la
décentralisation. L'analyse devra être affinée sur les
années suivantes où les dépenses d'insertion et d'aide
médicale ont pris une place plus importante dans les budgets
départementaux en raison de l'augmentation du chômage de longue
durée et de l'aggravation des phénomènes d'exclusion.
Par ailleurs, la mise en place de la PSD à partir de 1997 et la
suppression corrélative de l'attribution de l'ACTP aux personnes
âgées de plus de 60 ans a certainement des incidences sur les
disparités de prestation comme il est de règle dans les
premières années de fonctionnement d'un dispositif nouveau.
Pour autant, le débat, focalisé sur
la question des
disparités dans l'attribution de la PSD, ne doit pas occulter les
phénomènes de longue durée : la
décentralisation de l'aide sociale
sur près de dix ans n'a
pas été synonyme d'une tendance à
la dispersion
des
niveaux d'intervention des départements elle est allée de pair,
au contraire, avec une
convergence des niveaux de dépenses par
habitant
.
Comme le souligne M. Jean-Louis Sanchez, directeur de l'ODAS, "
Parmi
les diverses inquiétudes exprimées lors de la
décentralisation de l'aide sociale, l'une des plus vives portait sur
l'aggravation des inégalités en matière d'offre de
services des départements. Même si la réglementation
nationale assurait, et continue d'assurer, l'uniformisation des conditions
minimum d'accessibilité aux droits, on pouvait penser que les
disparités déjà existantes avant la
décentralisation allaient perdurer, voire s'accroître. Or,
l'analyse de l'évolution des dépenses de l'ensemble des
départements permet de constater l'existence d'une tendance plutôt
orientée vers la convergence des budgets d'action
sociale.
"
272(
*
)
La Cour des comptes, dans son rapport de 1995, relevait ainsi une tendance
à la réduction des écarts géographiques de la
dépense par habitant entre 1988 et 1993, retenant comme base de calcul
le rapport entre la dépense moyenne des départements ayant le
montant des dépenses par habitant le plus élevé d'une part
et celles des départements ayant le montant des dépenses par
habitant le plus faible d'autre part.
Cette méthode fait apparaître une réduction des
écarts départementaux importante (- 25,3 %) pour l'aide
médicale pour des raisons tenant à l'uniformisation des
règles d'attribution d'une aide aujourd'hui
" recentralisée ".
Elle fait ressortir également
une réduction significative des
écarts concernant l'aide sociale à l'enfance
(- 8,5 %)
et l'aide sociale aux personnes handicapées
, à la fois
pour les dépenses d'ACTP (- 9,9 %) et pour les aides à
l'hébergement (- 10,4 %). Seule l'aide sociale aux personnes
âgées ne fait pas apparaître de baisse d'écart, ce
qui s'explique à la fois parce que les données statistiques
n'intègrent pas l'effet du versement de l'ACTP à des personnes de
plus de 60 ans, mais aussi parce que les dépenses d'aide
ménagère ou d'hébergement en établissement ont
légèrement diminué du fait des tendances
démographiques et de l'amélioration du niveau de vie des
personnes âgées.
L'ODAS a également réalisé une étude en retenant
comme indicateur de dispersion le rapport de la dépense du
81
ème
département au
15
ème
département.
Evolution comparée des dépenses d'aide sociale et de leur dispersion 273( * )
|
|
Taux de
croissance
|
Taux
d'évolution
|
Tendance
|
|
Aide sociale aux personnes âgées |
- 3 % |
- 4 % |
La dispersion reste importante |
|
Aide sociale à l'enfance |
+ 24 % |
- 6 % |
Poursuite du resserrement à un rythme lent |
|
Allocation compensatrice |
+ 50 % |
- 19 % |
Accélération du mouvement qui date surtout de 1989 |
|
Hébergement des personnes handicapées |
+ 97 % |
- 12 % |
Mouvements erratiques depuis 1989, qui se poursuivent |
|
Ensemble de l'aide sociale |
+ 42 % |
- 3 % |
|
Sources : SESI, ODAS
Elle souligne ainsi que
c'est dans le secteur de l'hébergement des
personnes handicapées, où la croissance des dépenses a
été la plus forte, que la réduction des disparités
a été la plus significative.
Or, dans ce domaine,
"
l'augmentation des prestations repose essentiellement sur la mise en
oeuvre d'orientations politiques s'adaptant au contexte financier
".
En revanche, peuvent être considérées comme des domaines
à plus faible convergence de dépenses, l'aide sociale à
l'enfance et l'aide sociale aux personnes âgées.
L'aide sociale à l'enfance (ASE) est un secteur dont la dépense
augmente peu et pour lesquels l'éventail des dépenses se resserre
donc légèrement. L'ODAS fait néanmoins observer que les
plus fortes augmentations de dépenses concerne en majorité les
départements du sud et de l'ouest de la France dont les dépenses
étaient traditionnellement moins élevées :
l'uniformisation s'est donc effectuée sur des critères
socio-démographiques.
L'aide sociale aux personnes âgées non handicapées ne
connaît pas d'évolution forte : cela ne signifie pas qu'il
n'y ait eu aucun mouvement, mais les principales hausses et les principales
baisses concernent des départements dont la dépense était
faible. Au demeurant, le niveau d'intervention des départements
dépend beaucoup des données socio-démographiques.
• L'effort des départements a donc été
particulièrement soutenu en ce qui concerne les établissements
d'accueil pour personnes handicapées.
Le nombre de places d'accueil est passé de 39.000 en 1984 à
71.000 en 1994, puis à 92.000 au 1
er
janvier 1998
principalement sous forme de la création de foyers occupationnels et de
foyers d'hébergement.
Cet effort a permis un véritable rattrapage des retards constatés
au moment des lois de décentralisation qui s'est poursuivi dans les
années 1990 au moment où la crise s'approfondissait et où
une part plus importante des budgets locaux était absorbée par
les dépenses d'insertion.
Dix ans d'évolution des établissements médico-sociaux pour adultes handicapés
|
|
Nombre |
Nombre de places installées |
Evolution du nombre de places |
TE
(1)
pour
|
Evolution du CV (2) |
|||
|
|
1988 |
1998 |
1988 |
1998 |
|
1988 |
1998 |
1988/1998 |
|
Foyer d'hébergement |
935 |
1.229 |
30.915 |
39.283 |
+ 27 % |
1,04 |
1,24 |
- 19 % |
|
Foyers occupationnels |
345 |
882 |
13.755 |
29.731 |
+ 11,6 % |
0,46 |
0,94 |
- 22 % |
|
Foyers à double tarification |
nd |
187 |
nd |
6.222 |
nd |
nd |
0,20 |
nd |
*
Coefficient de variation
Champ : France métropolitaine
Date : données au 1
er
janvier 1988 et 1998
Source : DREES/Enquête ES - Population INSEE - projections
Omphale
Ces données appellent deux observations.
L'effort en matière d'équipements pour personnes
handicapées concerne non seulement les adultes handicapés
physiques et mentaux mais également des personnes âgées
proches de l'âge de 60 ans pour lesquelles l'infirmité s'est
déclarée tardivement, même si les données
statistiques ne permettent pas de mesurer la part relative des deux
catégories de population.
Les départements ont
réalisé un effort à la fois qualitatif et
quantitatif
: une première période a été
consacrée à la transformation de places vétustes
d'hospices en autant de places plus adaptées et plus coûteuses
dans les foyers d'accueil modernisé.
Cet effort s'est poursuivi pour faire face à l'afflux régulier de
nouveaux demandeurs, de l'ordre de 5.000 par an en moyenne. L'aide sociale en
matière d'hébergement des personnes handicapées adultes ou
vieillissantes constitue un poste de dépense important, ce qui conduit
à nuancer les reproches adressés aux départements
concernant leur manque de " générosité " en
matière de gestion de la PSD.
La seconde observation porte sur la
nécessité du maintien
d'une marge de manoeuvre financière des départements
. Les
investissements pour créer des places nouvelles sont d'autant plus
aisés que la section de fonctionnement du budget social est
équilibrée. A cet égard, le renchérissement du
coût des services peut amoindrir la faculté d'investissement des
budgets départementaux.
c) Les départements ont su développer leurs services sociaux
Dans son
rapport public de 1995 relatif à l'aide sociale départementale,
la Cour des comptes a reconnu
le caractère
" réussi " du partage des services et des effectifs
résultant de la mise en oeuvre de la loi du 22 juillet 1983. Des
conventions ont assuré le partage des services et des effectifs à
partir du début de l'année 1985. Trois agents sur quatre des
DDASS ont été transférés aux départements.
Aucune difficulté majeure n'est apparue en matière de personnel.
Les dépenses de personnel affectées aux différentes
missions de l'action sociale ont augmenté de 6 % par an en moyenne
entre 1984 et 1989 avant les mesures de revalorisation catégorielle
(accord " Durieux-Durafour ") pour des raisons liées à
la revalorisation du statut des travailleurs sociaux mais aussi à des
décisions volontaristes
des responsables départementaux.
C'est ainsi que les effectifs ont souvent dû être renforcés
pour assurer les tâches liées à la mission d'insertion des
titulaires du RMI.
Par ailleurs, les départements ont souhaité fréquemment
augmenter le recrutement d'agents de catégorie A
afin de
renforcer le taux d'encadrement qui était souvent inférieur
à la moyenne dans les services sociaux de l'Etat.
Il convient également de rappeler que les services de l'Etat avaient
recours à une " facilité " de gestion du
personnel : traditionnellement en effet les caisses d'allocations
familiales (CAF) et les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA)
mettaient à disposition du service social départemental, dans la
cadre de la " polyvalence de secteur ", des services chargés
du suivi des familles. Un remboursement partiel des frais correspondants
auprès des caisses de CAF et de MSA était prévu dans le
cadre de conventions.
A partir de 1983, un
mouvement de déconventionnement
s'est
engagé : d'une part, il s'agissait pour les départements de
recouvrer une certaine autonomie dans l'organisation de leurs services ;
d'autre part, les CAF, dont les personnels étaient parfois
réticents à l'égard de l'émergence du nouveau
pouvoir local, y ont vu une occasion de se recentrer sur leur mission
familiale. Alors que 89 CAF sur 124 étaient conventionnées avec
les départements au moment de la décentralisation, seules 52
l'étaient encore en 1996 et une vingtaine d'entre elles envisageaient
alors de se retirer
274(
*
)
.
• A partir du 1
er
janvier 1987, les dépenses de
matériel et de fonctionnement, les immeubles et les équipements
ont également fait l'objet de conventions de partage.
A cet égard, il est important de rappeler, comme le fait la Cour des
comptes, qu'au moment des transferts de compétences, l'informatique
était très peu développé au sein des services
sociaux. "
L'aide sociale générale pouvait être
traitée le plus souvent manuellement, malgré un nombre important
de dossiers
".
Les départements ont donc
procédé à l'informatisation de la plupart des grandes
prestations.
• Enfin, les départements ont souvent pris l'initiative de
développer des projets d'organisation innovants autour de la notion
de
territorialisation de l'action sociale
. Traditionnellement, les
découpages administratifs dans le secteur social s'articulent autour de
catégories de population aux caractéristiques communes
(handicapés, chômeurs, ...) ou à partir de la gestion de
grandes prestations (RMI, AAH, etc.).
Le risque de cette approche " segmentée " est de manquer
d'efficacité face à la tendance à la diversification des
prestations sociales et surtout d'empêcher la concrétisation d'un
" projet " d'insertion ou de prise en charge des personnes
concernées.
Comme le rappelle M. Jean-Louis Sanchez, délégué
général de l'ODAS, les départements ont souvent
initié des démarches pour remettre en cause l'organisation
traditionnelle des services.
Dans le secteur de la
protection de l'enfance
, de nombreux
départements ont ainsi procédé à un regroupement
des services d'aide sociale à l'enfance et de prévention
maternelle et infantile. S'agissant de l'action sociale, le tiers des
départements ont procédé à des restructurations
autour du concept de " projet " (santé, prévention et
politique de l'enfance, de la mère et de la famille, personnes
âgées et handicapées, insertion).
Certains départements ont choisi une démarche de
déconcentration de l'ensemble des services au niveau de " maisons
du département " afin de regrouper des services d'action sociale
aussi bien que des services techniques et culturels.
Simultanément, deux tiers des départements ont
procédé au redécoupage des circonscriptions d'action
territoriale en s'efforçant d'être mieux adaptés aux
bassins de vie.
Ces tentatives et ébauches d'une action sociale territorialisée
plus lisible et plus proche du citoyen permettent de relativiser les reproches
émis par la Cour des comptes sur le faible nombre de schémas
départementaux des établissements sociaux et
médico-sociaux régulièrement adoptées.
2. Les défis à relever
Même si elles ont déjà fait la preuve de leur aptitude à concilier équité et efficacité , les collectivités décentralisées sont aujourd'hui confrontées aux défis de l'exclusion et de la prise en charge des personnes âgées dépendantes.
a) Des besoins élevés en matière de renforcement de la cohésion sociale et de prévention pour la jeunesse
Au cours
des prochaines années, les collectivités locales -et
particulièrement les départements- seront confrontées
à une demande élevée pour participer au renforcement de la
cohésion sociale.
Celle-ci passera tout d'abord par le renforcement des mécanismes
classiques de lutte contre les exclusions d'où qu'elles proviennent.
Comme le montre les résultats plutôt décevants de la
reprise économique sur la diminution du nombre de titulaires du RMI qui
se maintient juste au-dessus de la barre du " million ",
le
" noyau dur " de l'exclusion représentée par les
bénéficiaires de minima sociaux demeure très difficile
à résorber.
La société moderne, caractérisée par un fort
déploiement des dispositifs de couverture des risques sociaux, se
révèle implacable pour ceux qui se retrouvent à sa marge
après avoir quitté les mécanismes de protection sociale
traditionnels adossés au monde du travail.
La fonction " insertion " des budgets départementaux n'est pas
appelée à disparaître d'elle-même sous l'influence de
la croissance retrouvée. L'avenir est plutôt au
développement d'une approche personnalisée des personnes en
situation d'exclusion
illustrée par l'article premier de la loi du
29 juillet 1998 qui dispose que les collectivités publiques ou
chargées d'un service public "
prennent les dispositions
nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de
ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement
personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou
sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais
les plus rapides
".
L'aide à la gestion d'un budget, les actions socio-éducatives, le
tutorat à l'intégration en entreprise, le suivi des contrats
d'insertion sont tout autant de missions que les collectivités locales
devront assumer de manière plus vigoureuse. En ce domaine, il devient de
plus en plus essentiel que l'Etat transfère aux collectivités
locales des leviers d'action pour leur permettre une intervention plus efficace.
L'autre aspect de la cohésion sociale réside dans l'ensemble des
mesures de prévention ou de soutien à la jeunesse
.
D'ores et déjà, de nombreux aspects de la politique de la ville
et de la solidarité urbaine, dans laquelle les grandes communes sont
fortement intervenues, comprennent divers dispositifs en faveur des jeunes dans
les quartiers (opérations
Ville Vie Vacances
notamment).
L'Union nationale des associations de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence
et des adultes (UNASEA) a évoqué, lors de son audition, les
tendances sociologiques de fond qui expliqueront le
maintien d'un niveau
élevé de prestation dans le secteur de l'aide à
l'enfance
: développement des familles monoparentales,
difficultés économiques entraînant des difficultés
de transmission des valeurs et se traduisant par une aggravation des
échecs scolaires et des incivilités commises par les jeunes,
affaiblissement des liens de solidarité " naturels " au sein
de la famille élargie ou à travers les relations de voisinage,
perception fataliste du recours à un " minimum social ".
A cela, on peut ajouter que les départements sont de plus en plus
souvent conduits à prendre en charge des jeunes dont la moyenne
d'âge est plus élevée et qui sont parfois fortement
" désocialisée ", se situant aux franges de la
compétence de la protection judiciaire de la jeunesse.
Il serait regrettable que l'Etat n'assume pas plus clairement les
responsabilités institutionnelles et financières qui sont les
siennes pour adapter et moderniser les organismes relevant de la protection
judiciaire de la jeunesse. Si tel n'était pas le cas, le dispositif de
l'aide sociale à l'enfance départementale à l'enfance
pourrait subir une certaine
déstabilisation
sauf à trouver
les solutions innovantes d'accompagnement de mineurs difficiles.
b) La question lourde de la dépendance
•
Les données démographiques montrent que l'allongement de la
durée de la vie et le
vieillissement des générations
d'après guerre
conduiront à des chocs inéluctables.
La France sera confrontée, d'ici à 2006, au départ en
retraite des générations nombreuses du " baby boom " de
l'après-guerre. Ce phénomène se conjugue avec
l'allongement de la durée de la vie et se traduit par un
fort
vieillissement de la population.
Le nombre de personnes de plus de 60 ans augmenterait de 10 millions
à l'horizon 2040 pour représenter 22 millions de personnes, soit
le tiers de la population totale contre un cinquième en 1995.
Le nombre de personnes âgées dépendantes est
appelé naturellement à fortement augmenter.
Le vieillissement de la population est à l'origine de la multiplication
des phénomènes de dépendance. En 1995, sur 8 millions de
personnes âgées de 65 ans, plus de 290.000 personnes
étaient confinés au lit ou au fauteuil et 3.700.000 personnes,
sans être immobilisées, avaient besoin de l'aide d'un tiers pour
les actes de la vie courante : s'habiller, se laver, etc. Dans son
récent rapport
275(
*
)
, M. Jean-Pierre
Sueur évalue, pour sa part, à 900.000 le nombre de personnes
âgées dépendantes vivant à domicile.
• Jusqu'à l'intervention de la
loi n° 97-60 du 24
janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance
(PSD), les personnes âgées dépendantes étaient
considérées comme des personnes handicapées et percevaient
à ce titre
l'allocation compensatrice pour tierce personne
(ACTP). En 1998, 198.000 personnes de 60 ans et plus
bénéficiaient de l'ACTP en France métropolitaine contre
116.000 en 1988. Progressivement, l'ACTP est devenue la principale prestation
en espèces versée aux personnes âgées
dépendantes. Pourtant, si l'ACTP avait été conçue
pour apporter une réponse adéquate aux besoins des personnes
handicapées adultes, son adaptation au problème de la
dépendance était plus contestable.
L'ACTP était versée aux personnes âgées
présentant un taux de handicap de 80 % au moins et justifiant de
ressources inférieures au plafond d'attribution de l'AAH, majorée
par le montant de l'ACTP :
elle ne pouvait pas être
modulée en fonction de la gravité de la perte d'autonomie
de
la personne.
Par ailleurs, l'ACTP, attribuée par les COTOREP sans contrôle des
conditions du recours effectif à une tierce personne, avait
été
détournée de sa vocation originelle
pour
devenir une simple prestation en espèces. Il en résultait un
problème d'équité, la prestation étant
versée aussi bien à des personnes isolées, pour qui l'aide
à domicile était une nécessité vitale, qu'à
des personnes âgées bénéficiant de soins de leur
famille sans aucun contrôle de qualité.
Enfin, se posait la question d'une
homogénéisation des
règles de l'aide sociale
: l'ACTP conçue pour des
personnes handicapées à la naissance ou atteintes
précocement dans leur vie active était assortie de mesures
favorables en termes d'obligation alimentaire et de récupération
sur succession dont on pouvait se demander si elles étaient
légitimement applicables à des personnes frappées par la
dépendance à un âge avancé. Il convient de rappeler
que l'aide sociale financée par la solidarité nationale vise
à apporter une aide à des personnes dans le besoin qui ne peuvent
être soutenues par leur famille ou dont les moyens sont insuffisants.
La prise de conscience des dysfonctionnements de l'ACTP avait conduit le
législateur, dans la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, à
demander la conduite d'une expérimentation relative à la prise en
charge des personnes dépendantes.
• Avec la loi du 24 janvier 1997 a été
instituée une nouvelle prestation d'action sociale en faveur des
personnes âgées de 60 ans et plus, qui remplissent des conditions
de dépendance et qui disposent de ressources inférieures à
un plafond, variable selon l'importance du besoin, et donc selon le montant de
la prestation attribuée. Le demandeur peut cumuler la prestation et ses
ressources dans la limite des plafonds de ressources -fixés par
décret à 6.249 francs pour une personne seule et
10.415 francs pour un couple- majorés de la prestation
accordée prise en compte dans la limite de 80 % de la majoration
pour tierce personne (soit 4.603 francs au 1
er
juin 2000).
Le plafond de cumul ne peut donc, en tout état de cause,
dépasser 10.852 francs par mois pour une personne seule (15.018 francs
pour un couple). Le montant maximum de la PSD est donc supérieur
à celui de l'ACTP.
• A la différence de l'ACTP,
la PSD est une prestation en
nature
, c'est-à-dire affectée au paiement de dépenses
préalablement déterminées par l'équipe
médico-sociale : elle est destinée à couvrir l'aide,
dont la personne âgée a effectivement besoin, à son
domicile ou dans un établissement, pour l'accomplissement des actes
essentiels de sa vie, "
nonobstant les soins qu'elle est susceptible de
recevoir
".
La PSD se décline à partir des mêmes conditions de
ressources qu'elle soit versée à domicile ou en
établissement.
S'agissant de la PSD à domicile, l'aide peut être apportée
directement, soit par un ou plusieurs salariés, recrutés en tant
qu'aide à domicile, soit par un service d'aide à domicile
agréé. Un membre de la famille peut être recruté
comme aide à domicile, à l'exclusion du conjoint ou du concubin.
10 % du montant de l'aide peuvent être utilisés pour des
prestations (port de repas à domicile, protections,
téléalarmes, ...) autres que la rémunération de
l'aide à domicile.
Dans le cas de personnes âgées dépendantes en
établissement, la PSD est versée directement à
l'établissement pour financer les surcoûts liés à
l'état de dépendance. La mise en oeuvre de ce principe supposait
toutefois la mise en place d'une réforme de la tarification des
établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes afin de distinguer les dépenses résultant de
la perte d'autonomie de la personne accueillie (intervention d'une tierce
personne) des autres dépenses de soins ou d'hébergement. Dans
l'attente de la tarification, la loi prévoit que la PSD est
versée à taux réduit aux établissements pour
contribuer au paiement des frais d'hébergement.
Comme on le sait,
la PSD fait l'objet d'un débat important qu'il
n'appartient pas à votre mission d'information d'éluder, ni de
trancher définitivement
.
Dans son intervention du 21 mars 2000 sur l'avenir des retraites, le Premier
ministre a porté un jugement sévère sur la PSD qui lui est
apparue "
à l'expérience, comme un
échec
" : il a ajouté que la prestation ne
bénéficiait qu'à une faible partie des personnes
concernées puisqu'elle n'était attribuée qu'à
120.000 d'entre elles. Il a estimé qu'elle était très
souvent d'un montant insuffisant et qu'elle était enfin très
inégalitaire, car sa mise en oeuvre par les conseils
généraux était particulièrement disparate et parce
que son montant variait considérablement d'un département
à l'autre pour des situations pourtant identiques.
Dans ce contexte, Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a
demandé à M. Jean-Pierre Sueur de préparer un rapport qui
lui a été transmis en mai dernier.
Votre mission tient d'abord à souligner que
les résultats de
la PSD, comme il est de règle pour toute nouvelle prestation, doivent
être appréciés dans la durée
, les données
disponibles confirmant le caractère toujours évolutif du nombre
de bénéficiaires.
C'est ainsi que le nombre de bénéficiaires a crû
constamment depuis la mise en place du dispositif passant de 23.000 à la
fin de 1997 à 86.000 en décembre 1998, puis à 117.000 en
décembre 1999. En un an, le nombre de bénéficiaires s'est
accru de 36 %, ce qui montre bien que le dispositif n'est pas figé.
Au total, depuis la création de la PSD, plus de 270.000 dossiers ont
été soumis à l'examen des conseils généraux,
dont près de 200.000 ont bénéficié d'une
décision favorable.
Le taux d'acceptation est de 75 % pour les demandes émanant de
personnes qui vivent à leur domicile et de 84 % pour celles qui
résident en établissement.
Le montant moyen de la prestation est d'environ 3.400 francs pour les personnes
qui résident à domicile et de 1.800 francs pour les personnes
résidant en établissement. Il existe néanmoins des
disparités entre les départements, le montant moyen de la PSD
varie de 3.800 francs par mois dans le quart des départements où
il est le plus élevé contre 2.900 francs dans le quart des
départements dans lesquels il est le plus faible.
La loi relative à la prestation spécifique dépendance
est sans doute perfectible ; pour autant il convient de ne pas lui faire
des reproches qu'elle ne mérite pas.
Tout d'abord,
la loi de 1997 a toujours été conçue
comme une loi provisoire qui peut donc être amendée
. Les
conseils généraux, lorsqu'ils ont été
consultés, ont été favorables à des propositions
d'amélioration permettant d'ajuster le dispositif en fonction des
besoins constatés sur le terrain : le plafond de ressources peut
être modifié par décret ; le taux des dépenses
autres que de personnel pouvant être réglées par la PSD,
actuellement fixé à 10 %, peut être
augmenté ; enfin, le seuil du recours sur succession actuellement
prévu à 300.000 francs pourrait être élevé
comme certains départements ont déjà choisi de le faire.
Ensuite
la loi de 1997 a incontestablement permis une coordination des
multiples intervenants
impliqués dans la prise en charge des
personnes âgées à travers les conventions obligatoires
passées avec les organismes de sécurité sociale selon un
cahier des charges national et la mise en place du
Comité national de
la coordination gérontologique
.
Sur le terrain, se constituent des équipes médico-sociales
comprenant au moins un médecin et un travailleur social qui ont pour
mission d'assurer une prise en charge de proximité au plus près
des besoins des usagers.
Par ailleurs, il est important de rappeler que la
faiblesse du montant moyen
de la PSD versée en établissement
est inhérente
à la phase préalable à l'instauration de la réforme
de la tarification par le Gouvernement qui a pris près de
deux ans de
retard
.
Il est certain que l'insuffisance des moyens de médicalisation des
établissements en raison de l'insuffisance de financement par
l'assurance maladie, fait supporter aux usagers des charges indues au titre des
soins.
A l'opposé de la recherche d'une amélioration raisonnée et
progressive du texte de 1997, la démarche proposée dans le
rapport de M. Jean-Pierre Sueur apparaît une fois encore
éloignée de l'esprit de la décentralisation
:
prestation d'un montant unique et uniforme sur tout le territoire, suppression
de tout recours sur succession, fixation rigide des conditions d'attribution de
la prestation.
Ce dispositif, comme le RMI, est un dispositif national que les
départements seraient invités à cofinancer et où
ils interviendraient comme " prestataires de services contraints ".
La réflexion devrait plutôt se porter sur l'amélioration du
dispositif actuel dans le respect des contraintes financières qui
s'impose au département ou dans une réforme plus globale qui
distinguerait mieux ce qui relève d'une prestation uniforme
financée par la solidarité nationale et la coordination d'une
offre de services au niveau des collectivités
décentralisées.
II. LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Dans des
sociétés évoluant rapidement sous l'effet des nouvelles
technologies de l'information, la diffusion des progrès techniques
nécessite un
réel effort de formation à toutes les
étapes du parcours professionnel.
De ce point de vue, la France présente un handicap : la proportion
au sein de la population active de ceux qui ne possèdent aucun
diplôme ou un diplôme de faible niveau demeure beaucoup trop
importante : en 1996, près d'un actif sur cinq, (19 %) n'a
aucun diplôme et 30 % un certificat d'études primaires. Ceci
conduit au demeurant à s'interroger sur le caractère performant
d'un système scolaire dans lequel 32 % des personnes de 25 à
64 ans n'avaient pas dépassé le niveau du premier cycle du
secondaire en 1995, alors que ce taux d'échec était dans le
même temps de 16 % en Allemagne et de 14 % aux
Etats-Unis
276(
*
)
.
En dépit de la volonté d'opérer en 1983 un transfert de
compétences, renforcé en 1993 par la loi quinquennale
n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle, le pouvoir de
décision des régions apparaît modeste face au
" domaine réservé " de l'Etat dans un système
aux multiples intervenants.
A. UN TRANSFERT CLAIR EN APPARENCE
1. Les choix de 1983
Lorsque
la région est devenue une collectivité locale de plein exercice,
au même titre que le département et la région, le
législateur a souhaité articuler les compétences de la
région autour de la notion de développement économique.
Ainsi, l'article 59 de la loi du 2 mars 1982 dispose que le
" conseil
régional a compétence pour promouvoir le
développement économique, social, sanitaire, culturel et
scientifique de la région et l'aménagement du territoire et pour
assurer la préservation de son identité dans le respect de
l'intégrité de l'autonomie et des attributions des
départements et des communes ".
Logiquement, la formation professionnelle est apparue comme une
compétence qui pouvait être assumée de manière
pertinente à l'échelon régional en articulation avec les
compétences confiées en matière de développement
économique et dans le prolongement des compétences
confiées en matière d'enseignement secondaire et supérieur.
L'article 82-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 confie donc à la
région une
compétence de droit commun
pour la mise en
oeuvre des actions
d'apprentissage
et de
formation professionnelle
continue.
A cet effet,
un fonds régional de l'apprentissage et de
la formation professionnelle continue
est créé dans chaque
région et sa gestion confiée au conseil régional.
Cette compétence de la région a été étendue,
par la loi du 20 décembre 1993, à l'ensemble de la
formation continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans.
2. L'apprentissage
S'agissant de l'apprentissage, traditionnellement
tourné vers
l'artisanat et les petites entreprises pour des jeunes aptes à
acquérir des savoir-faire par une confrontation directe au monde du
travail, la compétence des régions porte sur la
création et le financement des centres de formation d'apprentis
(CFA).
Ces centres, gérés par des associations, sont créés
par conventions quinquennales signées par le président du conseil
régional, les autres collectivités locales, les organismes
consulaires, les établissements d'enseignement privés, les
syndicats et les associations. Ils sont financés par le produit de la
taxe d'apprentissage
et surtout par la subvention régionale qui
couvre les frais relatifs au logement, au transport et aux repas des apprentis
suivant un barème indicatif établi chaque année par le
Gouvernement.
La région joue par ailleurs un
rôle de programmation
:
elle est chargée d'élaborer un
schéma
prévisionnel de l'apprentissage
qui doit venir s'intégrer
dans le document plus global que constitue le
plan régional de
formation professionnelle des jeunes
.
Le schéma prévisionnel est précisé par la
carte
de l'apprentissage
, préparée par la région, qui
définit le nombre de CFA, leur aire géographique, leur
capacité d'accueil et la nature des différentes sections qu'ils
comportent.
L'Etat conserve une place non négligeable
: tout d'abord, il
exerce un
contrôle pédagogique
sur le contenu des
enseignements et la qualification des personnels des CFA ; ensuite il
conserve la maîtrise des primes et des exonérations de charges
sociales aux entreprises qui forment des apprentis.
En matière d'apprentissage, les circuits de financement faisaient
apparaître en 1996 que l'Etat mobilisait budgétairement
8,5 milliards de francs
277(
*
)
tandis que
les régions intervenaient à hauteur de 4,2 milliards de
francs dans le fonctionnement des CFA cofinancés, en outre, par le
produit de la taxe d'apprentissage perçue auprès des entreprises
à hauteur de 3,4 milliards de francs.
L'opacité des modalités de distribution des fonds perçus
auprès des entreprises par les organismes collecteurs au titre de la
taxe d'apprentissage fait l'objet de critiques récurrentes. La loi du 6
mai 1996 a ainsi recentré l'affectation du produit de la taxe
d'apprentissage sur le financement des CFA entre lesquels la
péréquation a été renforcée.
3. La formation professionnelle continue
Aux
termes de l'article 84 de la loi du 7 janvier 1983, la région est
compétente pour arrêter chaque année un
programme
régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue
(PRDF)
.
Ce programme donne lieu à la consultation du
comité
régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi
(COREF) ainsi que des comités départementaux
correspondants.
Le COREF est une instance purement consultative ; composé de
représentants de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux,
présidé par le préfet ou par le président du
conseil régional selon les sujets abordés, il est informé
des programmes et moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'ANPE et
l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).
Ces plans doivent permettre à la région de se déterminer
sur les orientations générales qu'elle entend mettre en oeuvre
pour les catégories de formation à aider, les organismes
habilités à les délivrer ou les priorités à
établir concernant les publics bénéficiaires. Ils doivent
permettre de recenser les actions cofinancées avec l'Etat dans le cadre
des contrats de plan ou des contrats d'objectifs. Ces derniers sont conclus
entre l'Etat, une région et des organismes socioprofessionnels pour
fixer des objectifs concernant le
" développement
coordonné des différentes voies de formation
professionnelle ".
Les programmes régionaux sont mis en oeuvre par voie de conventions
passées avec les établissements publics d'enseignement, les
organismes paritaires de formation ou d'autres organismes habilités.
La compétence de la région en matière de formation
professionnelle se présente de manière originale par rapport aux
compétences locales traditionnelles, telles que l'aide sociale, qui
supposent la distribution de prestations ou la gestion d'un dispositif
administratif : l'exercice de la compétence régionale repose
sur
l'affirmation d'une fonction de coordination et de régulation au
sein de l'espace régional :
l'objectif de la région est
de parvenir à jouer " un rôle central de
régulation " en exerçant une
" mission d'animation
du partenariat régional, de production de systèmes
cohérents de filières de formation et de définition d'une
politique régionale répondant aux attentes des jeunes, des
chômeurs et des entreprises "
278(
*
)
.
" Acteur émergent " sur la scène des
collectivités locales en raison de son histoire, intervenant dans un
secteur marqué par une segmentation des intervenants et des zones
d'influence, la région a été conduite à
développer le caractère partenarial de ses politiques et de
ses interventions
. Ainsi les PRDF ont été conçus
davantage comme des schémas directeurs que comme des engagements
programmatiques et les contrats d'objectifs comme des protocoles d'intention
plutôt que des conventions normatives.
Le souhait des régions qui pourrait être de devenir
l'acteur
pivot
du système de formation professionnelle, c'est-à-dire
celui
" dont le positionnement dans le système (...)
détermine la stratégie des autres
acteurs "
(1)
peut se heurter néanmoins
à diverses contraintes.
Les branches professionnelles sont faiblement organisées au niveau
régional, voire inexistantes à cet échelon : cela
explique sans doute que seules une dizaine de régions avaient
signé des contrats d'objectifs en 1995 ; ces contrats couvrent des
secteurs déterminés tels que le BTP, la réparation et le
commerce automobile qui ne représentent pas l'ensemble du tissu
économique.
Il convient de souligner également le poids des services de l'Etat et
notamment de l'Education nationale dont le caractère centralisé
n'est plus à souligner.
4. La formation professionnelle des jeunes
La loi
quinquennale du 20 décembre 1993, présentée par M. Michel
Giraud, alors ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, a renforcé les attributions des régions dans le
domaine de la formation professionnelle des jeunes.
Avant 1993, quatre grands acteurs institutionnels intervenaient sur les voies
de formation :
- le rectorat et la direction régionale de l'agriculture pour
l'enseignement professionnel
dans les lycées qui regroupe
près de 60 % des jeunes en formation ;
- le conseil régional pour
l'apprentissage
;
- la
délégation régionale à la formation
professionnelle
pour les
actions d'insertion et de qualification
réalisées dans le cadre du
crédit de formation
individualisée
(CFI) ;
- les organisations professionnelles et interprofessionnelles pour la
formation en alternance
à travers les instruments que sont le
contrat de qualification et le contrat d'adaptation.
La loi " Giraud " procède à une décentralisation
en deux temps. A compter du 1
er
juillet 1994, les régions ont
reçu compétence pour organiser les
actions qualifiantes
pour les jeunes : il s'agit des actions de formation professionnelle
continue pour les jeunes de moins de 26 ans et leur accordant une
qualification relevant du champ de l'enseignement technologique au sens de
la loi du 16 juillet 1971 ou reconnue par les branches professionnelles.
En outre, de 1994 au 1
er
janvier 1999, a été ouverte
une période de transition au terme de laquelle doit être
opéré le
transfert de la formation dite
" préqualifiante "
pour les jeunes de moins de 26 ans. Ce
terme recouvre les actions de formation continue de jeunes sans qualification
de 16 à 25 ans auparavant assumées par les DRFP dans le cadre du
crédit formation individualisé (CFI).
Ce transfert a reposé sur une procédure conventionnelle et
progressive. Des conventions ont été passées entre les
régions et l'Etat afin de mettre en oeuvre les stages de formation
préqualifiante pour les jeunes issus du système scolaire sans
aucun diplôme et inscrits dans une agence pour l'emploi. Ces conventions
ont porté également sur le financement des
permanences
d'accueil d'information et d'orientation
(PAIO) qui jouent avec les
missions locales un rôle important dans le dispositif.
Par ailleurs, la loi du 20 décembre 1993 confirme le rôle
" d'acteur pivot " des régions en leur confiant la
préparation annuelle du
plan régional de développement
de la formation professionnelle des jeunes
(PRDFPJ).
Aux termes de l'article 83 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée, ce plan
a pour objet "
la programmation à moyen terme des
réponses aux besoins de formation, permettant un développement
cohérent de l'ensemble des filières de formation et prenant en
compte les réalités économiques régionales et les
besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures
chances d'accès à l'emploi
".
La vocation de ces plans régionaux est de couvrir l'ensemble des
filières de formation : formation initiale, apprentissage, contrats
d'insertion en alternance, actions de formation professionnelle pour les jeunes
demandeurs d'emploi.
Le plan établit une
forme subtile de gestion partagée avec
l'Etat
: il est élaboré par le conseil régional
"
en concertation avec l'Etat "
après
consultation obligatoire de diverses instances : organismes consulaires,
conseils généraux, conseil académique de l'Education
nationale, comité régional de l'enseignement agricole, conseil
économique et social régional, organisations d'employeurs et de
salariés.
Le plan est mis en oeuvre par des conventions d'application
"
approuvées par le conseil régional
" puis
"
signées, d'une part, par le président du conseil
régional et, d'autre part, par le préfet de région et les
autorités académiques concernées
".
Au 31 décembre 1997, seules 3 régions sur 26 n'avaient pas encore
conclu de conventions de délégations de compétences avec
l'Etat.
Comme en matière de formation continue, le rôle de la
région est moins de diriger que de coordonner : La région
joue un rôle d'autant plus actif qu'elle sait mettre en place des
pratiques partenariales avec les différents intervenants du secteur.
La réforme de 1993 a eu pour effet de renforcer le poids financier des
régions dans le domaine de la formation des jeunes : la part du
financement public des organismes de formation par les conseils
régionaux est passé de 25 % en 1993 à près de
33 % en 1995.
B. UN ETAT OMNIPRÉSENT DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION
L'Etat
conserve une place centrale dans le dispositif de formation professionnelle.
Si la région a été dotée en 1983 d'une
compétence de " droit commun ", celle-ci n'est pas
considérée comme une compétence " exclusive ".
Cette lecture repose sur une interprétation extensive de
l'article
L. 900-1
du code du travail qui fait de la formation professionnelle
" une obligation nationale à laquelle chacun doit
contribuer ".
L'article 82-1 de la loi du 7 janvier 1983 a souligné, il est vrai, que
les compétences régionales
dans le respect des règles
(...) figurant dans le code du travail
en matière de formation
professionnelle
ainsi que dans les lois non codifiées relatives
auxdites actions ".
Le rapport au Gouvernement
279(
*
)
de M.
Gérard Lindeperg, député de la Loire, illustre bien cette
conception relativement restrictive de la décentralisation en
matière de formation professionnelle :
" En inscrivant le
principe d'une compétence de droit commun, le Législateur n'a pas
posé de principe d'exclusivité de l'intervention des
régions sur les domaines d'intervention transférées, mais
un principe d'autonomie politique, administrative et financière sur les
actions qu'elles conduisent ".
1. L'Etat conserve en droit et en fait une compétence considérable
Aux
termes de la loi du 7 janvier 1983, la compétence
" résiduelle " de l'Etat porte tout d'abord sur les politiques
de formation en faveur de certaines catégories de la population
(détenus, réfugiés, éducation surveillée,
handicapés) correspondant à l'expression d'une solidarité
nationale et dont les actions ne relèvent pas d'une région
déterminée.
L'Etat demeure compétent en ce qui concerne
les actions de
portée nationale
de formation professionnelle continue ou
d'apprentissage.
Par actions de portée nationale, il faut entendre les actions relatives
à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs
régions, soit des formations destinées à des apprentis ou
à des stagiaires sans considération d'origine régionale.
Cette définition permet à l'Etat d'inscrire directement des
crédits de formation aux budgets des différents ministères
qui ne relèveront pas des fonds régionaux de la formation
professionnelle et de l'apprentissage. L'instrument principal de gestion de ces
crédits et l'association pour la formation professionnelle des adultes
(AFPA) qui comprend près de 200 sites de formation sur tout le
territoire et qui est dotée d'un budget de près de
4 milliards de francs.
Compte tenu du poids de l'AFPA mais aussi de l'ANPE, dans le dispositif de
formation, l'Etat conserve un levier d'action non négligeable :
c'est l'Etat qui procède à l'agrément des stages dont il
rémunère les stagiaires suivant une procédure de gestion
très centralisée.
L'ASSOCATION NATIONALE POURLA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)
Créée en 1949, l'AFPA est une association de la
loi de
1901 à gestion paritaire (Etat, partenaires sociaux, AFPA)
chargée d'une mission de service public par délégation du
ministre du travail.
Composante du service public de l'emploi, l'AFPA intervient aux
côtés de l'ANPE et des services déconcentrés de
l'Etat, pour permettre à des personnes engagées dans la vie
active, d'acquérir une qualification, de la maintenir ou de la
développer afin de favoriser leur insertion ou leur évolution
dans l'emploi en fonction des besoins du marché du travail. Depuis 1994,
les relations de l'AFPA avec l'Etat sont régies par un " contrat de
progrès ". Le contrat signé pour la période 1999-2003
précise que la mission centrale de l'AFPA est de permettre à des
demandeurs d'emploi adultes d'acquérir une qualification favorisant leur
insertion dans l'emploi.
L'AFPA est théoriquement gérée par deux organes
délibérants, l'assemblée générale et le
bureau. Mais comme le rappelle la Cour des comptes, dans son rapport public
annuel de 1997,
" le président
élu par
l'assemblée générale a toujours été choisie
au sein du collège des représentants de l'administration ;
le ministère du travail, chargé de la tutelle de l'AFPA,
désigne en fait le directeur général et le fait ensuite
agréer par "
l'assemblée
générale ".
En 1998 le budget de l'AFPA était de 5,44 milliards de francs dont
73 % provenaient d'une subvention de l'Etat. L'AFPA employait
11.397 salariés, répartis sur 190 sites d'information et
d'orientation professionnelle et 262 sites de formation. L'AFPA avait
procédé à 161.118 actions de formation et avait
accueilli 155.000 stagiaires environ.
Enfin, l'Etat conserve également la maîtrise des stages
créés en application de programmes établis en fonction des
orientations prioritaires de l'Etat
définies conformément
à la procédure prévue à
l'article L. 910-2
du code du travail. Celles-ci sont déterminées par le
comité interministériel de la formation professionnelle et de
la promotion sociale
après consultation des organisations
professionnelles et syndicales.
Le Plan national d'action pour l'emploi (PNAE) adopté en 1998 illustre
cette notion de programme prioritaire.
La dernière compétence maintenue par la loi à l'Etat porte
sur les
" études et actions expérimentales
nécessaires à la préparation de (ses) actions ainsi que
les moyens pour assurer l'information sur les politiques
engagées ".
Mais surtout l'Etat conserve par-delà les textes plusieurs attributions
essentielles qui lui donne un
pouvoir de fait considérable
.
C'est lui qui
définit le cadre juridique des interventions
de la
formation professionnelle : les modalités de conventionnement des
organismes de formation ou le statut des stagiaires relèvent du pouvoir
normatif de l'Etat.
L'Etat reste maître du contenu pédagogique des formations
dispensées : il détermine les programmes de formation et
gère l'homologation des filières et des diplômes ; il
assure le contrôle pédagogique du dispositif.
De surcroît, l'Etat conserve un rôle prépondérant
dans
la définition des relations avec les partenaires
sociaux
: les confédérations d'employeurs et les
syndicats qui disposent d'une représentation nationale se tournent
naturellement vers l'Etat pour la définition des orientations
prioritaires.
En matière de
contrôle
, l'Etat détient une vraie
compétence exclusive, qu'il s'agisse du respect par les employeurs de
l'obligation de financement du contrôle, des dépenses des
organismes collecteurs de fond ou du contrôle pédagogique des
organismes de formation.
2. L'Etat a étendu son rôle d'impulsion en sollicitant des financements croisés
Les
régions sont sollicitées sur de multiples partenariats qui
mobilisent entre le quart et le tiers de leurs ressources
280(
*
)
.
De multiples instruments sont utilisés dont les deux principaux sont le
contrat de plans Etat-région (CEPA) et le programme d'intervention
communautaire (PIC). Mais, il est possible de citer également les
contrats d'objectifs territoriaux (COT), les conventions tripartites relatives
à l'allocation de formation reclassement.
Le rapport Delafosse avait mis l'accent sur le risque de dilution des
responsabilités résultant de la multiplication de ces
procédures de financement croisé.
3. La région occupe encore une place restreinte dans le système de financement de la formation professionnelle
En 1996, la région n'était que le troisième financeur de la formation professionnelle (13 milliards de francs soit 9,2 %), loin derrière l'Etat qui représentait près de 41 % des dépenses et des entreprises qui financent environ 40 % du dispositif.
FINANCEMENT FINAL DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE EN 1996
(en millions de francs)
|
|
Insertion des jeunes |
Demandeurs d'emploi |
Actifs occupés |
Total |
|
Etat |
7.532 |
16.553 |
31.044 (1) |
55.129 |
|
Régions |
8.102 |
3.309 |
701 |
12.112 |
|
UNEDIC |
- |
8.047 |
- |
- |
|
Entreprises |
10.732 |
27 |
43.617 |
54.376 |
|
Total général (2) |
27.324 |
28.845 |
79.737 |
135.906 |
Source : MES/DARES, compte économique de la formation
professionnelle
(1) Il s'agit de la formation allouée aux agents de la fonction publique
(2) y compris les autres collectivités locales
Certes, les régions, depuis la mise en oeuvre de la loi quinquennale qui
a étendu leurs compétences en matière de formation des
jeunes, ont accru leur part relative dans la structure de la
dépense : en 1987, les régions ne représentaient que
6,3 % de la dépense totale et leur budget, qui depuis a quasiment
triplé, représentait alors 4,4 milliards de francs.
Il reste que l'Etat conserve la maîtrise de quatre cinquième des
crédits publics relatifs à la formation professionnelle. Qui plus
est, il apparaît que de 1984 à 1993, soit sur les dix
premières années de la décentralisation, l'Etat a
multiplié par trois ses crédits d'intervention en faveur des
salariés (hors fonction publique) tandis que les régions les
doublaient.
Le transfert de compétences est certes bien réel en
matière de formation professionnelle mais en ce domaine la
décentralisation demeure néanmoins largement inachevée.
III. LA SÉCURITÉ
A. UNE COMPÉTENCE LARGEMENT PARTAGÉE
Les lois
de décentralisation n'ont pas modifié la répartition des
compétences entre l'Etat et le maire en matière de police
générale. Cependant, en prévoyant l'institution de droit
du régime de police d'Etat, sur demande du conseil municipal, sous
certaines conditions prévues par décret en Conseil d'Etat,
l'article 88 de la loi du 7 janvier 1983 aurait pu aboutir à la
généralisation de ce régime. Il n'en fut rien et
l'étatisation de la police dans certaines communes n'a pas freiné
le développement des polices municipales, dont le statut a
été récemment clarifié par le législateur.
Dans ce domaine, comme dans d'autres, les collectivités locales ont
dû intervenir, pour faire face aux besoins de la population, en prenant
en charge des missions relevant en principe de l'Etat.
1. Un pouvoir étendu du maire en matière de police
a) L'objet de la police municipale
Investi
d'une compétence générale de police administrative au
niveau communal, le maire doit assurer l'ordre public local. Il est
également chargé d'attributions de police en tant qu'agent de
l'Etat. Enfin, il est officier de police judiciaire.
En tant qu'
autorité de police municipale
, le maire est
chargé, sous le contrôle administratif du représentant de
l'Etat, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution
des actes de l'Etat qui y sont relatifs (
article L. 2212-1
du
code général des collectivités territoriales).
L'
article L. 2212-2
du code général des
collectivités territoriales énonce
les buts de la police
municipale. Celle-ci doit assurer le
bon ordre
, la
sûreté
, la
sécurité
et la
salubrité
publiques.
Le même article donne une liste détaillée mais non
limitative des matières dans lesquelles ce pouvoir de police municipale
s'exerce. Les missions ainsi confiées au maire se caractérisent
à la fois par leur diversité et par leur complexité.
Le maire est ainsi chargé de la répression des rixes et disputes,
des bruits de voisinage (au titre des atteintes à la tranquillité
publique), de la prévention et de la réparation des pollutions de
toute nature, ou encore de la sûreté et de la commodité de
passage sur les voies publiques.
On sait que ce pouvoir de police, ainsi largement défini, a pu
être, dans la période récente, à l'origine d'une
mise en cause plus fréquente de la responsabilité personnelle des
maires
281(
*
)
.
Le maire dispose par ailleurs de pouvoirs de police portant sur des
objets
particuliers
(articles
L. 2213-1
et suivants du code
général des collectivités territoriales), sa
compétence pouvant alors être plus strictement limitée.
Ainsi, pour la police de la circulation, le maire n'est compétent que
sur les voies communales et sur les seules sections des routes nationales et
routes départementales, situées à l'intérieur de
l'agglomération, sous réserve des pouvoirs dévolus au
préfet sur les routes à grande circulation
(
article L. 2213-1
).
Enfin, le maire dispose de pouvoirs de
police spéciale
, notamment
en ce qui concerne la police rurale, qui lui sont confiés par le code
rural.
En tant qu'agent de l'Etat
, le maire exerce -cette fois sous
l'
autorité
du représentant de l'Etat- une mission
d'"
exécution des mesures de sûreté
générale
".
Enfin, en vertu de
l'article 16
du code de procédure
pénale, le maire a la qualité d'
officier de police
judiciaire
qu'il tient de droit sans habilitation préalable. A ce
titre, il est placé sous la surveillance du procureur de la
République.
b) Les limites du pouvoir de police du maire
Les
pouvoirs de police du maire sont néanmoins
encadrés de
plusieurs manières.
Le préfet dispose d'un
pouvoir de substitution
en vertu de
l'article L. 2215-1
du code général des
collectivités territoriales, qui l'autorise à prendre pour toutes
les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles et dans tous
les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les
autorités municipales les mesures nécessaires au maintien de la
salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publiques.
Mais lorsqu'une seule commune est en cause, ce pouvoir ne peut être
exercé par le préfet qu'après une mise en demeure du maire
restée sans résultat.
Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes
limitrophes, le préfet peut par ailleurs se substituer par
arrêté motivé, aux maires des communes concernées
pour exercer les pouvoirs de police relatifs à la répression des
atteintes à la tranquillité publique et au maintien du bon ordre
dans des endroits où il se fait de grands rassemblements de personnes.
Les
règlements pris par les autorités supérieures
constituent une seconde limite aux pouvoirs du maire en matière de
police municipale. Le maire a alors la possibilité de prendre des
mesures
plus sévères
que celles fixées par le
règlement (en matière de police de la circulation par exemple).
En revanche, il ne peut prendre des arrêtés assouplissant ces
règlements. Les mesures plus restrictives doivent être
justifiées par des circonstances particulières de
temps
et
de
lieu
.
Les pouvoirs de police du maire s'exercent en outre dans le cadre légal
sous
le contrôle du juge administratif
. Ainsi les mesures de
police doivent-elles être strictement nécessaires pour assurer
l'ordre public mais pas au-delà. Les interdictions
générales et absolues sont prohibées. Les mesures en cause
doivent respecter le principe d'égalité, les discriminations
étant en conséquence illégales. Enfin, le maire ne doit
pas commettre de détournement de pouvoir en usant de ses
prérogatives dans un but autre que celui en vue duquel elles lui ont
été confiées.
Certains
régimes spéciaux
de police peuvent
également limiter les pouvoirs du maire.
Dans les communes dotées d'une police d'Etat, le soin de réprimer
les atteintes à la tranquillité publique, sauf en ce qui concerne
les bruits de voisinage, incombe à l'Etat. Celui-ci a également
la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands
rassemblements d'hommes (
article L. 2214-4
du code
général des collectivités territoriales).
Enfin, à Paris, en vertu de l'arrêté des Consuls du
12 Messidor an VIII, la véritable compétence de police
appartient au préfet.
La loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986 a néanmoins
rapproché les compétences du maire de Paris de celles des maires
des communes à police étatisée. Lui ont ainsi
été dévolues des compétences en matière de
salubrité sur la voie publique, de maintien de l'ordre sur les foires et
marchés, de gestion et de conservation du domaine (
articles
L. 2512-13
du code général des collectivités
territoriales).
Dans les communes des départements de la " petite couronne "
parisienne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de Marne), le préfet,
en plus des compétences qui lui sont conférées dans les
communes à police étatisée, a la charge de la police de la
voie publique sur les routes à grande circulation, y compris en ce qui
concerne la liberté et la sûreté.
2. L'affirmation du rôle des polices municipales
a) L'émergence des polices municipales
Les
travaux préparatoires de la loi du 15 avril 1999 ont mis en
évidence la place croissante des polices municipales, mouvement que n'a
pas freiné le processus d'étatisation de la police.
282(
*
)
En avril 1998, le ministère de l'Intérieur recensait
3030
communes
dotées d'une police municipale, employant
13 098
agents
. Depuis 1984, le nombre de communes concernées a
augmenté de 73 % tandis que
le nombre des agents a plus que
doublé
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE POLICE MUNICIPALE
|
Années |
1984 |
1993 |
1998 |
1998/1984 |
|
Nombre de communes |
1 748 |
2 849 |
3 030 |
+ 73 % |
|
Nombre d'agents |
5 641 |
10 977 |
13 098 |
+ 132 % |
Cependant, les polices municipales présentent
une
réalité très
hétérogène
tant par le nombre des agents qu'elles
emploient que par les équipements, notamment l'armement, qu'elles
utilisent ou par les missions qu'elles remplissent.
Sur l'ensemble des communes dotées d'une police municipale, plus de 1400
communes, soit près de la moitié, ne disposent que d'un seul
agent alors que seules 5 communes en ont au moins 100.
Les polices municipales sont principalement implantées dans le sud-est,
le sud-ouest, la région parisienne, le nord et l'Est de la France.
Sur les 13 000 agents de police municipale en exercice,
4.946
soit un
peu
plus du tiers
(37,8 %)
sont armés
, essentiellement
avec des armes de la 4ème catégorie, dites armes
défensives.
Dans de nombreuses communes, les agents de police municipale se bornent
à une simple activité de police administrative effectuée
de jour, telle la surveillance des marchés. Dans d'autres communes, ils
effectuent de véritables missions de sécurité publique,
souvent la nuit, intervenant en complément, et souvent même,
à la place, des services de l'Etat.
Ce mouvement de développement des polices municipales n'a pas
été freiné par le processus d'étatisation de la
police. Sur
686 communes
de
plus de 10 000 habitants
disposant d'une police municipale
,
495
communes sont
placées sous le régime de la police d'Etat
.
L'étatisation de la police : les conditions applicables
La loi
du 23 avril 1941 avait fixé à
10 000
habitants le
seuil démographique à partir duquel l'étatisation
était susceptible d'intervenir.
Le nouveau mouvement impulsé par l'article 88 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983, qui aurait pu conduire à la généralisation
de la police d'Etat, n'a pas eu de traduction concrète pour des raisons
essentiellement budgétaires.
Les principes de l'étatisation sont actuellement fixés par
l'article L. 2214-1
du code général des
collectivités territoriales issu de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, précisé par le décret
n° 96-827 du 16 septembre 1996.
En vertu de ces dispositions, la police d'Etat peut être désormais
établie dans les communes dont la population permanente ou
saisonnière est supérieure à
20 000
habitants
et dont les caractéristiques de la délinquance sont celles des
zones urbaines, les communes de chefs-lieux de département étant
en tout état de cause placées sous ce régime.
Dans les communes dotées d'un tel régime, les agents de police de
la commune peuvent être intégrés dans les cadres de la
police nationale en vertu de
l'article L. 412-50
du code des communes.
L'article L. 2214-4
du code général des
collectivités territoriales transfère à l'Etat la
responsabilité en matière d'atteintes à la
tranquillité publique, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage,
et la charge du bon ordre en cas de grands rassemblements occasionnels.
A l'heure actuelle, la police est étatisée dans
1625
communes regroupant
29
millions d'habitants.
b) Le nouveau cadre juridique issu de la loi du 15 avril 1999
Le
statut des policiers municipaux était marqué, avant l'adoption de
la loi du 15 avril 1999, par de nombreuses
ambiguïtés : leurs
compétences
légales
était très en-deçà de leur
rôle réel, leur
statut
souffrait de très graves
insuffisances, notamment en ce qui concerne la
formation
et
l'équipement.
Nouvelle étape dans la démarche qui avait cherché depuis
plusieurs années, à mieux préciser le cadre légal
de l'intervention de ces polices, la loi du 15 avril 1999 - dont le texte est
issu des travaux de la commission mixte paritaire, réunie sous la
présidence de M. Jacques Larché - a permis d'opérer un
certain nombre de clarifications, non sans aboutir à un
encadrement
renforcé
des polices municipales
283(
*
)
.
La loi du 15 avril 1999
•
Une convention de coordination
Présentée comme la pierre angulaire du projet, la convention de
coordination, qui associe le maire de la commune et le préfet, a pour
objet d'assurer sur le terrain la
complémentarité des forces
de police municipales et des forces de sécurité dépendant
de l'Etat
. Elle est obligatoire dans toutes les communes employant au moins
cinq
agents de police municipale. Elle peut cependant intervenir
facultativement, à la demande du maire, dans les communes employant
moins de cinq agents. Elle est conclue entre le maire de la commune et le
préfet, après avis du procureur de la République. Elle
précise la nature et les lieux d'intervention des agents de police
municipale et les modalités de la coordination de leur action avec celle
de la police et de la gendarmerie nationale.
L'absence de convention de coordination
emporte : l'interdiction du
travail de nuit
des agents, entre
23 H et 6 H
, à l'exception des gardes statiques des
bâtiments communaux et de la surveillance de fêtes ou
manifestations organisées par la commune ; l'impossibilité
de
l'armement
des agents.
Le projet initial prévoyait l'intervention d'un
règlement de
coordination
,
conforme à un règlement type
approuvé par décret en Conseil d'Etat et pouvant, à
défaut d'accord entre le maire et le préfet pendant un
délai de six mois, être pris par le préfet seul,
après avis du procureur de la République. En retenant le principe
d'une convention, la commission mixte paritaire a confirmé la position
du Sénat qui avait estimé qu'il était impossible de
soumettre une police municipale à un règlement pris sans l'accord
du maire employeur.
•
Le double agrément des agents
La loi prévoit un double agrément des agents. En plus de
l'agrément par le procureur de la République qui existait
adéjà, les agents devront recevoir l'agrément du
préfet avant d'être nommés par le maire et
assermentés.
L'agrément pourra être retiré ou suspendu par le
préfet ou le procureur de la République, après
consultation du maire, ce dernier ayant alors la faculté de proposer un
reclassement dans un autre cadre d'emploi, dans les conditions prévues
en cas d'inaptitude physique reconnue d'un agent de la fonction publique
territoriale.
•
Une identification commune des tenues et des équipements
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules et
les équipements dont sont dotés les agents de police municipale
feront l'objet d'une identification commune de nature à
n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police et
la gendarmerie nationales. Il est de plus précisé que le port de
la carte professionnelle et de la tenue seront obligatoires pendant le
service.
•
L'autorisation d'utilisation en commun occasionnelle des services
de police municipale
En cas de manifestation exceptionnelle, à l'occasion d'un afflux
important de population ou en cas de catastrophe naturelle, le préfet
pourra autoriser les maires de communes limitrophes ou appartenant à une
même agglomération à
utiliser en commun,
pour un
délai déterminé
,
tout ou partie de leurs moyens de
police municipale, uniquement pour l'exercice d'activités de police
administrative.
•
La soumission à des règles de déontologie
Un code de déontologie des agents de police municipale sera
élaboré par décret, après avis de la commission
consultative des polices municipales.
•
La vérification des services
Des vérifications de l'organisation et du fonctionnement d'un service de
police municipale pourront être demandées par le maire, le
préfet ou le procureur de la République. Ces vérifications
seront décidées par le ministre de l'intérieur,
après avis de la commission consultative des polices municipales. Elles
seront opérées par les services d'inspection relevant de l'Etat.
Les modalités en seront fixées après consultation des
maires qui seront destinataires des conclusions, au même titre que le
préfet et le procureur de la République.
•
Des compétences élargies de police judiciaire sous
l'autorité fonctionnelle de la hiérarchie judiciaire
La loi n'a pas modifié les dispositions actuelles du
premier
alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des
collectivités territoriales
qui charge les agents de police
municipale d'exécuter, sous l'autorité du maire, des tâches
de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité
et de la salubrité publique.
Dans le domaine de la police judiciaire, les agents de police municipale
gardent la qualification
d'agent de police judiciaire adjoint
que leur
reconnaît
l'article 21 du code de procédure pénale
.
Mais la loi accroît leurs compétences dans ce domaine et leur
donne des moyens juridiques supplémentaires.
Les agents de police municipale resteront, chargés d'assurer
l'exécution des arrêtés de police du maire
. Des lois
spéciales les habilitent en outre à constater certaines
infractions (publicité, protection de la nature, pêche).
La loi élargit leurs compétences à la constatation
d'infractions
au code de la route
dont la liste est fixée
par
décret en Conseil d'Etat
. Ces compétences qui sont, à
l'heure actuelle limitées pour l'essentiel à la police du
stationnement des véhicules seront donc être étendues
à certains aspects de la police de circulation. La loi leur permet en
outre de constater des infractions relatives à la conservation du
domaine public routier.
Les agents de police municipale ont désormais la possibilité,
dans leur domaine de compétences, de dresser de véritables
procès verbaux
alors qu'ils ne pouvaient auparavant
qu'établir des rapports à l'intention du maire.
La loi habilite les agents de police municipale à relever
l'identité d'un contrevenant pour dresser les procès verbaux
concernant les infractions qu'ils sont habilités à constater. Si
le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de
son identité, l'agent de police municipale devra en rendre compte
immédiatement à un officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale. Ce dernier pourra alors lui ordonner
de lui présenter sur le champ le contrevenant afin de procéder
lui-même à une vérification d'identité. A
défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne pourra pas retenir
ce contrevenant.
La loi ouvre également la possibilité aux agents de police
municipale d'effectuer, dans le prolongement des infractions au code de la
route qu'ils sont autorisés à verbaliser, une
première
constatation de l'état alcoolémique
d'un contrevenant. Cette
constatation s'opère par analyse de l'air expiré à l'aide
d'un éthylotest. Si le test révèle une
présomption d'alcoolémie ou si le contrevenant refuse de s'y
soumettre, l'agent de police municipale doit en référer à
un officier de police judiciaire selon une procédure transposée
de celle applicable en matière de relevé d'identité. Cet
officier fera lui-même procéder aux vérifications et
constatations légales.
Les policiers municipaux doivent
rendre compte immédiatement
à tout
officier de police judiciaire
de la police nationale ou de
la gendarmerie nationale territorialement compétent de toute infraction
dont ils ont eu connaissance.
Concernant les contraventions qu'ils sont autorisés à verbaliser,
leurs procès-verbaux doivent être adressés
simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de
police judiciaire, au procureur de la République.
•
La reconnaissance législative de la qualité d'agent
de la fonction publique territoriale
Les agents de police municipale sont des
fonctionnaires territoriaux
recrutés dans le cadre d'un statut particulier, ce qui avait
été jusqu'à présent admis implicitement. Le cadre
d'emploi des agents de police municipale est un cadre d'emploi de
catégorie C faisant l'objet d'un statut particulier établi par le
décret n° 94-732 du 24 août 1994. Lors des
débats, le ministre s'est engagé à prévoir la
création un cadre d'emploi de
catégorie B
pour les
personnels d'encadrement.
•
Une amélioration du statut
La loi institue une
formation continue
obligatoire
des agents de
police municipale. Cette formation sera assurée par le Centre national
de la fonction publique territoriale, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Elle sera
financée par une redevance pour prestations de service, versée
par les communes concernées. La loi étend aux agents de police
municipale les dispositions en matière de
pensions de
réversion
applicables aux policiers nationaux, aux pompiers et aux
gendarmes.
•
La création d'une commission consultative des polices
municipales
Créée auprès du ministre de l'intérieur, cette
commission consultative des polices municipales est composée pour un
tiers de représentants des maires de communes employant des agents de
police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat, et, pour le
dernier tiers, de représentants des policiers municipaux, choisis par
les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires
territoriaux. Cette commission est présidée par un maire qui a
voix prépondérante en cas de partage.
Elle devra donner son avis sur les normes techniques qui doivent être
arrêtées en matière d'équipements des polices
municipales et sur le code de déontologie des agents de police
municipale ainsi qu'en matière de demande de vérification d'un
service de police municipale
•
L'armement des agents de police municipale
Avant la loi du 15 avril 1999, les conditions d'armement des agents de police
municipale étaient prévues au plan réglementaire par
le
décret n° 95-589 du 6 mai 1995
relatif à
l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions.
L'article 25
du décret du 6 mai 1995 prévoyait que les
fonctionnaires et agents des administrations publiques chargées d'un
service de police ou de répression sont autorisés, après
simple visa du préfet, à détenir et à
acquérir la plus grande partie des armes individuelles de
première catégorie, (armes de guerre), les armes de
quatrième catégorie (armes à feu d'autodéfense et
leurs munitions), et de sixième catégorie (armes blanches),
catégorie d'armes dont la détention est libre d'une
manière générale. En outre, les administrations ou
services publics peuvent acquérir ces mêmes armes en vue de leur
remise aux agents précités.
Quant à
l'article 58
de ce décret, il autorisait ces
mêmes fonctionnaires à porter ces catégories d'armes dans
l'exercice de leurs fonctions. Il revenait néanmoins au maire de
décider d'armer ou non les agents placés sous son autorité
en fonction des missions qu'il leur confie. Dans la majeure partie des cas, les
maires ont opéré ce choix lorsqu'ils assignent aux policiers
municipaux des missions les exposant à des risques (îlotages,
rondes nocturnes sur la voie publique, notamment).
Cette liberté laissée aux maires a pour contrepartie la
responsabilité applicable à la commune dans le cas où les
policiers municipaux disposent d'un armement.
Le procureur de la République pouvait, par ailleurs, à tout
moment
retirer son agrément
à des agents de police
municipale, leur interdisant ainsi d'exercer leurs fonctions et donc
d'être dotés d'une arme.
Les maires ont, dans l'ensemble, usé avec discernement de cette
prérogative. Sur les 13 000 agents de police municipale en exercice
seulement
37,7 %
(soit 4 946 agents en avril 1998) sont
armés. Certaines grandes villes (Lyon, par exemple) n'ont pas
jugé nécessaire d'armer leur police municipale. D'autres n'ont
prévu l'armement que d'une petite partie de leurs policiers municipaux
(10 sur 205 agents à Marseille).
Leur armement est pour l'essentiel constitué d'armes de la
4ème catégorie,
dites
armes défensives
.
Quelques communes ont préféré doter leurs agents d'armes
de 6ème catégorie, dites armes blanches mais on compte
également
239 armes
de 1ère catégorie.
La loi pose le principe d'un
armement sous conditions
des agents.
Des
autorisations nominatives
pourront être accordées aux
agents par le préfet, sur demande motivée du maire, lorsque la
nature des interventions
et les
circonstances
le justifieront, et
sous réserve de l'existence d'une
convention de coordination.
Les
circonstances
et les
conditions
dans lesquelles un agent
pourra porter une arme, de même que la catégorie et le type
d'armes qui seront autorisées, ainsi que les conditions de leur
acquisition et de leur détention par les communes sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le même
décret précise les modalités de la
formation
des
agents destinés à porter une arme.
B. LES LIMITES ACTUELLES DE LA POLITIQUE DE PROXIMITE
Depuis
quelques années, en outre, dans la lignée des réflexions
menées dans le cadre du colloque de Villepinte, le Gouvernement a
affirmé sa volonté de privilégier une politique de
proximité.
Devant votre mission d'information, M. Patrice Bergougnoux, directeur
général de la police nationale, a indiqué que la police de
proximité avait pour objet d'organiser les services de police selon le
principe de territorialisation autour de territoires bien identifiés.
Elle a été mise en oeuvre à partir d'avril 1999, dans une
première phase, à la préfecture de police et sur cinq
sites pilotes. Cette expérimentation a été étendue
à 62 autres sites à l'automne 1999. Au total, elle concerne 2
millions d'habitants dans 37 départements hors Paris. La
généralisation de la police de proximité devait concerner
en juin 2000, 63 circonscriptions entières de police, soit 10 millions
d'habitants, en priorité dans les zones couvertes par un contrat local
de sécurité. Une deuxième phase sera lancée en
octobre 2000, puis une troisième phase en juin 2001.
Cependant, les conditions de mise en oeuvre de cette politique suscite de
nombreuses interrogations
, soulignées par le Sénat
notamment dans le cadre de l'examen des crédits affectés à
la sécurité dans le projet de loi de finances.
284(
*
)
1. Des mesures marquées par de nombreuses incertitudes
a) Les contrats locaux de sécurité
Votre
rapporteur a précédemment souligné les
insuffisances
qui affectaient le dispositif des contrats locaux de
sécurité, illustrant ainsi les ambiguïtés des
politiques contractuelles que l'Etat engage avec les collectivités
locales
285(
*
)
.
On rappellera que ces contrats ont été prévus par une
circulaire interministérielle du 28 octobre 1997. Ils ont pour objet de
mobiliser tous les partenaires publics et tous les acteurs sociaux dans la mise
en oeuvre au plan local d'un dispositif préventif et répressif de
lutte contre l'insécurité. Leur mise en oeuvre a fait l'objet
d'une nouvelle circulaire interministérielle en date du 7 juin 1999.
Les contrats locaux de sécurité sont cosignés par le
préfet, le procureur de la République et le ou les maires
concernés. Ils associent, outre les services de l'Etat, des partenaires
privés tels les bailleurs sociaux, les sociétés de
transport en commun, les organismes consulaires ou des associations.
Au 1
er
octobre 1999
,
292 contrats
avaient
été signés. Une dizaine de contrats avaient
également été signés par le président du
conseil régional, 38 par le président d'un conseil
général et 136 par le recteur ou l'inspecteur d'académie.
Certains bailleurs sociaux, des sociétés de transport urbains ou
encore des organismes consulaires ont signé de tels contrats au lieu d'y
être simplement associés. Huit contrats thématiques
concernent les transports publics notamment à Lille. Etaient en cours
d'élaboration à cette même date, 431 autres contrats, dont
85 contrats intercommunaux et 5 spécifiques aux transports publics.
Devant votre mission d'information, M. Pierre Steinmetz, directeur
général de la gendarmerie nationale, a indiqué que la
gendarmerie prenait part à
un tiers
des contrats locaux de
sécurité, pour un tiers dans les zones où la gendarmerie
est seule intéressée et pour les deux tiers dans les zones
partagées avec la police nationale, en particulier en milieu suburbain.
Il a relevé le risque de confusion des rôles et des
responsabilités.
Les contrats locaux de sécurité doivent déterminer des
objectifs
à atteindre et des
actions
à engager sur
la base d'un diagnostic territorial de sécurité.
Les actions prévues dans ce cadre ont principalement concerné le
développement de l'îlotage, l'amélioration de l'accueil du
public et l'assistance aux victimes.
Le
caractère trop sommaire des diagnostics locaux de
sécurité
a été souligné, au mois
d'octobre 1998, par une mission interministérielle d'évaluation
des contrats. Cette évaluation a mis en évidence que l'urgence de
la signature du contrat a été parfois plus importante que le
diagnostic et le contrat lui-même. Elle a également relevé
la réticence de certains maires ainsi que l'insuffisante concertation
des services de l'Etat avec les conseils généraux.
En outre, les contrats locaux de sécurité s'insèrent dans
un
dispositif institutionnel trop complexe.
La circulaire du 7 juin 1999 a cherché à opérer un certain
nombre de clarifications, notamment quant au lien entre les contrats locaux de
sécurité et les conseils communaux et départementaux de
prévention de la délinquance.
Elle recommande la création de tels conseils là où ils
n'existent pas pour assurer le suivi local des contrats et prévoit d'en
élargir la composition aux différents partenaires
concernés.
Elle précise par ailleurs l'articulation des contrats avec la politique
de la ville. Le contrat local de sécurité doit constituer la
convention thématique du contrat consacré à la
sécurité et se substituer aux contrats d'action de
prévention pour la sécurité dans la ville, lorsqu'ils
existent.
Une cellule nationale d'animation et de suivi des contrats locaux et de
sécurité a été mise en place au ministère de
l'intérieur au printemps 1999.
b) Les emplois de proximité
Devant
votre mission d'information, M. Patrice Bergougnoux, directeur
général de la police nationale, a indiqué que 14 072
postes d'adjoints de sécurité avaient été ouverts
au 1
er
mars 2000, dont 1 280 en cours de formation et que 8 200
agents locaux de médiation sociale avaient été mis en
place à la fin de 1999, dont 5 760 dans les départements
très sensibles.
Les conditions de mise en place de ces emplois suscitent de nombreuses
inquiétudes dont votre commission des Lois s'est fait l'écho lors
de l'examen des crédits du ministère de l'intérieur pour
2000.
286(
*
)
Les adjoints de sécurité
Le
statut des adjoints de sécurité - qui relèvent des
" emplois-jeunes " - a été précisé par un
décret du 30 octobre 1997.
Agés de 18 à 25 ans
, ils
sont engagés
pour cinq ans
, sur la base d'un
contrat de droit
public
. Leur mission est de faire face à des besoins qui ne sont pas
satisfaits dans le domaine de la prévention, de l'assistance et du
soutien, en particulier dans les quartiers les plus sensibles. Ils ne peuvent
participer à des missions de police judiciaire ou de maintien de
l'ordre. Ils peuvent porter une arme lorsque leur mission le justifient.
Le
recrutement
a lieu dans un cadre départemental, après
une sélection opérée à partir de tests
psychologiques et d'un entretien. Aucun diplôme n'est exigé.
Une
formation initiale
d'une durée de 10 semaines - contre 8
semaines prévues initialement - est délivrée aux
intéressés. Elle comprend une partie théorique en
école d'une durée de 8 semaines et un stage de deux semaines dans
un service. Un tuteur les prend en charge.
Les adjoins de sécurité sont rémunérés au
SMIC sur la base de 169 heures de travail mensuelles.
En pratique, ils ont été affectés majoritairement à
des tâches d'
îlotage
et d'
accueil
dans les
commissariats. Ils sont le plus souvent dotés d'une
arme
.
Des
difficultés de recrutement
sont apparues. En outre, un
déficit de candidatures a été observé en
région parisienne. Une mission d'inspection commune de l'inspection
générale de l'administration et de l'inspection
générale de la police nationale a souligné
l'absence
d'un encadrement suffisant
, le
manque de formation
spécifique
des tuteurs des adjoints et la
déficience de la formation
des
adjoints eux-mêmes.
Les agents locaux de médiation sociale
Recrutés pour
cinq ans
et sur la base d'un
contrat
de droit privé
, dans le cadre des dispositions de l'article premier
de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement
d'activités pour l'emploi des jeunes, les agents locaux de
médiation sociale doivent remplir des missions de prévention,
périphériques de la sécurité publique au sens
strict.
Ils sont mis en place dans le cadre des contrats locaux de
sécurité. Le coût de leur rémunération est
réparti entre l'employeur (20%) et le ministère de l'emploi (80%).
Ces agents sont principalement employés par des communes mais aussi par
d'autres personnes morales chargés d'une mission de service public,
notamment des sociétés HLM ou des entreprises de transport public.
Les agents exercent en pratique des missions très variées, tels
que le service de nuit dans les logements sociaux, la surveillance dans les
transports en commun, aux abords des établissements scolaires ou des
espaces verts, l'accueil des victimes, la médiation sociale ou encore la
prévention de la toxicomanie.
Des difficultés sont apparues dans
l'encadrement
et la
formation
de ces agents, les collectivités étant souvent
démunies de cadres pouvant assumer ces missions.
c) Les difficultés rencontrées dans le redéploiement des personnels vers les zones sensibles
Une
politique de proximité efficace suppose des
moyens importants en
personnels placés au contact des populations
. Or les effectifs de
police, bien que stables depuis 1995, sont lourdement grevés par les
vacances de postes résultant du temps de formation des agents
appelés à remplacer les nombreux personnels partant en
retraite
287(
*
)
. Il ne serait pas acceptable
que, du fait de ces départs à la retraite, la
sécurité de nos concitoyens repose sur des emplois-jeunes
inexpérimentés, peu formés et recrutés dans des
conditions qui ne garantissent pas la qualité de leur action. En outre,
accaparés par des tâches administratives, des gardes statiques ou
des tâches " indues ", trop de policiers ne sont pas sur le
terrain.
Une bonne répartition des effectifs de police et de gendarmerie sur le
territoire constitue par ailleurs, une condition indispensable pour assurer
l'efficacité des politiques de sécurité publique.
Devant votre mission d'information, notre collègue Jean-Jacques Hyest,
coauteur avec M. Roland Carraz du rapport "
une meilleure
répartition des effectifs de police et de gendarmerie pour une meilleure
sécurité publique
", a souligné le paradoxe
existant entre la dotation élevée en personnels de
sécurité et le développement de la délinquance,
l'accroissement des inégalités territoriales et le très
fort sentiment d'insécurité éprouvé par nos
concitoyens. Il a fait observer que le découpage des circonscriptions de
police remontait à 1941 et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une
révision alors que 80% des français vivaient désormais
dans des zones urbaines et périurbaines.
A la suite du rapport précité, le Gouvernement avait retenu, lors
du conseil de sécurité intérieure du 27 avril 1998, le
principe d'un
redéploiement territorial
des forces de police et
de gendarmerie qui aurait permis d'affecter un plus grand nombre de policiers
et de gendarmes dans les zones sensibles. Ce plan aurait abouti à la
fermeture de 94 commissariats.
Le projet global de redéploiement a, en définitive,
été abandonné par le Premier ministre le 20 janvier 1999,
après que des oppositions se furent exprimées tant de la part des
élus concernés que des personnels. Une concertation au cas par
cas avec les élus a été privilégiée.
2. Un fort sentiment d'insécurité
Ces incertitudes affectant la politique de proximité en matière de sécurité s'inscrivent dans un contexte marqué par la détérioration des statistiques de la délinquance et de la criminalité et par une aggravation de la délinquance de proximité.
a) Une croissance globale des infractions
Inversant la tendance qui avait été
enregistrée
les trois années précédentes, l'année 1998 a
été marquée par une détérioration de ces
statistiques.
3 565 525 crimes et délits
ont été recensés,
soit environ 72 000 de plus que l'année précédente. Les
vols représentent plus de 64% de la criminalité. La
délinquance dite de voie publique représente plus de la
moitié (54,9%) de la délinquance enregistrée.
Quatre régions (Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais) concentrent plus de la moitié
(55,11%) des crimes et délits constatés en France
métropolitaine.
Les statistiques restaient orientées à la hausse au premier
semestre de 1999 (+ 2% au niveau national, +3,9% à Paris).
M. Patrice Bergougnoux, directeur général de la police nationale,
a observé, lors de son audition par votre mission d'information, une
stabilisation de l'évolution de la délinquance à partir du
deuxième semestre de 1999. Il a relevé que cette stabilisation
correspondait à la phase de mise en oeuvre de la police de
proximité et y a vu un signe encourageant pour poursuivre et
généraliser la réforme.
b) Une aggravation de l'insécurité quotidienne
En tout
état de cause, les statistiques officielles ne permettent pas de
retracer véritablement l'insécurité réellement
subie ou perçue par les citoyens dans leur vie quotidienne. Elles ne
recensent, en effet, que les faits signalés par leurs victimes. Or trop
souvent, les victimes d'infractions sont dissuadées de porter plainte.
Les taux d'élucidation des
infractions de proximité
restent particulièrement faibles : 13% pour les vols, moins de 10%
pour l'ensemble de la délinquance de voie publique (contre 85% pour les
homicides et en moyenne 28,66% pour l'ensemble des infractions).
En outre, 80% des affaires élucidées dans ces matières
sont
classées sans suite
par les parquets, faute de moyens
adéquats pour les traiter. Il y a donc là une rupture de la
chaîne répressive que ne peut suffire à justifier
l'encombrement des tribunaux.
Depuis plusieurs années, l'apparition de comportements provocants, dits
" incivilités
", susceptibles d'être
réprimés par une contravention, sont difficilement ressentis par
la population.
Au total, l'enquête de
" victimisation "
menée
par l'Institut des hautes études de sécurité
intérieure en association avec l'INSEE, a mis en évidence, en
octobre dernier, que les faits de délinquance commis en 1998 seraient
cinq fois supérieurs
à ceux des statistiques officielles.
Ce constat inquiétant doit être complété par
l'aggravation de la violence de proximité. Depuis 1988, les
dégradations et les coups et blessures volontaires ont plus que
doublé. Les vols avec violence ont pour leur part progressé de
75%.
En 1998, le service des renseignements généraux a recensé
26 000 faits de violence urbaine
, soit 10 000 de plus qu'en
1997. La moitié de ces faits ont porté sur des incendies de biens
(8 000 voitures en ont été victimes).
La croissance de la
violence dans les transports en commun
constitue un
phénomène particulièrement préoccupant. Elle
affecte la vie quotidienne des agents et des usagers.
Enfin, la
délinquance des mineurs
continue de progresser de
manière préoccupante. En 1998, le nombre de mineurs
impliqués dans des crimes ou des délits a atteint 171 787, soit
une hausse de 11,23%. Ils représentent 60% des personnes mises en cause
pour des vols de deux roues à moteur et 34,11% sur l'ensemble des vols.
Ils sont également plus fréquemment responsables de la
délinquance de voie publique (36% de l'ensemble des faits
recensés).
IV. L'ÉDUCATION
L'histoire de l'enseignement en France prend un tournant
idéologique, décisif pour son organisation, quand, à la
fin du XVIII
e
siècle, les philosophes militent pour que sa
responsabilité soit confiée à l'Etat. C'est chose faite,
dans les principes, sous la Révolution. Puis l'Empire donne en droit
à l'Université le monopole de l'enseignement, mais dans la
pratique l'enseignement primaire est laissé à l'Eglise. A partir
de 1830, sous l'influence d'une opinion plus libérale, on admet que
l'initiative de l'Etat s'accommode bien de la liberté de l'enseignement.
Ce principe trouve sa traduction dans la loi Falloux de 1850 pour
l'enseignement secondaire, qui instaure la possibilité pour les communes
et les départements de financer jusqu'à 10 % du budget des
écoles privées. Cette liberté sera par la suite
étendue progressivement à l'ensemble de l'enseignement. Cette
évolution est capitale, car c'est par ce premier biais que les
collectivités locales font leur entrée dans le champ de la
compétence scolaire.
Plus tard, la III
e
République organise un enseignement
primaire étatique remarquablement efficace et remarquablement
centralisé et renforce la séparation entre enseignement public
d'Etat et enseignement privé. Il faut attendre les années
cinquante pour que cette séparation s'atténue avec l'octroi
d'aides financières à tout enfant d'âge scolaire inscrit
dans l'enseignement public ou privé (loi Marie et Barangé) puis
avec le principe de la participation de l'Etat au financement de l'enseignement
privé (loi Debré du 31 décembre 1959).
Tout au long du XX
e
siècle, la sécularisation et la
démocratisation de l'enseignement public ont renforcé la
place
primordiale de l'Etat central
dans l'organisation de l'enseignement
même si les collectivités locales étaient
déjà associées pour la construction et l'entretien des
bâtiments et le logement des enseignants (écoles communales et
logement des instituteurs depuis 1886). En 1980, les collectivités
locales assument déjà 14,5 % des dépenses totales
d'éducation (locaux, personnels de service, crédits de
fonctionnement, activités périscolaires). On comprend donc
qu'à la veille des grandes lois de décentralisation, les
collectivités locales avaient une
vraie légitimité
à demander que soit partagée la responsabilité de
l'enseignement.
En 1983, deux traits principaux et opposés caractérisent
l'Education nationale.
1.
C'est une institution républicaine, héritière
des idées de la Révolution reprises dans le préambule de
la Constitution de 1946 (
" L'organisation de l'enseignement public
gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de
l'Etat "
) et partant plus liée au pouvoir central que partout
ailleurs en Europe.
2.
Qu'il s'agisse d'enseignement public ou privé, les
collectivités territoriales apportent déjà une
participation financière, ce qui justifie parfaitement leur aspiration
à prendre des responsabilités plus grandes, sous l'effet du
puissant mouvement de décentralisation mis en branle dans les autres
secteurs.
C'est pourquoi, soucieux de respecter les grands principes constitutionnels, le
législateur préférera conserver à l'Etat sa
fonction d'organisation du service public de l'enseignement et cédant au
poids des traditions et de l'Histoire, il parviendra à un
équilibre délicat qui relève plus du
partage
que du
transfert de compétences. Il est clair que l'Etat a gardé toutes
les fonctions importantes de la politique éducative en
transférant seulement aux collectivités locales les charges des
dépenses d'investissement, d'équipement et de fonctionnement
qu'il avait du mal à assumer.
A. LE PARTAGE DES COMPÉTENCES
L'idée était d'améliorer le service
public en
créant un cadre nouveau permettant une participation directe des divers
interlocuteurs
en partageant les compétences entre l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements secondaires
et en organisant une véritable concertation entre le service public, ses
acteurs et ses bénéficiaires.
Le primat de l'Etat en matière pédagogique est aussitôt
réaffirmé ainsi que la responsabilité des communes dans le
domaine de l'équipement et de l'entretien des écoles primaires.
Le département obtient la charge des collèges et la région
celle des lycées ; l'Etat conserve les universités.
D'autre part, les collectivités territoriales se voient confier des
attributions nouvelles en matière de
planification scolaire
(définition des besoins de formation, fixation des investissements
à réaliser et localisation des établissements), de
construction
et de
gestion
des établissements et de
participation au fonctionnement du système éducatif
(présence reconnue des élus locaux au sein des instances
consultatives départementales et académiques, ainsi que dans les
conseils d'administration des établissements d'enseignement). Enfin, en
conférant aux établissements d'enseignement le statut
d'établissement public local, la loi organise d'étroites
relations entre ces établissements et les institutions locales.
1. L'organisation institutionnelle
a) Le champ d'application des transferts de compétences
La
construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations,
l'équipement et le fonctionnement des établissements scolaires du
premier et du second degré
relèvent désormais de la
compétence des collectivités territoriales
. Le transfert
s'applique aussi bien aux établissements scolaires construits
après le transfert qu'à ceux existant lors du transfert.
Comme il a été dit, la répartition des compétences
est organisée selon un principe en apparence simple qui confie aux
communes la responsabilité des écoles (ce n'est qu'une
confirmation), aux départements celle des collèges et aux
régions celle des lycées et établissements de même
niveau.
Le patrimoine concerné comprenait le jour du transfert
(1
er
janvier 1986) 7.319 établissements du second
degré, soit près de 30.000 bâtiments principaux accueillant
environ 4,4 millions d'élèves.
Il faut noter que les établissements privés sous contrat sont
également concernés par le transfert de compétences,
puisque les régions et les départements participent
désormais à la prise en charge des dépenses de
fonctionnement pour les élèves de ces établissements.
b) Les nouvelles règles de planification et de programmation des équipements scolaires
Premièrement, la région a compétence pour
déterminer le schéma régional des formations qui
définit, à un horizon donné, les besoins qualitatif et
quantitatif de formation qui peuvent être satisfaits par les
collèges, les lycées et les autres établissements
visés par la réforme. La région arrête ce
schéma en tenant compte des orientations fixées par le Plan
après accord des départements et avant transmission au
représentant de l'Etat.
En second lieu, la région et le département arrêtent les
programmes prévisionnels d'investissement. Etablis pour les
collèges par les départements, pour les lycées et les
autres établissements de même niveau par la région, ces
programmes assurent la mise en oeuvre du schéma prévisionnel des
formations (localisation des établissements, capacité d'accueil,
mode d'hébergement des élèves). Ils sont
arrêtés, après accord de chacune des collectivités
concernées, par les projets situés sur son territoire.
Partant de ces programmes, le préfet arrête, sur proposition de
l'autorité académique, la liste des opérations que l'Etat
s'engage à pourvoir en postes.
c) Le régime des établissements publics locaux d'enseignement
(1) Un nouveau statut
Les
établissements d'enseignement sont devenus des
établissements
publics locaux
sans que toutefois lycées et collèges soient
soumis au droit commun des établissements publics locaux. Les EPLE ont
donc un
régime juridique complexe
. Seuls les actes du conseil
d'administration et du chef d'établissement relatifs au contenu et
à l'organisation de l'action éducative sont soumis à un
relatif régime d'autonomie. Ils sont exécutés quinze jours
après leur transmission à l'autorité académique,
sous réserve toutefois que cette autorité, dans ce délai,
n'en ait pas demandé l'annulation.
Le régime des actes budgétaires est particulièrement lourd
et se rapproche de celui des collectivités décentralisées,
mais les EPLE sont soumis à un triple contrôle, celui de la
préfecture, celui de la collectivité locale de rattachement et
celui de l'autorité académique. Cette situation a d'ailleurs
soulevé de nombreuses critiques.
(2) Une ouverture sur l'extérieur
D'autre
part, la loi du 22 juillet 1983 ouvre aux maires la possibilité
d'utiliser les locaux scolaires implantés sur sa commune sous la
responsabilité et après avis du conseil d'administration et
accord de la collectivité propriétaire. De plus, les
collectivités peuvent organiser dans les établissements
scolaires, pendant les heures d'ouverture et avec l'accord des instances et
autorités responsables, des activités éducatives,
sportives et culturelles complémentaires. Ces activités doivent
s'inscrire dans le prolongement de la mission publique d'éducation.
Autre nouveauté apportée par la décentralisation : le
maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable,
modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements pour
tenir compte des circonstances locales.
d) Les prérogatives conservées par l'Etat
(1) Prérogatives de l'Etat et moyens de contrôle
L'Etat
continue à définir les
objectifs généraux de la
politique d'éducation
. Il conserve la responsabilité de la
définition des
orientations pédagogiques
, des
contenus
d'enseignement et des diplômes qui sanctionnent les
formations ainsi dispensées. L'Etat conserve la
gestion des
personnels
(recrutement, formation, rémunération).
L'Etat fixe la
structure pédagogique générale
des
établissements. Chaque année, l'autorité académique
définit les différentes formations dispensées dans les
lycées et collèges (mais les établissements peuvent aussi
faire des propositions). La fixation de la structure pédagogique doit
tenir compte du schéma prévisionnel des formations et elle agit
forcément sur les objectifs programmés par les
collectivités en matière de structure, localisation et
configuration des bâtiments scolaires.
D'autre part, il incombe à l'Etat de fixer la
liste annuelle des
opérations de construction ou d'extension
des établissements.
L'inscription sur la liste ne restreint pas théoriquement le pouvoir des
collectivités de décider des investissements à
engager : en revanche, elle conditionne le financement des
opérations de construction ou d'extension par les dotations
spécifiques versées aux collectivités en vue de compenser
le transfert des dépenses d'investissement en matière
scolaire : dotation régionale d'équipement scolaire pour les
régions, dotation départementale d'équipement des
collèges pour les départements. La liste annuelle doit tenir
compte des programmes prévisionnels et ne peut prévoir
d'opérations non décidées par les collectivités
locales.
Il ressort pourtant de ce mécanisme que l'Etat s'est donné les
moyens de peser financièrement sur l'exercice des compétences
transférées.
(2) Mise en place d'instances de concertation territoriale
L'association des représentants des
collectivités au
fonctionnement du service public de l'Education se réalise, en dehors du
conseil d'administration des EPLE, dans le cadre des
conseils de l'Education
nationale du département et de l'académie
, institués
par l'article 12 de la loi du 12 juillet 1983, en remplacement des
organismes consultatifs compétents en matière scolaire.
Ces conseils sont présidés par le représentant de l'Etat,
du département ou de la région selon que les questions
examinées sont de la compétence de l'Etat ou d'une des
collectivités locales. Ils se réunissent au moins deux fois par
an. Ces instances consultatives dont le fonctionnement est
lourd
et
complexe
sont malgré tout conçues comme le pivot de la
concertation et du partenariat entre l'Etat et les collectivités
territoriales.
2. L'organisation financière
L'enseignement fait l'objet d'un financement partagé entre l'Etat et les collectivités territoriales.
a) Un financement partagé
Les
dépenses d'équipement relatives aux établissements publics
d'enseignement sont entièrement supportées par les
collectivités territoriales en ce qui concerne les investissements
lourds.
L'Etat prend à sa charge les dépenses relatives au premier
équipement en matériel réalisées dans le cadre d'un
programme d'intérêt national correspondant à l'introduction
de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels
spécialisés (informatique, bureautique,
télématique).
Pour les dépenses de fonctionnement, l'Etat reste la principale source
de financement puisqu'il supporte la rémunération des personnels
et les dépenses de fonctionnement pédagogique des
établissements (manuels scolaires, maintenance du matériel acquis
par l'Etat).
De plus, l'Etat supporte 80 % du forfait d'internat des
établissements privés sous contrat.
b) Des mécanismes spécifiques de compensation.
(1) Compensation des charges de fonctionnement.
Le transfert de compétences dans le domaine du fonctionnement des établissements scolaires a entraîné l'attribution d'une part supplémentaire de dotation générale de décentralisation.
(2) Compensation des charges d'équipement.
Dans le
domaine de l'investissement, il s'agit de dotations spécifiques :
la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) et la dotation
départementale d'équipement des collèges (DDEC). Ces
crédits ne peuvent être utilisés à des
opérations de création ou d'extension d'établissement
qu'à condition que celles-ci figurent sur la liste annuelle
d'opérations arrêtée par le préfet de région.
Les modalités de répartition annuelle des dotations entre les
collectivités sont assez complexes. La DRES est ventilée entre
les régions au moyen de critères statistiques prenant en compte
l'existant (superficie des bâtiments, effectifs scolarisés,
prévisions démographiques).
La DDEC est d'abord scindée en enveloppes régionales en fonction
des mêmes critères ; ces enveloppes sont ensuite
distribuées entre les départements d'une même région
par la conférence des présidents des conseils
généraux.
c) Financements conjoints entre collectivités de niveaux différents.
Les lois
de décentralisation prévoient différentes
possibilités, pour les collectivités territoriales, de participer
au financement d'établissements ne relevant pas de leur
compétence directe. Dans tous les cas, la participation doit être
fixée
par convention
entre les collectivités
concernées ; à défaut d'accord, le
représentant de l'Etat a la possibilité de trancher.
Pour les élèves fréquentant un établissement et
résidant dans une autre collectivité de rattachement, des
mécanismes de répartition intercommunale,
interdépartementale et interrégionale des charges de
fonctionnement ont été prévus. Pour les cités
scolaires ou les établissements regroupant collège et
lycée, une convention s'impose entre collectivités de
rattachement pour la répartition de l'ensemble des charges.
En outre, une procédure d'appel de responsabilité a
été instituée pour permettre à une commune de se
substituer à la région ou au département pour assumer la
responsabilité soit d'une opération d'investissement concernant
un lycée ou un collège soit des dépenses de fonctionnement
d'un ou plusieurs établissements.
3. La prise en charge par les collectivites de leurs nouvelles competences.
a) Transferts et mises à disposition de personnels.
(1) Les principes.
La loi
du 22 juillet 1983 met à la charge de l'Etat tous les
frais de
personnel
, ce qui entraîne que sont exclus du transfert les
personnels enseignants et les personnels administratifs, techniques, ouvriers
et de service (ATOS) qui sont pourtant, à titre principal,
chargés d'une tâche incombant aux collectivités, à
savoir le fonctionnement courant des établissements.
En outre, la situation des personnels des services déconcentrés
dits académiques est encore plus complexe : ils continuent à
travailler dans les cadres hiérarchiques des rectorats et des
inspections d'académie. Les personnels, comme l'administration centrale,
restent réticents à l'égard d'un transfert.
(2) Des transferts limités.
L'Etat s'est refusé à transférer les personnels des services du ministère où étaient exercées auparavant la plupart des compétences elles-mêmes transférées. En contrepartie, le recrutement par les collectivités territoriales de personnels de l'Education nationale a été fréquent.
(3) Une collaboration étroite entre services académiques et collectivités territoriales.
La plupart des collectivités recourent ponctuellement à l'aide des services déconcentrés de l'Education nationale.
b) L'organisation des services locaux
Les collectivités se sont progressivement dotées de services scolaires : on assiste à une croissance régulière du nombre d'agents affectés à la gestion des nouvelles compétences. D'une manière générale, la prise en charge par les collectivités territoriales de leurs nouvelles compétences a été rendue plus difficile par les hésitations concernant les mises à disposition des services de l'Etat et les transferts de personnels , mais aucun transfert en provenance des services de l'Education n'ayant en définitive eu lieu, les collectivités ont dû se doter de services scolaires parfois mal adaptés.
B. UN BILAN SATISFAISANT MALGRÉ DES INSUFFISANCES
1. Les insuffisances de la programmation
Grâce aux
schémas prévisionnels des
formations
, les régions détiennent un
rôle
prépondérant
en matière de planification scolaire.
Les
programmes prévisionnels d'investissement
(PPI) assurent la
mise en oeuvre des orientations du schéma prévisionnel des
formations et définissent, à l'horizon choisi par la
région ou le département, la localisation des
établissements, leur capacité d'accueil et le mode
d'hébergement des élèves.
Le concours apporté par les services académiques aux
collectivités a été assez important dans le domaine des
schémas prévisionnels. S'agissant des PPI, la participation des
rectorats a été très variable.
Il en résulte de
grandes disparités
d'une région
à l'autre et surtout de
grandes différences
d'appréciation
dans l'analyse des perspectives en matière
d'effectifs scolaires entre la collectivité et le rectorat.
La fonction de régulation en matière de programmation scolaire
relève du préfet de région qui, en établissant sur
proposition du recteur la liste annuelle des opérations, a le pouvoir
non de restreindre directement l'action des collectivités territoriales
mais de déterminer quelles opérations bénéficient
de la DRES ou de la DDEC. Cette procédure n'est pas toujours
appliquée. Souvent les collectivités financent leurs
dépenses au-delà des dotations de compensation
sur leurs
ressources propres
. La régulation ne peut alors pas fonctionner.
2. Des financements multiples
a) Les contributions des communes
L'application de la loi prévoit la participation des
communes
au financement des collèges publics.
Les départements définissent le taux de participation des
communes puis le produit attendu est réparti au prorata du nombre
d'élèves de chaque commune fréquentant le collège
et en fonction de leur potentiel fiscal.
Ce dispositif fixait l'extinction de la participation communale au
31 décembre 1994 avec possibilité pour les conseils
généraux de la réduire progressivement ou même de la
supprimer dès 1990.
Quant à la participation des communes à l'investissement des
collèges, elle a pu se poursuivre jusqu'en 1999 (avec possibilité
d'extinction anticipée).
En outre, les communes sont fréquemment sollicitées pour apporter
le terrain lors du financement d'une construction scolaire.
b) Les concours de l'Etat
La
compensation des charges transférées en matière de
fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement
s'effectue dans le cadre de la dotation générale de
décentralisation. S'agissant des dépenses d'investissement, on a
vu qu'il y avait deux dotations, la DDEC et la DRES. La DGD a augmenté
de plus de 30 % de 1983 à 1993 ; la DDEC a quadruplé et
la DRES plus que triplé pendant la même période.
En outre, l'Etat, à la suite de différents plans d'urgence (le
dernier est de l'automne 1998), a été amené à
verser des subventions exceptionnelles (plus de 4 milliards en 1988 et
1993 et 1,6 milliard entre 1994 et 1996).
Le dispositif de compensation financière spécifique à
la décentralisation scolaire n'a pas permis de couvrir les
dépenses effectivement engagées
par les collectivités
locales. Le taux de couverture est ainsi apparu très insuffisant
(exemple : taux de couverture de la DDEC en 1993 : 14,38 %).
3. Le remarquable effort des collectivités locales
La
contribution des conseils généraux aux budgets de fonctionnement
des collèges est passée de 3,1 milliards en 1986 à 4,6
milliards en 1990, puis à 5,3 milliards en 1992. Les régions, de
leur côté, ont dépensé 4 milliards de francs pour
les dépenses de fonctionnement des lycées en 1992 contre
2,4 milliards en 1986.
Mais c'est surtout l'immense effort financier volontairement consenti par les
collectivités locales pour rénover et améliorer les
établissements scolaires comme pour faire face à la
nécessité d'en construire de nouveaux qui frappe les esprits et
illustre le mieux le succès de la décentralisation. Les conseils
généraux ont apporté 19 milliards à ces
dépenses entre 1986 et 1990 (or, la DDEC ne couvrait que 32,7 % des
dépenses en 1986 et 23,2 % en 1990).
L'effort des régions est encore plus grand : plus de 31 milliards
de 1986 à 1990 (avec une DRES qui représentait 68 % des
dépenses en 1986 et 20 % en 1990).
|
1992 |
Départements
|
Régions
|
TOTAL |
|
Dépenses de fonctionnement |
5,3 |
3,9 |
9,2 |
|
Dépenses d'investissement |
7,9 |
15,2 |
23,1 |
|
TOTAL |
13,2 |
19,1 |
32,3 |
(en
milliards de francs)
Quand on compare les efforts des collectivités locales à ceux que
l'Etat consentait à la date des transferts et leurs réalisations
à celles qui étaient alors les siennes, il n'est pas difficile de
conclure que le rapprochement du pouvoir de décision du terrain
où elle s'applique a permis de satisfaire mieux et plus vite les besoins
à une période de forte croissance démographique. Les
investissements ont été multipliés par 5 pour les
collèges et par 12 pour les lycées.
La très forte croissance des dépenses d'investissement pour les
collèges est due au souci des élus départementaux d'offrir
aux élèves et à leurs enseignants un cadre de
qualité, mais elle s'explique aussi très simplement par
l'état de dégradation général du parc au moment du
transfert : il fallait remettre les bâtiments aux normes de
sécurité et de confort.
Les conseils régionaux se sont efforcés de développer les
capacités d'accueil des lycées, car les élèves
devenaient plus nombreux et le gouvernement se proposait de mener coûte
que coûte 80 % des élèves jusqu'au baccalauréat.
Les statistiques fournies par la direction de la programmation et du
développement du ministère de l'éducation nationale font
état, pour la dernière année connue (1998), de
27,8 milliards de francs consacrés par les départements
à l'éducation et de 29,4 milliards pour les régions.
Ces chiffres comprennent les 9,7 milliards dépensés par les
départements pour assurer le ramassage scolaire ainsi que les sommes
apportées par les départements et les régions au plan U2M.
LE
PARTAGE DU COÛT DE L'ÉDUCATION EN 1998
607
milliards de francs ont été dépensés en 1998 par la
France pour son système éducatif, soit 7,2 % du PIB et 10 300 F.
par habitant. La dépense moyenne par élève est de 37 200
F. L'Etat est le principal financeur (65 %) devant les collectivités
locales (20 %), les ménages (7 %), les entreprises (6 %), les
caisses d'allocations familiales (1,5 %) et les autres administrations (0,7 %).
Sur les 607 milliards de francs dépensés en 1998, 498,1 milliards
(soit 82 %) l'ont été pour des activités d'enseignement.
Les 18 % restants sont utilisés à l'organisation du
système d'enseignement (administration, orientation, recherche,
documentation) pour 13,3 milliards, aux cantines, internats, médecine et
transports scolaires pour 61,1 milliards de francs, à l'achat de livres,
fournitures, vêtements spécifiques pour 22,7 milliards et pour la
formation des personnels 12,1 milliards.
Il convient de noter qu'à l'intérieur des dépenses pour
les activités d'enseignement, la part des dépenses relatives au
second degré est prédominante (41,2 %) et que la part des
dépenses consacrées à l'enseignement supérieur
s'accroît sensiblement (16,5 % contre 13,6 en 1985), tandis que le
premier degré reste stable.
Parmi les collectivités locales, les communes sont le plus gros
financeur (12,5 %), car elles ont la charge des
rémunérations des personnels non enseignants du premier
degré, du fonctionnement et de l'investissement des écoles.
C. LA QUESTION DES TRANSPORTS SCOLAIRES
L'organisation et la responsabilité des transports sont
confiées à deux types d'autorités
décentralisées :
- les départements ont en charge les transports scolaires hors du
périmètre urbain,
- l'autorité compétente pour l'organisation des transports
urbains l'est également en matière scolaire à
l'intérieur de ces périmètres.
Ces autorités organisent le transport scolaire, mais elles peuvent,
toutefois, passer avec d'autres personnes publiques (communes, groupement de
communes) et même avec des personnes privées -associations de
parents d'élèves, ou associations familiales- des conventions qui
leur permettent de confier à ces personnes l'organisation même du
service.
Le département et les autorités organisatrices en
général sont compétents pour :
- créer et définir les services de transport scolaire,
c'est-à-dire pour décider de la création des circuits de
ramassage, de leur modification, de la fermeture des circuits ;
- fixer les catégories d'élèves admis dans le
circuit ;
- décider de l'ouverture éventuelle du service à d'autres
usagers ;
- déterminer les conditions du service du ramassage scolaire, notamment
prévoir quelles communes et quels établissements scolaires seront
concernés par le ramassage. Enfin, pour fixer les horaires, les
fréquences, les points d'arrêts du circuit ;
- décider du financement du transport scolaire. Il leur incombe donc de
décider de la politique tarifaire qu'elles entendent mener et peuvent
décider, soit d'instaurer la gratuité du transport des
élèves, soit de fixer le taux de participation des familles ;
- choisir le mode d'exploitation du service qui leur convient le mieux :
régie, délégation de service public ;
- enfin, prendre les mesures de sécurité en faveur des
élèves.
En matière de sécurité, l'Etat reste compétent pour
définir les règles de sécurité et vérifier
leur observation et pour le contrôle technique des véhicules. Il
exerce également un pouvoir général en matière
d'encadrements des tarifs, de réglementation technique et sociale et de
tenue de registre des transporteurs.
En application de l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983, le
département ou l'autorité compétente peut confier par
convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires, à
des communes, des groupements de communes, syndicats mixtes,
établissements d'enseignements, associations de parents
d'élèves et associations familiales.
Le financement est un financement croisé :
Etat/collectivités territoriales. Ainsi, a été mise en
place la compensation des charges transférées. Un droit à
compensation a été défini par le décret du 18 juin
1984 précité. A ce titre, l'Etat alloue aux autorités
compétentes des ressources équivalentes aux dépenses qu'il
effectuait à la date du transfert. Cette compensation s'est traduite par
l'attribution d'une part supplémentaire de la dotation
générale de décentralisation. Une actualisation intervient
chaque année, conformément aux dispositions de l'
article
L. 1614
du code général des collectivités
territoriales. Des subventions d'équipement peuvent s'ajouter à
la DGD. La question grave qui se pose aujourd'hui vient du nombre toujours plus
grand d'élèves transportés. Ce nombre croît sous
l'effet de la suppression de classes dans les zones rurales. On est donc en
droit de se demander si, plutôt que d'organiser à un coût de
plus en plus dispendieux le ramassage scolaire, source de fatigue et
d'insécurité pour les élèves, il ne serait pas plus
efficace de maintenir avec cet argent les classes supprimées par le
rectorat.
D. LA PARTICIPATION DES RÉGIONS AU FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L'effort des régions en faveur des
universités est
déjà très conséquent
, qu'il s'agisse de la
recherche, de l'innovation technologique, de la formation permanente, ou
même de la participation au montage pédagogique (financement de
formations de deuxième ou de troisième cycle, plus
particulièrement liées au développement économique
local). En outre, les régions ont été associées
à la réflexion engagée en 1990-1991 sous le nom de
" Université 2000 " par le Ministère de l'Education
nationale et la réalisation de ce programme se fait
avec l'effort
financier des collectivités locales à hauteur d'au moins
50 %
. Cette politique, qui a englobé les nouveaux
départements des Instituts Universitaires de Technologie (IUT), va se
poursuivre avec le plan " U3M " et à travers les nouveaux
contrats de plans Etat-Régions.
L'Etat ne peut, à lui seul, faire face à la crise de
l'enseignement supérieur, devenu un enseignement de masse qui exige, en
matière d'équipement, un vrai changement d'échelle.
Bien que l'enseignement supérieur reste de la seule compétence de
l'Etat, les régions y sont ainsi de plus en plus étroitement
associées sur le plan financier.
L'Etat doit cependant consulter les collectivités concernées pour
les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les
aménagements des établissements d'enseignement supérieur.
La région est également consultée sur les aspects
régionaux de la carte des formations supérieures et de la
recherche.
Depuis la loi du 4 juillet 1990, l'Etat a la possibilité de
confier aux collectivités territoriales la maîtrise d'ouvrage de
construction ou d'extension d'établissements d'enseignement
supérieur. Le plan Université 2000 (1990-1998) a
représenté un engagement budgétaire de 32 milliards
de francs répartis à parité entre l'Etat et les
régions.
Le plan U3M qui s'étend de 2000 à 2006 a pour objectif de
prolonger la politique de construction universitaire mise en oeuvre par U2000.
Il vise à améliorer les locaux universitaires existants, à
facilite les conditions de vie et de travail des étudiants et à
permettre la création de réseaux universitaires et
l'intégration de l'université dans la ville.
Le plan U3M suscite cependant une
véritable
inquiétude
: son coût est incertain et les nouvelles
obligations pour les collectivités territoriales semblent
particulièrement lourdes. Pour l'enseignement supérieur,
l'ensemble du plan U3M devrait représenter plus de 38 milliards de
francs dont 18 à la charge de l'Etat.
Les régions devront
financer le plan U3M selon des priorités qu'elles n'auront pas la
possibilité de remettre en cause
.
Si la culture fut peu concernée par la décentralisation,
l'initiative
et le
dynamisme
des collectivités
territoriales leur ont cependant permis de devenir des acteurs de premier plan
de l'action culturelle. La tendance de l'Etat à rétablir une
certaine
forme de tutelle
et à
instrumentaliser
les
financements croisés, très utilisés dans le domaine de la
culture, rend toutefois nécessaire une clarification des
responsabilités.
V. LA CULTURE
A. L'INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES A PRIS SON ESSOR AVANT LA DÉCENTRALISATION
Après la Révolution et la disparition des
corporations
et des maîtrises, le secteur culturel, beaucoup plus réduit que
nous ne l'entendons aujourd'hui, était désorganisé.
L'intervention de l'Etat dans le domaine de la culture a été
très tardive, ses premières grandes initiatives datant du XVIIIe
siècle, et restant cantonnées à la capitale. Sous la
pression des besoins, les municipalités prirent l'initiative de
créer des établissements d'enseignement musical. Puis ce
schéma se répéta dans tous les secteurs culturels que les
collectivités territoriales ont peu à peu investis. Dès le
XIXe siècle les grandes villes avaient ainsi développé
leurs équipements culturels, notamment des théâtres, des
bibliothèques et des musées, sans subvention ou aide d'aucune
sorte de l'Etat, constituant un tissu important d'institutions culturelles.
Freinées par les besoins de la reconstruction, les collectivités
locales ont cependant pris quelques initiatives culturelles très
modernes sous la IVe République. Les villes de Strasbourg, Avignon ou
Cannes ont notamment organisé des festivals, de théâtre ou
de musique, dès le début des années cinquante. Sous la Ve
République, l'effort des collectivités locales en faveur de la
culture s'est développé. Les départements ont ainsi eu
dès les années soixante un important patrimoine culturel à
gérer.
La création du Ministère des Affaires culturelles en 1959 n'a pas
entravé les initiatives locales. Au contraire, près de vingt ans
avant le mouvement de décentralisation, les ministres français de
la culture ont tendu à associer les collectivités territoriales
à leur action en faveur du développement et de la diffusion de
la culture.
Alors qu'André Malraux, qui s'est vu confié la création du
ministère, défend une conception très centralisatrice dans
le domaine de la culture, il incite les collectivités locales à
collaborer à la mise en oeuvre de ses initiatives les plus importantes.
Il va ainsi les associer progressivement à l'exécution des plans
quinquennaux de modernisation économique et sociale, qu'il a mis en
place dans le domaine de la culture, et à l'inventaire
général des richesse artistiques de la France. Il prévoit
également des partenariats directs avec les collectivités
territoriales, en créant les maisons de la culture, financées
à parité par l'Etat et les villes concernées.
Les initiatives de Jacques Duhamel, ministre des affaires culturelles de 1971
à 1973, ont concrétisé la prise de conscience du
rôle essentiel des collectivités locales dans le domaine de la
culture
, et ont visé à accroître les moyens de
coopération entre les collectivités locales et l'Etat, notamment
à travers la politique des chartes entre l'Etat et les villes, la
transformation des maisons de la culture en centres d'action culturelle, le
plan décennal pour la musique, la collaboration avec la
délégation à l'aménagement du territoire et
à l'action régionale (DATAR) et la mise en place du fonds
d'intervention culturel (FIC), permettant de financer des opérations
innovantes proposées par les collectivités locales.
Aux termes de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les
collectivités locales participent, dans le cadre des conseils
d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE), aux missions
d'information du public dans ces domaines et à la formation des
personnels intervenant dans le secteur de la construction.
Ainsi, l'intervention culturelle des collectivités locales a
trouvé son
plein essor
dans les années soixante-dix.
D'abord influencées par les orientations définies par l'Etat, les
collectivités territoriales ont mis en place à cette
époque des
politiques culturelles autonomes
et ont
augmenté leur effort financier en faveur de la culture.
L'évolution des dépenses culturelles des départements
montre que l'augmentation des sommes consacrées à la culture
n'est pas directement corrélée aux lois de
décentralisation, mais résulte de la
politique volontariste
menée par les départements
. Entre 1979 et 1978, le budget
culturel des départements progresse de 88 %, puis de 80,6 % entre 1978
et 1981, passant de 0,305 milliard de francs en 1975 à 1 milliard de
francs en 1981
(288(
*
))
.
La même remarque peut s'appliquer aux
communes
. Elles consacraient
près de 9,6 milliards de francs en 1978 à la culture. De 1978
à 1993, ces dépenses ont progressé en moyenne de 5 % par
an, l'augmentation la plus forte se situant en début de période
entre 1978 et 1984.
Lorsque les lois de décentralisation sont votées, les
collectivités locales se sont déjà vu reconnaître de
fait une
place essentielle dans l'action culturelle
, soit en partenariat
avec l'Etat, soit de leur propre initiative.
B. LES PRINCIPES RETENUS PAR LES LOIS DE DÉCENTRALISATION
La culture tient une part bien modeste dans les lois de décentralisation qui ont toutefois permis de clarifier les modalités d'intervention des collectivités locales dans quelques domaines circonscrits de l'action culturelle.
1. La confirmation des compétences exercées par les collectivités territoriales dans le domaine culturel
Le
caractère très restreint de la décentralisation dans le
secteur de la culture résulte à la fois des conceptions
centralisatrices du ministre de la culture, de la jeunesse relative du
ministère à cette époque, et de la forte demande
d'intervention étatique des milieux culturels, craignant une
instrumentalisation de la culture par les collectivités
locales
(289(
*
))
.
Dans ce contexte, les lois de décentralisation n'ont pas pris la mesure
du dynamisme que les collectivités locales avaient déjà
manifesté dans le domaine culturel et les transferts de
compétence et de responsabilité prévus par les lois du 7
janvier et du 22 juillet 1983 sont restés très limités.
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, attribue une compétence générale
aux trois niveaux de collectivités, en relation avec l'Etat :
"
la commune, les départements et les régions concourent,
avec l'Etat, à l'administration et à l'aménagement du
territoire, au développement économique, sanitaire, culturel et
scientifique et à l'amélioration du cadre de vie
".
La loi du 7 janvier 1983 définit une nouvelle organisation des pouvoirs
dans le domaine de l'architecture et du patrimoine. Elle prévoit (art.
70) la création des zones de protection du patrimoine architectural et
urbain (ZPPAU). Les ZPPAU permettent d'élaborer, avec l'accord des
conseils municipaux, des documents d'urbanisme spéciaux pour les abords
des monuments historiques et pour les quartiers et sites à
protéger pour des raisons architecturales et historiques. Ce texte
toutefois n'attente pas aux prérogatives de l'Etat en matière de
protection du patrimoine, qui sont exercées par les préfets de
région et les architectes des bâtiments de France, dont l'avis lie
la collectivité territoriale en matière de protection, de
restauration des monuments historiques ou d'aménagement d'une ZPPAU.
Par ailleurs, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant
la loi 7 janvier 1983, comporte une section consacrée à
l'environnement et à l'action culturelle (regroupant les articles 56
à 68). Aux termes de ces dispositions, la compétence de chaque
niveau de collectivités locales est reconnue (avec quelques nuances)
dans cinq domaines : création et gestion de bibliothèques,
création et gestion de musées, création et gestion
d'établissements d'enseignement public de musique, de danse et d'art
dramatique, création et gestion d'établissement d'enseignement
public des arts plastiques, conservation des archives.
2. Des compétences partagées
Certaines compétences relèvent de manière privilégiée d'un niveau de collectivité, ainsi en est-il notamment de la compétence des départements en matière d'archives. Cependant, aucune collectivité publique n'exerce le monopole d'une des compétences culturelles transférées , chaque collectivité intervenant dans l'ensemble des fonctions culturelles.
a) Les enseignements culturels
Aux
termes de l'article 63 de la loi du 22 juillet 1983, les établissements
d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique
relèvent de l'initiative et de la responsabilité de chaque niveau
de collectivité territoriales. Cette décentralisation est
cependant plus réduite qu'il n'y paraît, la compétence de
l'Etat demeurant totale dans le domaine de l'enseignement
général. Les lois de décentralisation ne l'ont pas
dessaisi de son pouvoir de programmation des enseignements artistiques, de
musique et de danse que reçoivent les enfants scolarisés.
La loi du 22 juillet 1983 prévoit que les écoles d'art peuvent
être classées ou agréées par l'Etat, en accord avec
la collectivité. Dans ce cas, l'Etat définit les qualifications
exigées du personnel enseignant, assure le contrôle de leurs
activités ainsi que le fonctionnement pédagogique des
établissements. Le classement offre certes un label de qualité
mais aussi de
nombreuses contraintes
sur lesquelles les
collectivités locales ne peuvent influer.
b) Les bibliothèques
On
distinguait jusqu'en 1983 trois catégories de bibliothèques
municipales en fonction du contrôle plus ou moins étendu de l'Etat
sur ces bibliothèques et du statut des bibliothécaires : les
bibliothèques classées, les bibliothèques
contrôlées, les bibliothèques surveillées. Dans les
trois cas, les financements étaient croisés. Les lois de
décentralisation ont entendu clarifier les règles et mettre fin
à une certaine confusion juridique dans ce domaine.
La loi du 22 juillet 1983 précise que les
bibliothèques
municipales
sont organisées et financées par les communes.
Leur activité reste cependant soumise au contrôle technique de
l'Etat. Dans le cas des bibliothèques classées, les
dépenses relatives aux personnels scientifiques d'Etat sont prises
intégralement en charge par l'Etat.
La loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des
collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de
spectacles cinématographiques créera une nouvelle
catégorie de bibliothèque municipale : les
bibliothèques municipales à vocation régionale (BMVR), le
financement de ces nouveaux équipements devant être assuré
par l'augmentation de la dotation générale de
décentralisation des communes.
En ce qui concerne les départements, l'article 60 de la loi du 22
juillet 1983 leur transfère la responsabilité des
bibliothèques centrales de prêt
, auparavant
créées et gérées par la direction du livre du
ministère de la culture. Le transfert de compétence n'a toutefois
pas été total. Les personnels scientifiques de l'Etat, les
conservateurs, ont conservé le statut d'Etat qui leur était
applicable avant 1983. Les autres personnels peuvent choisir d'appartenir
à la fonction publique de l'Etat ou à la fonction publique
territoriale. Les agents qui n'appartiennent pas à la fonction publique
territoriale sont mis à la disposition du président du conseil
général.
c) Les archives
Jusqu'en
1983, les archives relevaient de l'Etat, les départements prenant
à leur charge les dépenses relatives aux bâtiments et aux
personnels. L'article 66 de la loi du 22 juillet 1983 a transféré
l'essentiel des compétences en matière d'archives aux
départements
(les communes et les régions étant
propriétaires de leurs archives et pouvant les conserver
elles-mêmes, sauf exceptions législatives concernant les archives
des communes).
Les départements sont cependant soumis à de nombreuses
obligations : les archives départementales doivent accueillir les
archives des services extérieurs de l'Etat établis dans le
département, les autres archives publiques constituées dans leur
ressort ainsi que les archives que les communes sont tenues ou choisissent de
déposer.
Toutes les tâches de conservation et de mise en valeur des archives sont
soumises au contrôle technique et scientifique de l'Etat.
d) Les autres compétences
Chaque niveau de collectivités locales peut également créer et gérer des musées départementaux , les personnels des musées pouvant choisir leur statut de la même façon que les personnels des bibliothèques. La politique des collectivités locales est cependant largement contrainte par la définition des objectifs et priorités nationales définies par l'Etat, ainsi que l'a indiqué à la mission d'information Mme Maryvonne de Saint-Pulgent, conseiller d'Etat, dénonçant à cet égard le risque d'hégémonie de certaines valeurs artistiques soutenues par l'Etat, risque qui " disparaîtrait si les décideurs publics territoriaux pouvaient être libérés de la tutelle culturelle étatique ".
3. Des compétences encadrées
Les
compétences, partagées entre les différents niveaux de
collectivités, restent largement encadrées par l'Etat, peu
désireux de perdre le contrôle des activités culturelles.
La décentralisation dans le domaine culturel est donc à la fois
limitée
et
surveillée
.
De nombreuses normes techniques et des obligations législatives ou
réglementaires encadrent strictement les actions des
collectivités locales et
restreignent leur autonomie
dans chacun
de leur domaine d'intervention.
Certains décrets tendent également à
renforcer
ou
confirmer
les pouvoirs de l'Etat dans le domaine culturel. Le
contrôle scientifique et technique de l'Etat à l'égard des
institutions culturelles décentralisées a ainsi été
largement entendu. Il s'applique à la conservation des archives, au
fonctionnement des musées et des bibliothèques et se double d'un
contrôle pédagogique sur les établissements d'enseignement
artistique décentralisés.
Le décret n° 88-1037 du 9 novembre 1988 relatif au contrôle
technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités
territoriales et le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au
contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des
collectivités territoriales ont ainsi prévu : la
liberté d'accès des représentants de l'Etat dans toutes
les parties des bâtiments publics destinés à un usage
culturel, la possibilité de rendre des avis immédiatement
suspensifs concernant les constructions ou aménagements des locaux, la
restauration ou la désaffectation du domaine public de certains
documents, la prise de mesures d'urgence en cas de péril sur les
collectivités publiques et la production de rapports
généraux en particulier sur l'ensemble des questions relatives
à l'organisation et au fonctionnement des institutions
décentralisées.
Le décret du 8 novembre 1990 complète ce dispositif en
étendant aux bibliothèques centrales le contrôle technique
de l'Etat sur les bibliothèques territoriales.
4. L'évolution depuis 1983
a) Une lente mise en oeuvre des lois de décentralisation
Il a
fallu attendre le décret n° 86-102 du 20 janvier 1986 pour que les
transferts prévus par les lois de 1983 en matière de
bibliothèques et d'archives puissent être pleinement effectifs.
De plus, les opérations d'équipement du territoire en
bibliothèques départementales que l'Etat s'était
engagé à mener en 1984 n'ont été achevées
qu'en 1991. Rappelons que, dans le même temps, les conseils
généraux ont développé les politiques de lecture
publique départementale, augmenté les dessertes de livres,
recruté des personnels, etc.
En ce qui concerne les personnels des bibliothèques, les décrets
leur permettant d'exercer leur droit d'option entre le statut de la fonction
publique d'Etat et la fonction publique territoriale n'ont été
pris que le 2 septembre 1991.
b) L'évolution législative
Certains
textes ont offert aux collectivités territoriales la possibilité
d'élargir le domaine de leur action culturelle. Cependant, il semble que
ces dispositions tendent à
pallier les faibles marges de manoeuvre
budgétaires de l'Etat
qu'à approfondir la
décentralisation.
La loi du 13 juillet 1992 permet aux communes, groupements de communes,
départements et régions d'attribuer des subventions à des
entreprises existantes, exploitant des salles de spectacles
cinématographiques (réalisant en moyenne hebdomadaire moins de 2
200 entrées), alors que le maintien des salles de spectacles, notamment
dans les zones rurales, était menacé. Ces compétences
nouvelles ont été perçues comme une sollicitation
financière inavouée des acteurs locaux. On estime ainsi
qu'à l'heure actuelle
une salle de cinéma sur cinq est
gérée directement ou indirectement par une commune
.
La loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du
13 octobre 1945 relative aux spectacles a étendu aux départements
d'outre-mer l'application de l'ordonnance du 13 octobre 1945
précitée et leur a donc offert la possibilité de
subventionner les entreprises de spectacles vivants.
Ce texte prévoit également que les collectivités
territoriales, et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
peuvent exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 40 %
les théâtres nationaux, les autres théâtres fixes,
les tournées théâtrales et les théâtres
démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art
dramatique, lyrique ou chorégraphique, les concerts symphoniques, etc.
Cette disposition encourage les collectivités territoriales à
apporter leur soutien financier sous forme d'exonération d'impôt,
aux entreprises de spectacles vivants,
palliant ainsi, une fois encore, les
carences de l'Etat sans compensation financière et sans que leur
responsabilité réelle dans ce secteur de la culture ne soit
accrue
.
5. Les cas particuliers des départements d'outre-mer, puis de la Corse
La loi
n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
donne aux régions d'outre-mer compétence en matière
d'élaboration d'un programme culturel régional. Cette loi
prévoit l'attribution d'une dotation globale pour le
développement culturel.
L'article 56 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la
collectivité territoriale de Corse prévoit de renforcer les
responsabilités culturelles de la collectivité. Il convient de
préciser que la nouvelle collectivité territoriale n'a pas
bénéficié d'un réel transfert de compétence
dans la mesure où elle ne reçoit pas le monopole de
responsabilité dans les domaines énumérés à
l'article 56
(290(
*
))
. La circulaire conjointe du
ministère de l'intérieur et du ministère de la culture du
19 août 1992 précise que "
ces dispositions
n'entraînent pas l'exclusivité de l'intervention de la
collectivité de Corse
", les autres collectivités, et
surtout l'Etat, conservent leurs pouvoirs dans le secteur de la culture.
C. LES FAITS : DYNAMISME ET EFFICACITE DE L'ACTION CULTURELLE DES COLLECTIVITES LOCALES, RETICENCE DE L'ETAT
1. Un dynamisme local avéré
a) La prise de conscience de l'importance du développement culturel local
Dans les
faits, les collectivités locales ont développé des
politiques culturelles riches et diversifiées
en s'appuyant sur
leur clause générale de compétence, et en dépassant
largement les responsabilités que leur ont conféré les
textes législatifs.
Dans ce mouvement de décentralisation, dû à l'initiative
des collectivités locales plutôt qu'à des textes de
portée restreinte, la prise de conscience par les responsables locaux du
rôle déterminant de la culture, en termes d'image, de renforcement
du sentiment d'appartenance à un territoire et de développement
local a eu un rôle essentiel.
Conscientes de l'évolution du contexte où la valorisation du
patrimoine est désormais perçue comme un élément
d'attraction essentiel pour le territoire, et où l'attractivité
culturelle est un atout dans les décisions d'implantation des acteurs
économiques
(291(
*
))
, les
collectivités locales ont largement investi le domaine de la culture.
Elles en sont devenues les premiers financeurs publics et sont désormais
des
pôles d'innovation culturelle
, l'Etat perdant peu à peu
son rôle moteur
(292(
*
))
.
b) La mobilisation de moyens importants
Dans le
domaine de la culture, les collectivités locales ont fourni un
effort
financier considérable
.
Les services culturels municipaux ont connu une rapide montée en
puissance. En 1982, 77 % des communes de plus de 30 000 habitants et 65 % des
villes d'une taille inférieure avait une délégation
culturelle. En 1985, on recensait 120 offices culturels dans les villes de plus
de 9 000 habitants.
En 1993, les dépenses culturelles des communes se sont
élevées à 30,5 milliards de francs. Les communes de plus
de 10 000 habitants ont presque
quadruplé
leurs dépenses
culturelles entre 1978 et 1990, soit une progression de 93 % en termes
corrigés de l'inflation. Les communes plus modestes ont également
renforcé leurs efforts en faveur du développement culturel. Ces
efforts se traduisent par un
important accroissement de l'offre culturelle
publique locale.
Les dépenses des grandes municipalités soulignent
également l'importance des moyens mis au service de la culture. On
constate que seules deux grandes municipalités consacraient moins de 10
% de leur budget à la culture en 1993. Enfin, l'investissement
représentait 26 % de la dépense culturelle des communes en 1993,
les villes modestes et les villes périphériques investissant
proportionnellement plus que les villes-centres.
Pour leur part, les départements dépensent en moyenne 5,4
milliards de francs par an pour la culture, soit près de 100 francs par
habitant et 2,7 % de leurs dépenses totales. De 1975 à 1993, la
dépense totale des conseils généraux dans le secteur
culturel a plus que
quintuplé
en francs constants.
Les régions métropolitaines dépensent en moyenne 1 500
millions de francs pour la culture, soit environ 26 francs par habitants et 2,4
% des budgets régionaux. Depuis 1976, les crédits
régionaux alloués à la culture ont été
multipliés par douze en francs constants. Depuis 1988, cette progression
s'est cependant ralentie et s'est stabilisée autour d'un rythme annuel
de 5 %.
La comparaison des volumes de dépenses consacrées respectivement
par l'Etat et les collectivités locales au financement de la culture met
en exergue le dynamisme de ces dernières.
Elles dépensent
près de deux fois plus que l'Etat dans le domaine de la culture
ainsi que l'indique le schéma suivant :
LES
DÉPENSES CULTURELLES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
(
en
milliards de franc non comprises les autorisations de programme)
Ensemble des collectivités publiques
|
|
|
|
59,4 M |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
Etat Collectivités territoriales
|
|
22 M |
|
|
|
37,4 M |
|
|
|
37 % |
|
|
|
63 % |
|
Ministère Autres ministères
Régions Départements Communes
de la culture
|
13,1 M |
|
8,9 M |
|
|
1,5 M |
|
5,4 M |
|
30,5 M |
|
22 % |
|
15 % |
|
|
2,5 % |
|
9,1 % |
|
51,4 % |
c) Des politiques innovantes, adaptées aux besoins locaux
Les
collectivités locales sont en mesure d'apporter des réponses aux
aspirations nouvelles des populations
, jeunes notamment, d'une
manière différente de celle de l'Etat, qui pour sa part semble
avoir du mal à adapter ses interventions aux évolutions de la
société.
Le champ d'intervention des collectivités locales a évolué
depuis les lois de décentralisation, s'attachant, outre les secteurs
traditionnels, tels que le spectacle vivant et les arts plastiques, à
développer les pratiques en amateur et l'éducation artistique et
culturelle. De même, les collectivités territoriales assument
l'essentiel des dépenses en matière de culture scientifique,
technique et industrielle, alors que l'Etat a du mal à pérenniser
ses projets dans ce domaine. Les collectivités territoriales ont
également un rôle moteur dans le soutien aux musiques actuelles
amplifiées, à la musique traditionnelle et dans le secteur du
multimédia.
2. L'emprise de l'Etat
a) L'instrumentalisation des financements croisés
Le
système de financement des actions culturelles est d'une
grande
complexité
. Il présente certes l'avantage de permettre la
réalisation d'investissements d'équipements trop coûteux
pour une seule collectivité publique. Mais de nombreux
observateurs
(293(
*
))
constatent que l'une des
parties contractantes, le plus fréquemment l'Etat, devient prescripteur
des dépenses de l'autre, alors qu'elles sont liées par un accord
de cofinancement.
L'Etat instrumentalise les financements
croisés
: au titre d'une participation financière
très minoritaire, les services centraux s'octroient la direction des
projets culturels, notamment dans le domaine de l'enseignement musical
spécialisé. De même, le dysfonctionnement des fonds
régionaux pour l'art contemporain (FRAC) qui auraient dû
être le lieu d'un partenariat décentralisé entre l'Etat et
les régions montre que l'Etat suscite des partenariats
déséquilibrés, impliquant des contributions
financières des collectivités locales, alors qu'il conserve la
maîtrise de la politique culturelle menée dans ce cadre.
Il semble que l'on ait atteint les
limites de la contractualisation et du
cofinancement
et que le système actuel aboutisse à une
mauvaise adéquation entre la nature des activités, leur mode de
financement, et le niveau territorial qui en est responsable. Ainsi
l'inventaire est une compétence de l'Etat qui est majoritairement
financée par les départements, qui l'utilisent dans le cadre de
leur politique culturelle. Dans certains domaines, il semble donc qu'un
transfert de compétences et des ressources aux collectivités
locales permettrait une
meilleure lisibilité
et une
plus
grande proximité
entre le décideur et l'expression des
besoins.
b) Les obstacles à la déconcentration
Malgré des annonces répétées, la
déconcentration de la gestion des crédits du ministère de
la culture s'est faite
très lentement
. Le taux de 30 % de
crédits déconcentrés que le Premier ministre avait
fixé comme objectif à la fin de 1995 n'était pas atteint
à cette date. On estime aujourd'hui que la part des crédits
déconcentrés varie de 15 à 30 % selon les secteurs
concernés.
C'est sans doute dans ce domaine que les efforts les plus importants restent
à faire, afin que les collectivités locales puissent s'adresser
à un interlocuteur unique et que les directions régionales des
affaires culturelles (DRAC) puissent disposer d'une plus grande autonomie, pour
d'adapter leurs interventions aux particularités locales.
Le récent rattachement des services départementaux de
l'architecture et du patrimoine (SDAP) au ministère de la culture a
rendu la situation plus complexe encore. En effet, les directions
régionales de l'environnement, dont dépendaient auparavant les
SDAP, conservent aujourd'hui encore certaines compétences, notamment en
matière de suivi de la profession des architectes. De plus, la
difficulté d'établir des liens de subordination entre les SDAP au
niveau départemental et les DRAC au niveau régional
pénalise largement la mise en oeuvre des politiques culturelles
locales
(294(
*
))
.
De même, les collectivités locales se heurtent à la
multiplicité des acteurs
intervenant dans le domaine des
pratiques amateurs, de la jeunesse et de l'action culturelle dans les
quartiers. Outre le ministère de la culture, interviennent en effet dans
ces secteurs le ministère de la ville et le ministère de la
jeunesse et des sports, par le biais des directions de la jeunesse et de
l'éducation populaire.
L'attachement des services centraux à leurs compétences dans le
secteur culturel, très lisible et valorisant, constitue sans doute l'un
des obstacles les plus difficiles à surmonter, pour mettre en oeuvre une
déconcentration efficace, adaptée au
dynamisme
et à
l'efficacité
des collectivités locales dans les
différents domaines culturels.
VI. LE SPORT
A. AVANT LA DÉCENTRALISATION : DÉJÀ UN TERRAIN DE CHOIX POUR L'INITIATIVE LOCALE
Les communes furent les premières collectivités publiques à investir le domaine sportif. Incitées par l'Etat à renforcer leur action, elles ont rapidement développé des outils et des politiques autonomes.
1. Développement des équipements
Les
communes se sont intéressées au sport par le biais des
équipements sportifs
, qu'elles ont construits à partir des
années trente.
L'Etat, pour remédier au retard de la France dans le domaine des
installations sportives, engage un programme d'équipement, qu'il finance
à parité avec les communes, pour un montant total de 63 millions
de francs. Cette politique d'implantation d'équipements sportifs sur le
territoire se poursuit, par le biais, dès 1946, des grilles
d'équipements puis des lois de programmes d'équipements sportifs
et socio-éducatifs, prises au cours des IV
éme
et
V
ème
Plans.
Dès les années soixante-dix, cependant, cette politique subit ses
premiers infléchissements. Sous l'effet de la diversification des
pratiques sportives et de la crise économique, l'Etat perd
progressivement son rôle d'impulsion. Après 1968 le budget de
l'Etat consacré au sport diminue régulièrement, alors que
les communes continuent leurs efforts et renforcent leurs moyens, financiers et
humains, pour mener à bien des politiques autonomes.
2. Création des services municipaux des sports
Les
communes ont été incitées, dès la
Libération, à créer des offices municipaux des sports
(OMS), puis des services municipaux des sports. Dans ce domaine
également, le rôle moteur de l'Etat s'est peu à peu
réduit,
laissant l'initiative aux communes
.
Rapidement, les communes concluent que ce n'est pas aux OMS, associations de la
loi 1901, de prendre la responsabilité de la gestion des installations
sportives et créent les premiers services municipaux des sports à
la Libération. Compléments naturels des OMS, ils ont en charge la
gestion des équipements sportifs et des deniers communaux alloués
au sport.
Cette tendance est renforcée par l'obligation faite aux communes, par la
loi n° 51-662 du 24 mai 1951, de "
faire surveiller d'une
façon constante par du personnel qualifié, titulaire du
diplôme d'Etat, toute baignade d'accès payant pendant les heures
d'ouverture au public
". Au fur et à mesure qu'elles
construisent des équipements sportifs, les villes se dotent ainsi de
services des sports.
La dernière intervention de l'Etat dans ce domaine date de la fixation
du tableau indicatif des emplois communaux
(295(
*
))
,
dès lors les communes vont multiplier leurs services des sports de
façon plus autonome.
3. Les départements
Les
premières interventions des départements dans le domaine sportif
sont également antérieures aux lois de décentralisation.
Certains conseils généraux n'ont pas attendu l'intervention du
législateur de 1982 pour engager une
véritable politique
départementale du sport
, dès les années soixante.
Quelques conseils généraux ont créé des conseils
départementaux des sports à vocation consultative, d'autres ont
recruté des animateurs sportifs cantonaux, afin de développer
l'animation sportive en milieu rural.
B. LES LOIS DE DÉCENTRALISATION ET LA LOI " SPORT " : LES SILENCES DU LÉGISLATEUR SUR LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
1. Le sport : un domaine oublié par les lois de décentralisation
Le sport
est l'un des rares domaines qui ne fasse l'objet d'aucun article dans les
différentes lois de décentralisation. Tout au plus, la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 comportait-elle une section relative
à l'environnement et à l'action culturelle, faisant état
des
promenades
et des
randonnées
.
En fait, les seules dispositions concrètes mais implicites relatives au
sport concernent la répartition des charges des équipements
scolaires, et par conséquent des équipements sportifs scolaires,
entre les différents niveaux de collectivités
(296(
*
))
. Ces dispositions peu précises ont d'ailleurs
donné lieu à des difficultés dans la détermination
de la compensation relative à la mise à disposition des
équipements communaux pour les élèves des collèges
et des lycées.
Il a d'ailleurs fallu attendre une circulaire du 9 mars 1992 pour que soient
définies les modalités de ce transfert de compétence. Les
charges de fonctionnement relèvent du budget des établissements,
alors que les investissements se rapportent à la construction, et sont
à la charge des collectivités locales.
2. La loi sport du 16 juillet 1984
Le
silence des textes relatifs à la décentralisation n'est pas
compensé par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives.
Il avait été envisagé, lors de la préparation de ce
texte de
spécialiser les compétences
de chaque
catégorie de collectivités territoriales dans le domaine sportif.
La région aurait reçu compétence en matière de
formation et de développement du sport de haut niveau, le
département en matière d'action sociale et d'insertion par le
sport et la commune en matière d'animation et de développement
des activités physiques et sportives.
Les quelques dispositions relatives aux collectivités territoriales qui
sont en fait prévues par la loi de 1984 n'ont, au moins dans sa version
initiale,
aucune valeur impérative
. Si les collectivités
locales font le choix de développer ce domaine de leur action, elles
doivent le faire en respectant la réglementation prévue par la
loi. En matière d'équipements sportifs, elles devront se
soumettre à l'homologation, et elles seront contraintes d'observer la
réglementation concernant l'enseignement, l'encadrement et l'animation
des activités physiques et sportives.
3. Les modifications successives de la loi " sport "
Quelques
aménagements et précisions ont été apportés
en matière d'exercice des compétences dans le domaine du sport
par les modifications successives de la loi du 16 juillet 1984.
La réforme de 1992
(297(
*
))
précise
notamment les modalités de collaboration entre les collectivités
territoriales et l'Etat. Les services déconcentrés de l'Etat
peuvent ainsi apporter leur soutien technique aux collectivités
territoriales, dans la mise en oeuvre de projets de développement
économique et social, sur la base d'une convention passée entre
les deux parties.
La loi du 16 juillet 1984 a également été modifiée
en vue "
d'adapter les statuts actuels des clubs sportifs
professionnels français aux nouvelles conditions financières du
sport professionnel de haut niveau en Europe
". Les modifications,
introduites en 1994
(298(
*
))
et
pérennisées en 1999
(299(
*
))
, tendent
à permettre aux collectivités territoriales d'octroyer des
subventions aux clubs sportifs dans des conditions précises (relatives
aux plafond, convention, et modalités d'utilisation de ces subventions).
Cette disposition étend certes le champ d'action des
collectivités territoriales, mais constitue également un
moyen
de pallier les carences financières de l'Etat
.
Enfin, une nouvelle réforme de la loi du 16 juillet 1984 est
actuellement soumise au Parlement. Certaines dispositions concernent
directement les collectivités territoriales, mais cette fois encore,
l'
occasion d'éclaircir les responsabilités des acteurs locaux
dans le domaine sportif a été négligée
. Seules
quelques mesures précisent les obligations des collectivités
locales en matière de construction d'équipements sportifs
scolaires, et confient au département une nouvelle responsabilité
dans le domaine des sports de nature. Le conseil général devra
ainsi établir un plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée, et un plan départemental des espaces,
sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Il est regrettable qu'aucune compensation financière ne soit
prévue comme corollaire de ces nouvelles responsabilités.
La répartition historique des compétences,
caractérisée par la prépondérance des communes, n'a
donc pas été bouleversée par les différents textes
de loi précités. En revanche, on peut estimer que le mouvement
général de décentralisation a incité les
départements et les régions à renforcer leur action dans
le domaine du sport, en raison notamment de la disparition de la tutelle de
l'Etat.
C. UN DYNAMISME QUI CONFIRME LA PRÉPONDERANCE DES COMMUNES
1. Un effort financier considérable
Les
crédits alloués au sport par les collectivités
territoriales ont augmenté de 1 005 % entre 1981 et
1990
(300(
*
))
.
Les communes sont les premiers financeurs publics du sport.
L'effort qu'elles consacrent au financement du sport est
en constante
augmentation
. Entre 1981 et 1989, l'effort communal a augmenté de 73
% en francs constants, s'élevant en 1989 à 22 milliards de
francs.
La principale caractéristique liée à cette augmentation
est l'évolution de la répartition des financements au profit des
dépenses de fonctionnement. La forte croissance des investissements en
équipements sportifs (décennie 1970) s'est ralentie mais a
largement contribué à l'augmentation des dépenses de
fonctionnement qui sont passées en dix ans de 60 % du budget sport
à 82 %. Ainsi, dès 1989, sur les 22 milliards de francs
consacrés au sport par les communes, 18 % concernaient des
opérations d'investissement (soit 4 milliards de francs) et
82 % étaient alloués aux dépenses de fonctionnement
(soit 18 milliards de francs).
En 1999, les communes consacrent environ 27 milliards de francs au sport. Le
sport représente 6 à 7 % du budget global des communes.
Dans les
départements
, les crédits affectés au
sport sont
stables
. Les politiques sportives peuvent sembler
relativement étrangères aux compétences traditionnelles
des départements, les conseils généraux ont cependant pris
la pleine mesure du formidable
outil d'insertion sociale
que constitue
le sport. Les crédits sportifs, qui s'élevaient à
1,08 % du budget des conseils généraux à la fin des
années quatre-vingt, représentent à la fin des
années quatre-vingt-dix, 1,06 % de ces budgets. En 1999, les
dépenses des départements consacrées au sport
s'élèvent à 2,35 milliards de francs, environ
55 % de ces crédits étant consacrés à
l'investissement, et 45 % aux dépenses de fonctionnement.
L'effort financier des
régions
en faveur du sport a
été multiplié
par dix-huit
de 1982 à 1994.
Les contributions des régions au sport représentent environ
0,87 % du budget des conseils régionaux, soit 0,75 milliard de
francs toutes régions confondues en 1999.
C'est à partir de 1986 que les régions ont recruté des
personnels, à l'image du Nord-Pas-de-Calais et de la Bourgogne, pour
développer des actions dans le domaine du sport, et ce en l'absence de
toute obligation. Les efforts des conseils régionaux sont d'ampleur
très variée. A l'heure actuelle, seule la région
Nord-Pas-de-Calais est dotée d'un service des sports et des loisirs
occupant seize agents ; dans les autres régions, deux personnes en
moyenne gèrent les politiques et actions sportives.
L'effort financier des collectivités locales en faveur du sport est
largement supérieur à celui de l'Etat, ainsi que le montre le
tableau suivant.
|
Acteurs |
Dépenses engagées
|
Pourcentage du total |
|
Etat |
14 |
31,7% |
|
Communes |
27 |
61,3 % |
|
Départements |
2,35 |
5,3 % |
|
Régions |
0,75 |
1,7 % |
|
|
Soit 44,1 |
Soit 100 % |
|
Soit toutes collectivités locales |
30,1 |
68,3 % |
Source : Ministère de la jeunesse et des sports
2. L'action relative aux équipements et installations sportives
a) Action en matière de sécurité
Le
premier pouvoir du maire dans le domaine sportif est également un devoir
et consiste à
assurer la sécurité des sportifs et du
public
, lors des entraînements et diverses manifestations sportives.
Dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale, le maire intervient, par
arrêté portant autorisation d'ouverture au public, sur les
questions de sécurité. Il fixe les conditions d'utilisation des
équipements sportifs de sa commune et les modalités des
manifestations sur la voie publique. Il engage sa responsabilité
pénale, au titre de l'infraction de coups et blessures volontaires si un
sportif ou un spectateur subit un dommage en raison d'une carence de sa part.
Il faut ajouter à cette compétence générale
prévue par l'
article R. 123-2
du code de la
construction et de l'habitation, un pouvoir de police spéciale, celle
des baignades et des activités nautiques dans une zone s'étendant
jusqu'à 300 mètres du rivage, aux termes de la loi dite
" littoral " du 3 janvier 1986.
b) Les installations sportives
L'action
des collectivités locales dans le domaine des équipements et des
installations sportives dispose d'une
forte visibilité
. Les
communes consacrent près de 50 % des crédits alloués au
sport à la construction et à l'entretien des installations
sportives.
Cet axe des politiques sportives communales, permettant la mise à
disposition des usagers, est essentiel. Les communes veillent ainsi à
offrir aux associations sportives, aux clubs sportifs, et à la
population scolaire les moyens de pratiquer leur discipline. Dans les pays
européens voisins, les clubs possèdent eux-mêmes leurs
installations et les municipalités, ou autorités
équivalentes, n'interviennent pas dans ce domaine.
Selon les représentants des services du ministère de la jeunesse
et des sports auditionnés par la mission d'information, l'association
étroite des acteurs locaux (communes, départements et
régions) aux fédérations et aux acteurs nationaux est une
particularité française, qui explique, le
développement
constant du nombre de pratiquants sportifs
et permet à la France
d'être le pays le " plus médaillé "
proportionnellement à sa population.
Cette situation est cependant remise en cause. Malgré les efforts
financiers des acteurs locaux, le patrimoine sportif, construit essentiellement
dans les années soixante-dix, et le début des années
quatre-vingt, est largement dégradé. Sa rénovation
nécessiterait environ
soixante milliards de francs
.
A cette usure, s'ajoutent les impératifs techniques et de
sécurité qui impliquent
d'importants investissements de mise
aux normes
. Outre les fréquents changements de réglementation
de la pratique des sports, décidés par les
fédérations, qui induisent de régulières et
coûteuses transformations des terrains et des stades, la loi du 13
juillet 1992 a ajouté à la loi de 1984 des dispositions relatives
à l'
homologation des enceintes sportives
. Celles-ci
définissent des
normes très contraignantes
pour les
établissements recevant du public au titre des manifestations sportives.
Les difficultés et le coût de cette mise aux normes ont
entraîné plusieurs reports successifs de la date limite à
laquelle devront être homologuées les installations sportives,
soit le 1
er
juillet 2004, aux termes du projet de loi modifiant la
loi de 1984 en cours de discussion.
Ces dispositions, indispensables, lorsqu'elles concernent la
sécurité du public et des sportifs,
limitent la marge de
manoeuvre des collectivités locales
, qui ne peuvent pratiquement
plus envisager la construction de nouvelles installations sportives.
3. Un soutien indispensable au mouvement sportif
L'action
des collectivités locales en faveur du mouvement sportif revêt
deux formes, le
soutien au sport amateur
et
le soutien au sport de
haut niveau
.
Sans les subventions municipales, la mise à disposition de personnel
communal, notamment d'emplois-jeunes, et la mise à disposition
d'installations sportives, la plupart des associations sportives seraient dans
l'incapacité de fonctionner, alors que leur
mission
d'intégration sociale
est unanimement reconnue.
Les
communes
favorisent également le développement du
sport de haut niveau, notamment
en subventionnant les clubs sportifs
. La
loi du 28 décembre 1999 a d'ailleurs pérennisé la
possibilité pour les collectivités territoriales d'accorder des
aides à ces clubs. Sans ces subventions, qui grèvent parfois
lourdement le budget des petites communes, de nombreux clubs professionnels,
dans certaines disciplines, telles que le rugby, le basket, le handball, le
hockey, et le football n'existeraient plus, incapables de compenser la perte de
ces ressources par des financements privés suffisants.
Outre la construction et l'entretien des équipements sportifs
nécessaires à l'enseignement sportif pour les collégiens,
les
départements
ont essentiellement développé des
politiques axées sur l'attribution de subventions. Ces subsides
bénéficient aux projets sportifs des communes et au
fonctionnement de grands clubs sportifs (en général
professionnels).
Les
régions
, pour leur part, soutiennent l'implantation des
pôles sportifs de haut niveau sur leur territoire. De plus, elles ont
développé des politiques de soutien au mouvement sportif.
La formation sportive est une activité plus récente. Les
régions ont en effet créé des modules de formation,
notamment pour les sportifs de haut niveau, et les personnes encadrant la
pratique du sport amateur bénévolement. Cette politique comble
certaines lacunes de la politique de formation délivrée par
l'Etat, et répond aux aspirations des sportifs.
4. Des initiatives pour les nouvelles pratiques sportives
Au-delà de leurs rôles traditionnels de soutien au
mouvement sportif et d'équipement du territoire en installations
sportives, les collectivités locales développent de
nouvelles
politiques sportives
, adaptées aux nouveaux besoins.
Au cours des quinze dernières années le sport a connu des
mutations
importantes
. Le développement du temps libre a
induit un fort accroissement de la pratique sportive et une large
diversification. La pratique individuelle du sport a considérablement
augmenté (13 millions de licenciés sur 30 millions de
pratiquants). De plus, les populations sportives se sont largement
diversifiées
et comptent désormais des adultes et des
personnes âgées.
Les collectivités territoriales ont rapidement mis en place des
réponses appropriées
à ces évolutions. Elles
ont notamment veillé à répartir les temps d'utilisation
des installations sportives, afin de permettre aux nouveaux publics d'en
disposer. Elles ont renforcé leurs politiques d'animation et de
développement sportifs, organisant notamment des manifestations
adéquates sur la voie publique pour les " nouveaux sports ",
telles que les randonnées cyclistes, ou les courses pour patineurs sur
route.
D. DES DYSFONCTIONNEMENTS QUI HANDICAPENT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LE DOMAINE DU SPORT
Dans la mise en oeuvre de leur politique sportive, les élus locaux se heurtent à deux écueils majeurs : la volatilité des normes qu'ils doivent respecter et l'absence d'un interlocuteur unique représentant l'Etat.
1. La multiplicité des services extérieurs compétents
La
répartition des compétences entre les différents
ministères contribue à multiplier le nombre des
représentants de l'Etat compétents dans un secteur précis
du domaine sportif, et par conséquent le nombre d'interlocuteurs des
collectivités territoriales. L'absence de concertation et de
coordination entre les services extérieurs de l'Etat constitue un
facteur de
complexification
et handicape la mise en place de politique
locale sportive cohérente.
Les services extérieurs du ministère de la jeunesse et des sports
ne disposent que de très peu de crédits
déconcentrés et ne peuvent intervenir dans tous les domaines
concernés par l'action sportive des collectivités territoriales.
Depuis 1982, les professeurs d'éducation physique étant
placés sous la responsabilité du ministère de l'Education
nationale et non plus sous la responsabilité du ministère des
sports, les collectivités locales souhaitant mettre en oeuvre (et
financer) des activités péri ou extra scolaires doivent obtenir
l'accord du rectorat, tout en respectant les cadres de contrat fixés
par le ministère de la jeunesse et des sports.
De même, depuis 1994, les crédits permettant la réalisation
d'équipements sportifs de proximité sont affectés au
ministère des affaires sociales et de la ville. Ces équipements
sont donc financés par les crédits du Fonds social urbain,
déconcentrés et gérés par les directions
départementales de l'équipement. Pour autant, le ministère
de la jeunesse et des sports participe toujours aux différents
politiques de requalification sociale des quartiers dégradés
ainsi qu'aux actions éducatives et de prévention en faveur des
jeunes en difficultés (qui peuvent d'ailleurs prendre la forme
d'activité péri ou extra scolaires).
Selon les actions et les projets qu'elles souhaitent développer, les
collectivités territoriales doivent parvenir à réunir et
convaincre trois ou quatre représentants de l'Etat. Les financements de
ces actions deviennent donc particulièrement
complexes
et les
responsabilités
s'entremêlent
, souvent au détriment
des élus locaux.
2. Normes et responsabilité
Les normes de sécurité et d'hygiène applicables aux installations sportives ne sont nullement remises en cause. Elles permettent souvent de résoudre des situations dangereuses et d'éviter à l'avenir des accidents graves, à l'instar des mesures régissant l'homologation des installations ouvertes au public, prises après la catastrophe de Furiani. De plus, ces dispositions législatives prévoient des délais d'adaptation permettant de répartir la charge financière qu'elles induisent sur plusieurs années. Il n'en est pas de même de toutes les normes que les collectivités territoriales doivent respecter, notamment celles qui ont une valeur infra-législative.
a) Les normes techniques
Les
fédérations sportives disposent d'un monopole absolu pour les
règles techniques relatives à leur discipline (règlement
sportif). Au-delà des règles techniques pures, les
fédérations se sont vu reconnaître
(301(
*
))
la capacité d'édicter des
normes
réglementaires
concernant les équipements utilisés
lors des compétitions sportives qu'elles organisent.
Le décret n° 93-1034 du 31 août 1993 détermine les
conditions dans lesquelles les modifications de normes peuvent intervenir. Deux
dispositions restreignent le pouvoir des fédérations : une
étude préalable à toute modification doit être
réalisée pour prévoir les conséquences
économiques, et une interdiction est prévue, empêchant les
fédérations, d'imposer un type de matériau ou de
matériel, seul le résultat obtenu devant être défini.
Ces quelques restrictions ne prévoient
aucune
périodicité
de modification des règles. Les
collectivités territoriales sont donc soumises aux
réformes
incessantes des normes
, engendrant des travaux d'adaptation multiples et
coûteux.
Enfin, il convient de rappeler que les fédérations peuvent
influencer très largement sur le pouvoir de police du maire
s'exerçant sur les installations sportives. En effet, lorsqu'un maire
décide pour des raisons de sécurité ou d'hygiène de
ne pas délivrer l'autorisation d'ouverture au public, les
représentants de la fédération appliquent une sorte de
sanction implicite, en déclarant perdante l'équipe sportive du
territoire. Cette pression, ajoutée aux pressions économiques,
conduit parfois des élus locaux à autoriser des rencontres, et
à engager ainsi leur responsabilité.
b) Les règles applicables aux personnels sportifs
Outre
son rôle de définition des conditions de recrutement du personnel
des services municipaux des sports (par l'arrêté du 16 mai 1966),
le ministère des sports enrichit régulièrement la
liste
des brevets d'Etat
nécessaires pour encadrer ou enseigner les
différentes disciplines sportives. Ces dispositions indispensables pour
la sécurité des sportifs se révèlent parfois
inadaptées aux besoins des collectivités locales
, qui ne
peuvent trouver les personnels disposant des compétences et des
qualifications requises.
Les collectivités territoriales rencontrent ainsi des difficultés
à mettre en oeuvre leur politique sportive lorsqu'elles ne peuvent
recruter le personnel nécessaire pour la mener à bien. En raison
de la multiplication des conditions de compétence et de diplôme,
et des changements fréquents de la nomenclature des brevets d'Etat
délivrés par le ministère de la jeunesse et des sports,
certaines collectivités territoriales sont contraintes de renoncer
à leurs projets.
De plus, dans certaines disciplines récentes, les brevets d'Etat
n'existent pas encore. Les collectivités territoriales hésitent
alors à recruter des personnels ayant une pratique sûre de ces
disciplines, mais dont les compétences ne sont pas sanctionnées
par un diplôme, la responsabilité de l'autorité
exécutive de la collectivité locale pouvant être
engagée en cas d'accident.
VII. LES INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
A. LA SITUATION ANTÉRIEURE À 1982 : UN CADRE JURISPRUDENTIEL RESTRICTIF
Les
collectivités territoriales sont elles-mêmes des agents
économiques de premier plan par le seul exercice de leurs
compétences traditionnelles. Les flux financiers que produit
l'accomplissement de leurs missions leur donnent une place importante dans
l'économie locale en tant qu'acheteurs comme en tant qu'employeurs. Ce
rôle économique essentiel se distingue de celui d'intervenant au
profit des entreprises du secteur marchand.
Les relations entre les collectivités locales et l'économie n'ont
longtemps été appréciées qu'à travers ce
qu'il est convenu d'appeler l'" interventionnisme économique "
c'est-à-dire le moment où la collectivité publique
intervient dans un domaine réservé à l'initiative
privée. Ces interventions sont demeurées soumises à des
conditions très restrictives sinon à une interdiction totale et
très largement définie par la jurisprudence administrative. Mais
les lois de décentralisation de 1982 ont marqué un tournant
décisif en reconnaissant et en confirmant les capacités
d'intervention des collectivités locales dans le secteur
économique.
Auparavant, les interventions économiques des collectivités
locales évoluaient dans un
cadre jurisprudentiel restrictif
.
Dans de nombreux avis ou décisions du Conseil d'Etat, apparaissent
plusieurs préoccupations : souci de
ne pas fausser les
règles du droit commercial
et en particulier celles qui concernent
la faillite ; souci de
respecter les règles de la
concurrence
qui se trouveraient violées si des aides publiques
pouvaient être attribuées à des entreprises
privées ; nécessité de
sauvegarder les finances
locales
contre les risques financiers encourus dans une gestion de type
privé.
Le juge administratif considérait que seules des
circonstances
particulières
de temps et de lieu ou un
intérêt
public local
pouvaient
justifier une intervention des
collectivités locales
.
Mais les
premières transformations
apportées par le
Conseil d'Etat à sa position traditionnelle ont été
progressivement élargies
: ainsi a-t-il été
admis qu'une commune crée un service dès lors que son prix
était plus modique et ses conditions plus favorables que ceux du secteur
privé (
Syndicat des exploitants de cinématographes de
l'Oranie, 12 juin 1959
) ; quant à la notion
d'intérêt public local, elle a été élargie
des besoins primordiaux aux besoins les plus divers.
Allant encore plus loin, le Conseil d'Etat a admis des interventions des
collectivités locales justifiées par leur nature même,
parce qu'elles se rattachent à un service public de nature
administrative : création par une commune d'un service de
consultation juridique à l'occasion de la réalisation d'un
lotissement (
Sect. 23 décembre 1970, préfet du Val-d'Oise
et ministère de l'intérieur contre commune de Montmagny
).
Dans le domaine des services publics industriels et commerciaux, la Haute
Juridiction a considéré qu'un tel service pourrait être
assuré dans le cas où il constitue le prolongement d'un service
existant. Poursuivant cette évolution, le Conseil d'Etat en est venu
à admettre des aides directes
aux entreprises en vue du
développement économique.
B. LES LOIS DE DÉCENTRALISATION : PRINCIPES ET LIMITES
La
loi n° 82-213 du 2 mars 1982
autorise explicitement pour la
première fois les collectivités locales à intervenir en
faveur des entreprises. Son
article 5
dispose, en effet, que
" la commune peut intervenir en matière économique dans
les conditions prévues au présent article ".
Dans le même esprit, la
loi n° 83-8 du 7 janvier
1983
, relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat, dispose
dans son
article premier
que ces mêmes collectivités
règlent par leurs délibérations les affaires
d'intérêt local :
" A ce titre, elles concourent avec
l'Etat à l'administration et à l'aménagement du
territoire, au développement économique, social et culturel,
ainsi qu'à la protection de l'environnement et à
l'amélioration du cadre de vie ".
De plus, la loi n° 83-645 du 13 juillet 1983, définissant
les choix stratégiques, les objectifs et les grandes actions du
développement de la Nation pour le IX
e
Plan reconduit
les règles établies par le plan intérimaire en ce qui
concerne les interventions économiques des collectivités locales,
sous réserve, en cas de besoin d'un réexamen à mi-parcours.
Dans le même temps, la liberté des collectivités locales
était renforcée par la suppression de tous contrôles
a
priori
remplacés par une possibilité de recours
juridictionnel dans le seul cas de violation de la loi.
La nouvelle législation établit une distinction entre, d'une
part, les interventions proprement dites en faveur du développement
économique et, d'autre part, l'aide aux entreprises en difficulté
et la protection des intérêts économiques et sociaux.
S'agissant de
l'action en faveur de l'intervention économique,
la
loi distingue entre les
aides directes,
limitativement
énumérées et strictement encadrées, et les
aides
indirectes
, en principe libres, car elles sont censées ne pas
profiter à l'entreprise en établissant un lien financier entre
elles et la collectivité qui les accorde.
L'aide aux entreprises en difficulté et la protection des
intérêts sociaux
est également libre, sous
réserve de conditions peu contraignantes. En particulier, les conditions
et les modalités de l'aide doivent être formalisées par une
convention conclue entre la collectivité et l'entreprise, et il ne peut
être pris aucune participation dans le capital d'une
société commerciale hormis les sociétés
d'économie mixte locales et, pour les régions, les
sociétés de développement régional et les
sociétés de financement.
Hormis les conditions particulières propres à telle ou telle
catégorie d'aides, le législateur, principalement sous
l'influence du Sénat, a établi
trois grandes limites
de
principe à la nouvelle liberté des collectivités
locales :
- la première limite concerne le
respect des compétences
de l'Etat
: ce dernier "
a la responsabilité de la
conduite de la politique économique et sociale ainsi que la
défense de l'emploi
" ;
- la deuxième tient à la réaffirmation du principe
selon lequel l'intervention économique des collectivités locales
s'exerce "
sous réserve du
respect de la liberté du
commerce et de l'industrie
et du
principe de l'égalité
des citoyens devant la loi
" ;
- enfin, les interventions économiques des collectivités
locales doivent respecter "
les règles de
l'
aménagement
du territoire
".
S'ajoute à ces limites de droit interne l'exigence de la
compatibilité des aides
des collectivités locales avec les
dispositions du
droit communautaire
relatives aux aides publiques,
en
particulier l'article 92 du Traité de Rome
, lequel dispose que
" sauf dérogations prévues par le Traité, sont
incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles
affectent les échanges avec les Etats membres, les aides
accordées par les Etats, ou au moyen de ressources d'Etat, sous quelque
forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en
favorisant certaines entreprises ou certaines productions ".
Les aides
des collectivités locales sont assimilées à des aides de
l'Etat.
C. LE DISPOSITIF RÉSULTANT DE LA NOUVELLE LÉGISLATION
1. L'action en faveur du développement économique
L'action
en faveur du développement économique regroupe les interventions
en direction des entreprises et de leur environnement, afin de favoriser la
création et l'extension des entreprises.
Faute d'être dégagé par la loi elle-même,
le
critère de distinction entre aides directes et aides indirectes
l'a
été par la juridiction administrative
302(
*
)
: l'aide directe
se traduit par la mise
à disposition de
moyens financiers
à l'entreprise
bénéficiaire, avec une conséquence comptable
(immédiate ou potentielle) dans son compte de résultats.
Quant aux
aides indirectes
, elles recouvrent toutes les autres formes
d'aides consistant soit à mettre à la disposition des entreprises
des biens immeubles, soit à améliorer leur environnement
économique et à faciliter l'implantation ou la création
d'activités.
a) Les aides directes au développement économique
L'utilisation par les collectivités locales des aides
directes en faveur du développement économique s'effectue sous
une quadruple contrainte.
Première contrainte
, ces aides sont
limitativement
énumérées
par la loi (art. 4 de la loi n°
82-6 du 7 janvier 1982). Il s'agit de la
prime régionale à la
création d'entreprises,
de la
prime régionale à
l'emploi
,
de prêts, avances et bonifications
d'intérêts.
Aucune forme nouvelle d'aide directe ne peut être envisagée en
dehors de ces dispositions, sous réserve d'une habilitation
législative expresse donnée aux collectivités
locales
303(
*
)
.
Deuxième contrainte
, le régime des aides directes se
caractérise par la prééminence conférée
à la région dans la loi du 2 mars 1982 : les initiatives
éventuelles des départements et des communes sont ainsi
subordonnées à
l'intervention préalable de la
région.
Cette prééminence de la région comporte trois
conséquences pour les autres collectivités :
- les communes et les départements ne peuvent que compléter
l'aide régionale lorsque celle-ci n'atteint pas le plafond fixé
par décret ;
- elles ne doivent intervenir que dans les zones et les secteurs
d'activités retenus par le conseil régional (
art. L 1511-2 al.
2
du code général des collectivités
territoriales) ;
- elles ne peuvent accorder une aide directe à une entreprise que
si la région a décidé, au préalable, de lui
octroyer une aide.
Toutefois, la région ne peut rien faire qui s'apparenterait à une
mise sous tutelle
des départements et des communes.
Troisième contrainte
, ayant trait à la forme, l'octroi des
aides directes résulte, pour toutes les catégories d'aides, d'une
décision de l'exécutif local
prise en exécution
d'une délibération de l'assemblée locale. C'est une
compétence qui ne peut faire l'objet d'aucune délégation.
Quatrième et dernière contrainte
, de pure logique, les
aides directes destinées aux entreprises ne peuvent être
versées que si l'entreprise se trouve dans une situation
régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Ces contraintes s'appliquent aux différentes aides directes, que l'on
peut regrouper en deux catégories : d'une part les primes, d'autre
part les prêts, avances et bonifications d'intérêts.
La
prime régionale à l'emploi (PRE)
est accordée
aux entreprises ayant pour objet l'une des activités
déterminées par le conseil régional et réalisant
une création, une extension ou une reconversion. Son montant varie de
10 000 F à 20 000 F par emploi, dans la limite de
trente emplois (il est de 40 000 F dans les zones de montagne et dans
celles ayant bénéficié de l'ancienne aide spéciale
rurale). La PRE ne peut être cumulée avec la prime
d'aménagement du territoire (PAT).
La
prime régionale à la création d'entreprises
(PRCE)
a un montant forfaitaire, à la différence de la
précédente : d'un montant maximum de 150 000 F,
elle peut être accordée aux entreprises ayant pour objet l'une des
activités définies par le conseil régional, qui s'engagent
à créer un certain nombre d'emplois.
Les primes sont donc encadrées par des dispositions strictes. En outre,
la prime à la création d'entreprise est réservée
aux entreprises créées depuis moins d'un an, la prime
régionale à l'emploi à celles dont le chiffre d'affaires
ne dépasse pas 300 millions de francs. Les emplois
créés doivent être à durée
déterminée.
Les
prêts, avances et bonifications d'intérêts
,
accordés à des conditions plus favorables que celles du
marché font l'objet d'une
réglementation uniforme
, qui ne
varie pas en fonction d'un zonage géographique
304(
*
)
. Il doit s'agir de
prêts à long
terme
, impliquant des
créations d'emplois
(jusqu'à 30
pour une création d'entreprise) et respectant un
écart
maximum
avec le taux moyen du marché des obligations
305(
*
)
. Les avances ne comportant pas paiement d'un
intérêt sont interdites.
b) Les aides indirectes
Contrairement aux aides directes, les aides indirectes sont
libres
. Les trois catégories de collectivités locales
(communes, départements, régions) sont donc placées sur un
pied d'égalité pour octroyer, seule ou conjointement, des aides
indirectes en faveur du développement économique.
Cette liberté autorise un foisonnement d'initiatives :
promotion
et aides à la
commercialisation de produits
,
conseil en gestion
, actions en faveur de
l'immobilier d'entreprises,
crédit bail immobilier,
toléré de manière
exceptionnelle, en particulier dans le domaine du commerce et de l'artisanat.
Une première exception à cette liberté concerne les
rabais consentis sur les loyers ou les prix de vente d'un bâtiment
qui ne sont autorisés que dans des conditions strictes.
La liberté des collectivités locales est également
fortement encadrée en matière de
garanties d'emprunts
, en
raison de l'utilisation massive par les collectivités locales de ce
procédé, qui n'entraîne pas de charge immédiate pour
celles-ci mais peut se révéler très lourd de
conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur
306(
*
)
. A la règle initiale du plafonnement des
engagements, le législateur a ajouté des règles
prudentielles nouvelles
307(
*
)
concernant les
garanties accordées à des personnes privées
308(
*
)
pour les emprunts qu'elles souscrivent.
Autre limite à la marge d'initiative des collectivités locales,
elles ne peuvent, en principe, sauf autorisation par décret en Conseil
d'Etat, prendre de participation dans le
capital de sociétés
commerciales
autres que les SEM. Cependant, afin de faciliter la
mutualisation des risques et de limiter les conséquences
financières des aléas assumés par les collectivités
locales, la loi les autorise à participer au capital de
sociétés anonymes ayant pour objet exclusif de garantir des
concours financiers octroyés à des personnes de droit
privé, notamment à des entreprises nouvellement
créées. Les modalités de constitution et de fonctionnement
de ces
sociétés de garantie
ont été
fortement encadrées par le décret n° 88-491 du
2 mai 1988.
2. La protection des intérêts économiques et sociaux de la population
Cette protection constitue le second volet de l'intervention économique des collectivités locales ; elle recouvre les aides aux entreprises en difficulté, les actions destinées à assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et subsidiairement les aides en faveur des entreprises exploitant un cinéma.
a) Les aides aux entreprises en difficulté
Le
régime actuel de ces aides se caractérise selon l'origine de
celles-ci : interdites lorsqu'elles proviennent des communes, elles sont
autorisées lorsqu'elles émanent des départements ou des
régions.
En ce qui concerne le
département
(alinéas 1 et 2 de
l'
article
L. 3231-3
du code général des
collectivités territoriales), les aides aux entreprises en
difficulté, qui ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de
redressement, ne sont pas subordonnées à une intervention
préalable de la région et sont prévues en des termes
extrêmement larges. Il n'y a pas en la matière la distinction
entre aides directes et indirectes qui existe à propos des aides
économiques ; toutefois, une exception vise la prise de
participation au capital d'une société commerciale, interdite en
l'absence d'autorisation par décret en Conseil d'Etat, même dans
le cas d'une entreprise en difficulté.
Quant à la
région
, sa compétence est affermie par
l'
article
4211-1-6°
du code général des
collectivités territoriales.
Elle a pour mission, dans le respect des attributions des départements
et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces
collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement
économique, social et culturel de la région par toutes
interventions dans le domaine économique, dans les mêmes
conditions et limites que celles prévues pour le département et
après consultation préalable des conseils municipaux et des
conseils généraux concernés.
La circulaire n° 82-102 du 24 juin 1982 du ministère de
l'intérieur et de la décentralisation a précisé que
la notion de protection des intérêts économiques et sociaux
de la population
" doit être interprétée à
la lumière des circonstances propres de chaque affaire, une certaine
proportion devant exister entre l'importance de la collectivité
concernée et la gravité des conséquences
prévisibles du sinistre qui pourrait se produire faute d'une tentative
de sauvetage de l'entreprise ".
La même circulaire a tenté de donner quelques critères,
juridiques et économiques, destinés à guider les
élus dans leurs interventions.
• Critères juridiques :
Ce sont la cessation de paiement, le dépôt de bilan, la suspension
provisoire des poursuites, le règlement judiciaire. Ces critères
ont l'inconvénient de ne pouvoir être constatés qu'une fois
la situation gravement détériorée. C'est pourquoi il
convient de les compléter par des critères économiques
dont l'évolution est plus progressive.
• Critères économiques :
Il s'agit de baisses du carnet de commandes, d'incidents de paiement des
cotisations sociales, de chômage technique ou de mesures de licenciement.
L'aide
de la collectivité est
subordonnée
, on l'a
vu, à la
conclusion
d'une
convention
prévoyant les
mesures nécessaires au renflouement de l'entreprise.
b) Le maintien des services nécessaires à la population
Les
articles L. 2251-3, L. 3231-3 et L. 4211-1 (6°)
du
code général des collectivités territoriales qui trouvent
leur source dans les articles 5 et 66 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 modifiés par la loi n°88-13 du 5 janvier
1988) autorisent respectivement les communes, les départements et les
régions à accorder des aides directes et indirectes, lorsque
cette intervention a pour but
" d'assurer le maintien des services
nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en
milieu rural et que l'initiative privée est absente ou
défaillante ".
L'intervention des collectivités locales est donc subordonnée
à
trois conditions
:
- elle doit porter sur un service nécessaire à la
satisfaction des
besoins de la population
, sans qu'il s'agisse
nécessairement d'un service public. Peuvent être aidées
toutes sortes d'activités publiques ou privées dès lors
qu'elles concourent à satisfaire des besoins de la population :
stations-service, hôtels, restaurants, magasins d'alimentation,
débits de tabac ou de boissons, etc. ;
- le service concerné doit être nécessaire à la
satisfaction des
besoins de la population en milieu rural
(notion plus
large que la notion de commune rurale qui est limitée aux communes de
moins de 2.000 habitants) ; peuvent être pris en compte non
seulement les besoins de la population résidente mais aussi ceux de la
population de passage ;
- l'initiative privée
doit être
défaillante
.
Ces interventions obéissent aux règles applicables aux actions en
faveur des entreprises en difficulté.
c) Les subventions des communes aux entreprises exploitant un cinéma
Prévue à l' article L 2251-4 du code général des collectivités territoriales qui reprend les dispositions de l'article 5 § IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, cette intervention concerne les communes rurales . Elle s'adresse aux entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation des salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion des entreprises spécialisées dans la projection des films visés à l'article 279 bis du code général des impôts. Elle est subordonnée aux stipulations d'une convention entre l'exploitant et la commune.
D. LE BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF
Les
interventions économiques des collectivités territoriales sont
mal connues parce que leur recensement n'est ni complet ni fiable. D'autre
part, le phénomène lui-même est mal encadré, car les
règles communautaires sont difficiles à assimiler, peu suivies et
rarement contrôlées. Quant aux règles nationales mises en
places depuis 1982, elles sont apparues en décalage avec les
réalités locales, au point que des réformes ont
été envisagées dès 1988 sans jamais pourtant
être conduites à terme.
Il est difficile aujourd'hui encore de recenser les instruments de mesure des
aides accordées par les collectivités territoriales. En revanche,
il est plus aisé de percevoir les écarts de pratique entre les
collectivités et l'assouplissement de fait imposé au cadre
juridique communautaire et national. On distingue mal la combinaison entre les
interventions de l'Union européenne et celles de l'Etat et entre ce
dernier et les autres niveaux d'administration décentralisée.
Trois aspects de cette tentative de bilan se dégagent toutefois.
• Les aides des collectivités territoriales aux entreprises sont
restées modérées (rapportées au montant de leurs
dépenses) mais elles n'ont fait que se développer et se
diversifier.
• Le cadre juridique communautaire et national éclate sous le coup
des nécessités pratiques.
• L'efficacité de ces interventions reste difficile à
mesurer.
1. Le développement constant des aides aux entreprises
Les
interventions des collectivités territoriales se sont
intensifiées sous l'effet de plusieurs facteurs : le déclin
ou la disparition d'activités industrielles traditionnelles, les
restructurations entraînées par l'introduction des techniques
nouvelles de production ou de gestion des entreprises, l'accentuation de la
concurrence et la mobilité accrue des entreprises.
Les collectivités territoriales ont donc été soit
contraintes d'intervenir (déclin, restructuration) pour lutter contre le
chômage, soit tentées de le faire (accentuation de la concurrence,
mobilité accrue) pour provoquer une décision d'implantation.
a) Il n'est pas aisé de mesurer l'importance des aides accordées.
Le
recensement quantitatif des interventions économiques des
collectivités locales se révèle par nature :
•
incomplet
: depuis 1991, seules les collectivités de
plus de 5.000 habitants sont prises en compte au lieu de celles de 700
habitants auparavant. Or, les communes de moins de 5000 habitants regroupent
40% de la population et 95% des communes ;
• peu fiable
: les définitions des catégories
d'aides diffèrent selon les caractéristiques retenues par le
ministère des finances et la loi, en particulier pour ce qui concerne la
distinction entre aides directes et indirectes.
Toutefois, un bilan quantitatif des interventions économiques des
collectivités locales peut être fait globalement puis par secteur
d'activité, nature de collectivités et par nature des aides
accordées.
à
Le bilan global : une part réduite dans les budgets
locaux
Entre 1984 et 1994, les
aides au développement économique
accordées par les collectivités locales au secteur privé
ont
triplé
(4,4 milliards de francs à 14,3 milliards de
francs) pour se stabiliser ensuite (13,8 milliards de francs en 1998).
Elles représentent en 1984 comme en 1998 la quasi-totalité des
interventions économiques des collectivités locales (95,9 %
et 99,5 %). Au regard de leurs dépenses totales, les aides
représentent une part minime de l'effort des collectivités
locales : 1,50 % pour les communes, 1,60 % pour les
départements et 5,15 % pour les régions en 1998. La prudence
des collectivités locales et l'interdiction faite aux communes par la
loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'aider les entreprises en
difficulté explique ce phénomène.
Au total des aides accordées par les collectivités locales, il
faut ajouter les
garanties d'emprunts
dont l'encours s'élevait
à 235 milliards de francs en 1998. Les communes interviennent pour
62 % dans l'encours des garanties d'emprunts et le logement
représente 93 % de cet encours.
à
Les collectivités concernées : la
prédominance des régions
En 1998, la part des communes et groupements représente près de
la moitié (47,1 %) des interventions des collectivités
locales et celle des départements le quart (25,2 %). La part des
régions qui atteignait en 1994 40,9 % des interventions a
diminué (27,7 % des interventions en 1998).
Toutefois, cette analyse doit être mesurée à l'aune des
moyens budgétaires de chaque collectivité ; ainsi les
interventions économiques représentaient, en 1994, 4,7 % des
dépenses d'équipement des communes, 5,2 % de celles des
départements et 10,3 % de celles des régions.
à
La répartition par secteur d'activité : l'industrie,
le commerce, l'artisanat et le logement en tête
Deux grands secteurs d'activité concentrent près des deux tiers
des aides : l'industrie, le commerce et l'artisanat (40,1 %) et le
logement (23,1 %). La part de l'industrie est en diminution constante
depuis 1984 puisqu'à cette date, ce secteur représentait 50
à 55 % du total des aides.
Trois autres secteurs d'activité méritent attention :
• l'agriculture qui reçoit 11,6 % des aides et dont la part a
le plus chuté depuis 1984 (-17,4 %) Ce sont les régions qui
contribuent le plus sous formes de subventions (63,7 %) ;
• le tourisme qui, en 1998, réunit 5,1 % des aides dont
45 % en provenance des départements ; ce secteur a vu sa part
osciller entre 8 % et 5 % entre 1984 et 1998 ;
• le bâtiment et les travaux publics dont la part dans le total des
aides est de 8,4 % soit une valeur moyenne depuis 1983 ; les communes
représentent 83 % de l'effort consenti en faveur de ce secteur.
à
La nature des aides accordées : la
prééminence des aides directes
Les aides directes représentent plus de
75 % du total
des
aides (10,5 milliards de francs en 1998 soit 75,94 %) ; cette
prépondérance est encore plus marquée pour deux types de
collectivités : les départements (83,7 %) et les
régions (82,9 %).
Les secteurs qui bénéficient des aides directes étaient,
par ordre décroissant, en 1998 : logement (25,6 %), industrie
commerce et artisanat (30 %), agriculture (13,6 %), bâtiment et
travaux publics (9,5 %).
Les aides indirectes (hors garanties d'emprunts et de cautionnements) qui sont
en progression de 2,1 % en 1998 par rapport à 1997,
représentent moins d'un quart des aides des collectivités locales
(24 % en 1998) et sont essentiellement octroyées par les communes
(63,25 % en 1998).
Les prises de participation des collectivités locales dans les
sociétés mixtes locales, les sociétés de
développement régional ou autres sociétés
représentent 30,4 % des aides indirectes en 1998.
La participation aux fonds de garantie est extrêmement réduite
(1,5 % en 1998), ce qui prouve que ces fonds sont vraiment tombés
en désuétude.
b) La multiplication des initiatives, parfois au-delà du cadre légal
Les
difficultés économiques et la dégradation de l'emploi ont
provoqué, à la faveur des lois de décentralisation, une
implication directe plus forte des
élus locaux
dans le
développement, qu'elle soit volontaire ou contrainte. Ils sont
devenus des acteurs du développement très
sollicités
.
Le cadre était souple ; les collectivités ont fait preuve
d'imagination ; les aides se sont diversifiées. Finalement, le
développement des initiatives aux différents niveaux
d'administration publique a débouché sur une certaine
confusion institutionnelle
. Les objectifs des lois de
décentralisation ne se sont pas traduits dans les faits dans la mesure
où les régions auxquelles la loi avait octroyé une
compétence d'impulsion, de coordination et d'initiation,
parallèlement à celle de l'Etat, ont rarement exercé ce
rôle, en raison du caractère très localisé des
interventions Les départements ont souvent conduit leur propre
politique
.
Les contrôles des chambres régionales des comptes de même
que les enquêtes de la Direction générale des
collectivités locales, indiquent que les
aides directes
notamment
les primes régionales à la création d'entreprises (PRCE)
et les primes régionales à l'emploi (PRE) sont relativement
délaissées et que les
collectivités agissent largement
sans référence au cadre législatif de 1982
.
Les collectivités sont plutôt tentées d'accorder des
prêts et avances à taux très bonifiés ou nuls.
L'utilité économique de ces prêts à taux faible ou
nul est mise en avant par les collectivités lorsqu'ils sont
destinés à l'artisanat ou à des PME dans la mesure
où ils permettent d'accroître les capitaux permanents de ces
entreprises. Ils répondent ainsi pour partie au manque de fonds propres
des sociétés petites ou moyennes. Les collectivités se
substituent donc aux établissements bancaires sous le coup de la
nécessité.
S'agissant des
aides indirectes
, les garanties d'emprunt ou les
cautionnements apportés à des entreprises privées par les
collectivités territoriales (principalement les communes) ont un peu
décliné en nombre, mais cette diminution n'a pas
été compensée par un recours accru aux fonds de garantie
dont la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 entendait faire un instrument
de mutualisation des risques pris par les collectivités en
matière de garantie d'emprunt.
Cette loi a autorisé la participation de plein droit des régions,
des départements et des communes au capital de sociétés
anonymes ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers
octroyés à des personnes de droit privé (en 1994, seuls
cinq régions et cinq départements participaient au capital de ces
sociétés de garantie).
Les sociétés de capital-risque, qui permettent un soutien en
fonds propres aux PME-PMI afin de les aider dans leur phase de démarrage
ou de développement, rencontrent une faveur plus grande auprès
des collectivités même si ces participations restent modestes.
Les collectivités ont également développé des
actions d'animation pour la promotion économique de leur territoire, la
prospection d'investisseurs nationaux ou internationaux, le conseil et la
diffusion d'informations.
Cependant, l'essentiel des interventions des collectivités territoriales
reste concentré sur les
aides à l'immobilier
d'entreprise
et aux terrains : aménagement de zones d'activités
économiques, réalisation d'ensembles immobiliers destinés
à accueillir des entreprises, aides foncières et aides à
la construction d'immeubles destinés à des entreprises
particulières. Or, il s'avère qu'avant même de profiter
à des entreprises déterminées, ces aménagements
sont de lourdes charges pour les collectivités jusqu'à ce qu'ils
trouvent preneurs.
Enfin, d'une façon générale, les collectivités
locales ont aussi
délégué
une partie de leur
compétence dans le domaine de l'action économique en ayant
recours, au-delà même des actions de promotion et de prospection,
à des structures spécialisées de droit privé,
placées sous leur contrôle (" agences
économiques " ou " comités d'expansion ").
2. Les interventions économiques des collectivités territoriale sont-elles efficaces ?
Les
collectivités territoriales se proposent de
favoriser la
création ou l'extension d'entreprises
et plus
particulièrement de PME-PMI. A cet objectif correspondent des aides sous
forme d'avances de garanties d'emprunts, d'apports en capitaux propres ou de
primes à la création d'emplois.
Ces mesures peuvent avoir leur utilité Mais comme l'ont mis en
évidence les travaux du Sénat sur la proposition de loi
présentée par nos collègues Jean-Pierre Raffarin et
Francis Grignon, tendant à favoriser la création et le
développement des entreprises sur les territoires, les outils dont
disposent les collectivités locales pour soutenir la création de
PME-PMI, pourraient être
perfectionnés
309(
*
)
.
Les dispositifs existants de soutien à la création d'entreprises
souffrent, en effet, d'une insuffisante prise en considération des
besoins réels des petites et moyennes entreprises
En outre, les entreprises sont très attentives à un niveau
modéré de charge fiscale locale. Au-delà, il ressort de
toutes les enquêtes d'opinion auprès des chefs d'entreprise qu'ils
sont particulièrement sensibles au contexte de développement
offert par les collectivités publiques : aménagement de
l'espace, y compris de zones d'activités ; voirie et
infrastructures ; services publics de la formation professionnelle et de
l'emploi, mise en réseau des initiatives privées et publiques et
développement de synergies (par exemple, en matière de transferts
de technologie et de savoir-faire).
Autrement dit, les entreprises attendent d'abord des collectivités
territoriales, agents économiques et sociaux de premier plan, qu'elles
exercent leurs compétences propres et traditionnelles.
Les interventions économiques répondent également à
l'objectif
d'aménagement du territoire
. Certaines régions
ont moins d'atouts ou sont entrées dans une phase de déclin. En
l'absence d'intervention publique, la stagnation voire la régression
économique de ces territoires nuiront à la collectivité et
à ses membres. Il y a donc nécessité de
rééquilibrer. La loi du 4 février 1995 a
défini des " zones d'aménagement du territoire ". Il
appartient aux collectivités territoriales par les aides
économiques qu'elles accordent de renforcer les effets de cette
politique en lui apportant des moyens financiers supplémentaires.
Les collectivités territoriales veulent aussi
aider les entreprises
les plus petites à anticiper
et à financer les progrès
qualitatifs indispensables à leur survie, au maintien de leurs positions
ou à leur développement. Les outils qui correspondent à
cet objectif sont notamment les fonds d'aide au conseil, à la
communication, à l'embauche de cadres, à l'exportation.
Les
effets
sont cependant parfois
décevants.
Tout d'abord, l'
impact
sur le comportement des entreprises, qui
obéit à des lois économiques, est
incertain
. Dans
le domaine économique, les collectivités territoriales n'ont
aucune assurance d'avoir une influence déterminante sur le comportement
des entreprises pour deux raisons : la décision d'investir et de
recruter ne leur appartient pas ; les résultats obtenus peuvent
être remis en cause à court, moyen ou long terme par une multitude
de facteurs sur lesquels elles n'ont aucune prise : stratégie des
groupes internationaux, conjoncture économique, capacités de
gestion des dirigeants des entreprises aidées...
En second lieu, la
dispersion
des initiatives peut s'avérer
inefficace. La multiplicité des niveaux d'intervention (communal,
intercommunal, départemental, régional, étatique,
européen) encourage les " chasseurs de primes " et peut
provoquer de coûteux doubles emplois.
En troisième lieu, la
concurrence entre les collectivités
peut leur être préjudiciable. Les entreprises d'une taille
importante et désireuses de changer d'implantation ou de créer de
nouvelles unités peuvent, en effet, être tentées de mettre
en concurrence plusieurs collectivités françaises ou même
une collectivité française et une collectivité
étrangère.
Les collectivités territoriales prennent elles-mêmes conscience
des risques de cette concurrence. Cinq présidents de région du
Grand-Est ont ainsi signé le 15 mars 1995 une clause de
non-concurrence destinée à éviter toute
délocalisation d'une région vers une autre.
En quatrième lieu, le risque d'une
neutralisation
des politiques
d'aménagement du territoire existe. Les collectivités qui
bénéficient d'un niveau d'activité économique
supérieur, voire très supérieur, à la moyenne
nationale disposent, à pression fiscale égale et malgré
l'existence de dispositifs légaux de péréquation, de
moyens financiers beaucoup plus importants pour aider les entreprises
installées ou s'implantant sur leur territoire. Leurs interventions
risquent de neutraliser le soutien différencié que l'Etat et
l'Union européenne s'efforcent d'apporter, par leurs politiques
d'aménagement du territoire, aux zones défavorisées.
Enfin, les collectivités peuvent encourir des
risques financiers
.
Ces risques sont relatifs lorsque les sommes en cause, quoique
élevées, représentent une fraction minime du budget de la
collectivité concernée mais il est arrivé que certaines
collectivités fragiles aillent jusqu'à la cessation temporaire de
paiement.
E. UN CADRE JURIDIQUE EN DÉCALAGE AVEC LA RÉALITÉ
La
pratique des collectivités territoriales s'est souvent
écartée des règles en vigueur mais, à la
décharge de celles-ci, il convient de signaler que ces règles
soulevaient de véritables difficultés d'interprétation et
donc d'application dues à leur imprécision.
Tout d'abord, la loi de 1982 a
créé des catégories sans
les définir
: aides directes et aides indirectes.
L'administration a fini par admettre que les aides directes se traduisent par
l'octroi de moyens financiers aux entreprises bénéficiaires et
que les aides indirectes consistent, soit à louer ou vendre à des
entreprises des immeubles, soit à favoriser l'environnement
économique général, à faciliter l'implantation ou
la création d'activités économiques ou à
créer les conditions propices à un meilleur développement
économique. Cette distinction ne semble pas avoir suffi à lever
les incertitudes qui demeurent sur le régime juridique applicable.
1. Les manquements aux règles
•
Les collectivités territoriales créent des régimes
d'
aides
directes
ou versent des concours financiers aux
entreprises sans fondement juridique. Les plafonds des primes et les taux des
prêts, avances et bonification d'intérêts ne sont pas
toujours respectés. De nombreux départements accordent des aides
alors que la région ne les octroie pas.
• En matière d'
aides
indirectes
à
l'immobilier d'entreprises
, l'interdiction de consentir des rabais sur les
locations ou rétrocession aux entreprises situées dans des zones
non éligibles à la prime d'Etat d'aménagement du
territoire (PAT) n'est pas toujours respectée et, dans les zones
éligibles, le plafonnement du rabais (25 % de la valeur
vénale) est le plus souvent ignoré.
D'autre part, les collectivités territoriales, d'après la Cour
des comptes, feraient un usage abusif du crédit-bail.
• Les irrégularités concernant l'octroi des
garanties
, la participation à des
fonds de garantie
,
à des
sociétés de capital-risque
et au
capital
d'entreprises
sont moins nombreuses. Toutefois, reste entier le
problème des collectivités qui ont pris des participations dans
des sociétés privées en dehors des conditions
fixées par la loi.
• Certaines collectivités, par "
satellites
"
interposés, interviennent dans le secteur concurrentiel, hors de leur
champ de compétence. Cette intervention peut soulever des
difficultés au regard du principe de la liberté du commerce et de
l'industrie et de celui de l'égalité des citoyens devant la loi.
• La pratique confiant à des
tiers l'octroi de concours
publics
fait encourir aux collectivités locales le risque de gestion
de fait.
2. Les difficultés d'interprétation et de contrôle
a) Les incertitudes du cadre juridique résultent tout d'abord du droit communautaire
Le
Traité de Rome
pose comme principe que les aides accordées
par les Etats sous quelque forme que ce soit sont incompatibles avec le
marché commun dans la mesure où elles affectent les
échanges entre les Etats membres. Cependant, ce principe admet des
exceptions : sont possibles les aides destinées à faciliter
le développement de certaines activités ou de certaines
régions... La Commission se réserve de statuer sur leur
légalité lors de son examen de la compatibilité des
régimes nationaux d'intervention économique avec les
règles de la Communauté. Les aides des collectivités
territoriales sont donc indirectement soumises au respect des obligations
communautaires.
Dans le contrôle qu'elle exerce, la Commission apprécie les
effets que les aides peuvent produire sur les marchés
concernés
. Cette appréciation est très largement
fondée sur des circonstances de fait, telles que l'intensité de
l'aide, l'importance de l'entreprise bénéficiaire et des courants
commerciaux, la situation du marché (notamment au regard de
difficultés conjoncturelles et structurelles), les éventuelles
conséquences sur d'autres secteurs d'activités, l'incidence sur
les marchés extérieurs et intérieurs.
La Commission dispose ainsi d'une
compétence exclusive
et d'un
large pouvoir d'appréciation
, sous le contrôle de la Cour
de justice des Communautés européennes qui veille au respect des
règles de procédure, afin d'assurer la protection des droits des
tiers (Etats, entreprises concurrentes et entreprises
bénéficiaires), tant par rapport aux décisions prises par
les dispensateurs d'aides que par rapport à celles de la Commission.
En vertu de l'article 93-3 du Traité, les Etats membres sont dans
l'obligation de notifier
tout projet d'aide particulière ou de
régime d'aides afin de permettre à la Commission de
procéder à son examen préalable ; le projet ne peut
être mis en oeuvre avant que la Commission ait reconnu
définitivement sa compatibilité avec le marché commun.
En matière d'aides, le droit communautaire
ne distingue pas entre
aides directes ou indirectes
, toutes les aides sont comptabilisées.
Des aides régulières sur le plan national ne le seront pas
forcément au regard du droit communautaire plus strict qui a
été élaboré par la Commission. Une autre
difficulté tient à ce fait justement que les dispositions
applicables en droit communautaire résultent d'actes de la Commission
dont la valeur juridique demeure incertaine. La Cour de justice ne s'est pas
encore prononcée sur la compétence de la Commission pour
arrêter de telles normes.
Enfin, ni les administrations déconcentrées de l'Etat ni les
collectivités territoriales ne sont suffisamment informées des
obligations de notification à la Commission des aides allouées.
Les administrations françaises ne sont pas d'ailleurs seules en cause.
Le droit communautaire des aides aux entreprises
Les
principes à partir desquels seront examinées au niveau
communautaire les aides accordées par les Etats membres aux entreprises
sont contenus dans des communications de la Commission qui sont
dénommés " encadrements " ou " lignes
directrices ".
Ces documents n'ont pas de portée juridique mais ils constituent la
doctrine de la Commission en matière d'aides et leurs dispositions
s'imposent dans les faits aux Etats membres dans la mise en oeuvre de leurs
régimes d'aides.
Les principaux encadrements publiés à ce jour sont :
- l'encadrement des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises (paru au
JOCE le 23 juillet 1996) qui prévoit que les taux d'aide maximaux
à l'investissement sont de 15 % brut pour les petites entreprises (moins
de 50 salariés) et de 7,5 % pour les moyennes entreprises (moins de
250 salariés). Dans les zones éligibles à la prime
d'aménagement du territoire pour les projets industriels, le taux d'aide
est plafonné à 30 %. Dans les DOM, il peut atteindre 75 % .
- l'encadrement des aides à finalité régionale pour la
période 2000-2006 (paru au JOCE le 10 Mars 1998 pour application au
1
er
janvier 2000) établi des règles d'attribution des
aides dans les zones en retard de développement (zones éligibles
à la PAT " industrie " et DOM) ;
- l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement (parue au JOCE
le 10 mars 1994) concerne les aides aux investissement permettant de
réduire ou d'éliminer la pollution. Il fixe des taux d'aide
maximaux qui varient selon la nature de l'aide, la taille de l'entreprise
concernée et sa localisation ;
- l'encadrement des aides à la recherche et au développement
(paru au JOCE le 17 février 1996) régit les aides liées
directement à la production ultérieure et à la
commercialisation de nouveaux produits, procédés ou services. Les
taux d'aide maximaux varient en fonction de l'activité aidée, la
taille de l'entreprise concernée et sa localisation ;
- enfin, la communication " de minimis " (paru au JOCE le 6 mars
1996) qui fixe un seuil d'aide au-dessous duquel la Commission considère
que l'aide ne peut fausser la concurrence, ce qui la dispense d'une
notification préalable. Ce seuil est fixé à 100 000 euros
par entreprise sur trois ans.
Il est à noter que le règlement du Conseil du 7 mai 1998 (JOCE du
14 mai 1998) habilite la Commission à arrêter des
règlements d'exemption de notification sur les aides en faveur notamment
des PME, de la recherche et du développement et de la protection de
l'environnement. Ceux-ci, non encore arrêtés, auront vocation
à remplacer les encadrements actuels.
b) La réglementation nationale est également génératrice de difficultés
Les
règles concernant les interventions économiques des
collectivités territoriales au profit du secteur marchand
s'insèrent dans le droit administratif, mais elles coexistent par
définition avec le droit bancaire, celui des sociétés et
des principes de droit commercial ou civil.
Devant l'abondance de questions juridiques non résolues, il n'est pas
surprenant que le
contrôle de légalité
s'exerce
malaisément surtout lorsque les aides sont versées à
partir d'un fonds global ou par l'intermédiaire d'un tiers.
De plus, les décisions à analyser sont nombreuses ; elles
peuvent émaner, pour une même opération ou plusieurs
opérations liées entre elles, de plusieurs collectivités
de niveaux différents. Le secrétariat général pour
les affaires régionales, la préfecture du département et
une sous-préfecture peuvent, à propos d'une même affaire,
être amenés à exercer leur contrôle de
légalité.
Mais les préfets doivent prioritairement apporter leur concours au
développement économique local et à la lutte contre le
chômage. Or, tels sont les motifs affichés de toutes les aides. Le
préfet est investi par le Gouvernement de l'obligation de participer
activement à la sauvegarde et au développement de l'emploi alors
que les moyens dont il dispose sont limités et qu'il est dès lors
contraint à s'appuyer sur ceux des collectivités territoriales.
Au surplus, l'Etat n'est fréquemment plus capable de dégager, en
face des crédits des fonds structurels européens qu'il doit
mettre en oeuvre, les contreparties nationales requises par le principe
communautaire d'additionnalité. Celles-ci sont alors
négociées auprès des collectivités territoriales.
Un contrôle strict de la légalité de l'intervention de ces
dernières pourrait, dans de telles hypothèses, aboutir
indirectement à priver notre pays de certains financements
communautaires.
DEUXIÈME PARTIE
LES PROPOSITIONS
DE LA MISSION D'INFORMATION :
POUR UNE RÉPUBLIQUE
TERRITORIALE
__________
DEUXIÈME PARTIE
LES PROPOSITIONS DE LA MISSION D'INFORMATION : POUR UNE RÉPUBLIQUE
TERRITORIALE
Le bilan
établi par votre mission d'information souligne à la fois
l'efficacité
des collectivités territoriales et les
menaces
qui planent sur la décentralisation.
Forcé de s'adapter aux réalités de la mondialisation dans
un cadre européen plus contraignant, l'Etat est tenté de faire
des collectivités locales les instruments de ses politiques. Il
cède trop souvent à la tentation récurrente de la
recentralisation
.
Dans un
environnement institutionnel complexe
, la
confusion
des
responsabilités constitue un terrain propice au foisonnement des
initiatives, tout en présentant le risque de contribuer au
découragement
des élus et de rendre l'action publique
peu lisible pour les citoyens.
Malgré les
performances de leur gestion financière
, les
collectivités locales sont à la merci d'un retournement de
conjoncture. Leurs marges de manoeuvre
se resserrent
sous l'effet
conjoint de l'alourdissement des charges dont elles n'ont pas la
maîtrise, de la moindre progression de leurs ressources et des atteintes
à leur pouvoir fiscal. Cette évolution met en péril leur
capacité à répondre aux besoins nouveaux.
L'épuisement des mécanismes de la dotation globale de
fonctionnement, la mise en cause de la fiscalité locale et le
développement des formules contractuelles dans un cadre à la fois
imprécis et déséquilibré témoignent d'un
essoufflement de la décentralisation
, préjudiciable
à l'efficacité de l'action publique et à
l'approfondissement de la démocratie de proximité.
*
*
*
Pour
la mission d'information, retrouver l'esprit de la décentralisation est
un impératif
.
Il s'agit de mieux associer les citoyens pour
affronter ensemble les nouveaux défis sociaux et de construire, avec
l'Etat et non contre l'Etat, une République territoriale
rénovée
.
C'est pourquoi la mission s'est prononcée en faveur d'une
relance
vigoureuse et concertée de la décentralisation
, qui passe
par :
•
la définition d'un nouveau contrat de confiance avec
l'Etat, dans le cadre d'une organisation institutionnelle plus efficace ;
• une clarification des compétences, dans le sens d'une
décentralisation renforcée ;
• des moyens humains mieux adaptés et des marges de manoeuvre
financière préservées, le principe de libre administration
des collectivités locales étant mieux garanti.
CHAPITRE I
UNE ORGANISATION INSTITUTIONNELLE PLUS
EFFICACE
Renforcer le cadre institutionnel de la décentralisation
passe d'abord une adaptation de l'Etat aux conséquences de cette grande
réforme (I).
Cet objectif nécessaire justifie, en outre, d'accompagner les mutations
de l'organisation administrative locale avec le double souci de
l'efficacité et de la simplification (II).
I. POUR UN ÉTAT TERRITORIAL ADAPTÉ À LA DÉCENTRALISATION
A. UN ÉTAT RECENTRÉ SUR SES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
a) L'État n'a pas le monopole de l'intérêt général
L'État unitaire, dont le modèle ne saurait
être
considéré comme figé, a tardé à prendre en
compte le rôle plein et entier des collectivités locales. Lors de
son audition par la mission, M. Jean Picq, conseiller-maître
à la Cour des comptes et auteur d'un rapport sur la réforme de
l'État, estimait que l'État en France avait été
sérieusement ébranlé par la décentralisation mais
que son architecture était encore le résultat d'un
climat de
méfiance envers les collectivités locales
.
Appelant de ses voeux un changement d'attitude de l'État, la mission
plaide pour l'instauration de relations de confiance avec les
collectivités locales. Comme l'affirmait M. Christian Poncelet,
président du Sénat, devant le Congrès de
l'assemblée des départements de France, "
nous avons
besoin d'un État moderne, responsable, davantage à
l'écoute des collectivités locales et d'un État majeur,
qui tire définitivement les conséquences des lois de
décentralisation
".
Dans l'idée de donner corps à un " État contractuel
à la française " et de faire vivre la
" République territoriale ", la mission prône un
renoncement aux mesures centralisatrices qui révèlent la
défiance de l'État à l'égard des acteurs locaux.
En effet,
l'État n'a pas le monopole de l'intérêt
général
, auquel participent également les
collectivités locales. Dès lors, la recherche de
l'équité dans la diversité est plus efficace, au regard du
principe d'égalité, qu'un traitement uniforme et donc le plus
souvent inadéquat des situations sur l'ensemble du territoire.
En ce sens, la mission recommande
une meilleure association des élus
locaux aux décisions
ayant une incidence sur leurs charges ou leurs
ressources.
Aussi l'élaboration des textes réglementaires
doit-elle être organisée en concertation avec les élus
locaux.
Une modification de la conception même des textes réglementaires
ne s'impose-t-elle pas ? Il faudrait passer de la règle
précise et impersonnelle fixée par l'État à la
détermination d'un cadre juridique d'application souple et
variée, favorisant l'expérimentation.
b) L'État doit se désengager des fonctions de gestion
L'État doit accepter de concevoir son rôle en
fonction de la nouvelle donne que constitue la décentralisation et la
reconnaissance aux collectivités territoriales de compétences de
plein exercice
310(
*
)
.
En particulier, l'État doit se recentrer sur ses
fonctions
régaliennes
(justice, police, ordre public et
sécurité, diplomatie et affaires étrangères,
défense, monnaie et finances) et permettre aux collectivités
locales d'assumer leurs compétences dans les meilleures conditions, y
compris en reconnaissant une certaine diversité dans la mise en oeuvre
des politiques publiques. Son rôle réside essentiellement dans la
péréquation
, afin de réduire les
inégalités de ressources entre collectivités locales, et
dans la
solidarité nationale
.
Selon le rapport " Poursuivre la décentralisation "
311(
*
)
, réaffirmer les mission de l'État
consiste en la révision de la répartition des compétences
avec les collectivités locales, pour limiter les compétences
partagées et les financements croisés.
Comme l'indiquait M. Christian Poncelet, président du Sénat,
devant l'Académie des sciences morales et politiques,
"
l'État doit s'appliquer à lui-même le principe
de subsidiarité.
S'il doit conserver tout son pouvoir
d'orientation et de mise en cohérence, les décisions concernant
la vie des territoires doivent, elles, être systématiquement
prises au niveau local le plus proche. D'une manière
générale,
l'État moderne doit être un État
modeste recentré sur ses fonctions régaliennes, sa mission de
stratégie et ses attributions de garant de la cohésion sociale et
territoriale.
"
La mission considère que les départs massifs à la retraite
des fonctionnaires de l'État est une occasion de repenser le rôle
et les missions de l'État et de réduire le poids des
dépenses induites de fonction publique qui représentent
aujourd'hui 40 % du budget de l'État.
B. RÉNOVER LA FONCTION DE CONTRÔLE
La
mission déplore la "
rupture de
légitimité
" entre les actes de l'État, qui
bénéficient d'une présomption d'efficacité et de
régularité, et ceux des collectivités locales, soumis
à un contrôle parfois tatillon. Or, l'ensemble des
collectivités territoriales fonctionnent, au moins autant que
l'État, au bénéfice de l'intérêt public.
Le principe de libre administration des collectivités territoriales
suppose que le juge accepte que les décideurs locaux aient
une marge
d'appréciation
pour tout ce qui n'est pas interdit par la loi, alors
que, trop souvent, celui-ci considère que tout ce qui n'est pas
autorisé par le législateur est en fait interdit aux élus
locaux.
1. L'État doit veiller à la qualité du contrôle de légalité
L'affaiblissement de la qualité du service rendu par l'État aux collectivités locales aboutit à une perte d'ingénierie au niveau local , renforçant encore l'emprise des administrations centrales. La mission souhaite une meilleure qualité du service rendu par l'État en matière de contrôle de légalité, notamment en direction des collectivités ayant des moyens juridiques limités.
a) Sanctionner les défaillances manifestes du contrôle de légalité
Le
sentiment d'insécurité juridique qui pénalise aujourd'hui
la vie publique locale, mis en évidence dans le rapport d'étape
de la mission d'information, est alimenté par le fait que le
contrôle de légalité ne vaut pas certification de
légalité.
Or, la cour administrative de Marseille
312(
*
)
ayant récemment introduit un nouveau cas de
responsabilité de
l'État dans l'exercice du contrôle de légalité, sur
le terrain de la
faute simple
313(
*
)
,
il est dans l'intérêt de l'État d'améliorer la
qualité de ce contrôle.
Cette solution jurisprudentielle permettrait aux collectivités locales
d'engager la responsabilité de l'État dans tous les cas où
les défaillances de ce contrôle sont préjudiciables aux
décideurs locaux. Il n'est en effet
pas acceptable que les
élus soient inquiétés par le juge financier voire par le
juge pénal alors que le contrôle de légalité
intervenu en amont n'a donné lieu à aucune observation ni
à un déféré
.
Une telle solution a néanmoins donné lieu à certaines
objections.
M. Jean-Pierre Duport, président de l'Association du corps
préfectoral, a rappelé que le contrôle de
légalité n'était que la capacité de saisir le juge
en cas de doute. Il a estimé que la responsabilité de
l'État ne pouvait être mise en cause pour non-exercice du
contrôle de légalité.
L'engagement de la responsabilité de l'État au titre du
contrôle de légalité pourrait allonger le délai dans
lequel les actes des collectivités locales deviendraient
exécutoires, en raison de l'encombrement des juridictions
administratives. De plus, le risque existerait d'un développement de
contrôles pointilleux.
Tout en ne sous-estimant pas la valeur de ces objections et en relevant qu'un
renforcement mal maîtrisé du contrôle de
légalité pourrait conduire à une paralysie administrative
la mission souligne néanmoins l'intérêt de la jurisprudence
admettant la responsabilité financière de l'État pour
réparer le préjudice causé à une
collectivité locale.
b) Renforcer la qualité juridique du contrôle
Dans son
rapport d'étape, la mission d'information a souhaité que le
contrôle de légalité participe davantage à la
sécurisation juridique. A cette fin, elle a préconisé
qu'il continue à s'exercer dans les préfectures mais dans un
cadre rénové
, notamment grâce à une meilleure
formation des agents qui en ont la charge, par l'adaptation des outils
d'analyse et par l'apport de compétences extérieures.
Reçu par la mission, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de
l'Intérieur, a envisagé un
renforcement de
l'interministérialité pour l'élaboration des instructions
aux préfets en matière de contrôle de
légalité
. Il a souhaité de la diffusion plus rapide de
l'information juridique vers les préfectures grâce à la
constitution d'une banque de données juridiques et aux
possibilités du réseau " intranet " ainsi que
l'amélioration de l'évaluation grâce à des outils
statistiques plus élaborés et plus fiables.
Afin de
renforcer l'articulation entre contrôle de
légalité et contrôle de gestion
,
M. Hubert Blanc, conseiller d'État, reçu en audition
par la mission, a regretté que les services préfectoraux
utilisent peu la procédure prévue aux
articles L. 234-1
et
L. 234-2
du code des
juridictions financières prévoyant que le préfet peut
transmettre à la chambre régionale des comptes, à titre
préventif, les conventions relatives à des
délégations de service public ou aux marchés publics afin
que celle-ci formule des observations dans le délai d'un mois.
Lors de son audition par la mission, M. François Tutiau,
président de l'association des juristes territoriaux, s'est
demandé s'il fallait maintenir le caractère rétroactif des
annulations contentieuses, compte tenu des délais très tardifs
dans lesquels les jugements intervenaient. Il a proposé une annulation,
valable uniquement pour l'avenir, à compter de la date du jugement, afin
d'éviter les problèmes juridiques liés à
l'exécution des jugements, éventuellement sous astreinte.
La mission prend acte de cette dernière proposition. Considérant
qu'elle remet en cause un des fondements du droit administratif
français, elle ne peut la retenir, mais souhaite attirer ainsi
l'attention sur les conséquences de la lenteur de la justice
administrative sur l'action publique locale.
2. La fonction de conseil doit être développée
a) Les attentes des élus sont fortes
Pour les
élus locaux de
Nord Pas-de-Calais
314(
*
)
, le renforcement des moyens des services
préfectoraux n'est pas véritablement de nature a améliorer
l'efficacité du contrôle de légalité. 56 %
d'entre eux appellent de leurs voeux le développement d'une fonction
nouvelle de conseil et d'aide à la décision au sein des
préfectures.
Le
renforcement du conseil aux collectivités locales
, unanimement
souhaité, recueille l'approbation contrastée des élus
selon la formule considérée :
- l'instauration d'
agences intercommunales de conseil
gérées par les élus locaux et composées d'agents de
la fonction publique territoriale est la structure qui respecte le plus
l'autonomie des collectivités locales (40 % des suffrages des
élus du Nord Pas-de-Calais, 60 % de ceux des élus du
département de Vaucluse, 72 % en Alsace) ;
- la création d'une fonction spécifique de conseil au sein des
services déconcentrés de l'État est
plébiscitée (36 % des élus du Nord Pas de Calais)
mais peut susciter des réserves quant à son articulation avec le
principe de libre administration des collectivités territoriales ;
- le développement des services juridiques internes des
collectivités locales semble moins attrayant que le regroupement
intercommunal (18 % des élus du Nord Pas-de-Calais).
b) Renforcer les capacités d'expertise interne
La
mission juge essentiel de renforcer
les services juridiques des
collectivités locales
. En ce sens, M. Jean-Bernard Auby,
président de l'association française de droit des
collectivités territoriales, s'est déclaré
réservé sur le soutien que l'État pourrait apporter aux
collectivités locales en matière de conseil juridique, estimant
que celles-ci devaient avant tout
améliorer leur capacité
d'expertise interne
.
Lors de son audition par la mission, M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'Intérieur, a souhaité quant à lui le
développement de la mission de conseil des préfets aux
collectivités locales, en particulier dans les domaines des
marchés publics et de l'urbanisme, tout en refusant d'entrer dans une
logique de certification des décisions des collectivité locales.
Parce qu'il respecte le plus la spécificité des
collectivités locales,
le développement de structures
intercommunales de conseil
est une des voies envisageables. De plus, le
travail sur le terrain des associations d'élus, tendant à
apporter un conseil juridique de qualité aux collectivités
locales ne disposant pas d'un service spécifique étoffé,
mérite d'être salué.
77 % des élus d'Alsace estiment par ailleurs nécessaire de
développer la mission d'alerte et de conseil des chambres
régionales des comptes ; ils demandent la garantie de la
confidentialité des observations et le renforcement du caractère
contradictoire de procédures.
M. Jacques Oudin, membre de la mission et rapporteur du groupe de travail
sur les chambres régionales des comptes commun aux commissions des Lois
et des Finances du Sénat, a souhaité la création d'une
structure capable de conseiller les collectivités locales, tout en
écartant l'idée que ce rôle soit confié aux chambres
régionales des comptes.
Le rapport du groupe de travail a clairement mis en évidence les
obstacles à l'exercice d'une telle fonction par les chambres
régionales des comptes, tant au regard des moyens humains limités
de certaines d'entre elles que du risque d'un dédoublement fonctionnel,
incompatible avec les stipulations de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. Jean-Paul Amoudry, président de ce groupe de travail commun et
rapporteur de la proposition de loi tendant à réformer les
conditions d'exercice des compétences locales et les procédures
applicables devant les chambres régionales des comptes, a ajouté
que ce conseil pourrait prendre la forme d'un
groupement
d'intérêt public
, composé de représentants du
Parlement, des collectivités locales, du Comité des finances
locales et de personnalités qualifiées. Cet organisme, qui
pourrait avoir une antenne dans chaque département, serait un
référent indépendant, garantissant l'autonomie des
collectivités locales.
La mission prend acte du fait que cette proposition n'a pas été
retenue en dernière analyse par le Sénat. Tout en souscrivant
pleinement à l'objectif poursuivi par MM. Jacques Oudin et
Jean-Paul Amoudry, auteurs de la proposition de loi, de renforcer la fonction
de conseil auprès des collectivités locales ainsi que
l'information juridique et financière de ces dernières, le
Sénat a estimé que la formule proposée d'un groupement
d'intérêt public et de missions juridiques pourrait
apparaître lourde par rapport à l'objectif poursuivi. En
conséquence, la question reste posée de la structure la mieux
adaptée pour conseiller les collectivités locales en
matière juridique et financière.
3. Les contrôles financiers
Lors de
l'examen de la proposition de loi relative aux procédures applicables
devant les chambres régionales des comptes, le Sénat, suivant sa
commission des Lois
315(
*
)
, a adopté
plusieurs mesures tendant à rénover les conditions d'exercice de
l'examen de la gestion des collectivités territoriales.
Tout d'abord, le Sénat a réaffirmé que la
nécessité d'un contrôle
a posteriori
des
collectivités locales
n'était pas contestable et s'inscrivait
dans le droit fil de l'article 15 de la Déclaration des droits de
l'Homme et du citoyen
316(
*
)
du
26 août 1789. L'existence d'un contrôle financier est en
effet la contrepartie de l'autonomie et des responsabilités des
collectivités locales.
Afin de mieux assurer la sécurité juridique des actes des
collectivités locales et de promouvoir un véritable dialogue
entre les élus locaux et les chambres régionales des comptes, le
Sénat a :
- donné une
définition légale de l'objet de l'examen de
la gestion
. Portant sur la régularité des actes de gestion et
sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs
fixés, le contrôle de gestion ne saurait dériver vers un
contrôle de l'opportunité. La définition des objectifs de
la gestion locale relève exclusivement des élus, responsables
devant le suffrage universel, et ne sauraient faire l'objet d'observations de
la part des chambres régionales des comptes ;
- précisé que les
lettres d'observations provisoires
des
chambres régionales des comptes ne sont
pas susceptibles de
communication
;
- prévu la présentation de ses conclusions par le
ministère public avant l'arrêt des observations définitives
sur la gestion par la chambre ;
- renforcé le rôle de la Cour des comptes afin
d'
homogénéiser les procédures
mises en oeuvre par
les différentes chambres régionales des comptes
sur
l'ensemble du territoire national
;
- reconnu aux chambres régionales des comptes un "
droit
d'alerte
" sur les insuffisances du cadre législatif et
réglementaire en vigueur ;
- renforcé le
caractère contradictoire des
procédures
. La faculté de demander la rectification des
observations définitives sur la gestion est prévue ; il
s'agit d'inscrire les missions des chambres régionales des comptes dans
le cadre des principes généraux de notre droit ;
- précisé que
les lettres d'observations définitives
sont des actes " susceptibles de faire grief " et d'être
déférées devant le Conseil d'État
;
- révisé les seuils en dessous desquels l'
apurement
administratif
est applicable. Le seuil de population a été
porté de 2.000 à 2.500 habitants pour les communes et
à 10.000 habitants pour les groupements de communes, le montant des
dépenses ordinaires pris en compte passant de 2.000.000 F à
7.000.000 F ;
- précisé les inéligibilités applicables en cas de
gestion de fait, afin de rendre à cette procédure sa vocation qui
est de rétablir la séparation entre l'ordonnateur et le
comptable ;
- enfin, établi un " délai de neutralité " de
six mois précédant les élections pendant lequel les
lettres d'observations définitives ne pourraient être
publiées, délai qui concernerait les élections auxquelles
il doit être procédé pour la collectivité
concernée.
La mission s'inscrit dans le droit fil des positions adoptées par le
Sénat, tendant à rénover le contrôle de gestion des
collectivités locales.
C. CHANGER L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT
1. Parfaire les partages de services
La
mission dénonce le maintien des effectifs des services de l'État
dans les secteurs où la responsabilité a été
transférée aux collectivités territoriales, par exemple
pour les collèges et les lycées.
Elle souhaite voir appliqué le principe fixé par la loi, selon
lequel tout transfert de compétence est accompagné d'un transfert
de personnel. Ce principe ne doit subir aucune exception ou atténuation.
A titre d'exemple, la commission consultative sur l'évaluation des
charges résultant des transferts de compétences
317(
*
)
a rappelé qu'il convenait d'organiser les
conditions du transfert des personnels consécutif à la mise en
oeuvre de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 qui a
confié aux régions, à compter du
1
er
janvier 1999, la compétence en matière
de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans.
2. Alléger l'organisation territoriale de l'État
Les
services de l'État doivent adapter leurs interventions aux besoins
spécifiques du territoire sur lequel ils agissent, plutôt que de
faire prévaloir une conception trop uniforme. Ainsi, l'organisation de
l'État doit tenir compte de l'extrême diversité des
territoires (zone de montagne, zone littorale, zones fortement
urbanisées, zones rurales et enclavées, etc.).
En effet, comme le souligne le " rapport Santel "
318(
*
)
, "
le principe
d'adaptation est un de
ceux qui caractérisent le service public. Pourtant, la conception
administrative dominante est encore celle de
l'uniformité
:
au nom du principe d'égalité, l'administration territoriale de
l'État devrait être uniforme de Lille à Mende et de Brest
à Grenoble. C'est confondre la nécessaire égalité
du service rendu au public, avec l'égalité des moyens, en
l'occurrence de
l'organisation
".
Le
choix des niveaux pertinents de déconcentration
soulève
la question du découpage administratif de l'État. La loi relative
à l'administration territoriale de la République du 6
février 1992 et la charte de la déconcentration militent pour le
maintien de l'identité entre les circonscriptions d'action de
l'État avec le découpage des collectivités
décentralisées.
Toutefois, dans ce cadre,
il ne paraît pas nécessaire que
chaque ministère cumule une direction départementale et une
direction régionale
, alors même que les compétences
sont partagées et parfois entièrement transférées
aux collectivités locales.
Au regard de l'objectif d'efficacité de l'action publique, la mission ne
considère
pas pertinent qu'à chaque niveau de
collectivité décentralisée corresponde un niveau
déconcentré de l'État
.
Lorsque les compétences sont décentralisées, il n'est
pas conforme à l'impératif d'efficacité et de bonne
gestion que l'État maintienne des
services d'exécution
à l'échelon local.
L'État doit admettre qu'en
matière d'action sociale ou d'équipement, l'intervention de
l'État dans les tâches de proximité et de gestion fait
double emploi avec l'intervention des collectivités locales.
Selon la compétence considérée, la direction
départementale serait seule maintenue : tel pourrait être le
cas en matière d'action sociale ; dans d'autres cas, la direction
régionale serait l'échelon le plus pertinent et rendrait
superfétatoire le maintien des directions départementales ;
par exemple en matière d'emploi. En complément, le " rapport
Picq "
319(
*
)
suggérait de regrouper
les actuels services départementaux et régionaux de l'État
en quelques grandes directions territoriales
320(
*
)
.
Entendu par la mission, M. Jean-Pierre Duport, président de
l'Association du corps préfectoral, a estimé que,
tant qu'une
compétence restait du ressort de l'État, les services
extérieurs étaient nécessaires
. Il a toutefois admis
que
tous les ministères ne devaient pas bénéficier de
tels services
.
L'organisation des services de l'État et de leurs modes de
coopération pourrait
varier d'un département à l'autre,
d'une région à l'autre
321(
*
)
.
En effet, pour certaines missions, l'intervention de plusieurs échelons
n'est pas efficace. A titre personnel, M. Jean-Pierre Duport,
président de l'association du corps préfectoral, en a convenu, se
demandant s'il était nécessaire que l'organisation de
l'État soit la même sur toutes les parties du territoire.
Comme l'écrit Bruno Rémond
322(
*
)
,
conseiller-maître à la Cour des comptes : "
Tout est
possible ! il faut simplement s'attacher à
faire coïncider
la logique des territoires, celle des politiques publiques et celles des
institutions politiques comme des structures
administratives
".
D. UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA DÉCONCENTRATION
1. Dénoncer les ambiguïtés de la déconcentration
a) L'inertie des administrations centrales
Deux
formes de déconcentration peuvent être
distinguées
323(
*
)
; qu'elle soit
territoriale ou fonctionnelle, la déconcentration se heurte à
l'inertie des administrations centrales
.
Comme le rappelle le " rapport Picq "
324(
*
)
, les administrations centrales, elles-mêmes
largement dépossédées par les cabinets ministériels
de leur rôle de conception des politiques, ont beaucoup de mal à
se dépouiller de la seule responsabilité importante qu'elles
peuvent encore exercer : la gestion.
Or, dès lors que les administrations centrales s'occupent
systématiquement d'exécution et de gestion, elles perdent de vue
ce qui devrait être au coeur de leur vocation : l'élaboration
des politiques publiques.
De plus, si un véritable transfert des tâches de gestion des
administrations centrales vers les services extérieurs paraît un
élément indispensable de la déconcentration, le risque est
grand cependant de reproduire le modèle administratif centralisé,
consistant à conserver au centre les fonctions " nobles ", en
particulier la conception stratégique des politiques publiques, pour
laisser les tâches ingrates aux échelons locaux, diminuant encore
leur attractivité pour les agents. A titre d'illustration, au titre de
la déconcentration
seuls 88 emplois ont été
supprimés en administration centrale au profit de l'administration
territoriale de 1994 à 1999.
b) Quels liens entre décentralisation et déconcentration ?
Les
liens entre décentralisation et déconcentration
ne font pas
l'objet d'un consensus. Deux conceptions opposées rendent compte des
ambiguïtés de la déconcentration des services de
l'État :
- la déconcentration peut être pensée comme un
processus
indépendant de la décentralisation.
Priorité du
début des années 1990, la déconcentration constituait
un compromis entre la direction des affaires publiques par l'État, la
recherche d'une meilleure gestion des ministères, et l'adaptation locale
des interventions ;
- au contraire, la déconcentration peut être perçue comme
une
adaptation de l'État à la décentralisation
, par
la constitution d'échelons territoriaux suffisamment forts pour servir
d'interlocuteurs aux élus locaux.
La mission considère qu'
à bien des égards,
déconcentration et décentralisation apparaissent comme deux
termes antinomiques
. Alors que la décentralisation consiste en un
partage des pouvoirs entre l'État et les collectivités locales,
l'État, par la déconcentration, ne partage pas son pouvoir mais
se rapproche seulement des citoyens en installant sur place des services
spécialisés dotés d'une certaine autonomie.
En d'autres termes, "
la déconcentration véhicule encore
des arrière-pensées ou des présupposés ignorant
la décentralisation
et largement nourris de l'essoufflement du
mouvement de réformes locales.
" Nourrie des dysfonctionnements indéniables du paysage
administratif local et présentée comme l'un des défis de
la décentralisation,
la déconcentration ne finit-elle pas par
être
une forme de déni de la
décentralisation ?
"
325(
*
)
En ce sens, M. Jean Picq, conseiller-maître à la Cour
des comptes, entendu par la mission, a considéré que
la
déconcentration était un moyen de maintenir le pouvoir du
centre
. L'État s'est servi de la déconcentration pour
éviter de poursuivre l'effort de décentralisation, comme
l'illustre le développement de la police de proximité.
La déconcentration peut ainsi apparaître comme un moyen alternatif
pour
contourner la logique de la décentralisation
ou la figer
à mi-parcours dans un hybride de
"
déconcentralisation
".
La déconcentration pose certainement la question de
l'échelon pertinent
d'intervention de l'État
,
c'est-à-dire la détermination d'un interlocuteur pertinent pour
les collectivités locales. Mais,
lorsque les impératifs de
coordination tendent à limiter les marges de manoeuvre de chacun des
partenaires, la déconcentration agit comme un frein à la
décentralisation
.
La mission considère
qu'une nette priorité doit être
donnée à la décentralisation, processus fondé sur
la légitimité démocratique de l'élection,
plutôt qu'à la déconcentration, que l'État ne
parvient pas à organiser
.
En effet, la déconcentration a pu être pour l'État un moyen
de reprendre le contrôle des compétences qui avaient
été décentralisées : le développement
récent du pouvoir de substitution des préfets en est
l'illustration.
En période de recentralisation des pouvoirs, la
déconcentration n'est pas une priorité
.
La mission d'information juge nécessaire de
rompre le lien entre
déconcentration et décentralisation
, seule cette
dernière pouvant être l'expression de l'entière confiance
accordée par l'État aux collectivités locales.
2. Redéfinir les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés
La
mission recommande de
faire respecter une définition des rôles
entre le centre et le terrain correspondant à l'objectif
d'efficacité
et de simplicité. A ce titre, le respect du
principe d'égalité ne doit pas être perçu comme un
frein à la déconcentration des services de l'État.
Les administrations centrales doivent préparer les grands choix
stratégiques nationaux, élaborer les politiques publiques et les
normes juridiques nécessaires à la garantie de
l'intérêt général et de la cohésion
nationale, fixer des objectifs aux services déconcentrés et
promouvoir systématiquement l'évaluation.
Les services déconcentrés doivent être en mesure de mettre
en oeuvre les politiques publiques, étant bien entendu que la mise en
oeuvre ne se limite pas à l'exécution mais suppose une
véritable capacité d'étude de la part de ces services, la
contractualisation des objectifs et des moyens avec l'administration centrale,
l'évaluation systématique des résultats et une autonomie
de gestion suffisante.
3. Promouvoir une véritable " interministérialité de terrain "
La
mission souscrit à l'idée, préconisée par le
" rapport Picq ", d'une " mission régionale ",
instrument d'une véritable
interministérialité de
terrain
dégagée des tâches de gestion
, se
consacrant entièrement aux fonctions d'expertise, de planification et
d'évaluation.
Des
fusions de services
doivent être envisagées. Par
exemple, certains départements pourraient relancer l'expérience
de regroupement des directions départementales de l'agriculture et des
directions départementales de l'équipement, dont les missions
sont complémentaires.
Interrogé sur les fusions de services, M. Jean-Pierre Duport,
président de l'association du corps préfectoral, s'est
déclaré opposé à des regroupements autoritaires de
services de l'État, estimant nécessaire de maintenir dans chaque
département des spécialistes dans chaque domaine de
compétence.
A défaut de cette formule très intégrée, des
délégations interservices
326(
*
)
, voire de simples
rapprochements entre
services
327(
*
)
doivent être
systématisés. Une véritable organisation
interministérielle suppose toutefois d'aller plus loin que des relations
bilatérales, par la mise en place de véritables réseaux
interservices étendus.
Cette interministérialité passe par le renforcement de
l'autorité préfectorale sur les services
déconcentrés de l'État, réduits et
restructurés autour de "
pôles de
compétences
" placés sous l'autorité du
préfet. Le
double rattachement, hiérarchique et
fonctionnel
, d'un service déconcentré au préfet et
à son administration centrale, doit être conçu selon une
logique de réseau.
Lors de son audition par la mission, M. Émile Zuccarelli, alors
ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de
la décentralisation, a souhaité réaffirmer le pouvoir de
coordination des préfets sur les services déconcentrés. Il
a noté que
l'autorité des préfets ne pouvait s'exercer
de la même façon à l'égard des différents
services et d'un département à l'autre
. Il a jugé
préférable de proposer une " boîte à
outils ", incluant la déconcentration des crédits, afin que
les préfets choisissent le mode d'organisation le plus adapté
à leur département.
En particulier,
la mise en commun de moyens
humains ou matériels
doit être encouragée. Il s'agit de confier au préfet les
moyens techniques et humains lui permettant d'agir sur l'ensemble des secteurs
de compétence étatique avec la même marge de manoeuvre que
celle dont disposent les présidents de conseil général ou
régional. Cette mise en réseau concerne le
partage de services
juridiques
et les
formations de niveau interministériel
.
Il convient aussi d'encourager l'organisation du travail en équipe des
sous-préfets, chacun ayant un domaine de spécialisation. La voie
d'un
renforcement de l'autorité du préfet par une
présence suffisamment longue dans un poste
(quatre ou cinq ans)
mérite d'être explorée
328(
*
)
.
Le
rattachement du corps préfectoral au Premier ministre
pourrait permettre de mieux affirmer son caractère
interministériel. Dans cette conception, le rattachement au
ministère de l'Intérieur ne se justifie plus que par des raisons
historiques, lorsque les missions du préfet consistaient avant tout
à faire respecter l'ordre public.
En ce sens, s'exprimant devant l'Académie des sciences morales et
politiques, M. Christian Poncelet, président du Sénat, s'est
déclaré favorable à l'idée d'instituer une
véritable "
mission de coordination interministérielle
des politiques publiques, placée auprès du Premier ministre et
à laquelle seraient directement rattachés les
préfets
", ajoutant qu'aujourd'hui "
la gestion du
corps préfectoral par le ministère de l'Intérieur ne
s'imposait plus
".
4. Renforcer le rôle du préfet comme interlocuteur des collectivités locales
Entendu
par la mission, M. Jean Puech, président de l'Assemblée des
départements de France, a déploré que le préfet
soit un interlocuteur de moins en moins " décisionnaire " face
aux élus locaux et qu'il se trouve trop souvent mis à
l'écart par les administrations déconcentrées au profit
d'un dialogue direct avec leur administration centrale.
Comme l'indiquait notre collègue M. Daniel Hoeffel, membre de
la mission d'information et rapporteur pour avis des crédits de la
décentralisation
329(
*
)
, "
la
déconcentration doit faire des services déconcentrés, sous
l'autorité des préfets, de véritables
interlocuteurs
pleinement responsables
des collectivités locales
".
Faire du préfet sinon l'interlocuteur unique, du moins un interlocuteur
responsable dans les domaines de compétence de l'État, est
inséparable de la réflexion sur les niveaux pertinents de
déconcentration. A défaut, les dérives actuellement
constatées, tendant à faire de la déconcentration un moyen
de contrer la décentralisation, se perpétueraient.
Cette conception suppose de rompre la chaîne de commandement entre les
services déconcentrés et les administrations centrales, au profit
de
l'affirmation du commandement par le préfet.
En d'autres
termes, le préfet doit être le pivot de l'organisation
territoriale de l'État et ne doit pas être concurrencé par
les services déconcentrés sur lesquels il est censé avoir
autorité.
A cette condition, les collectivités territoriales n'auraient pas en
face d'elles des services d'exécution qui leur opposent une concurrence
ou font double emploi dans l'exercice de leurs compétences
, mais un
préfet reconnu comme un interlocuteur compétent.
La mission est favorable à
l'évaluation des services
déconcentrés par le préfet
: les services de
l'État doivent s'engager sur des objectifs précis et
vérifiables au regard du principe de l'efficacité des politiques
publiques.
Cette évaluation, que semblent tant redouter les services de
l'État, serait un moyen objectif de mesurer l'efficacité des
politiques mises en oeuvre par les services déconcentrés, afin
d'en comparer les mérites avec les résultats des politiques
menées par les collectivités territoriales
.
II. ACCOMPAGNER LES MUTATIONS DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE LOCALE
A. POURSUIVRE LE RENFORCEMENT DE L'INTERCOMMUNALITE SANS REMETTRE EN CAUSE L'IDENTITE COMMUNALE
1. La commune, cellule de base de la démocratie locale
a) Une perception claire par les élus locaux du rôle de l'intercommunalité
En
souscrivant au renforcement de l'intercommunalité de projet, le
Sénat a clairement marqué sa conviction que des
compétences
partagées
pouvaient être des
compétences
mieux exercées.
Ce constat vaut également
en matière fiscale
. La mise en
commun du produit de la taxe professionnelle sur un périmètre
supra-communal constitue un moyen efficace pour prévenir les
concurrences néfastes entre communes et éviter des distorsions de
richesses fiscales entre communes voisines.
Cette " plus-value " que peut apporter l'intercommunalité
à l'exercice des compétences communales est désormais bien
perçue par les élus locaux.
Interrogés dans le cadre des Etats généraux
organisés à Strasbourg, le 19 mars 1999, par le président
Christian Poncelet,
75%
des élus d'Alsace ont
déclaré souscrire au renforcement de l'intégration fiscale
des établissements publics de coopération intercommunale par la
promotion de la taxe professionnelle unique.
Les élus locaux d'Auvergne, interrogés lors des Etats
généraux qui se sont tenus le 12 mai 2000, estiment très
majoritairement (66%) que l'intercommunalité est un cadre adéquat
pour la mise en oeuvre de véritables politiques structurantes. 78%
d'entre eux sont engagés dans des structures intercommunales.
Une majorité des élus locaux de Basse-Normandie a
également marqué sont intérêt pour le rôle de
l'intercommunalité comme cadre pour la mise en oeuvre de
véritables projets politiques intercommunaux, lors des Etats
généraux organisés à Caen, le 22 octobre 1999. Ils
approuvent très massivement le transfert de certaines ressources
fiscales des communes membres aux groupements et notamment la promotion de la
taxe professionnelle à taux unique sur le territoire du groupement (71%).
L'approbation de la dynamique qui peut résulter de
l'intercommunalité ressort clairement des réponses des
élus de Vaucluse, au questionnaire qui leur a été
adressé dans le cadre des Etats généraux, 71% d'entre eux
se prononçant en faveur d'un renforcement de l'intégration
fiscale.
b) Une réaffirmation nécessaire de la place des communes
En
dépit de cette adhésion très large au renforcement de la
coopération intercommunale, un nombre non négligeable
d'élus locaux expriment des interrogations sur l'avenir de la commune.
40% des élus d'Auvergne voient ainsi dans l'intercommunalité un
risque de disparition des communes. 30% des élus de Basse-Normandie
expriment le même sentiment.
Ces craintes expliquent la très faible adhésion à
l'idée de faire désigner les délégués
intercommunaux au suffrage universel direct. 32% seulement des élus
d'Alsace marquent leur approbation à cette éventualité.
58% des élus de Basse-Normandie y sont hostiles.
Face à ces interrogations, votre mission d'information entend
affirmer que les communes doivent demeurer les cellules de base de la
démocratie locale.
Niveau d'administration de
proximité,
elles doivent continuer
à jouer un
rôle essentiel
dans la prise en charge d'un
certain nombre de besoins relevant de la
vie quotidienne
de nos
concitoyens
.
L'identité communale
constitue une richesse qui doit être
préservée dans un contexte d'ouverture des frontières et
de mondialisation de l'économie, rendant d'autant plus essentiel le
renforcement des repères de proximité. Le réseau
d'élus locaux qui bénévolement répondent aux
attentes les plus diverses de la population constitue un atout que notre pays
doit conforter.
Le développement de l'intercommunalité ne doit donc pas se
faire au détriment de l'identité communale.
Présentant à votre mission d'information différentes
expériences étrangères, le professeur Gérard Marcou
a ainsi fait valoir que les récentes évolutions en Allemagne dans
le domaine de la coopération intercommunale n'avaient pas
dévitalisé les communes, qui peuvent continuer à exercer
des compétences auxquelles elles restent attachées.
Dans ce domaine comme dans d'autres, la
subsidiarité
devra donc
constituer un objectif des politiques mises en oeuvre.
2. Un mouvement de rationalisation de l'intercommunalité qui doit être approfondi
a) Des progrès incontestables
Le bilan
établi par votre mission d'information a mis en évidence le
renforcement continu de l'intercommunalité de projet.
Ce mouvement engagé avant même l'adoption de la loi du 12 juillet
1999, a été conforté par les dispositions de ce texte
auquel le Sénat a apporté sa pleine contribution.
La
suppression
d'un certain nombre de structures (districts,
communautés de villes et, à terme, les syndicats
d'agglomération nouvelle) et une
meilleure hiérarchisation
des catégories d'établissements publics de coopération
intercommunale (communautés urbaines, communautés
d'agglomération, communautés de communes) sont de nature
à
rationaliser
le " paysage " de
l'intercommunalité.
Le nombre élevé (51) de
communautés
d'agglomération
créées avant le 31 décembre
1999 souligne l'impact positif d'un
dispositif incitatif
qui peut
permettre de remédier à l'échec des formules de
coopération en milieu urbain.
En outre, les incitations financières adoptées au profit des
communautés de communes
soumises au régime de la taxe
professionnelle unique, grâce à l'impulsion du Sénat, ont
contribué efficacement à un recours accru à ce
régime fiscal, facteur de rationalisation en ce qu'il évite les
concurrences abusives entre les communes pour attirer les entreprises. Elles
ont également permis, comme l'avait demandé le Sénat, de
réaliser un
indispensable rééquilibrage
entre le
milieu urbain et le milieu rural, que les communautés de communes ont
désormais vocation à concerner principalement.
Sur le plan des compétences, les fonctions
d'aménagement
et de
développement
- exercées à titre obligatoires
par les structures à fiscalité propre - sont désormais
placées au premier rang. Or elles jouent un
rôle
stratégique
dans le renforcement des territoires.
Le
régime juridique
de l'intercommunalité a
incontestablement été clarifié par la
réduction
du nombre de catégories d'établissements
publics de coopération intercommunale. La dispersion des structures
avait, en effet, constitué l'un des facteurs essentiels de la
complexité excessive du cadre juridique applicable. En outre, la mis en
place - conformément aux recommandations du groupe de travail de votre
commission des Lois - d'un
" tronc commun "
des dispositions
ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale constitue
un élément essentiel de simplification.
b) Des améliorations souhaitables
Votre
mission d'information souhaite que ce mouvement de rationalisation soit
poursuivi et approfondi.
Différentes interrogations soulevées par le Sénat lors des
travaux préparatoires de loi du 12 juillet 1999
330(
*
)
devront en particulier recevoir des réponses
dans les prochaines années.
L'objectif de simplification
du cadre juridique de
l'intercommunalité, déjà engagé, devra être
parachevé. Quels que soient les progrès qui ont
résulté à la fois de la réduction du nombre de
catégories d'établissements publics de coopération
intercommunale et de l'édiction de règles communes dans le code
général des collectivités territoriales, les dispositions
applicables demeurent encore
complexes.
Ce constat vaut
particulièrement pour le
dispositif fiscal
, sensiblement
corrigé par la loi du 12 juillet 1999.
Comme le Sénat l'a, à maintes reprises, souligné lors de
l'examen des projets de codification, l'effort de
rassemblement
et de
rationalisation
des textes applicables aux collectivités locales et
à leurs établissements publics doit nécessairement
être complété par une nécessaire
simplification
de leur contenu.
La
rationalisation des structures
devra également être
poursuivie. Outre la transformation des districts et des communautés de
villes, déjà acquise ou en voie de l'être, celle des
syndicats d'agglomération nouvelle apparaît souhaitable. Tel est
le sens des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 les concernant.
Par ailleurs, la transformation des structures existantes devra s'inscrire dans
le cadre de la
hiérarchisation
souhaitée par le
législateur entre les catégories destinées aux grandes
agglomération (les communautés urbaines), celles destinées
aux agglomérations de taille moyenne (les communautés
d'agglomération) et celles concernant plus spécifiquement le
milieu rural (les communautés de communes).
Enfin, le législateur a souhaité maintenir, aux
côtés d'une intercommunalité à fiscalité
propre, une
intercommunalité syndicale
ayant vocation à
prendre en charge différents services. Le Sénat a veillé
à ce que les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 ne mettent pas en
cause des syndicats de communes existant depuis de nombreuses années et
qui ont fait la preuve de leur efficacité.
Cependant le choix - opéré dès la loi d'orientation du 6
février 1992 qui a créé les communautés de communes
et les communautés de villes - de doter les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
de compétences optionnelles portant sur la gestion de différents
services ou équipements pose la question de la
conciliation
de
ces missions avec celles exercées par les structures syndicales
classiques.
La loi du 12 juillet 1999 a prévu un certain nombre de règles
destinées à assurer ces complémentarités.
Pour l'avenir néanmoins des
évolutions progressives
seront
probablement souhaitable, à mesure que les structures à
fiscalité propre s'affirmeront dans l'exercice de leurs
compétences optionnelles. La formule du
syndicat mixte
peut
être une formule adaptée pour faciliter la recherche des
complémentarités et favoriser les évolutions des
structures existantes. Telle a été la démarche du
législateur, la loi du 12 juillet 1999 ayant autorisé les
communautés d'agglomération et les communautés urbaines
à transférer certaines de leurs compétences à un
syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le
périmètre communautaire.
En toute hypothèse, votre mission d'information juge indispensable que
ces différentes évolutions soient fondées sur une
démarche volontaire
des élus locaux, démarche seule
de nature à garantir le succès de la coopération
intercommunale. La
commission départementale de la coopération
intercommunale
- dont le Sénat a renforcé le rôle lors
des travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 - peut constituer
un cadre efficace pour favoriser les concertations nécessaires et
veiller au développement harmonieux de la coopération
intercommunale.
Le Sénat s'est, à ce titre, légitimement
inquiété du contenu de certaines dispositions relatives à
l'urbanisme
prévues par le projet de loi relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains.
331(
*
)
Le périmètre des nouveaux
schémas de cohérence territoriale
ne devra pas, en effet,
être un moyen de
remettre en cause les périmètres de
l'intercommunalité
définis dans le cadre des dispositions de
la loi du 12 juillet 1999. En outre, le contenu de ces schémas ne devra
pas conduire à faire prévaloir les
choix d'urbanisme de
l'agglomération
sur les préoccupations légitimes
d'établissements publics de coopération intercommunale
situés dans sa périphérie qui pourront avoir
été intégrés dans le périmètre du
schéma.
Le Sénat avait adopté plusieurs dispositions de nature à
prévenir ces risques
, notamment en renforçant le
rôle de la commission départementale de la coopération
intercommunale
et en exigeant des
majorités qualifiées
pour surmonter des désaccords entre établissements publics de
coopération intercommunale parties prenantes au schéma. Ces
garanties n'ont malheureusement pas été maintenues par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture du projet de loi, après
l'échec de la commission mixte paritaire. Les réserves
exprimées par le Sénat demeurent donc d'actualité.
Sur le plan fiscal
, la promotion de la taxe professionnelle unique comme
outil de rationalisation des politiques fiscales, s'inscrit dans le contexte de
la réforme de la taxe professionnelle qui, opérée par la
loi de finances pour 1999, a prévu la suppression progressive de la part
" salaires ", soit le tiers des bases de cette taxe.
Cette démarche paradoxale et contradictoire, voulue par le Gouvernement
et la majorité de l'Assemblée nationale, pose la question de la
pérennité de cette taxe
, et donc soulève de fortes
interrogations
sur l'avenir de la taxe professionnelle unique
comme mode
de financement de l'intercommunalité.
Enfin, le
financement de l'intercommunalité par la dotation globale
de fonctionnement
soulève le problème des équilibres
de cette dotation et de sa capacité à financer
simultanément des objectifs très variées, au
détriment de sa fonction de base. Votre rapporteur développera
plus longuement cet aspect essentiel pour l'avenir, dans le cadre du chapitre
consacré aux perspectives du système de financement
local
332(
*
)
.
3. Vers une élection directe des délégués intercommunaux ?
a) Une question importante pour la démocratie locale...
La
question du mode de désignation des délégués
intercommunaux a fait l'objet depuis plusieurs années de nombreuses
réflexions et propositions.
Devant votre mission d'information, M. Jean-Pierre Sueur, président de
l'Association des maires de grandes villes de France, tout en se
déclarant partisan du maintien des communes et des départements,
a ainsi estimé que la montée en puissance des
agglomérations devait s'accompagner de l'élection au suffrage
universel des organes délibérants de ces structures, de plus en
plus amenées à voter le taux de leurs impositions, sans avoir de
légitimité.
Lors de l'examen en première lecture de la loi du 12 juillet 1999,
l'Assemblée nationale avait envisagé un dispositif qui,
concernant les seules communautés urbaines, aurait ouvert la voie
à une désignation directe des délégués
intercommunaux.
Après des débats approfondis tant à l'Assemblée
nationale qu'au Sénat et au sein de la commission mixte paritaire,
celle-ci a, en définitive, décidé de ne pas maintenir ce
dispositif.
La proposition de l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi du 12 juillet 1999 : une désignation directe des délégués des communautés urbaines
Lors de
l'examen en première lecture de la loi du 12 juillet 1999,
l'Assemblée nationale avait prévu des modalités nouvelles
de désignation des délégués des communautés
urbaines, qui aurait eu lieu désormais à l'occasion de
l'élection des conseillers municipaux. L'Assemblée nationale
suggérait ainsi,
pour les seules communautés urbaines
, de
s'engager dans la voie d'une élection au suffrage universel direct des
délégués d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
même si cette désignation ne devait pas être distincte de
celle des conseillers municipaux.
Ce mécanisme aurait été limité aux
seules
communes
d'au moins 3 500
habitants
. Il aurait consisté
à ce qu'au sein de chaque liste de candidats à l'élection
municipale, soient
" distingués "
les candidats qui,
une fois élus, auraient été appelés à
devenir
délégués
de la commune au sein de la
communauté urbaine. Chaque liste devait comporter autant de candidats
appelés à devenir délégués que de
sièges à pourvoir au sein de l'organe délibérant de
la communauté urbaine pour représenter la commune. Les
sièges de délégués auraient été
répartis à la représentation proportionnelle entre les
listes, au prorata du nombre de sièges obtenus par chacune d'entre elles
au sein du conseil municipal. Une liste complémentaire aurait
été établie lorsque le nombre de sièges de
délégués au sein du conseil aurait été
supérieur à celui des conseillers municipaux. Le texte
adopté par l'Assemblée nationale renvoyait, par ailleurs, aux
dispositions applicables aux conseillers municipaux pour les cas de vacance ou
de démission (
article L. 2121-21
du code
général des collectivités territoriales).
Cette rédaction soulevait des
difficultés réelles
qui ont été mises en évidence par les travaux du
Sénat
333(
*
)
. D'une part, elle
introduisait une
différence de régime
dans le mode de
désignation entre les communes de
plus de
3 500 habitants
et les autres. Auraient siégé au
sein de l'organe délibérant des délégués
procédant de l'élection directe alors que d'autres seraient issus
des conseils municipaux. Outre le problème de principe que pouvait poser
cette différence de régime juridique pour des
délégués d'un même organe délibérant,
les communes de
moins de 3.500 habitants
auraient pu subir un
affaiblissement de leur position au sein de celui-ci. Cette disposition aurait
également eu des effets sur
la situation des conseillers
municipaux
eux-mêmes dont certains seulement auraient, pour toute la
durée du mandat municipal, eu vocation à siéger au sein du
conseil de la communauté urbaine. Enfin, outre celles liées
à l'organisation du scrutin, plusieurs difficultés pratiques
auraient dû être surmontées : le cas des communes ne
faisant pas partie de la communauté urbaine au moment du scrutin ;
celui d'une communauté urbaine se créant à
échéance éloignée du renouvellement des conseils
municipaux ; la situation résultant d'une démission d'un
délégué en cours de mandat.
Pour cet ensemble de raisons et tout en jugeant que la
réflexion
devrait être poursuivie
afin que la question essentielle de la
légitimité des délégués intercommunaux
trouve à terme une solution satisfaisante, le Sénat avait
considéré qu'il était
prématuré
de
s'engager dans la voie d'une
désignation directe
alors même
que le processus d'approfondissement de l'intercommunalité de projet
était loin d'être achevé.
b) ...Dont tous les effets doivent être mesurés
Votre
mission d'information considère que le rôle croissant
exercé par des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, dotés de
compétences très étendues et du pouvoir majeur de lever
l'impôt constitue un véritable
enjeu démocratique
.
La question d'une élection au suffrage universel direct des
délégués des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
mérite donc d'être posée.
En prévoyant, dans tous les cas, la désignation des
délégués intercommunaux des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein
des conseils municipaux, la loi du 12 juillet 1999 a apporté une
clarification souhaitable
, de nature à mieux assurer la
légitimité de ces délégués, clarification
à laquelle le Sénat a pleinement souscrit.
Sur l'initiative de M. Jean-Claude Gaudin et plusieurs de nos collègues,
dont votre rapporteur, le Sénat a adopté, le 15 juin dernier, une
proposition de loi qui permet au conseil municipal de Paris, Marseille et Lyon,
de porter leur choix pour siéger au conseil de la communauté
urbaine, sur des conseillers d'arrondissement, qui bénéficient
également de la légitimité du uffrage
universel.
334(
*
)
Pour autant, alors que la réussite du processus en cours de renforcement
d'une intercommunalité de projet suppose l'implication des élus
municipaux, il convient de mesurer le risque d'opposer deux
légitimités concurrentes, situation qui, en définitive,
mettrait en cause la réussite des projets de développement.
L'élection directe des délégués intercommunaux
aurait, en effet, des conséquences sur la nature des
établissements publics de coopération intercommunale et sur leurs
relations avec les communes, structures de base de la démocratie locale.
C'est pourquoi, souscrivant aux conclusions qui se sont
dégagées lors de l'examen de la loi du 12 juillet 1999 ,
votre mission d'information considère que, si elle ne doit pas
être écartée, la perspective d'une désignation
directe des délégués intercommunaux ne devrait être
envisagé qu'une fois acquis le développement de
l'intercommunalité de projet autour de structures à
fiscalité propre.
B. PROMOUVOIR UNE DOUBLE EXIGENCE D'EFFICACITÉ ET DE SIMPLIFICATION
La
montée en puissance de l'intercommunalité de projet, favorisant
l'émergence de territoires de projet, redessinera le paysage
institutionnel et modifiera sans doute les relations entre les
différents niveaux de collectivités, sans que l'on puisse encore
apprécier avec certitude la nature et l'ampleur de ces évolutions
à venir. Les développements ci-dessus ont démontré
que cette nouvelle donnée pouvait se concilier avec l'existence des
communes, dont le rôle demeure essentiel dans la
gestion de
proximité.
Privilégiant une
démarche pragmatique
, votre mission
d'information a par ailleurs écarté toute idée d'un
" grand soir " de la carte territoriale qui aboutirait à
supprimer tel ou tel niveau d'administration locale.
Chaque niveau de collectivité a sa légitimité
ancrée dans l'histoire administrative et la réalité des
territoires. En dehors de la région créée par la loi,
l'existence des communes et des départements a été
consacrée par la Constitution (article 72).
L'analyse menée dans la première partie du présent rapport
sur les systèmes institutionnels des Etats voisins a, par ailleurs, mis
en évidence que le nombre de niveaux d'administration locale ne
constituait pas une véritable originalité du système
français.
Si une originalité de notre organisation locale existe, elle
réside essentiellement dans le nombre de communes. Or le
développement de l'intercommunalité a précisément
pour objet de pallier les inconvénients de l'émiettement communal.
Pour autant une exigence de
clarté
s'impose à l'action
publique vis à vis des citoyens et des contribuables. Elle implique de
rechercher les voies d'une organisation territoriale la plus rationnelle
en
privilégiant l'efficacité et la simplification.
1. L'exigence d'efficacité
a) Une identification claire des missions respectives des différents niveaux
La
complémentarité des différents niveaux passe tout d'abord
par une
identification claire
de leurs missions respectives. En
s'appuyant sur les vocations dominantes de chaque niveau d'administration
locale et en leur transférant des blocs de compétences les lois
de 1983 avaient d'ailleurs obéi à cette logique.
Si, comme on l'a vu, la logique des blocs de compétences n'a pu
être mise en oeuvre avec toute la rigueur souhaitable, il n'en demeure
pas moins que chacun des niveaux
a su identifier assez clairement ses
missions essentielles
. Cette évolution n'a pu qu'être
encouragée par un contexte économique difficile qui s'est traduit
par une progression plus limitée des ressources locales, obligeant ces
dernières à des arbitrages entre leurs différentes
actions. Elle doit être
confirmée
et
approfondie.
La mission sénatoriale sur l'aménagement du territoire avait
recherché cette identification en matière d'aménagement du
territoire en considérant que la région devait être le chef
de file de la programmation et de la coordination interdépartementale,
jouant à ce titre un rôle privilégié pour la mise en
place de grandes infrastructures et l'action économique, tandis que le
département devait être le chef de file du développement
rural
335(
*
)
.
• Le
département
doit demeurer l'échelon des
solidarités sociales et territoriales.
Institué sous la
période révolutionnaire, organisé en collectivité
territoriale par la loi du 10 août 1871, le département a su
s'appuyer sur son expérience en mettant à profit les nouvelles
capacités d'action que lui a conférées la
décentralisation pour renforcer ses moyens et ses compétences
traditionnelles. L'évolution des budgets départementaux (111,3
milliards de francs en 1983, 252,1 milliards de francs en 1999)
témoigne de la place des départements dans le processus de
décentralisation.
Par une mise en oeuvre efficace de ses compétences, le
département a su répondre aux
nouvelles attentes de la
population
notamment dans le domaine social, qui représente
désormais près de 60% des dépenses de fonctionnement dans
les budgets départementaux.
Le département est par ailleurs un
espace de solidarité
,
non seulement par le biais de la péréquation
départementale de la taxe professionnelle mais aussi par
l'intermédiaire du budget départemental qui corrige certaines
inégalités entre communes, en permettant notamment
l'équipement des communes rurales.
Ils jouent également un rôle très efficace dans de nombreux
autres domaines, par exemple celui des transports.
Certaines voix s'élèvent, par ailleurs, pour estimer que le
canton
n'aurait plus de signification en milieu urbain.
Telle a été la position exprimée devant votre mission
d'information par M. Jean-Pierre Sueur, président de l'Association des
maires de grandes villes de France, qui a suggéré de remplacer
l'élection au suffrage universel des conseillers généraux
par l'élection au suffrage universel de l'assemblée
intercommunale, laquelle désignerait des représentants au conseil
général.
Votre mission relève que cette question trouvera probablement sa place
dans le cadre du débat sur les régimes électoraux.
Elle entend néanmoins affirmer son attachement à une
représentation effective des territoires et
à la
préservation du lien de proximité entre les conseillers
généraux et les électeurs.
• Collectivité territoriale plus jeune, la
région
a
une vocation plus orientée vers
l'impulsion
et la
coordination
en matière
d'aménagement du territoire et de
développement économique.
Les différents textes généraux applicables aux
régions ont confirmé cette vocation. Dès la loi du 5
juillet 1972 qui, leur reconnaissant la personnalité morale, les a
érigées en établissements publics, les compétences
régionales ont été spécialisées dans le
domaine économique et social.
Tout en leur étendant la " clause générale " de
compétence (
article L. 4111-1
du code
général des collectivités territoriales), les lois de
décentralisation ont néanmoins confirmé cette vocation
particulière.
L'article L. 4211-1
du code général des
collectivités territoriales précise que la région
"
a pour mission, dans le respect des attributions des
départements et des communes et, le cas échéant, en
collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au
développement économique, social et culturel de la région
(...)
". On retrouve cette même vocation dans la loi du 29
juillet 1982 portant réforme de la planification, dans la loi du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou encore
dans la loi d'orientation du 4 février 1995 qui a prévu
l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement et
de développement du territoire ainsi que la création, dans chaque
région, d'une conférence régionale qui est un cadre pour
la concertation des différents partenaires.
L'affirmation de cette vocation spécifique peut passer par certaines
précisions concernant les
compétences régionales
.
Telle a été la démarche du législateur qui a
confié aux régions la responsabilité d'élaborer un
schéma régional en matière de tourisme
(loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992), ainsi que de
nouvelles compétences en matière de formation professionnelle
(loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993) et, sur la demande
de la région intéressée, de traitement de déchets
industriels (loi n° 95-101 du 2 février 1995). En outre,
la loi d'orientation du 4 février 1995 (article 67) a permis une
expérimentation de la régionalisation des réseaux
ferroviaires d'intérêt local. Le projet de loi relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains prévoit de
transférer à l'ensemble des régions, le 1
er
janvier 2002, les compétences que l'Etat détient en
qualité d'autorité organisatrice des transports ferroviaires de
voyageurs d'intérêt régional.
L'i
mpact
de ces transferts de compétences sur les
budgets
régionaux
ne doit cependant pas être sous-estimé. Ces
budgets s'élèvent à quelque 86 milliards de francs en
1999. Cette même année, les dépenses totales pour la
formation professionnelle continue et l'apprentissage ont progressé
à un rythme élevé (+6,2%). De même
l'expérimentation - qui a concerné 7 régions - en
matière ferroviaire a pesé sur les budgets tant en investissement
qu'en fonctionnement.
La
réforme du mode de scrutin régional et la mise en place
d'une
procédure d'adoption sans vote du budget régional
Le mode
de scrutin mis en place par la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 (scrutin
de liste à un seul tour, à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne) n'a pas permis
l'émergence de majorité stables dans toutes les régions.
En 1986, quatorze présidents de conseils régionaux (sur 22 en
métropole) avaient pu être élus au premier tour, en
bénéficiant d'une majorité absolue de suffrages.
En 1992, deux présidents de conseils régionaux seulement ont
été élus à la majorité absolue et quatre
régions bénéficiaient d'une majorité
homogène (Auvergne, Basse-Normandie, Franche-Comté et
Pays-de-Loire). Les autres conseils régionaux ont été
contraints de rechercher des majorités à partir d'accords avec un
ou plusieurs groupes charnières très minoritaires, ces derniers
jouant ainsi un rôle d'arbitre et exerçant une fonction-clé
sans rapport avec leur représentativité réelle.
A l'issue des élections régionales de 1998, trois conseils
régionaux seulement disposent d'une majorité absolue
(Basse-Normandie, Limousin et Pays-de-Loire), ce qui ne signifie pas que les
dix-neuf autres assemblées régionales soient en situation de
blocage.
•
L'adoption sans vote du budget régional
L'absence de majorité absolue n'a pas toujours empêché les
conseils régionaux de fonctionner. Avant 1998, deux régions
seulement s'étaient heurtées à une impossibilité de
faire adopter leur budget (Haute-Normandie en 1995 et en 1996 et Ile-de-France
en 1997). Sur cent trente budgets proposés entre 1993 et 1997, trois
seulement ont été rejetés, soit une proportion de
2,3 %. Cependant les difficultés s'étaient aggravées
dans la période ultérieure dans plusieurs conseils
régionaux. Issue de propositions de loi déposées à
l'Assemblée nationale, la loi du 7 mars 1998 a prévu
une nouvelle procédure complexe d'adoption sans vote des budgets
régionaux. Cette nouvelle procédure a eu pour objet de doter
l'exécutif des moyens de surmonter les
blocage
s pouvant
résulter de
l'absence de majorité stable
, lors de
l'adoption du budget, acte essentiel pour la vie de chaque région.
Après des premières applications qui ont suscité des
controverses, ce dispositif a été renforcé et
complété par la loi du 19 janvier 1999, laquelle a
parallèlement réformé le mode de scrutin régional.
Le Sénat avait marqué ses réserves sur une
procédure - adoptée par la seule Assemblée nationale en
lecture définitive - qui aboutit en pratique à un
véritable
dessaisissement
de l'assemblée
délibérante.
•
La réforme du mode de scrutin régional
La loi du 19 janvier 1999, adoptée en lecture définitive par
l'Assemblée nationale, a modifié également le mode de
scrutin régional. Elle a prévu qu'à compter du prochain
renouvellement des conseils régionaux, les conseillers régionaux
seront élus dans le cadre régional au scrutin de liste à
deux tours. Si une liste obtient la
majorité absolue
des
suffrages exprimés au
premier tour
, il lui est attribué le
quart des sièges arrondi à l'entier supérieur
. Les
autres sièges
sont
répartis entre
toutes
les
listes
(
sauf
celles qui n'auraient pas recueilli
3 % des suffrages exprimés)
à la représentation
proportionnelle
suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est
procédé à un
deuxième
tour
auquel
peuvent se présenter les listes ayant recueilli au moins 5 % des
suffrages exprimés. Les
fusions de listes
sont autorisées,
sauf pour celles n'ayant pas obtenu
au moins 3 % des suffrages
exprimés
. L'attribution des sièges au deuxième tour
s'effectue dans les conditions décrites ci-dessus, sous réserve
que la " prime majoritaire " est attribuée à la liste
ayant obtenu la majorité relative.
Le Sénat avait pour sa part confirmé son attachement à
l'organisation des élection régionales dans des circonscriptions
départementales. Il avait fixé la prime majoritaire au tiers des
sièges, afin de veiller à la constitution effective de
majorités.
b) Encourager les formules de coopération interdépartementale et interrégionale
Un plus
grande efficacité de l'action publique locale peut aussi passer par le
développement des formules de coopération entre
départements et entre régions.
Ces collectivités ont su de longue date mettre en oeuvre les
coopérations nécessaires sur des
sujets d'intérêt
commun
. Les régions ont notamment mis en place ces
coopérations sous forme
d'associations
ou
d'accords
ponctuels
: Conférence des régions du Sud Europe
Atlantique ; Association " Grand Est " ; Association du
grand Sud ; Association Axe atlantique ; l'Axe alpin ; la
conférence permanente des présidents des régions du bassin
parisien ; l'Association entre la Bretagne et les Pays de la Loire ;
l'Association entre la région Champagne Ardennes et la région
Picardie ; l'Association TGV normand ; l'Association pour la
promotion de l'axe Calais-Bayonne ou encore le " Pool " agronomique
de l'ouest.
Votre mission d'information souhaite que cette démarche puisse
être engagée chaque fois qu'elle paraît de nature à
renforcer l'efficacité de l'action publique, en assurant une plus grande
synergie entre les actions entreprises par plusieurs collectivités.
Il conviendra néanmoins de tirer les conséquences de
l'échec des formules institutionnelles
mises en place par le
législateur pour offrir un cadre juridique à ces
coopérations.
La coopération interrégionale prévue par
l'article L.
5611-1
du code général des collectivités
territoriales, sous la forme soit de conventions interrégionales, soit
d'institutions d'utilité commune, n'a jamais été mise en
oeuvre.
Il n'existe pas non plus d'ententes interrégionales, au sens de
l'article L. 5621-1
du code général des
collectivités territoriales. Instituée par la loi d'orientation
du 6 février 1992, cette formule qui a la forme d'un
établissement public, n'a donc pas rencontré plus de
succès que celles mises en place auparavant, en dépit de
l'assouplissement de ses règles de création prévu par la
loi d'orientation du 4 février 1995.
c) Vers un droit à l'expérimentation institutionnelle ?
Enfin,
l'exigence d'efficacité doit conduire à s'interroger sur la
reconnaissance d'un
droit à l'expérimentation
institutionnelle
.
Cette question pose, à l'évidence, des difficultés d'ordre
constitutionnel, que votre mission d'information n'a pas sous-estimées.
On sait, par exemple, que le Conseil constitutionnel a censuré le
système d'assemblée unique imaginé en 1982 pour les
départements d'outre-mer, en considérant que les mesures
d'"
adaptations
" admises par l'article 73 de la Constitution
pour ces départements ne sauraient avoir pour effet de leur
conférer une "
organisation particulière
"
prévue par l'article 74 pour les seuls territoires d'outre-mer
(
décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982
)
Cependant, la
rigidité
de l'organisation institutionnelle et
l'exigence
d'uniformité
peuvent freiner certaines
évolutions qui seraient pourtant de nature à renforcer
l'efficacité de l'action publique.
Dans ces conditions, votre mission d'information considère qu'il
pourrait être envisagé de permettre aux collectivités
locales, par une démarche volontaire, d'expérimenter des formules
institutionnelles nouvelles qui en fonction des résultats de
l'expérimentation pourrait, le cas échéant, être
étendue ultérieurement à d'autres collectivités.
Ces formules expérimentales devraient être mises en oeuvre dans un
cadre juridique précis de nature à garantir le respect du
caractère unitaire et indivisible de la République.
2. L'exigence de simplification
a) Le pays doit rester un espace de projet
Tel
qu'il a été conçu dans le cadre des dispositions de la loi
d'orientation du 4 février 1995, le pays devait rester un espace de
projet et ne devait en aucune manière constituer un nouveau niveau
d'administration locale.
La première partie du présent rapport a mis en évidence
que la loi du 25 juin 1999 a sensiblement complexifié le dispositif
applicable aux pays au point de susciter des incertitudes quant à leur
place exacte dans le paysage local.
Ces incertitudes ressortent des réponses au questionnaire adressé
aux élus locaux dans le cadre des Etats généraux.
Ainsi, les élus d'Auvergne voient d'abord dans le pays un espace naturel
de projet et de coopération (42% des réponses). Une
majorité d'entre eux son déjà engagés dans un pays
(56%). Mais 88% constatent le manque de clarté de l'articulation entre
les pays, les établissements publics de coopération
intercommunale et les collectivités locales.
De même, 53% des élus de basse-Normandie considèrent que le
pays doit demeurer un outil ponctuel de développement local. 37% d'entre
eux souhaite une clarification juridique notamment des relations avec les
collectivités et établissements publics de coopération
intercommunale.
Votre mission d'information considère que le pays doit demeurer un
espace de projet et qu'il n'a pas vocation à devenir un nouvel
échelon territorial.
b) Pour une harmonisation des zonages et une simplification des procédures qui leur sont attachées
Dans
leur principe, ces zonages ont une légitimité qui ne peut
guère être contestée. Ils sont en particulier un instrument
indispensable dans la mise en oeuvre des politiques d'aménagement du
territoire.
Le bilan réalisé par votre mission d'information a
néanmoins souligné que la superposition des zonages constituait
un élément de complexité qui mettait en cause
l'efficacité de l'action publique locale. Il a mis en lumière que
la simplification dans ce domaine était toujours attendue.
Votre mission d'information souhaite que la réflexion soit poursuivie
en vue d'une meilleure harmonisation des différents zonages.
Au-delà des zonages, c'est également à la
complexité des procédures qui leur sont attachées, qu'il
convient de remédier.
Il est en particulier indispensable de surmonter la lourdeur patente du circuit
financier d'attribution des enveloppes communautaires au titre de la
politique structurelle européenne
, lourdeur qui se traduit par
une sous-consommation des enveloppes attribuées à la France.
Votre mission d'information juge donc indispensable que cette
procédure soit davantage décentralisée afin que les
collectivités locales ne soient plus pénalisées par une
organisation défaillante.
C. RENFORCER LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Un des
éléments constitutifs de la possibilité
d'expérimentations institutionnelles souhaitée par de nombreuses
collectivités territoriales tient dans le renforcement des
coopérations décentralisées.
Certes, les difficultés qui brident l'essor de ces coopérations
ne relèvent pas entièrement de l'Etat ou des Etats, et toutes les
collectivités territoriales ne sollicitent pas avec la même force
que leur soient accordées des marges de manoeuvre plus importantes en ce
domaine.
Mais pour celles qui souhaitent aller de l'avant, la voie n'est pas toujours
libre.
1. Les principaux freins au développement de la coopération décentralisée
Tout
d'abord,
le souhait de coopérer par delà les frontières
nationales n'est pas ressenti avec la même vivacité dans toutes
les régions frontalières
, dont certaines sont marquées
par des relations ambivalentes avec leurs voisins, surtout en cas
d'inégalité de développement économique. Des
traditions culturelles différentes, ajoutées à la
barrière linguistique, peuvent concourir également à une
relative indifférence mutuelle.
L'organisation territoriale différente entre les Etats ne facilite
pas non plus la mise en oeuvre concrète des initiatives locales
.
Ainsi, pour la zone du Rhin supérieur, qui est une des premières
à avoir amorcé des contacts entre la France, l'Allemagne et la
Suisse, la disparité des structures administratives et des
législations dans les domaines fiscal, social, de l'urbanisme urbain et
commercial comme du droit du travail, entrave durablement les rapprochements
souhaités.
Les exemples les plus cités par les responsables de cette région
touchent aux
infrastructures de transport
(construction de ponts sur le
Rhin, harmonisation des liaisons routières et ferroviaires),
particulièrement importantes dans une zone où les travailleurs
frontaliers tant français qu'allemands sont très nombreux.
La
réduction des diverses nuisances engendrées par les
activités industrielles
nécessiterait également une
conjugaison des efforts entrepris de chaque côté de la
frontière. Dans cette zone du Rhin supérieur, l'ancienneté
de la coopération se traduit aussi par une pluralité de
structures compétentes qui n'est pas un facteur
d'efficacité : ainsi coexistent la Commission intergouvernementale
franco-germano-suisse, la Conférence franco-germano-suisse du Rhin
supérieur, et le Conseil rhénan.
2. Promouvoir une politique globale et intégrée dans les objectifs de l'aménagement du territoire national
Le
renforcement de l'autonomie d'action des collectivités territoriales
doit être accompagné du rappel de quelques principes de base,
rappel nécessaire pour dissiper toute éventuelle
ambiguïté sur le rôle respectif de l'Etat et des
collectivités territoriales. Ces principes pourraient être ainsi
définis : les collectivités territoriales doivent rester
dans les limites de leur compétence ; elles doivent respecter les
engagements internationaux de la France, et ne peuvent passer de convention
avec un Etat étranger ; enfin, ces conventions sont soumises au
contrôle de légalité de droit commun.
Une fois ces préalables réaffirmés, il faut s'attacher
à
promouvoir une politique globale de coopération
transfrontalière, intégrée dans les objectifs de
l'aménagement du territoire français
. Ces objectifs
viseraient ainsi la réduction des inégalités entre
territoires, non seulement au sein des frontières nationales, mais
également au sein de l'espace européen.
L'un des moyens les plus opérationnels pour parvenir à ce
résultat est de
permettre aux diverses collectivités
territoriales d'être
, non plus seulement des interlocuteurs de la
Commission européenne, comme c'est le cas depuis le traité de
Maastricht, mais également
des acteurs de la définition des
fonds structurels et de leur répartition
.
Seule, en effet, une étroite association des collectivités
territoriales aux décisions qui les intéressent au premier chef
permettra de renforcer leurs coopérations transnationales, car elle
instituera notamment une information directe des intervenants européens
de leurs projets en ce domaine. En effet, le niveau européen semble le
seul pertinent pour traiter cette question. Ainsi serait-il opportun de :
- Doter les instances de coopération transfrontalière d'un budget
commun leur permettant de mener des actions communes ;
- Développer des services communs dans le domaine de l'emploi, de
l'assurance maladie et des prestations sociales ;
- Reconnaître le rôle déterminant joué par les
collectivités dans la gestion des fonds communautaires, et leur mise en
oeuvre sur les territoires transfrontaliers ;
- Simplifier les structures déjà en place en matière de
coopération transfrontalière : ainsi, dans la région
du Rhin supérieur, la Commission intergouvernementale et la
Conférence du Rhin supérieur font double emploi et seule cette
dernière semble en mesure d'assumer les missions de
coopération ;
- Promouvoir des modes d'action souples et adaptables aux circonstances :
ainsi, la construction d'un pont sur le Rhin nécessite actuellement un
traité qui doit être ratifié par le Parlement. L'Etat
co-financeur d'un pont pourrait consentir à la réalisation d'un
tel ouvrage sans qu'elle soit subordonnée à la conclusion d'un
traité, qui en retarde la création.
CHAPITRE II
DES COMPÉTENCES CLARIFIÉES ET
RENFORCÉES
Entre
une logique de répartition des compétences qui aboutirait
à une spécialisation illusoire des différents niveaux et
une situation de cogestion généralisée source de confusion
de l'action publique, votre mission d'information a estimé qu'il
était possible de privilégier une
démarche
intermédiaire
qui, tout à la fois, cherche à clarifier
les compétences par grands secteurs de la vie sociale et préserve
la mise en oeuvre de formules partenariales entre l'Etat et les
collectivités, entre collectivités elles-mêmes.
Cette démarche pragmatique est confortée par l'expérience
de près de vingt ans de mise en oeuvre de la décentralisation.
D'un côté, peu nombreux sont les domaines de l'action publique qui
ne justifient pas
l'intervention de plusieurs niveaux
. La pratique des
cofinancements
est souvent indispensable pour faire aboutir des projets
utiles au développement des territoires. Cependant l'efficacité
de l'action publique et le droit des citoyens de connaître la destination
des deniers publics commandent que les
partenariats
soient
développés dans un
cadre rénové qui garantisse
l'équilibre des relations entre les différents partenaires.
D'un autre côté, le maintien de formes de partenariats ne doit pas
dispenser de rechercher une
répartition plus homogène des
compétences
entre les différents niveaux. Cette
démarche est source d'efficacité mais aussi de clarté pour
les citoyens qui doivent pouvoir identifier clairement les vocations
principales des administrations publiques. Elle peut justifier certains
ajustements de compétences
qui doivent reposer, dans chaque cas,
sur la recherche du
niveau le plus adéquat.
Mais ces
ajustements
ne peuvent être acceptables que si, au
préalable, le cadre juridique et financier d'exercice des
compétences est
clarifié.
C'est pourquoi, votre mission d'information considère que toute
clarification des compétences est subordonnée à une
amélioration du cadre juridique
dans lequel elles sont
exercées (I).
C'est sous cette réserve que peut être recherchée une
rationalisation de la répartition des compétences
au service
d'une meilleure efficacité de l'action publique (II).
I. UN PRÉALABLE : UNE AMÉLIORATION DU CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER D'EXERCICE DES COMPÉTENCES
A. DES PRINCIPES MIEUX AFFIRMÉS POUR L'EXERCICE DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES
1. Une compensation intégrale et évolutive des charges transférées
La loi
du 2 mars 1982 a posé, à juste titre, le principe d'une
compensation des charges transférées par des ressources fiscales
et, pour le solde, par des attributions budgétaires.
Ce système
souple
et
dynamique
ne permet pas, par
construction, une compensation intégrale des charges
transférées puisque les recettes transférées
évoluent selon un rythme qui leur est propre, différent du
coût des compétences. La compensation pourrait donc aussi bien
être favorable que défavorable. En pratique, elle est
défavorable
, même si les résultats sont
différents selon les compétences et selon les
collectivités. Globalement, le système de compensation a toujours
été défavorable aux régions et est
défavorable aux départements depuis 1994
336(
*
)
.
Les transferts de compétences se sont donc traduits pour les
collectivités locales soit par une
augmentation de leur
fiscalité,
soit par
l'éviction d'autres dépenses
obligatoires.
Le caractère défavorable des compensations s'accentue depuis que
l'Etat a renoncé, au milieu des années 80, à les financer
par des transferts d'impôts et a privilégié la voie de la
compensation budgétaire, notamment par le biais de la dotation
générale de décentralisation (DGD). La DGD est
indexée sur le taux d'évolution de la DGF alors que les
impôts transférés, la vignette, les droits de mutation et
les cartes grises, progressent à un rythme dynamique quoique sujet
à des fluctuations fortes d'un exercice à l'autre.
Le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement
urbains discutée au Parlement au printemps 2000, et en particulier ses
dispositions relatives à la régionalisation de la
compétence ferroviaire, introduit une nouveauté de nature
à rendre encore plus défavorable le taux de couverture des
charges transférées par les recettes transférées.
En effet, il remet en cause le principe selon lequel la compensation est
intégrale
au moins à la date du transfert (les ressources
transférées sont égales au coût pour l'Etat de la
compétence lorsqu'il la transfère) puisque l'assiette de la
compensation a été déterminée à partir d'un
audit ancien, réalisé en 1994 par un cabinet privé
d'audit, et qui ne prend pas en compte des dépenses certaines à
venir, telles que la rénovation des gares, la compensation des tarifs
sociaux décidés par l'Etat ou les régionalisation de
lignes à venir.
A la lumière de ces éléments, il conviendrait de :
Tirer les conséquences du rôle croissant joué par la
DGD en revalorisant son mode d'indexation
.
Lorsque l'indexation de la DGD sur la DGF a été
décidée, en 1983, la DGF était elle-même
indexée sur l'évolution du produit le la TVA, qui est un
impôt à fort rendement
. Il serait donc opportun de revenir
à l'esprit d'origine. Plusieurs modes d'indexation sont
envisageables :
- une solution a minima consisterait à considérer que
l'indice
de la DGF
prévu à
l'article L. 1613-1
du code
général des collectivités territoriales, qui prend en
compte l'évolution des prix et 50 % du taux de croissance du
produit intérieur brut, constitue un taux plancher. Si, une
année, la DGF augmente plus vite que l'indice prévu par le code
général des collectivités territoriales, son taux
d'évolution est retenu. Si elle augmente moins vite, l'indice de la DGF
est appliqué ;
- une solution plus équitable consisterait à indexer la DGD sur
l'évolution des recettes fiscales nettes de l'Etat
, en francs
constants et à périmètre du budget de l'Etat constant. De
cette façon, les ressources servant à financer les
compétences transférées évolueraient au même
rythme que les ressources de l'Etat. En cas de mauvaise conjoncture, les
collectivités participeraient à l'effort national en voyant leurs
recettes diminuer dans les mêmes proportions que celles de l'Etat.
Une indexation de la DGD sur l'évolution du coût des
compétences transférées doit en revanche être exclue
car elle serait profondément inflationniste, les collectivités
étant assurées de voir leur DGD augmenter si elles augmentent
leurs dépenses.
Mieux tenir compte des modifications législatives et
réglementaires qui affectent l'exercice des compétences
transférées.
Le droit actuel prévoit que "
toute charge nouvelle incombant
aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat,
par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice
des compétences transférées est
compensée
". Le montant des compensations est donc
révisé seulement lorsque le coût des compétences
augmente du fait de modifications réglementaires. En cas de modification
législative, la révision du montant des compensations n'est pas
obligatoire.
Par exemple, la DGD des départements n'a pas été
modifiée par la création du revenu minimum d'insertion (RMI), qui
a pourtant renchéri le coût de la compétence en
matière d'aide sociale car, juridiquement, la mise à la charge
des départements du volet " insertion " du RMI ne constituait
pas un transfert plein et entier de compétence, seul susceptible de
donner lieu à compensation.
Un dispositif de
révision périodique
du montant de la base
des compensations, sous l'égide de la commission consultative sur
l'évaluation des charges, devrait être mis en place. De plus, le
caractère automatique de la compensation devrait être
étendu aux modifications par voie législative des règles
relatives à l'exercice des compétences transférées.
S'assurer que la compensation est intégrale à la date du
transfert
.
Une telle préconisation ne devrait pas avoir lieu d'être puisque
la loi le prévoit déjà. Toutefois, le
précédent de la régionalisation du transport ferroviaire
incite à la prudence.
Une procédure d'avis de la commission consultative sur
l'évaluation des charges devrait être envisagée.
Revoir la procédure de consultation de la commission consultative
sur l'évaluation des charges
L'article L. 1614-3
du code général des
collectivités territoriales prévoit que la commission
consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) émet un avis sur
les modalités de compensation des transferts de charges, ou les
modalités de diminution des ressources locales en cas de
recentralisation de compétence.
En pratique, la portée de cet avis est faible. Par exemple, dans le cas
de la recentralisation de la compétence d'aide médicale par la
loi du 25 juillet 2000 relative à la couverture maladie universelle
(CMU), la CCEC n'a pas été consultée à l'occasion
de l'élaboration du projet de loi " CMU ". Elle n'a pas non
plus été consultée sur le montant de la réduction
de la DGD des départements inscrit dans le projet de loi de finances
pour 2000. Elle s'est réunie après coup, en décembre 1999,
pour donner son avis sur l'arrêté de répartition de la
baisse de la DGD entre les différents départements.
De même, la CCEC ne se prononcera pas sur le montant de la compensation
aux régions du transfert de la compétence ferroviaire avant son
inscription dans la loi de finances pour 2001. Elle se prononcera après,
pour apprécier la répartition de ces crédits entre les
régions.
Cette procédure curieuse vient sans doute d'une interprétation
stricte de la rédaction du code général des
collectivités territoriales qui prévoit que "
le montant
des dépenses résultant des accroissements et diminutions de
charges est constaté
pour chaque collectivité
par
arrêté
conjoint du ministre chargé de
l'intérieur et du ministre chargé du budget
,
après
avis
" de la CCEC. Cette rédaction peut laisser entendre que la
CCEC doit apprécier la répartition d'une enveloppe donnée
entre les collectivités prévue par un arrêté, mais
n'est pas compétente pour se prononcer sur le montant total de
l'enveloppe.
Il conviendrait de la modifier pour préciser que la CCEC doit se
prononcer sur le montant des compensations inscrit dans les projets de loi de
finances, quitte à se réunir à nouveau pour donner son
avis sur l'arrêté de répartition des crédits entre
les collectivités.
2. Une réelle liberté d'organisation dans la mise en oeuvre des compétences transférées
a) Retrouver l'esprit de la décentralisation
La
décentralisation repose sur un triptyque "
liberté
d'initiative, diversité, responsabilité
".
Si l'Etat transfère des compétences aux collectivités
locales, c'est parce qu'il estime que ces compétences seront
exercées de manière plus efficace à un niveau de
proximité.
Quelle peut être la signification de cette démarche si le cadre
juridique d'exercice de la compétence est tellement
détaillé que les collectivités locales ne disposent plus
d'aucune marge d'appréciation ?
Le bilan établi par votre mission d'information a mis en évidence
que l'Etat avait de plus en plus la tentation de confier des compétences
aux collectivités locales en définissant au préalable
l'objectif
à atteindre et les
moyens
à mettre en
oeuvre en prévoyant, en outre, des sanctions pour le cas où une
collectivité n'aurait pas respecter ces prescriptions.
Il y a là une
déviation manifeste
de l'esprit de la
décentralisation. Retrouvant de vieux réflexes, l'Etat traite les
collectivités locales comme des acteurs mineurs incapables par
eux-mêmes de promouvoir l'intérêt général.
Or, de deux choses l'une : soit l'Etat considère que le domaine de
compétences en cause est d'intérêt national, il lui revient
alors de le prendre en charge seul sans solliciter les
collectivités locales ; soit il estime que ce domaine
compétences, tout en relevant principalement de ces dernières,
justifie néanmoins son intervention. Il lui appartient alors de
s'inscrire dans le cadre d'un
partenariat équilibré
avec
les collectivités locales.
Tel est le sens de l'Etat contractuel " à la
française " dont votre mission d'information souhaite
l'émergence.
Or les dispositifs récents témoignent au contraire d'un retour
de
l'Etat tutélaire, dont les relations avec les collectivités
locales sont marquées du sceau de la suspicion.
Votre mission d'information juge indispensable un retour à l'esprit de
la décentralisation qui permet une gestion de proximité
fondée sur l'initiative et respectant la diversité des
réalités locales.
A cette fin les collectivités locales doivent disposer d'une
véritable liberté d'organisation dans la mise en oeuvre de leurs
compétences.
b) Quelles voies juridiques pour mieux garantir le respect des compétences locales ?
Le bilan
établi par votre mission d'information a rappelé que la
définition des compétences des collectivités locales dans
un cadre défini par le législateur était apparue comme un
progrès par rapport à la situation antérieure pendant
laquelle les collectivités avaient subi de multiples
transferts de
charges imposés
par l'Etat tutélaire.
Or ce rôle de la loi, conforme d'ailleurs aux exigences
constitutionnelles telles qu'elles ont été
précisées par le Conseil constitutionnel, n'a pas suffi à
mettre un terme à ces transferts de charges imposés. Le bilan
figurant dans la première partie du présent rapport le met
clairement en évidence.
Plus grave, les dispositifs législatifs récents, adoptés
de part la volonté du Gouvernement et de la majorité de
l'Assemblée nationale, contre la position exprimée par le
Sénat, font ressortir que la loi ordinaire, loin d'être
protectrice des compétences locales, peut être source de
contraintes excessives
tant en ce qui concerne le
contenu
des
compétences que les
moyens
de leur exercice
en particulier sur
le plan financier
.
Votre rapporteur a précédemment rappelé le
caractère relativement elliptique des dispositions de l'article 72 de la
Constitution, qui fixe le principe de la libre administration par des conseils
élus "
dans les conditions prévues par la loi
"
et de l'article 34, qui confie au législateur le soin de définir
les principes fondamentaux "
de la libre administration des
collectivités locales, de leurs compétences et de leurs
ressources
".
Dès lors, votre mission d'information s'est interrogée sur le
point de savoir si ce cadre constitutionnel ne devait pas être
précisé
pour mieux assurer le respect de la libre
administration des collectivités locales.
Elle a donc pris connaissance avec le plus grand intérêt de la
proposition de loi constitutionnelle issue de l'initiative de M. le
président du Sénat, qui tendrait à inscrire dans la loi
fondamentale la garantie de l'autonomie fiscale des collectivités
locales, le principe de compensation intégrale et concomitante des
transferts de compétences et de charges et qui consacrerait le
rôle de représentant des collectivités territoriales de la
République dévolu au Sénat par la Constitution, en lui
conférant un pouvoir législatif équivalent à celui
de l'Assemblée nationale pour les projets et propositions de loi
relatifs aux collectivités locales.
337(
*
)
3. Un droit à l'expérimentation sur la base du volontariat
Dans une
société complexe, l'action publique doit pouvoir
s'adapter
en permanence aux nouveaux défis qui se présentent à
elle.
Cette exigence d'adaptation qui s'impose notamment à l'action publique
locale, implique une
certaine souplesse
dans le cadre juridique
d'exercice des compétences. Elle peut également justifier
qu'avant que de nouvelles compétences ne leur soient
transférées, les collectivités locales puissent les avoir
expérimentées.
Cette méthode n'est pas inconnue de notre législation. Outre
qu'il a pu prévoir dans certains domaines des dispositifs limités
dans le temps afin de pouvoir en dresser un bilan et apprécier
l'opportunité de les reconduire, le législateur a
également mis en place de
véritables
expérimentations
.
Le transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional ou
le domaine social donnent une illustration de cette méthode.
Un
exemple d'expérimentation en matière de compétences :
le transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt
régional
338(
*
)
La
décentralisation du transport ferroviaire régional s'est
effectuée en plusieurs étapes.
Envisagée, dès 1974, par M. Olivier Guichard, elle a fait l'objet
d'une expérience intéressante dans la région
Nord-Pas-de-Calais à la fin de la décennie. La loi d'orientation
des transports intérieurs du 30 décembre 1982 a par la suite
ouvert à la SNCF et aux régions la faculté de signer des
conventions.
A la suite du rapport de nos collègues Hubert Haenel et Claude Belot, au
nom de la commission sénatoriale d'enquête sur la SNCF, la loi
d'orientation du 4 février 1995 (article 67) a organisé une
expérimentation de la régionalisation. En application de ces
dispositions et de celles de l'article 15 de la loi n° 97-533 du 25 juin
1997 portant création de l'établissement public
" Réseau ferré de France ", une expérimentation
a été engagée dans six puis dans sept régions
volontaires (Alsace, Centre, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Limousin).
L'expérimentation, qui devait en principe s'achever le 31
décembre 1999, a été prolongée de deux ans par
l'article 21 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire. Cette
expérimentation a posé les principes d'un transfert de
compétences de l'Etat vers les régions pour les transports
collectifs d'intérêt régional.
Le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement
urbains prévoit de transférer à l'ensemble des
régions les compétences que détient l'Etat en
qualité d'autorité organisatrice du transport ferroviaire de
voyageurs d'intérêt régional. Ce transfert de charges doit
être compensé sous la forme d'un versement par l'Etat, d'une
compensation annuelle indexée. Les régions conclurait une
convention avec la SNCF, fixant les conditions d'exploitation et de financement
des services relevant de la compétence régionale. Un bilan de ce
transfert devrait être établi cinq ans après
l'entrée en vigueur de la réforme.
En 1998, l'Etat a versé
2,813 milliards de francs
aux
régions expérimentatrices, lesquelles ont prévu
d'investir
6 milliards de francs
dans la nouvelle
génération des trains TER et dans les rénovations de
matériels.
Deux cent
rénovations de gares
ont
été réalisées en partenariat avec les
régions, les départements et les communes. On estime que
l'expérimentation a permis une augmentation de
6%
du nombre de
trains en 1998 contre 2,3% dans les régions non expérimentales.
La SNCF s'est pour sa part montrée satisfaite de
l'expérimentation en termes de niveau d'activité.
Le Sénat a souscrit au choix de la date du
1
er
janvier
2002
pour la généralisation de la régionalisation du
transport ferroviaire régional. En revanche, il a souligné que la
ressource prévue par le projet de loi au titre de la compensation
financière des régions
était très insuffisante.
Il a relevé qu'en ne prenant en compte que les déficits
courants d'exploitation qui seront constatés en 2000 et la dotation
nécessaire au renouvellement du matériel roulant, la compensation
envisagée faisait l'impasse sur un certain nombre de
charges
,
notamment l'indispensable modernisation des gares régionales et le
manque à gagner généré par les tarifs sociaux
décidés et mis en oeuvre par l'Etat. En outre, les
modalités d'évolution
prévues pour la compensation lui
sont apparues comme sans rapport avec une
vision dynamique
du
développement du service public ferroviaire régional. Le
Sénat a donc adopté une série de modifications
inspirées de la volonté de compensation équitable des
charges nouvelles qui seront supportées par les régions, afin de
donner à celles-ci les moyens véritables d'exercer les missions
qui leur sont ainsi confiées.
Expérimentations et initiatives locales en matière sociale
Le
revenu minimum d'insertion
a fait l'objet de diverses
expérimentations à l'initiative des collectivités locales
avant l'entrée en vigueur de la loi du 1
er
décembre
1988.
Deux catégories d'expérimentations peuvent être
distinguées : certaines expériences résultent d'une
démarche propre des collectivités locales, parfois en relation
avec l'association ATD-Quart Monde : dès février 1985, le
département de l'Ille-et-vilaine met en place un revenu minimum familial
garanti (RMFG) qui sera transformé, en juin 1986, en un dispositif de
complément local de ressources (CLR) dans le cadre d'une convention
associant l'Etat, le conseil général d'Ille-et-Vilaine et les
communes ; le conseil général du Territoire de Belfort
crée en mars 1986, avec l'aide de l'Etat, un dispositif
dénommé " contrat-ressources personnalisé
d'autonomie ".
Le succès des expériences précitées a conduit
l'Etat à solliciter les collectivités locales pour élargir
le champ des expériences. Par circulaire n° 86-23 du 29 octobre
1986, parfois appelée " circulaire Zeller ", l'Etat propose de
s'associer au financement des compléments locaux de ressources (CLR) qui
lui seront proposés par les collectivités locales. Ce dispositif
qui laisse une liberté de choix à l'échelon territorial
aboutira à la mise en place de CLR par voies de convention dans
plusieurs départements. Notre ancien collègue, M. Pierre Louvot,
dans son rapport sur le projet de loi relatif au RMI, avait ainsi
analysé les CLR mis en place dans le Doubs, en Indre-et-Loire, dans la
ville de Grenoble avec le concours du département de l'Isère,
dans la Marne, en Haute-Loire, dans le Rhône et dans la Sarthe.
Près de 25 dispositifs locaux seront ainsi recensés par le CERC
dans une étude de 1988
339(
*
)
.
Les solutions innovantes retenues par les collectivités locales en
matière de droits dérivés (aide à l'accès au
logement, dispositifs de réinsertion) et les enseignements concrets des
expériences conduites sur le terrain ont été utiles lors
de la préparation de la loi de 1988 dont on peut regretter qu'elle n'ait
pas toujours appliqué les principes décentralisateurs à
l'oeuvre dans les expériences initiales.
La
prestation dépendance
a également fait l'objet
d'expérimentations. A l'initiative de la commission des Affaires
sociales du Sénat, la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994
relative à la sécurité sociale comportait une disposition
(article 38) autorisant des
" dispositifs expérimentaux d'aide
aux personnes âgées dépendantes "
.
Quelques principes simples ont été alors retenus : tout
d'abord, les expérimentations devaient être conduites dans le
cadre de conventions conclues entre les départements, des organismes de
sécurité sociale et, éventuellement, d'autres
collectivités territoriales, dans le cadre d'un cahier des charges
établi sur le plan national.
Par ailleurs, un Comité national était chargé
d'évaluer les résultats des expérimentations, montrant
ainsi la volonté du législateur de ne pas préjuger des
résultats définitifs.
Douze départements sur plus de quarante postulants ont été
retenus pour l'expérimentation qui a été lancée
à compter de la publication du cahier des charges en octobre 1995.
Il est à noter que cette expérimentation a été
interrompue de manière anticipée du fait du dépôt
d'un projet de loi sur la prestation spécifique dépendance par le
gouvernement de M. Alain Juppé en octobre 1995.
Ces expérimentations permettent de rechercher de manière
pragmatique dans quelles conditions l'action publique pourra être
conduite de la manière
la plus efficace
.
Dès lors qu'elles ne mettent pas en cause
l'égalité
devant la loi des citoyens et des entreprises situées sur le territoire
concerné, elles apparaissent parfaitement compatibles avec le cadre
fixé par la Constitution.
C'est pourquoi, votre mission d'information souhaite qu'un véritable
droit à l'expérimentation soit reconnu aux collectivités
locales dans le domaine des compétences.
B. DE NOUVELLES RÈGLES DU JEU POUR L'EXERCICE EN PARTENARIAT DE COMPÉTENCES PARTAGÉES
1. Entre l'Etat et les collectivités locales : un partenariat rééquilibré
a) Pour un Etat " contractuel "
L'Etat " contractuel "
que votre mission
d'information souhaite voir émerger est un Etat qui a pleinement
intégré le rôle et la place des collectivités
locales dans le fonctionnement des institutions et la mise en oeuvre de
l'action publique.
Recentré sur ses fonctions essentielles, cet Etat fait confiance aux
collectivités locales pour prendre en charge les missions qui appellent
une
gestion de proximité.
Si nécessaire, il peut développer avec elles des
partenariats
notamment pour fédérer les énergies au
service de l'intérêt général.
A cette fin le contrat peut être un vecteur efficace pour mettre en place
des
cofinancements
lorsqu'ils s'avèrent indispensables.
Selon la formule utilisée devant votre mission d'information par notre
collègue Jean-Pierre Raffarin, président de l'Association des
régions de France, le cofinancement est nécessaire à un
" actionnariat de projet ".
Mais il importe de définir un cadre contractuel
clair
et
équilibré.
b) Une nouvelle règle du jeu pour les relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités locales
La
clarification du cadre contractuel des relations entre l'Etat et les
collectivités locales doit être envisagée aux
différentes étapes
de la procédure contractuelle.
Mais la
pertinence
du recours à la technique contractuelle doit
au préalable être examinée. Selon le domaine
concerné, la contractualisation peut être source de
confusion
et doit donc être
écartée.
Il en est ainsi pour des compétences qui appelant une gestion de
proximité peuvent en réalité parfaitement être
décentralisées.
La technique contractuelle n'est alors
rien d'autre qu'un moyen pour l'Etat de garder la maîtrise d'oeuvre alors
même que les financements sont majoritairement apportées par les
collectivités locales.
Dans des domaines qui, à l'inverse, relèvent des
compétences régaliennes de l'Etat,
la contractualisation
peut être de nature à
diluer
les responsabilités.
Elle nuit donc à la clarté de l'action publique. Le contrat doit
donc être réservé aux domaines qui relèvent
effectivement d'une
responsabilité partagée
entre l'Etat
et les collectivités locales.
Un second préalable concerne
l'éparpillement des
procédés contractuels.
Il apparaît indispensable que
pour un même domaine, les actions conjointes menées par l'Etat et
les collectivités locales fassent l'objet d'un
document contractuel
unique. Cette méthode est source de clarté et
d'efficacité.
Ces préalables étant posés, votre mission d'information
juge d'abord nécessaire une première clarification qui porte sur
les collectivités qui doivent être associées à ce
partenariat.
Contrairement à une pratique observée dans la
période récente, décrite dans la première partie du
présent rapport, si l'Etat veut solliciter les collectivités
locales dans un domaine considéré, il doit associer dès la
phase de négociation, tous les partenaires dont les compétences
seront concernées par le contrat.
Une deuxième clarification doit porter sur les
conditions de
négociation du contrat.
Votre mission d'information juge nécessaire que cette négociation
soit menée au plus près des réalités locales.
L'Etat doit donc rompre avec la tradition de l'acte unilatéral qui
imprègne encore trop souvent les comportements administratifs. Le
" dirigisme méthodologique " n'est pas adapté à
une négociation équilibrée entre partenaires
responsables.
La clarification doit également porter sur le
contenu
des
contrats passés par l'Etat avec les collectivités locales.
Le contrat ne doit plus être, comme il l'a été trop
souvent, un instrument de transfert de charges de l'Etat vers les
collectivités, sans transfert parallèle des
responsabilités.
Selon le principe " qui paie commande ", l'Etat ne peut avoir recours
à la technique contractuelle pour faire financer ses propres
compétences par les collectivités locales tout en gardant la
maîtrise d'oeuvre.
En outre, une
définition précise des engagements
respectifs de l'Etat et des collectivités cocontractantes apparaît
indispensable à l'efficacité même de l'outil contractuel.
Enfin, la clarification souhaitée par votre mission d'information
implique que les partenaires au contrat
respecte les engagements qu'ils ont
souscrits.
Le bilan établi par le présent rapport a mis en évidence
que l'Etat s'était trop souvent dispensé d'exécuter les
obligations qu'il avait lui-même librement contractées.
Cette démarche
décrédibilise l'Etat
comme
partenaire des collectivités locales. Elle met en cause la
portée
même du procédé contractuel qui n'a de
sens que pour autant que les cocontractants se sentent tenus par les
engagements figurant au contrat.
La
mauvaise exécution
des obligations contractuelles peut
également mettre en cause l'efficacité de l'outil contractuel. Il
en est ainsi notamment des retards dans les financements, retards qui
perturbent le bon déroulement des actions conjointement
décidées.
Ces défaillances posent le problème de l'organisation de l'Etat,
de sa capacité à concevoir et à appliquer des
procédures efficaces
.
Mais les collectivités locales ne doivent pas subir les
conséquences des insuffisances des procédures appliquées
par l'Etat.
C'est pourquoi, votre mission d'information considère que les
défaillances de l'Etat dans le respect de ses obligations contractuelles
pourraient faire l'objet de
sanctions financières.
De telles sanctions inciteraient à une
meilleure définition du
contenu
et de l'échéancier
des obligations respectives
des partenaires au contrat. Elle les conduirait, le cas échéant,
à mieux distinguer entre, d'une part,
l'énoncé
d'objectifs
n'ayant pas de traduction immédiate et donc
insusceptibles d'engager la responsabilité contractuelle et, d'autre
part, les
engagements précis
des cocontractants pouvant mettre en
jeu leur responsabilité en cas de défaillance.
2. Entre collectivités locales : la promotion de la collectivité chef de file
Le bilan
établi par votre mission d'information a souligné qu'à
l'expérience, il était apparu illusoire de chercher à
supprimer toute forme de cofinancements entre collectivités pour la
réalisation d'un même projet. Tel est en particulier le cas pour
la réalisation de grands équipements, le concours de plusieurs
collectivités étant alors souvent
indispensable.
Le cofinancement, s'il s'exerce dans le cadre d'un
véritable
partenariat
, peut également traduire de véritables
solidarités
et
complémentarités
en vue d'une
plus grande efficacité de l'action publique.
La notion de collectivité chef de file peut contribuer à assurer
une
plus grande cohérence
des actions communes ainsi conduites.
Elle a été mise en avant, sur l'initiative du Sénat, par
la loi d'orientation du 4 février 1995. Le II de l'article 65 de cette
loi a prévu, en effet, qu'une loi de clarification des
compétences entre l'Etat et les collectivités locales devrait
définir "
les conditions dans lesquelles une
collectivité pourra assumer le rôle de chef de file pour
l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences
relevant de plusieurs collectivités territoriales.
"
Or cette notion,
n'a, à ce jour, pas reçu de traduction
législative
.
Pourtant elle conserve toute sa pertinence pour clarifier les conditions
d'exercice des compétences
C'est pourquoi, lors de l'examen de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire, le
Sénat avait adopté un article additionnel prévoyant la
désignation d'une collectivité chef de file pour des
actions
communes
menées par la voie conventionnelle par les
collectivités et leurs groupements en
matière
d'aménagement du territoire et de développement
économique
.
Le texte issu des travaux du Sénat, écarté par
l'Assemblée nationale lors de la lecture définitive du projet de
loi après échec de la commission mixte paritaire, était
libellé comme suit :
" Lorsque, pour l'exercice de leurs compétences relatives
à l'aménagement du territoire et au développement
économique, les collectivités territoriales et leurs groupements
décident de mener des actions communes dans des conditions fixées
par une convention, cette convention désigne pour chacune des actions
envisagées l'une de ces collectivités ou l'un de ces groupements
pour en coordonner la programmation et l'exécution.
" La convention peut charger la collectivité ou le groupement chef
de file d'exercer pour le compte des parties à la convention les
missions du maître d'ouvrage au sens de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et d'en assumer les
droits et les obligations. Un cahier des charges annexé à la
convention peut, en outre, définir les moyens communs de fonctionnement
nécessaires à la réalisation de ces actions.
" Sauf stipulations contraires, pour des actions communes à la
région, au département et au groupement : la région
est la collectivité chef de file pour la programmation et
l'exécution des actions d'intérêt régional ; le
département ou le groupement est la collectivité chef de file des
actions relatives au développement local et à la promotion des
solidarités réciproques entre la ville et l'espace
rural. "
Ainsi conçue, cette notion de collectivité chef de file n'a
pas pour objet de modifier la répartition actuelle des
compétences entre les collectivités territoriales.
Elle a
vocation à régir la mise en oeuvre d'actions communes à
plusieurs collectivités, notamment celles décidées dans le
cadre du contrat de plan.
Dans le dispositif adopté par le Sénat, la collectivité
chef de file devait jouer un rôle de
coordination
de la
programmation
et de
l'exécution
de ces actions communes.
Garante de la cohérence des
objectifs communs
aux
différentes collectivités, la collectivité chef de file
n'exercerait en aucun cas un pouvoir de contrainte.
Cette notion ne remet donc pas en cause le principe fondamental des lois de
décentralisation qui
prohibe toute tutelle
d'une
collectivité sur l'autre.
Chaque collectivité pourrait exercer ses compétences dans le
cadre du partenariat avec d'autres collectivités autour d'objectifs
communs et d'engagements
librement pris
ou sous une autre forme qui lui
paraîtrait plus appropriée.
Ce partenariat ne modifierait pas, par ailleurs, les
compétences de
l'Etat
dans son rôle de
garant de la cohésion nationale.
La fonction de chef de file est donc une fonction d'animation et de
coordination dans un cadre volontaire destiné à favoriser une
plus grande cohérence de l'action des collectivités
territoriales.
En outre, le Sénat avait prévu que les parties à la
convention pourraient décider de lui confier les responsabilités
du maître d'ouvrage. Un cahier des charges annexé à la
convention pouvait définir les moyens communs de fonctionnement
nécessaires à la réalisation de ces actions.
Le Sénat avait jugé nécessaire de
désigner dans
la loi
la collectivité qui serait, en principe, chef de file pour
des
actions communes à la région et aux
départements
. Les parties à la convention auraient eu
néanmoins la faculté, en fonction du contexte local, de
désigner un autre chef de file.
Sauf stipulation contraire
, pour des actions communes à la
région et au département, la région devait être la
collectivité chef de file des
actions d'intérêt
régional
, le département exerçant la même
mission pour le
développement local
et
la promotion des
solidarités réciproques
entre la ville et l'espace rural.
Il serait évidemment souhaitable que s'applique un
principe de
subsidiarité
dans le choix de la collectivité chargée
d'exercer cette mission de coordination.
Ainsi précisé, ce dispositif semblait de nature à
répondre aux exigences constitutionnelles, telles qu'explicitées
par le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° 94-358 DC du
26 janvier 1995
, notamment quant à l'exercice par le
législateur de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la
Constitution de définir les principes de la libre administration des
collectivités, de leurs compétences et de leurs ressources.
Votre mission d'information considère que la notion de
collectivité chef de file, sans remettre en cause le contenu des
compétences, peut apporter une clarification utile dans la mise en
oeuvre des partenariats entre collectivités.
C. DES MOYENS INSTITUTIONNELS RENFORCÉS
Pour
faire face à des tâches toujours plus nombreuses, les
collectivités locales ont dû avoir recours à divers modes
de gestion des services publics, tendant à mieux adapter ces derniers
aux besoins et aux exigences des usagers.
Elles ont néanmoins été confrontées à
certaines rigidités du cadre institutionnel dans lequel elles exercent
ces missions. Surmonter ces rigidités par la promotion de formules
institutionnelles adaptées qui garantissent à la fois
l'efficacité
et la
sécurité juridique
de
l'action publique locale demeure une préoccupation d'actualité.
En outre, les collectivités locales ont décliné tous les
modes de la gestion déléguée, dont le rôle
mérite d'être souligné.
Enfin, le statut des sociétés d'économie mixte locale,
lesquelles occupent une place importante dans le paysage local, pourrait
être aménagé.
1. La recherche de formules adaptées pour surmonter les rigidités du cadre institutionnel
Il
existe de nombreuses formules de gestion directe ou
déléguée, mais les services publics sont tous régis
par des textes distincts dont l'objet ne peut pas être étendu
au-delà de celui pour lequel ils ont été conçus
Certains services nouveaux résultant de nouveaux besoins de la
population n'entrent pas dans les cadres existants.
Les associations régies par la loi du 1
er
juillet 1901 sont
utilisées par les collectivités locales pour gérer plus
souplement certaines opérations qu'étoufferaient les
règles de la comptabilité publique locale. Il s'agit
essentiellement des activités socio-culturelles, mais il peut arriver
qu'elles interviennent dans des projets de développement
économique local.
Le recours à cette formule associative n'est néanmoins pas sans
risque pour les collectivités locales et pour les élus qui
peuvent notamment se trouver exposés à la procédure de
gestion de fait.
Le recours excessif aux associations para-administratives et ses dangers ont
été relevés dans divers rapports de la Cour des Comptes.
Ce recours aux associations pour la gestion de certains services locaux fait
courir un
triple risque
aux collectivités et à leurs
responsables :
- un risque financier, pour la collectivité, au titre des engagements
pris ;
- un risque pour les personnes, élues ou fonctionnaires de la
collectivité (ingérence et maniement de deniers publics - gestion
de fait) ;
- un risque de mise en jeu par le juge judiciaire de la responsabilité
des dirigeants de l'association qui auraient commis des fautes de gestion.
C'est pourquoi différentes réflexions ont eu pour objet de
définir une nouvelle forme juridique permettant de mieux concilier
l'efficacité de l'action publique avec la nécessaire
sécurité juridique.
Tel fut notamment l'objet de la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale sous la
précédente
législature, qui tendait à faciliter la création
d'établissements
publics locaux
(rapport n° 3289 de
M. Christian Dupuy, député - Xe législature)
La proposition de loi se proposait de doter les collectivités
territoriales d'un instrument juridique simple destiné à
favoriser le développement des services publics.
Elle se fondait sur le constat que le choix risqué que font très
souvent les élus locaux de confier à des associations de la loi
de 1901 la gestion de certains services publics montrait bien qu'ils ne
disposaient pas d'instruments juridiques adaptés.
La proposition de loi facilitant la création d'établissements publics locaux
Adoptée par l'Assemblée nationale, le 16 janvier
1997,
la proposition de loi posait le principe de la création d'une nouvelle
catégorie d'établissements publics, dotés de la
personnalité morale et de l'autonomie administrative et
financière et placés sous la tutelle d'une ou plusieurs
collectivités locales.
L'établissements public local (EPL) serait créé par une
délibération de l'assemblée délibérante ou
par des délibérations concordantes des collectivités
intéressées. Au conseil d'administration de l'EPL, les
représentants de la collectivité ou des collectivités
seraient majoritaires.
Le président du conseil d'administration serait l'ordonnateur des
dépenses et des recettes de l'EPL. Le personnel relèverait du
statut de la fonction publique territoriale quand le service public serait
à caractère administratif et des dispositions du code du travail
quant il serait à caractère industriel et commercial (à
l'exception du directeur et de l'agent comptable).
L'EPL serait soumis en matière financière, budgétaire et
comptable aux règles de la comptabilité publique et aux
règles budgétaires et comptables de la collectivité
territoriale dont il dépend.
Enfin, le comptable de l'établissement serait soit un comptable direct
du Trésor, soit, si la délibération qui l'a
créé le prévoit, un agent comptable nommé par le
préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis
du trésorier payeur général.
Cette proposition de loi n'a pas été examinée par le
Sénat avant la fin de la Xè législature.
Votre mission d'information n'entend pas préjuger des résultats
d'un examen plus approfondi d'un dispositif de ce type, dont toutes les
conséquences devraient être évaluées.
Cependant, force est de constater que l'adéquation des moyens
institutionnels à la dispositions des collectivités locales pour
mener à bien leurs missions demeure d'actualité.
2. Le rôle de la gestion déléguée
La
gestion des services publics s'est beaucoup développée depuis le
lendemain de la Grande Guerre, car les besoins de la population n'ont pas
cessé de croître sous la pression de l'évolution
économique et sociale.
Aujourd'hui, en matière de services publics locaux, les modes sont
divers et combinent
gestion déléguée
et
gestion
directe
. Les modes de gestion associent les acteurs publics de tous les
niveaux et ils associent aussi acteurs publics et acteurs privés.
On peut considérer que, devant la variété des situations
rencontrées, reflet elles-mêmes de la variété des
modes de partenariat, le pragmatisme doit l'emporter. Collectivités
publiques et acteurs privés doivent concourir ensemble à la
satisfaction des besoins collectifs en respectant des impératifs
d'efficacité et d'économie de moyens.
Devant votre mission d'information, M. Marceau Long, président de
l'Institut de la gestion déléguée, vice-président
honoraire du Conseil d'Etat, a tenu à préciser qu'il n'y avait
pas, selon lui, de hiérarchie entre la gestion directe et la gestion
déléguée, et que le choix entre ces deux modes devait se
faire au cas par cas.
Parmi les modes de gestion traditionnelle, la
régie directe
est
le plus ancien. En l'espèce, il n'y a pas création d'une personne
morale distincte de la collectivité et celle-ci garde un contrôle
absolu sur l'exploitation du service. Les opérations effectuées
en dépenses et en recettes sont directement enregistrées au
budget de la collectivité.
Puis, avec l'intervention croissante des collectivités locales dans le
domaine économique et social, on a isolé les activités
industrielles ou commerciales assurées par les collectivités
locales dans des
régies pourvues de l'autonomie budgétaire
(mais non de la personnalité morale).
Le degré suivant est la
régie personnalisée,
c'est-à-dire une régie dotée de l'autonomie
financière et de la personnalité morale. Une
délibération du conseil municipal décide de la
création d'une régie personnalisée. La régie est
administrée par un conseil d'administration. L'agent comptable reste un
comptable direct du trésor ou un agent comptable spécial
nommé par le préfet.
La collectivité peut également déléguer le
service public au secteur privé :
-
la gérance
(l'exploitation du service est confiée
à une personne privée rémunérée par la
collectivité dans des conditions fixées par contrat) ;
-
la régie intéressée
(l'exploitant est
rémunéré selon un forfait et par participation aux
résultats ; la collectivité supporte seule les pertes
éventuelles et prend en charge les investissements) ;
-
la concession
(contrat par lequel la collectivité confie
à une personne privée ou publique l'exploitation d'un service
public ; le concessionnaire est rémunéré par les
redevances des usagers, à charge pour lui d'assurer le fonctionnement du
service à ses risques et périls) ;
-
l'affermage
(distinct de la concession dans la mesure où
l'entrepreneur privé ne supporte pas les frais initiaux d'installation
du service mis en oeuvre ; le fermier reçoit une partie des
redevances et la collectivité une autre partie avec laquelle elle essaie
d'amortir les frais supportés à l'origine).
Force est d'observer qu'au cours de la dernière décennie, le
législateur a encadré de manière très forte la
procédure de délégation de service public. Ces
règles nouvelles ont pu
complexifier les procédures
que
les élus locaux doivent mettre en oeuvre.
Devant votre mission d'information, M. Marceau Long a ainsi
précisé que l'application de la loi du 29 janvier 1993, dite
" loi Sapin ", entraînait une procédure en dix huit
étapes (ou seize étapes pour la " procédure
allégée ").
Tout en relevant qu'il n'existait toujours pas de définition
légale, ni de la délégation, ni de la concession de
service public, il a néanmoins considéré que le nouveau
cadre législatif avait apporté plus de transparence et qu'il
mettait la France " à l'abri " au regard du droit
communautaire même si les instances européennes continuaient
à se méfier de la notion
d'intuitu personae.
La définition de la délégation résulte de la
jurisprudence qui a considéré que, pour qu'il y ait
délégation, il fallait qu'une partie substantielle de
l'exploitation soit assurée par la rémunération du
service. Encore faut-il s'entendre sur la notion de " partie
substantielle " (15, 20 ou 25% ?).
En dépit de certaines incertitudes et des complexités qui peuvent
affecter son régime juridique, le rôle de la gestion
déléguée dans l'action publique locale doit
néanmoins être souligné.
3. Les sociétés d'économie mixte
Le
partenariat s'est développé entre les collectivités
locales, entre les collectivités locales et l'Etat et entre les
collectivités locales et le secteur privé. Le partenariat
public-privé, significatif de l'évolution des mentalités
et des pratiques, répond à la nécessité de
surmonter les rigidités du cadre institutionnel imposé aux
collectivités locales.
Créées par le décret du 27 décembre 1926, les
sociétés d'économie mixte (S.E.M.) permettent d'associer
des capitaux publics et privés pour la poursuite d'objets
d'intérêt général. Les SEM se sont
particulièrement illustrées dans
l'aménagement du
territoire
à partir des années 50.
Toutefois, le cadre juridique des SEM n'était pas suffisamment
précis ni suffisamment souple, c'est pourquoi une clarification fut
apportée par la loi du 7 juillet 1983 qui a introduit les principes du
droit des sociétés commerciales. Cette loi renforce le
contrôle des collectivités locales sur les SEM tout en
assouplissant leur fonctionnement, ce qui en fait un
outil
privilégié pour la gestion des services publics locaux.
Le statut juridique des SEM est calqué sur celui des
sociétés anonymes : elles en revêtent la forme avec
une différence concernant le capital minimum obligatoire qui doit
être d'au moins 1 000 000 de francs pour les sociétés
d'aménagement et de 1 500 000 francs pour les sociétés de
construction. Les collectivités territoriales doivent y détenir
(séparément ou à plusieurs) plus de la moitié du
capital sans que cette prise de participation ne puisse aller au-delà de
80 %.
La gestion des SEM locales est placée sous le régime du
contrôle
a posteriori.
Certains actes sont soumis à
l'obligation de transmission au préfet dans les quinze jours de leur
adoption. (Il s'agit des procès-verbaux du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance, des procès-verbaux des assemblées
générales et des contrats).
Lorsque le représentant de l'Etat juge qu'une délibération
met en péril la santé financière des collectivités
locales concernées, il saisit, dans le délai
d'un mois
, la
Chambre régionale des comptes. Cette saisine entraîne une seconde
lecture par le Conseil d'administration ou de surveillance ou par les
assemblées générales. La Chambre régionale des
comptes dispose d'un délai
d'un mois
à compter de la
saisine pour faire connaître son avis au préfet, à la SEM
locale et aux assemblées délibérantes des
collectivités locales concernées.
Forts de l'excellent bilan des SEM, les élus dirigeants de SEM
réclament aujourd'hui une
modernisation du cadre juridique
de
l'économie mixte locale.
Depuis le début des années 1990, les SEM rencontrent des
difficultés économiques, juridiques et administratives qui
grèvent leur action.
Premièrement, l'expérience a fait ressortir la
nécessité de renforcer le
contrôle démocratique
des assemblées délibérantes
des collectivités
territoriales sur les opérations confiées aux SEM et sur les SEM
elles-mêmes.
Deuxièmement, l'évolution du cadre juridique et de la doctrine
administrative a créé une contradiction flagrante entre le droit
et la volonté politique des élus locaux sur trois points :
les relations financières entre les collectivités territoriales
et les SEM, le droit de la concurrence, le statut de l'élu
administrateur de SEM.
En ce qui concerne les
relations financières
, la jurisprudence du
Conseil d'Etat a eu pour effet d'interdire aux collectivités locales de
soutenir les SEM dont elles sont les actionnaires majoritaires (pas d'aides
directes ou indirectes en dehors des conditions fixées par les lois du 7
janvier et 2 mars 1982 sur les aides des collectivités locales
aux entreprises privées).
En ce qui concerne le
droit de la concurrence
, la loi du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique a soumis les
SEM, au même titre que les sociétés privées
fermières ou concessionnaires de services publics, mais contrairement
aux établissements publics, à un régime de mise en
concurrence pour les délégations de services publics. Ceci met
une collectivité locale actionnaire d'une SEM dans l'obligation de la
mettre en compétition avec d'autres sociétés pour
exploiter le service (pour lequel la SEM avait été
créée !).
Enfin, en ce qui concerne le
statut des élus administrateurs de
SEM
, les risques liés aux délits de prise illégale
d'intérêt et de favoritisme justifient qu'ils
bénéficient d'une protection juridique renforcée.
Les SEM sont également pénalisées (contrairement aux
sociétés d'HLM classiques) par l'interdiction faite aux
collectivités locales d'accorder des aides financières pour
conduire et gérer leurs programmes de logements sociaux.
Les élus demandent aujourd'hui que :
- les collectivités soient en meure d'exercer pleinement leurs
responsabilités
d'actionnaires majoritaires
par tout concours
financier nécessaire ;
- les relations financières entre les collectivités et leur SEM
s'inscrivent dans un
cadre conventionnel propre à l'économie
mixte locale
garantissant une totale
transparence
et un
contrôle effectif
des assemblées
délibérantes ;
- la
sécurité juridique
soit rétablie et permette
aux collectivités territoriale le
libre choix
de leurs modes de
gestion.
La Fédération nationale des Sociétés
d'économie mixte préconise une refonte du statut. Elle souhaite
l'ouverture d'un débat sur l'assouplissement de la composition du
capital (il y aurait donc des SEM à capitaux publics minoritaires). La
Fédération récuse également la multiplicité
des contrôles qui pèsent sur les SEM.
L'avant-projet de loi préparé par M. Emile Zuccarelli
contenait des mesures destinées aux SEM.
Il autorisait les collectivités locales à accorder aux SEM des
avances en compte courant d'associés. Il prévoyait aussi
qu'à l'avenir les conventions pour lesquelles les collectivités
déléguaient des opérations d'aménagement à
des SEM locales comporteraient obligatoirement un plan de financement global de
l'opération mentionnant le montant total de la participation
demandée à la collectivité. Ces mesures ont
été jugées insuffisantes par les SEM et les élus
locaux.
Lors de son audition devant la mission, M. Loïc Le Masne,
président de la Fédération nationale des SEM a
estimé que le " projet Zuccarelli " ne répondait pas
aux aspirations des SEM ; il a déclaré en outre que les
collectivités locales devaient bénéficier de marges de
manoeuvre plus grandes dans l'exercice de leur rôle d'actionnaires.
M. Loïc Le Masne a fait remarquer aussi qu'une réforme des SEM
devrait apporter un peu de souplesse dans les contrôles, estimant
qu'elles étaient aujourd'hui les entreprises les plus
contrôlées de France, puisque, comme les entreprises
privées, elles étaient soumises au contrôle d'un conseil
d'administration, d'un commissaire aux comptes et de l'administration fiscale,
mais, du fait de leur actionnariat public, elle relevaient également du
contrôle de la légalité et de celui de la Chambre
régionale des comptes.
Ces légitimes préoccupations des élus dirigeants de SEM
devront être prises en considération.
II. UNE RÉPARTITION PLUS RATIONNELLE DES COMPÉTENCES AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ DE L'ACTION PUBLIQUE
La
mission n'a pas limité ses réflexions aux moyens de clarifier le
cadre juridique de l'exercice des compétences.
Elle s'est interrogée sur l'opportunité de nouveaux transferts de
compétences de l'Etat aux collectivités locales, dans le sens
d'une décentralisation renforcée.
Sans couvrir tout le champ de l'action publique, elle a voulu formuler quelques
propositions, en tenant compte de la
vocation principale
de chacun des
niveaux de collectivités locales, des
évolutions
constatées
dans le partage du financement des compétences de
l'Etat ainsi que des
réalités du terrain
.
Les suggestions de la mission concernent l'éducation, la formation
professionnelle, l'équipement, l'action sociale et
médico-sociale, la culture, la sécurité, les services
d'incendie et de secours et, enfin, les interventions économiques.
D'autres domaines pourraient justifier un examen complémentaire, afin de
mieux préciser la répartition des compétences. Tel
pourrait en particulier être le cas de
l'environnement
, même
si, dans ce domaine, la détermination de blocs de compétences
très délimités peut être difficile à
concevoir et pas nécessairement souhaitable. Pour autant, le financement
de la gestion de l'eau, les limites territoriales de compétence pour la
gestion des déchets et l'énergie, constitueront des enjeux
importants pour l'action publique locale au cours des prochaines années.
Ces propositions -dont la mise en oeuvre exigera une réelle
volonté politique- sont formulées sous les réserves
précédemment soulignées. Toute nouvelle
décentralisation de compétence suppose en particulier un accord
préalable sur la réalisation de deux conditions
déterminantes : une
compensation
juste et évolutive
des charges transférées et une
liberté réelle
d'organisation
pour les collectivités locales.
L'expérimentation
sur la base du volontariat, chaque fois que
possible, présente l'avantage de garantir l'adhésion des
collectivités intéressées et de préserver
l'avenir.
A. L'ÉDUCATION : TRANSFÉRER LA RESPONSABILITÉ DES BÂTIMENTS UNIVERSITAIRES AUX RÉGIONS
La
participation substantielle des collectivités territoriales
-et en
particulier des régions-
au financement des universités
,
dans le cadre du plan " université 2000 ", axé sur
l'investissement immobilier, puis du plan " U3M ", inscrit dans les
contrats de Plan Etat-Région 2000-2006 et comportant un nouveau volet
" vie étudiante ", pose de longue date la question du
transfert aux régions de l'enseignement supérieur,
compétence de l'Etat.
La mission a pris position en faveur d'un transfert aux régions de la
construction et de l'entretien des bâtiments universitaires
. La
vocation de la région en matière de développement
économique et d'aménagement du territoire, de même que ses
compétences dans le domaine de la formation professionnelle, en
particulier en faveur des jeunes, plaident pour ce transfert. L'Etat
contribuerait à assumer la charge du personnel enseignant et des
dépenses pédagogiques.
L'ampleur des dépenses nécessaires pour réhabiliter un
patrimoine dégradé et adapter ses capacités d'accueil
à l'explosion du nombre d'étudiants ne doit pas être
éludée. Il est clair qu'un transfert aux régions devrait
être subordonné à un
état des lieux
et faire
l'objet d'une
négociation préalable
, sérieuse, sur
les modalités de compensation par l'Etat des charges
transférées, tenant compte de la richesse des régions et
du nombre d'étudiants prévisible. Ce transfert ne serait pas
exclusif d'une participation des départements volontaires et des villes
au financement.
La mission d'information n'entend remettre en cause la compétence
pédagogique de l'Etat ni dans l'enseignement supérieur, ni dans
les enseignements primaire et secondaire, tout en préconisant le
développement de l'expérimentation, nécessaire pour mieux
adapter le système éducatif à l'évolution de
besoins diversifiés.
*
* *
La
mission s'est par ailleurs préoccupée des conditions de
recrutement et de gestion des personnels intervenant dans la vie quotidienne
des établissements du second degré.
Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de
santé (ATOS) ne sont pas un ensemble homogène. Ceux qui
relèvent du cadre A (21 %) ont des fonctions de direction. Les ATOS du
cadre B (8 %) s'occupent d'administration scolaire et universitaire. Le
cadre C (71 %) est chargé de l'entretien général et
de la vie pratique quotidienne des établissements scolaires. L'ensemble
de ces personnels représentent 205 520 agents (dont un quart dans
les établissements universitaires). Enfin, les ATOS se partagent entre
un petit nombre affecté à l'administration centrale (4 042
personnes) et dans les services académiques (29 773 personnes). La
plupart des ATOS sont donc déconcentrés, c'est-à-dire en
l'occurrence affectés dans les établissements du second
degré et du supérieur. Les emplois ATOS sont répartis, par
l'administration centrale, entre les académies. En l'absence de
création de poste, il y a redéploiement entre les
académies, mais aujourd'hui il n'existe plus de marge pour
redéployer.
Aussi bien les établissements que les collectivités locales
déplorent que le nombre des personnels ATOS reste insuffisant.
Le rôle des ATOS relevant du cadre C pour le bon fonctionnement des
établissements et l'importance de cette présence adulte au milieu
des élèves sont reconnus par tous et tout le monde s'accorde pour
demander la création de postes nouveaux. La Commission d'enquête
sénatoriale sur la situation et la gestion des personnels des
écoles et des établissements du second degré s'en est
émue
340(
*
)
.
La gestion des personnels ATOS est rendue difficile aujourd'hui en raison du
transfert de compétences aux collectivités locales en
matière de constructions scolaires. En effet, après avoir
consacré, comme on l'a vu, des sommes considérables à la
restauration et à la construction d'établissements, les
collectivités locales ne comprennent pas que maintenant l'Etat leur
mesure chichement les moyens de l'entretien quotidien des bâtiments.
Ce problème est resté pendant, car toute évolution sur le
statut ou le mode de recrutement des ATOS constitue un point très
sensible dans les discussions avec les organisations syndicales. En effet, ces
dernières considèrent que les ATOS contribuant à la bonne
exécution du service public de l'éducation doivent conserver leur
statut actuel et ne dépendre que de l'Etat en tant que fonctionnaires
associés au projet éducatif global dont l'Etat a la
maîtrise.
Une première solution consisterait à rationaliser la gestion
de ces personnels au niveau académique en favorisant la mutualisation
des moyens entre plusieurs établissements.
Une partie des tâches des ATOS pourrait également être
confiée à des sous-traitants : cela est plus
particulièrement vrai pour le nettoyage et la restauration. Le
ministère de l'Education nationale étudie actuellement le
développement des formules d'externalisation.
Interrogé par la Commission d'enquête sur la situation et la
gestion des personnels des écoles et des établissements du second
degré, le précédent ministre de l'éducation
nationale avait indiqué à la commission que le ministère
étudiait des formules de contractualisation avec les
collectivités territoriales afin qu'elles puissent participer au
recrutement de personnels ATOS supplémentaires.
Pour répondre aux besoins des établissements et aux
préoccupations des élus locaux, au nom de la proximité et
de l'efficacité, le transfert aux collectivités locales du
recrutement et de la gestion des personnels intervenant dans la vie quotidienne
des établissements du second degré devrait être
envisagé
. Un tel transfert de compétences devrait
s'accompagner d'une compensation financière correspondante. Les
collectivités seraient libres d'opter pour le type de gestion qui leur
semblerait, au vu des circonstances locales, le mieux adapté.
Pour les responsables locaux, cette réforme ne serait pas
entièrement une nouveauté puisqu'ils ont déjà en
charge cette compétence pour le primaire et qu'ils complètent
déjà les défaillances de l'Etat dans le secondaire et le
supérieur.
Une telle réforme devrait s'engager dans la plus large concertation avec
les personnels concernés.
B. LA FORMATION PROFESSIONNELLE : RENFORCER LA COMPÉTENCE DES RÉGIONS
La
formation professionnelle est un domaine dans lequel la compétence
transférée aux régions, loin de devenir une
compétence de droit commun de plein exercice, est devenue une
compétence partagée où l'Etat continue de jouer un
rôle prédominant tout en conservant la maîtrise des contours
de sa sphère de compétence.
Par le biais de l'Association pour la formation permanente des adultes (AFPA)
ou du fonds national pour l'emploi (FNE), l'Etat conserve de grandes
possibilités d'intervention tout en ayant par ailleurs
transféré aux régions une large fraction des
dépenses ordinaires ce qui lui a permis de réduire le niveau de
ses charges ordinaires.
Alors que les régions ont une connaissance du tissu
socio-économique local, il apparaît peu efficace de les cantonner
à une responsabilité résiduelle, même si l'Etat doit
conserver globalement la maîtrise des orientations prioritaires qui
couvrent les secteurs les plus décisifs de la politique
économique et sociale.
Votre mission d'information a estimé que la conjoncture
économique favorable permettait de franchir une nouvelle étape en
faveur de la
décentralisation de la formation professionnelle
afin d'assurer une adéquation des performances de l'appareil de
formation professionnelle aux débouchés offerts par les bassins
d'emplois locaux.
L'Etat ne devrait conserver en dernier ressort de compétences que sur
les seules actions de formation professionnelle qui relèvent de la
solidarité nationale
et qui ne peuvent à ce titre
être rattachées à aucune région
déterminée : il s'agit des actions en faveur des
détenus, des étrangers ayant le statut de réfugiés,
des jeunes relevant des institutions d'éducation surveillée et
des personnes handicapées dont le financement doit impliquer l'ensemble
de la collectivité nationale.
En revanche, deux domaines pour l'avenir devaient connaître une
décentralisation plus achevée :
- le premier porte sur les
actions de formation continue
qui ne
relèvent pas aujourd'hui du fonds régional de la formation
professionnelle et de l'apprentissage. Il s'agit notamment des actions de
formation de droit commun de l'association pour la formation professionnelle
des adultes (AFPA) ;
- le second concerne les programmes prioritaires, en faveur notamment des
chômeurs de longue durée, relevant des orientations prioritaires
définies annuellement par le comité interministériel de la
formation professionnelle et de la promotion sociale. Là encore les
régions peuvent jouer un rôle plus décisif en articulation
avec les compétences dévolues au département en
matière d'insertion.
La décentralisation doit passer prioritairement
par une
réorganisation territoriale de l'AFPA en agences régionales
placées sous la responsabilité des régions.
L'objectif doit être, dans le
respect de l'autonomie
des
partenaires sociaux
, de permettre aux régions de détenir une
marge d'impulsion élargie tant en ce qui concerne l'homologation des
enseignements que l'adaptation de leurs contenus aux réalités
locales.
Qu'il s'agisse de l'apprentissage ou de la formation continue des adultes, la
décentralisation passe par une influence reconnue des régions
dans l'organisation des filières et par la possibilité
d'adaptation de la réglementation nationale.
Le transfert des centres locaux de l'AFPA à la région, dans un
cadre conventionnel respectueux des contraintes et des besoins des acteurs
socio-économiques, permettra de mieux insérer ces organismes dans
la vie économique régionale.
C. L'ÉQUIPEMENT : CONFIER AU DÉPARTEMENT L'ENTRETIEN DES ROUTES NATIONALES
Il
convient de rappeler que la loi du 2 mars 1982 confie au président du
conseil général la gestion du domaine public routier
départemental.
La définition de ce dernier remonte historiquement à un
décret impérial du 16 décembre 1811 qui opérait un
classement des routes en distinguant les " routes impériales "
des routes départementales. Il prévoyait les mesures
nécessaires à leur création et à leur entretien.
Un décret-loi du 14 juin 1938 a par la suite précisé que
les "
routes départementales, les chemins vicinaux de grande
communication et d'intérêt commun sont fondus en une seule
catégorie de voies dénommées chemins publics
départementaux ".
Cette appellation sera modifiée
par le code de voirie routière qui reviendra à l'appellation de
routes départementales.
De fait, la distinction entre routes départementales et routes
nationales n'a rien d'intangible. Parce que le réseau des routes
nationales qui atteignait près de 82.000 km en 1970 entraînait par
sa taille une trop forte dispersion des moyens financiers, la loi
n° 71-1061 du 29 décembre 1971 a transféré
près de 53.000 km de routes nationales dans la voirie
départementale.
La mission d'information a estimé que près de trente ans
après l'opération de 1971, une nouvelle opération de
transfert devrait intervenir afin de permettre aux départements, avec le
soutien des régions, de procéder aux travaux d'entretien dont le
besoin se fait sentir.
Le transfert devrait porter sur une partie importante du réseau routier
national non concédé, l'Etat devant demeurer compétent en
matière d'investissements sur le réseau autoroutier non
concédé.
Comme le rappelle notre collègue M. Gérard Miquel dans son
rapport spécial annuel
341(
*
)
, des
études techniques sur le réseau national non
concédé montrent que, s'agissant des chaussées, 11 %
des voies nécessitent des interventions lourdes. Concernant les ouvrages
d'art, 10 % d'entre eux doivent faire l'objet d'un simple entretien
courant et 66 % nécessitent un entretien spécialisé.
Dans 5 % des cas, la structure est atteinte de manière grave ce qui
nécessitera des travaux de réhabilitation réparation.
De fait, comme le rappelle le rapporteur spécial,
le problème
de l'entretien du réseau routier national est devenu crucial
. Les
crédits d'entretien sont en baisse alors même que
" la
faiblesse de ces dotations conduit immanquablement à une
dégradation du patrimoine routier ".
Enfin, il est indéniable que les collectivités locales, notamment
les régions, sont déjà fortement sollicitées par la
voie de
fonds de concours
sur le réseau routier national.
Les collectivités locales sont ainsi fréquemment
" invitées " à participer au financement de travaux de
renforcement ou d'élargissement à deux fois deux voies sur le
réseau routier national qui répondent à une demande forte
de la part des usagers. En 2000, les dépenses du budget de l'Etat
afférentes au réseau national non concédé
représentaient 6,3 milliards de francs (dont 3,4 milliards de
francs au titre de l'entretien) alors que les fonds de concours devaient
contribuer à hauteur de 4 milliards de francs au financement.
Dans le bilan complet
342(
*
)
qui est
dressé par le rapport " Delafosse ", il apparaît qu'en
1993 les fonds de concours impliquant les collectivités locales avaient
servi à 78 % à financer les travaux sur les routes
nationales, soit 5,7 milliards de francs au total versés par les
régions pour près de 70 % et par les départements
pour 25 %.
Un nouveau transfert doit être opéré en matière
d'entretien des routes nationales assorti des moyens nécessaires pour
permettre aux départements d'accomplir cette mission.
D. L'ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE : DÉMÊLER L'ÉCHEVEAU DES COMPÉTENCES PARTAGÉES ENTRE L'ETAT ET LE DÉPARTEMENT
1. Clarifier la répartition des compétences
•
La mission d'information propose tout d'abord de rétablir une
unité d'action en matière de politique de santé en
transférant à l'Etat les actions départementales de
prévention sanitaire
Une telle mesure de recentralisation apportée sera en
réalité une opération de clarification et de
simplification car la prévention sanitaire constitue un
élément essentiel de la politique de santé qui ne saurait
relever d'approches cloisonnées en fonction de compétences.
Il est donc proposé de transférer à l'Etat les
compétences confiées au département dans les
domaines :
- des actions de lutte contre la lèpre ;
- du dépistage précoce des affections cancéreuses et de
la surveillance après traitement des anciens malades ;
- de la prophylaxie de la tuberculose et des maladies
vénériennes (lutte contre les " fléaux
sociaux ").
•
La mission d'information suggère ensuite de simplifier
les règles de prise en charge des personnes handicapées
Afin de simplifier et de clarifier le dispositif, il est proposé une
répartition des compétences non plus par catégorie
d'établissement mais
par fonction
correspondant à un
besoin.
Le département deviendrait la collectivité " chef de
file " pour l'exercice de la fonction
" vie quotidienne et
accompagnement social "
recouvrant l'hébergement, les loisirs
et l'aide à l'autonomie, que la personne handicapée soit à
domicile ou en établissement.
L'Etat assurerait la fonction
" emploi, travail ou
activité "
suivant la nature du handicap ; la fonction
" soins "
incomberait aux organismes de protection sociale.
Pour chacun des établissements, une clé de répartition
juste et équitable entre les financeurs devra être
déterminée en fonction d'une appréciation exacte de la
réalité de la nature des dépenses.
2. Revenir à l'esprit des " blocs de compétence " pour gérer les nouveaux domaines de l'action sociale
•
La mission d'information propose de revenir à l'esprit de la
décentralisation en mettant fin aux formules de cofinancement
obligatoire des fonds d'aide aux jeunes (FAJ) et des fonds de solidarité
pour le logement (FSL)
Les FAJ et les FSL ne peuvent être supprimés car ils
représentent des formules utiles d'aide aux personnes en
difficulté pour l'aide à l'accès ou au maintien dans un
logement ou pour l'entrée des jeunes en difficulté dans la vie
active.
En revanche, il faut revenir à l'esprit des lois de
décentralisation : les missions actuellement dévolues aux
FAJ et aux FSL doivent être confiées aux départements.
En contrepartie l'effort financier de l'Etat doit être maintenu :
- soit sous la forme du transfert d'une recette fiscale dont les
départements fixeraient les taux ;
- soit sous la forme d'une " dotation de mission
décentralisée " qui pourrait comprendre une partie fixe
indexée sur le niveau des dotations actuellement
déléguées par l'Etat au titre des FAJ et des FSL et une
partie variable, jouant une fonction de péréquation, en tenant
compte de critères tels que le nombre de jeunes en difficulté, le
nombre de logements sociaux ou de places en structure d'hébergement
d'urgence.
Les conseils généraux pourront ajuster au mieux les
critères d'attribution des aides des FSL et des FAJ pour tenir compte
des situations locales dans le respect du cadre légal.
•
Enfin, la mission d'information préconise d'engager une
consultation en vue de clarifier les responsabilités dans le dispositif
départemental d'insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du RMI afin d'en améliorer
l'efficacité
Le nombre de bénéficiaires du RMI s'est beaucoup accru depuis
1988 ; depuis un an la reprise de la croissance n'entraîne pas de
baisse significative des titulaires du RMI.
Le système actuel manque de clarté et de
visibilité ; l'objectif doit être de
mettre fin à
la " cogestion ",
c'est-à-dire à la
présidence conjointe du conseil départemental de l'insertion
(CDI) et à l'élaboration conjointe du programme
départemental d'insertion (PDI).
En partant de l'existant, il convient de préciser quelles sont les
missions assumées par chacun en analysant les compétences et les
responsabilités réellement exercées.
Une fois les responsabilités clarifiées, le plan
départemental d'insertion sera fondé sur une démarche
partenariale ; il s'agira d'une convention précisant les
engagements de chaque partenaire dans un cahier des charges.
La présence des collectivités locales devrait être
réaffirmée au niveau des bureaux des commissions locales
d'insertion (CLI) dont les fonctions devraient être plus importantes en
matière de contrôle d'exécution et de validation des
contrats.
Le rôle des départements dans la gestion du RMI devrait
être conçu en cohérence avec la clarification de leurs
responsabilités dans la gestion des FSL et des FAJ.
E. LA CULTURE : MIEUX ORDONNER UN PAYSAGE CONFUS
Comme on
l'a vu dans la première partie de ce rapport, la culture est un domaine
qui a fait l'objet de
transferts de compétence limités
,
circonscrits aux
bibliothèques
et aux
archives
. Pour le
reste, l'enchevêtrement des compétences partagées entre
l'Etat et les collectivités locales, agencé par une multitude de
contrats, a engendré une complexité flagrante. Les financements
croisés sont la règle. Au moyen de contributions
financières modérées, l'Etat continue de piloter nombre de
projets culturels locaux.
Les tentatives pour clarifier les compétences entre l'Etat et les
collectivités locales n'ont jamais abouti et le ministère de la
culture a préféré la déconcentration à la
décentralisation.
Cette situation n'a pas découragé le dynamisme des
collectivités locales, lesquelles éprouvent trop souvent
cependant le sentiment de dépenser beaucoup en restant fortement
influencées par les orientations du ministère dans leurs
initiatives.
La mission propose
deux mesures de clarification
.
La première concerne la
protection du patrimoine
,
prérogative régalienne de l'Etat pour des raisons historiques
liées au droit de propriété sur les monuments
classés, mais cogérée avec les collectivités
locales en matière d'usage et de transformation du patrimoine. Ainsi,
l'entretien du patrimoine représente le second poste de dépense
des départements. L'inventaire des richesses archéologiques,
architecturales et patrimoniales, compétence de l'Etat, est
majoritairement financé par les départements, dans le cadre de
leur politique en matière de tourisme.
La mission propose de
transférer l'inventaire aux
départements
, avec les personnels compétents, ce qui
permettrait une meilleure lisibilité et une plus grande proximité
entre le décideur et l'expression des besoins.
Les communes peuvent être associées à l'inventaire du
patrimoine architectural du XXè siècle à conserver, ainsi
qu'à la protection et à la promotion des éléments
non classés du patrimoine immobilier.
La seconde proposition de la mission concerne
l'enseignement
artistique
. La répartition actuelle des compétences manque de
clarté. L'enseignement artistique est dispensé dans les
établissements d'enseignement général, écoles,
collèges et lycées. Les collectivités locales peuvent en
outre créer chacune à leur niveau des écoles publiques
d'art à vocation spécifique : musique, danse, arts
plastiques. Le fonctionnement des écoles est placé sous le
contrôle de l'Etat, qui pourtant ne contribue qu'à hauteur de
10 % au financement de l'enseignement artistique organisé par les
collectivités locales.
La mission propose de décentraliser les écoles, selon leur
niveau, en les plaçant sous l'entière responsabilité des
collectivités locales -majoritairement des communes- qui sont à
l'origine de leur création, dans le cadre d'un schéma
départemental d'enseignement artistique. Les régions seraient
chef de file pour l'enseignement de haut niveau à vocation
professionnelle.
Un financement approprié devrait accompagner ce transfert de
responsabilités, associant l'Etat, le département et
peut-être la région, pour contribuer à aider les communes
les moins riches à faire face aux besoins.
Les collectivités disposeraient d'une plus grande latitude pour
recruter les personnels chargés de l'enseignement artistique, en
particulier des professeurs de musique titulaires de diplômes
délivrés par les conservatoires.
F. LA SÉCURITÉ : OUVRIR DROIT À L'EXPÉRIMENTATION POUR PLACER UNE POLICE TERRITORIALE DE PROXIMITÉ SOUS L'AUTORITÉ DES MAIRES
1. Une exigence : relever le défi de la délinquance de proximité
La
sécurité constitue, après le chômage, la
deuxième préoccupation
de nos concitoyens.
Or, le bilan établi par votre mission d'information a souligné
une évolution inquiétante des phénomènes
d'insécurité.
D'une part, la délinquance connaît globalement une
forte
progression
, la délinquance dite de voie publique occupant une place
prédominante dans ce bilan (54,9%).
D'autre part, l'insécurité de proximité s'aggrave, avec
notamment l'apparition de
formes nouvelles de délinquance
, telles
que les violences urbaines et ce qu'il est convenu d'appeler les
" incivilités ".
Par ailleurs, la progression de la
délinquance des mineurs
constitue un phénomène très préoccupant.
Face au défi que constitue l'insécurité,
l'Etat doit
à l'évidence jouer un rôle majeur.
C'est à lui
qu'il revient en priorité de garantir le respect du
droit à la
sûreté
qui, selon
l'article 2
de la déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, sont au même titre que la
liberté, la propriété et la résistance à
l'oppression, des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.
Pour autant, le maire s'est vu reconnaître un pouvoir de police
générale. En outre, le développement des
polices
municipales
a mis en évidence que, face aux carences de l'Etat, les
communes ont été de plus en plus appelées à
intervenir dans ce domaine, au point que la sécurité peut
apparaître d'ores et déjà comme une
compétence
très largement
partagée
entre l'Etat et les communes.
Tel est le sentiment exprimé par une forte majorité des
élus d'Aquitaine (62% de réponses dans ce sens), lors des Etats
généraux organisés à Bordeaux, le 17 mars dernier.
Ce sentiment est encore plus affirmé dans les communes de
plus de 10
000
habitants (83% des réponses).
2. Mieux associer les élus locaux aux politiques de sécurité
L'Etat a
lui-même incité les collectivités locales à
s'associer à son action dans des partenariats, tels que les contrats
locaux de sécurité. Cette démarche témoigne du
besoin accru d'une
territorialisation
des politiques de
sécurité.
Le bilan établi par votre mission d'information a néanmoins
relevé les
limites actuelles
de la politique de la police de
proximité menée par l'Etat. Cette politique a fait l'objet d'une
mise en route laborieuse
et reste marquée par beaucoup
d'incertitudes.
Son succès sera donc subordonné à la
correction
des
différents défauts qui ont pu être constatés :
faiblesse des diagnostics préalables, mise en cohérence des
différents dispositifs, mise à niveau des effectifs, formation
des personnels.
En outre, comme l'a suggéré le président Christian
Poncelet, à l'occasion des Etats généraux des élus
locaux, qui se sont tenus à Bordeaux, sans remettre en cause l'essence
régalienne des politiques de sécurité, celles-ci doivent
entrer dans le " nouvel âge " de la
compétence
partagée
avec ceux qui incarnent le pouvoir de proximité, se
trouvent confrontés au désarroi et aux attentes de leurs
concitoyens et dont le bilan est en partie jugé sur l'état de la
sécurité dans leur commune.
Certes, les polices municipales, par le rôle préventif et
dissuasif qu'elles assument, contribuent à associer les maires à
la mise en oeuvre des politiques de sécurité dans le cadre
désormais prévu par la loi du 15 avril 1999. Cette association
pourrait néanmoins prendre une
forme plus ambitieuse.
A cette fin, les communes pourraient se voir reconnaître un
droit
à l'expérimentation
pour la création
d'une police
territoriale de proximité placée sous l'autorité du maire
et soumise au contrôle de l'Etat et des procureurs de la
République.
Cette police territoriale pourrait résulter de la fusion des polices
municipales existantes et des unités territoriales de la police
nationale.
Ses missions devraient concerner la
sécurité publique de
proximité
. Elle devrait à cette fin traiter en
priorité la petite délinquance et veiller à un meilleur
accueil des victimes.
Les services relevant de l'Etat pourraient, pour leur part, davantage se
consacrer à la criminalité organisée et à la grande
délinquance sur un ressort territorial élargi.
Dans les communes ayant fait ce choix, le maire disposerait d'une
plénitude de compétences
pour gérer les
problèmes de sécurité qui touchent directement la vie
quotidienne de nos concitoyens.
Il jouerait un rôle majeur, en liaison avec la gendarmerie et la police
nationale, pour faire en sorte que certaines parties du territoire ne soient
pas des " zones de non droit " où les lois de la
République ne s'appliqueraient pas.
Enfin, votre rapporteur relève que l'évolution des politiques de
sécurité dans les prochaines années posera la question de
la
mise en commun des moyens
des communes sur un périmètre
plus large que le territoire communal. Le rôle de la coopération
intercommunale dans ce domaine ne devra donc pas être occulté,
même si sa traduction concrète peut s'avérer plus
délicate, le pouvoir de police étant un pouvoir propre du
maire.
G. LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS : RENFORCER LE RÔLE DU DÉPARTEMENT
1. Le bilan de la départementalisation
La
loi n° 96-369 du 3 mai 1996
a prévu la
départementalisation des services d'incendie et de secours, dans un
délai de cinq ans, afin de favoriser une distribution des secours
égale sur l'ensemble du territoire et de rationaliser l'action de
structures locales très hétérogènes. Ces services
ont été installés, suivant les départements, entre
le printemps 1997 et le printemps 1998.
Le service départemental d'incendie et de secours est un
établissement public commun au département, aux communes et
aux structures intercommunales
. Son conseil d'administration est
composé de représentants de ces collectivités et
établissements, le préfet y siégeant de plein
droit
343(
*
)
.
Les
transferts des personnels et des biens
affectés au service
d'incendie et de secours doivent s'opérer dans un délai de cinq
ans suivant la promulgation de la loi du 3 mai 1996. Au 31 décembre
1999, les transferts réalisés concernaient 60 % des
effectifs de sapeurs-pompiers professionnels, 40 % des effectifs de
sapeurs-pompiers volontaires et l'ensemble des matériels roulants,
tandis que 67 schémas départementaux d'analyse et de couverture
des risques (SDACR) étaient arrêtés par le préfet.
La réforme de 1996 a entraîné une
harmonisation
à l'intérieur du département. Outre la création
d'un corps départemental de sapeurs-pompiers (professionnels et
volontaires), le régime du travail a été revu à la
baisse, le régime indemnitaire à la hausse
344(
*
)
, la faculté pour les collectivités
locales de rémunérer les vacations des sapeurs-pompiers
volontaires étant devenue obligation. Malgré les efforts
considérables des collectivités locales en direction des
personnels et pour améliorer la qualité du service d'incendie et
de secours, le mécontentement des sapeurs-pompiers s'est traduit par
plusieurs mouvements de grève.
La réforme a aussi conduit à une importante
mise à
niveau
des infrastructures et des équipements, afin d'uniformiser la
couverture des risques dans le département. A terme, la
mutualisation
des ressources et des moyens
devrait permettre des économies
d'échelle... à condition de réussir dans des conditions
équitables la
mutualisation des charges
.
Comme le relevait notre collègue
M. René-Georges Laurin, rapporteur pour avis
345(
*
)
du budget de la sécurité civile,
"
plusieurs présidents de SDIS estiment qu'il leur sera
difficile de mettre en oeuvre avant le 3 mai 2001, date prévue par
la loi du 3 mai 1996, l'ensemble des dispositions prévues pour la
départementalisation des services d'incendie et de secours, en raison
des enjeux financiers de la réforme
".
2. Le financement très contesté des SDIS
Le
services départementaux d'incendie et de secours sont financés
par les communes et établissements publics de coopération
intercommunale membres ainsi que par le département. Les contributions
de ces collectivités au budget du SDIS constituent des
dépenses obligatoires
dont la répartition est fixée
par le conseil d'administration selon des paramètres fixés par la
loi. Une très grande diversité caractérise ainsi les
clés de répartition des cotisations de chacune des
collectivités membres du SDIS. La mise à niveau des
équipements, source de
dépenses supplémentaires
considérables
pour un grand nombre de collectivités, a
exacerbé les tensions liées à la répartition des
charges et à la péréquation entre les communes.
En pratique, en fonction des " clés de répartition "
propres à chaque SDIS, la part des départements dans le
financement peut varier de 10 % à 99,99 %, laissant donc
apparaître des clivages sensibles entre collectivités.
De plus, les élus locaux s'interrogent légitimement sur le
financement d'un service dont le pouvoir décisionnel relève, pour
une grande part, de l'État
, tandis que le coût en est
largement supporté par les collectivités locales. Ainsi, l'Etat
fixe le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers, tandis que la
direction opérationnelle des secours est partagée entre le
préfet et le maire, selon leurs pouvoirs de police respectifs.
Or, l'Etat tend à se désengager, comme en témoigne la
diminution des crédits de subvention pour les dépenses de
services d'incendie et de secours de la sécurité civile.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur
346(
*
)
au nom
de la commission des Lois d'une proposition de loi de notre collègue
Jean Faure tendant à permettre aux communes d'exiger des
intéressés le remboursement des frais de secours qu'elles ont
engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la
pratique d'une activité sportive ou de loisir, soulignait ainsi
"
la nécessité de
redéfinir
de
manière plus claire et plus stable
les relations financières
entre l'État et les collectivités territoriales en matière
de secours
".
3. Pour un renforcement du rôle du département
La
commission de suivi et d'évaluation
de la loi du 3 mai 1996,
présidée par M. Jacques Fleury, député et
parlementaire en mission, dont le rapport vient d'être remis au ministre
de l'Intérieur, propose
trois pistes pour la réforme du
financement
des services d'incendie et de secours :
- un
renforcement de l'implication financière de l'Etat
(aides
exceptionnelles en cas de catastrophes de grande ampleur ; aide aux
collectivités les moins riches ou les plus exposées...) ;
-
une contribution des sociétés d'assurance et d'autoroute et
des agences régionales d'hospitalisation
aux dépenses de
sécurité civile ;
-
une révision des règles de répartition des
contributions
entre le département, les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale
de nature
à contenir les charges des communes
et un aménagement en
conséquence de la représentation de ces collectivités et
établissements au sein des conseils d'administration des SDIS.
De son côté,
l'Assemblée des Départements de
France (ADF)
et l'Association des présidents de SDIS
(APSIS)
demandent qu'une réflexion de fond soit engagée
sur le devenir de la
compétence
incendie et secours, en raison de
la dualité des pouvoirs et des responsabilités entre les
présidents de SDIS et les préfets, et que soit mis à
l'étude le recours à la
fiscalisation directe
par le SDIS.
Pour sa part, votre mission souhaite que le rôle du département
dans le fonctionnement des SDIS soit renforcé.
Pour autant, un aménagement de la répartition des
responsabilités entre collectivités ne doit pas occulter
l'impératif d'une plus grande implication financière de
l'Etat, dont le rôle ne doit pas se limiter à la prise de
décisions que les collectivités doivent ensuite supporter
.
H. LES INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES DES COLLECTIVITÉS LOCALES : ADAPTER LE DROIT AUX RÉALITÉS LOCALES
Les
interventions économiques des collectivités locales peuvent
être utiles et efficaces, à la condition d'être
engagées et conduites dans un contexte juridique encadrant
convenablement leur liberté de manoeuvre.
Comme le soulignait notre collègue Daniel Hoeffel, rapporteur du groupe
de travail de la commission des lois sur la décentralisation
347(
*
)
, les collectivités locales ont
un
rôle essentiel à jouer pour maintenir un certain niveau
d'équité sociale et territoriale
. Elles peuvent contribuer
à créer un cadre cohérent pour les entreprises et
promouvoir des projets collectifs. A travers des démarches
partenariales, les élus locaux, qui connaissent le tissu
économique, sont bien placés pour identifier les besoins et
imaginer des solutions pour l'emploi local.
Or, comme on l'a vu, l'efficacité des interventions économiques
des collectivités locales est mise en question par la
complexité du cadre juridique national,
en décalage avec
la réalité, à laquelle s'ajoutent les incertitudes
résultant de son
défaut d'harmonisation avec le droit
communautaire
d'inspiration plus libérale. Ainsi, la distinction
entre les aides directes et les aides indirectes -que la loi n'a pas
définie précisément- s'avère d'autant moins
pertinente que le Traité de Rome ne la prend pas en compte. Les
dispositions communautaires applicables résultent d'actes de la
Commission européenne dont la valeur juridique demeure incertaine. Les
collectivités locales ne sont pas suffisamment averties des obligations
de notification à la Commission européenne auxquelles elles
doivent se soumettre.
M. Emile Zuccarelli, précédent ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
avait élaboré un projet de loi, destiné à
simplifier la législation nationale et à l'adapter au cadre
communautaire, qui n'a pas été présenté au
Parlement.
LE " PROJET ZUCCARELLI "
Le
" projet Zuccarelli " se proposait de supprimer la distinction
entre aides directes et aides indirectes et de lui substituer un régime
unique de subventions dont les collectivités locales
détermineraient elles-mêmes les critères d'attribution dans
la limite de taux plafonds fixés par référence aux
plafonds admis par la Commission européenne. Le projet supprimait donc
la prime régionale à l'emploi, la prime régionale à
la création d'entreprise, les bonifications d'intérêts, les
prêts et avances à des conditions plus favorables que le taux du
marché, de même que toutes les aides à l'immobilier
d'entreprise ainsi que la possibilité de financer ou d'accorder sans
limitation de montant des aides en nature aux entreprises.
En outre, le projet plafonnait le montant total annuel des dépenses des
collectivités locales et des groupements en faveur des entreprises
à un pourcentage de leurs recettes de fonctionnement.
Les nouveaux moyens d'intervention prévus par le projet de loi
A la place des aides qu'il supprimait, le projet dotait les
collectivités locales de moyens d'interventions nouveaux qui devaient
leur permettre de soutenir la création et le développement
d'entreprises par des subventions aux investissements et en facilitant leur
accès au crédit et au renforcement de leurs fonds propres.
•
Les subventions
Les subventions auraient pu être distribuées par les communes, les
départements, les régions et les groupements intercommunaux au
profit d'investissements matériels ou immatériels ; mais
elles n'auraient concerné que les entreprises de moins de 250
salariés.
Le montant des subventions aurait été plafonné à
600 000 francs, dans la limite de 50 % de l'investissement
réalisé.
•
L'accès au crédit
Le projet prévoyait de permettre aux collectivités locales et
à leurs groupements de doter des fonds de garantie auprès de
société de garantie sans forcément être actionnaires
de ces établissements.
•
Le renforcement des fonds propres
Deux modalités d'intervention nouvelles auraient été
offertes aux collectivités locales :
1° - Possibilité de doter des fonds d'investissement auprès
de sociétés de capital-investissement ;
2° - Possibilité de prendre en charge les commissions dues par les
bénéficiaires de garanties d'apport en fonds propres.
Dans l'attente d'une réforme, une circulaire récente du Premier
ministre, en date du 8 février 1999, relative à
l'application au plan local des règles relatives aux aides publiques, a
tenté de mettre au clair ce qui est autorisé et ce qui est
interdit par combinaison du droit national et du droit européen. Ce
texte, certainement utile pour guider les élus locaux dans leurs
initiatives, ne suffit pas cependant à clarifier une situation confuse.
Votre mission considère qu'une
meilleure coordination avec le droit
communautaire
est un objectif prioritaire, afin de faire
bénéficier les territoires des fonds structurels européens
dans les meilleures conditions. Il faut en particulier abandonner la
distinction entre
aides directes et indirectes
et redéfinir les
interventions en fonction des plafonds communautaires, en prenant en compte des
éléments objectifs tels que le coût des opérations
subventionnées ou la taille de l'entreprise.
Il paraît souhaitable de rechercher une plus grande
complémentarité entre les différentes
collectivités, en organisant des partenariats, à partir de
l'approche globale d'un projet économique.
Afin de
garantir les collectivités locales
contre les risques
financiers encourus, les ratios prudentiels existants devraient être
préservés, ce qui n'exclut pas de recourir à de nouveaux
critères. Ainsi, la participation d'une collectivité au
financement d'un projet pourrait être plafonnée en fonction de la
charge relative qui en résulterait pour son budget.
Le réalisme et la prudence qui devraient guider toute réforme des
interventions économiques des collectivités locales n'interdisent
pas l'innovation et l'audace.
C'est ainsi que le Sénat a adopté le 10 février 2000
une
proposition de loi
(n° 254, 1998-1999) tendant à
favoriser la
création et le développement des entreprises sur
les territoires
, issue des travaux du groupe de travail " Nouvelles
entreprises et territoires ", constitué au sein de la commission
des affaires économiques, et animé par nos collègues
Jean-Pierre Raffarin et Francis Grignon. Parmi un ensemble de mesures
destinées à promouvoir la création d'entreprises, ce texte
ouvre des
perspectives novatrices à l'action publique locale
.
Votre mission tient à souligner tout l'intérêt de ce
dispositif, qui permettrait aux collectivités locales de contribuer
à la naissance et au développement des entreprises innovantes.
LA
PROPOSITION DU SÉNAT EN FAVEUR DE LA CRÉATION
ET DU
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Le
Sénat, souhaitant améliorer l'environnement de la création
d'entreprises dans une logique de développement local mieux
réparti, plus durable et plus harmonieux, a adopté la proposition
de loi, présentée par MM. Raffarin, Grignon et plusieurs de
leur collègues, tendant à favoriser la création et le
développement des entreprises sur les territoires. Le Sénat
entend ainsi veiller au développement territorial, faciliter les
financements de proximité, simplifier le statut juridique et social de
l'entrepreneur et, d'une manière générale, favoriser
l'essor des petites et moyennes entreprises.
Quatre articles de la proposition de loi sénatoriale concernent plus
spécifiquement les collectivités territoriales. Les modifications
qu'ils contiennent avaient déjà été introduites par
le Sénat lors de la discussion de la loi n° 99-533 du
25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire, mais le Gouvernement s'y
était opposé, au motif de la discussion à venir d'un
projet de loi réformant le régime des interventions
économiques des collectivités locales (projet Zuccarelli).
L'article 3 de la proposition de loi a trait à la participation des
collectivités territoriales à la création
"
d'incubateurs territoriaux
". A la différence d'une
pépinière d'entreprises, un incubateur accueille les porteurs de
projets avant même la création de leur entreprise, et les
accompagne tout au long de celle-ci. Si le Gouvernement envisage de faciliter
la création de structures de ce type au sein des universités et
des organismes de recherche, aucune disposition ne le permet à l'heure
actuelle pour les collectivités territoriales.
La proposition de loi vise donc à combler un vide juridique, en donnant
la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs
groupements de mettre à la disposition des porteurs de projets
" des locaux, du matériel, des moyens, y compris humains "
- voire des équipements - afin qu'ils puissent notamment
réaliser un plan de financement de leur projet de création
d'entreprise. Une convention est conclue entre le bénéficiaire et
la collectivité : elle fixe d'ailleurs, le cas échéant, le
montant d'une bourse dont le bénéficiaire peut
bénéficier pendant deux ans au plus, sous certaines conditions,
afin " d'atténuer (...) les conséquences financières
sur sa situation individuelle de son projet de création
d'entreprise ".
Cette bourse serait réservée, sous conditions de ressources, aux
jeunes créateurs d'entreprises de moins de 25 ans.
Plusieurs partenaires (collectivités, établissements publics,
SEML, etc.) peuvent décider d'effectuer en commun cette mise à
disposition : ils signent alors une convention entre les différents
partenaires, déterminant notamment le mode de sélection des
porteurs de projets.
L'article 3 permet également aux collectivités locales de
participer la constitution ou à l'abondement de " fonds
d'amorçages territoriaux ". Ces fonds d'investissement,
appelés à intervenir avant même le recours au
capital-risque, pourraient ainsi agir à l'échelon local. La
participation financière des collectivités territoriales pourrait
y être indirecte, en finançant les frais d'instruction des petits
dossiers : sinon, toute participation directe sera soumise à un plafond
(défini ultérieurement par décret en Conseil d'Etat),
étant établi que de toute façon " la part des
concours financiers publics au fonds d'amorçage ne peut excéder
la moitié du total des concours ".
L'article 4 institue un
label de
"
pôle d'incubation
territorial
", décerné dans le cadre du contrat de plan
Etat-région, et qui pourrait permettre à ce pôle
d'accéder à des aides et à des avantages fiscaux
spécifiques.
Il instaure par ailleurs, à l'appréciation des
collectivités locales, une possibilité d'exonération
totale ou partielle de la taxe professionnelle pour les entreprises qui ont
été créées grâce à l'action d'un
pôle d'incubation territorial, pour une durée maximale de trois
ans.
L'article 6 encadre le soutien financier des collectivités territoriales
aux organismes qui distribuent des
avances remboursables
, soutien qui
pour l'heure relève d'une pratique sans fondement légal.
Deux plafonds sont ainsi prévus, aucune collectivité ne pouvant
apporter à elle seule plus de 30 % des fonds distribués par
un tel organisme, et l'ensemble des concours publics reçus par celui-ci
ne pouvant en excéder 60 % (70 % dans certaines zones
définies par la loi " Pasqua " du 4 février 1995).
Enfin, l'article 8 a directement trait aux avances remboursables dont peuvent
bénéficier, sous certaines conditions, les créateurs
d'entreprises : c'est-à-dire des prêts, sans
intérêt, financés par l'Etat, remboursables sous cinq ans.
Il prévoit que les collectivités territoriales peuvent contribuer
à la mise en oeuvre et au financement de ces avances, par le biais d'une
convention passée avec l'Etat.
CHAPITRE III
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES
SPÉCIFICITÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
La prise
en compte de la spécificité des collectivités
territoriales, la responsabilité accrue des élus dans le choix de
leurs collaborateurs, la simplification des structures et la réduction
des charges financières ont toujours constitué les
priorités du Sénat en matière de fonction publique
territoriale.
Ces priorités demeurent d'actualité, l'assouplissement des
contraintes statutaires devant permettre de mieux affirmer la
spécificité des collectivités locales (II).
Mais ces dernières devront en outre relever le défi de la
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
(I).
I. RELEVER LE DÉFI DES 35 HEURES
A. DE TROP NOMBREUSES INCERTITUDES
1. L'absence de norme
Une
enquête de l'Association des Maires de France sur la réduction du
temps de travail dans la fonction publique territoriale met en évidence
que
l'absence de référence législative
sur la
durée du travail dans la fonction publique territoriale est ressentie
par les maires.
En effet, à l'heure actuelle,
aucun texte législatif ou
réglementaire
ne fixe la durée hebdomadaire de travail des
agents des collectivités territoriales. La jurisprudence
administrative
348(
*
)
considère qu'il
appartient à l'organe délibérant de régler
l'organisation des services de la collectivité, et notamment de fixer la
durée hebdomadaire du travail du personnel territorial.
Toutefois, le décret n° 94-725 du 24 août 1994
relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction
publique de l'Etat, qui fixe cette durée à 39 heures, peut
servir de référence aux collectivités territoriales. La
parité entre les fonctions publiques en matière de
rémunération conduit à la parité en matière
de temps de travail.
Le législateur a déjà eu l'occasion de se prononcer en
faveur de
l'annualisation du temps de travail
, dans la seule fonction
publique territoriale. L'expérimentation de l'annualisation du temps de
travail
349(
*
)
des agents à temps partiel
et des agents à temps non complet
350(
*
)
est prévue par la " loi Hoeffel " du
27 décembre 1994. Toutefois, en raison de l'absence de
décret d'application cette dernière disposition est restée
lettre morte... laissant les élus locaux et les agents, notamment les
agents techniques spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM), dans l'incertitude juridique.
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail a ouvert la voie à une
réduction du temps de travail dans la fonction publique, en des termes
peu précis
351(
*
)
.
2. Le constat établi par le " rapport Roché "
Le
rapport remis le 10 février 1999 par
M. Jacques Roché
, conseiller maître honoraire
à la Cour des comptes, sur le temps de travail dans les trois fonctions
publiques, aboutit aux conclusions suivantes :
- l'environnement réglementaire actuel est inadapté ;
son cadre rigide n'a pas empêché une
extrême
diversification des situations
qui se sont développées par
accumulation de mesures ponctuelles, sans réflexion globale ;
- la durée hebdomadaire de travail n'est plus qu'une
référence théorique tant les instruments de modulation
à la disposition des agents sont nombreux (congés
supplémentaires, autorisations d'absence, horaires variables...) ;
- pour opérer des comparaisons incontestables et pertinentes, seul
le
décompte annuel des heures travaillées
permet de
prendre en compte toutes les variations et modulations qui affectent le temps
de travail ;
Ainsi, dans la fonction publique territoriale,
25 % des
collectivités affichent une durée hebdomadaire de travail
inférieure ou égale à 35 heures tandis que 41 %
se situeraient entre 36 et 38 heures hebdomadaires ;
- faute d'un instrument de mesure uniforme, les différences
constatées dans les durées de travail ne sont pas lisibles. Des
inégalités de traitement des personnels se sont
développées sans que des motifs objectifs les justifient ou
continuent de les justifier ; en particulier, les modifications du
régime indemnitaire, censées compenser les
"
particularismes
" de certaines fonctions, ne sont pas
réexaminés ; ces pratiques constituent un
obstacle
à la polyvalence et à la mobilité des agents
;
- la souplesse introduite dans l'aménagement du temps de travail
n'a pas été assez axée sur les
besoins des usagers
mais trop souvent liée à la conclusion d'accords locaux suite
à certains conflits ;
- en général, la réduction et l'aménagement du
temps de travail n'ont pas été l'occasion d'une
réflexion globale sur l'organisation du travail
.
B. UNE MÉTHODE CONTESTABLE
1. La méthode réglementaire a été retenue après l'échec d'un accord-cadre
Le
projet d'accord cadre relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique n'ayant
été approuvé que par un seul syndicat, la CFDT,
M. Emile Zucarelli, précédent ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, a
constaté, le 28 février 2000,
l'échec des
négociations
352(
*
)
avec les
syndicats et a
renoncé à un accord fixant des
règles communes pour la réduction du temps de travail dans la
fonction publique
.
M. Michel Sapin, actuel ministre de la fonction publique, n'a pas
tenté de relancer la concertation avec les organisations syndicales,
préférant
procéder par la voie
réglementaire
.
L'objectif du Gouvernement est
l'entrée en application des
" 35 heures " dans les fonctions publiques au
1
er
janvier 2002
, date de la
généralisation de la mesure dans le secteur privé.
Deux
avant-projets de décrets
relatifs à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail ont
été mis à disposition sur le site internet du
ministère de la fonction publique, l'un concernant la fonction publique
de l'Etat, l'autre la territoriale, étant bien entendu que
le second
ne pourrait être adopté qu'après une intervention du
législateur.
Les
collectivités locales se verront imposer les " 35 heures "
sans en maîtriser les règles ni les modalités.
M.
Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'État, a exposé les principes du passage aux 35 heures dans les
fonctions publiques :
- le décompte des heures de travail dans le public ne peut suivre des
modalités différentes de celles de la " loi Aubry "
concernant le secteur privé ;
- il faut disposer d'un cadre national strict, fixé par décret,
permettant un traitement égal de l'ensemble des fonctionnaires ;
pour le reste, la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
dans les fonctions publiques sera décentralisée et
déconcentrée ;
- dans les services de l'État, les 35 heures seront une occasion
d'améliorer le service aux usagers par une réorganisation du
travail ; les besoins en emplois s'apprécieront dans ce
cadre et tiendront compte de la priorité accordée à
la résorption de l'emploi précaire ;
- le Gouvernement reconnaît que la politique de l'emploi dans les
collectivités territoriales s'inscrit dans le cadre du principe
constitutionnel de libre administration des collectivités locales... La
position du Gouvernement paraît pour le moins contradictoire au regard de
l'étroitesse de la marge de manoeuvre laissée aux élus
locaux par l'avant-projet de décret pour la fonction publique
territoriale.
Les modalités de la réduction du temps de travail dans les
fonctions publiques sont contenues dans les avant-projets de
décrets :
- la
définition du temps de travail
serait identique dans les
secteurs public et privé ; la durée du
travail
effectif
s'entendrait comme "
le temps pendant lequel les agents
sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à
ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles
"
353(
*
)
;
- la durée du travail effectif serait fixée à trente-cinq
heures par semaine, le décompte du temps de travail étant
réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail
effectif de
1600 heures
; cette durée serait
susceptible d'être réduite pour tenir compte de sujétions
particulières (travail de nuit, travaux pénibles ou dangereux,
horaires décalés, etc.) ;
- le travail serait organisé selon des "
cycles
"
pouvant être définis par service ou par nature de fonction ;
- les
heures supplémentaires
feraient l'objet d'une compensation
horaire, ou, à défaut, seraient indemnisées ;
- au cours d'une même semaine, la durée du travail ne pourrait
dépasser
quarante-huit
heures ; calculée sur une
période de douze semaines, elle ne pourrait dépasser
quarante-quatre
heures ;
- la
durée quotidienne
de travail ne pourrait excéder dix
heures, l'amplitude maximale de la journée de travail étant
fixée à douze heures.
Selon l'avant-projet de décret : "
Les dispositions du
décret relatif à l'aménagement du temps de travail dans la
fonction publique de l'État sont applicables aux agents des
collectivités territoriales et des établissements publics en
relevant
".
La mission d'information ne peut que constater l'étroitesse de la marge
de manoeuvre que le Gouvernement envisage de laisser aux employeurs
locaux :
le décret se contenterait d'appliquer à la
fonction publique territoriale les règles édictées pour
les agents de l'État, selon une conception restrictive du principe de
parité !
Or, le principe de parité entre les fonctions publiques, posé par
la loi, doit pouvoir être corrigé par la loi. Au regard de la
hiérarchie des normes, il paraît pour le moins singulier
d'envisager que la loi concernant les collectivités territoriales serait
subordonnée dans son contenu aux solutions retenues par décret
pour les agents de l'Etat, alors même que le principe de
spécificité des collectivités territoriales a même
valeur que le principe de parité.
2. Une disposition nationale est-elle nécessaire ?
En tout
état de cause, la mission d'information prend acte de la
grande
richesse des solutions imaginées par les collectivités
territoriales elles-mêmes, en l'absence de toute règle à
valeur nationale
: les exemples sont nombreux de collectivités
ayant adopté une mesure de réduction du temps de travail tout en
améliorant le service rendu aux usagers, par une extension de la plage
des horaires d'ouverture au public, en recherchant une plus grande souplesse
dans la gestion des personnels, en favorisant la polyvalence des agents et en
redéployant les personnels en fonction des nouveaux besoins.
Les collectivités territoriales qui ont anticipé le
" passage aux 35 heures " n'ont pas
bénéficié d'un cadre législatif et
réglementaire de référence ; la capacité
d'innovation ainsi gagnée laisse à penser qu'un cadre national,
uniformisant, n'est pas adapté à la situation très
contrastée des collectivités locales.
Pour autant, les collectivités qui auront attendu le vote de la loi ne
devront pas être pénalisées lors du passage aux trente-cinq
heures. La question d'une compensation financière de la part de
l'État, tenant compte du coût d'adaptation et de
réorganisation des services, mérite d'être posée. En
effet, le risque existe que le coût financier la mise en oeuvre de la
réduction du temps de travail ne conduise les collectivités
à augmenter la pression fiscale. De plus, la mise en oeuvre de la
réduction du temps de travail devra être progressive afin de
permettre la meilleure adaptation possible des personnels concernés
à la nouvelle organisation du travail.
Sans vouloir empiéter sur le débat parlementaire qui devrait
avoir lieu lors de la prochaine session, la mission d'information
considère que
la création d'emplois ne saurait être
l'objectif unique de la réduction du temps de travail
. Au contraire,
il semble de bonne gestion que la question de la création d'emplois ne
soit examinée que dans un second temps, après avoir
envisagé toutes les mesures en faveur des redéploiements
d'effectifs et de la réorganisation des services.
II. ASSOUPLIR LES CONTRAINTES STATUTAIRES ET AFFIRMER LA SPÉCIFICITÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Les
employeurs locaux ne souhaitent pas que soient remis en cause les principes
régissant la fonction publique territoriale
, mais considèrent
que leur application conduit souvent à des difficultés de gestion
du personnel. Si la fonction publique territoriale doit continuer à
relever d'un statut national fixant des droits et obligations, les
collectivités locales doivent en revanche bénéficier
d'
une certaine souplesse dans la gestion de leur personnel
.
A ce sujet, Mme Martine Buron, vice-présidente de l'association des
petites ville de France, a mis en évidence les difficultés
rencontrées par les villes de 3.000 à 20.000 habitants, en
termes de recrutement dans les filières sociales ou de création
de postes à horaire réduit ou variable.
62 % des élus d'Alsace
354(
*
)
souhaitent un assouplissement des conditions de recrutement des personnels
territoriaux. Le développement de la mobilité des personnels
constitue la deuxième priorité des élus alsaciens (20
%) ; vient ensuite l'adaptation des formations initiale et continue
(14 %).
A. RESPECTER LA LIBERTÉ DE RECRUTEMENT ET DE GESTION DES EMPLOYEURS LOCAUX
1. Professionnaliser les concours
La
mission estime qu'une révision du
système des concours
est
nécessaire, afin de ne plus en faire le mode de recrutement
quasi-exclusif dans la fonction publique territoriale.
En effet, le
système du concours
a-t-il vocation à rester
le mode exclusif de recrutement dans la fonction publique, alors que les
départs à la retraite sont une occasion de diminuer le nombre de
fonctionnaires, de les affecter aux postes où les besoins vont
être les plus sensibles demain, et d'embaucher les personnes qui auront
les compétences requises, sans pour autant remplir les conditions de
diplôme ou réussir l'ensemble des épreuves d'un concours
inadapté aux réalités professionnelles ?
Lors de son audition par la mission, M. Rémy Schwartz, maître
des requêtes au Conseil d'Etat, auteur d'un rapport sur le recrutement,
la formation et le déroulement de carrière des agents
territoriaux, publié en mai 1998, a préconisé la
révision des épreuves des concours et la substitution de
concours sur titres aux concours sur épreuves
.
La mission est favorable à une meilleure
reconnaissance de
l'équivalence des titres.
Cette solution permettra aux
collectivités de recruter les agents diplômés, lesquels, en
l'état actuel des textes, sont recrutés beaucoup plus facilement
dans la fonction publique de l'État, qui ne leur impose pas de nouvelles
épreuves.
Pour l'accès à certains métiers, notamment dans les
filières techniques, sociales et culturelles, la possession du
diplôme d'État correspondant devrait suffire. Organiser des
épreuves spécialisées n'a guère de sens et se
révèle coûteux pour les collectivités, alors que
l'aptitude des agents à l'exercice de la profession a déjà
été validée par l'obtention du diplôme d'État
correspondant. A titre d'exemple, les collectivités locales devraient
pouvoir recruter les ingénieurs des grands corps de l'État sans
leur faire passer un nouveau concours, mais aussi les assistantes sociales
diplômées d'État et les professeurs de musique
diplômés du conservatoire.
Constatant que l'essentiel des mesures visant à améliorer la
gestion des concours relevaient du pouvoir réglementaire, la mission
regrette
l'absence d'instance de concertation en la matière
.
2. Respecter la liberté contractuelle et la liberté de gestion
La
mission estime que le recrutement contractuel doit rester un moyen
privilégié de souplesse.
Les rigidités du statut
peuvent être assouplies par la voie de la contractualisation, sans
remettre en cause la " voie royale " d'intégration dans la
fonction publique territoriale, à savoir le concours, la nomination et
la titularisation.
A la suite du protocole d'accord du 14 mai 1996, la loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à
l'emploi dans la fonction publique, dite " loi Perben ", s'est
donné pour objectif la résorption de l'emploi précaire.
Par dérogation aux règles normales de recrutement dans la
fonction publique territoriale, la loi a autorisé l'ouverture de
concours réservés à certains agents non titulaires
des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics. La prévention de sa reconstitution et l'amélioration des
garanties offertes aux agents non titulaires relèvent quant à
elles du pouvoir réglementaire.
La mission considère que
l'objectif de réduire la part de
l'emploi contractuel dans la fonction publique doit être bien compris. En
effet, certains besoins ne peuvent être assurés que par des
contractuels
.
Il est essentiel de respecter en ce domaine la
liberté de l'employeur, notamment pour certains emplois
supérieurs
.
La régulation du recrutement contractuel par le contrôle de
légalité ayant été renforcée, le recrutement
de non-titulaires fait aujourd'hui l'objet de motivations précises de la
part des collectivités employeurs, réduisant ainsi le risque de
dérive.
Les modes de recrutement doivent prendre en compte les nouveaux métiers
nécessaires à l'accomplissement des missions des
collectivités locales.
B. AFFIRMER LE POUVOIR DE DÉCISION DES COLLECTIVITÉS LOCALES : POUR UN PRINCIPE DE PARITÉ QUI NE SOIT PAS À SENS UNIQUE
Il est
regrettable que le Gouvernement ait pour principe de calquer purement et
simplement les règles applicables à la fonction publique
territoriale sur celle de l'Etat, au mépris de la
spécificité des collectivités territoriales.
Lors de son audition par la mission, M. Michel Delebarre, président du
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), a regretté
que
le véritable employeur de la fonction publique territoriale soit
désormais l'Etat
, à travers la production législative
et réglementaire et la conduite des négociations avec les
syndicats.
Il a fait part du paradoxe suivant :
- le principe de parité entre les fonctions publiques est
formellement " respecté ", en raison de l'unité de
décision, permettant à l'Etat de régir l'ensemble de la
fonction publique d'Etat et territoriale ;
- mais il n'existe aucune parité de fait, notamment en
matière de rémunération et d'indemnités.
Les
négociations
dans la fonction publique doivent associer les
élus locaux. Il n'est pas acceptable que l'État soit seul
à édicter les règles s'imposant à l'ensemble des
employeurs publics, alors qu'il n'en supporte pas les conséquences
financières.
La mission estime nécessaire d'
organiser la représentation des
collectivités locales employeurs dans les négociations touchant
la fonction publique.
Cette participation pourrait être garantie par
la loi.
C. LA FORMATION ET LA MOBILITÉ : POUR UNE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PLUS ATTRACTIVE
1. Une formation initiale rénovée
La
mission souhaite :
- la
mutualisation des efforts de formation initiale
des administrateurs
territoriaux avant leur recrutement. Il s'agit d'éviter la situation
actuelle, dans laquelle les collectivités de taille moyenne sont
dissuadées d'embaucher des administrateurs, ceux-ci les quittant
rapidement pour de plus grandes collectivités. Cette solidarité
entre les collectivités territoriales pourrait employer la voie
contractuelle ;
- la
validation des acquis,
permettant de tenir compte de la valeur
professionnelle de l'agent et d'améliorer la formation
complémentaire d'application, qui serait mieux définie et plus
courte ;
- l'organisation de la
formation sur le terrain
, c'est-à-dire au
sein même de la collectivité qui a procédé au
recrutement de l'agent.
2. Une obligation de fidélité ?
Constatant que de nombreux jeunes embauchés quittent
leur
collectivité d'origine à l'issue des six mois de formation
complémentaire d'application, il serait utile de créer une
obligation de fidélité
à l'égard de la
collectivité employeur, pour une durée de trois ans.
La loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la
fonction publique territoriale a complété la loi du
12 juillet 1984 relative à la formation des fonctionnaires
territoriaux afin de prévoir que les agents ayant suivi une formation
initiale pourront être soumis à
l'obligation de servir dans la
fonction publique territoriale
. A cette occasion, le Sénat avait
approuvé l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale,
considérée comme " le complément logique " de
l'obligation de formation.
Cette mesure est restée lettre morte faute de décret
d'application.
Jugeant que les petites communes étaient souvent appelées
à former les jeunes fonctionnaires territoriaux, Mme Martine Buron,
vice-présidente de l'Association des petites villes de France, a
souhaité qu'une
durée minimale d'emploi dans la
collectivité de première affectation
leur soit imposée.
A défaut, une obligation contractuelle pourrait être
envisagée, la deuxième collectivité remboursant une partie
des sommes engagées par la première au titre de la formation de
l'agent.
3. La mobilité et le déroulement de carrière : récompenser le mérite et les compétences
La
mobilité interne à la fonction publique territoriale, comme la
mobilité en direction de la fonction publique de l'État, doivent
être développées. Les positions statutaires sont sans doute
trop strictement encadrées.
La mission souhaite la poursuite de l'adaptation des
quotas d'avancement
et les
seuils démographiques
, récemment assouplis
par voie réglementaire, afin d'éviter les effets de seuils
désastreux pour les collectivités dont les besoins en personnel
qualifié sont sous-estimés. Il s'agit de tenir compte non
seulement de la situation de la collectivité à un instant
donné, mais aussi de prendre en considération les
évolutions, en particulier la croissance démographique ou le
caractère touristique de la collectivité.
Afin de favoriser la mobilité interne à la fonction publique
territoriale, la mission souhaite un
assouplissement de l'interdiction de la
mobilité à l'intérieur d'une même
collectivité, d'une filière à l'autre
. Il est
regrettable que les obstacles à la mobilité fonctionnelle des
agents, liés au cloisonnement excessif entre les filières,
s'ajoute aux difficultés de la mobilité géographique.
Le
déroulement de carrière
des agents territoriaux
pourrait laisser davantage de place à la mobilité
au sens
large, y compris
aux expériences dans le secteur privé. En
particulier,
les règles interdisant le cumul des activités et
des rémunérations et ménageant des exceptions doivent
être remises à plat
, comme le préconise un
récent rapport du Conseil d'État.
La mission recommande des " passerelles " entre fonction publique
territoriale et fonction publique de l'État. Elle se félicite
qu'un décret du 16 novembre 1999 permette aux administrateurs
territoriaux d'être détachés dans le corps des
administrateurs civils.
Enfin, la mission souhaite que
la promotion interne traduise davantage la
valeur professionnelle des agents
que l'évolution de carrière
purement statutaire, à l'ancienneté. Les collectivités
locales doivent pouvoir sanctionner les compétences de leurs agents et
récompenser le mérite
.
D. LE PRINCIPE D'ADAPTATION ET L'ANTICIPATION DES BESOINS DES COLLECTIVITÉS LOCALES : L'EXEMPLE DE L'INTERCOMMUNALITÉ
Lors de
son audition par la mission, M. Emile Zuccarelli, alors ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'État et de la
décentralisation, a réaffirmé le principe de la
carrière mais a reconnu qu'il était possible de
compléter les filières par de nouveaux cadres d'emplois, en
fonction des nouveaux métiers
.
Après la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale,
les
structures intercommunales, dotées de compétences
élargies, devront disposer de personnels adaptés à leurs
missions spécifiques
.
Conséquence de l'intercommunalité, les
franchissements de
seuils
vont bouleverser la gestion des ressources humaines : la
structure intercommunale, en raison de son importance démographique,
pourra recruter des agents auxquelles les communes membres n'ont pas
accès.
Les adaptations du statut, permettant une plus grande mobilité et
encourageant les " intercommunalités de projet ", pourraient
être recherchées, au lieu de pénaliser
systématiquement les agents qui choisissent une mobilité
professionnelle ou géographique.
La fonction publique territoriale
devra tenir compte à la fois
des contraintes des communes participant au groupement, mais aussi de
l'entité juridique autonome que constitue l'EPCI.
Si la transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) n'affecte pas la situation des agents déjà
en fonctions
355(
*
)
, il en va
différemment en cas de
création
: le nouvel
établissement de coopération intercommunale est un employeur
local à part entière au sens de la loi statutaire du 26 janvier
1984. La création d'emplois par l'organe délibérant
s'accompagnera généralement des
suppressions d'emplois dans
les communes adhérentes
. Les personnels sont nommés par le
président de l'EPCI par mutation, détachement, ou à partir
des listes d'aptitude établies après concours.
Le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ne peut être muté dans
le nouvel EPCI qu'avec son accord explicite ; le transfert est en
général effectué par mutation. Si le fonctionnaire refuse
le transfert, les suppressions d'emplois s'accompagnent d'un dispositif
protecteur
356(
*
)
. Les agents non titulaires (de
droit public ou de droit privé) ne bénéficient d'aucune
garantie de carrière, mais, sauf accord contraire des parties, les
contrats sont exécutés dans les conditions antérieures
jusqu'à leur échéance
357(
*
)
.
Afin de rendre attractif le transfert des agents communaux vers les nouveaux
EPCI, l'organe délibérant pourra maintenir aux agents
concernés, à titre individuel, les compléments de
rémunération ayant le caractère d'avantages acquis que
leur versait leur précédent employeur sur le fondement de
l'article 111 de la loi du 24 janvier 1984.
CHAPITRE IV
UN SYSTÈME DE FINANCEMENT LOCAL
RENOVÉ
La
mission considère que la rénovation du système de
financement local devait comprendre trois axes.
Tout d'abord, elle juge indispensable de garantir l'autonomie fiscale des
collectivités locales en modernisant les impôts locaux (I).
Ensuite, elle souhaite renforcer la dimension péréquatrice des
concours de l'Etat aux collectivités locales et s'orienter vers une
simplification et une amélioration de l'efficacité des
dispositifs existants (II).
Enfin, elle plaide en faveur d'une modification des relations
financières entre l'Etat et les collectivités locales, afin de
lier l'évolution des concours de l'Etat à l'évolution des
contraintes qui pèsent sur les budgets locaux et d'assurer un meilleur
partage de la croissance entre l'Etat et les collectivités locales
(III).
I. LA FISCALITE LOCALE, CONDITION NÉCESSAIRE DE LA LIBRE ADMINISTRATION
La
Constitution du 4 octobre 1958 pose, sans le définir, le principe de
libre administration des collectivités locales. L'article 72 dispose que
les collectivités territoriales de la République
"
s'administrent librement par des conseils élus et dans les
conditions prévues par la loi
". L'article 34 précise
que la loi détermine les principes fondamentaux "
de la libre
administration des collectivités locales, de leurs compétences et
de leurs ressources
", et fixe les règles concernant
"
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toute nature
", impôts locaux compris.
La tradition française de financement des collectivités locales
par l'impôt a rendu le principe de libre administration indissociable de
la notion d'autonomie financière et fiscale.
Les résultats des enquêtes menées auprès des
élus locaux dans plusieurs régions de France à l'occasion
de la tenue, à l'initiative du Président du Sénat, des
Etats généraux des élus locaux témoignent du lien
étroit entre libre administration et autonomie fiscale dans l'esprit des
élus. Par exemple, 71 % des élus d'Auvergne ayant
répondu à l'enquête ont estimé que la
réduction de l'autonomie fiscale des collectivités n'est pas
compatible avec le principe de libre administration.
A. LA LIBRE ADMINISTRATION NE SE RESUME PAS A LA LIBERTÉ DE DÉPENSER
1. Un modèle possible
La
rédaction actuelle de la Constitution de 1958 ne prévoit pas
explicitement que les collectivités locales bénéficient de
ressources d'origine fiscale. Elle n'établit
a fortiori
pas de
lien entre l'existence d'une fiscalité directe locale et le principe de
libre administration.
Dans la plupart des pays de l'Union européenne, les collectivités
locales s'administrent librement sans pour autant maîtriser
l'évolution de toutes leurs ressources fiscales. En Allemagne, la
Constitution prévoit un partage du produit des impôts d'Etat entre
l'Etat fédéral et les collectivités locales. Les
ressources de celles-ci s'apparentent donc plus à des
prélèvements sur les recettes fiscales de l'Etat, dont le taux
d'indexation serait fixé par la Constitution, qu'à une
fiscalité directe.
En 1995, dans tous les pays de l'Union européenne à l'exception
de la Suède, la part des ressources locales provenant d'impôts
dont les taux sont votés par les collectivités locales
était inférieure à la part de ces ressources dans les
budgets locaux français. Cette plus grande dépendance envers
l'Etat ne semble pourtant pas constituer un obstacle à l'exercice normal
de compétences étendues
358(
*
)
.
Par ailleurs, la capacité réelle des collectivités locales
française à agir sur le montant de leurs recettes fiscales est
parfois mise en doute. Lors de son audition par la mission le 8 mars 2000, M.
Philippe Valletoux, membre du directoire du Crédit local de
France-Dexia, a considéré que "
l'autonomie fiscale des
collectivités locales était réelle en apparence, mais
théorique dans les faits. Il a mis l'accent sur le rôle de l'Etat
en matière de recensement et de calcul de la matière imposable,
de fixation des règles de plafonnement et de liaison des taux des taxes
directes locales, enfin d'exécution des tâches administratives de
recouvrement et d'encaissement de l'impôt local
".
Ces éléments peuvent conduire à considérer que le
coeur de la libre administration des collectivités ne réside pas
dans leur mode financement mais dans leur latitude à décider
librement de leurs dépenses. Cette conception a été
relayée par la secrétaire d'Etat chargée du budget
à l'occasion du débat au Sénat sur la suppression de la
part régionale de la taxe d'habitation : "
On peut soutenir
que la libre administration s'entend essentiellement de la liberté
d'emploi des ressources, le législateur devant veiller à ce
qu'elles soient suffisantes en quantité pour permettre aux
collectivités locales d'exercer les compétences qui leur sont
dévolues
"
359(
*
)
.
Un tel raisonnement avait déjà été tenu par le
Gouvernement dans les observations qu'il a présentées au Conseil
constitutionnel lorsque celui-ci a été amené à se
prononcer sur la conformité à la Constitution de certaines
dispositions de la loi de finances pour 1999 : "
la libre
administration repose
essentiellement, pour être effective, sur la
libre disposition des sommes nécessaires à l'exercice de leurs
compétences par les collectivités locales. Aucune règle
constitutionnelle n'implique de privilégier une catégorie de
ressources par rapport à une autre
".
Au cours de l'assemblée plénière du Conseil
économique et social du 20 juin 2000, la rapporteuse au nom de la
section des économies régionales et de l'aménagement du
territoire d'un projet d'avis relatif à la décentralisation et au
citoyen a estimé que le débat sur la nature des ressources des
collectivités locales ne constituait pas un véritable
enjeu : "
Peut-être,
a-t-elle déclaré
,
conviendrait-il de mettre un terme au débat sur le choix qu'il serait
indispensable d'opérer entre les dotations de l'Etat et la
fiscalité locale. L'essentiel est plutôt de permettre à ces
collectivités d'assurer leurs compétences et de répondre
aux besoins, quelle que soit l'origine de leurs moyens financiers
".
2. Une solution inadaptée au contexte français
Si la
notion d'autonomie fiscale est aussi étroitement associée au
principe de libre administration, c'est que la fiscalité locale est
perçue comme un rempart contre la tentation centralisatrice de l'Etat.
Lors de son audition par la mission le 8 mars dernier, notre collègue
Jean-Pierre Fourcade, président du Comité des finances locales, a
souligné que "
dans un Etat encore jacobin comme la France, il
était fondamental et conforme à notre culture que coexistent des
recettes fiscales propres, levées sous la responsabilité des
collectivités locales, et des transferts de l'Etat
".
M. Alain Guengant, professeur à l'université de Rennes, a
pour sa part qualifié de décentralisation
"
tronquée
" un système dans lequel les
collectivités locales ne pourraient plus voter le taux des impôts
qu'elles perçoivent.
En théorie, la libre administration pourrait se contenter de la
liberté de dépenser. Cependant, en France, force est de constater
que la réduction de l'autonomie fiscale des collectivités locale
s'inscrit dans une logique centralisatrice puisqu'elle s'accompagne de la
réduction de la capacité des collectivités à
décider de leurs dépenses. Un nombre croissant de dispositions
législatives et réglementaires imposent aux collectivités
des dépenses obligatoires nouvelles, tandis que, par le biais des
contrats de plan, l'Etat oriente les choix de dépenses des
collectivités locales.
Par conséquent, faute du maintien de la capacité des
collectivités locales à agir sur le montant de leurs ressources,
la tendance décrite par notre collègue Jean-Pierre Raffarin, lors
de l'examen par le Sénat du projet de loi de finances rectificative pour
2000, ne sera pas susceptible d'être renversée :
"
Nous devenons des quasi-préfets. Nous gérons des
dotations et des circulaires. Il ne nous manque plus que les casquettes, mais
nous sommes prêts à les porter, s'il nous faut assumer jusqu'au
bout ce destin, qui est de servir la cause non pas de la
décentralisation mais d'une certaine
déconcentration !
"
360(
*
)
.
Notre collègue Pierre Mauroy, lors du débat consacré
à la décentralisation, organisé au Sénat le 3
novembre 1998, a parfaitement résumé l'importance du lien entre
libre administration et fiscalité locale dans le contexte
français : "
En France, il existe en effet, presque
mécaniquement, une tendance forte de l'Etat à recentraliser
(...)
En France, l'Etat recentralise normalement, naturellement, quelle que
soit la couleur de ceux qui sont au pouvoir, et notamment au
Gouvernement
(...)
Je comprends la préoccupation des
élus de vouloir, par exemple, établir des budgets assis sur des
recettes clairement définies afin de ne pas être à la merci
des dotations de l'Etat, trop facilement susceptibles d'être remises en
cause
"
361(
*
)
.
B. UN ATOUT À PRÉSERVER
En
matière de financement local, la France est par de nombreux aspects en
avance sur ses voisins. Par exemple, lors de leur audition par la mission le 15
juin 1999, les représentants du cabinet Arthur Andersen ont
souligné que "
notre pays avait des atouts et des exemples
à proposer, car il avait notamment été un
précurseur en matière de concessions de service public alors que,
cent ans plus tard, la Grande Bretagne et les pays scandinaves s'interrogeaient
sur les meilleures méthodes pour établir un partenariat
public/privé
".
Il en va de même en matière de fiscalité directe locale.
Alors que la France supprime progressivement ses impôts locaux, ses
voisins les plus proches, l'Espagne et l'Italie, s'inspirent de son exemple et
accroissent la marge de manoeuvre fiscale de leurs collectivités
locales.
En Espagne, depuis 1997, les communautés autonomes ont la
possibilité de moduler le taux et le barème de la fraction de
l'impôt sur le revenu qui leur était antérieurement
reversée par l'Etat.
En Italie, une réforme de 1997 a créé à compter du
1
er
janvier 1998 un impôt régional sur les
activités productives assis sur la valeur ajoutée nette (hors
amortissements) produite par les entreprises et les collectivités
publiques au plan régional, ainsi qu'un impôt régional et
un impôt communal additionnels à l'impôt sur le revenu. La
création de ces impôts additionnels a été
décidée pour compenser la perte de recettes provenant pour les
communes de la suppression d'impôts anciens et archaïques.
Trois raisons principales plaident pour que la France ne renonce pas à
l'acquis de la fiscalité directe locale :
1. Un impératif démocratique
Au cours
de son audition par la mission le 8 mars 2000, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie a rappelé que, selon
lui,
" la part communale de la taxe d'habitation constituait le coeur
de l'autonomie fiscale des collectivités locales
". En effet,
la taxe d'habitation est l'impôt qui unit les élus locaux à
leurs concitoyens, qui sont électeurs mais également
contribuables. Or, comme le relève notre collègue
député René Dosière dans son avis au nom de la
commission des lois sur les crédits des collectivités locales
dans le projet de loi de finances pour 2000, "
il est
particulièrement dangereux d'opérer une distinction entre le
contribuables et les électeurs
" car "
ne pas payer
l'impôt local constitue une forme d'exclusion civique. De ce point de
vue, la substitution du budget de l'Etat à la fiscalité locale,
dans les conditions où elle se pratique, conduit à augmenter
considérablement le nombre de foyers exonérés
(...).
Il s'agit d'une régression démocratique qui ne peut que
développer l'irresponsabilité, parmi les habitants, et parfois
aussi, parmi les élus
"
362(
*
)
.
Pour que les électeurs puissent véritablement juger de la
capacité des "
conseils élus
" à
administrer leur collectivité, il faut que ceux-ci soient en mesure
d'être jugés non pas sur la manière dont ils
répartissent des crédits qui leurs sont alloués, mais
sur l'ensemble de leurs orientations
, et notamment sur le
rapport
entre le niveau de la pression fiscale locale et la qualité des services
fournis aux citoyens
.
Du point de vue des collectivités locales, la disparition de la
fiscalité locale constituerait un
recul par rapport au principal
acquis de la décentralisation, la suppression des tutelles
administratives et financières
. En effet, en s'arrogeant la
maîtrise de l'évolution du montant des ressources locales, l'Etat
crée une nouvelle tutelle budgétaire et, de fait, reprend d'une
main ce qu'il a donné de l'autre moins de vingt ans auparavant.
2. Une nécessité économique
A niveau
de ressource équivalent, il n'est pas neutre pour une
collectivité de bénéficier de transferts de l'Etat
plutôt que de ressources fiscales.
Le système actuel de financement des collectivités à
la fois par des dotations de l'Etat et par des ressources propres, fiscales
notamment, est protecteur
pour les collectivités locales car il leur
permet d'avoir des ressources d'origines différentes, dont le montant ne
fluctue pas en fonction des mêmes paramètres. Lorsque l'Etat
connaît une situation budgétaire tendue, les collectivités
peuvent s'ajuster en maîtrisant leurs dépenses mais aussi en
recourant à la fiscalité. Lorsque les bases augmentent faiblement
en raison de la conjoncture économique, les concours de l'Etat, qui
progressent de manière relativement stable, jouent un rôle
contra-cyclique efficace. La complémentarité des modes de
financement des collectivités locales est donc source de
sécurité pour les budgets locaux.
La fiscalité locale est source de dynamisme économique
,
puisque l'augmentation des bases qui résultent de la mise en oeuvre des
politiques locales (constructions de logements, attraction d'entreprises, etc.)
permet d'intéresser les collectivités au succès de leurs
actions. Il peut en résulter une baisse des taux d'imposition puisque
les bases augmentent.
L'existence de ressources propres dont les collectivités
déterminent le montant leur permet de
s'administrer de manière
plus libre
puisqu'elles sont à même de mobiliser les
ressources nécessaires au financement d'action qu'elles jugent
prioritaires.
Les collectivités ne financent évidemment pas la totalité
de leurs investissements par des hausses d'impôts mais, comme le souligne
notre collègue député René Dosière,
"
le pouvoir fiscal donne à la collectivité une plus
grande capacité d'endettement et donc de programmation de ses
dépenses d'investissement
". Cette analyse est
corroborée par les critères utilisés par les agences de
notation financière, dont le rôle est de déterminer la
capacité des collectivités locales à rembourser leur
dette : "
la flexibilité fiscale étant une
variable d'ajustement très importante en cas de tensions
financières, elle représente un facteur d'analyse majeur et peut
avoir une influence significative sur les notes attribuées par Standard
& Poor's
"
363(
*
)
.
En d'autres termes, si l'existence d'une fiscalité locale est importante
dans la mesure où une collectivité doit pouvoir mobiliser des
ressources soit pour financer une action prioritaire ou pour faire face
à ses engagements financiers, il convient que la pression fiscale soit
modérée de manière à pouvoir utiliser l'impôt
lorsque c'est nécessaire. La fiscalité locale constitue donc une
puissante incitation à une gestion locale prudente et responsable,
puisque de faibles taux d'imposition ne peuvent être durablement atteints
que par la maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Plus généralement, l'intérêt économique de
l'existence d'une fiscalité directe locale a été bien
résumée par l'OCDE, dans les termes suivants
364(
*
)
:
" La responsabilisation des collectivités locales -
Dans un
contexte décentralisé, les niveaux d'administration locaux
doivent financer leurs actions par des ressources locales, et essentiellement
fiscales. L'obligation de maintenir ou d'augmenter la base fiscale est une
forme d'incitation à la mobilisation locale en faveur du
développement économique. Des attitudes malthusiennes des
collectivités locales face au développement d'activités
économiques, comme par exemple un faible intérêt pour
l'aménagement de zones d'activités et une
préférence pour une activité résidentielle,
cèdent le pas à de véritables stratégies de
croissance économique.
Un élu local dont les ressources se
composent essentiellement de subventions centrales se trouve placé dans
la position d'un quémandeur ; un élu local responsable des
rentrées fiscales devient un acteur du
développement.
"
La fiscalité locale renforce l'initiative locale
Lorsque, dans les observations qu'il a présentées à la
suite de la saisine du Conseil constitutionnel sur la loi de finances pour
1999, le Gouvernement estime que "
la libre administration repose
essentiellement, pour être effective, sur la libre dispositions des
sommes nécessaires à l'exercice de leurs compétences par
les collectivités locales
", il raisonne comme si les
collectivités étaient des services déconcentrés de
l'Etat ou des préfets auxquels on confie des enveloppes de
crédits globalisées.
Or, la gestion locale ne se résume pas à la mise en oeuvre de
politiques décidées par l'Etat, mais implique
l'élaboration de stratégies territoriales qui nécessitent
de pouvoir moduler le montant des recettes en fonction des priorités du
moment.
La fiscalité locale est la contrepartie de l'interdiction des
déficits de fonctionnement
Les raisonnements de l'Etat en matière de libre administration des
collectivités locales témoignent des libertés que prennent
les Gouvernements successifs avec les règles de gestion comptable.
L'Etat emprunte pour financer ses dépenses de fonctionnement, pour payer
ses fonctionnaires par exemple. Dans la loi de finances initiale pour 2000, le
déficit de la " section de fonctionnement " du budget de
l'Etat s'élevait à près de 50 milliards de francs.
La loi interdit de telles largesses aux collectivité locales. Par
conséquent, la fiscalité doit pouvoir jouer le rôle de
variable d'ajustement
des budgets locaux et financer leurs
dépenses obligatoires lorsque les dotations reçues ne permettent
pas de couvrir les dépenses.
3. Une exigence constitutionnelle
La
Constitution du 4 octobre 1958 n'établit pas de lien explicite entre la
principe de libre administration et l'existence d'une fiscalité directe
locale.
Ce lien a été établi à deux reprises par la
jurisprudence du Conseil constitutionnel :
- le Conseil a fixé un principe général selon lequel
"
les règles posées par la loi ne sauraient avoir pour
effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités locales
au point d'entraver leur libre administration
"
365(
*
)
;
- le Conseil a établi qu'un prélèvement par l'Etat sur les
ressources fiscales d'une collectivité ne peut être
opéré "
qu'à titre exceptionnel et ne doit
concerner qu'une partie de l'impôt local ; il doit être
défini avec précision quant à son objet et à sa
portée ; il ne doit pas avoir pour conséquence d'entraver la
libre administration des collectivités
concernées
"
366(
*
)
;
Le Conseil n'a jamais considéré que ces principes avait
été enfreints mais a eu l'occasion de les réaffirmer. Il a
jugé conforme à la Constitution un prélèvement sur
les recettes fiscales d'une collectivité en relevant "
qu'eu
égard au montant du prélèvement en cause par rapport
à l'ensemble des recettes de fonctionnement du budget de la ville de
Paris, sa suppression n'est pas contraire au principe de libre administration
des collectivités territoriales
"
367(
*
)
.
Lorsqu'il s'est prononcé sur la conformité à la
Constitution de la suppression de la part salariale de l'assiette de la taxe
professionnelle, le Conseil a rappelé que les règles
posées par la loi "
ne sauraient avoir pour effet de restreindre
les ressources fiscales des collectivités au point d'entraver leur libre
administration
" mais a considéré que, puisque
"
en contrepartie de la suppression progressive de la part salariale de
la taxe professionnelle, la loi institue une compensation
(...)
ces
règles n'ont ni pour effet de diminuer les ressources globales des
collectivités locales ni de restreindre leurs ressources fiscales au
point d'entraver leur libre administration
"
368(
*
)
.
La décision relative à la suppression de la part salariale de la
taxe professionnelle confirme l'existence d'un
seuil minimal de ressources
fiscales
en deçà duquel la libre administration des
collectivités locales serait remise en cause. En effet, elle laisse
entendre que la transformation d'un impôt en dotation pourrait porter
atteinte à la libre administration par deux biais
différents :
- d'une part, si la mesure proposée avait pour effet de diminuer les
ressources globales des collectivités locales ;
- d'autre part, si la mesure proposée restreignait de manière
exagérée les ressources fiscales locales.
Il ressort de ce double critère qu'une réforme qui remplacerait
un impôt local par une compensation plus intéressante
financièrement pour les collectivités locales pourrait
malgré tout être jugée contraire à la Constitution
si elle faisait disparaître une part trop importante des recettes
fiscales locales.
C. POUR DES IMPÔTS LOCAUX ADAPTÉS ET GARANTIS CONSTITUTIONNELLEMENT
La
préservation de l'acquis de la fiscalité directe locale se heurte
à une double difficulté. D'une part, le " flou " de la
rédaction actuelle de la Constitution n'a pas permis au Conseil
constitutionnel de considérer que les atteintes successives au pouvoir
fiscal local avaient été de nature à entraver la libre
administration des collectivités locales.
D'autre part, l'archaïsme et le caractère injuste des impôts
directs locaux affaiblit le plaidoyer en faveur de l'autonomie fiscale des
collectivités locales.
1. Vers une réforme de la Constitution ?
Le
Conseil constitutionnel a considéré à plusieurs reprises
que la suppression d'un impôt local ne devait pas avoir pour effet de
réduire les ressources globales des collectivités, et que
l'existence d'impôt locaux était une condition nécessaire
du principe de libre administration.
Cette jurisprudence prétorienne n'a jamais abouti à censurer une
disposition législative. La position du Conseil constitutionnel peut se
comprendre puisque la rédaction actuelle de la Constitution n'offre
aucune piste qui pourrait lui permettre de définir le seuil en
deçà duquel une suppression d'impôt local remettrait en
cause la libre administration des collectivités locales.
La définition d'un tel seuil serait d'ailleurs un exercice
compliqué, puisque les différents niveaux de collectivités
locales n'ont pas tous la même proportion de recettes fiscales dans leurs
recettes totales. Par exemple, à la différence des communes, les
régions et les départements bénéficient des
impôts transférés au moment des lois de
décentralisation. Certaines collectivités
bénéficient de produits domaniaux très importants qui
réduisent la part de la fiscalité dans leurs recettes totales.
Le Président du Sénat, M. Christian Poncelet, le président
du comité des finances locales, notre collègue Jean-Pierre
Fourcade, le président de l'association des maires de France, notre
collègue Jean-Paul Delevoye, le président de l'association des
départements de France, notre collègue Jean Puech, et le
président de l'association des régions de France, notre
collègue Jean-Pierre Raffarin, ont considéré qu'il
était temps de
faciliter la tâche du Conseil constitutionnel en
instaurant une protection constitutionnelle de l'autonomie fiscale des
collectivités locales
.
Dans l'exposé des motifs de la proposition de loi constitutionnelle
déposée sur le bureau du Sénat le 22 juin 2000, ils
affirment que "
la protection constitutionnelle de l'autonomie fiscale
des collectivités locales est, plus que jamais, indispensable en raison
des menaces qui plânent sur l'existence même de l'impôt
local.
"
Par ailleurs, l'autonomie fiscale des collectivités locales
est, en France, bien plus nécessaire que dans d'autres Etats, notamment
fédéraux,
pour que nos collectivités puissent
asseoir définitivement leur autonomie politique, dans un pays
marqué par une tradition multiséculaire de centralisation.
"
Le législateur de 1982 ne s'y était d'ailleurs pas
trompé en prévoyant qu'une partie des transferts de charge serait
compensée par des ressources fiscales nouvelles
transférées par l'Etat
".
Le dispositif proposé pour le nouvel article 72-1 de la Constitution du
4 octobre 1958 repose sur quatre principes :
- l'autonomie fiscale est consubstantielle du principe de libre
administration : "
la libre administration des
collectivités territoriales est garantie par la perception de ressources
fiscales dont elles votent les taux dans les conditions prévues par la
loi
" ;
- une meilleure définition du seuil en deçà duquel la
suppression d'impôt locaux serait de nature à remettre en cause la
libre administration : "
les ressources fiscales
représentent la part prépondérante des ressources des
collectivités territoriales
" ;
- une invitation à une réforme en profondeur de la
fiscalité directe locale dépassant les traditionnelles
" quatre taxes ", en rappelant que "
les collectivités
territoriales peuvent percevoir le produit des impositions de toute
nature
" ;
- l'interruption du mouvement de remplacement des impôts locaux par des
dotations : "
toute suppression d'une ressource fiscale
perçue par les collectivités territoriales donne lieu à
l'attribution de ressources fiscales équivalentes
".
2. Des impôts locaux adaptés
L'éventualité d'une protection constitutionnelle
de la
fiscalité locale rend plus que jamais nécessaire une
réforme de celle-ci, en faisant bénéficier les
collectivités du produit d'impôts modernes, ou modernisés,
qui ne soient pas principalement caractérisés par les injustices
qu'ils engendrent entre collectivités ou entre contribuables et qui
procurent aux budgets locaux une ressource assise sur la croissance.
Aucune réforme de grande envergure de la fiscalité locale n'a
été menée à son terme. La création de la
taxe professionnelle a été caractérisée par
l'obsession de ne pas bouleverser excessivement les équilibres atteints
par l'ancienne patente. L'application à la taxe professionnelle d'une
assiette fondée sur la valeur ajoutée prévue par la loi 10
janvier 1980 n'a été mise en oeuvre. La révision des
valeurs locatives cadastrales décidée en 1990 a été
réalisée mais jamais appliquée. Le projet de remplacer la
part départementale de la taxe d'habitation par une taxe
départementale sur le revenu a été enterré.
Le Gouvernement issu des élections législatives de 1997 a pour
lui le mérite de la constance. Il met en oeuvre avec
détermination une politique de réforme de la fiscalité
locale
en supprimant peu à peu les impôts existants et en les
remplaçant par des dotations budgétaires
. L'inadaptation des
impôts locaux lui permet de rencontrer peu de résistance dans
cette entreprise.
Il appartient aujourd'hui aux élus locaux d'élaborer des projets
alternatifs. Toutefois, pour être crédibles, ces propositions
devront s'appuyer sur des simulations fines de leurs conséquences sur
les contribuables et sur les ressources des collectivités locales. Seul
le Gouvernement est en mesure de procéder à un tel exercice.
La première condition d'une réforme d'envergure de la
fiscalité locale réside donc dans la volonté du
Gouvernement de " tester ", sans a priori, les différentes
réformes possibles
.
Plusieurs pistes sont envisageables. La plupart d'entre elles sont connues
depuis longtemps, mais la viabilité de leur mise en oeuvre n'a jamais
été évaluée sérieusement.
Rénover les impôts existants
La modernisation des impôts actuels pourrait marquer la volonté
des collectivités locales de lier fiscalité locale et justice
fiscale :
-
la taxe d'habitation
: le Gouvernement issu des élections
législatives de 1997, dans son rapport sur la taxe d'habitation remis au
Parlement en application de l'article 28 de la loi de finances pour 2000 a
enterré définitivement la révision des bases
décidée en 1990 en considérant que les travaux de
simulation réalisés à partir des résultats de la
révision des bases de 1990 "
ont mis en évidence que
cette réforme conduit à des transferts entre contribuables,
insatisfaisants, tant sur le plan de l'efficacité économique que
sur le plan de la justice sociale
".
Pour sauver la taxe d'habitation, il convient donc d'envisager d'autres pistes
de réforme de son assiette. Une première piste consisterait
à conserver une assiette fondée sur la valeur locative, mais
à la rendre plus dynamique en substituant aux valeurs indiciaires
actuelles une valeur locative déclarée par le contribuable,
à charge pour le législateur de définir un système
d'équivalence pour logements habités par leurs
propriétaires.
Une deuxième piste consisterait à remplacer l'assiette actuelle
de la taxe d'habitation par une assiette fondée sur le revenu, afin de
prendre en compte la capacité contributive des contribuables.
Cette idée est ancienne. Elle avait été soutenue par la
commission spéciale constituée à l'Assemblée
nationale pour examiner le projet de loi devenu la loi du 10 janvier 1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale. Animée
par le souci "
d'aller plus loin dans la voie de la personnalisation de
l'impôt
", la commission s'était prononcée en
faveur d'une réforme tendant à "
substituer à la
part départementale de la taxe d'habitation un impôt proportionnel
sur le revenu. Se trouverait ainsi satisfait le voeu généralement
exprimé de lier les impositions locales sur les ménages aux
revenus de ces derniers. L'impôt proportionnel serait assis sur des bases
très voisines de l'impôt sur le revenu et ne nécessiterait
donc aucune déclaration supplémentaire. Il ne s'appliquerait donc
qu'aux personnes imposables à l'impôt sur le revenu et serait
assorti d'abattements familiaux analogues à ceux qui sont
pratiqués en matière de taxe d'habitation. Il serait dû non
seulement au titre des résidences principales mais aussi, moyennant une
réduction des bases, au titre de chacune des résidences dont le
redevable a la jouissance
"
369(
*
)
.
L'article 56 de la loi du 30 juillet 1990 sur la révision des
évaluations cadastrales avait posé le principe de la substitution
à la part départementale de la taxe d'habitation, d'une taxe
proportionnelle sur le revenu mais son application a été
reportée par la loi du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions
fiscales.
Dans son rapport sur la modernisation de la fiscalité locale
370(
*
)
, notre collègue député Edmond
Hervé va plus loin et estime que "
l'assiette de la taxe
d'habitation doit être constituée par les revenus des
habitants
(...)
Pour des raisons de simplicité et
d'équité, nous proposons de retenir les revenus pris en compte
pour le calcul de la CSG
". Dans son esprit, ce n'est pas seulement la
part départementale mais l'ensemble de l'assiette de la taxe
d'habitation qui doit être revue.
Votre rapporteur considère pour sa part que, dans un premier temps, il
serait judicieux d'asseoir sur le revenu un impôt perçu par les
départements et destiné à financer des dépenses
sociales. La CSG, dont l'assiette large touche tous les contribuables mais
aussi tous les revenus, permettant ainsi de pratiquer des taux peu
élevé, présente les caractéristiques d'un
impôt moderne adapté aux besoins des collectivités locales.
-
la taxe professionnelle
: avec la suppression progressive de la
part salariale de son assiette, la taxe professionnelle va devenir un
impôt assis uniquement sur les immobilisations, donc sur le capital. Dans
son quinzième rapport au président de la République, le
Conseil des impôts a établi que c'était
précisément cette fraction de l'assiette de la taxe
professionnelle qui pénalisait la compétitivité des
entreprises. La revendication des organisations représentatives des
entreprises d'une suppression de la taxe professionnelle va donc se trouver
renforcer.
Il est encore temps de donner sa chance à l'assiette de la taxe
professionnelle prévue par la loi du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, c'est-à-dire
la
valeur ajoutée
. Comme l'a remarqué M. Alain Guengant,
professeur à l'université de Rennes, lors de son audition par la
mission le 8 mars 2000, la mise en place de la cotation minimale de taxe
professionnelle et le plafonnement du montant des cotisations en fonction de la
valeur ajoutée tendent à transformer progressivement la taxe
professionnelle "
au sein d'un tunnel de taux,
[en]
un
impôt calculé au niveau national en fonction de la valeur
ajoutée
". La nationalisation de cet impôt,
préconisée par le Conseil des impôts, devient
progressivement une réalité.
La mise en place de l'assiette " valeur ajoutée " au plan
local a souvent été déclarée impossible en raison
des difficultés de sa localisation sur le territoire. Votre rapporteur
suggère que soit expertisée une éventuelle transposition
à la taxe professionnelle de l'assiette du nouvel impôt
régional sur les entreprises perçu par les régions
italiennes depuis 1998 et dont l'assiette repose sur la valeur ajoutée
nette (hors immobilisations).
Une autre solution, avancée par M. Michel Klopfer, mériterait
d'être examinée : "
si l'on souhaite transformer un
impôt archaïque en impôt moderne, une solution existe qui
passe à la fois par une assiette nationale (la valeur ajoutée ou,
mieux encore, l'excédent brut d'exploitation pour que la masse salariale
soit totalement hors-jeu) et par une base locale (les immobilisations
limitées aux seules valeurs foncières). La valeur ajoutée
n'étant pas localisable sur le territoire, elle serait calculée
nationalement pour chaque entreprise et pondérée localement par
les implantations utilisées. Chaque collectivité disposerait
ainsi comme assiette d'un pourcentage de l'excédent brut d'exploitation
de l'entreprise correspondant à la part des immobilisations
foncières qu'elle abrite sur son territoire
"
371(
*
)
;
-
les taxes foncières
: les taxes foncières, et
notamment la taxe foncière sur les propriétés
bâties, sont rarement évoquées lors des discussions sur la
réforme de la fiscalité locale. Pourtant, cet impôt
rapporte plus aux collectivités locales que la taxe d'habitation. Les
exonérations et les dégrèvements y sont moins nombreux
qu'en matière de taxe professionnelle ou de taxe d'habitation, ce qui
permet aux collectivités locales de bénéficier pleinement
des augmentations de produit qui résultent des augmentations des taux.
De fait, les taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties augmentent plus vite que les taux de la taxe d'habitation.
Pourtant, l'assiette des taxes foncières n'est pas plus juste que celle
de la taxe d'habitation puisqu'elle repose sur des valeurs locatives qui n'ont
pas été révisées depuis 1970 pour les
propriétés bâties et 1961 pour les propriétés
non bâties.
Lors de son audition par la mission le 8 mars 2000, M. Alain Guengant,
professeur à l'université de Rennes, a craint que le recours
à la taxe foncière sur les propriétés bâties
"
ne se heurte un jour à l'absence de révision
des
bases
" et a estimé qu'elle telle éventualité
"
constituerait une menace pour le maintien d'une fiscalité
directe locale
".
A la fin des années 70, M. Jacques Thyraud avait rendu au nom du
comité d'études de la politique foncière un rapport qui
plaidait en faveur de la transformation des taxes foncières en un
impôt déclaratif assis sur la valeur vénale des
propriétés. Cette proposition avait été reprise
à son compte par la commission spéciale de l'Assemblée
nationale chargée d'examiner les dispositions de la loi du 10 janvier
1980 : "
L'un des avantages de cette solution est de n'exiger
aucune définition des terrains à bâtir, le seul
critère étant la valeur vénale qui varie selon les
vocations nouvelles attribuées à un terrain. De plus, le
caractère très évolutif d'une telle assiette favoriserait
une relative stabilité des taux (...) Il deviendrait ainsi possible de
juguler certains phénomènes spéculatifs, de mettre fin
à des sous impositions choquantes
"
372(
*
)
.
Sans se prononcer sur cette proposition, votre rapporteur suggère
qu'elle serve de base à une réflexion sur l'évolution de
l'assiette des taxes foncières.
Transférer le produit de certains impôts ?
Dans de nombreux pays, au premier rang desquels l'Allemagne, les recettes
fiscales des collectivités locales sont principalement
constituées du transfert par l'Etat d'une fraction du produit de
certains impôts, selon une clef de répartition prévue par
la loi, voire la Constitution.
Des dispositifs de ce type existent également en France, puisque l'Etat
reverse à la collectivité territoriale de Corse le produit de la
taxe intérieure sur les produits pétroliers perçus dans
l'île. Une extension de cette pratique donne lieu à des
débats récurrents. Ainsi, lors de l'examen par le Sénat du
projet de loi appelé à devenir la loi du 10 janvier 1980, le
rapporteur du texte au nom de la commission des finances, notre collègue
Jean-Pierre Fourcade, déclarait : "
Nous serons
obligés d'en venir un jour à la suppression de la taxe
d'habitation et à son remplacement par une affectation directe aux
collectivités locales d'une partie de l'impôt sur le
revenu
"
373(
*
)
.
Au cours de l'été 1999, un article du président de la
région Limousin, M. Robert Savy, relançait le débat sur le
partage des impôts d'Etat. Votre rapporteur ne se prononce pas en sa
faveur car elle ne constituerait qu'une forme améliorée de
prélèvements sur les recettes de l'Etat, dont l'expérience
a montré que l'Etat n'était pas prêt à fixer les
modes d'indexation en partenariat avec les collectivités locales. En
outre, cette solution ne permet de maintenir la capacité des
collectivités locales à voter le taux des impôts qu'elles
perçoivent.
Par ailleurs, cette solution provoquerait des transferts de richesse entre
collectivités locales puisque les bases des impôts nationaux ne
sont pas réparties sur le territoire de la même manière que
celles des actuels impôts locaux.
Transférer certains impôts
Les lois de décentralisation ont prévu que les compétences
transférées aux collectivités seraient financées au
moins pour moitié par des transferts d'impôts d'Etat. Avec les
droits de mutation, la vignette et la taxe sur les cartes grises, les
départements et les régions ont ainsi pu bénéficier
de ressources certes volatiles, mais globalement dynamiques.
Cette pratique a été abandonnée depuis le milieu des
années 80 mais le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer
discutée au Parlement au printemps 2000 lui a donné une nouvelle
actualité en prévoyant le transfert aux départements
d'outre-mer le vote des taux des droits sur les tabacs.
Il conviendrait d'explorer la possibilité de nouveaux transferts. Dans
un premier temps, ces transferts pourraient se substituer aux compensations
d'exonérations versées par l'Etat aux collectivités
locales.
Permettre le vote de taux additionnels aux impôts perçus par
l'Etat
En Espagne, depuis 1997, les communautés autonomes peuvent voter des
taux additionnels à l'impôt sur le revenu, voire en modifier le
barème.
Les solutions de ce type permettent de conserver aux collectivités
locales un pouvoir en matière de vote des taux tout en les faisant
bénéficier d'impôts modernes et dynamiques. En
période de basse conjoncture, les collectivités locales
subiraient les mêmes contraintes que l'Etat. Elles présentent
également l'avantage de ne pas conduire à des transferts de
richesse entre collectivités.
En revanche, elles peuvent se révéler
contre-péréquatrices s'il s'avère que les bases des
impôts d'Etat sont plus importantes dans les collectivités riches.
Créer de nouveaux impôts
L'Italie a créé en 1997 un nouvel impôt régional sur
les entreprises et deux impôts régionaux et communaux additionnels
à l'impôt sur le revenu. Ce trois nouveaux impôt ont
remplacé d'anciens impôts archaïques.
En France, l'Etat créé à son profit de nouveaux
impôts à fort rendement, tels que la contribution sociale
généralisée (CSG) ou la taxe générale sur
les activités polluantes (TGAP). La même créativité
pourrait être utilisée pour procurer aux collectivités
locales des sources de revenus modernes et adaptées à leurs
besoins et, à terme, remplacer certains des impôts actuels.
Le partage de l'impôt sur le revenu dans plusieurs pays de l'Union européenne
Les
différentes modalités de partage de l'impôt sur le revenu
entre l'Etat et les collectivités locales dans les pays de l'Union
européenne témoignent de la diversité des moyens de faire
bénéficier les collectivités locales du produit
d'impôts modernes et dynamiques tout en, dans certains cas,
préservant ou accentuant leur marge de manoeuvre fiscale.
Pays-Bas
L'impôt sur le revenu, comme l'ensemble des impôts d'Etat, alimente
un fonds qui est ensuite reversé aux collectivités locales. Le
montant des sommes affectées au fonds est déterminé par le
Gouvernement, en fonction de l'évolution des besoins des
collectivités, et fait l'objet d'un vote du Parlement.
Allemagne
Le produit de l'impôt sur le revenu est partagé entre l'Etat
fédéral et les collectivités locales en fonction d'une
clef de répartition fixe : 42,5 % pour l'Etat
fédéral, 42,5 % pour les länder et 15 % pour les
communes.
Danemark
Outre le barème national, l'impôt sur le revenu comprend un taux
provincial, un taux communal et un " complément
ecclésiastique communal ".
Les taux de ces trois compléments locaux sont fixés librement par
les autorités provinciales et communales. Toutefois, l'addition des taux
nationaux et locaux ne doit pas conduire à un prélèvement
global supérieur à 58% du revenu imposable d'un contribuable.
L'éventuel excédent est restitué au contribuable par
l'Etat et les collectivités locales.
Belgique
Les communautés linguistiques et les régions
bénéficient du reversement d'une fraction de l'impôt sur le
revenu perçu par l'Etat. Les régions peuvent également
voter des impôts additionnels à l'impôt sur le revenu ou, au
contraire, accorder des remises.
Les communes peuvent créer librement des centimes additionnels à
l'impôt d'Etat sur le revenu.
Italie
Depuis le 1
er
janvier 1998, une fraction de l'impôt sur le
revenu calculé selon le barème d'Etat est prélevée
pour le comptes des budgets régionaux. A compter de 2000, le taux,
fixé par les régions, est compris entre 0,5 % et 1%.
Depuis le 1
er
janvier 1999, les communes perçoivent un
impôt additionnel à l'impôt sur le revenu, dont la base est
constituée du revenu imposable à l'impôt sur le revenu. Le
taux de cet impôt comprend deux composantes : un taux fixe
déterminé par l'Etat et un taux variable déterminé
par les communes. Il est plafonné à 0,2 %, l'augmentation ne
pouvant dépasser 0,5 % en trois ans.
Espagne
Depuis le 1
er
janvier 1997, les communautés autonomes ont le
pouvoir de voter un barème d'impôt sur le revenu, en
complément du barème d'Etat allégé d'autant, ainsi
que de moduler les abattements et les réductions d'impôt. En mars
1999, huit communautés autonomes en avaient utilisé cette
faculté. Le montant de l'impôt régional sur le revenu ne
peut être inférieur ou supérieur de 20 % au montant de
l'impôt d'Etat appliqué au même revenu.
Par ailleurs, une fraction de l'impôt perçu par l'Etat doit
être reversée aux communautés autonomes. Cette fraction est
progressivement portée de 15 % à 30 %.
Depuis 1980 et 1981, au Pays basque et en Navarre, l'impôt sur le revenu,
comme l'ensemble des impôts à l'exception de la TVA et des droits
de douane, est géré, collecté et perçu par les deux
communautés autonomes. Il est prévu que le poids global des
prélèvements obligatoires de nature fiscale ne peut être
inférieur au poids des mêmes prélèvements
perçus par l'Etat.
Source : Direction de la législation fiscale.
II. UNE PÉRÉQUATION RENFORCÉE
A. LA PÉRÉQUATION EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA DECENTRALISATION ?
1. Les termes du débat
Les
écarts de richesse entre les différentes parties du territoire
s'accroissent depuis vingt ans. La péréquation est donc
indispensable pour préserver l'homogénéité du tissu
économique et social national.
La décentralisation et l'autonomie fiscale des collectivités
locales sont parfois ressenties comme de nature à entretenir ces
inégaliités plutôt qu'à les résorber.
2. La péréquation est le corollaire de la décentralisation
L'échange reproduit ci-dessous entre une ministre et un
parlementaire élu local, intervenu à l'occasion du débat
au Sénat sur la suppression de la part régionale de la taxe
d'habitation, témoigne de deux conceptions différentes de la
péréquation :
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat
: (...) la
libre administration des collectivités locales poussée
jusqu'à son terme signifie-t-elle que chacun garde ses ressources et
refuse de " péréquer " en faveur des régions le
plus pauvres ?
M. Jean-Pierre Raffarin
: C'est le rôle du contrat de
plan.
374(
*
)
D'une part, la ministre oppose libre administration et
péréquation et sous entend que seule une politique
étatique centralisée permet d'assurer la redistribution des
richesses entre les territoires.
D'autre part, notre collègue souligne que,
dans un Etat unitaire
décentralisé, il appartient à l'Etat de maintenir la
cohérence territoriale non pas en ponctionnant les ressources fiscales
des collectivités locales, dont il convient de respecter l'autonomie,
mais en modulant le montant des concours financiers qu'il verse aux
collectivités locales en fonction de leur richesse
.
L'exemple des contrats de plan est révélateur. Ces contrats
représentent une enveloppe financière très importante, que
l'Etat pourrait répartir en tenant compte de la richesse des
régions. Pourtant, il ne le fait pas. La volonté initiale de
classer les régions en trois groupes en fonction de leur niveau de
richesse pour les attributions des contrats 1994-1999 n'a pas été
respectée. Pour les contrats de plan 2000-2006, l'objectif de modulation
en fonction des richesse n'a même pas été repris.
En réalité, la politique consistant à vouloir
opérer une
redistribution des richesses fiscales entre les
collectivités
trahit l'incapacité de l'Etat à
introduire plus de péréquation dans les critères de
répartition des dotations qu'il verse aux collectivités
locales.
B. AMÉLIORER LE CARACTÈRE PÉRÉQUATEUR DE LA DGF
En 2000,
seuls 13 % des crédits de la DGF des communes sont consacrés
à la péréquation.
Plusieurs solutions sont possibles pour améliorer cette proportion. Leur
mise en oeuvre serait cependant particulièrement délicate car ces
solutions ont pour effet soit d'aboutir à des transferts de richesses
entre collectivités soit d'accroître le coût de la DGF pour
l'Etat.
1. Modifier l'ordre de répartition des composantes de la DGF ?
Le droit
actuel prévoit que les crédits supplémentaires
résultant de l'augmentation du montant de la DGF d'une année sur
l'autre sont répartis entre la dotation forfaitaire, versée
à toutes les communes, et la dotation d'aménagement,
péréquatrice et versée aux structures intercommunales et
aux communes défavorisées, selon une clef de répartition
défavorable à la péréquation puisque le
comité des finances locales doit affecter à la dotation
forfaitaire entre 50 % et 55 % du taux de croissance de la DGF.
En d'autres termes, la dotation d'aménagement constitue le solde de la
DGF des communes une fois déterminé le montant de la dotation
forfaitaire. Son taux de progression ne peut pas dépasser 50 % de
l'augmentation de la DGF, et peut descendre, comme en 2000, jusqu'à
45 %.
A titre de comparaison, le code général des collectivités
territoriales prévoit que, au sein de la DGF des départements, la
dotation de péréquation représente 45 % des
crédits disponibles.
Une première piste pour renforcer le poids de la
péréquation dans la DGF des communes consisterait à
renverser les rôles et à décider que la dotation
d'aménagement reçoit entre 50 % et 55 % de
l'augmentation de la DGF au titre d'une année, la dotation forfaitaire
recevant le solde.
Une telle solution permettrait d'affirmer clairement le choix de la
péréquation au détriment du minimum garanti pour toutes
les communes. Elle pourrait également constituer une incitation à
l'intercommunalité, les communes soucieuses de compenser la baisse de
leur dotation forfaitaire ayant intérêt à adhérer
à un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre, puisque ces EPCI perçoivent
tous une DGF.
Cette solution comporterait pourtant des inconvénients puisqu'elle
pénaliserait les communes qui, sans être riches, ne sont pourtant
pas éligibles aux dotations de solidarité qui constituent la
dotation d'aménagement, la dotation de solidarité urbaine (DSU)
et la dotation de solidarité rurale (DSR). De tels cas de figure sont
courants du fait du caractère imparfait des critères
d'éligibilité aux dotations de solidarité (de la DSU en
particulier, qui est accordée en fonction du nombre de logement sociaux
mais ne tient pas compte du " parc social de fait ").
L'éventuelle entrée en vigueur de cette solution est donc
conditionnée par une révision des critères d'attribution
des dotations de solidarité, afin d'éviter qu'une réforme
tendant à améliorer la péréquation ne
pénalise certaines communes défavorisées.
2. Dissocier la dotation d'intercommunalité de la DGF des communes ?
La
dotation d'aménagement représente 13 % des crédits de la
DGF des communes en 2000. Parmi ces 13 %, 6 % sont consacrés
à la dotation d'intercomunalité et 7 % à la DSU et la
DSR.
La part de la péréquation en faveur des communes n'augmente pas,
en raison du développement de l'intercommunalité, qui aboutit
à accroître chaque année le montant de la dotation
correspondante. Pour compenser la faible progression de la DSU et de la DSR,
les Gouvernements dégagent chaque année des crédits
supplémentaires, qu'ils consacrent aux deux dotations de
péréquation.
Pour améliorer la lisibilité du dispositif et éviter que
l'intercommunalité ne pèse sur la DSU et la DSR, notre
collègue Jean-Pierre Fourcade, président du comité des
finances locales, a proposé de dissocier la dotation
d'intercommunalité de la DGF des communes. De cette façon, la DSU
et la DSR pourraient bénéficier de l'intégralité de
l'augmentation de la dotation d'aménagement et parvenir à des
taux de progression acceptables.
Les crédits consacrés aujourd'hui par le Gouvernement à
majorer la DSU et la DSR pourraient directement être affectés
à l'intercommunalité. Le Gouvernement s'est partiellement
engagé dans cette voie avec la loi sur le renforcement et la
simplification de la coopération intercommunale, qui organise pour les
nouvelles communautés d'agglomération un financement
extérieur à l'enveloppe de la DGF des communes. Ces
communautés bénéficient d'un abondement de 500 millions de
francs du montant de la dotation d'intercommunalité et, si cette somme
est insuffisante, d'un prélèvement sur la dotation de
compensation de la taxe professionnelle.
Cette solution présente l'avantage de réserver la DGF des
communes aux communes et de garantir une meilleure progression du montant des
dotations de solidarité.
Elle présente l'inconvénient d'avoir un coût
budgétaire puisqu'elle remet en cause le principe de la
répartition à enveloppe fermée entre les EPCI et les
communes. Dans la situation actuelle, si la dotation d'intercommunalité
augmente beaucoup, la DSU et la DSR jouent le rôle de variable
d'ajustement. Dans le cadre d'une enveloppe autonome pour la dotation
d'intercommunalité, l'augmentation mécanique du montant de cette
dotation, en raison de l'augmentation du nombre d'habitants résidant
dans des communes appartenant à des structures intercommunales, se
traduira par une augmentation du coût pour l'Etat du financement de
l'intercommunalité.
Toutefois, des simulations seraient nécessaires pour déterminer
dans quelle proportion le surcoût qui en résulterait pour l'Etat
serait supérieur aux sommes qu'il consacre chaque année à
améliorer le taux de progression de la DSU et de la DSR et pour financer
les communautés d'agglomération.
En 1994, le commissariat général du Plan
375(
*
)
proposait de "
réviser la dotation
ville-centre afin de favoriser les regroupements intercommunaux
",
autrement dit de réorienter vers le financement de
l'intercommunalité les crédits de la fraction
" bourgs-centres " de la DSR.
3. Lier l'évolution de la dotation forfaitaire à celle de la dotation d'intercommunalité ?
Le
développement de l'intercommunalité aboutit à une
situation paradoxale : les communes transfèrent des
compétences à des EPCI, qui perçoivent une DGF en
contrepartie, mais, dans l'autre sens, la dotation forfaitaire des communes ne
baisse pas lorsqu'elles n'exercent plus certaines compétences.
Les mécanismes actuels de répartition de la DGF conduisent donc
à financer deux fois les mêmes compétences : une fois
en versant aux communes leur dotation forfaitaire et une deuxième fois
en versant une dotation d'intercommunalité aux EPCI.
Il pourrait être envisagé, pour tirer les conséquences du
développement de l'intercommunalité, de mettre progressivement
fin à ces doublons en accordant une moindre dotation forfaitaire aux
communes membres de structures intercommunales à fiscalité
propre, à due concurrence des compétences qu'elles ont
transférées.
Les sommes ainsi dégagées viendraient majorer le montant de la
DSU et de la DSR.
C. RATIONALISER LES DISPOSITIFS ACTUELS
Les
mécanismes actuels de péréquation souffrent de trois
faiblesses :
- il sont complexes. Chaque année, lors de la séance du
comité des finances locales consacrée à la
répartition des crédits du fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et du fonds
national de péréquation (FNP), les élus dénoncent
l'opacité et la complexité de ces deux " usines à
gaz " ;
- ils ne font l'objet d'aucune évaluation quand à leur
efficacité ;
- leurs moyens sont limités.
1. Simplifier les dispositifs actuels ?
L'objectif de dispositifs péréquateurs est de
parvenir
à la correction la plus fine possible des écarts de richesse. Les
critères d'éligibilité aux différents fonds de
péréquation sont donc inévitablement complexes. Le
ministère de l'intérieur consacre chaque année beaucoup
d'énergie pour collecter les données qui permettent
d'établir les indices synthétiques déterminant
l'éligibilité au fonds de solidarité de la région
Ile-de-France, à la dotation de solidarité urbaine ou à la
dotation de solidarité rurale.
S'agissant du FNPTP, du FNP ou encore des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), la longueur des
articles du code général des impôts qui leur sont
consacrés est inversement proportionnelle au volume des
crédits qui leur sont affectés :
- les ressources des FDPTP dépendent de l'écrêtement de
bases de taxe professionnelle, qui est calculé de manière
différente selon que ces bases sont communales, intercommunales, selon
le régime fiscal de la structure intercommunale concernée et
selon la catégorie à laquelle elle appartient. La
répartition des crédits obéit également à
des règles différenciées en fonction de ces mêmes
paramètres ;
- le FNPTP et le FNP pâtissent également de la diversité
d'origine de leurs ressources. Leurs dépenses sont soit
décidées par le comité des finances locales, soit
financées par prélèvement " automatique " sur
leur recettes.
Les bénéficiaires de ces fonds sont aujourd'hui dans
l'incapacité de percevoir précisément les raisons de la
modification d'une année sur l'autre du montant des attributions qui
leur sont versées, d'autant plus que, chaque année ou presque, la
loi de finance modifie les règles du jeu.
L'amélioration de la lisibilité du fonctionnement des fonds de
péréquation passe par une meilleure identification de l'objet de
chacun des dispositifs.
En 2000, le FNPTP et le FNP remplissent sept
missions différentes, certaines n'ayant d'ailleurs aucun lien avec la
réduction des écarts de richesse entre territoires.
Toutefois, une telle entreprise de clarification, si elle débouchait sur
une simplification des mécanismes de répartition, conduirait
inévitablement à des transferts de ressources entre
collectivités. Le bien fondé de ces transferts serait difficile
à établir en raison de l'absence d'instrument de mesure de
l'efficacité des différents instruments financiers de la
péréquation.
2. Mieux cibler les dispositifs actuels ?
Les
critères d'éligibilité aux différents instruments
de péréquation conduisent à verser des attributions
à un nombre très élevé de communes. En 2000 :
- 92 % des communes sont éligibles à la fraction
" péréquation " de la dotation de solidarité
rurale ;
- 76 % des communes de plus de 10.000 habitants sont éligibles à
la dotation de solidarité urbaine (mais seulement 12 % des communes
dont la population est comprise entre 5.000 et 10.000 habitants) ;
- 51 % des communes de plus de 10.000 habitants de la région
Ile-de-France sont éligibles au FSRIF ;
- 48 % des communes bénéficient d'attributions du FNP.
Mécaniquement,
un durcissement des critères
d'éligibilité à ces dotations permettrait
d'accroître le montant des transferts en direction des communes les plus
défavorisés.
Toutefois, plus des critères d'éligibilité sont stricts,
plus ils se doivent d'être fiables afin d'éviter les injustices.
Or, déjà aujourd'hui, les critères
d'éligibilité, notamment ceux de la DSU, laissent de
côté certaines communes qui, au regard de leur potentiel fiscal,
ne peuvent pas être considérées comme riches.
3. Renforcer les moyens des dispositifs actuels ?
Les
crédits consacrés aux instruments financiers de la
péréquation sont en deçà des besoins.
Ce constat a conduit le parti socialiste, au cours de sa convention
consacrée aux " territoires " tenue en juin 2000, à
préconiser de porter à 25 % la part des concours de l'Etat
ayant une vocation péréquatrice. Il a estimé la proportion
actuelle à environ 15 %.
Ce taux correspond à la part de la péréquation dans la
DGF. La part du total des concours péréquateurs dans l'ensemble
des dotations de l'Etat aux collectivités locales est de 10,4 %. Le
montant total des crédits de la péréquation
(c'est-à-dire les dotations péréquatrices versées
par l'Etat ajoutées aux dispositifs de redistributions entre
collectivités) est de 23,1 milliards de francs, soit le quart du montant
total de la DGF.
L'augmentation de ce montant par réorientation vers les
collectivités défavorisées de crédits aujourd'hui
attribuées sans condition de richesse
se heurte au problème
des transferts de richesse et à la difficulté de définir
des critères d'éligibilité fiables.
L'augmentation de ce montant par augmentation de la masse totale des
concours de l'Etat aux collectivités locales
est également
envisageable puisque, aujourd'hui, l'Etat perçoit de manière
indue des crédits qui auraient vocation à alimenter les budgets
locaux et qui pourraient donc légitimement être
réorientés vers la péréquation. Il en va
ainsi :
- du
produit de la fiscalité locale de France
Télécom
, dont les collectivités locales ne
perçoivent, par le biais du FNPTP, que la fraction du produit
supérieure au produit acquitté en 1994, soit environ un tiers du
total en 2000. L'Etat continue de percevoir l'équivalent du produit de
la fiscalité locale de France Télécom en 1994, soit
près de 5 milliards de francs.
De nombreux élus locaux plaident en faveur d'une mise au droit commun de
la fiscalité locale de France Télécom. Cette
évolution semble inévitable, notamment pour des raisons de
concurrence équitable entre France Télécom et ses
concurrents. Cependant, à titre transitoire, l'Etat pourrait
décider d'affecter une fraction plus importante de ce produit au
FNPTP
376(
*
)
;
- du
produit de la majoration de la cotisation de
péréquation
décidée par la loi de finances pour
1989. Entre 1990 et 1998, plus de 40 % du produit de cette cotisation a
alimenté le budget de l'Etat et non le FNPTP. Cette proportion a
augmenté depuis la loi de finances pour 1999 qui a majoré cette
cotisation pour financer le coût pour l'Etat de la compensation de la
suppression de la part salariale de la taxe professionnelle.
Dans un rapport consacré à la péréquation de la
taxe professionnelle
377(
*
)
, notre
collègue député Gérard Fuchs a jugé qu'il
serait "
ambitieux
(...)
d'accroître la part de
l'augmentation du taux de la cotisation de péréquation allant aux
fonds de péréquation. Votre rapporteur ne méconnaît
pas la difficulté d'une telle entreprise, compte tenu des contraintes
budgétaires, alors que la compensation par l'Etat de la réforme
de la taxe professionnelle est évaluée par la loi de finances
pour 1999 à 11,8 milliards de francs pour la seule année
1999
".
L'affectation au FNPTP de la majoration de 1989 au lieu de celle de 1999
permettrait de concilier le souci de M. Fuchs de ne pas remettre en cause
l'équilibre financier de la réforme de la taxe professionnelle
tout en majorant les ressources du FNPTP de plus de 1,5 milliard de francs. La
perte de recettes pour le budget de l'Etat ne devrait pas être
considérée comme une réduction de ses ressources mais
comme la disparition d'un avantage indu, dans le cadre d'un retour à
l'esprit de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité directe locale, qui a prévu que le produit de la
cotisation de péréquation était destiné à
financer le FNPTP ;
- du
montant des réfactions appliquées à certaines
compensations versées aux collectivités locales dont les recettes
fiscales augmentent rapidement
. Plusieurs dispositions législatives
prévoient que le montant des compensations d'exonérations
fiscales versées à une collectivité est réduit si
le produit des quatre taxes perçu par cette collectivité augmente
à un rythme élevé. Les collectivités dont le
produit des quatre taxes augmente faiblement sont dispensées de
réfaction.
Le jeu des réfactions est aujourd'hui un moyen pour l'Etat de
réduire le coût des compensations. S'il était prévu
que les économies ainsi réalisées étaient
consacrées à alimenter un fonds de péréquation, les
réfactions deviendraient un instrument de la réduction des
écarts de richesses entre collectivités.
En 1994, le commissariat général du Plan préconisait
d'augmenter les crédits consacrés à la
péréquation en regroupant "
l'ensemble des compensations
dans un fonds de péréquation à vocation
nationale
". La mise en oeuvre d'une telle proposition se heurterait
aux difficultés pratiques de détermination des critères
d'éligibilité suffisamment incontestables pour justifier
l'atteinte à l'autonomie fiscale des collectivités que
constituerait une remise en cause totale des compensations qu'elles
perçoivent au titre des exonérations de leurs bases fiscales.
Votre rapporteur préfère se réjouir du succès de la
forme la plus décentralisatrice de péréquation, la mise en
commun volontaire des recettes de la taxe professionnelle, principale source
d'écart de richesse entre collectivités, dans le cadre de la taxe
professionnelle unique (TPU). Entre 1999 et 2000, le nombre de communes
concernées par ce régime fiscal a été
multiplié par trois, de même que le nombre d'habitants
résidant dans des communes à TPU.
III. UNE NOUVELLE DONNE POUR LES CONCOURS DE L'ÉTAT
Si on
considère que des concours de l'Etat aux collectivités locales
adaptés devraient, d'une part, permettre aux collectivités
locales d'exercer leurs compétences dans de bonnes conditions et,
d'autre part, ne pas être de nature de remettre en cause
l'équilibre des finances publiques, force est de constater que la
configuration actuelle ne répond pas à ces deux exigences.
La politique de remplacement des impôts par des dotations
budgétaires entraîne une augmentation rapide des dépenses
structurelles incompressibles de l'Etat tandis que, au contraire, les dotations
de fonctionnement, d'équipement et de compensation des charges
transférées, augmentent moins vite que le coût des
dépenses obligatoires des collectivités locales.
A. FIXER DES RÈGLES DU JEU CLAIRES
1. Instaurer un véritable rendez-vous triennal
Les
finances locales sont un domaine dans lequel le "
pilotage à
vue
" est la règle. Certaines réformes très
importantes pour l'équilibre financier des collectivités locales
résultent de textes préparés dans l'urgence et sans
concertation, comme la suppression de la part salariale de la taxe
professionnelle ou la suppression de la part régionale de la taxe
d'habitation.
En matière de dotations, les taux d'indexation restrictifs prévus
par la loi sont régulièrement contournés à
l'occasion de l'examen des lois de finances au gré de la conjoncture
économique mais aussi du degré d'insatisfaction rencontré
parmi les élus de terrain de la majorité parlementaire. Les
effets d'annonces se multiplient, et se traduisent par la mise en place de
" tuyaux " entre les dispositifs, les mesures nouvelles
annoncées par un Gouvernement étant souvent financées en
prélevant les crédits d'autres enveloppes. La création de
l'enveloppe normée pluriannuelle des concours de l'Etat aux
collectivités locales n'a pas constitué un progrès
à cet égard.
En matière de dépenses, les charges nouvelles interviennent au
gré des évolutions législatives et réglementaires,
en dehors de toute cohérence
.
L'inscription des relations financières entre l'Etat et les
collectivités locales dans un cadre triennal aurait pu contribuer
à remédier à certains de ces travers si elle avait
su
dépasser la logique purement budgétaire
. Il convient
aujourd'hui de " densifier " le contenu des pactes ou des contrats
appelés à régir pendant trois ans les relations
financières entre l'Etat et les collectivités locales en
instaurant un véritable " rendez-vous triennal ", dont
l'ordre du jour comprendrait trois volets
:
- l'annonce par le Gouvernement de la norme de progression qu'il entend
appliquer à l'enveloppe normée des concours aux
collectivités locales ;
- une présentation détaillée des hypothèses
à partir desquelles cette norme a été établie.
Cette présentation comprendrait les prévisions d'évolution
des dépenses des collectivités locales pour la période
concernée ainsi que les prévisions d'évolution des autres
recettes des collectivités locales, fiscales notamment. Le Gouvernement
expliquerait également de quelle manière ses orientations en
matière de finances locales s'inscrivent dans le cadre
général de sa stratégie budgétaire ;
- l'annonce des réformes susceptibles d'intervenir en matière de
finances locales pendant la période concernée. Ces
réformes seraient prises en compte dans la détermination de la
norme d'évolution. Aucune autre réforme susceptible de remettre
en cause les prévisions de recettes et de dépenses retenues par
le Gouvernement pour établir la norme de progression de l'enveloppe
normée ne pourrait entrer en vigueur pendant la période de trois
ans
378(
*
)
.
Les conditions de détermination de l'évolution des concours de
l'Etat reflètent largement la nature de la relation entre l'Etat et les
collectivités locales.
En Grande-Bretagne, l'Etat fixe cette norme
d'évolution de manière unilatérale, en fonction de
l'appréciation qu'il porte sur l'évolution des besoins des
collectivités locales. En Allemagne, système
fédéral, c'est la Constitution qui organise le partage de la
richesse nationale entre le niveau central et les collectivités locales.
En France, la détermination du montant des enveloppes accordées
aux collectivités locales appartient essentiellement au pouvoir
exécutif en raison de la faible marge de manoeuvre du Parlement en
matière budgétaire. En l'état actuel de notre droit
constitutionnel, il ne peut pas en être autrement. Toutefois, les
collectivités locales peuvent légitimement attendre de l'Etat
qu'il justifie les options qu'il retient, et qu'il ne modifie pas les
règles du jeu en cours de route.
Le rendez-vous triennal présenterait l'avantage de remédier
à l'opacité actuelle des règles d'évolution des
concours de l'Etat aux collectivités locales, souvent ressenties comme
arbitraires par les élus locaux, en faisant apparaître clairement
les enjeux, les choix et les perspectives d'avenir.
2. Associer les collectivités locales aux décisions qui ont des conséquences sur leurs budgets
Les
efforts réalisés par les collectivités locales en
matière d'assainissement financier sont remis en cause par
l'intervention de dispositions législatives et réglementaires qui
s'imposent à elles et qui se traduisent par une aggravation de leurs
charges.
Il en est ainsi particulièrement dans le domaine des
rémunérations des agents et des normes techniques qui
s'appliquent à leurs équipements. Dans ces deux domaines, il est
urgent de revoir les procédures applicables :
- les collectivités locales devront désormais être
associées à la négociation des accords salariaux dans la
fonction publique.
Les décisions prises par l'Etat dans ce domaine
ont des conséquences très lourdes pour les budgets locaux. Entre
1990 et 1997, les dépenses de personnel de l'Etat ont progressé
de 32 % tandis que celles des administrations publiques locales ont
augmenté de 46 %. Ce taux de progression supérieur n'est pas
due uniquement aux recrutements, qui n'expliqueraient qu'un cinquième de
l'augmentation des dépenses locales, mais aussi à la structure de
la fonction publique territoriale qui compte une proportion plus
élevée d'agents de catégorie C. En 2000, l'accord salarial
du 10 février 1998 se traduit par un surcoût de 41,3 milliards de
francs, dont 23,3 %, soit 10 milliards de francs, à la charge des
collectivités locales. Pourtant, les collectivités n'ont pas
été associées à la négociation de cet accord.
- en matière de
normes techniques
, votre mission a
déjà plaidé, dans son rapport d'étape, pour une
nouvelle approche
379(
*
)
qui
aboutisse notamment à accroître la participation des
représentants des élus dans les instances où sont
étudiées et décidées les normes ; à
préciser l'étude d'impact afin d'évaluer le coût des
normes sur les budgets ; à établir un lien juridique entre
la durée de validité des normes respectées lors de la
réalisation d'un équipement et la durée d'amortissement
comptable de cet équipement.
Les dispositions ayant une incidence sur les budgets locaux, qu'elles
donnent lieu ou non à compensation financière, devraient
systématiquement et
préalablement à leur
entrée en vigueur être soumises à l'avis d'instances
telles que le comité des finances locales, à qui le Gouvernement
a pris l'habitude de soumettre certains textes, mais surtout la commission
consultative sur l'évaluation des charges (CCEC).
L'article L. 1614-3
du code général des
collectivités territoriales prévoit déjà une
procédure de consultation de la CCEC dans le cadre des
compétences transférées. Cette disposition n'est pas
toujours respectée puisque la commission ne s'est pas réunie
entre 1996 et 1999, et que cela n'a pas empêché la publication de
textes législatifs et réglementaires relatifs aux dépenses
et aux recettes transférées.
Depuis 1995, le bilan des transferts de charges réalisé par la
commission, dans le cadre d'un rapport au Parlement, comprend également
un bilan des charges qui ne s'inscrivent pas dans le cadre des
compétences transférées. Cet apport pourrait être
complété en prévoyant que la commission émet un
avis sur tous les textes qui ont un impact financier sur les
collectivités locales, et pas seulement sur les transferts de
compétences au sens strict. L'avis de la commission devrait comprendre
une
évaluation précise des conséquences des
dispositions proposées sur les budgets locaux
.
Dans les deux cas, la consultation de la CCEC devrait être
préalable
à l'examen de la disposition concernée
par le Parlement s'il s'agit d'une mesure législative ou de la
publication du texte au journal officiel s'il s'agit d'une disposition
réglementaire.
B. REVOIR LE MODE D'INDEXATION DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT
A
l'exception des dégrèvements, dont le montant évolue de
manière automatique, et des subventions, dont le montant dépend
de la volonté de l'Etat, les concours de l'Etat aux collectivités
locales évoluent en fonction d'indexations fixées par la loi.
Les taux d'indexation des dotations de l'Etat aux collectivités locales
sont donc au coeur des relations financières entre l'Etat et les
collectivités locales. Ils jouent un rôle de plus en plus grand
depuis que les impôts locaux sont progressivement transformés en
dotations.
1. Associer les collectivités locales à la croissance
Depuis
la création de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux
collectivités locales, les débats sur la pertinence du mode
d'indexation de chaque dotation a été éclipsé par
celui sur le taux d'évolution de l'"
ensemble
" qui
regroupe toutes les dotations de fonctionnement et d'équipement. En
effet, si l'indexation de l'une des composantes de l'enveloppe normée
est revalorisée, cela se traduit par une réduction du montant de
la variable d'ajustement, la dotation de compensation de la taxe
professionnelle, (DCTP).
Pourtant, les deux débats doivent être menés de
front :
a) Quelle progression pour l'enveloppe normée ?
Le
débat sur le taux d'indexation de l'enveloppe normée est en
réalité un débat sur le taux de progression de la
DCTP
, puisque toutes les autres dotations qui composent l'enveloppe
évoluent en fonction de mécanismes qui n'ont pas
été modifiés depuis 1996. Par conséquent, la
véritable question dans le cadre d'une réflexion sur le
fonctionnement d'une enveloppe normée est : dans quelles conditions
peut-il être acceptable pour les collectivités locales de
consentir à une baisse de la DCTP ?
Le rôle de la variable d'ajustement est de permettre un plafonnement de
la contribution de l'Etat. Dès lors, il faut admettre que la dotation
qui joue ce rôle puisse baisser. En revanche, organiser une baisse
annuelle du montant de la variable d'ajustement comme c'est le cas depuis 1996
n'est pas acceptable.
Il s'agit donc de déterminer quel est le " bon plafond " pour
l'enveloppe normée. Votre rapporteur considère que l'enveloppe
normée devrait augmenter
au même rythme que sa principale
composante, la DGF
. Dans ce cas de figure, la DCTP ne baisserait que si les
autres dotations qui composent l'enveloppe normée augmentaient plus vite
que la DGF. Si les autres dotations évoluaient moins vite que la DGF, la
DCTP continuerait à progresser, ce qui serait légitime puisque,
à l'origine, la DCTP est une compensation d'exonérations de bases
de taxe professionnelle qui, elles, continuent à augmenter.
Dans l'état actuel du mode de calcul de l'enveloppe
normée
380(
*
)
, le bon taux de progression
à retenir pour l'enveloppe serait " l'indice de la DGF ", qui
prend en compte l'évolution des prix et la moitié du taux de
croissance en volume du produit intérieur brut.
Cette suggestion reste une proposition
a minima
puisqu'elle revient
à considérer que l'Etat, malgré la contribution positive
des collectivités locales aux finances publiques et au dynamisme de
l'économie nationale, n'accorderait aux collectivités locales que
la moitié de la croissance du PIB en valeur.
b) Quelle progression pour les dotations de fonctionnement et d'équipement ?
Pour
permettre un plafonnement des concours de l'Etat sans réduire
arbitrairement le montant de la DCTP, il conviendrait que l'enveloppe
normée évolue au même rythme que sa principale composante,
la DGF. Une fois posé ce préalable, il n'en reste pas moins que
les modalités d'indexation des dotations qui composent l'enveloppe
normée doivent elles aussi faire l'objet d'un nouvel examen.
Ces dotations évoluent selon
trois modes d'indexation
différents :
- le
taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des
administrations publiques
s'applique aux trois dotations
d'équipement, la dotation globale d'équipement et les deux
dotations de compensation des charges transférées, la dotation
départementale d'équipement des collèges (DDEC) et la
dotation régionale d'équipement scolaire (DRES).
Ce taux paraît le plus approprié, même si les crédits
de la DRES et de la DDEC n'ont pas permis de couvrir l'ensemble des
dépenses résultant du transfert des compétences
correspondantes. S'il fallait remédier à cette difficulté,
une revalorisation périodique de l'assiette des dotations serait
préférable à une modification de leur indexation, qui a le
mérite d'être lisible et adaptée au type de dépense
financé par ces dotations ;
- le
taux d'évolution des recettes fiscales nettes de l'Etat
s'applique aux dotations de l'Etat au fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle et au fonds national de
péréquation. Ce mode d'indexation est également pertinent
s'agissant de dotations qui, historiquement, ont été mises en
place pour remplacer l'affectation à ces fonds de compensations
d'exonérations fiscales. Toutefois, il conviendrait de préciser
que ce taux est calculé indépendamment des modifications du
périmètre du budget de l'Etat
381(
*
)
;
- le
taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement
concerne évidemment la DGF, mais également plusieurs dotations
qui évoluent comme elle, au premier rang desquelles la DGD et ses
" satellites " (la DGD Corse et la DGD Formation professionnelle).
Le taux d'évolution de la DGF est différent de l'indice de la DGF
prévu à
l'article L.1613-1
du code général
des collectivités territoriales puisqu'il tient compte du recalage de la
base de la DGF et de la régularisation de son montant. Ce taux peut donc
être supérieur à celui de l'indice de la DGF. Il lui a le
plus souvent été inférieur.
Sachant que les dépenses obligatoires des collectivités
locales augmentent à un rythme soutenu, leur principale dotation de
fonctionnement doit-elle continuer à évoluer en fonction d'un
indice qui ne tient compte que de la moitié du taux de croissance du PIB
en valeur ?
Ne devrait-elle pas plutôt dépendre d'un
indicateur d'évolution des charges des collectivités
locales ? Une telle démarche serait cohérente avec la
jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle "
le
législateur peut définir des catégories de dépenses
qui revêtent pour une collectivité territoriale un
caractère obligatoire ; que toutefois les obligations ainsi mises
à la charge d'une collectivité territoriale doivent être
définies avec précision quant à leur objet et à
leur portée et ne sauraient méconnaître la
compétence propre des collectivités territoriales ni entraver
leur libre administration
"
382(
*
)
.
La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire du 4 février 1995 avait prévu la création d'un
indicateur de charges, qui n'a jamais été mis en oeuvre. Lors de
son audition par la mission le 8 mars 2000, M. Alain Guengant, professeur
à l'université de Rennes, a souligné que les pays qui
utilisaient de tels mécanismes tendaient à les faire
disparaître en raison des difficultés pratiques qu'ils posaient.
Une solution alternative pourrait consister à mettre en place des
planchers d'évolution
pour les dotations de fonctionnement, en
fonction du taux d'évolution de certaines dépenses obligatoires.
Par exemple, jusqu'au début des années 90, la DGF ne pouvait pas
augmenter moins vite que les rémunérations des agents de la
fonction publique territoriale.
Au cours de leur audition par la mission le 8 mars 2000, notre collègue
Jean-Pierre Fourcade, président du comité des finances locales,
et M. Alain Guengant, ont évoqué la possibilité d'une
indexation de la DGF, voire de toutes les dotations de fonctionnement, sur le
taux d'évolution des
recettes fiscales
nettes de l'Etat (à
périmètre du budget de l'Etat constant). De cette manière,
les collectivités locales bénéficieraient dans les
mêmes proportions que l'Etat des recettes fiscales engendrées par
la croissance économique et, en cas de ralentissement de
l'activité économique, supporteraient le même contrecoup
que l'Etat. Dans une telle hypothèse, il conviendrait cependant de
neutraliser l'effet des éventuelles baisses d'impôt
décidées par l'Etat sur le taux de progression de ses recettes
fiscales au titre d'une année.
Le maintien d'un lien entre l'évolution des concours de l'Etat et le
taux de croissance du PIB en valeur pourrait également être
envisagé, en soulignant que, compte tenu du rôle important de
soutien à la croissance joué par les collectivités
locales, la part du taux d'évolution du PIB qui leur serait
consacrée devrait au moins être supérieure à
50 %.
2. Le cas particulier de l'indexation des compensations d'exonérations fiscales
Depuis
la loi de finances pour 1999, les compensations d'exonérations fiscales
tendent à être indexées sur le taux d'évolution de
la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Cette indexation concerne désormais la compensation de la suppression de
la part salariale de la taxe professionnelle, la compensation de la part
régionale de la taxe d'habitation, la compensation de la taxe
additionnelle régionale sur les droits de mutation et la compensation de
la baisse du taux des droits de mutation à titre onéreux des
départements, incluse dans la dotation globale de
décentralisation. Le taux d'évolution de la DGF est
déconnecté de l'évolution des bases qui sont
compensées. Il évolue souvent moins vite que ces bases.
En 2000, l'écart entre le taux d'évolution de la DGF (0,8 %) et
le taux de progression des anciennes bases " salaires " de la taxe
professionnelle (plus de 3 %) a conduit le Gouvernement à accepter
d'indexer, pour cet exercice seulement, la compensation non pas sur le taux
d'évolution de la DGF mais sur l'indice de la DGF prévu par le
code général des collectivités territoriales, qui
s'élève en 2000 à 2,04 %. En 2001, une telle
dérogation ne sera pas nécessaire car le taux d'évolution
de la DGF sera vraisemblablement élevé, et supérieur
à l'indice de la DGF.
En matière de compensation, il convient de respecter un principe
simple : la transformation d'impôt locaux en dotations
budgétaires réduit la marge de manoeuvre fiscale des
collectivités locales et se traduit par une modification de leur
système de financement, qui a ses partisans et ses détracteurs.
Les partisans et les détracteurs de cette modification s'accordent pour
penser qu'elle ne doit pas se traduire par une perte de ressource manifeste
pour les collectivités locales. Pour que cette volonté commune
soit traduite dans les faits, trois évolutions sont possible en
matière d'indexation des compensations d'exonérations
fiscales :
- prévoir que le taux d'indexation ne peut être inférieur
à l'indice de la DGF prévu à
l'article L. 1613-1
du
code général des collectivités territoriales. Si le taux
d'évolution de la DGF est supérieur à l'indice de la DGF,
il s'applique. S'il lui est inférieur (en cas de régularisation
négative importante par exemple), c'est l'indice de la DGF qui
s'applique. De cette manière, les dérogations de même
nature que celle accordée en 2000 à la compensation de la
suppression de la part salariale de la taxe professionnelle n'auront plus
à être âprement négociées par les
collectivités locales et les parlementaires, mais seront de droit.
- aligner le taux de progression des compensations sur celui des recettes
fiscales de l'Etat. Les compensations s'analysant comme un transfert des
contribuables locaux vers les contribuables nationaux, il serait
légitime que les ressources correspondantes des collectivités
locales évoluent dans les mêmes proportions que celles de
l'Etat ;
- indexer le montant des compensation sur une fraction du taux de croissance du
PIB en valeur comprise entre 50 % et 100 %.
LES PROPOSITIONS DE LA MISSION D'INFORMATION
Proposition n° 1 : Recentrer l'Etat sur ses
compétences régaliennes, ses fonctions de conception et de
réglementation, son rôle de garant des grands équilibres
économiques et de la solidarité nationale.
Proposition n° 2 : Associer les collectivités locales
à l'élaboration des textes réglementaires qui les
concernent.
Proposition n° 3 : Promouvoir une nouvelle conception du
contrôle de légalité qui le fasse participer à la
sécurisation juridique.
Proposition n° 4 : Moderniser le contrôle financier
conformément aux orientations retenues par le groupe de travail sur les
chambres régionales des comptes.
Proposition n° 5 : Parfaire les partages des services
territoriaux de l'Etat correspondant aux transferts de compétences aux
collectivités locales.
Proposition n° 6 Eviter la superposition des services
déconcentrés car il n'est pas nécessaire qu'à
chaque niveau de collectivité décentralisée corresponde un
niveau déconcentré de l'Etat ; regrouper certains services
déconcentrés.
Proposition n° 7 : Renforcer l'autorité du préfet
sur les services déconcentrés ; pour développer
l' " interministérialité " de terrain,
généraliser les " pôles de compétences "
autour des préfets.
Proposition n° 8 : Instituer une mission de coordination
interministérielle placée auprès du Premier ministre,
à laquelle seraient rattachés les préfets.
Proposition n° 9 : Poursuivre la simplification du cadre
juridique de l'intercommunalité et la rationalisation des structures
intercommunales ; renforcer le rôle de la commission
départementale de la coopération intercommunale.
Proposition n° 10 N'envisager une éventuelle réforme
tendant à élire les délégués intercommunaux
au suffrage universel direct qu'une fois acquis le développement de
l'intercommunalité de projet autour de structures à
fiscalité propre, et préserver la place des communes comme
cellules de base de la démocratie locale.
Proposition n° 11 : Encourager les formules de
coopération interdépartementale et interrégionale.
Proposition n° 12 : Expérimenter des formules
institutionnelles nouvelles, sur la base du volontariat, tenant compte des
spécificités locales, dans un cadre juridique précis de
nature à garantir le caractère unitaire et indivisible de la
République.
Proposition n° 13 : Promouvoir les pays comme espaces de projet,
et non pas comme nouvel échelon territorial.
Proposition n° 14 : Assurer une meilleure harmonisation des
différents zonages.
Proposition n° 15 : Mieux associer les collectivités
locales à la procédure d'attribution des fonds structurels
européens.
Proposition n° 16 : Renforcer la coopération
décentralisée, notamment en dotant les instances de
coopération transfrontalière d'un budget commun, en simplifiant
les structures en place, et en favorisant des modes d'action souples et
adaptables aux circonstances.
Proposition n° 17 : Afin de mieux adapter la compensation des
charges transférées à leur évolution réelle,
revaloriser le mode d'indexation de la dotation générale de
décentralisation ; réviser périodiquement le montant
de la base des compensations ; prévoir la révision
automatique du montant des bases lorsque le coût des compétences
augmente par suite de modifications législatives des règles
relatives à l'exercice des compétences transférées.
Proposition n° 18 : N'admettre aucune exception à la
règle légale d'évaluation des charges
transférées à la date du transfert.
Proposition n° 19 : Recueillir l'avis de la commission
consultative sur l'évaluation des charges sur le montant des
compensations inscrit dans les projets de loi de finances et sur
l'arrêté de répartition des crédits entre les
collectivités.
Proposition n° 20 : Réserver la contractualisation entre
l'Etat et les collectivités aux domaines qui relèvent
effectivement d'une responsabilité partagée.
Proposition n° 21 : Associer dès la phase de
négociation tous les partenaires dont les compétences seront
concernées par le contrat, au plus près des
réalités locales.
Proposition n° 22 : Inciter l'Etat à tenir ses
engagements contractuels, en prévoyant des sanctions financières
en cas de défaillance.
Proposition n° 23 : Donner un contenu légal à la
notion de collectivité chef de file pour assurer un rôle de
coordination de la programmation et de l'exécution des actions communes
à plusieurs collectivités territoriales, sans remettre en cause
la prohibition de toute tutelle d'une collectivité sur l'autre.
Proposition n° 24 : Promouvoir l'expérimentation, chaque
fois que possible, avant tout éventuel nouveau transfert de
compétences.
Proposition n° 25 : Transférer aux régions la
responsabilité de la construction et de l'entretien des bâtiments
universitaires.
Proposition n° 26 : Transférer à chaque niveau de
collectivité la responsabilité de la gestion des personnels
concourant à la vie quotidienne dans les établissements
d'enseignement entrant dans son domaine de compétences.
Proposition n° 27 : Réorganiser
l'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes
(AFPA) en
associations paritaires régionales, afin de renforcer les
compétences des régions en matière d'organisation des
filières, d'homologation des formations et d'adaptation des
règles nationales.
Proposition n° 28 : Transférer aux départements la
responsabilité des travaux d'entretien sur les routes nationales non
classées, dans le respect des règles de compensation des
transferts de charge.
Proposition n° 29 : Transférer à l'Etat les
compétences départementales en matière de
prévention sanitaire afin d'unifier les blocs de compétence en
matière de santé publique.
Proposition n° 30 : Simplifier les règles de prise en
charge des personnes handicapées en recentrant la compétence des
départements exclusivement sur les fonctions d'hébergement et
d'accompagnement social.
Proposition n° 31 : Confier intégralement aux
départements l'exercice des missions actuellement assumées en
faveur des familles ou des jeunes en difficulté par les fonds de
solidarité pour le logement (FSL) et les fonds d'aide aux jeunes (FAJ)
en assurant une compensation par transfert des crédits d'Etat
affectés à ces fonds.
Proposition n° 32 : Mettre fin à la cogestion en
matière d'insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du RMI en clarifiant les compétences
respectives de l'Etat et des collectivités territoriales dans un cadre
partenarial.
Proposition n° 33 : Transférer aux départements
l'inventaire, l'Etat conservant ses prérogatives régaliennes en
matière de conservation du patrimoine.
Proposition n° 34 : Reconnaître explicitement aux
collectivités locales, et en particulier aux communes, la
responsabilité des établissements d'enseignement artistique, en
associant à cette compétence un financement approprié.
Proposition n° 35 : Reconnaître aux communes un droit
à l'expérimentation pour la création d'une police
territoriale de proximité, placée sous l'autorité du maire
et soumise au contrôle de l'Etat et des procureurs de la
République.
Proposition n° 36 : Clarifier le cadre juridique des
interventions économiques des collectivités locales en
harmonisant la législation nationale avec le droit européen,
notamment en supprimant la distinction entre aides directes et indirectes et en
redéfinissant les aides selon des critères plus objectifs ;
renforcer les moyens juridiques des collectivités locales pour aider
à la création d'entreprises innovantes.
Proposition n° 37 : Renforcer le rôle des
départements dans le fonctionnement des services d'incendie et de
secours.
Proposition n° 38 : Pour mieux adapter la fonction publique
territoriale aux spécificités des collectivités locales,
professionnaliser les concours et promouvoir le concours sur titres, en
reconnaissant l'équivalence des diplômes, pour des qualifications
spécifiques.
Proposition n° 39 : Préserver la voie du recrutement
contractuel, indispensable élément de souplesse.
Proposition n° 40 : Organiser la représentation des
collectivités territoriales employeurs dans les négociations
touchant la fonction publique.
Proposition n° 41 : Mutualiser la formation initiale des
administrateurs territoriaux avant leur recrutement ; valider les acquis,
pour adapter la formation complémentaire à la valeur
professionnelle de l'agent ; organiser la formation initiale sur le
terrain.
Proposition n° 42 : Imposer aux agents une durée minimale
d'emploi dans la collectivité de première affectation.
Proposition n° 43 : Poursuivre l'adaptation des quotas
d'avancement et des seuils démographiques.
Proposition n° 44 : Pour rendre la fonction publique plus
attractive, lever les obstacles à la mobilité d'une
filière à l'autre ; favoriser la mobilité entre
collectivités, et entre la fonction publique territoriale et la fonction
publique d'Etat.
Proposition n° 45 : Favoriser la promotion interne comme
sanction d'une compétence et reconnaissance de la valeur professionnelle
de l'agent.
Proposition n° 46 : Compléter les filières de la
fonction publique territoriale par de nouveaux cadres d'emplois, pour prendre
en compte les nouveaux métiers.
Proposition n° 47 : Adapter le statut de la fonction publique
territoriale à l'évolution de l'intercommunalité.
Proposition n° 48 : Inscrire la garantie de l'autonomie fiscale
des collectivités locales dans la Constitution, afin de renforcer le
principe constitutionnel de libre administration.
Proposition n° 49 : Moderniser la fiscalité locale en ne
négligeant aucune piste : rénover l'assiette des
impôts existants ; tranférer de nouvelles ressources fiscales
aux collectivités locales, soit pour remplacer les impôts actuels,
soit pour remplacer certaines dotations de l'Etat. Ces nouvelles ressources
pourraient provenir soit du transfert d'impôts, soit de la
possibilité pour les collectivités locales de voter des taux
additionnels aux impôts d'Etat, soit de la création de nouveaux
impôts.
Proposition n° 50 : Pour améliorer la
péréquation, renforcer le caractère redistributif des
dotations de l'Etat aux collectivités locales, et notamment de la
dotation globale de fonctionnement.
Proposition n° 51 : Mesurer l'efficacité des dispositifs
actuels de péréquation de manière à permettre une
simplification et un meilleur ciblage.
Proposition n° 52 : Réorienter vers la
péréquation des crédits qui en sont aujourd'hui
détournés, tels que la fiscalité locale de France
Télécom ou une partie de la fraction du produit de la cotisation
de péréquation perçue par l'Etat.
Proposition n° 53 : Poursuivre la politique d'encouragement
à l'application du régime fiscal de la taxe professionnelle
unique.
Proposition n° 54 : Fixer la norme d'évolution des
concours financiers de l'Etat aux collectivités locales
(" l'enveloppe normée ") après un débat
parlementaire au cours duquel auront été présentées
les mesures susceptibles d'affecter les budgets locaux, notamment les nouvelles
charges, au cours de la période pour laquelle s'applique cette norme
d'évolution.
Proposition n° 55 : Associer les collectivités locales
aux décisions qui ont des conséquences sur leurs budgets,
notamment en matière de rémunération des agents et de
détermination des normes techniques.
Proposition n° 56 : Revoir les modalités
d'évolution des concours de l'Etat en prévoyant des modes
d'indexation qui tiennent compte de l'objet de chaque dotation et qui
permettent de faire bénéficier les collectivités de leur
contribution à la croissance du produit intérieur brut.
OBSERVATIONS DU GROUPE SOCIALISTE
SUR LES
PROPOSITIONS FIGURANT DANS LA MOTION ADOPTÉE
PAR LA MISSION
D'INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION
La
décentralisation est aujourd'hui approuvée par l'ensemble des
élus comme un acquis irréversible ; ceux-ci souhaitent
poursuivre ce mouvement en simplifiant ce qui peut l'être dans le
fonctionnement comme dans les champs d'action des institutions locales.
Il était temps de procéder à un bilan. C'est dans cette
perspective, que le Gouvernement a confié à Pierre Mauroy la
présidence d'une commission, où siègent tous les
représentants des associations d'élus, chargée de faire
des propositions pour rendre la décentralisation plus légitime,
efficace et solidaire. Celle-ci rendra ses conclusions au début de
l'automne prochain.
Les travaux de la mission d'information nous paraissent être une
contribution intéressante à verser au dossier de la
décentralisation.
Ce rapport est plus un constat, qu'un ensemble de propositions concrètes
et de ce fait susceptible de recueillir un certain consensus.
Cependant parmi les mesures préconisées dans la motion du rapport
de la mission d'information un certain nombre appellent des réserves,
inquiétudes, voire opposition de notre part.
Les propositions formulées, apparaissent plus comme une liste de
souhaits quelquefois insuffisamment articulés et
hiérarchisés que comme des propositions concrètes et
précises.
Ainsi par exemple:
Si nous n'avons pas d'opposition a priori à l'idée de promouvoir
" une collectivité chef de file
" pour les
compétences partagées, encore faudrait-il que cette notion soit
précisée au regard de critères déterminants
(compétence principale, financeur principal...) et veiller à ce
qu'elle n'entraîne pas la tutelle d'une collectivité locale sur
une autre.
Avant toute réforme tendant au transfert des constructions
universitaires à la région, il est indispensable d'évaluer
avec précision les besoins pour l'avenir en matière
d'investissement et de maintenance des universités. Il en va de
même pour le transfert de la gestion des personnels administratifs et
techniques des établissements d'enseignement. En règle
générale toute modification des compétences entre l'Etat
et les collectivités ou entre collectivités doit être
précédée d'une étude d'impact approfondie prenant
en compte l'existant et les perspectives à moyen terme.
La suggestion " d'ouvrir droit à l'expérimentation pour
placer une police territoriale de proximité sous l'autorité des
maires" par contre appelle notre opposition totale. L'Etat se doit d'assurer
l'égale sécurité de tous. Le principe de libre
administration des collectivités locales permet aux communes qui le
souhaitent de se doter d'une police municipale. La loi du 15 avril 1999
relative aux polices municipales a fourni un cadre législatif
précis à l'action des polices municipales ; il convient de
ne pas aller au-delà.
Sur ce plan des missions régaliennes il nous semble dangereux de trop
expérimenter en laissant un pouvoir très important aux
collectivités locales, lequel pourrait entraîner des
dérives.
S'agissant des propositions faites concernant la fonction publique
territoriale, la présentation de celles-ci laisse à penser que le
recrutement de contractuels serait insuffisant. Or le statut de la fonction
publique territoriale permet le recrutement d'agents contractuels pour des
tâches spécifiques à durée
déterminée ; aller au-delà remettrait en cause le
principe du concours qui préside à une fonction publique
indépendante et compétente. Nous sommes opposés à
toute extension du recrutement de contractuels.
La promotion des métiers territoriaux par les institutions en charges de
l'organisation des concours doit être une priorité, afin de
recruter dans de bonnes conditions des professionnels devant remplacer les
nombreux départs à la retraite et de prendre en compte
l'évolution des tâches au sein de nos collectivités dans
une perspective prospective. Pour autant nous pensons que les cadres d'emploi
existant sont assez larges pour intégrer les nouveaux métiers et
qu'il n'est pas nécessaire d'en créer de nouveaux.
En ce qui concerne la rénovation du système du financement local,
nous regrettons que la solidarité entre les collectivités locales
soit trop peu abordée. De même, il nous semblerait souhaitable de
préciser les axes d'une " modernisation de la taxe
d'habitation "
Enfin, la proposition de loi constitutionnelle du président Poncelet,
est pour nous inacceptable. Outre le fait, qu'elle confère au
Sénat un droit de veto parfaitement injustifié sur tous les
textes relatifs aux collectivités territoriales, en constitutionalisant
les relations entre l'Etat et les collectivités locales elle fait
descendre la Constitution à un niveau qui n'est pas le sien. Les
règles de compensation des charges transférées sont
déjà prévues par les lois de décentralisation et le
dispositif proposé impliquerait que l'on modifie la Constitution chaque
fois que l'on voudrait adapter ces règles. La nécessaire
réforme de la fiscalité locale ne passe pas par une
révision constitutionnelle.
ANNEXES
_____
ANNEXE 1
RAPPEL DES PROPOSITIONS DU RAPPORT D'ÉTAPE
DE LA
MISSION D'INFORMATION
PROPOSITIONS DE LA MISSION D'INFORMATION
EN VUE DE
RENFORCER
LA SÉCURITÉ JURIDIQUE
DE L'ACTION LOCALE
I. RÉNOVER L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DES COLLECTIVITÉS
LOCALES : DES RÈGLES DU JEU CLAIRES
POUR DES ÉLUS
RESPONSABLES
1.
Assurer la sécurité juridique en établissant un
" corpus " de règles claires
•
achever la codification
des textes applicables aux
collectivités locales, non seulement la partie réglementaire du
code général des collectivités territoriales mais aussi
les codes sectoriels intéressant les compétences locales ;
•
codifier les incriminations
relevant du droit pénal
spécial ;
• clarifier les règles applicables
dans plusieurs secteurs
d'intervention des collectivités locales et rechercher une
simplification des textes, notamment en matière financière et
fiscale ;
•
promouvoir une
nouvelle approche des normes techniques
applicables aux collectivités locales, par une meilleure
évaluation de leur coût financier dans le cadre des études
d'impact des projets de loi et décrets en Conseil d'Etat, par une
association plus fréquente des collectivités locales au processus
d'élaboration des normes, par une plus grande stabilité des
normes applicables et par le renforcement de l'information des élus
locaux sur les normes en vigueur.
2. Assurer la sécurité juridique en clarifiant les
responsabilités
• mieux préciser la
responsabilité des
différents acteurs
dans la conduite des actions publiques locales
par une clarification de la répartition des compétences et des
modalités de leur exercice, notamment à travers le recours
à des procédés contractuels ;
•
approfondir la réforme de l'Etat
afin de clarifier les
missions et l'organisation des services déconcentrés ;
• mieux définir les modalités de
répartition des
responsabilités au sein même des collectivités
locales ;
•
renforcer les moyens de contrôles propres
aux
collectivités locales et reconnaître la fonction de juriste au
sein des filières de la fonction publique territoriale ;
• promouvoir une nouvelle conception du contrôle de
légalité
qui le fasse participer à la
sécurisation juridique ;
• moderniser le contrôle financier
conformément aux
orientations retenues par le groupe de travail du Sénat sur les chambres
régionales des comptes.
II. CONCILIER LES EXIGENCES DU MANDAT LOCAL ET LA PÉNALISATION ACCRUE
DE LA SOCIÉTÉ
La mission, qui n'a pas estimé souhaitable de rétablir un
régime spécifique et dérogatoire au profit des élus
locaux, a envisagé plusieurs mesures, la plupart de caractère
général, donc susceptibles de concerner l'ensemble des
citoyens :
1.
revaloriser la voie civile
comme mode normal de
réparation des préjudices en appliquant aux dommages subis
à l'occasion de fautes d'imprudence ou de négligence des
procédures accélérées inspirées des
dispositifs existants ; favoriser la transaction ; autoriser le
représentant de l'Etat à élever le conflit dès la
phase d'instruction ;
2.
rendre à la sanction pénale sa
finalité
qui est de réprimer une faute morale :
• en
limitant le nombre d'incriminations pénales
dès lors que les comportements en cause ne revêtent aucune
intention de nuire ;
• en clarifiant, conformément au principe constitutionnel de
légalité des délits et des peines, la définition de
certaines infractions pénales susceptibles de concerner les élus
locaux, notamment le délit de favoritisme dans les marchés
publics ;
3.
caractériser la faute d'imprudence ou de
négligence
susceptible d'engager la responsabilité
personnelle en privilégiant une causalité adéquate qui
impliquerait un lien direct entre la faute et le dommage et, à
défaut, subordonnerait la responsabilité à l'existence
d'une violation manifestement délibérée d'une obligation
de sécurité imposée par les lois ou les
règlements ;
4.
promouvoir un recours plus systématique à la formule du
témoin assisté
et
modifier les conditions de la mise en
examen
qui ne pourrait intervenir qu'en présence d'indices
graves
ou
concordants
;
clarifier les conditions de la
garde à vue
en appliquant une règle de
proportionnalité entre les mesures susceptibles d'être prises et
la dangerosité des intéressés ou la
nécessité d'assurer leur protection.
5.
mieux sanctionner les
recours abusifs
et remédier
à
l'" atomisation "
actuelle de l'action publique ;
6.
poursuivre la réflexion sur les voies et moyens d'utiliser
la responsabilité de la collectivité locale
pour tous les
cas où les faits non volontaires reprochés à un élu
local ne sont pas détachables des fonctions, en s'inspirant, le cas
échéant, du système des infractions administratives
prévu en droit allemand ;
7.
charger, selon les cas, l'Etat ou la collectivité
locale, de la protection juridique de l'élu et permettre la prise en
charge par la collectivité locale de
l'assurance personnelle
de
ce dernier ainsi que
l'intervention des associations départementales
de maires
dans les instances introduites par les élus municipaux
à la suite d'injures, de menaces ou d'agressions à raison de
leurs fonctions.
PROPOSITIONS DE LA MISSION D'INFORMATION
EN VUE
D'AMÉLIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE
DES MANDATS LOCAUX
En
matière de conditions d'exercice des mandats locaux,
diverses
améliorations ont déjà été proposées
lors de l'examen du projet de loi ordinaire relatif à la limitation
du cumul des mandats et des fonctions.
Pour autant, l'adoption de ces dispositions ne répondrait pas à
l'ensemble des problèmes rencontrés quotidiennement par les
élus locaux dans l'exercice de leurs mandats et fonctions.
Afin de favoriser l'accès des citoyens aux fonctions électives
locales et de rééquilibrer la représentation sociologique
des élus, la mission a adopté les propositions suivantes :
1. Concilier plus aisément une activité professionnelle
et l'exercice d'un mandat local
• La mission a souhaité que la durée des
autorisations d'absence et des crédits d'heures puisse être
considérée comme une période de travail effectif pour le
calcul des cotisations sociales au titre du régime général
de la sécurité sociale et de l'assurance chômage.
Cette mesure est destinée à éviter que les salariés
élus locaux ne soient pénalisés au moment du calcul de la
pension de vieillesse du régime général, ou le cas
échéant, lors du calcul du montant des indemnités
journalières d'assurance maladie ou des indemnités de
chômage.
La mission estime que l'exercice du mandat ne doit plus conduire à un
affaiblissement du niveau de protection sociale de l'élu dans son
domaine professionnel. Une table ronde pourrait réunir les partenaires
sociaux et l'Etat pour déterminer les modalités de cette prise en
charge.
• Par ailleurs, la mission a proposé que la
réglementation du droit du travail autorise explicitement une
création d'emploi à durée déterminée ou le
recours au travail temporaire, sur toute la durée du ou des mandats
électifs du salarié élu local, afin de faciliter son
éventuel remplacement durant les périodes d'absence liées
à l'exercice de son mandat.
2. Faciliter l'exercice à plein temps du mandat local
• La mission a estimé qu'à l'avenir un plus grand
nombre de salariés hommes et femmes souhaiteront renoncer temporairement
ou durablement à l'exercice de leur activité professionnelle pour
se consacrer plus entièrement à leur mandat local, y compris dans
des collectivités locales de taille moyenne.
Pour ne pas décourager les vocations des salariés du secteur
privé, la mission a demandé que le droit à suspension du
contrat de travail et à réintégration à l'issue du
mandat, ainsi que le mécanisme d'affiliation automatique au
régime général de sécurité sociale, soient
étendus à tous les maires, maires-adjoints, présidents
d'organismes de coopération intercommunales, conseillers
généraux et conseillers régionaux renonçant
à leur activité professionnelle pour exercer leur mandat,
nonobstant toute considération liée à l'importance
démographique de la collectivité.
• Par ailleurs pour les personnes ayant exercé les fonctions
de maires à plein temps, la mission a souhaité le maintien du
versement de l'indemnité sur une période de six mois à
l'issue du mandat, soit dans l'hypothèse où l'ancien élu
est inscrit au chômage, soit qu'ayant repris ou créé une
activité indépendante, le niveau de ses revenus soit
inférieur à celui procuré par les indemnités. Cette
" indemnité d'aide au retour à la vie professionnelle "
devra être financée par un organisme
ad hoc
financé
par des cotisations versées par les collectivités locales afin
d'assurer une mutualisation des risques entre elles.
• Enfin, la mission s'est prononcée pour
l'amélioration du régime de retraite des élus à
plein temps.
Les élus qui ont renoncé au cours de leur mandat à leur
activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de leur
mandat doivent être autorisés à maintenir leur
adhésion aux régimes de retraite par rente pendant toute la
durée de leur mandat.
D'une manière générale, la retraite des élus locaux
devrait être améliorée :
- soit en revalorisant le niveau des retraites versées par l'IRCANTEC,
selon des modalités à déterminer avec cet organisme ;
- soit en généralisant à l'ensemble des élus le
dispositif des retraites par rente à des taux de cotisations
modulées selon que l'élu exerce son mandat à plein temps
ou maintienne son activité professionnelle.
3. Revaloriser les indemnités de fonction
La mission a exprimé son attachement au principe de gratuité du
mandat, tout en préconisant un aménagement du régime des
indemnités de fonction :
• La mission a souhaité que le montant des indemnités
de fonction soit revalorisé pour permettre aux élus locaux
d'exercer leurs fonctions dignement sans pour autant grever trop lourdement les
finances publiques. Le nouveau barème, adopté dans le cadre de la
discussion du projet de loi ordinaire relatif à la limitation du cumul
des mandats, constitue une avancée importante.
• Par ailleurs, la mission a proposé, dans un souci de
clarté et compte tenu de l'importance croissante des
responsabilités incombant aux élus locaux, que les
assemblées délibérantes se prononcent de droit sur le taux
maximal des indemnités de fonction qui peut être réduit
pour des raisons liées à l'intérêt de la
collectivité locale ou consécutives à la mise en oeuvre
des mesures de plafonnement des indemnités en cas de cumul.
• Les progrès en matière d'indemnisation doivent
être assortis d'une mesure de solidarité en faveur des communes
rurales : le bénéfice de la dotation " élu
local " serait étendu à toutes les communes de
métropole de moins de 3.500 habitants dont le potentiel fiscal est
inférieur à la moyenne de leur strate démographique.
• Enfin, la mission s'est prononcée en faveur d'une
clarification légale du statut juridique de l'indemnité de
fonction et du caractère insaisissable de la fraction correspondant
à des frais d'emploi.
4. Reconnaître et généraliser l'exigence de
formation de l'élu
• Afin de mieux orienter les actions de formation vers les
préoccupations concrètes des élus locaux, la mission a
demandé que le Conseil National de la Formation des élus locaux
soit habilité à édicter un schéma pluriannuel des
objectifs prioritaires de formation qui devait être respecté lors
de l'agrément des organismes de formation.
• Par ailleurs, la commission a souhaité que le droit
à la formation posé par la loi du 3 février 1992 soit
complété en précisant que chaque responsable d'une
collectivité territoriale devra suivre au moins une formation au cours
de l'exercice de son mandat.
ANNEXE 2
LISTE DES PERSONNALITÉS
AUDITIONNÉES
•
M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, ministre de l'Intérieur (2 mars
1999)
• M. Christian SAUTTER, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie (8 mars 2000)
• M. Emile ZUCCARELLI, ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de la décentralisation (16 mars 1999)
• M. Philippe ADNOT, sénateur de l'Aube, rapporteur du groupe
de travail du Comité des finances locales (CFL)
(15 décembre 1999)
• MM. Jean-Paul AMOUDRY, sénateur de Haute-Savoie,
président, et Jacques OUDIN, sénateur de Vendée,
rapporteur, du groupe de travail commun de la commission des lois et de la
commission des finances sur les chambres régionales des comptes
(7 décembre 1999)
• M. Jean-Jacques ANDRIEUX, directeur général de l'Union
nationale des associations de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des
adultes (UNASEA) (5 avril 2000)
• M. Jean-Bernard AUBY, président de l'Association
française de droit des collectivités territoriales, professeur
à l'Université de Paris II (6 mai 1999)
• M. Jean AUROUX, président de la Fédération des
maires de villes moyennes, accompagné de MM. Bruno BOURG-BROC,
Bernard MURAT et Antoine ROGNARD, membres du conseil d'administration de cette
association (27 avril 1999)
• M. Claude BADRONE, sous-directeur au service de la
législation fiscale au ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie (26 octobre 1999)
• M. Jean-Pierre BALLIGAND, vice-président de l'Institut de la
Décentralisation, député de l'Aisne (8 mars 2000)
• MM. Alain BAUER et Xavier RAUFER, auteurs de l'ouvrage
" Violences et insécurités urbaines " (28 mars
2000)
• M. Jean BERGOUGNOUX, président du groupe d'études et
de réflexion interrégional (GERI) (11 mai 1999)
• M. Patrice BERGOUGNOUX, directeur général de la
police nationale (21 mars 2000)
• M. Hubert BLANC, conseiller d'Etat (10 juin 1999)
• M. Anastassios BOUGAS, chef d'unité adjoint à la
direction de la coordination et de l'évaluation (DG XVI) à la
Commission européenne (8 juin 1999)
• M. Joël BOURDIN, sénateur de l'Eure, rapporteur de
l'Observatoire des finances locales (3 novembre 1999)
• M. Roger BRUNET, géographe, directeur de recherche au Centre
national de la recherche scientifique (11 mai 1999)
• Mme Martine BURON, vice-présidente de l'Association des
petites villes de France (APVF), M. Claude HAUT, membre du Bureau, et
M. Adrien ZELLER, vice-président (24 mars 1999)
• M. Pierre CALAME, président de la Fondation
Charles-Léopold Meyer (15 juin 1999)
• Me Régis de CASTELNAU, président de l'Association
française des avocats spécialisés dans le conseil aux
collectivités locales (18 mai 1999)
• M. Marc CENSI, président de l'Assemblée des districts
et communautés de France (27 avril 1999)
• M. Yves CHARPENEL, directeur des affaires criminelles et des
grâces au ministère de la justice (18 mai 1999)
• M. Jean-Louis CHAUZY, président de l'assemblée
permanente des présidents des conseils économiques et sociaux
régionaux, et M. Pierre TROUSSET, président d'honneur
(7 avril 1999)
• M. Gérard CHRISTOL, président de la conférence
des bâtonniers (18 mai 1999)
• M. Jacques CREYSSEL, directeur délégué du mouvement
des entreprises de France (MEDEF) (8 mars 2000)
• M. Michel DELEBARRE, président du Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT) (5 avril 2000)
• M. Joël DELPLANQUE, directeur des sports au ministère
de la jeunesse et des sports (5 avril 2000)
• M. Claude DOMEIZEL, sénateur des Alpes de
Haute-Provence, président de la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales (CNRACL) (8 décembre 1999)
• M. Gérard-François DUMONT, démographe, ancien
recteur de l'académie de Nice, professeur à l'université
de Paris-Sorbonne (11 mai 1999)
• M. Xavier DUPONT, directeur de la solidarité au conseil
général d'Ille-et-Vilaine (22 juin 1999)
• M. Jean-Pierre DUPORT, préfet de la région
d'Ile-de-France et président de l'association du corps
préfectoral (6 mai 1999)
• M. Didier DURAFFOURG, président du syndicat national des
secrétaires généraux et des directeurs
généraux des collectivités locales (9 février
2000)
• Mme Bernadette DURAND, chargée du développement,
M. Régis PELTIER, responsable de la mission développement de
la branche retraite de la Caisse des dépôts et consignations,
Mme Michelle VERRECCHIA, responsable de la gestion administrative du Fonds
de pension des élus locaux (FONPEL) (15 décembre 1999)
• M. Pierre FAUCHON, sénateur de Loir-et-Cher, rapporteur du
groupe de travail de la commission des lois du Sénat sur la
responsabilité pénale des élus locaux (10 juin 1999)
• M. Hugues FELTESSE, directeur général de l'Union
nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et
sociales (UNIOPSS) (29 mars 2000)
• M. Jean-Pierre FOURCADE, sénateur des Hauts-de-Seine,
président du comité des finances locales, (8 mars 2000)
• M. Jacques FOURNIER, membre honoraire du Conseil d'Etat
(29 juin 1999)
• M. Michel GARNIER, directeur de la programmation et du
développement au ministère de l'éducation nationale
(9 février 2000)
• M. Pierre GAUTHIER, directeur de l'action sociale,
délégué interministériel au revenu minimum
d'insertion (4 avril 2000)
• M. Guy GILBERT, professeur à l'université Paris X
Nanterre (3 novembre 1999)
• M. Alain GUENGANT, professeur à l'université de Rennes
(8 mars 2000)
• M. Daniel HOEFFEL, sénateur du Bas-Rhin, vice-président de
l'Association des maires de France (AMF) (9 novembre 1999)
• M. Dominique HOORENS, directeur des études du
Crédit local de France (29 février 2000)
• M. Jean-Jacques HYEST, sénateur de Seine-et-Marne, coauteur
du rapport " Une meilleure répartition des effectifs de la police
et de la gendarmerie pour une meilleure sécurité publique "
(4 avril 2000)
• M. Jean-Jacques ISRAEL, membre du Conseil de l'Ordre des avocats au
Barreau de Paris, et M. Michel CEOARA, membre de la commission de droit
administratif de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris (18 mai 1999)
• M. Didier LALLEMENT, directeur général des
collectivités locales au ministère de l'intérieur
(6 juillet 1999)
• M. Alain LARANGÉ, inspecteur général de
l'administration, et M. Sébastien COMBEAUD, inspecteur de
l'administration (1
er
juillet 1999)
• M. Philippe LAURENT, consultant, président de la
société Philippe Laurent Consultants (29 février
2000)
• M. Loïc LE MASNE, président de la
fédération nationale des sociétés d'économie
mixte, accompagné de M. Maxime PETER, directeur
général (21 mars 2000)
• Mlle Elke LÖFFLER, administrateur au département de la
gestion publique de l'Organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE) (8 juin 1999)
• M. Marceau LONG, président de l'Institut de la gestion
déléguée, vice-président honoraire du Conseil
d'Etat (28 mars 2000)
• M. Gérard MARCOU, universitaire, professeur à
l'université de Paris I (28 mars 2000)
• M. François MASSEY, directeur régional et
départemental de la jeunesse et des sports (région Centre et
département du Loiret) (29 mars 2000)
• Mme Mireille MONTAGNE, directeur de la vie sociale du
département de la Savoie (22 juin 1999)
• M. Frédéric NÉRAUD, secrétaire
général de la Fédération nationale des maires
ruraux (24 mars 1999)
• M. Bruno ODIN, directeur de l'Association des maires de
Charente-Maritime et président de l'association des directeurs
d'associations des maires, et M. Michel OCYTKO, directeur de l'Association
des maires d'Indre-et-Loire et responsable de la formation des élus
(9 novembre 1999)
• M. Jean PICQ, conseiller maître à la Cour des Comptes,
auteur d'un rapport sur la réforme de l'Etat (29 février
2000)
• M. Jean-Marie PONTIER, professeur de droit public à
l'Université d'Aix-Marseille III (1
er
juillet 1999)
• M. Jean PUECH, sénateur de l'Aveyron, président de
l'Assemblée des départements de France (27 avril 1999)
• M. Jean-Pierre RAFFARIN, sénateur de la Vienne,
président de l'Association des régions de France
(10 février 1999)
• M. Michel RICARD, directeur-adjoint de l'architecture et du
patrimoine au ministère de la culture (8 février 2000)
• M. Jacques RIGAUD, président de RTL (26 janvier 2000)
• M. René RIZZARDO, directeur de l'Observatoire des politiques
culturelles (9 février 2000)
• Mme Maryvonne de SAINT PULGENT, Conseiller d'Etat
(8 février 2000)
• M. Jean-Louis SANCHEZ, délégué
général de l'ODAS (Observatoire national de l'action sociale
décentralisée) (22 juin 1999)
• M. Rémy SCHWARTZ, maître des requêtes au Conseil
d'Etat, auteur d'un rapport sur le recrutement, la formation et le
déroulement de carrière des agents territoriaux (26 janvier
2000)
• M. Pierre STEINMETZ, directeur général de la
gendarmerie nationale (14 mars 2000)
• M. Jean-Pierre SUEUR, président de l'Association des maires de
grandes villes de France (10 février 1999)
• M. Philippe THILLAY, secrétaire national de l'association
" Les Francas " (5 avril 2000)
• MM. Maurice TRUNKENBOLTZ, président du conseil
d'administration de l'IRCANTEC, Jean-Philippe TRESARRIEU, directeur du service
administration et pilotage des fonds gérés, Jacques MEUNIER,
responsable juridique et fiscal, et Arnaud-José LOKO, responsable de
l'actuariat (15 décembre 1999)
• M. François TUTIAU, président de l'association des
juristes territoriaux (10 juin 1999)
• M. Philippe VALLETOUX, membre du Directoire du Crédit local de
France-Dexia (8 mars 2000)
• M. Alain VAN der MALIÈRE, directeur de la DRAC
d'Ile-de-France (8 février 2000)
• M. Eric WOERTH, directeur associé d'Arthur Andersen,
responsable des collectivités locales, accompagné de
M. Philippe PEUCH-LESTRADE, associé (15 juin 1999)
• M. Maurice WYNEN, maire de Paziols (Aude) (18 mai 1999)
I.
1
" Sécurité juridique,
conditions d'exercice des mandats locaux : des enjeux majeurs pour la
démocratie locale et la décentralisation ", rapport
n° 166, 1999-2000.
2
" Chambres régionales des comptes et élus
locaux : un dialogue indispensable au service de la démocratie
locale ". Rapport (n° 520 - 1997-1998) établi par
M. Jacques Oudin au nom du groupe de travail présidé par
M. Jean-Paul Amoudry.
3
Les deux premières missions d'informations sur la
décentralisation, présidées par
M. Daniel Hoeffel, dont le rapporteur était M. Christian
Poncelet, ont abouti à la publication des rapports n° 490
du 12 jullet 1983 et n° 177 du
19 décembre 1984. La troisième mission d'information
sur la même thème, dont le président était
M. Charles Pasqua et le rapporteur M. Daniel Hoeffel, a
conduit à la publication du rapport n° 248 du 27 mars
1991.
4
La mission d'information sur l'avenir de l'espace rural
français, présidée par M. Jean François-Poncet
et dont les rapporteurs étaient MM. Hubert Haenel, Jean Huchon
et Roland du Luart, a établi le rapport n° 249 du 27 mars
1991. La mission d'information sur l'aménagement du territoire,
présidée par M. jean François-Poncet et dont les
rapporteurs étaient MM. Gérard Larcher, Jean Huchon,
Roland du Luart et Louis Perrein a publié le rapport n° 343 du
13 avril 1994.
5
" Démocratie locale et responsabilité ",
rapport (n° 328 du 7 juin 1995) établi par M. Pierre
Fauchon, au nom du groupe de travail présidé par M. Jean-Paul
Delevoye.
6
" La décentralisation : Messieurs de l'Etat,
encore un effort ", rapport (n° 239 - 1996-1997) établi
par M. Daniel Hoeffel au nom du groupe de travail de la commission des
Lois présidé par M. Jean-Paul Delevoye.
7
Rapport de M. Jacques Oudin, déjà cité.
8
Avis adopté le 21 juin 2000, sur le rapport de Mme
Claudette Brunet-Léchenault.
9
C. Eisenmann " Les structures de l'administration ", in
Traité de Science administrative, Paris, Mouton, 1966, p. 298 et 299.
10
Déclaration de politique générale , 8
juillet 1981.
11
Cf. " Sécurité juridique, conditions
d'exercice des mandats locaux : des enjeux majeurs pour la
démocratie locale et la décentralisation ", les rapports du
Sénat n° 166 (1999-2000), p.23.
12
Cf. " Maîtriser la société de
l'information : quelle stratégie pour la France ? ",
rapport de MM. Alain Joyandet, Pierre Hérisson et Alex
Türk, au nom de la mission commune d'information sur l'entrée dans
la société de l'information (n° 436, 1996-1997).
13
Ces difficultés ont été décrites dans
l'avis consacré au bilan et aux perspectives financières de la
décentralisation adopté au cours de sa séance du 6 juillet
1994 par le conseil économique et social, ainsi que par Jacques
Méraud dans
Les collectivités locales et l'économie
nationale
(Crédit local de France - Dexia,, 1997).
14
Depuis 1995, sur l'initiative du Sénat, un Observatoire
des finances locales a été créé au sein du
comité des finances locales. En son nom, notre collègue Joël
Bourdin présente chaque année un précieux rapport sur la
situation financière des collectivités locales.
15
Les données relatives aux dépenses de
fonctionnement et d'investissement des collectivités locales figurant
dans le présent chapitre ne comprennent pas les dépenses des
établissements publics de coopération intercommunale.
16
Les collectivités locales en chiffres 1999, DGCL, p. 51.
17
Dans le projet de loi de finances pour 2000, le déficit de
fonctionnement de l'Etat s'établissait à près de 50
milliards de francs.
18
La stabilisation de la part des communes et des EPCI dans le
total pourrait également s'expliquer par une augmentation rapide de la
fiscalité perçue par les départements et les
régions. Mais cette explication n'est pas vérifiée.
19
Chambres régionales des comptes et élus locaux - un
dialogue indispensable au service de la démocratie locale, n°520,
1997-98.
20
Proposition de loi tendant à réformer les
conditions d'exercice des compétences locales et les procédures
applicables devant les chambres régionales des comptes,
présentée par MM. Jacques Oudin, Jean-Paul Amoudry, Philippe
Marini, Patrice Gélard, Joël Bourdin, Paul Girod et Yann Gaillard,
session ordinaire de 1999-2000, n° 84.
21
Source : INSEE Première, n° 698,
février 2000.
22
L'indicateur conjoncturel de fécondité est la somme
des taux de fécondité par âge observés une
année donnée. Cette indicateur donne le nombre d'enfants
qu'aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de
fécondité observés l'année considérée
à chaque âge demeuraient inchangés.
23
L'espérance de vie à la naissance est égale
à la durée de vie moyenne d'une génération fictive
qui aurait tout au long de son existence les conditions de mortalité par
âge de l'année considérée.
24
Source : " Données sur la situation sanitaire et
sociale en France en 1999 ", La Documentation française.
25
Et plus particulièrement M. Jean Bergougnoux,
Président du groupe d'étude et de réflexion
interrégional, dont sont issus les chiffres ci-dessous.
26
Selon le scénario dit " central " de l'INSEE,
avec un indice de fécondité de 1,8 enfant par femme.
27
Age tel que 50 % de la population est plus âgée
et 50 % moins âgée.
28
Avec les hypothèses suivantes : indice de
fécondité 1,8 ; mortalité tendancielle ;
migrations 50.000/an ; calcul du GERI pour la France métropolitaine.
29
Voir INSEE Première n° 692 - Janvier 2000.
30
L'INSEE donne les définitions suivantes :
Aire urbaine : ensemble de communes d'un seul tenant et sans
enclave, constitué par :
- un pôle urbain (unité urbaine offrant au moins
5.000 emplois),
- une couronne périurbaine composée de communes rurales ou
d'unités urbaines dont au moins 40 % de la population
résidente possédant un emploi travaille dans le reste de l'aire
urbaine.
Espace à dominante rurale : ensemble des communes, non
multipolarisées, qui n'appartiennent pas à une aire urbaine.
31
Voir notamment le rapport d'information n° 415 de M.
Gérard Larcher " Les terroirs urbains paysagers : pour un
nouvel équilibre des espaces périurbains ", Sénat
1997-1998.
32
Source : INSEE, Point de conjoncture - Octobre 1999,
données CVS-CJO.
33
En données FAB-FAB, y compris le matériel
militaire ; Source : Tableau de bord du commerce extérieur,
douanes françaises.
34
D'après une reconstitution d'Eurostat sur la base d'une
Europe à 12 pour la période 1958-1994, qui permet de comparer
l'évolution des échanges, citée par la lettre de l'OFCE
n° 172, lundi 16 février 1998.
35
Source : " Les notes bleues de Bercy "
n° 174, janvier 2000.
36
Ainsi, le taux d'abstention aux élections municipales
depuis le début de la V
e
République a-t-il
évolué comme suit :
Date des élections municipales
Taux d'abstention
8 mars 1959 25,3 %
14 mars 1965 21,8 %
14 mars 1971 24,7 %
13 mars 1977 21,1 %
6 mars 1983 21,6 %
12 mars 1989 27,1 %
11 juin 1995 30,6 %
Il faut cependant relever que ce taux progresse avec le rythme des
consultations électorales, qui s'est accentué depuis 1979 avec
l'instauration des élections européennes, puis des
élections régionales, en 1986. Il ne peut donc être
considéré à lui seul comme le signe d'une
désaffection envers la vie publique.
37
Cf. le rapport établi par MM. Gérard Larcher, Jean
Huchon, Roland du Luart et Louis Perrein, au nom de la mission d'information
sur l'aménagement du territoire, présidée par M.
Jean-François Poncet (n° 343, 1993-1994).
38
La présidence du Comité des régions est
assurée depuis le début de l'année 2000 par un belge, M.
Jos Chabert.
39
Décision 82-137 DC du 25 février1982 et
décision 92-316 DC du 20 janvier 1993. Dans le second cas, le
législateur avait voulu instituer la suspension automatique, pendant
trois mois, de l'exécution des actes des collectivités en
matière d'urbanisme, de marchés et de conventions de
délégation de service public lorsque le représentant de
l'État demandait au juge administratif le sursis à
exécution.
Le Conseil constitutionnel a estimé que
ces dispositions privaient
ainsi de garanties suffisantes l'exercice de la libre administration des
collectivités locales.
Puis, dans la décision 94-358 DC du
26 janvier 1995, il a approuvé un dispositif de suspension
similaire, limitée toutefois à un mois.
40
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions.
41
Articles L. 2131-6, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 1111-7 et L. 2511-23
du code général des collectivités territoriales.
42
Projet de loi relatif au référé devant les
juridictions administratives, en attente de promulgation.
43
Pour une critique de l'insécurité juridique
actuelle, voir le rapport d'étape de la mission commune
d'information : rapport n° 166 (Sénat, 1999-2000)
intitulé : " Sécurité juridique, conditions
d'exercice des mandats locaux : des enjeux majeurs pour la
démocratie locale et la décentralisation ", janvier 2000.
44
En 1996, 5,9 millions d'actes ont été
transmis, 176.000 observations ont été adressées et
le nombre des déférés devant les tribunaux administratifs
s'est élevé à 1961, soit un taux de recours contentieux de
3,3 pour 10.000
.
45
Les questions de
personnel
représentaient 71 %
des recours en 1988 et 36 % en 1996 ; les contentieux relatifs
à l'
urbanisme
sont passés de 14 à
27 % ; ceux traitant des
marchés et contrats
, de 5
à 19 % et les saisines relatives aux finances publiques, de 2
à 8 %. A l'opposé, certains domaines, où les
collectivités locales disposent pourtant de pouvoirs importants, sont
caractérisés par une absence totale de
déféré préfectoral : aide et action sociales,
aide aux investissements de l'enseignement privé, activités du
service d'incendie et de secours, etc.
46
Rapport du Gouvernement au parlement sur le contrôle a
posteriori des actes des collectivités locales et des
établissements publics locaux, troisième trimestre 1999.
47
Le délai théorique d'élimination du stock
d'affaires en cours devant les tribunaux administratifs s'établit en
1998 à deux ans. Il est de trois ans et deux mois devant les cours
administratives d'appel.
48
En 1989, sur 738.000 actes administratifs en matière
d'urbanisme pris par les autorités locales et transmis aux
préfets, il y a eu 7.000 recours et finalement
272 déférés. Or, à la même
période, le Conseil d'État a été saisi de
732
recours en appel dans ce domaine, soit 2,5 fois plus que
le nombre des déférés.
En 1997, les décisions des tribunaux administratifs ont
été favorables aux préfets dans 72 % des cas ;
le taux d'appel contre les jugements au fond devant les cours administratives
d'appel s'est élevé à 17,8 %. Ce taux est très
variable d'une année sur l'autre (30,5 % en 1996, 13,5 % en
1995).
49
Rapport public 1993 : " Décentralisation et
ordre juridique ".
50
Ce champ vise les actes dont il est difficile pour les citoyens
soit d'apprécier la portée en raison de leur complexité
particulière, soit d'entreprendre la contestation en raison de la
lourdeur des moyens qu'il faudrait mettre en oeuvre ; ou les actes
engageant les collectivités territoriales dans des voies hasardeuses
pour l'utilisation de leur patrimoine ou de leurs revenus.
51
Introduit par la loi n° 92-10 du 4 janvier 1992,
complétée par la loi n° 93-122 du 29 juillet 1993.
52
En 1997, tel était le cas de 16200 collectivités
locales, 22300 établissements publics locaux et 30200
établissements publics spécialisés.
53
Les quatre points du contrôle budgétaire sont :
le respect du calendrier d'adoption du budget ; l'existence d'un
équilibre réel de la section d'investissement et de la section de
fonctionnement ; la sincérité des documents
budgétaires ; l'inscription des dépenses obligatoires. En
1997, les chambres régionales des comptes ont émis
1.300 avis budgétaires.
54
Budget primitif, budget supplémentaire, décision
modificative, compte administratif.
55
En 1997, le nombre total de jugements rendus sur les comptes des
comptables publics s'est élevé à 17000, ce qui correspond
à un rythme de contrôle quadriennal. 300 débets ont
été prononcés et 140 jugements traitant de gestion de fait
ont été rendus.
56
En 1997, les chambres régionales des comptes ont
adressé 995 lettres d'observations définitives aux
collectivités locales.
57
Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la
décentralisation.
58
Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative au financement des
partis et des campagnes électorales.
59
Rapport n° 325 (Sénat, 1999-2000), mai 2000, et
rapport d'information n° 520 (Sénat, 1997-1998) du groupe de
travail commun des commissions des finances et des lois, intitulé :
" Chambres régionales des comptes et élus locaux : un
dialogue indispensable au service de la démocratie locale ", juin
1998.
60
40 % des élus locaux du département du
Vaucluse consultés ont répondu au questionnaire.
61
51,5 % des élus locaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
consultés ont répondu au questionnaire.
62
Près de 48 % des élus locaux de la
région Nord Pas-de-Calais consultés ont répondu au
questionnaire.
63
Dans le département du Nord, les 224.000 actes
transmis au préfet n'ont donné lieu qu'à
8.000 lettres d'observations, 50 déférés
préfectoraux et 11 saisines de la chambre régionale des
comptes.
64
Voir infra, chapitre III, " Une logique contractuelle
inégalitaire ".
65
Sauvegarde de l'intégrité des institutions
républicaines, puissance publique, fonctions régaliennes
(souveraineté, autorité, paix).
66
Mise en oeuvre des politiques nationales. Le préfet est
le représentant exclusif et direct du Premier ministre et de chacun des
ministres.
67
Article 34 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982, décret n° 82-389 du
10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à
l'action des services et organismes publics de l'État dans les
départements.
68
Rapport du Commissariat général du Plan :
" Pour un État stratège, garant de l'intérêt
général ".
69
Deux mesures symbolisent la volonté du
général de Gaulle de doter l'État d'une administration
moderne et efficace : d'une part, la création de l'École
nationale d'administration par l'ordonnance n° 45-2263 du
9 octobre 1945, unifiant le recrutement de la haute fonction publique
; d'autre part, l'adoption de la loi du 19 octobre 1946 portant
statut général de la fonction publique.
70
Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964
fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets.
71
Décret n° 72-196 du 10 mars 1972.
72
Articles 26 et 73 de la loi du 2 mars 1982.
73
Principe des prestations réciproques posé par les
articles 30 et 77 de la loi du 2 mars 1983.
74
Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 qui
règle les modalités du partage financier des services.
75
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'État.
76
Article 19 de la loi du 7 janvier 1983.
77
Article 28 de la loi du 2 mars 1982.
78
Article 5 de la loi du 7 janvier 1983 et
article 102 de la loi du 2 mars 1982.
79
Article 7 de la loi du 7 janvier 1983.
80
Article 10 de la loi du 7 janvier 1983.
81
Article 12 de la loi du 7 janvier 1983.
82
Article 26 de la loi du 2 mars 1982.
83
Au niveau départemental, ces conventions ont eu pour
résultat de transférer au président du conseil
général, dès 1982 : le secrétariat de
l'assemblée départementale ; le bureau du budget
départemental ; le service s'occupant d'administrer le personnel
payé par le département ; le service chargé de toutes les
aides financières, subventions, concours ou autres accordés par
le conseil général (actions économiques, scolaires ou
culturelles, aides au communes, formation professionnelle) ; le service
programmant les activités départementales ; le bureau
gérant l'architecture et la voirie départementales ainsi que le
patrimoine immobilier départemental ; les services départementaux
d'incendie et de secours et la protection civile.
84
Article 8 de la loi du 7 janvier 1983.
85
Décret du 31 juillet 1985.
86
Décret n° 87-160 du
13 février 1987.
87
Transports scolaires, services gérant les ports, voirie
départementale, contrôle des subventions départementales.
88
Le comité financier de gestion, présidé par
le président du conseil général, et le comité des
collectivités utilisatrices, présidé par le préfet.
89
Loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992
relative à la mise à disposition des départements des
services déconcentrés du ministère de l'équipement
et à la prise en charge des dépenses de ces services.
90
La convention signée par le président du conseil
général et le préfet devait fixer le détail des
prestations et des sommes concernées. Si le département ne
souhaitait pas recourir au parc, il pouvait conclure une
convention de
retrait
, dont la dure maximale était fixée à dix ans.
91
Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 portant
diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales.
92
Cité dans le numéro 293 des Cahiers
français, " Les collectivités locales en mutation ",
octobre - décembre 1999.
93
Par exemple en faisant de l'octroi du permis de construire une
compétence de niveau préfectoral, confiée au directeur
départemental de l'équipement.
94
Les " services extérieurs " de l'État
sont renommés " services déconcentrés " ;
ceux-ci sont organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales
que sont la circonscription régionale, la circonscription
départementale et la circonscription d'arrondissement.
95
Rôle de conception, d'animation, d'orientation,
d'évaluation et de contrôle.
96
circulaires du 9 juillet 1996 et 7 mars 1997.
97
décret n° 97-695 du 31 mai 1997.
98
décret du 16 juillet 1996.
99
décret n° 97-142 du
13 février 1997.
100
décret n° 97-503 du 21 mai 1997.
101
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 et
décrets des 19 et 24 décembre 1997.
102
Pierre Grémion.
103
Jean-Pierre Balligand, député. Il présente
aussi la déconcentration comme " le Lazare administratif ",
ressuscité en 1995...
104
Alain Richard, ancien député, ancien rapporteur
général du budget à la commission des Finances de
l'Assemblée nationale. Entretien publié dans la revue
" Pouvoirs locaux " en 1992 (numéro spécial pour les
dix ans de la décentralisation).
105
Rapport d'activité de l'Inspection Générale
de l'Administration (IGA).
106
Rapport du M. Gilbert Santel, directeur
général de l'administration et de la fonction publique,
délégué interministériel à la réforme
de l'État, intitulé : " La modernisation de
l'administration territoriale de l'État " (octobre 19 98).
107
Mission sur l'organisation de la déconcentration des
administrations centrales (MODAC).
108
Tel est le cas des professeurs des écoles.
109
A l'exclusion d'actes plus complexes et sensibles, comme
l'avancement au choix, la mutation , etc.
110
" Les investissements civils exécutés par
l'État et les investissements exécutés avec une subvention
de l'État sont d'intérêt régional ou
départemental, à l'exception des investissements
d'intérêt national déterminés par
décret ".
111
Dès 1982, la nécessité de procéder
au partage de services et de locaux. entre l'État et les
collectivités territoriales a conduit à donner plus de
compétences aux préfets dans le domaine immobilier. Le
décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs
des préfets dans les départements prévoit que " le
préfet est responsable, sous l'autorité de chacun des ministres
concernés, de la gestion du patrimoine immobilier et des
matériels des services de l'État dans le
département ". Cette position de chef de file a été
confirmée par la charte de la déconcentration du
1er juillet 1992 qui confie aux préfets la gestion du parc
immobilier de l'État.
112
Loire Atlantique, Meurthe-et-Moselle, Yvelines, Haute-Vienne,
Essonne et Hauts-de-Seine.
113
Un chargé de mission pour les questions
immobilières prépare les documents de programmation que sont le
schéma départemental d'implantation des services de l'État
et le programme annuel d'équipement et d'entretien.
114
Articles 25 et 26 de la loi du
4 février 1995.
115
Malgré les termes mêmes de la circulaire du Premier
ministre du 3 juin 1998 selon lesquels " le programme fixera les
orientations ministérielles en matière de développement de
la déconcentration ".
116
" La décentralisation : Messieurs de l'Etat
encore un effort ! " (n° 239, 1996-1997).
117
Voir le rapport d'information n° 239, Sénat
1996-1997, pp.66-67, p.124 et la motion adoptée par le groupe de
travail, p.8, point 1.
118
Lettre de mission du Premier Ministre à M. Jean Auroux.
119
" Réforme des zonages et aménagement du
territoire ", rapport à M. le Premier ministre, par M. Jean Auroux.
120
Typologie inspirée du rapport AUROUX
précité.
121
Zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique.
122
Zone d'importance communautaire pour les oiseaux.
123
Permanence d'accueil d'information et d'orientation
124
Zones d'aménagement du territoire ; zones de
revitalisation rurale ; territoires ruraux de développement
prioritaire ; zones urbaines sensibles ; zones de redynamisation
urbaine ; zones franches urbaines ; régions
ultrapériphériques françaises.
125
Sur la PAC, voir : " Quelle réforme pour la
politique agricole commune ? ", rapport d'information
n° 466, Sénat, 1997-1998, président : M. Philippe
François, rapporteurs : MM. Marcel Deneux et Jean-Paul Emorine.
Sur la réforme des fonds structurels : voir la résolution du
Sénat et le rapport n° 88 de M. Jean-Pierre Raffarin,
novembre 1998, au nom de la Commission des Affaires économiques.
126
Cette proposition a été avalisée par les
services du Commissaire Monti
127
78.454 francs par foyer fiscal en 1994.
128
Voir les rapports budgétaires pour avis sur
l'aménagement du territoire de M. Jean Pépin au nom de la
Commission des Affaires économiques, projets de loi de finances pour
1999 et 2000.
129
Pour de plus amples développements sur la réforme
de la politique structurelle européenne, voir le rapport
précité de M. Jean-Pierre Raffarin, au nom de la Commission des
Affaires économique, Sénat, 1998, n° 88.
130
Règlement (CE) 1260/1999 du Conseil du
21 juin 1999 portant dispositions générales sur les
fonds structurels.
131
C'est-à-dire par rapport aux anciens zonages 2 et 5b.
132
Voir notamment la circulaire du 9 septembre 1999 de la ministre
de l'aménagement du territoire sur la préparation des
propositions régionales de zonage pour le futur
" objectif 2 ".
133
Voir à ce sujet le rapport pour avis n° 91 de
M. Gérard Larcher au nom de la Commission des Affaires
économiques sur les crédits de la politique de la ville dans le
projet de loi de finances pour 2000, Sénat, 1999-2000.
134
Loi précitée n° 99-533 du 25 juin 1999.
135
Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
136
Propos de Mme Dominique Voynet, Journal officiel du 6 avril
1999, Sénat, page 2117.
137
Les crédits totaux consacrés par l'Etat à
l'aménagement du territoire s'élèveraient, d'après
le " jaune " budgétaire à 56 ,5 milliards de
francs, y compris en comptabilisant toutes les exonérations fiscales et
sociales liées à cet objectif.
138
Défini à l'article 11 du règlement
communautaire précité du 21 juin 1999 portant dispositions
générales sur les fonds structurels.
139
Information donnée par Mme Dominique Voynet, ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, lors de son audition
devant la Commission des Affaires économiques le 30 juin 1999.
140
" Pour une efficacité renforcée des
politiques structurelles communautaires ", avril 1998.
141
Elaborés par les Préfets de région, les
Présidents de conseils régionaux et les autres partenaires.
142
En pratique, les délégations de crédits des
administrations centrales s'arrêtent au 30 novembre et tout paiement
de subvention est interdit à partir du 15 décembre.
143
Fonds européen de développement économique
régional.
144
Le 8 juin 1999.
145
Question n° 19657 de M. Marcel Vidal, réponse au
Journal Officiel du 16 décembre 1999, Sénat, questions, page 4147.
146
Décidés lors d'une réunion
ministérielle du 1
er
septembre 1999.
147
Voir notamment le site Internet de la DATAR :
www.datar.gouv.fr.
148
Loi de départementalisation du 19 mars 1946.
149
Article 299-2 du Traité d'Amsterdam.
150
Rapport intitulé : " Les départements
d'outre mer aujourd'hui : la voie de la responsabilité " (juin
1999).
151
Équipements routiers, fiscalité, interventions
économiques...
152
Pour la période 2000-2006, les crédits des fonds
structurels européens s'élèveront à
23 milliards de francs et les crédits inscrits dans les contrats de
plan État-région à 5,6 milliards de francs.
L'utilisation de ces crédits, aujourd'hui entravée par une
organisation administrative trop pesante, devra à l'avenir relever de
décisions locales et non métropolitaines.
153
Rapport n° 393 (Sénat, 1999-2000) de M.
José Balarello au nom de la commission des Lois (juin 2000).
154
Rapport n° 366 (Sénat, 1999-2000)
intitulé : " Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion : la départementalisation à la recherche d'un
second souffle ".
155
Cf. rapport précité, p. 1221 et ss.
156
Cf. rapport précité, p. 50 et ss.
157
Rapport précité, p. 92.
158
Cette description avait été faite devant les
commissions réunies du Sénat par M. Gaston Defferre, ministre de
l'intérieur, lors de la présentation du projet de loi relatif
à la répartition des compétences.
159
Rapport précité, p. 98-99.
160
De M. Jean-Pierre Gaudin, aux presses de Sciences-Po. Le passage
cité figure en introduction.
161
" Les matières contractuelles " par le
professeur Jacques Moreau, in AJDA du 20 octobre 1998.
162
Loi n° 82-653.
163
Des schémas de services collectifs ont toutefois
été institués. Mais leur parution, par décret,
n'est pas intervenue à temps pour constituer un réel
" cadrage " de la négociation de la 4
ème
génération de contrats plan Etat-régions.
164
Les chiffres cités dans ce paragraphe sont issus du
rapport public 1998 de la Cour des comptes.
165
Tenue le 19 janvier 2000 au Sénat.
166
Chiffre issu du rapport officiel de M. Jacques
Chérèque sur les contrats de plan : " Plus de
région et mieux d'Etat ", 1998.
167
Auxquels s'ajoutent le financement de grands projets
d'infrastructure pour un total de 18 milliards de francs.
168
Voir le rapport de la commission spéciale du Sénat
n° 1, 1996-1997, président M. Jean-Pierre Fourcade,
rapporteur M. Gérard Larcher.
169
Rapport de M. Gérard Larcher au nom de la Commission des
Affaires économiques, Sénat n° 107, 1992-1993.
170
Circulaire du 2 février 1989 relative au
développement de la politique contractuelle avec les
collectivités locales.
171
Dont le rapport pour avis n° 91 de M. Gérard
Larcher au nom de la Commission des Affaires économiques sur les
crédits de la politique de la ville dans le projet de loi de finances
pour 2000 dresse un bilan pour le moins mitigé.
172
D'après les informations rendues publiques par M. Claude
Bartolone en octobre 1999.
173
Circulaire du 31 décembre 1998 relative aux contrats de
ville 2000-2006.
174
Notre collègue Gérard Larcher, dans le cadre de la
rédaction de ses rapports pour avis des crédits de la ville dans
les projets de loi de finances pour 1999 et 2000, au nom de la Commission des
Affaires économiques, a pu constater la distorsion entre les moyens de
communes telles que Mantes-la-Jolie et Valenciennes et l'ampleur des
problèmes posés à ces collectivités.
175
Circulaire du 28 octobre 1997 relative à la
mise en oeuvre des CLS et circulaire du 7 juin 1999 relative aux CLS.
176
Voir la brochure éditée en janvier 2000 par
le ministère de l'intérieur rendant compte de ces travaux.
177
Voir le rapport d'étape de la mission
interministérielle d'évaluation des CLS en date du
30 septembre 1998, dit " rapport Karsenty ", dont le
contenu est révélé par la gazette des communes, des
départements et des régions en date du
1
er
février 1999.
178
Dans l'article de " La Gazette " du 1
er
février 1999 précité, page 23.
179
Circulaire du 31 juillet 1998 relative à la
préparation des contrats de plan Etat-régions.
180
S'ils sont constitués en EPCI ou si les
collectivités concernées ont constitué un GIP ou un
syndicat mixte (article 25).
181
Les conditions figurent à l'article 26 de la loi du 25
juin 1999.
182
Article 29 de la loi du 25 juin 1999.
183
Voir notamment les actes de la journée d'études
" Décentralisation et contractualisation " organisée
par l'Institut de la décentralisation et la région
Nord-Pas-de-Calais le 13 septembre dernier, ou l'ouvrage
" L'action publique par convention ", les cahiers de la
décentralisation n° 3, février 2000, par MM.
Gaudin et Dubois.
184
Circulaire du 31 juillet 1998.
185
Voir le rapport n° 446 (1999-2000)
présenté par M. René André au nom de la
délégation du Sénat à la planification :
" Les troisièmes contrats de plan Etat-Région
(1994-1999) : une ambition inachevée ".
186
Lors de son audition le 1
er
juillet 1999.
187
Article précité de MM. Gaudin et Dubois.
188
Sénat, Séance du 10 novembre 1999,
Journal officiel des débats, page 4816, question orale n° 346
adressée à la ministre de l'aménagement du territoire et
de l'environnement.
189
Dans sa contribution à la journée d'études
de l'Institut de la décentralisation du 13 septembre 1999.
190
Voir l'article précité du professeur Laurence
Lalliot.
191
In Le Monde du samedi 24 juillet 1999.
192
Rapport n° 288, Sénat, 1991-1992.
193
Notamment dans le rapport précité de M. Sueur
" Demain la ville ", ou lors de la journée d'études de
l'Institut de la décentralisation.
194
MM. G. Marcou, F. Rangeon, J.L. Thiébault, " Le
Gouvernement des villes et les relations contractuelles entre
collectivités publiques " in le Gouvernement des villes, Descartes
et cie, 1997.
195
Article 1
er
de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions : " ...Des lois
détermineront... les garanties statutaires accordées aux
personnels des collectivités territoriales... "
196
L'organisation des fonctionnaires en cadres d'emplois et le
recours au recrutement par concours avec établissement de listes
d'aptitude par ordre de mérite sont aussi des traductions du principe de
parité.
197
" L'accès des fonctionnaires de l'État, des
fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres
fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces
trois fonctions publiques constituent des garanties fondamentales de leur
carrière " (article 14 de la loi du 13 juillet 1983
- Titre Ier du statut général).
198
Le partage des services entre l'État et les
collectivités territoriales nécessitait un partage des personnels
compétents. En ce sens, les articles 122 et 123 de la loi du
26 janvier 1984 ont prévu un
droit d'option
entre le
statut de fonctionnaire territorial et le statut de fonctionnaire de
l'État, ouvert aux fonctionnaires de l'État exerçant leur
fonctions dans un service de l'État transféré aux
collectivités locales et aux fonctionnaires des collectivités
exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'État. Les
fonctionnaires n'ayant pas fait usage de leur droit d'option dans le
délai prévu par la loi sont réputés avoir
opté pour le maintien de leur statut antérieur.
199
Rapport n° 82 (Sénat, 1983-1984) de
M. Daniel Hoeffel au nom de la commission des Lois et rapport
n° 170 (Sénat, 1986-1987) de M. Paul Girod.
200
Dans le département de Vaucluse, lors des États
généraux des élus locaux en décembre 1998,
52 % des élus locaux ont considéré que le statut
n'était pas compatible avec le principe de libre administration des
collectivités locales, et le principe de liberté de recrutement
qui en est le corollaire.
Ils sont 74 % à exprimer la même opinion en Alsace
(États généraux de mars 1999).
201
Le
recrutement sans concours
de fonctionnaires de
catégorie C a été proposé par le Sénat
(article 38 de la loi statutaire du 26 janvier 1984). De plus,
les
emplois réservés
et les
emplois fonctionnels
font aussi exception au principe du concours.
202
Opposé au
système de l'emploi
en vigueur
pour les agents territoriaux avant 1984, permettant leur licenciement en cas de
suppression d'emploi.
203
Les emplois correspondant aux grades supérieurs d'un
cadre d'emplois ne peuvent être créés que dans les
collectivités dont l'importance démographique est suffisante.
204
Article 53 de la loi statutaire du
26 janvier 1984.
205
directeur général des services, directeur
général adjoint des services des départements et des
régions ; secrétaire général,
secrétaire général adjoint des communes de plus de
5.000 habitants ; directeur général des services
techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de
20.000 habitants ; directeur ou directeur adjoint de certains
établissements publics...
206
Au 31 mars 2000, 192 fonctionnaires de
catégorie A involontairement privés d'emploi étaient pris
en charge par le CNFPT.
207
Deux modalités du principe de solidarité,
caractérisant les régimes par répartition, doivent
être distinguées :
- la compensation généralisée à l'ensemble des
régimes de retraite (créée en 1974), qui utilise pour
référence les pensions les plus faibles versées ;
- la surcompensation (mise en place en 1985) concernant les régimes
spéciaux, qui prend pour base la moyenne pondérée des
pensions.
208
De 36 % actuellement, le taux de surcompensation passerait
à 34 % en 2000 et 30 % en 2001. A titre personnel, lors de son
audition par la mission, M. Claude Domeizel, président de la
CNRACL et membre de la mission d'information, a estimé que ce taux
aurait dû être abaissé à 22 %.
209
Dans sa rédaction issue de la loi du
28 novembre 1990, il dispose : " L'assemblée
délibérante de chaque collectivité ou le conseil
d'administration d'un établissement public local fixe les régimes
indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les
différents services de l'État ".
210
les modalités de recrutement les plus fréquentes
dans la catégorie A sont le recrutement de non-titulaires
(39 %) et les mutations (26 %).
211
" Eu égard à la nature particulière
des liens qui s'établissent entre une collectivité publique et
ses agents non titulaires, les contrats par lesquels il est
procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes
dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par un
tiers y ayant un intérêt suffisant ".
212
Rapport n° 366 (Sénat, 1999-2000)
intitulé : " Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion : la départementalisation à la recherche d'un
second souffle ".
213
Rapport n° 393 (Sénat, 1999-2000) de M. José
Balarello, au nom de la commission des Lois.
214
Le décret prévoit le versement d'une
" indemnité d'éloignement des départements
d'outre-mer " non renouvelable aux fonctionnaires de l'État qui
reçoivent une affectation dans l'un de ces départements et dont
le précédent domicile était distant de plus de 3000 km du
lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, s'ils accomplissent une
durée minimum de services de quatre années consécutives
dans leurs nouvelles fonctions.
Le montant de cette indemnité d'éloignement correspond à
un an de traitement indiciaire de base (seize mois pour la Guyane). S'y ajoute
une majoration familiale de respectivement un mois et quinze jours de
traitement brut pour le conjoint et chacun des enfants à charge
accompagnant le fonctionnaire affecté outre-mer.
215
Cet arrêt du 25 mars 1996 du Tribunal des
conflits, " Préfet de la région Rhône Alpes,
préfet du Rhône, contre conseil de prud'hommes de Lyon ",
opère un revirement de jurisprudence concernant les agents non
titulaires de l'État et des collectivités territoriales, en
posant que " les personnels non statutaires travaillant pour le compte
d'un service public à caractère administratif sont des agents
contractuels de droit public quel que soit leur emploi ".
216
Rapport n° 1 (1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry
au nom de la commission des Lois.
217
Fin avril 1999, 183.000 emplois jeunes étaient
créés, dont 164.000 ont déjà été
embauchés. Les collectivités territoriales représentent
à elles seules 39 % des emplois créés, soit
près de 40.000, et 5.500 communes sont engagées dans le
dispositif.
218
En considérant les départs à la retraite
certains (inscrits dans la pyramide des âges), à l'horizon 2015,
la moitié des salariés actuellement présents dans le
secteur public auront plus de 60 ans contre un peu plus d'un tiers dans le
privé.
219
Entre 2005 et 2015, le nombre annuel des départs à
la retraite sera de 65.000. Jusqu'en 2040, ce nombre sera de 60.000. D'ici la
fin de l'année 2012, environ 45 % des agents en fonctions dans les
administrations civiles de l'État, soit 807.000 personnes, seront partis
à la retraite.
220
JO Sénat, séance du 8 novembre 1978, p. 3057 et
suivantes.
221
" Les collectivités territoriales de la
république sont les communes, les départements, les territoires
d'outre-mer. Toute autre collectivité est créée par la loi.
" Ces collectivités s'administrent librement par des conseils
élus et dans les conditions prévues par la loi.
" Dans les départements et les territoires, le
délégué du Gouvernement à la charge des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect
des lois. "
222
à partir du 1
er
janvier 1983 pour la taxe sur
les cartes grises, à partir du 1
er
juin 1984 pour les droits
de mutation et du 1
er
décembre 1984 pour la vignette
223
Dans son rapport au Parlement de 1999, la commission
consultative sur l'évaluation des transferts de charges indique que
" la compensation des transferts intervenus en faveur des communes ayant,
pour la plupart des compétences, obéit à des logiques
spécifiques, aucune étude pertinente ne peut être
menée ".
224
Par ailleurs, dans sa rédaction d'origine, l'article L.
1614-3 du code général des collectivités territoriales,
issu de l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1984, devait
s'appliquer
"
pendant
la période de trois ans
prévue à l'article 4 de la loi n° 88-3 du 7 janvier
1983
". En conséquence, en retenant à l'article L.1614-5
les mots "
Au terme
de la période
... ", le
législateur a manifestement souhaité que la proportion de 50 %
s'applique à compter du terme de la période de trois ans.
225
A l'origine de la DGF, il existait un mécanisme dit de
" surgarantie " qui jouait lorsque l'indexation de la DGF
était inférieure à l'augmentation du traitement des agents
d'un certain indice.
226
La part de l'Etat dans le financement des contrats de plan
s'établissait à 60 % pour la période 1984-88, 55% pour la
période 1989-93 et 52 % pour les contrats 1994-99.
227
La présentation et le contenu de ces rapports s'inspirent
du rapport sur " la compensation des transferts de compétences
entre l'Etat, les départements et les régions "
présenté en septembre 1996 par notre collègue Paul Girod
au nom de l'Observatoire des finances locales.
228
Les inégalités sont particulièrement
importantes en matière de taxe professionnelle, puisque 5 % des
collectivités locales perçoivent 95 % du produit de cet
impôt.
229
En 1999, 25 % des cotisations de HLM augmenteraient, 5,6%
des cotisations des locaux non-HLM appartenant à la catégorie
" luxe " diminueraient de plus de 25 % tandis que 13,3 % des
cotisations des locaux non-HLM appartenant à la catégorie
" médiocre " augmenteraient de plus de 100 %.
230
Dans son rapport " Pour une modernisation de la
fiscalité locale " (Assemblée nationale, onzième
législature, n° 1066), notre collègue député
Edmond Hervé rappelle que "
la taxe d'habitation, dans son
principe, ne prend pas en compte la capacité contributive du foyer. La
caricature de ce constat fut révélée en 1997 lorsque l'on
apprit que 12.500 contribuables de l'impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) ne payaient pas de taxe d'habitation !
".
231
Comme le relève l'agence de notation financière
Standard & Poor's, les fluctuations de la taxe professionnelle sont
"
limitées dans la mesure où elle est calculée
sur un stock et non sur un flux et peu de collectivités ont donc
assisté à une réduction de leurs bases même en
période de récession. Ce n'est pas le cas en Suède par
exemple, où les ville perçoivent l'impôt sur le revenu, ou
en Allemagne où les régions perçoivent également
l'impôt sur les sociétés " (" La notation des
collectivités locales
", octobre 1999).
232
Assemblée nationale, n° 2387, onzième
législature.
233
En neutralisant l'effet de la recentralisation de l'aide
médicale des départements, qui se traduit en théorie par
une baisse des dépenses des départements de 9,1 milliards de
francs et s'est accompagnée d'une réduction de même montant
de la dotation générale de décentralisation,
l'augmentation des dotations s'élève à 11,9 milliards de
francs.
234
Avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives
à la taxe d'habitation prévues par la loi de finances
rectificative pour 2000.
235
Sur ce point, cf. infra, le 3 du B du V.
236
JO Sénat, séance du 24 novembre 1995, p. 2915.
237
A sa création, la dotation globale de fonctionnement
était indexée sur l'évolution des recettes de TVA. Puis,
elle a évolué comme les prix jusqu'en 1990. En 1991, elle a
augmenté en fonction d'un indice prenant en compte les prix et 50 %
du taux de croissance du PIB. En 1992 et 1993, cet indice a été
calculé à partir des deux tiers du taux de croissance du PIB. En
1994 et 1995, seuls les prix ont été retenus. Depuis 1996,
l'indice de la DGF tient compte des prix et de la moitié du taux de
croissance du PIB.
238
Sur ce point, voir le rapport de notre collègue
député Gérard Saumade, " Soutenir l'investissement
local ", Assemblée nationale, onzième législature,
n° 1782, pp. 83-84.
239
Cf. supra III, B, 3.
240
La loi de finances rectificative pour 2000 met en place un
dispositif de même esprit s'agissant de la prise en charge par l'Etat des
dégrèvements de taxe d'habitation, en gelant les taux à
leur niveau de 2000.
241
JO Sénat, séance du 24 novembre 1995, p. 2917.
242
JO Assemblée nationale, séance du 21 octobre 1995,
p. 2301.
243
L'expression " abondements extérieurs "
désigne les majorations du montant de certaines dotations lorsqu'elles
ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'enveloppe normée. Si
elles l'étaient, le montant de la DCTP serait réduit d'autant.
244
Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1996,
nos collègues députés Didier Migaud, Augustin Bonrepaux et
Jean-Pierre Balligand avaient présenté un amendement indexant
l'enveloppe normée sur " la somme de l'évolution
prévisionnelle des prix à la consommation et des
deux
tiers
de la croissance en volume associés au projet de loi de
finances ".
245
L'article L. 2334-4 du code général des
collectivités territoriales dispose que " le potentiel fiscal d'une
commune est déterminé par application aux bases communales des
quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à
chacune de ces taxes. Il est majoré du
montant, pour la
dernière année connue, de la compensation prévue au I du D
de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 ", c'est-à-dire la
compensation de la suppression de la part " salaires " de la taxe
professionnelle.
246
L'article L. 2334-5 du code général des
collectivités territoriales définit l'effort fiscal comme le
rapport entre le produit des " quatre taxes " perçu dans une
commune et son potentiel fiscal (diminué de la part correspondant
à la taxe professionnelle).
247
85 % des crédits de la dotation
d'intercommunalité sont répartis en tenant compte de la richesse
des communes, mesurée par leur potentiel fiscal. Les 15 % restants
ne tiennent compte que de la population des communes et de leur coefficient
d'intégration fiscale.
248
Même si, compte tenu du caractère imparfait des
critères d'éligibilité aux dotations de solidarité,
certaines collectivités, et surtout des communes, qui ne sont pas
favorisées doivent néanmoins supporter le poids de lourdes
baisses de DCTP.
249
Les EPCI ne sont remboursés qu'à hauteur de la
fraction de leur population résidant dans une commune éligible
à la DSU ou à la DSR " bourgs-centres ".
250
En tenant compte de la compensation de la suppression de la part
régionale de la taxe d'habitation.
251
Cf. supra, 3 du B du III.
252
En 1995, 5 % des collectivités locales percevaient
95 % du produit de la taxe professionnelle.
253
n° 91-291 DC.
254
Sur ce point, voir le 2 du B du I du chapitre III de la
présente partie.
255
Institut de la Décentralisation, Info Parlement, mai 2000.
256
Au sens large, c'est à dire en englobant les cotisations
sociales.
257
Conseil des impôts,
La taxe professionnelle
,
quinzième rapport au Président de la République, 1997.
258
JO Sénat, séance du 24 novembre 1999, p. 4861.
259
JO Sénat, séance du 7 juin 2000, p. 3741.
260
Michel Borgetto et Robert Lafore. Droit de l'aide et de
l'action sociale, Domat droit public, Montchrestien.
261
Robert Castel, Les métamorphoses de la question
sociale, Librairie Arthème Fayard, 1995.
262
Ces dispositifs sont plus connus sous leur appellation de
" carte santé " ou de " passeport de soins ".
263
La décentralisation en matière d'aide sociale,
Cour des Comptes, rapport au Président de la République,
décembre 1995.
264
Les politiques sociales en faveur des personnes
handicapées adultes, Cour des Comptes, rapport au Président de la
République, 1993.
265
RMI, le pari de l'insertion - Rapport de la commission
présidée par Pierre Vanlerenberghe, 1992.
266
Sur les données transmises par
72 départements.
267
La Fédération rassemble : le syndicat
général des organismes privés sanitaires et sociaux
à but non lucratif (SOP), le syndicat national des associations pour la
sauvegarde de l'enfant à l'adulte (SNASEA), le syndicat national des
associations de parents et amis de personnes handicapées mentales
(SNAPEI).
268
Avis n° 93 (Sénat 1999-2000) présenté
au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi de finances
pour 2000 par M. Jean Chérioux, sénateur (Tome I -
Solidarité).
269
La lettre de l'ODAS, numéro spécial,
1
er
avril 2000.
270
Etudes et résultats, DREES, n° 68 - juin 2000.
271
Etudes et résultats n° 39 novembre 1999 - Direction
de la recherche, de l'étude, de l'évaluation et des statistiques
(DREES).
272
L'action sociale, dix ans de décentralisation 1984-1994
-Jean-Louis Sanchez, Claudine Padieu- ODAS.
273
L'action sociale, dix ans de décentralisation 1984-1994,
op.cit.
274
Action sociale, la décentralisation face à la
crise -1996 - Jean-Louis Sanchez- ODAS Editeur..
275
L'aide personnalisée à l'autonomie : un
nouveau droit fondé sur le principe d'égalité - rapport
remis à Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la
solidarité par M. Jean-Pierre Sueur, Maire d'Orléans - Mai 2000.
276
Cf. " La formation professionnelle - diagnostics,
défis et enjeux " ; contribution du secrétariat d'Etat
aux droits des femmes et à la formation professionnelle, mars 1999.
277
Y compris le coût des primes et exonérations de
charges sociales
278
Rapport sur l'évaluation des politiques régionales
de formation professionnelle, Comité de coordination des programmes
régionaux d'apprentissage et de formation continue, octobre 1999.
279
" Les acteurs de la formation professionnelle : pour
une nouvelle donne, " Rapport au Premier ministre par Gérard
Lindeperg, député de la Loire, conseiller régional
Rhônes-Alpes, septembre 1999.
280
C. Julien " les politiques régionales de formation
professionnelle continue " L'Harmattan, 1998.
281
Cf. rapport d'étape précité de votre
mission d'information.
282
Cf. le rapport étabi par M. Jean-Paul Delevoye, au nom de
la commission des Lois (n° 455, 1997-1998).
283
La loi du 15 avril 1999 a fait l'objet des décrets
n°s 2000-275, 2000-276 et 2000-277 du 24 mars 2000.
284
Cf. L'avis de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission
des Lois, sur le projet de loi de finances pour 2000 (n° 94,
1999-2000,Tome II, Intérieur : police et sécurité).
285
Cf. supra, chapitre III.
286
Cf. rapport précité de M. Jean-Patrick Courtois,
p. 22 et ss.
287
Dans les cinq prochaines années, plus de 24.000
départs sont attendus, soit du fait de la limite d'âge, soit pour
départ anticipé.
(288) Ces chiffres sont cités par Jacqueline Mengin et Jacques Lepage,
dans " Le rôle culturel du département " (La
Documentation Française, Paris, 1987).
(289) Cette analyse est commune à Mme Maryvonne de Saint-Pulgent,
conseiller d'Etat, M. Jacques Rigaud, président de RTL, auteur d'un
ouvrage sur la refondation de la politique culturelle, M. René Rizzardo,
directeur de l'Observatoire des politiques culturelles, et M. Michel
Ricard, directeur de l'architecture et du patrimoine, entendus par la mission
commune d'information les 26 janvier et 8 février 2000.
(290) Ces domaines sont la diffusion artistique et culturelle, les
enseignements artistiques, les travaux de conservation des monuments
n'appartenant pas à l'Etat, sous réserve des dispositions de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
(291) Cf. audition de M. Michel Ricard, directeur-adjoint de l'architecture et
du patrimoine au ministère de la culture, du mardi 8 février
2000.
(292) Cf. auditions de M. Jacques Rigaud, précitée, et de M.
René Rizzardo, précitée.
(293) Cf. audition de Mme Maryvonne de Saint-Pulgent, précitée.
(294) Cf. audition de M. Ricard, précitée.
(295) Par l'arrêté du 3 novembre 1958.
(296) Ces dispositions sont prévues par l'article 14 de la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983.
(297) Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, modifiant la loi du 16 juillet
1984.
(298) Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier.
(299) Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures
relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives.
(300) Colloque sur le financement du sport, 23 mars 1991.
(301) Par l'article 42
bis
de la loi du 16 juillet 1984.
302
Conseil d'Etat, 18 novembre 1991, Département des
Alpes-Maritimes, avec les conclusions du Commissaire du Gouvernement Pochard.
303
Conseil d'Etat, 15 février 1993, Région
Nord-Pas-de-Calais.
Voir aussi Conseil d'Etat, 6 juin 1986,
Département de la Côte-d'Or, A.J.D.A. 1986, p 594 et Conseil
d'Etat, 1
er
octobre 1993, Commune de Vitrolles c/ M. Catalan pour
des exemples de délibérations de collectivités locales
jugées illégales.
304
Selon le ministère de l'intérieur, les aides des
collectivités aux conditions du marché sont libres.
305
Défini par un arrêté du ministre des
finances du 23 janvier 1996.
306
Voir les rapports publics de la Cour des Comptes, 1983 et 1988,
Journaux officiels, et son rapport public particulier de novembre 1996.
307
Art. 10, 11 et 12 de la loi n° 88-13 du 5 janvier
1988 d'amélioration de la décentralisation..
308
Ces règles ne s'appliquent pas aux personnes morales de
droit public (collectivités locales, établissements publics dont
les chambres consulaires...).
309
Cf. rapport (n° 189, 1999-2000) de M. Francis Grignon,
au nom de la commission des affaires économiques, saisie au fond, ainsi
que les avis (n° 201, 1999-2000) de M. Paul Girod, au nom de la
commission des lois, et (n° 200, 1999-2000) de M. Joseph
Ostermann, au nom de la commission des finances, saisies pour avis.
310
Présidé par M. Jean-Paul Delevoye, le groupe de
travail de la commission des Lois du Sénat a publié le rapport
de M. Daniel Hoeffel, n° 239 (Sénat, 1996-1997)
intitulé : " La décentralisation : Messieurs de
l'État, encore un effort ! ", en mars 1997.
311
Rapport de la commission du Livre Blanc présidée
par Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre, et René Monory,
alors président du Sénat, intitulé :
" Poursuivre la décentralisation : réflexions sur le
bilan et les perspectives de la décentralisation ", 1994.
312
Arrêt du 21 janvier 1999, Ministre de l'Intérieur
contre commune de Saint Florent et autres : " Si le préfet
n'est pas tenu de déférer au juge administratif toutes les
décisions illégales des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics et si, par conséquent, son
abstention ne saurait par elle-même engager la responsabilité de
l'État, l'abstention prolongée du préfet de Haute-Corse de
ne pas déférer au tribunal administratif les décisions
importantes et aux illégalités facilement décelables du
syndicat intercommunal à vocation multiple du Nebbio constitue, en
l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité
de l'État envers les communes de Saint Florent et autres ".
S'il existe une contradiction apparente entre le fait de reconnaître un
caractère discrétionnaire au déféré
préfectoral, et le fait de retenir quand même la
responsabilité de l'État alors que le préfet s'est abstenu
de déférer, cette contradiction peut être résolue en
admettant que l'absence de déféré préfectoral s'il
n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir peut
néanmoins donner lieu à une indemnisation en cas de faute.
313
En l'espèce, il s'agissait de l'abstention
prolongée du préfet de Haute-Corse de déférer
à la juridiction administrative un certain nombre de
délibérations aux illégalités facilement
décelables prises par le bureau d'un syndicat intercommunal.
314
États généraux de septembre 1999.
315
Rapport n° 385 (Sénat, 1999-2000) de M. Jean-Paul
Amoudry, mai 2000.
316
" La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration ".
317
Délibération n° 99-3 adoptée le
8 juin 1999.
318
Rapport de M. Gilbert Santel, directeur général de
l'administration et de la fonction publique, délégué
ministériel à la réforme de l'État,
intitulé : " La modernisation de l'administration territoriale
de l'État ", octobre 1998.
319
Rapport " L'État en France : servir une nation
ouverte sur le monde " (mai 1994) de la mission sur les
responsabilités et l'organisation de l'État
présidée par Jean Picq, conseiller-maître à la Cour
des comptes.
320
Direction de l'équipement, de l'environnement et du monde
rural ; direction de la santé, de la population et de la
solidarité ; direction des affaires économiques ;
direction des affaires culturelles.
321
Cette proposition figure dans le " rapport Santel ".
322
Entretien dans le numéro 293 des Cahiers français,
" Les collectivités locales en mutation ",
octobre-décembre 1999.
323
La délégation territoriale, ou
déconcentration horizontale, consiste à favoriser la coordination
des services de l'État sur un même territoire, par une
délégation du pouvoir central aux préfets,
représentants de l'État dans le département ou la
région. Elle est complémentaire de la délégation
fonctionnelle, ou déconcentration verticale, qui met en valeur la
spécificité des métiers et la ligne hiérarchique de
commandement entre le centre et ses établissements publics.
324
Rapport " L'État en France : servir une nation
ouverte sur le monde " (mai 1994 de la mission sur les
responsabilités et l'organisation de l'État
présidée par Jean Picq, conseiller-maître à la Cour
des comptes.
325
M. Jean-Pierre Balligand, député.
326
Le délégué, désigné par le
préfet, aurait une autorité directe sur les chefs de service
concernés.
327
par exemple entre les directions départementales de
l'équipement et celles de l'agriculture et de la forêt.
328
En deux ans de 1997 à 1999, dans 85 départements
le préfet a changé de poste une ou plusieurs fois.
329
Avis n° 94, tome I (Sénat, 1999-2000), au nom
de la commission des Lois, sur les crédits relatifs à
l'administration territoriale et à la décentralisation, inscrits
dans le projet de loi de finances pour 2000.
330
Cf. Les rapports de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission
des Lois, saisie au fond (n° 281, 1998-1999) et de M. Michel Mercier,
au nom de la commission des Finances, saisie pour avis (n° 283, 1998-1999).
331
Cf. les rapports précités de M. Louis
Althapé, au nom de la commission des Affaires économiques, saisie
au fond, et de M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des Lois, saisie pour
avis.
332
Cf. infra, chapitre V, II.
333
Cf. rapport précité de M. Daniel Hoeffel au nom
de votre commission des Lois, p.105 et ss.
334
Proposition de loi de M. Jean-Claude Gaudin, Michel Mercier,
Emmanuel Hamel, Serge Mathieu, Francis Giraud et André Vallet, tendant
à permettre aux conseillers d'arrondissement de siéger au conseil
d'une communauté urbaine.
335
Cf. rapport précité, p. 128 et ss.
336
Sur ce point, voir le II du chapitre V de la première
partie du présent rapport.
337
Proposition de loi constitutionnelle relative à la libre
administration des collectivités territoriales et à ses
implications fiscales et financières, présentée par MM.
Christian Poncelet, Jean-Paul Delevoye, Jean-Pierre Fourcade, Jean Puech et
Jean-Pierre Raffarin.
338
Cf. le rapport précité établi par notre
collègue Louis Althapé, au nom de la commission des Affaires
économiques, sur le projet de loi relatif à la solidarité
et au renouvellement urbains.
339
Protection sociale et Pauvreté, protection légale
et expériences locales de revenu minimum garanti -CERC- n° 88,1988
- La Documentation française.
340
" Mieux gérer, mieux éduquer, mieux
réussir : redonner son sens à l'autorisation
budgétaire ", rapport (n° 328, 1998-1999) de
MM. Francis Grignon, Jean-Claude Carle et André Vallet au nom de la
commission d'enquête présidée par M. Adrien Gouteyron.
341
Annexe n° 24 : Equipement, transports et logement
(tome II - Transports : routes et sécurité routière)
du rapport général n° 89 (25 novembre 1999) sur le
projet de loi de finances pour 2000.
342
Rapport du groupe de travail sur les relations
financières entre l'Etat et les collectivités locales
présidé par M. François Delafosse, conseiller maître
à la Cour des comptes.
343
Le schéma d'analyse et de couverture des risques (SDACR)
est en effet arrêté par le préfet sur avis conforme du
conseil d'administration.
344
Le Gouvernement a refusé de prendre les dispositions
réglementaires prévues par la loi du 3 mai 1996 pour
harmoniser les régimes de travail des sapeurs-pompiers professionnels
à la suite de leur regroupement au sein de corps départementaux,
laissant aux SDIS le soin de traiter cette question. En revanche, la
progression des indemnités, décidée par l'Etat, est
supportée par les collectivités concernées.
345
Rapport n° 94 (Sénat, 1999-2000), projet de loi
de finances pour 2000.
346
Rapport n° 31 (Sénat, 1999-2000), octobre 1999. La
commission a modifié l'intitulé de la proposition de loi,
celle-ci " tendant à permettre une participation des pratiquants
d'activités sportives ou de loisir aux frais de secours engagés
par les communes ".
347
" La décentralisation - Messieurs de l'Etat encore
un effort ! " - Rapport (n° 239, 1996-1997) au nom du groupe de
travail présidé par M. Jean-Paul Delevoye.
348
Conseil d'Etat, 10 octobre 1990, commissaire de la
République du département de Seine et Marne contre commune de
Montereau-Fault-Yonne.
349
Seule l'expérimentation de l'annualisation du service
à temps partiel a fait l'objet d'un décret d'application.
350
Il faut distinguer, d'une part, les emplois à temps
complet ou à temps incomplet (nature de l'emploi créé),
d'autre part le service à temps plein et celui à temps partiel
(façon dont un emploi à temps complet est occupé).
351
Article 14 de la loi du 13 juin 1998 : " Dans les
douze mois suivant la publication de la présente loi, et après
consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au
parlement un rapport sur le bilan et les perspectives de la réduction du
temps de travail pour les agents de la fonction publique. "
352
Des désaccords majeurs sur le décompte annuel du
temps de travail, sur la base de 1600 heures, sont à l'origine de
l'échec des négociations.
353
Quant à la
période
d'astreinte
, elle
s'entend comme " une période pendant laquelle l'agent, sans
être à la disposition permanente et immédiate de son
employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un
travail au service de l'administration, la durée de cette intervention
étant considérée comme un temps de travail effectif ".
354
États généraux des élus locaux de
mars 1999.
355
Article 41 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale (article L. 5211-41 du code général des
collectivités territoriales) : l'ensemble des personnels de
l'établissement transformé est réputé relever du
nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont
les siennes.
356
Articles 97 et 97 bis de la loi du 24 janvier 1984 :
maintien en surnombre jusqu'au reclassement, prise en charge au-delà de
ce délai par le CNFPT des fonctionnaires de catégorie A, et par
le centre de gestion, des fonctionnaires de catégorie B ou C. Voir
supra, les incidents de carrière.
357
Article 35 de la loi du 12 juillet 1999 (article L. 5211-5 du
code général des collectivités territoriales) : le
nouvel EPCI est substitué aux communes dont il reprend les
compétences, directement ou indirectement, dans toutes leurs
délibérations,, tous leurs actes et tous leurs contrats,
afférents aux compétences transférées.
358
L'agence de notation financière Standard & Poor's
relève que, "
à l'échelle européenne, les
responsabilités assumées par les collectivités locales
françaises restent relativement limitées. Les compétences
les plus lourdes financièrement, telles que la santé ou
l'éducation (définition des programmes scolaires,
rémunération des professeurs) sont gérées en France
par l'Etat, alors que dans de nombreux pays tels que l'Espagne, l'Allemagne, la
Belgique ou l'Italie, elles sont administrées et financées par
les régions
" (" La notation des collectivités
locales, octobre 1999).
359
JO Sénat, séance du 7 juin 2000, p. 3741.
360
JO Sénat, séance du 7 juin 2000, p. 3740.
361
JO Sénat, séance du 3 novembre 1998, p. 4156.
362
Assemblée nationale, onzième législature,
avis n° 1865.
363
" La notation des collectivités locales ",
octobre 1999.
364
Groupe de travail n° 6 sur les politiques de
développement régional (DT/REG(97)10),
Les politiques
régionales dans les années 90 : réorientation vers une
recherche de la compétitivité et des partenariats avec les
niveaux infrarégionaux,
16-17 décembre 1997.
365
Décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991.
366
Décision n° 91-291 du 6 mai 1991.
367
Décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991.
368
Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1999.
369
JO AN, séance du 17 mai 1979, p. 3931.
370
Assemblée nationale, onzième législature,
n° 1066.
371
" Moderniser la taxe professionnelle ",
Les
Echos
, 3 février 1999.
372
JO AN, séance du 17 mai 1979, p. 3931.
373
JO Sénat, séance du 3 novembre 1978, p. 3061.
374
JO Sénat, séance du 7 juin 2000, p. 3741.
375
Rapport au premier ministre, " La France de l'an
2000 ", 1994.
376
Toutefois, l'article 1635 sexies du code général
des impôts prévoit que le produit de la fiscalité locale de
France Télécom perçu par l'Etat finance la dotation de
compensation de la taxe professionnelle.
377
Assemblée nationale, onzième législature,
rapport d'information n° 1779.
378
Si un tel dispositif était actuellement en vigueur, le
Gouvernement aurait dû trouver d'autres sources de financement que la
DCTP pour l'intercommunalité. En effet, pour la période
1999-2001, le contrat de croissance et de solidarité prévoit
uniquement que la DCTP est la variable d'ajustement de l'enveloppe
normée et ne précise pas qu'elle a vocation à financer
l'intercommunalité. A l'initiative du Sénat, la loi du 12 juillet
1999 relative à l'intercommunalité dispose d'ailleurs que le
financement de l'intercommunalité par la DCTP ne sera possible que
jusqu'au terme du contrat de croissance et de solidarité. Le prochain
contrat devra donc revoir le mode de financement des communautés
d'agglomération.
379
Rapport précité, p. 43 et ss.
380
Pour le calcul de l'enveloppe normée, la DGF est
calculée à partir de son " indice " prévu
à l'article L. 1613-1 du code général des
collectivités territoriales tandis que les dotations qui sont
indexées sur la DGF évoluent comme le taux de progression de la
DGF, c'est à dire l'évolution de la DGF en tenant compte du
recalage de et de la régularisation du montant de cette dotation.
381
Dans la loi de finances pour 2000, le transfert des recettes du
budget de l'Etat vers la sécurité sociale a conduit les dotations
aux deux fonds de péréquation à légèrement
diminuer alors que, malgré 40 milliards de francs de baisses
d'impôts, les recettes fiscales nettes de l'Etat augmentaient quand
même de 2,7 %.
382
Décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990.







