2003 PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES
BOURDIN (Joel)
RAPPORT D'INFORMATION 63 (98-99) - DELEGATION DU SENAT POUR LA PLANIFICATION
Table des matières
- PRÉSENTATION
- AVANT-PROPOS
-
CHAPITRE I
INCERTITUDES SUR L'ÉCONOMIE MONDIALE -
CHAPITRE II
PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES À MOYEN TERME
POUR L'ÉCONOMIE FRANÇAISE- I. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS D'UNE PROJECTION DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE À L'HORIZON 2003 (réalisée par l'OFCE)
- II. SYNTHÈSE COMPARATIVE DES PRÉVISIONS À MOYEN TERME
-
CHAPITRE III
PERSISTANCE DU CHÔMAGE, COÛT DU TRAVAIL ET FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE- I. COÛT DU TRAVAIL ET EMPLOI
-
II. LES ÉTUDES EMPIRIQUES JUSTIFIENT DES TRANSFERTS DE CHARGES EN
FAVEUR DU TRAVAIL PEU QUALIFIÉ
- A. LES RÉSULTATS DES ÉTUDES MACROÉCONOMÉTRIQUES : UN LIEN DISTENDU ENTRE COÛT DU TRAVAIL ET EMPLOI
- B. LES RÉSULTATS DES ÉTUDES MICROÉCONOMIQUES : UNE FORTE SENSIBILITÉ DE L'EMPLOI AU COÛT DU TRAVAIL POUR LES SALARIÉS LES MOINS QUALIFIÉS
- C. LA SYNTHÈSE DES ÉTUDES EMPIRIQUES OPÉRÉE DANS LES MODÈLES MACROÉCONOMIQUES JUSTIFIE A PRIORI DES ALLÉGEMENTS DE CHARGES CIBLÉS SUR LES BAS SALAIRES
- D. L'ÉVALUATION DES EFFETS DES ALLÉGEMENTS DE CHARGES SUR LES BAS SALAIRES MIS EN oeUVRE DEPUIS 1993
- E. LE DISPOSITIF ACTUEL D'ALLÉGEMENTS DE CHARGES SUR LES BAS SALAIRES PEUT TOUTEFOIS PRÉSENTER DES EFFETS PERVERS.
-
III. ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES ET EMPLOI
- A. LES MODÈLES MACROÉCONOMIQUES SUGGÈRENT QUE LES MODALITÉS DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE NE SONT PAS NEUTRES POUR L'EMPLOI
- B. L'EXTENSION DE L'ASSIETTE DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SE TRADUIRAIT TOUTEFOIS PAR DES TRANSFERTS IMPORTANTS ENTRE ENTREPRISES SUSCEPTIBLES D'EN LIMITER L'EFFICACITÉ POUR L'EMPLOI
- C. LA MODULATION DES COTISATIONS CHÔMAGE
- IV. CONCLUSION
-
ANNEXE N° 1
UNE PROJECTION DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE
(1998-2003)- I. CONCEPTION GÉNÉRALE DE L'EXERCICE
- II. PRINCIPALES HYPOTHÈSES DE LA PROJECTION
- III. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS MACROÉCONOMIQUES
- IV. TENDANCE DES FINANCES PUBLIQUES
N° 63
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès verbal de la séance du 16 novembre 1998.
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation du Sénat pour la planification
(1)
sur les
perspectives macroéconomiques à moyen terme
(1998-2003),
Par M. Joël BOURDIN,
Sénateur.
(1)
Cette délégation est composée de
: MM. Joël
Bourdin,
président
; Serge Lepeltier, Marcel Lesbros, Georges
Mouly, Jean-Pierre Plancade,
vice-présidents
; Mme Odette
Terrade, M. Roger Husson,
secrétaires
; M. Pierre André,
Mme Janine Bardou, MM. Michel Charzat, Patrick Lassourd, Henri Le Breton,
Daniel Percheron, Roger Rinchet, Alain Vasselle.
Prévisions et projections économiques -
Chômage -
Consommation - Cotisations sociales - Croissance - Déficit public -
Dépenses de santé - Dette publique - Dollar - Echanges
extérieurs - Emploi - Finances sociales - Inflation -
Investissement - Modèles macroéconomiques - Politique
budgétaire - Population active - Productivité - Salaires -
Sécurité sociale - Système financier international - Taux
de change - Taux d'intérêt - Union économique et
monétaire.
PRÉSENTATION
Depuis
sa création en 1982, la Délégation pour la Planification
soumet chaque année au Sénat, au moment de la discussion
budgétaire, des éléments de réflexion sur les
perspectives économiques à
moyen terme
. Cet exercice
permet de faire la synthèse des différents travaux de
projection
et de
simulation
suivis par le Service des Etudes du
Sénat, sous l'égide de la Délégation.
Ceux qui sont présentés dans le
premier chapitre
et
l'
annexe n° 2
permettent d'illustrer les
incertitudes
sur l'
économie mondiale
et
l'
environnement
international
de l'économie française, grâce à
diverses simulations réalisées à l'aide du
modèle
multinational
MIMOSA utilisé par l'Observatoire
français des conjonctures économiques (OFCE).
Le
deuxième chapitre
et l'
annexe n° 1
présentent une projection à l'horizon 2003 de
l'
économie française
, et les tendances des
finances
publiques
associées à cette projection. Cet exercice,
mené à l'aide du modèle MOSAÏQUE de l'OFCE, est
ensuite
comparé
aux prévisions à moyen terme de
quatre autres organismes : l'Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE), le Centre de Recherches pour
l'expansion de l'économie et le développement des entreprises
(REXECODE) et le Bureau d'informations et de prévisions
économiques (BIPE).
Enfin, le
troisième chapitre
et
l'annexe n° 3
sont
consacrés à une étude des liens entre
l'
emploi
, le
coût du travail
et le
financement de la
Sécurité sociale
, et à un inventaire des
différentes questions qui se posent lorsqu'on simule, à l'aide de
modèles macroéconomiques, les effets d'une réforme de
l'
assiette
ou d'un
allégement
des
cotisations
sociales
.
AVANT-PROPOS
En
présentant le résultat de projections réalisées
à l'aide de modèles macroéconomiques, votre
Délégation entend favoriser la diffusion d'une information sur
des travaux dont le degré de technicité ne facilite guère
l'utilisation. Ce faisant, elle souhaite contribuer à la
compréhension des mécanismes économiques et, par une
exploration du moyen terme,
mettre en lumière
les questions et
les choix de politique économique.
De même, une assemblée parlementaire ne saurait négliger
les
moyens modernes
d'analyse et de prévision, par ailleurs
largement utilisés par le Gouvernement.
Cependant, votre Délégation a souvent insisté sur les
limites inhérentes aux exercices de simulation réalisés
à l'aide de modèles économiques. Elle ne prétend
pas ainsi, en présentant ces travaux de projection, décrire une
prévision
et, encore moins, une évolution
probable
de l'économie française.
Une projection constitue en effet une prolongation du passé et, de ce
fait, une extrapolation des tendances en cours.
Ce souci de prudence doit être rappelé avec une insistance
particulière cette année.
Votre Rapporteur considère tout d'abord que des
modifications
notables des
comportements
des agents économiques, que les
modèles ne peuvent prendre en compte, sont susceptibles de se produire
au cours des prochaines années pour deux raisons
1(
*
)
:
- le lancement de l'
euro
en premier lieu, susceptible de modifier le
fonctionnement du système financier international et les comportements
d'investissement en Europe ;
- le développement des
nouvelles techniques de communication
et
de traitement de l'information qui pourrait, en Europe, à l'instar des
Etats-Unis depuis le début des années 90, amplifier le nouveau
cycle d'investissement.
Par ailleurs, la
crise financière
aiguë que vient de
connaître l'économie mondiale jette une
ombre
sur les
travaux de projection présentés aujourd'hui : quelles seront
les conséquences de cette crise ? Peut-on considérer qu'elle
est terminée ? L'Europe peut-elle rester à l'abri d'un
ralentissement qui affecte pratiquement toutes les autres zones de
l'économie mondiale ?
C'est pour apporter des éléments de réponse à ces
questions, déterminantes pour les perspectives
à moyen
terme
de l'économie
française
, que le chapitre I
consacre d'importants développements aux
incertitudes
sur
l'
économie mondiale
et à l'analyse de la
conjoncture
européenne.
CHAPITRE I
INCERTITUDES SUR L'ÉCONOMIE
MONDIALE
Depuis
le Colloque sur les perspectives de l'
économie mondiale
,
organisé le 2 avril dernier par votre Délégation, et la
présentation à cette occasion d'une projection à l'horizon
2005, réalisée par l'OFCE à l'aide du modèle de
simulation de l'économie mondiale MIMOSA
2(
*
)
, celle-ci a connu de profonds bouleversements.
Alors qu'à cette date, la crise des pays
" émergents "
3(
*
)
, née
pendant l'été 1997 avec la dévaluation du baht
thaïlandais, paraissait circonscrite aux pays d'Asie du Sud-Est, celle-ci
s'est étendue à la Russie, et dans une moindre mesure, aux pays
d'Amérique latine. En effet, la chute des prix des matières
premières et du pétrole, consécutive à la crise
asiatique, a fait apparaître le caractère peu soutenable de
l'endettement de la Russie, conduisant ce pays à laisser filer sa
monnaie et à déclarer un moratoire unilatéral sur sa
dette. Les pertes ainsi encourues par les investisseurs occidentaux sur les
titres russes ont amorcé un processus de défiance à
l'égard des placements dans les pays émergents qui, par
contagion, a commencé à affecter l'Amérique latine.
Dans le même temps, la confiance des marchés financiers des pays
développés, qui avait résisté à la crise
asiatique, a été profondément ébranlée par
la crise russe, induisant un krach boursier " rampant ", une forte
volatilité des prix des actifs financiers, une fuite devant le risque et
une préférence accrue pour des placements plus liquides.
Ainsi s'est dessinée une "
interaction
déstabilisatrice
"
4(
*
)
entre deux
séries d'événements apparemment indépendants, la
crise des pays émergents et la crise des marchés financiers
occidentaux, de nature à affecter la croissance mondiale au cours des
prochaines années. En effet, les perturbations dans l'
allocation
internationale
des
capitaux
et de l'épargne, ou, autrement
dit, dans le
financement
par les pays développés de la
croissance des pays émergents, pourraient
compromettre
la sortie
de la crise qui les affecte.
Ainsi votre Délégation a-t-elle été conduite
à s'interroger sur la
validité
du scénario
d'
environnement international
à moyen terme réalisé
au printemps de chaque année à sa demande et qui,
traditionnellement, sert de
cadre
à la projection de
l'économie française qu'elle présente à l'automne.
Elle a donc demandé à l'OFCE de réaliser un certain nombre
de simulations, afin d'évaluer l'
impact
de ces
perturbations
récentes : élargissement de la crise des pays
émergents, enlisement de l'économie japonaise et baisse du dollar
par rapport aux monnaies européennes.
Ces travaux, dont votre rapporteur essaiera de tirer dans ce chapitre les
principales conclusions et qui sont présentés
intégralement dans l'annexe n° 2, font apparaître un
premier
constat
: si les perspectives de la
croissance
mondiale
à court terme doivent être sensiblement
révisées, suite aux événements des six derniers
mois (de l'ordre de 0,5 point de croissance en 1998 et 1999 selon l'OFCE),
les prévisions de croissance pour l'Union européenne n'en
seraient pas pour autant modifiées.
Ce
diagnostic
rejoint d'ailleurs celui de la plupart des instituts
indépendants de prévision ou celui des organisations
économiques internationales (FMI, OCDE ou Commission européenne).
Son fondement est désormais bien connu : le dynamisme de la demande
intérieure en Europe, supérieur aux estimations et aux
prévisions du printemps dernier, compenserait la dégradation de
l'environnement international.
Mais, et c'est le
paradoxe
que votre Rapporteur tentera
d'éclaircir ci-dessous, la
convergence
étonnante des
diagnostics et des prévisions relatives à l'Union
européenne,
contraste
nettement avec le climat
d'
incertitude
qui affecte l'économie mondiale et les
prévisionnistes eux-mêmes...
I. LA CRISE DES PAYS ÉMERGENTS
Les
causes, le déroulement et les conséquences éventuelles de
la crise des économies dynamiques d'Asie, étendue ensuite
à la Russie et l'Amérique latine, sont décrites de
façon précise et éclairante dans l'
annexe
n° 2
. Quatre enseignements majeurs se dégagent de cette
étude :
1.
Ce que l'on nomme communément la " crise asiatique "
a effectivement débuté en juillet 1997 avec la dévaluation
du baht thaïlandais, qui a entraîné la dévaluation en
chaîne des autres devises de la région, mais les premiers signes
de
déséquilibre
étaient apparus dès
1995
.
Dès cette année-là en effet, le
renchérissement
du dollar
, auquel sont liées la plupart des monnaies de la
région, par rapport aux monnaies européennes et surtout
japonaise, a brutalement affecté la compétitivité de ces
pays. Ce phénomène a été aggravé par des
tensions sur les prix de production, provoquant un accroissement du
déficit des
balances courantes.
Il a ainsi fallu deux ans pour
assister à une correction, d'autant plus brutale qu'elle était
tardive
. Cela montre combien, à ne considérer que les taux
de croissance et le rendement des investissements, sans prendre en compte les
données macroéconomiques fondamentales telles que le taux de
change ou les comptes extérieurs, a pu se développer une myopie
collective à l'égard de ces pays.
2.
L'afflux important de
capitaux à court terme
vers cette
zone a donné lieu à une croissance incontrôlée des
crédits bancaires
, du fait de la quasi absence de
régulation interne des systèmes financiers, et à un
emballement du crédit. Il en est résulté des
phénomènes
spéculatifs
, de telle sorte que
l'endettement extérieur et l'endettement privé interne
étaient gagés sur des actifs et des marchés
surévalués.
3.
L'impact
maximal
du choc financier en Asie a été
atteint vers le milieu de l'année 1998. La croissance de la zone devrait
ainsi être nulle en 1998 et repartir en 1999, et l'
essentiel du
choc
de la crise des pays d'Asie
serait absorbé en 1999
(indépendamment de ses conséquences sur d'autres zones
émergentes et notamment l'Amérique latine) ;
après
1999
, la croissance des pays développés après 1999
serait donc peu affectée.
4.
La crise des pays émergents a généré deux
effets de sens contraire sur la croissance des principaux pays
développés :
- - un effet favorable résultant du retour des capitaux sur les
marchés des pays développés (" fuite vers la
qualité ") et de la baisse des taux d'intérêt à
long terme (de l'ordre d'un demi-point par rapport au printemps dernier) ;
- un effet défavorable sur le commerce extérieur, lié aux
dévaluations des monnaies des pays émergents et à la
contraction de leur demande interne. Les pays développés sont
différemment exposés
à cet impact commercial.
Ainsi, les exportations vers les pays émergents touchés par la
crise (Asie et Amérique latine) représentent
3,3 %
du
PIB
japonais
,
3,1 %
du PIB des
Etats-Unis
et
2,2 %
seulement du PIB de l'
Union européenne
.
5.
L'utilisation d'un modèle
multinational
, tel que le
modèle MIMOSA, qui met en évidence les interactions
internationales et les interdépendances entre économies, permet
de simuler l'impact d'un événement tel que la crise des pays
émergents. Cet exercice doit cependant être
interprété avec prudence, dans la mesure où il suppose la
définition, particulièrement délicate, d'un
" scénario sans crise " et d'hypothèses relativement
arbitraires. Les auteurs de la simulation ont par exemple
considéré que la crise boursière récente dans
l'OCDE relevait de la correction attendue d'une hausse excessive, et
n'était pas directement imputable à la crise des pays
émergents.
Sous ces réserves, il est possible de mettre en évidence quelques
résultats significatifs
(pour plus de détails on pourra se
rapporter aux pages 118 à 120 de l'annexe n° 2) :
- La crise des pays émergents amputerait la
croissance
de
l'
Union européenne
de
0,6 point en 1998
et
0,8 point en 1999
; celle des
Etats-Unis
de
1,1 point en 1998
et
1 point en 1999
; celle du
Japon
de
1,4 point en 1998
et
1 point en
1999
;
- le rythme de l'
inflation
dans l'Union européenne serait
abaissé de
0,4 point
en 1998 comme en 1999 ; de
0,6 point en 1998 et 0,7 point en 1999 aux Etats-Unis. La dynamique
de
désinflation
dans les économies
développées serait ainsi renforcée par la baisse du prix
du pétrole et des matières premières, et par la baisse des
prix des produits importés, suite aux dévaluations dans les pays
émergents ;
- la crise se traduit par un
rééquilibrage des soldes
commerciaux
dans le monde, à l'exception notable des Etats-Unis qui
n'enregistreraient pas de correction significative de leur déficit
extérieur.
Les excédents européens se réduiraient à hauteur de
73 milliards de dollars en deux ans ; les soldes commerciaux des pays
émergents se redresseraient de manière spectaculaire
(+ 150 milliards de dollars en deux ans pour les pays d'Asie,
+ 37 milliards de dollars pour l'Amériqe latine).
II. L'ENLISEMENT DE L'ÉCONOMIE JAPONAISE
Dans la
prévision présentée par l'OFCE devant votre
Délégation au mois d'avril dernier, la croissance de
l'économie japonaise en 1998 était légèrement
positive (+ 0,3 %). Depuis cette date, l'
investissement
privé a connu dans ce pays une forte contraction, liée notamment
au
rationnement du crédit
par les banques (compte tenu de
l'accumulation de créances douteuses), à l'augmentation du nombre
de faillites et aux incertitudes sur la croissance nippone.
Les experts de l'OFCE ont cherché à évaluer l'impact de
cette chute de l'investissement privé. Selon cette simulation, les
taux de croissance
pour 1998 seraient ainsi
réduits
de
2,3 points au Japon (ce qui se traduirait par une baisse du PIB japonais
de 2 % en 1998), 0,4 point aux Etats-Unis et 0,3 point en Europe.
Les taux de croissance pour 1999 ne seraient pas affectés ;
néanmoins, cet exercice permet d'illustrer le
risque
pour
l'économie mondiale d'un nouveau
report de la reprise
japonaise.
Certainement faudrait-il ajouter à cette évaluation un
commentaire plus
qualitatif
pour apprécier l'impact de la
récession japonaise sur l'économie mondiale, à la
lumière des propos tenus par M. Kenneth COURTIS, Economiste en
chef à la Deutsche Bank en Asie, à l'occasion d'un Colloque qui
s'est récemment tenu au Sénat
5(
*
)
.
Celui-ci se demandait dans quelle mesure, en 1994-1995, le Mexique et les pays
d'Amérique latine touchés par le crise auraient pu renouer avec
la croissance aussi rapidement si leur partenaire principal, les Etats-Unis, ne
s'était pas trouvé dans une phase conjoncturelle aussi favorable.
Ce rappel visait à souligner la contrainte que pourrait
durablement
exercer l'enlisement de l'économie japonaise sur les
pays en crise d'Asie.
III. DÉPRÉCIATION DU DOLLAR ET POLITIQUE MONÉTAIRE EN EUROPE
La
prévision réalisée en avril dernier reposait sur une
anticipation de baisse de la valeur du dollar, de 6 francs en 1998
à 5,53 francs en 1999. Cette baisse a été, au cours
des six derniers mois, plus précoce que prévu
6(
*
)
.
Plusieurs facteurs conduisent à envisager l'
amplification
de ce
mouvement : à court terme, le ralentissement de l'économie
américaine, la perspective d'une poursuite de la baisse des taux
d'intérêt aux Etats-Unis et les effets de
" réallocation de portefeuilles " liés à
l'introduction de l'euro ; à moyen terme, la persistance du
déficit extérieur américain et d'un excédent
européen.
Une variante réalisée à l'aide du modèle MIMOSA
permet d'évaluer l'impact d'une
baisse supplémentaire
de
5 % en 1999
du dollar face à toutes les monnaies. Celle-ci
amputerait la
croissance
en
Europe
de
0,5 point en
1999
et 0,2 point en 2000 ; de 0,4 point au Japon en 1998 et
1999 ; la croissance aux Etats-Unis serait supérieure de
0,3 point en 1999 et 2000.
On peut déduire de ces simulations qu'une poursuite de la baisse du
dollar, jusqu'à une valeur de
1 dollar = 5,10 francs, aurait en 1999 un
effet
restrictif
sur la croissance européenne
supérieur
à celui d'un enlisement de l'économie japonaise dans la
récession, et sensiblement du même ordre que la crise des pays
émergents, représentant environ
40 % du PIB
mondial
7(
*
)
. Ces travaux permettent ainsi de
montrer que l'orientation de sa
politique monétaire
et de sa
politique de change
pourrait être tout aussi
déterminante
pour l'économie européenne que la
dégradation de son environnement international.
De plus, la crise des pays émergents, conjuguée à la
baisse récente du dollar, devrait avoir un fort
effet
désinflationniste
sur les économies européennes, que
l'on peut évaluer à partir des simulations
présentées ci-dessus, à 1 point environ en 1999.
Il faut rappeler que l'inflation en Europe se situe déjà à
un faible niveau : sur les douze derniers mois, en France et en Allemagne,
les prix à la consommation n'ont progressé que de 0,5 %.
Ainsi faut-il craindre que le caractère déjà
restrictif
de la politique monétaire en Europe
8(
*
)
ne s'aggrave du fait de la poursuite de la
désinflation.
Une
baisse des taux d'intérêt
, en Europe comme aux
Etats-Unis, serait donc aujourd'hui justifiée.
Selon le modèle MIMOSA (cf. annexe n° 2, page 123), une baisse
des taux de l'ordre d'un demi-point en Europe comme aux Etats-Unis soutiendrait
la croissance à hauteur de 0,2 point la première
année et 0,1 point la deuxième année en Europe
(l'effet est sensiblement le même aux Etats-Unis).
En première analyse, l'impact de cette mesure apparaît modeste et
elle ne permettrait pas de faire face à des aléas importants,
tels qu'un approfondissement de la crise des pays émergents ou un
prolongement de la récession au Japon. Toutefois, cette
évaluation ne prend pas en compte l'incidence d'une baisse
concertée des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en Europe
sur l'évolution des
taux de change
: celle-ci permettrait en
effet une
moindre dépréciation du dollar
que dans
l'hypothèse où l'Europe ne suivrait pas le mouvement
d'assouplissement de la politique monétaire amorcé, semble-t-il,
aux Etats-Unis.
IV. QUELLE CROISSANCE POUR L'EUROPE ?
A. HYPOTHÈSES DE LA PROJECTION DE L'OFCE : L'EUROPE À CONTRE-COURANT
Compte
tenu de la convergence et du degré d'interdépendance des
économies européennes, les hypothèses de croissance pour
l'Union européenne
déterminent
très largement les
prévisions pour l'
économie
française.
La projection à moyen terme de l'économie française,
réalisée par l'OFCE et présentée dans le
chapitre II
et l'
annexe n° 1
, repose sur
l'hypothèse d'une stabilisation de la croissance européenne
autour de 2,5 % par an à partir de 1999 (après
+ 2,7 % en 1998).
Les experts de l'OFCE ont ainsi retenu un scénario qui peut
apparaître optimiste eu égard à la dégradation de
l'environnement extra-européen décrite ci-dessus ou, au
contraire, plutôt prudent si on le compare à la dernière
phase d'expansion cyclique de la période 1986-1990 (+ 3,4 %
par an en moyenne).
Le propos de votre Rapporteur n'est pas d'arbitrer entre ces deux
appréciations mais de tenter d'analyser ce qui sous-tend et ce que
suppose cette hypothèse, notamment à la lumière des
simulations présentées ci-dessus.
• Il faut tout d'abord observer qu'à la crise des
économies des pays émergents et du Japon, se superposerait
dès 1999 une forte
contraction
de l'activité aux
Etats-Unis
.
Même si l'économie américaine a continué de
croître au troisième trimestre de 1998 à un rythme
annualisé proche de 3,5 %, les facteurs qui ont longtemps soutenu
la croissance devraient, selon l'OFCE, se
retourner
brutalement :
le
taux d'épargne
des ménages, qui se situe aujourd'hui
à un point bas historique (0,3 %), devrait augmenter en raison de
la crise boursière ; surtout, l'
investissement
des
entreprises devrait se contracter en raison de la baisse des profits des
entreprises et de la crise financière qui menace la solvabilité
des banques. Le taux de croissance du PIB aux Etats-Unis passerait ainsi de
3,2 % en 1998 à 0,5 % en 1999. Ce retournement serait
néanmoins de courte durée, grâce à une
politique
monétaire accommodante
: à partir de 2000,
l'économie américaine retrouverait un rythme normal
d'activité et un taux de croissance de l'ordre de 2,2 % par an
entre 2000 et 2003.
• Malgré un environnement mondial dont la dégradation
devrait s'aggraver avec le ralentissement américain, les experts de
l'OFCE, comme la plupart des organismes de prévisions, nationaux ou
internationaux, ont certes retenu l'hypothèse d'un ralentissement de la
croissance en Europe (de + 2,7 % en 1998 à + 2,5 %
en 1999), mais pas celle d'une contraction comparable à celle de ses
partenaires. Les arguments en faveur d'une
stabilisation
de
l'économie européenne sur son sentier de
croissance
potentielle
ont été mis en lumière par les
débats récents sur les hypothèses associées au
projet de loi de finances pour 1999 et sont désormais bien connus :
la demande intérieure en Europe a gagné en vigueur au premier
semestre 1998, notamment la consommation des ménages soutenue par la
progression de l'emploi et des revenus ; les ajustements
budgétaires seraient moins sévères qu'au cours des
années récentes ; la croissance se maintient à un
rythme élevé dans plusieurs pays de la zone euro (Espagne,
Pays-Bas, Irlande).
Ce diagnostic relativement consensuel appelle quatre observations :
- Il faut d'abord rappeler que si ces prévisions se réalisaient,
ce ne serait pas la première fois que l'économie
européenne évoluerait à " contre-courant " de
ses principaux partenaires : la forte reprise de la fin des années
80 s'est produite dans un contexte de fort ralentissement en Amérique du
Nord ; au contraire, la récession européenne de 1993 a
coïncidé avec la forte croissance américaine.
Ces " décalages de conjoncture " ne sont pas
surprenants : l'Europe, prise dans son ensemble, est une
zone
fermée
sur l'extérieur. Le rapport des exportations au PIB
n'est que de 9,4 % ; si on y inclut les pays d'Europe centrale et
orientale, aujourd'hui dans une phase de forte expansion (de l'ordre de
8 % en 1998), le rapport des exportations au PIB de l'Europe n'est que de
6 %.
- A partir des simulations présentées au début de ce
chapitre, on peut estimer que la crise des pays émergents, le
prolongement de la crise au Japon et la baisse du dollar
" coûteraient " à l'économie européenne
environ 1,3 point de croissance en 1999. On peut donc en déduire,
afin d'apprécier le diagnostic des prévisionnistes, que
sans
ces événements exceptionnels
la croissance européenne
se serait située autour de
4 % en 1999
, soit un taux de
croissance atteint une seule fois - en 1988 - depuis le premier choc
pétrolier.
- Si l'on raisonne sur des taux de croissance en
glissement
9(
*
)
qui, à l'inverse des taux de croissance en
moyenne annuelle, permettent d'observer les fluctuations conjoncturelles
infra-annuelles
, on observe que depuis la fin de 1997, la croissance
européenne a fortement
ralenti
. Elle se trouve aujourd'hui sur
une pente de 2 % l'an environ, contre 3,5 % l'an au cours des trois
premiers trimestres de 1997.
Il faut en déduire qu'une prévision de croissance en moyenne
annuelle de 2,5 % en 1999 suppose une
forte reprise
de
l'économie européenne au second semestre de 1999 et un retour de
l'activité sur un rythme d'activité annualisé de 3 %.
C'est donc une anticipation d'
accélération
de
l'activité, et non de stabilisation, qui sous-tend l'hypothèse de
croissance à court terme en Europe.
- Les deux observations qui précèdent conduisent à
considérer que les experts de l'OFCE ont privilégié un
scénario à
court terme très favorable
et même
normatif
pour l'économie européenne, le scénario
à moyen terme ayant un caractère plus
tendanciel
.
B. UN " SCÉNARIO NOIR " POUR L'EUROPE ?
Votre
Rapporteur rappelait en introduction à ce chapitre le
double
décalage
entre l'optimisme des prévisions à court
terme pour l'Europe et la dégradation de son environnement mondial,
d'une part, et entre cet optimisme et l'inquiétude exprimée en
marge de leurs prévisions par les économistes, d'autre part.
Ceci peut s'expliquer par l'attitude des prévisionnistes qui consiste
à privilégier un scénario
" moyen "
.
Ainsi, un scénario
extrême
d'effondrement de
l'économie mondiale et de l'économie européenne n'est-il
pas, dans cette approche, le plus
probable
. On peut comprendre
également le souci des prévisionnistes de ne pas ajouter au
ralentissement de la croissance en présentant des prévisions
pessimistes qui porteraient atteinte au moral des agents économiques.
C'est cette attitude qui avait pu être observée à l'automne
1992, où les prévisions pour 1993, dans leur grande
majorité, n'intégraient pas l'hypothèse d'un
ralentissement encore plus fort que celui déjà à l'oeuvre,
certainement dans le souci de ne pas contribuer à la perte de confiance
des agents. On sait ce qu'il advint de la croissance en 1993...
• Cette référence historique à la
récession de 1993
est, précisément, avancée
parfois pour discuter les scénarios à court terme actuels pour
l'Europe.
En 1993, la récession est venue d'un effondrement de la demande
intérieure que les déterminants économétriques
habituels de la consommation ou de l'investissement n'ont pu expliquer (en
particulier la remontée du taux d'épargne des ménages). Le
contexte macroéconomique
actuel semble aujourd'hui
très
différent
: les
taux de change
intra-européens
sont stabilisés, alors qu'en 1992-1993 les fortes dévaluations de
certaines monnaies européennes (lire italienne, peseta espagnole
notamment) avaient généré un climat d'incertitude qui a
certainement contribué à la chute de l'investissement
industriel ; surtout, les
taux d'intérêt réels
à la fin de 1992 étaient
quatre fois plus
élevés
qu'actuellement, suite au choc de la
réunification allemande. Le scénario monétaire, à
l'exception de l'incertitude sur le dollar, est ainsi aujourd'hui beaucoup plus
favorable, de sorte que les deux périodes ne peuvent pas être
comparées.
• Votre Rapporteur regrette pourtant qu'aucun organisme de
prévision n'ait cherché à construire, ne serait-ce
qu'à titre
illustratif
, un " scénario noir "
pour l'économie européenne. Puisque celui-ci est présent
à l'esprit, un tel exercice aurait en effet permis d'envisager les
hypothèses conduisant à un tel scénario, de
vérifier leur vraisemblance et de " tester " les
réactions de politique économique.
Selon votre Rapporteur, et si l'on fait abstraction d'une possible rechute du
dollar dont les conséquences pour l'économie européenne
ont été évoquées précédemment, les
hypothèses permettant de simuler un scénario à court terme
plus défavorable pour l'économie européenne doivent
être recherchées du côté de la demande
intérieure plutôt que du côté de l'environnement
international.
En effet, dans les scénarios présentés, la croissance
mondiale vue d'Europe serait
nulle
en 1998 et faiblement positive en
1999. Pour que l'environnement international soit encore plus
défavorable, il faudrait un effondrement de l'Amérique latine ou
une nouvelle crise en Asie (sachant que l'OFCE retient par ailleurs
l'hypothèse que l'économie américaine entrerait en
récession à la fin de 1998).
En Amérique latine, le Brésil souffre d'un déficit public
et d'une dette élevés, de la surévaluation de sa devise et
de la faiblesse de l'épargne nationale. La fragilité de ce pays,
qui représente 50 % du PIB de l'Amérique latine, menace
ainsi l'ensemble de la zone. L'effondrement de l'Amérique latine
toucherait directement les Etats-Unis, compte tenu de leur implication dans
cette région : il entraînerait une chute des marchés
boursiers, du dollar et des menaces d'insolvabilité pour le
système bancaire américain. L'actualité récente
semble pourtant indiquer que, grâce à l'aide internationale et du
Fonds monétaire international, ainsi qu'au soutien des Etats-Unis, ce
risque devrait être maîtrisé. De même, un
approfondissement de la crise en Asie, au-delà des évolutions
déjà observées, ne paraît pas l'hypothèse la
plus probable. Les dévaluations passées permettent en effet le
rétablissement des comptes extérieurs et les prêts
consentis à ces pays par le Fonds monétaire international ont
permis la reconstitution des réserves de changes. Les taux de change se
sont ainsi stabilisés et les
taux d'intérêt
ont
quasiment
retrouvé
les niveaux d'avant la crise.
Les risques d'affaiblissement de la croissance en Europe paraissent donc
résider essentiellement dans une orientation moins favorable de la
demande intérieure que celle généralement
envisagée. Trois facteurs pourraient en être à
l'origine :
- une
remontée
des
taux d'épargne
, dont la baisse
a soutenu la demande en Europe dans la période récente,
particulièrement en Italie et, dans une moindre mesure, en Allemagne et
en France. Les effets de richesse
10(
*
)
pouvant
être considérés comme négligeables en Europe, c'est
essentiellement un
arrêt de la baisse
du
chômage
,
initiée depuis peu, qui pourrait entraîner des comportements de
précaution et une remontée des taux d'épargne. Or, compte
tenu du ralentissement en Europe depuis le début de l'année, les
créations d'emplois pourraient être moins fortes ;
- une
moindre résistance
de l'
investissement
des
entreprises au ralentissement de la demande mondiale que celle observée
jusqu'à présent ;
- un
effondrement du crédit
("
credit crunch
")
en raison de la dégradation de la situation des banques. Si ce risque
est bien réel au Japon, il semble moins présent aux Etats-Unis et
encore moins en Europe. L'intervention de la Réserve
Fédérale américaine pour éviter la
défaillance d'un intermédiaire financier montre que les Banques
centrales sauraient mobiliser les moyens nécessaires pour éviter
une crise bancaire " systémique ". Plus que d'un
"
credit crunch
", il faudrait plutôt s'inquiéter
d'un rationnement du crédit
11(
*
)
. Les
économistes consultés par votre Rapporteur considèrent
généralement que ses
effets
seraient cependant
amortis
en Europe, en raison de la forte remontée de la
profitabilité des entreprises, qui diminue le recours au crédit,
ou du degré élevé d'autofinancement des entreprises.
A plusieurs égards, la situation de l'économie européenne
en 1998 se rapproche de celle de la reprise de 1994 : même
détente monétaire et ralentissement de la demande mondiale.
Néanmoins, d'autres éléments ont conduit les experts de
l'OFCE à ne pas privilégier un scénario de reprise
avortée comme en 1995 : l'inflation se situe à un niveau
très bas, inférieur aux objectifs des Banques centrales et,
surtout, les
ajustements budgétaires
, opérés de
manière
conjointe
en Europe (ce qui a renforcé leur effet
restrictif sur l'activité) à partir de 1994, seraient à
l'avenir beaucoup moins sévères.
C. SORTIE DE CRISE POUR L'ÉCONOMIE MONDIALE ?
La
projection réalisée par l'OFCE pour le Sénat
décrit, pour le moyen terme, un retour de la croissance de
l'
économie mondiale
vers sa
tendance
antérieure,
soit 3 % par an environ.
Le scénario de
sortie de crise
ainsi présenté
rejoint par ailleurs celui élaboré par d'autres organismes de
prévision (cf. chapitre II, page 47).
Le sentiment que la crise financière serait derrière nous est
renforcé par la prise de conscience que traduit la position des pays
industrialisés réunis au sein du G7, ou celle du Fonds
monétaire international, en faveur d'une
" libéralisation
ordonnée des mouvements de capitaux
"
12(
*
)
. Il faut cependant observer que, hormis
l'augmentation des ressources du FMI, cette mobilisation n'a pas encore
entraîné de décisions concrètes. Or, il faut
souligner que celles-ci seront d'autant plus difficiles à mettre en
oeuvre que la crise récente, à l'inverse des crises
précédentes, n'est pas de nature exclusivement
macroéconomique
, mais aussi une crise d'insolvabilité
d'
agents privés
(intermédiaires financiers notamment).
Si la crise récente pouvait néanmoins déboucher sur une
meilleure régulation du système financier international
13(
*
)
, il faut craindre que les problèmes à
l'origine de ces turbulences ne demeurent.
Votre Rapporteur évoquera ainsi
trois inquiétudes
majeures pour le
moyen terme
14(
*
)
:
• La persistance du
déficit extérieur
américain
, conséquence d'une insuffisance structurelle
d'épargne, est à l'origine de la
volatilité du
dollar
et constitue une menace pour la stabilité de
l'économie mondiale. Celle-ci doit en effet vivre sous la menace
permanente d'un arrêt du financement de l'endettement considérable
des Etats-Unis par les investisseurs non américains. De ce point de vue,
l'avènement de l'euro introduit une incertitude supplémentaire.
• La question du
recyclage de l'épargne
dégagée par les pays de l'OCDE demeure pendante. Jusqu'à
présent, celui-ci s'est opéré sous la forme de mouvements
de capitaux à
court terme
vers les pays émergents, ou, en
cas de crise, sous la forme d'interventions du FMI. Il serait souhaitable pour
la stabilité du système financier international que ce recyclage
se réalise sous la forme de mouvements de capitaux à
long
terme
et d'
investissements directs
ou, autrement dit, que les
opérateurs de ce recyclage soient moins des intermédiaires
financiers que des
entreprises
.
Par ailleurs, la persistance d'excédents commerciaux substantiels en
Europe et au Japon ne favorise pas le redémarrage de l'activité
dans les pays émergents. Sous cet aspect, des politiques plus favorables
à l'augmentation de la demande intérieure en Europe et au Japon
seraient de nature à renforcer la croissance mondiale.
• Les exigences de
rentabilité
très
élevées des épargnants des pays développés
ont conduit à des prises de risque excessives, tant du côté
des entreprises que du côté des institutions financières,
et à la crise actuelle. Un
redressement
de l'économie
mondiale suppose donc l'acceptation, par les créanciers des pays
développés, de taux de rentabilité des capitaux investis
moins élevés
.
CHAPITRE II
PERSPECTIVES
MACROÉCONOMIQUES À MOYEN TERME
POUR L'ÉCONOMIE
FRANÇAISE
L'Observatoire français des conjonctures
économiques
(OFCE) a réalisé, à la demande du Service des Etudes du
Sénat, une
projection
de l'économie française
à l'horizon 2003, à l'aide de son modèle MOSAÏQUE
(voir
Annexe n° 1
, page 73).
Cet exercice est de nature essentiellement
macroéconomique
, mais
il a été demandé aux experts de l'OFCE d'en tirer le
maximum d'indications sur l'évolution des
finances publiques
.
Les résultats les plus significatifs de cette étude sont
présentés dans la première partie de ce chapitre. Ils sont
comparés, dans une deuxième partie, aux travaux de même
nature réalisés par d'autres organismes, l'INSEE, le Bureau
d'information et de prévisions économiques (BIPE) et le Centre de
recherches pour l'expansion de l'économie et le développement des
entreprises (REXECODE). Un
tableau
récapitulatif fournit, page
52, les résultats chiffrés de ces différents
exercices.
I. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS D'UNE PROJECTION DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE À L'HORIZON 2003 (réalisée par l'OFCE)
A. LA DEMANDE INTÉRIEURE SOUTIENT LA CROISSANCE
1. Consommation et épargne des ménages
Dans les
modèles macroéconomiques, deux variables déterminent
l'évolution de la consommation des ménages :
- la progression du pouvoir d'achat de leur revenu ;
- l'augmentation des prix, qui se traduit par une diminution de la valeur des
actifs monétaires des ménages et de leur consommation
(" effet d'encaisses réelles ").
• A
court terme
, la consommation des ménages serait
soutenue, selon l'OFCE, par l'accélération de l'évolution
du pouvoir d'achat du
revenu des ménages
. Celui-ci progressant de
3,1 % en 1998 et 2,5 % en 1999, grâce à l'augmentation
de l'emploi et à celle des salaires individuels.
La désinflation et la baisse du chômage alimentent par ailleurs
une baisse du taux d'épargne, de sorte que la consommation des
ménages progresserait sensiblement en 1998 et 1999 : respectivement
+ 3,5 % et + 3 %. (Dans la prévision du Gouvernement
associée au projet de loi de finances pour 1999, l'augmentation de la
consommation est de 3,1 % en 1998 et 2,7 % en 1999).
Ce redressement de la consommation des ménages contrasterait ainsi
avec l'atonie observée depuis 1990 (+ 1,2 % par an en moyenne
de 1990 à 1997). Il serait toutefois insuffisant pour combler le
" déficit de consommation " qui s'est creusé au cours
des dernières années. Selon les modèles
macroéconomiques, ce déficit de consommation, au regard de ses
deux déterminants " traditionnels " rappelés ci-dessus,
serait encore de 5 % environ à la fin de 1999.
• La question que peuvent dès lors se poser les
modélisateurs est de savoir si les ménages combleront sur le
moyen terme
tout ou partie de ce retard de consommation (ce qui
correspondrait à un retour de leur taux d'épargne vers un niveau
plus " normal ").
La projection à moyen terme élaborée cette année
par l'INSEE (et présentée page 47) a
délibérément
un caractère normatif :
elle cherche à explorer un scénario cohérent de comblement
progressif des déséquilibres que connaît aujourd'hui
l'économie française, en raison de la faiblesse de la croissance
depuis le début des années 90.
Selon ce scénario, la consommation des ménages progresserait de
2,9 % par an
en moyenne de 2000 à 2003 et le taux
d'épargne baisserait de 1 point au cours de cette période.
La moitié du déficit de consommation
15(
*
)
accumulé depuis 1990 serait ainsi
comblé.
La projection réalisée par l'OFCE a un caractère plus
tendanciel
16(
*
)
. Pourtant, l'augmentation
de la consommation sur le moyen terme - + 2,6 % par an en
moyenne de 2000 à 2003 - n'y est pas très différente
de celle observée dans la projection de l'INSEE.
Dans les deux exercices en effet, la consommation des ménages est
soutenue par une progression du pouvoir d'achat du revenu des ménages
(+ 2,4 % par an en moyenne de 2000 à 2003 selon l'OFCE et
+ 2,6 % par an en moyenne selon l'INSEE) qui
contraste
avec
l'évolution observée de 1990 à 1997, soit
+ 1,6 % par an en moyenne.
(Les déterminants de l'évolution du pouvoir d'achat des
ménages sont analysés dans le paragraphe suivant : B.
" Le lien croissance, emploi, salaires ").
• Des analyses de nature
socio-démographique
menées par le Bureau d'informations et de prévisions
économiques sur l'évolution à long terme de la
consommation et de l'épargne des ménages, permettent de
compléter l'approche macroéconométrique
développée ci-dessus.
Dans l'analyse macroéconomique traditionnelle de l'épargne
inspirée par KEYNES, l'épargne constitue un
solde
entre le
revenu disponible et la consommation.
Ceci suppose que les ménages font d'abord un choix sur le niveau de
leur consommation puis sur le niveau de leur investissement (en logement
notamment), et que si la totalité de leur revenu n'est pas
absorbée, il reste en solde ce que la Comptabilité nationale
nomme l'épargne financière.
Il résulte de ce raisonnement qu'en phase de ralentissement de la
croissance, et donc des revenus, les ménages puisent dans leur
épargne afin de maintenir le niveau de leur consommation. La baisse du
taux d'épargne a ainsi un effet de
stabilisation
de la
conjoncture (ou " contracyclique ").
Or, la récession de 1993 s'est traduite au contraire par une hausse du
taux d'épargne, surprenante au regard de cette théorie, qui a
contribué à amplifier la contraction de l'activité
(" effet procyclique "). Cela a conduit un certain nombre
d'économistes, en particulier le Bureau d'information et de
prévisions économiques (BIPE), en association avec le Centre de
recherche sur l'épargne (CREP), à " revisiter " les
théories traditionnelles de l'épargne.
Parmi celles-ci, la " théorie du cycle de vie "
17(
*
)
, inspirée de l'approche keynésienne,
stipulait que l'épargne des ménages suivait au cours de leur
existence l'évolution inverse de leurs revenus : croissante tout au
long de l'âge actif avec l'augmentation du revenu liée à
l'avancement, dans le but d'accumuler un patrimoine jusqu'à la retraite,
décroissante après la retraite afin de maintenir leur
consommation.
Les études qui ont conduit à l'élaboration de cette
théorie ont cependant été réalisées dans les
années cinquante, c'est-à-dire avant le plein
épanouissement des régimes de retraite par répartition.
Celui-ci a considérablement accru les revenus des retraités et
aurait ainsi modifié les comportements d'épargne au cours de la
vie. Selon les chercheurs du BIPE et du CREP, le taux d'épargne
croîtrait désormais uniformément avec l'âge. Les
personnes âgées de plus de 60 ans, qui représentent
16 % de la population en France, réaliseraient ainsi plus de
41 % des placements financiers afin, notamment, d'assurer par des
transferts les revenus des générations suivantes.
Cette analyse modifie l'approche usuelle des comportements d'épargne.
Elle a conduit le BIPE à en tirer des hypothèses de nature
macroéconomique sur l'évolution du taux d'épargne (et donc
de la consommation) à moyen terme.
Selon le BIPE, en effet, "
Sur les quinze dernières
années, la répartition du revenu national a favorisé les
ménages âgés, au détriment des jeunes
générations. Entre 1984 et 1995, les ressources par ménage
des plus de 60 ans se sont (...) accrues de 4,2 % l'an, quand celles
des ménages de moins de 30 ans ne gagnaient que 1,1 %,
autrement dit diminuaient avec l'inflation.
" Un certain rééquilibrage devrait s'opérer entre
1997 et 2003, avec une politique fiscale plutôt pénalisante pour
les revenus des retraités et une amélioration des conditions
d'entrée sur le marché du travail.
" Entre 1995 et 2003, les revenus par ménage des moins de
30 ans pourraient progresser de 3,3 % et ceux des ménages de
30 à 45 ans de 2,5 %, quand ceux des ménages de
45 ans et plus ne gagneraient que 2 % l'an ".
Cette amélioration de la position relative des classes d'âge
jeune, à plus faible taux d'épargne, conjuguée à la
moindre progression du revenu des retraités, à forte propension
à épargner, se traduirait ainsi par une
baisse globale du taux
d'épargne
au cours des prochaines années. Celui-ci passerait,
selon le BIPE, de 14,6 % en 1997 à 12,1 % en 2003,
hypothèse qui contribue au
dynamisme de la consommation
à
moyen terme (+ 2,4 % par an en moyenne selon le BIPE).
• Le principal enseignement de ces travaux est leur
convergence
vers un diagnostic d'
inflexion
marquée de l'évolution de
la consommation des ménages au cours des prochaines années, par
rapport à la
tendance
des dernières années.
De 1998 à 2003, la consommation progresserait ainsi de 2,8 % par
an en moyenne selon l'OFCE et de 2,9 % selon l'INSEE, contre 1,2 % de
1990 à 1997. La consommation des ménages contribuerait ainsi
à la
croissance
du PIB à hauteur de 1,9 point par an
en moyenne selon l'OFCE (2 points selon l'INSEE). Il faut rappeler qu'au
cours des années 1990 à 1997, cette contribution de la
consommation à la croissance du PIB a été modeste :
+ 0,7 point par an en moyenne.
Le réalisme de ces scénarios peut être
apprécié à la lumière de deux
considérations :
- la progression de la consommation décrite par ces projections serait
sensiblement
inférieure
à celle observée au cours
des années 1986 à 1990, qui constituent le dernier cycle de forte
croissance de l'économie française (+ 3,2 % par an en
moyenne) ;
- celle-ci est cependant fortement
tributaire
des évolutions de
court terme
. Si, en 1999, la vive progression de l'emploi et la baisse
du chômage ne se prolongeaient pas, l'augmentation du revenu des
ménages et la baisse du taux d'épargne décrites par les
projections seraient fortement
compromises
.
2. L'investissement des entreprises
La
projection élaborée par l'OFCE décrit un " cycle
d'investissement " caractéristique d'une période de reprise
économique, cependant de courte durée. L'amélioration des
perspectives de débouchés en début de période
entraîne un redressement de l'investissement en 1998 et 1999
(respectivement + 6,4 % et + 6 %). Par la suite,
l'évolution de l'investissement se rapprocherait de celle du PIB et se
stabiliserait autour de 3,3 % par an en moyenne.
• Il faut tout d'abord souligner que la reprise
à court terme
de l'investissement ainsi décrite est beaucoup moins dynamique que
celle qu'a pu connaître l'économie française lors
d'épisodes antérieurs de reprise de l'activité : en
1988 et 1989, l'investissement avait ainsi progressé de plus de
10 % chaque année. Inversement, on peut s'inquiéter de la
capacité de résistance de l'investissement des entreprises au
ralentissement de la demande
étrangère
, inquiétude
alimentée par les résultats médiocres des dernières
enquêtes de conjoncture sur l'investissement industriel.
• Dans une réflexion de
moyen terme
, il faut rappeler
que, comme en matière de consommation des ménages,
l'investissement des entreprises souffre d'un " déficit "
important par rapport à l'évolution qui résulterait de ses
deux déterminants traditionnels dans les modèles,
c'est-à-dire l'évolution des perspectives de
débouchés
et les
profits
anticipés par les
entreprises. Le retard d'investissement des entreprises par rapport à
son niveau simulé par les modèles est ainsi de l'ordre de
35 %.
Deux facteurs sont le plus souvent avancés par les économistes
pour expliquer la divergence depuis 1993 entre l'investissement observé
et l'investissement simulé :
- l'attentisme des entreprises, lié aux
incertitudes
sur la
réalisation de l'Union économique et monétaire et aux
perturbations monétaires en Europe (hausse des taux
d'intérêt liée à la réunification allemande,
dévaluation de 1992 et 1995) ;
- l'
endettement
des entreprises, explication qui semblerait
validée par les travaux économétriques de l'INSEE.
Si ces deux facteurs sont effectivement à l'origine de la faiblesse de
l'investissement depuis 1993, l'avènement de l'euro et la poursuite du
désendettement des entreprises, déjà nettement perceptible
depuis quelques années, créeraient les conditions favorables
à un rattrapage à moyen terme du retard d'investissement. C'est
le diagnostic retenu par l'INSEE ; il se traduit par une progression de
5,5 % par an en moyenne de l'investissement entre 2000 et 2003.
Le BIPE, enfin, introduit dans sa prévision l'hypothèse que la
diffusion des nouvelles techniques de consommation et de traitement de
l'information pourrait "
tirer à la hausse
" le nouveau
cycle d'investissement. Cela se traduit en prévision par une progression
annuelle moyenne de l'investissement des entreprises de 5,3 % entre 1998
et 2003.
3. La croissance
La
croissance
du PIB dans la projection de l'OFCE s'élève
à 2,6 % par an en moyenne entre 1998 et 2003, avec un
profil
qui peut être décomposé en trois phases :
- après une croissance du PIB de 2,3 % en 1997, l'activité
s'accélère en 1998 (+ 3,0 %) et en 1999
(+ 2,7 %). Les taux de croissance ainsi affichés par les deux
premières années de la projection sont sensiblement
équivalents
à ceux retenus par le Gouvernement dans les
hypothèses associées au projet de loi de finances pour 1999.
Ce regain de dynamisme s'expliquerait par le redressement de la consommation
des ménages et par l'initialisation d'un nouveau cycle d'investissement
des entreprises, décrits ci-dessus.
- en 2000, la croissance ralentit (+ 2,3 %), en raison du tassement
de la demande intérieure ;
- un retour de l'économie française vers son sentier de
croissance
potentielle
, liée à la reprise de
l'activité chez nos principaux partenaires, s'opère en fin de
projection. La croissance annuelle du PIB sur la période 2001-2003
s'établit à 2,5 % en moyenne.
En termes de
contribution à la croissance
du PIB, le fait le plus
marquant est le redressement de la contribution de la
demande
intérieure
: celle-ci contribue positivement à la
croissance à hauteur de
2,9 points par an
en moyenne, contre
0,5 point par an entre 1991 et 1997. Inversement, la contribution des
échanges extérieurs est négative - - 0,3 point
par an en moyenne - alors qu'elle était positive de 0,7 point
par an entre 1991 et 1997.
La projection décrit ainsi un véritable
basculement
des
moteurs de la croissance, prolongeant l'évolution observée en
1997-1998
18(
*
)
, et un
retour
de
l'économie française à un fonctionnement à la fois
moins
aléatoire
et plus
coopératif
: son
développement s'appuie plus sur son
propre dynamisme
que sur
celui de ses partenaires.
B. LE LIEN CROISSANCE, EMPLOI, SALAIRES
Le redressement de la demande intérieure décrit par la projection trouve essentiellement son origine dans l'accélération des revenus salariaux des ménages (les cotisations sociales, les impôts et les prestations sociales ne joueraient en effet qu'un rôle marginal dans la progression du pouvoir d'achat du revenu des ménages (cf. annexe n° 1 page 86). Celle-ci résulte de l'évolution de l'emploi et des salaires individuels : votre Rapporteur tentera ci-dessous d'éclaircir les liens complexes (dans les modèles tout autant que dans la réalité) entre croissance, emploi et salaires.
1. La productivité du travail
L'évolution de l'emploi résultant du taux de
croissance de l'économie est déterminée, dans une
projection menée à l'aide d'un modèle, par :
- une hypothèse sur la
tendance
d'augmentation de la
productivité
du travail. Celle-ci connaît depuis une
dizaine d'années un ralentissement marqué, au-dessous de 2 %
par an. Depuis quelques années, on observe une rupture de la
productivité du travail par rapport à sa tendance de long
terme : à croissance équivalente, les créations
d'emplois sont aujourd'hui plus importantes que par le passé. Cet
enrichissement du contenu en emplois de la croissance
s'explique
notamment par le développement du temps partiel et par les divers
dispositifs d'allégement des charges sur les bas salaires (ce point est
abordé dans le
chapitre III
, page 63), sans toutefois
épuiser les causes de ce phénomène ;
- un effet du " cycle de productivité " : en
période d'accélération de l'activité, les
entreprises n'ajustent leurs effectifs qu'avec retard (ce qui se traduit par
une hausse transitoire de la productivité, au-dessus de sa
tendance) ; en phase de ralentissement, le retard dans l'ajustement des
effectifs entraîne une hausse transitoire de la productivité.
L'augmentation de la productivité par tête observée dans la
projection de l'OFCE s'élève ainsi à
1,8 % par an
en moyenne : elle se situe ainsi à mi-chemin entre le net
ralentissement observé depuis 1995 (+ 1,5 % par an) et la
tendance observée depuis une dizaine d'années (+ 2,0 %).
Par ailleurs, la projection n'intègre pas de ralentissement
supplémentaire de l'évolution de la productivité par
tête pouvant résulter de la réduction de la durée
légale du travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires :
les experts de l'OFCE, en effet, n'ont pas cherché à simuler
l'impact de cette mesure, compte tenu de la fragilité des
hypothèses - souvent de nature plus microéconomique que
macroéconomique - que cela aurait nécessité
d'intégrer dans la projection.
Néanmoins, on peut considérer que si l'évolution de la
productivité retenue en projection (+ 1,8 % par an en moyenne)
prolonge le ralentissement tendanciel observé depuis une dizaines
d'années, les modélisateurs auraient pu également
extrapoler
sur le moyen terme le fort enrichissement du contenu en
emplois de la croissance observé au cours des dernières
années. Ce choix aurait eu, en projection, des effets plus favorables
à l'évolution de l'emploi. C'est celui qu'a retenu par exemple
l'INSEE dans son scénario de moyen terme.
2. L'évolution de l'emploi
La
projection de l'OFCE décrit une progression de l'emploi total de
1 % par an en moyenne entre 1998 et 2003, soit en moyenne
227 000
créations nettes
d'emplois par an. Il faut rappeler qu'entre 1991 et
1997, l'emploi total avait
diminué
de 0,1 % par an en
moyenne.
Le résultat de la projection de l'OFCE en matière d'emploi tient
compte d'une hypothèse de création de 350 000
" emplois-jeunes " dans le secteur non-marchand. Les auteurs de la
projection ont toutefois considéré que les
créations
nettes
d'emplois induites par le dispositif en faveur des emplois-jeunes
seraient limitées à 80 % des embauches
réalisées (soit 280 000
créations nettes
d'emplois en trois ans) et que les 20 % restants seraient intervenus
même en l'absence de cette mesure (celle-ci générant un
" effet d'aubaine "). La projection retient par ailleurs
l'hypothèse que ces emplois seraient
pérennisés
.
L'hypothèse retenue par l'INSEE, selon laquelle l'enrichissement du
contenu en emplois de la croissance observé au cours des années
récentes serait susceptible de perdurer, se traduit par une
évolution plus favorable de l'emploi total en projection : celui-ci
progresserait ainsi de
240 000 par an
entre 1998 et 2003(cf.
tableau page 35).
3. Les salaires
Le
pouvoir d'achat du salaire par tête
(secteur privé)
progresse dans la projection de l'OFCE de 1,6 % par an en moyenne entre
1998 et 2003. Cette accélération des salaires individuels par
rapport aux années récentes (+ 1 % par an en moyenne de
1991 à 1997) s'explique par la baisse du chômage en début
de période, qui renforce les revendications salariales et se traduit par
une évolution des salaires plus dynamique. On observe en effet cette
relation inverse entre salaires et niveau du chômage - ou " courbe
de Phillips " - dans tous les modèles macroéconomiques.
L'augmentation de l'emploi entraîne par ailleurs une progression du
pouvoir d'achat de la
masse salariale
plus rapide que celle du salaire
par tête. Dans le secteur marchand, celle-ci progresse de 3 % par an
en moyenne, soit
plus rapidement
que le
PIB
marchand
(+ 2,7 % par an en moyenne).
Il en résulte une
déformation
, en faveur des salaires, du
partage de la valeur ajoutée
entre salaires et profits et, par
conséquent, une
baisse du taux de marge
des entreprises de
près de
3 points
entre 1998 et 2003, ce qui traduit une
inflexion
par rapport à l'évolution observée entre
1993 et 1998.
Une baisse du taux de marge des entreprises peut induire des tensions
inflationnistes si les entreprises souhaitent augmenter leurs prix afin de
restaurer leur taux de marge. Lorsqu'elle se produit, cette réaction
peut avoir des effets restrictifs sur l'activité : la hausse des
prix entraîne une hausse du
taux d'épargne
(et une moindre
progression de la consommation des ménages) et dégrade la
compétitivité
. Selon le modèle, toutefois, le taux
de marge ne s'éloigne pas de manière suffisante du niveau
désiré par les entreprises pour produire ce type
d'enchaînement.
Ainsi la projection ne met-elle en évidence que l'effet positif, en
termes de demande, de l'accélération de l'évolution des
revenus distribués.
4. Conclusion
•
Si votre Rapporteur insistait en préambule sur la complexité des
liens entre croissance, emploi et salaires, il doit également souligner
la
fragilité
des évolutions décrites ci-dessus.
Celle-ci tient à la relation entre salaires et inflation telle que la
décrit la projection mais, surtout, à l'évolution de la
productivité
.
Tout d'abord, les projections de l'OFCE et de l'INSEE prolongent sur le moyen
terme le ralentissement de la productivité du travail observé ces
dernières années (de manière plus nette dans le cas de la
projection de l'INSEE). Or, le débat entre économistes sur
l'interprétation du phénomène d'enrichissement du contenu
en emplois de la croissance au cours des années récentes ne
semble pas tranché : celui-ci pourrait correspondre à une
inflexion significative de la
tendance
de croissance de la
productivité par tête,
tout autant
, dans une période
de faible croissance, qu'à une inflexion des
délais
d'ajustement
de l'emploi à la production (c'est-à-dire une
atténuation du " cycle de productivité "). Aussi
faut-il considérer avec prudence l'hypothèse, implicite dans ces
projections, d'un enrichissement
durable
du contenu en emplois de la
croissance.
Par ailleurs, il faut évoquer la forte incertitude, de nature
statistique
, sur l'évolution de la productivité au cours
des années récentes. Par exemple, l'évolution de la
productivité du travail dans les comptes nationaux provisoires pour 1986
était estimée à - 0,1 %, alors que, selon les
comptes définitifs, elle a été en réalité de
+ 3,6 %. Le diagnostic sur l'enrichissement du contenu en emplois de
la croissance pourrait ainsi être atténué au fur et
à mesure des révisions statistiques.
• Au-delà de ces incertitudes, votre Rapporteur considère
que si la projection ne décrit pas l'évolution la plus
probable
à moyen terme de l'emploi, la productivité et les
salaires, elle n'en délivre pas moins un
message
clair :
l'économie française pourrait supporter une évolution plus
rapide des revenus salariaux, de nature à soutenir la demande
intérieure, et sans qu'il en résulte nécessairement des
tensions inflationnistes.
C. LE CHÔMAGE
•
La projection de l'OFCE décrit une progression de l'emploi total de
1 % par an en moyenne entre 1998 et 2003, soit en moyenne
227 000
créations nettes d'emplois
par an
(cf. supra,
page 31).
L'OFCE retient par ailleurs une hypothèse d'augmentation de la
population active
potentielle
, c'est-à-dire la population active
qui serait observée sous le seul effet des tendances
socio-démographiques, de
154 000 par an
.
Toutefois, l'évolution de la population active
effective
diffère sensiblement de celle de la population active potentielle :
en effet, en période d'augmentation de l'emploi, des travailleurs
jusqu'alors " découragés " se présentent sur le
marché du travail, entraînant ainsi une évolution de la
population active observée supérieure à celle de la
population active potentielle.
Ces phénomènes de " flexion des taux
d'activité ", simulés par le modèle, se traduisent en
projection par une augmentation de la population active effective de
198 000 par an
.
Compte tenu de l'évolution respective de l'emploi et de la population
active, le
nombre de chômeurs
diminuerait en moyenne de
30 000 par an
environ sur la période 1998-2003. Cette
diminution serait sensible en début de période
(- 58 000 chômeurs en 1998 et - 119 000
chômeurs en 1999) ; par la suite, le nombre de chômeurs se
stabiliserait et tendrait même à augmenter
légèrement.
Quant au
taux de chômage
, il passerait de 11,5 % en 1998
à 11 % en 2003.
Ces évolutions sont résumés dans le
tableau
ci-après :
EMPLOI ET CHÔMAGE
|
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001-2003* |
|
ÉVOLUTION MOYENNE (en milliers) |
|
|
|
|
|
- Emploi total |
305,3 |
386,5 |
219,1 |
151,9 |
|
- Population active totale |
247,3 |
267,0 |
214,3 |
154,1 |
|
- Nombre de chômeurs |
- 58,0 |
- 119,5 |
- 4,8 |
2,2 |
|
- Taux de chômage (au sens du B.I.T.) |
11,5 |
11,1 |
11,1 |
11,0 |
*
Evolution annuelle moyenne sur la période et niveau en 2003 pour le taux
de chômage.
Source : Modèle MOSAÏQUE - OFCE.
• Dans la projection à moyen terme réalisée par
l'INSEE, le nombre de chômeurs baisse de
120 000 par an
environ entre 1998 et 2003 (cf.
tableau
ci-dessous), soit nettement plus
que dans la projection de l'OFCE (30 000 par an), ce qui ramènerait
le taux de chômage à 9,6 % en 2003 (contre 11 % selon
l'OFCE).
Cet écart ne s'explique que marginalement par l'évolution de
l'emploi : les créations nettes d'emplois dans les deux projections
sont en effet sensiblement équivalentes (+ 240 000 emplois
supplémentaires par an selon l'INSEE, + 227 000 selon l'OFCE).
La différence est essentiellement imputable aux hypothèses
d'évolution de la population active retenues dans les deux exercices.
Selon l'INSEE, en effet, la population active n'augmenterait que de
120 000 par an
environ entre 1998 et 2003, contre 198 000 par
an selon l'OFCE, en raison notamment d'une divergence d'évaluation des
effets de flexion des taux d'activité.
DÉCOMPOSITION DE L'EMPLOI ET DU
CHÔMAGE
SUR
LE MOYEN TERME
(Projection de l'INSEE)
|
(Croissance, en milliers) |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
EMPLOI TOTAL |
300 |
300 |
260 |
182 |
203 |
208 |
|
POPULATION ACTIVE |
140 |
140 |
142 |
121 |
93 |
77 |
|
NOMBRE
DE CHÔMEURS
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TAUX DE CHÔMAGE |
11,9 |
11,4 |
10,8 |
10,6 |
10,1 |
9,6 |
Pour les années 2000 à 2003, source : INSEE.
Pour les années 1998 et 1999, source : Rapport
économique, social et financier annexé au projet de loi de
finances pour 1999 (pages 119 et 120).
• Votre Rapporteur tire deux enseignements de ces comparaisons :
- tout d'abord, il faut regarder les résultats de ces projections en
matière de chômage avec beaucoup de précaution, puisqu'ils
sont tributaires d'hypothèses très incertaines sur
l'évolution de l'offre de travail ;
- par ailleurs, une période très favorable en termes de
créations d'emplois (telle que la décrivent la projection de
l'OFCE et celle de l'INSEE) laisserait, dans les meilleurs hypothèses
sur l'évolution de la population active, le taux de chômage autour
de 10 %. Ceci permet de souligner le niveau atteint par le
chômage structurel
en France, c'est-à-dire le chômage
lié aux caractéristiques profondes du fonctionnement du
marché du travail
19(
*
)
. Celui-ci est
pratiquement trois fois plus élevé qu'au début
années 70 (où il se situait aux alentours de 3-4 %) et
beaucoup plus important que chez la plupart de nos partenaires. Ce constat
justifie l'attention particulière qui sera réservée dans
le
chapitre III
à la question du coût du travail et des
cotisations sociales à la charge des employeurs.
D. LES TENDANCES DES FINANCES PUBLIQUES
Le modèle MOSAÏQUE de l'OFCE ne permet qu'une approche globale des finances publiques. Il a été néanmoins demandé aux experts de l'OFCE d'en tirer le maximum d'indications sur l'évolution détaillée des finances publiques (présentée dans l' annexe n° 1 ). Votre Rapporteur s'attachera ci-après à décrire celles qui lui paraissent les plus significatives.
1. Les hypothèses relatives aux dépenses
La
définition des hypothèses sur l'évolution des
dépenses publiques présuppose :
- un
pronostic
sur l'orientation
délibérée
de la politique budgétaire et l'évolution des dépenses
publiques autres que les prestations sociales (masse salariale publique,
dépenses courantes et investissements des administrations) ;
- un
diagnostic
sur l'évolution
tendancielle
des
prestations sociales
, dont l'évolution à moyen terme est
plus difficile à maîtriser par les pouvoirs publics.
• Sur le premier point, les experts de l'OFCE ont retenu
l'hypothèse d'un léger ralentissement de l'évolution des
dépenses publiques
(
hors prestations sociales)
:
celles-ci progresseraient en francs constants de 2,1 % par an en moyenne
de 1998 à 2003, contre 2,2 % de 1991 à 1997.
Surtout, les dépenses publiques (hors prestations sociales)
augmenteraient en projection
moins vite
que le PIB (+ 2,6 %
par an en moyenne), alors que sur la période 1991-1997, leur progression
a été sensiblement plus rapide que celle du PIB (2,2 %
contre 1,3 %). Néanmoins cette hypothèse d'augmentation des
dépenses publiques traduit une
inflexion
par rapport aux
contraintes imposées au cours des trois dernières années
(1995, 1996 et 1997). Ceci est particulièrement vrai de
l'évolution de la
masse salariale publique
: l'OFCE a ainsi
supposé que l'augmentation annuelle moyenne des effectifs publics
(+ 40.000 par an) se prolongerait à l'horizon 2003 et que le
pouvoir d'achat de l'indice brut des traitements de la fonction publique
augmenterait de 0,7 % par an en moyenne de 1999 à 2003
(après - 0,7 % en 1996 et 1997). La masse salariale publique
augmenterait ainsi en francs constants de 2,7 % par an en moyenne entre
1998 et 2003, contre 2,4 % par an de 1991 à 1997.
• L'évolution à moyen terme des
prestations
sociales
est conditionnée par la réponse à la question
suivante : le ralentissement très marqué de
l'évolution des
prestations maladie
entre 1991 et 1997
(+ 0,5 % en
pouvoir d'achat
en 1997, et + 1,9 % par
an en moyenne de 1991 à 1997) sera-t-il durable ?
L'évolution observée au cours des six dernières
années semble obéir à deux facteurs :
- la mise en oeuvre de
plans de maîtrise
des dépenses de
santé qui ont produit des
effets immédiats
: les
prestations-maladie n'ont ainsi progressé en pouvoir d'achat que de
0,8 % en 1994 et de 0,5 % en 1997 ;
- le ralentissement de la croissance et du
revenu
des ménages au
cours de cette période, qui a contribué au ralentissement de la
consommation des soins médicaux.
Les auteurs de la projection ont considéré que les
réformes successives depuis le " Plan Juppé " jusqu'au
projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999
(qui ne se limitent pas à une réduction des remboursements mais
mettent en oeuvre une nouvelle politique de gestion des soins) pourraient
infléchir durablement la tendance de l'augmentation des dépenses
de santé. Mais, par ailleurs, l'accélération de la
croissance et du
revenu
des ménages, observée en
projection, se traduirait par une évolution plus rapide de la
consommation médicale
qu'au cours des années
récentes. Cette analyse s'appuie notamment sur l'évolution
observée en 1998, année de forte reprise économique :
la prolongation des résultats des premiers mois conduit en effet
à retenir une hypothèse de croissance en volume des
prestations-maladie de 3,4 % sur l'ensemble de l'année.
Les experts de l'OFCE ont ainsi retenu une évolution du pouvoir d'achat
des dépenses maladie supérieure à celle de la
période antérieure, soit
2,7 % par an
en moyenne de
1998 à 2003 (contre 1,9 % par an de 1991 à 1998).
Le choix de cette hypothèse obéit au caractère
délibérément tendanciel de cet exercice. Il accroît
cependant, en projection, les contraintes de financement du régime
d'assurance-maladie.
2. L'équilibre à moyen terme des régimes sociaux
Malgré le diagnostic des experts de l'OFCE sur une
accélération de l'évolution des prestations-maladie au
cours des prochaines années par rapport à la période
récente, d'autres facteurs concourent cependant, en projection, au
ralentissement
global de l'
ensemble des prestations
sociales
: la baisse du chômage qui se traduit par un freinage
des dépenses d'indemnisation ; la moindre progression du nombre de
retraités
en raison de l'arrivée à l'âge de
la retraite des classes creuses des années 1940 à 1943 ; le
ralentissement démographique, enfin, qui entraîne un
ralentissement de la masse des prestations familiales.
Au total, le pouvoir d'achat de l'
ensemble
des
prestations
sociales
augmenterait de
2,3 % par an
en moyenne de 1998
à 2003 (contre 2,6 % par an de 1991 à 1997).
L'augmentation annuelle moyenne des prestations sociales
en valeur
entre
1998 et 2003 (3,6 %) serait ainsi
inférieure
à celle
du PIB en valeur (3,9 %) et à celle de la
masse salariale
en
valeur, qui progresse en projection légèrement plus vite que le
PIB (4,1 %).
Ainsi, l'équilibre à moyen terme des comptes sociaux serait
atteint
sans apport de recettes
supplémentaires.
3. Le besoin de financement des administrations publiques et la dette publique
•
Exprimé en pourcentage du PIB, le
besoin de financement
des
administrations publiques (au sens de la Comptabilité européenne)
se
réduit
en projection de
1,8 point
entre 1997 et
2003, pour atteindre
1,2 % en 2003
.
Le
tableau
figurant dans l'
encadré
ci-dessous
décrit la variation du déficit public et analyse les
différentes
contributions
à cette variation.
|
|
|||||||||||
|
En % |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Ratio déficit / PIB (au sens de Maastricht) |
5,6 |
5,8 |
4,9 |
4,1 |
3,0 |
2,9 |
2,3 |
1,9 |
|
1,5 |
1,2 |
|
Variation du ratio déficit/PIB (au sens de la Comptabilité nationale) par rapport à l'année précédente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dont : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
effet du taux de pression fiscale |
- 0,4 |
- 0,1 |
- 0,5 |
- 1,3 |
- 0,5 |
+0,0 |
- 0,2 |
- 0,2 |
+ 0,0 |
+0,1 |
+0,1 |
|
effet de l'écart de croissance du PIB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
effet de l'écart de croissance des dépenses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
effet des charges d'intérêt |
+0,3 |
+0,2 |
+0,2 |
- 0,1 |
- 0,2 |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,1 |
|
Source :Comptabilité nationale, prévisions OFCE, modèle MOSAÏQUE. |
|||||||||||
|
La deuxième ligne décrit la variation du ratio déficit public/PIB au sens de la Comptabilité nationale par rapport à l'année précédente. Cette ligne peut ainsi ne pas être cohérente avec la ligne précédente en raison de la mesure différente du ratio de déficit public selon la Comptabilité nationale et selon la Comptabilité européenne (comptabilisation différente des coupons courus sur les obligations d'Etat, des opérations de crédit-bail des administrations, des avances accordées par l'Etat aux entreprises du secteur aéronautique et, enfin, de certaines opérations des hôpitaux publics). |
|||||||||||
Les lignes suivantes décrivent les
différentes
contributions
à la variation du ratio de déficit public,
mesuré au sens de la Comptabilité nationale. Un signe
-
traduit une contribution à la
réduction
du ratio de
déficit public. Une signe
+
traduit une contribution à
l'
augmentation
du déficit public.
La
troisième ligne
met en évidence l'incidence de
l'augmentation des
taux d'imposition
décidés de 1993
à 1997, sur la réduction du déficit public.
La
quatrième ligne
montre l'effet de la divergence entre la
croissance
effective
et la croissance
potentielle
de
l'économie française (évaluée ici à
2,5 % par an). Cette ligne permet d'analyser l'
incidence de la
conjoncture
sur le déficit public. Sur la période
1993-1997
, la croissance de l'économie française est
inférieure à son potentiel (excepté en 1994), ce qui
contribue à l'
augmentation
du déficit public (notamment en
1993). La croissance des années 1998 et 1999 résultant de la
projection de l'OFCE est favorable à la réduction du ratio de
déficit public. Le ralentissement en fin de période contribue au
contraire à son augmentation.
La
cinquième ligne
décrit l'effet de l'écart
entre l'évolution des dépenses publiques et la croissance
potentielle du PIB. C'est une façon d'apprécier l'incidence de
l'
orientation délibérée de la politique
budgétaire
. Une augmentation des dépenses publiques
inférieure à la croissance potentielle du PIB contribue ainsi
à la
réduction
du ratio de déficit public. C'est le
cas pour toutes les années présentées dans le tableau,
à l'exception de 1993, 1996 et 1998.
La
sixième ligne
montre enfin l'incidence de
l'évolution des
charges d'intérêt
. Celle-ci
contribue nettement à l'aggravation du ratio de déficit public de
1993 à 1995, en raison de l'augmentation de la dette publique et de la
hausse des taux d'intérêt. En projection (1998-2003), les charges
d'intérêt baissent en pourcentage du PIB et contribuent de
manière régulière à la diminution du
déficit.
On peut déduire du tableau ci-dessus que, compte tenu des
hypothèses relatives aux dépenses publiques qui progressent en
projection moins rapidement que la
croissance potentielle
du PIB
(évaluée ici à 2,5 %, ce qui correspond à
l'extrémité haute de la fourchette des estimations de croissance
potentielle généralement proposées), l'
orientation
délibérée
de la politique budgétaire
contribuerait, dans la projection de l'OFCE, à la réduction du
déficit public (de l'ordre de 0,2 point de PIB par an).
De même, la réduction des charges d'intérêt en
pourcentage du PIB (cf. infra) concourrait à la réduction du
déficit public (de 0,1 point de PIB par an).
En revanche, on peut observer à la lecture de ce tableau que, de
manière quelque peu surprenante, l'accélération de la
croissance ne constituerait pas un facteur important de réduction du
déficit public. Ceci peut s'expliquer notamment par
l'
évaluation
très haute de la
croissance
potentielle
par les experts de l'OFCE, soit 2,5 %. En
conséquence, la croissance annuelle du PIB en projection (2,6 %)
n'est pas très différente de la croissance potentielle ainsi
estimée.
Au total, l'
incidence de la conjoncture
sur la réduction du
déficit public (y compris, à taux de pression fiscale constant,
l'effet de l'accélération des recettes fiscales) serait, selon
ces calculs, pratiquement
nulle
.
• Selon les auteurs de la projection, la
dette
des
administrations publiques exprimée en pourcentage du PIB passerait de
57,7 % en 1997 à 58,4 % en 1998 et 58,6 % en 1999.
A partir de 2000 toutefois, les administrations publiques dégageraient
un
excédent primaire
- c'est-à-dire hors charges
d'intérêts - suffisant pour stabiliser, puis réduire
le ratio dette/PIB. Celui-ci passerait ainsi de 58,5 % en 2000 à
56,3 % en 2003.
L'incidence favorable de l'hypothèse d'une baisse des taux
d'intérêt et de la réduction du ratio de dette publique
permet une diminution de la
charge nette des intérêts
versés par les administrations publiques, exprimée en pourcentage
du PIB : celle-ci passerait de 3,2 % en 1998 à 2,7 % en
2003.
Il faut observer que ces évolutions sont étroitement
dépendantes
: la réduction du déficit public
et des taux d'intérêt permet une diminution du ratio de dette
publique, laquelle se traduit par une baisse de la charge
d'intérêts en pourcentage du PIB, qui entraîne une
augmentation de l'excédent budgétaire primaire et une baisse de
la dette publique, etc. Ces évolutions
illustrent
, à
rebours, le caractère
cumulatif
de la dette publique : en
effet, si une seule des évolutions décrites par la projection
venait à s'inverser (ralentissement de la croissance, hausse du
déficit public ou hausse des taux d'intérêt, par exemple),
l'ensemble des relations détaillées ci-dessus s'en trouveraient
inversées.
4. Conclusions
•
Les remarques qui précèdent permettent de rappeler la
complexité
de l'évolution des finances publiques. Celle-ci
est en effet aussi
dépendante
de l'orientation
délibérée de la politique budgétaire que de
l'environnement macroéconomique.
Une projection réalisée à l'aide d'un modèle
macroéconomique permet précisément d'illustrer cette
complexité et, notamment, l'
interaction
entre l'évolution
des finances publiques et celle de la croissance.
Dans la projection réalisée par l'OFCE, on peut considérer
que cette interaction est particulièrement
favorable
: le
redressement des comptes publics se produit sans pénaliser la croissance
à moyen terme ; inversement, l'accélération de la
croissance permet un rééquilibrage des finances publiques sans
contrainte majeure sur les dépenses.
Evidemment, cet
équilibre
serait
rompu
si la croissance
était, au cours des prochaines années - et notamment en
début de période -, inférieure à celle
décrite par la projection. L'
encadré
figurant à la
fin de ce chapitre permet d'illustrer l'
impact
sur le solde public d'une
contraction
de l'activité selon qu'elle résulte d'un
freinage de la demande étrangère ou d'un ralentissement de la
consommation des ménages
20(
*
)
.
• L'incertitude sur la croissance à court terme de
l'économie française et sur le réalisme de la
prévision associée au projet de loi de finances pour 1999 a
contribué à alimenter un débat sur l'
orientation
de
la
politique budgétaire
. Certains considèrent ainsi que
celle-ci est insuffisamment rigoureuse : toute détérioration
de l'environnement macroéconomique par rapport aux prévisions
entraînerait une dégradation du déficit public et
conduirait à envisager des mesures de redressement budgétaire,
afin de préserver l'objectif initial de déficit public, ces
mesures entraînant une contraction supplémentaire de
l'activité... D'autres avancent qu'une politique budgétaire plus
rigoureuse compromettrait la reprise et la réalisation de l'objectif de
déficit public.
Votre Rapporteur estime que le débat ainsi posé ne l'est pas dans
les meilleurs termes : une politique budgétaire plus
active
aurait en effet consisté, dans une
période de reprise
,
à fixer un objectif
ex ante
de
réduction
du
déficit public - et de
maîtrise
des
dépenses -
plus ambitieux
que celui figurant dans le projet
de loi de finances pour 1999, quitte à relâcher la contrainte
budgétaire en cas de ralentissement de la croissance, et à
accepter un déficit public
ex post
plus élevé que
l'objectif initial.
• Si ces réflexions sont inspirées par des
considérations de court terme, elles s'imposent également dans
une perspective de moyen terme. On note à cet égard dans la
projection de l'OFCE, que le déficit public serait ramené en 2003
à 1,2 % du PIB. Ce résultat paraît satisfaisant eu
égard à la situation de départ (3 % en 1997). Il
l'est moins si l'on considère que l'économie française se
trouverait en 2003 au terme d'une période de croissance, certes
inférieure à celle de la reprise cyclique de la fin des
années 80 (+ 3,2 % par an en moyenne), mais néanmoins
supérieure à sa croissance tendancielle. Ainsi devrait-elle
affronter un éventuel retournement conjoncturel avec un déficit
public de même importance, pour mémoire, que celui qu'elle
connaissait avant la récession de 1993... Ainsi votre Rapporteur
considère-t-il que le redressement souhaitable des finances publiques
sur le moyen terme devrait être plus substantiel que celui que
décrit la projection.
Pour que la politique budgétaire puisse avoir un effet
contracyclique
dans une période de ralentissement conjoncturel,
il faut également qu'elle s'assigne cet objectif dans une période
d'accélération de la croissance.
ENCADRÉ N° 2
INCIDENCE SUR LES
FINANCES PUBLIQUES D'UNE CROISSANCE PLUS FAIBLE
Cet
encadré a pour but d'illustrer, au moyen du modèle MOSAÏQUE,
l'impact sur le déficit public d'une diminution du taux de croissance de
l'économie.
La principale difficulté de cet exercice tient aux modalités
selon lesquelles on simule à l'aide du modèle, un taux de
croissance plus faible.
Celui-ci pourrait, par exemple, résulter d'une hypothèse de
ralentissement de la
croissance de nos partenaires
, donc de la demande
étrangère adressée à la France. Un taux de
croissance inférieur pourrait également être obtenu
grâce à une hausse du taux d'épargne des ménages,
qui se traduirait par une moindre progression de la
consommation des
ménages.
Mais les hypothèses qui permettent de simuler un ralentissement de la
croissance (baisse de la demande étrangère ou baisse de la
consommation des ménages) ont une influence différente sur les
finances publiques :
- une croissance freinée par les échanges extérieurs
pénalise les exportations, lesquelles ne sont pas assujetties à
la TVA, alors qu'une diminution de la consommation diminue au contraire les
recettes de TVA ;
- le ralentissement de la consommation des ménages pénalise plus
le secteur des services, et la diminution de la demande étrangère
le secteur industriel ; les services étant relativement plus riches en
main-d'oeuvre que l'industrie, l'emploi et les cotisations sociales
évoluent plus défavorablement dans le premier cas.
Le
tableau ci-dessous
présente les résultats de deux
simulations réalisées avec MOSAÏQUE.
Les résultats sont présentés à 1 an, 2 ans et 5
ans pour un
niveau
de PIB inférieur de 1 % à la
situation de référence pour chacune de ces trois dates. La
dernière colonne donne l'impact au terme de cinq ans dans
l'hypothèse d'un taux de croissance inférieur
d'un point
chaque année
tout le long de la période.
On peut en déduire qu'une diminution de 1 % du PIB à cinq
ans entraîne une hausse de 0,8 point du ratio déficit
public/PIB si la croissance est due à une baisse de la consommation des
ménages.
Toutefois cette variante a surtout un intérêt analytique, car en
réalité, l'impact sur les importations d'une diminution de la
consommation entraîne une accélération progressive du PIB.
La simulation d'une diminution de la demande extérieure est en fait
plus proche d'une hypothèse de croissance plus faible de un point par
an, mais équilibrée. Il est possible d'en retenir l'idée
que 1 % de PIB en moins à cinq ans entraîne une hausse de
0,4 point du ratio déficit public/PIB, et qu'un taux de croissance
inférieur de un point par an pendant cinq ans se traduit par une
dégradation d'environ 4 points du ratio déficit
public/PIB.
Impact d'une croissance moindre sur le solde public (en % du PIB)
|
|
Impact
d'une diminution de
|
Impact
d'un taux de croissance inférieur de
|
||
|
|
à 1 an |
à 2 ans |
à 5 ans |
|
|
Hypothèse de
ralentissement
|
|
|
|
|
|
Hypothèse de
ralentissement
|
|
|
|
|
II. SYNTHÈSE COMPARATIVE DES PRÉVISIONS À MOYEN TERME
La
projection de l'OFCE, telle qu'elle vient d'être présentée
constitue une extrapolation des tendances à l'oeuvre dans
l'économie française, sur la base d'une prolongation des
comportements observés sur le passé. Cela peut être
considéré comme une limite de ce genre d'exercice, dans la mesure
où il pose plus de questions pour le moyen terme qu'il n'apporte de
réponses. Mais ceci obéit également à ce que votre
Rapporteur considère comme la finalité des projections
réalisées à l'aide de modèles. Ceux-ci offrent en
effet un cadre global où les évolutions et les comportements
macroéconomiques sont cohérents entre eux : en cela, ils
constituent à tout le moins un instrument d'analyse utile pour les choix
de politiques économiques.
Les travaux présentés ci-après procèdent d'une
autre logique et recourent à d'autres méthodes.
Tout d'abord, la projection à moyen terme réalisée par
l'
INSEE
, dont quelques éléments significatifs ont
été évoqués ci-dessus, vise à explorer un
scénario cohérent de
comblement progressif des
déséquilibres
que connaît l'économie
française à la suite des années de faible croissance de
1990 à 1996. Ce scénario, qui ne peut être
considéré comme une prévision, repose ainsi sur diverses
hypothèses favorables d'inflexion des comportements observés sur
la période récente et en stimule les effets.
Les travaux à moyen terme de deux organismes, dont le Sénat suit
régulièrement les travaux, sont également
résumés ci-dessous : il s'agit des
prévisions
,
réalisées hors modèle et " à dire
d'expert ", du
Centre de recherches pour l'expansion de
l'économie et le développement des entreprises (REXECODE)
et
du
Bureau d'informations et de prévisions économiques
(BIPE)
.
A. LE SCÉNARIO RETENU PAR L'INSEE
L'INSEE
a réalisé au mois de juin dernier une projection à moyen
terme (1998-2003) de l'économie française qui explore les
modalités d'un retour de la production à sa tendance de long
terme et d'une résorption des déséquilibres du
marché du travail.
Les deux premières années (1998-1999) correspondaient aux
prévisions officielles du Gouvernement du printemps dernier
(+ 3 % pour la croissance en 1998 et + 2,8 % en 1999). On
ne présente donc ici que la projection pour la période de moyen
terme (2000-2003).
Celle-ci décrit une stabilisation de la croissance
légèrement au-dessous de 2,9 % à partir de 2000 et
jusqu'en 2003. Sur la période de moyen terme, la croissance annuelle
moyenne serait donc sensiblement plus élevée que dans les autres
prévisions, ce qui permettrait de
résorber
les marges de
croissance aujourd'hui
inutilisées
: le PIB se rapprocherait
de son
niveau potentiel.
Ce scénario juxtapose l'hypothèse d'une politique
budgétaire qui resterait restrictive et celle d'un environnement
international bien orienté à moyen terme, en dépit de la
crise asiatique. Il retient des hypothèses cruciales sur l'inflexion des
comportements des agents privés (ménages et entreprises) par
rapport à ceux de la période 1990-1996 :
- Les conditions seraient favorables à un rattrapage de retard
accumulé en matière d'
investissement
depuis le
début des années 90 ; d'une part, l'achèvement du
processus d'unification monétaire en Europe contribuerait à
diminuer l'incertitude et à accroître la rentabilité
attendue de l'investissement ; d'autre part, "
la situation
financière des entreprises devrait s'améliorer "
(selon
l'INSEE) ce qui entraînerait une baisse de leur
taux d'endettement
et une reprise de l'investissement ; l'investissement des entreprises
croîtrait ainsi de 5,5 % par an en moyenne sur la période de
moyen terme.
- Selon l'INSEE, "
la consommation est depuis quelques années
inférieure à ce qu'on pourrait attendre au vu de
l'évolution du pouvoir d'achat des ménages et des prix (...). Ce
sont près de 5 % de sous-consommation qui restent
inexpliqués (...). "
Dans un tel contexte, la projection de l'INSEE retient un rattrapage partiel de
ce déficit. La consommation des ménages s'accroîtrait alors
de 2,9 % par an sur la période de moyen terme ;
parallèlement, leur taux d'épargne passerait de 14,8 % en
1999 à 13,8 % en 2003 .
Ce scénario, que la baisse du chômage ne suffirait pas à
expliquer, est ainsi qualifié de "
volontariste
" par
l'INSEE.
Son aspect le plus marquant - et même surprenant -
réside certainement dans l'évolution du chômage : le
nombre de chômeurs diminuerait régulièrement, de l'ordre de
100 000 par an en moyenne. Le taux de chômage passerait ainsi de
11,9 % en 1998 à 9,6 % en 2003. Il faut néanmoins
remarquer que la projection réalisée l'année
dernière à la même époque affichait, malgré
un scénario de
croissance très proche
, un taux de
chômage de 11,6 % en
2002
, contre 10,1 %
également en 2002 dans le scénario présenté cette
année.
Cette différence s'explique essentiellement par l'inflexion des
hypothèses d'évolution de la population active d'une année
sur l'autre : dans l'exercice réalisé cette année, la
population active est supposée augmenter de 110 000 par an, alors
que cette augmentation était évaluée l'année
dernière à 150 000 par an. L'hypothèse retenue cette
année a évidemment une incidence nettement plus favorable sur
l'évolution du chômage.
Il y a donc sur ce point une incertitude qui brouille l'analyse sur
l'évolution à moyen terme du chômage et qui
mériterait d'être éclaircie par les économistes.
Il n'en reste pas moins qu'à l'horizon de la projection
réalisée cette année par l'INSEE, dont le caractère
" volontariste " a été souligné, et au terme
d'une période de forte croissance, le taux de chômage est encore
proche de 10 %, ce qui donne une indication du niveau du chômage
structurel en France (cf. page 35).
B. LA PRÉVISION DE REXECODE
La
prévision pour la période 1998-2003, présentée par
l'Institut de conjoncture REXECODE au printemps dernier, se situe en termes de
croissance au bas de la " fourchette " des prévisions
nationales à moyen terme (cf.
tableau
récapitulatif, page
52).
REXECODE confirme certes le diagnostic d'un
redémarrage
à
court terme de l'activité, en France comme dans la plupart des pays
européens. Celui-ci serait toutefois moins fort que dans les autres
prévisions.
A
moyen terme
, la France reviendrait sur un sentier de croissance de
2,2 % par an. Son potentiel de croissance à moyen terme serait
affecté, comme celui de l'ensemble des
économies
européennes
, par deux facteurs :
- une
compétitivité
structurelle de l'offre insuffisante,
en raison de la médiocre compétitivité technologique et de
coûts unitaires de production nettement supérieurs à ceux
des Etats-Unis ;
- le début du
déclin démographique
; le
ralentissement de l'augmentation de la population entraînerait un
fléchissement tendanciel de la croissance économique ; de
plus, en termes de demande, la population " en âge de premier
équipement " diminuerait sensiblement au cours des cinq prochaines
années.
Enfin, la prévision décrit une légère baisse du
taux de chômage : de 11,9 % en 1999 à 11,1 % en
2002.
C. LA PRÉVISION DU BIPE
La
prévision à moyen terme (1998-2003), présentée par
le BIPE au mois de septembre dernier, offre des résultats assez proches
de ceux de la projection de l'OFCE décrite dans ce chapitre.
Le taux de croissance annuel moyen s'élève à 2,6 %,
comme dans la projection de l'OFCE, et l'activité y est également
soutenue par la
demande intérieure
.
Trois paramètres devraient contribuer, selon le BIPE, à ce
"
cheminement favorable
" de l'économie
française et de l'ensemble des économies européennes :
• le lancement de l'
euro
qui stabilise le marché
financier européen ;
• les effets induits par le
retournement du marché du travail
et l'augmentation de l'emploi, qui devraient se traduire par des
comportements de consommation plus favorables ;
• la diffusion des
nouvelles technologies
de l'information qui
contribueront au soutien de l'investissement des entreprises.
La prévision du BIPE se caractérise par un profil très
marque :
- la croissance serait soutenue jusqu'en 2001 (+ 3 % par an en
moyenne) ;
- un net ralentissement, de nature cyclique, se produirait en 2002
(+ 1,9 %), avant une légère reprise en 2003
(+ 2,2 %).
Par ailleurs, la baisse du taux d'épargne est, dans la prévision
du BIPE, beaucoup plus sensible (de 14,3 % en 1998 à 12,1 % en
2003) que dans les autres exercices. Elle s'explique par les
considérations, de nature
démographique
, sur
l'épargne des ménages évoquées aux pages 25 et 26.
Enfin, le taux de chômage baisserait : de 11,9 % en 1998
à 9,7 % en 2003, ce qui correspond à une baisse du nombre de
chômeurs de 110 000 par an d'ici 2003.
Malgré le niveau encore relativement élevé du
chômage en fin de période, le BIPE considère
néanmoins que des " risques de pénurie de main-d'oeuvre
qualifiée " pourraient apparaître.
Les principaux résultats des scénarios de moyen terme qui
viennent d'être présentés sont décrits dans le
tableau récapitulatif
ci-dessous.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRINCIPAUX SCÉNARIOS
MACROÉCONOMIQUES
DE MOYEN TERME
|
|
OFCE*
|
INSEE
|
REXECODE**
|
BIPE***
|
|
TAUX ANNUELS MOYENS |
1998 - 2003 |
1998 - 2003 |
1998 - 2002 |
1998 - 2003 |
|
VOLUMES (évolution en %) |
|
|
|
|
|
PIB |
2,6 |
2,9 |
2,4 |
2,6 |
|
Importations |
6,1 |
5,2 |
6,2 |
6,2 |
|
Exportations |
5,4 |
5,2 |
5,9 |
5,9 |
|
Consommations des ménages |
2,8 |
2,7 |
2,4 |
2,4 |
|
Investissement des entreprises |
4,2 |
5,1 |
3,6 |
5,2 |
|
Investissement logement |
1,3
|
- |
0,8 |
2,2 |
|
PRIX (évolution en %) |
|
|
|
|
|
PIB |
1,3 |
1,7 |
1,3 |
|
|
Prix à la consommation |
1,3 |
1,7 |
1,4 |
1,6 |
|
COMPTE DES MÉNAGES EN POUVOIR D'ACHAT |
|
|
|
|
|
Revenu disponible brut (Evolution en %) |
|
|
|
|
|
Taux
d'épargne moyen
|
|
|
|
|
|
EMPLOI
SALARIÉ
|
|
|
|
|
|
EMPLOI
TOTAL
|
|
|
|
|
|
TAUX DE
CHÔMAGE
|
11,0
|
9,6 |
11,1 |
9,7 |
*
Observatoire français des conjonctures économiques.
** Centre de Recherches pour l'expansion de l'économie et le
développement des entreprises.
*** Bureau d'Informations et de Prévisions économiques.
CHAPITRE III
PERSISTANCE DU CHÔMAGE,
COÛT DU TRAVAIL ET FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE
Le
débat relatif aux liens entre le financement de la protection sociale et
l'emploi est né dans les années 1980 de deux
préoccupations : d'une part, " l'effet de ciseaux "
résultant pour la Sécurité sociale de la divergence entre
la faible croissance de l'assiette des cotisations et le dynamisme des
dépenses ; d'autre part, la persistance d'un taux de chômage
élevé, notamment pour les salariés les moins
qualifiés, qui semblent victimes d'un biais du progrès technique
en leur défaveur.
Ces deux évolutions ont donné lieu dans un premier temps à
deux types de réponse : d'un côté, pour faire face aux
difficultés de financement de la sécurité sociale, le
remplacement d'une part croissante des cotisations sociales par la
CSG
,
prélèvement à l'assiette plus large ; de l'autre,
pour faire face au chômage des salariés peu qualifiés, le
développement, à partir de 1993,
d'allégements de
charges
sur les bas salaires. Ces dispositifs recueillent désormais
un certain consensus.
Les débats sur les modalités de financement de protection
sociale et les allégements de charges les plus favorables à
l'emploi sont toutefois plus que jamais d'actualité : d'une part,
les efforts de maîtrise des finances publiques entrepris depuis plusieurs
années et le dynamisme des recettes fiscales et sociales ouvrent
aujourd'hui la possibilité de réformer et d'alléger les
prélèvements obligatoires ; d'autre part, la lenteur du
reflux du chômage dans des projections de moyen terme optimistes, comme
celles qui sont présentées dans les chapitres
précédents, invite à utiliser ces marges de manoeuvre pour
favoriser l'emploi.
C'est pourquoi votre Rapporteur essaiera dans ce chapitre de proposer quelques
éclairages issus de l'analyse économique sur les relations entre
le coût du travail et l'emploi, sur les effets des allégements de
charges sociales, enfin sur les liens entre les modalités de financement
de la Sécurité sociale et l'emploi.
I. COÛT DU TRAVAIL ET EMPLOI
A. LA DÉTERMINATION DU " BON NIVEAU " DU COÛT DU TRAVAIL EST MALAISÉE
•
D'un côté, un coût du travail " trop
élevé " se traduit par des prix à la production
excessifs, donc par une perte de
pouvoir d'achat
pour les consommateurs
et une perte de
compétitivité-prix
pour les entreprises,
deux évolutions qui réduisent la demande adressée aux
entreprises, donc l'
emploi.
De l'autre, le " coût du travail " constitue un
revenu
,
éventuellement différé ou redistribué dans le cas
des cotisations sociales. Dès lors, un coût du travail
élevé est aussi un soutien pour la
demande
intérieure et le reflet d'un haut
niveau de vie
21(
*
)
.
• Par ailleurs, le coût du travail doit être
rapporté à la
productivité
de la main-d'oeuvre
employée, le rapport entre ces deux grandeurs déterminant le
" coût salarial unitaire ", c'est-à-dire le coût
des rémunérations du travail pour une unité produite.
Le coût du travail est, en France, parmi les plus élevés
des pays de l'OCDE, mais la productivité y est également
très élevée. Au total, les
comparaisons
internationales
de coût salarial unitaire placent ainsi la France
dans une position moyenne. Ces comparaisons soulèvent toutefois deux
difficultés
:
- en premier lieu, le
lien
entre
productivité et
coût
/ rémunération du travail n'est pas
univoque
à l'échelle macroéconomique : certes,
d'un côté une productivité élevée permet une
rémunération élevée ; mais, de l'autre, un
coût du travail très élevé est susceptible de
sélectionner les entreprises, les activités, et les
salariés à forte productivité, donc de se traduire par une
productivité moyenne élevée, mais au prix de
l'éviction du marché du travail des salariés les moins
qualifiés et des activités " peu productives ". C'est
cette seconde interprétation qui est privilégiée dans des
travaux récents mettant en évidence, pour la France, la faiblesse
de l'emploi dans les services aux personnes ou le commerce de
détail
22(
*
)
;
- en second lieu, l'interprétation des comparaisons internationales de
coût du travail est délicate en raison de la volatilité des
taux de change, des différences de structure d'emploi et de
qualification, enfin de la diversité des systèmes de
prélèvements obligatoires (les rémunérations sont
en apparence plus élevées dans les pays où la protection
sociale est financée en tout ou partie par des impôts, et non par
des cotisations sociales).
B. LES SPÉCIFICITÉS DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE AU REGARD DU COÛT DU TRAVAIL
•
En dépit des allégements de charges sur les bas salaires mis en
oeuvre depuis 1993, le
coût
salarial minimum
se situe en
France à un niveau encore relativement élevé par rapport
aux autres grands pays industrialisés. En outre, les seuls pays
où le coût salarial minimum est plus élevé qu'en
France se distinguent ou bien par un taux de chômage également
plus élevé (ainsi la Belgique), ou bien par la faible proportion
de travailleurs non diplômés dans leur population active (ainsi
l'Allemagne et les Pays-Bas
23(
*
)
).
• Par ailleurs, l'écart entre le coût du travail pour
l'employeur et le salaire net perçu par le salarié est
particulièrement élevé en France, ceci résultant du
financement de la protection sociale par des cotisations assises sur les
salaires (cf.
annexe 3
).
Les conséquences de cet écart sont discutées. Elles
dépendraient notamment de la perception qu'ont les salariés de
ces cotisations sociales : impôt ou revenu
différé ? Il est toutefois probable que cet écart se
traduise pour le moins par une
désincitation psychologique
au
travail déclaré d'un côté, à l'embauche de
l'autre.
• Enfin, le financement de la protection sociale par des
prélèvements directement assis sur le travail pourrait avoir
été défavorable à l'emploi.
Le ralentissement de la croissance à partir de 1973, puis la baisse de
la part des salaires dans la valeur ajoutée ont en effet freiné
l'assiette
des cotisations sociales, alors même que l'extension de
la couverture sociale de la population, le vieillissement démographique,
le dynamisme des dépenses de santé et le développement du
chômage tendaient à accroître les besoins de financement de
la sécurité sociale. Cet " effet de ciseaux " s'est
traduit par une augmentation quasi-continue des taux de cotisations, qui a
engagé le financement de la protection sociale dans un
cercle
vicieux
:
- ou bien la hausse des cotisations sociales, qu'elles soient formellement
à la charge des salariés ou à la charge des employeurs, se
traduit
in fine
par une moindre progression du salaire net, et il en
résulte un ralentissement des revenus d'activité, d'où une
démotivation
ou une
désincitation au travail
pour
les salariés ;
- ou bien la hausse des cotisations sociales n'est pas entièrement
répercutée sur les salaires nets, et il en résulte une
augmentation du coût du travail qui pénalise la
compétitivité-prix des entreprises et les incite à
substituer du capital aux emplois, d'où une
baisse
de la
demande de travail
.
Au total, la hausse des taux de cotisations sociales entraîne une baisse
de l'
emploi
, donc une contraction de l'assiette des cotisations
sociales, ce qui, à dépenses et déficit constants,
requiert une nouvelle hausse des taux de cotisations, etc.
C. LES EFFETS THÉORIQUES D'UNE BAISSE DU COÛT DU TRAVAIL SUR L'EMPLOI
1. Des effets favorables au niveau des entreprises et des choix de consommation des ménages
•
Toutes choses égales par ailleurs, la baisse du coût du travail
incite les entreprises à privilégier des modes d'organisation et
de fabrication comportant une plus grande part de travail, et une moindre part
d'équipement ou d'investissements immatériels. La baisse du
coût du travail par rapport à celui du capital tend donc à
ralentir la " substitution du capital au travail " dans les
entreprises, c'est-à-dire leurs investissements de rationalisation et de
modernisation. Il en résulte un ralentissement des gains de
productivité, donc un
enrichissement du contenu en emplois de la
croissance
: à croissance du PIB égale,
l'économie crée plus d'emplois.
Cet effet est relativement
lent
. Il n'intervient en effet qu'au fur et
à mesure que les entreprises modifient leur organisation ou renouvellent
leur outil de production. Il est de ce fait difficile à mesurer.
Cet effet est vraisemblablement d'autant plus important que la baisse du
coût du travail apparaît
pérenne
: en effet, les
entreprises ne modifieront pas leurs modes de production pour
bénéficier d'aides qui leur semblent transitoires.
Cet effet d'enrichissement du contenu en emplois de la croissance est
symétriquement défavorable à l'
investissement
, et
de ce fait
ambigu
pour la
croissance
à long terme. En
effet, il ralentit la modernisation de l'économie et la diffusion du
progrès technique, ce qui peut freiner la croissance et repousser
certains ajustements. Cependant, en période de chômage durable, la
réinsertion dans l'emploi de personnes éloignées du
marché du travail prévient la dégradation de leur
"
capital humain
", et accroît donc le potentiel de
croissance de l'économie à long terme.
• Par ailleurs, la baisse du coût du travail, toutes choses
égales par ailleurs, se traduit immédiatement ou bien par une
baisse des
prix
des biens et services si les entreprises maintiennent
leurs marges, ou bien par une hausse des
profits
des entreprises, si
celles-ci maintiennent leurs prix de vente
24(
*
)
.
La baisse des prix nationaux est favorable aux consommateurs, et tend
à stimuler la
demande
intérieure. En outre, elle
accroît la compétitivité de la production nationale tant
sur le marché intérieur qu'à l'exportation, ce qui tend
à augmenter la production, donc l'
emploi
. Par ailleurs, la hausse
des profits favorise le désendettement des entreprises et leurs
investissements.
• Parallèlement, si les entreprises répercutent la baisse
du coût du travail sur leurs prix, il en résulte un changement de
la hiérarchie des
prix relatifs
, en faveur des biens et services
" intensifs en main-d'oeuvre ". L'altération des prix relatifs
entraîne en théorie une
modification
progressive des
choix des consommateurs
, au profit des biens et services intensifs en
main-d'oeuvre (en particulier les services à la personne), et au
détriment des biens intensifs en capital (en particulier les biens de
haute technologie). Cet
effet de " substitution
macroéconomique "
, qui favorise notamment l'émergence de
nouvelles activités de proximité, accélère le
développement de la " société de services ",
freine les importations (proportionnellement moins riches en services) et se
combine à l'effet de substitution microéconomique décrit
plus haut pour enrichir le contenu en emplois de la croissance.
2. Des effets favorables atténués par les effets récessifs du financement de la baisse du coût du travail
La
baisse du coût du travail peut trouver son origine :
- ou bien dans une
baisse
des
salaires nets,
qui risque
d'entraîner, d'une part un fléchissement de la consommation des
ménages, d'autre part une démotivation des salariés, donc
une dégradation de leur productivité ;
- ou bien dans une baisse des
charges sociales
assises sur les salaires.
A déficit public constant, cet allégement doit être
compensé
par une contraction des dépenses publiques ou par
une augmentation d'autres prélèvements, ces deux mesures
présentant également des effets récessifs à
court-moyen terme.
Donc, dans tous les cas, le financement de la baisse du coût du travail
en atténue fortement les effets favorables sur l'emploi, dans une
proportion qui dépend des
modalités
de ce financement (cf.
annexe 3
).
II. LES ÉTUDES EMPIRIQUES JUSTIFIENT DES TRANSFERTS DE CHARGES EN FAVEUR DU TRAVAIL PEU QUALIFIÉ
A. LES RÉSULTATS DES ÉTUDES MACROÉCONOMÉTRIQUES : UN LIEN DISTENDU ENTRE COÛT DU TRAVAIL ET EMPLOI
•
Les études économétriques réalisées dans
les pays industrialisés, à partir de données
macroéconomiques
(le PIB, l'investissement, le coût moyen
du travail, l'emploi au niveau national, etc.), valident en
général les intuitions théoriques
précédentes en mettant en évidence un effet profit (la
baisse du coût du travail accroît les profits et l'investissement
des entreprises), un effet compétitivité (la baisse du coût
du travail améliore la compétitivité relative de nos
entreprises), ainsi qu'un " effet de substitution " (la baisse du
coût du travail ralentit la substitution capital/travail), même si
le lien final entre coût du travail et emploi s'avère parfois
distendu. Les politiques de baisse du coût du travail peuvent en effet
conduire à des enchaînements récessifs si elles sont
conduites également dans des pays voisins, et si elles s'y traduisent
simultanément par un ralentissement des salaires, une hausse des
impôts ou une baisse des dépenses publiques, donc une contraction
de la demande finale.
• Toutefois,
dans le cas de la France
, la plupart des
études macroéconométriques
ne permettent pas
de
mettre en évidence un " effet de substitution ",
c'est-à-dire un impact de la baisse du coût du travail sur le
rythme de la substitution capital/travail.
Trois explications sont avancées à ce résultat fortement
contre-intuitif :
- des
difficultés statistiques
résultant notamment de la
forte variabilité du contexte national ou international au cours des 20
dernières années (en particulier de la part des salaires dans la
valeur ajoutée), ainsi que de l'impossibilité de
mesurer
de manière fiable l'
investissement
et surtout le stock de capital
installé (c'est-à-dire de valoriser l'ensemble des usines et des
équipements installés en France) ;
- des
facteurs culturels
: les consommateurs français
seraient réticents à accroître leur demande de services de
proximité, et la mauvaise image de ces emplois freinerait le
développement de l'offre de travail dans ce domaine ;
- une
dynamique autonome de rationalisation
dans le secteur
industriel résultant de la concurrence internationale et des normes de
rentabilité requis par les actionnaires : les entreprises
industrielles poursuivraient ainsi des investissements de modernisation et de
substitution du capital au travail, indépendamment de l'évolution
du coût du travail en France, d'autant plus que les allégements de
charges ne seraient pas perçus comme pérennes.
B. LES RÉSULTATS DES ÉTUDES MICROÉCONOMIQUES : UNE FORTE SENSIBILITÉ DE L'EMPLOI AU COÛT DU TRAVAIL POUR LES SALARIÉS LES MOINS QUALIFIÉS
•
Les études économétriques réalisées en
France à partir de
données d'entreprises
25(
*
)
font en revanche apparaître que le rythme des
investissements de rationalisation y est sensible au coût du travail,
c'est-à-dire que " l'élasticité de substitution entre
capital et travail " est significative
26(
*
)
. Ce résultat tend à suggérer que
l'absence de sensibilité de la substitution capital / travail au
coût du travail à l'échelle macroéconomique est une
illusion statistique
.
• Les études conduites sur données d'entreprises qui
distinguent le travail par niveau de qualification suggèrent par
ailleurs que
la sensibilité de l'emploi au coût du travail
serait beaucoup
plus élevée
-de l'ordre du double- pour le
travail peu qualifié
que pour le travail moyen, et serait
très faible, voire nulle, pour le travail hautement qualifié, qui
serait ainsi " complémentaire " du capital.
C. LA SYNTHÈSE DES ÉTUDES EMPIRIQUES OPÉRÉE DANS LES MODÈLES MACROÉCONOMIQUES JUSTIFIE A PRIORI DES ALLÉGEMENTS DE CHARGES CIBLÉS SUR LES BAS SALAIRES
•
Les modèles macroéconomiques constituent normalement un cadre
cohérent pour confronter et relier les mécanismes
économiques, tels qu'ils sont estimés à partir
d'études économétriques.
S'agissant de l'évaluation de l'impact de la baisse du coût du
travail, les modèles économiques constituent toutefois un
instrument
très
limité
.
En effet, l'impact effectif de la baisse du coût du travail
dépend largement, comme cela vient d'être évoqué,
des
réactions
et des
anticipations
des consommateurs et
des entrepreneurs, en particulier de leurs opinions sur la
pérennité de la mesure, ce que les modèles ne peuvent
évidemment prendre en compte.
Par ailleurs, les modèles appréhendent assez mal les dynamiques
de prix relatifs mises en jeu par une baisse du coût du travail.
De surcroît, les modèles économiques sont des
représentations très agrégées de l'économie,
qui ne permettent guère de jauger l'effet de mesures qui, comme les
allégements de charges sur les bas salaires, sont ciblées et ont
des effets très différenciés selon les secteurs
d'activité.
Enfin, les utilisateurs de modèles macroéconomiques de
simulation de l'économie française sont confrontés
à un dilemme pour évaluer l'impact de la baisse du coût du
travail sur l'emploi. En effet, les équations habituelles de ces
modèles sont fondées sur des estimations
économétriques réalisées à l'échelle
macroéconomique, donc ne comportent pas, ou très peu, d'effet de
substitution capital / travail (cf. supra A.1). Dès lors, ou bien les
modélisateurs " laissent tourner leurs équations ", ce
qui est cohérent, mais donne des résultats peu
vraisemblables ; ou bien, et c'est l'option qu'ils retiennent le plus
souvent, ils introduisent arbitrairement une valeur vraisemblable pour
l'élasticité de substitution du capital au travail, au risque de
préjuger de ce qu'ils souhaitent évaluer.
• Sous ces réserves, les modélisations économiques
suggèrent les résultats suivants :
- Un allégement
uniforme
des charges sociales patronales,
compensé
par la hausse d'autres prélèvements,
pourrait présenter des effets favorables, mais
modestes
sur
l'emploi (ce point sera discuté au III) ;
- Les allégements de charges
ciblés
sur les bas
salaires, compensés par la hausse d'autres prélèvements,
c'est-à-dire un transfert de charge des cotisations sociales sur les bas
salaires vers d'autres modes de financement de la cotisation sociale, seraient
très favorables à l'emploi.
Le transfert de
dix milliards de francs
de cotisations sociales
assises sur les bas salaires vers d'autres sources de financement de la
sécurité sociale se traduirait ainsi, sous des hypothèses
vraisemblables d'élasticité de substitution du travail peu
qualifié au capital, par la création nette de
10 000
à
50 000 emplois
à
moyen-long terme
, selon
les modèles et les financements alternatifs retenus. Les
allégements de charges actuels, ciblés sur les bas salaires ou
les salariés les moins qualifiés (73 milliards de francs en
1997, dont 44 milliards de francs pour la ristourne dégressive),
permettraient ainsi, s'ils étaient maintenus, la création de
75 000 à 375 000 emplois
à l'horizon de dix ans
à
déficit public constant
ex-ante
27(
*
)
.
• Ces évaluations appellent plusieurs précisions :
- il s'agit là de créations
nettes
d'emplois,
c'est-à-dire d'un
solde
entre la création d'un nombre
supérieur d'emplois à bas salaires et la disparition ou la
non-création d'un nombre inférieur d'emplois hautement
qualifiés ;
- l'impact de ces allégements de charges sur l'emploi est
très
lent
(à mesure que les entreprises renouvellent leurs modes de
production et que les consommateurs modifient leur habitudes) : le plein
effet de la mesure ne serait atteint qu'à l'horizon d'une dizaine
d'années. Ces mesures ne sauraient donc se substituer entièrement
à des dispositifs de soutien conjoncturel de l'emploi ;
- les emplois à bas salaires potentiellement créés par les
allégements de charges ciblés ne bénéficieraient
pas nécessairement en premier lieu aux
salariés
non
qualifiés
. En effet, dans le contexte d'un marché du travail
globalement dégradé, ces emplois sont susceptibles d'être
pourvus par des salariés qualifiés
" déclassés ". Ainsi, les politiques
d'allégement de charges sur les bas salaires ne sauraient se substituer
entièrement aux dispositifs visant à aider individuellement des
personnes en difficulté (par exemple des jeunes sans
diplôme).
D. L'ÉVALUATION DES EFFETS DES ALLÉGEMENTS DE CHARGES SUR LES BAS SALAIRES MIS EN oeUVRE DEPUIS 1993
•
Il n'existe à ce jour aucune évaluation précise de
l'impact réel sur l'emploi des allégements de charges sur les bas
salaires mis en oeuvre depuis 1993 : au contraire de mesures pour l'emploi
très ciblées ou contractuelles, pour lesquelles une mesure des
effets est possible, le dispositif d'allégement de charges sur les bas
salaires se prête mal à une évaluation.
En effet, les employeurs eux-mêmes ne peuvent déterminer si les
emplois qu'ils ont créés ou maintenus depuis l'entrée en
vigueur du dispositif auraient été créés en
l'absence de l'allégement (" effet d'aubaine "), s'ils se sont
substitués à des emplois mieux rémunérés
(" effet d'éviction ") ou si le dispositif leur a permis de
conquérir des parts de marché au détriment d'entreprises
concurrentes (" effet de cannibalisme ").
C'est pourquoi les expertises chiffrées relatives aux effets sur
l'emploi des allégements de charges sur les bas salaires,
réalisées notamment dans le cadre d'un rapport du CSERC
28(
*
)
au Premier ministre en 1996, puis en 1997 dans le
cadre de l'instance d'évaluation de la loi quinquennale, sont en fait
des évaluations théoriques des
effets potentiels
de ce
dispositif, qui ne diffèrent en rien des évaluations
réalisées avant son entrée en vigueur.
• Néanmoins, l'enrichissement du contenu en emplois de la
croissance au cours des dernières années pourrait résulter
en partie de la mise en oeuvre des allégements de charges sur les bas
salaires : en théorie (cf. infra), la mise en oeuvre des
allégements de charges sur les bas salaires à partir de la loi du
27 juillet 1993 et de la loi quinquennale du 20 décembre 1993, devait en
effet se traduire par un ralentissement de la substitution capital / travail,
donc par une décélération de gains de productivité,
c'est-à-dire par un
enrichissement du contenu en emplois de la
croissance
.
Or, l'économie française connaît effectivement, depuis le
début des années 1990, un ralentissement des gains de
productivité par rapport à leur tendance baissière de long
terme
29(
*
)
. Cette inflexion des gains de
productivité, que les statisticiens datent selon les cas de la fin de
1992 ou de 1993, aurait permis à l'économie française de
créer ou de préserver, à croissance du PIB
inchangée sur la période 1993-1997, près de
300 000 emplois supplémentaires
à la fin de 1997.
Il semblerait d'ailleurs que cet enrichissement du contenu en emplois de la
croissance se soit
prolongé en 1998
: l'emploi est
particulièrement dynamique, au contraire des reprises
précédentes où les entreprises attendaient plusieurs
semestres avant d'embaucher.
• La part qui revient aux allégements de charges sociales pour
expliquer cette inflexion du contenu en emplois de la croissance demeure
toutefois difficile à établir, d'autant plus que les
modalités de ces allégements ont été
particulièrement
instables
30(
*
)
.
L'enrichissement du contenu en emplois de la croissance résulte sans
doute en premier lieu de l'accélération du développement
du
travail à temps partiel
à partir de 1992, sous l'effet
notamment de l'abattement de charges spécifique institué en
septembre 1992, puis du biais des allégements de charges sur les bas
salaires en faveur du travail à temps partiel : jusqu'à la
" proratisation " des allégements en fonction du temps de
travail en 1997, il était plus avantageux pour un employeur d'embaucher
deux salariés à mi-temps qu'un salarié à temps
complet.
Par ailleurs, trois phénomènes temporaires pourraient avoir
concouru au ralentissement des gains de productivité depuis 1992 :
- le niveau élevé des
taux
d'
intérêts
réels
jusqu'à la fin de 1995, qui renchérissait les
investissements, donc freinait la substitution capital / travail ;
- le
ralentissement de la croissance
elle-même entre
1991-1996 : les périodes de croissance lente seraient en effet peu
propices à l'innovation et à la diffusion du progrès
technique ;
- le développement de la
flexibilité
du marché du
travail, et plus particulièrement de l'intérim : par rapport
aux reprises précédentes, les entreprises semblent avoir en effet
embauché plus tôt parce qu'elles pouvaient plus aisément
recourir à une main-d'oeuvre temporaire.
Il est néanmoins vraisemblable que les allégements de charges sur
les bas salaires ont amplifié, sinon
catalysé
,
l'enrichissement du contenu en emplois de la croissance : selon le
directeur de la DARES
31(
*
)
, M. Claude Seibel,
les allégements de charges seraient ainsi à l'origine de 80 000
emplois supplémentaires à la fin de 1997, et de 120 000 emplois
supplémentaires à la fin de 1998
32(
*
)
.
E. LE DISPOSITIF ACTUEL D'ALLÉGEMENTS DE CHARGES SUR LES BAS SALAIRES PEUT TOUTEFOIS PRÉSENTER DES EFFETS PERVERS.
Le
dispositif actuel d'allégements de charges sur les bas salaires (une
" ristourne du coût du travail dégressive " de
12,4 % au niveau du SMIC jusqu'à 0 % pour un salarié
dont la rémunération horaire équivaut à
1,3 SMIC), répond à un
compromis
entre deux
exigences :
- une baisse du coût du travail pour les plus bas salaires suffisante
pour avoir un
impact psychologique
sur les décisions
d'embauche ;
- un
coût
pour les finances publiques
maîtrisé
.
Le caractère progressif de la ristourne présente toutefois un
effet pervers : pour augmenter de 100 francs le salaire net d'un
employé rémunéré au niveau du SMIC, l'employeur
doit débourser 260 francs, ce qui constitue une
désincitation très forte aux augmentations individuelles de
salaires et donc aux efforts de formation, aussi bien pour l'employeur que pour
les salariés. Au total, le caractère dégressif de la
ristourne se traduit par un "
piège à bas salaires
et
à basses qualifications ".
• Le double constat de l'efficacité des allégements de
charges sur les bas salaires d'une part, des effets pervers de la ristourne
dégressive d'autre part, a conduit M. Edmond MALINVAUD,
professeur au Collège de France et ancien Directeur
Général de l'INSEE, à préconiser, dans le cadre
d'un rapport présenté le 11 juillet 1998 au Premier
ministre :
- la
pérennisation
du dispositif actuel, dont il estime (suivant
en cela les estimations antérieures les plus optimistes) qu'il se
traduirait par la création de
300 000 emplois
à
l'horizon 2005 ;
- le
reprofilage
des
cotisations sociales
, qui seraient
progressives pour tous les salariés
33(
*
)
.
M. MALINVAUD estime que ce reprofilage, c'est-à-dire en fait
un
transfert de cotisations sociales des bas salaires vers les hauts salaires
,
se traduirait par la création de
150 000 emplois
supplémentaires
à l'horizon de dix ans par rapport au
dispositif précédent.
Au vu des considérations théoriques exposées
précédemment, et plus particulièrement de la
sensibilité plus forte de l'emploi peu qualifié au coût du
travail, cette seconde préconisation apparaît logique :
alléger le coût du travail peu qualifié en augmentant le
coût du travail qualifié se traduirait vraisemblablement par une
hausse de l'emploi total à long terme. Elle manifesterait en outre la
solidarité de la Nation vis-à-vis des salariés les moins
qualifiés.
• Cette proposition soulève toutefois deux objections :
- le dispositif proposé réduirait la
lisibilité
et
la
légitimité
de notre système de protection
sociale en y mélangeant plus encore assurance et redistribution ;
- la hausse des charges sociales sur les plus hauts salaires
pénaliserait
l'innovation
, les entreprises de
haute
technologie
et les salariés les plus qualifiés au
détriment de la
croissance
. Des simulations
réalisées à l'aide du modèle MIMOSA de l'OFCE
suggèrent ainsi que le transfert à l'échelle
européenne de 1 point de PIB (80 milliards de francs) de
cotisations sociales des bas salaires vers les hauts salaires se traduirait
certes à l'horizon de cinq ans par une hausse de l'emploi total en
France (+ 100 000 environ ), mais au prix d'un
ralentissement de
la croissance
équivalent à 0,9 point de PIB - soit 0,2
point de croissance en moins par an - (cf.
annexe n° 3
).
III. ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES ET EMPLOI
A. LES MODÈLES MACROÉCONOMIQUES SUGGÈRENT QUE LES MODALITÉS DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE NE SONT PAS NEUTRES POUR L'EMPLOI
•
Sous les hypothèses habituellement retenues dans les modèles
macroéconomiques : taux de change fixe (c'est-à-dire pas de
réaction de politique économique de nos partenaires si notre
compétitivité s'améliore) ; négociations
salariales portant sur les salaires bruts ; enfin, absence de substitution
capital/travail, il ressort les résultats suivants
34(
*
)
(cf. annexe n°3) :
- Le déplacement de 50 milliards de francs
35(
*
)
de cotisations sociales patronales vers des
prélèvements directement assis sur les
ménages
(CSG, cotisations sociales salariés ou impôt sur le revenu) serait
susceptible de créer de l'ordre de
20 000 à 100 000
emplois
à l'horizon de dix ans. Cet effet favorable trouve son
origine dans deux mécanismes : d'une part, la modération du
coût du travail qui résulte de ce déplacement est, selon
les modèles, toujours favorable à l'emploi ; d'autre part,
la désinflation résultant de la baisse du coût du travail
favorise un repli du taux d'épargne des ménages, ce qui limite la
contraction de leur consommation résultant de la baisse de leur revenu ;
- les effets d'un transfert de cotisations sociales employeurs vers la TIPP
sont un peu moins favorables ;
- les effets sur l'emploi et le chômage d'un transfert des cotisations
employeurs vers d'autres prélèvements sur les
entreprises
ne sont
pas significatifs.
• En revanche, si l'on retient comme hypothèse une valeur
vraisemblable pour la substitution capital / travail (cf. discussion au
II) :
- le transfert de cotisations sociales patronales vers des
prélèvements sur les ménages présente toujours un
effet légèrement favorable, inchangé par rapport aux
hypothèses précédentes et résultant des mêmes
mécanismes ;
- mais le transfert de cotisations sociales patronales vers des
prélèvements assis sur le capital (impôt sur les
sociétés ou cotisation à la valeur ajoutée
notamment) se traduirait par des effets beaucoup plus favorables à
l'emploi, et d'autant plus favorables que l'investissement s'en trouverait
renchéri par rapport au travail. Au total, le déplacement de 50
milliards de francs de cotisations sociales employeurs vers d'autres
prélèvements sur les entreprises pourrait se traduire par
200 000 à 400 000 emplois
supplémentaires
à l'horizon de dix ans.
• Dans tous les cas, le déplacement de 50 milliards de
francs de cotisations sociales employeurs vers la
TVA
(ce qui
représenterait une hausse d'environ 2 points de TVA) se traduit par un
impact favorable,
40 000 à 80 000 emplois
supplémentaires à moyen terme, entièrement imputable au
surcroît de compétitivité extérieure
résultant mécaniquement de la mesure. Cet effet favorable
s'atténuerait toutefois progressivement.
B. L'EXTENSION DE L'ASSIETTE DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SE TRADUIRAIT TOUTEFOIS PAR DES TRANSFERTS IMPORTANTS ENTRE ENTREPRISES SUSCEPTIBLES D'EN LIMITER L'EFFICACITÉ POUR L'EMPLOI
Il
s'agit là d'une évidence : toute réforme de la
fiscalité à prélèvements constants se traduit par
des gagnants et des perdants. Schématiquement, l'analyse exposée
plus haut suggère qu'un transfert de charges des bas salaires vers les
hauts salaires et/ou surtout des entreprises intensives en main-d'oeuvre vers
les entreprises hautement capitalistiques, serait favorable à l'emploi
total.
Cette remarque liminaire appelle toutefois quatre observations :
• Le transfert des cotisations sociales employeurs vers des
prélèvements assis sur les ménages (CSG, IR ou TVA),
aurait des effets diffus et de faible ampleur au regard du revenu des
ménages (50 milliards de francs de prélèvements
représentent moins de 1 % de leur revenu disponible), mais
l'expérience suggère qu'une hausse des prélèvements
sur les ménages est toujours difficile à mettre en oeuvre.
• Le transfert de cotisations sociales employeurs vers d'autres
prélèvements sur les entreprises (cotisation à la valeur
ajoutée, taxes sur les profits,) dont les effets sur l'emploi sont
potentiellement plus favorables, se traduirait par une
redistribution
de
grande ampleur
entre entreprises
36(
*
)
. Cela signifie qu'une réforme à
prélèvements constants de la fiscalité des entreprises
devrait être
progressive
, au risque d'en limiter les effets sur
l'emploi.
• La spécialisation d'une économie, et plus
généralement la structure d'ensemble de son système
productif, reflètent dans une certaine mesure la structure de sa
fiscalité.
L'analyse macroéconomique suggère que la réforme des
prélèvements sur les entreprises n'est potentiellement
créatrice d'emplois que si elle s'accompagne d'un redéploiement
du tissu productif vers des secteurs plus riches en emplois. Cette
reconversion
, qui constitue d'ailleurs l'objectif premier des
écotaxes, est toutefois
coûteuse
, dès lors que
doivent être déclassées des installations durables (par
exemple des raffineries). Ce coût, qui n'est guère pris en compte
dans les simulations macroéconomiques précédentes, est
susceptible de réduire au moins temporairement les effets sur l'emploi
attendus d'une modification de l'assiette des prélèvements
sociaux. En outre, ce redéploiement de l'économie, donc les
créations d'emplois afférentes, nécessite pour être
effectif des réformes pérennes, conduites selon un calendrier
crédible.
• Enfin, à prélèvement total constant, une baisse
du coût relatif du travail par rapport au capital se traduirait par une
baisse modeste du coût absolu du travail, mais par une hausse
significative des
taux d'imposition
sur le
capital
.
Les deux assiettes sont en effet dans un rapport de 1 à 4 environ. Cela
signifie qu'un transfert de grande ampleur de cotisations sociales employeur
vers d'autres prélèvements sur les entreprises ou des taxes sur
les revenus du capital, pourrait entraîner une
délocalisation
de l'
épargne
et des investissements
susceptible de freiner la croissance et l'emploi, ce dont les modèles ne
peuvent rendre compte.
Au total, le remplacement de cotisations sociales par des taxes sur le capital
risque de se traduire par une croissance plus riche en emploi, mais moins
dynamique, cet effet pervers étant d'autant plus fort que le capital est
mobile
37(
*
)
.
C. LA MODULATION DES COTISATIONS CHÔMAGE
Il est
régulièrement proposé de
moduler
les taux de
cotisations chômage
employeurs en fonction du passé
récent de l'entreprise en matière d'embauches et de
licenciement : les entreprises qui ont licencié auraient un malus,
tandis que les entreprises qui ont récemment embauché auraient un
bonus
38(
*
)
.
A priori, la modulation des cotisations chômage est un système
relativement
lisible
qui pourrait avoir un effet favorable sur l'emploi
en réduisant le coût marginal des créations d'emplois d'une
part, en freinant les licenciements de l'autre. La théorie
économique suggère toutefois que l'augmentation des coûts
de licenciements peut constituer un frein à l'
embauche
, notamment
lorsque la reprise de l'activité est peu assurée, ce qui pourrait
être le cas de l'économie française aujourd'hui : les
employeurs seraient plus réticents à embaucher s'ils sont au
bonus maximal et s'il existe un risque significatif qu'ils doivent licencier
plus tard.
La modulation des coûts de licenciements risquerait ainsi ou bien de
réduire la flexibilité nécessaire aux entreprises, ou bien
d'être contournée (les entreprises en expansion embauchant
prioritairement des intérimaires) amplifiant la tendance actuelle
à la concentration de la flexibilité sur une minorité de
salariés " non permanents " et augmentant la
précarité
de l'emploi pour les jeunes.
La modulation des cotisations chômage aurait également pour
conséquence de pénaliser les entreprises lors des phases de
ralentissement de l'activité, au risque de conduire les plus fragiles
d'entre elles à la faillite et, surtout, de pénaliser
structurellement les
secteurs en déclin
(par exemple le textile),
c'est-à-dire de pénaliser des entreprises qui peuvent
n'être en rien "
responsables
" de leurs
difficultés.
Au total, la modulation des cotisations chômage apparaît ainsi
comme un dispositif
darwinien
, favorisant la disparition des entreprises
les plus fragiles et des secteurs en déclin, et accélérant
le développement de nouvelles entreprises et de nouvelles
activités, sans que le bilan coût-avantage pour l'emploi de ce
darwinisme économique soit très net : il dépend sans
doute de la dynamique d'innovation d'une économie, de la durée
moyenne du chômage (si les salariés licenciés des secteurs
en déclin tardent à retrouver un emploi, il en résulte un
effet récessif) et de l'aptitude des salariés à changer
plusieurs fois de métier au cours de leur vie.
IV. CONCLUSION
Il
résulte clairement des analyses économiques qui
précèdent que
les baisses de prélèvements les
plus favorables à l'emploi sont celles qui sont lisibles,
pérennes et ciblées sur les bas salaires
. Votre rapporteur
regrette ainsi que les marges de manoeuvre budgétaires pour 1999 soient
pour partie utilisées par une mesure, l'allégement de la part des
salaires dans la taxe professionnelle, qui ne remplit guère ces
conditions.
Les analyses économiques qui précèdent suggèrent
également qu'
il
n'existe pas de structure miracle
pour le
financement de la protection sociale, et que les effets à attendre sur
l'emploi d'une modification de l'assiette des cotisations sociales sont
modestes au regard de l'ampleur du chômage.
Ce constat ne doit pas conduire à renoncer à des réformes
de fond, qu'il est par ailleurs indispensable d'articuler avec les
allégements du coût du travail prévus dans le cadre de la
loi sur les 35 heures. Mais ce constat signifie que l'on ne peut faire
l'économie ni d'une réflexion sur l'
efficience
du
système de protection sociale, ni d'une démarche de
rationalisation des dépenses
.
Il importe notamment, selon votre rapporteur, d'améliorer la
lisibilité d'ensemble des prélèvements et des
dépenses de protection sociale.
La
transparence
du système de protection sociale est en effet une
exigence démocratique
: "
tous les citoyens ont le
droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution publique, de la consentir librement,
d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette,
le recouvrement et la durée
", selon l'art. 14 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
La transparence est aussi le gage d'une bonne gestion. Elle constitue
également une condition nécessaire à l'
adaptation
continue
de notre protection sociale aux exigences changeantes de
l'économie et de la société.
ANNEXE N° 1
UNE PROJECTION DE L'ÉCONOMIE
FRANÇAISE
(1998-2003)
SOMMAIRE
Pages
I.
CONCEPTION GÉNÉRALE DE L'EXERCICE
75
II. PRINCIPALES HYPOTHÈSES DE LA PROJECTION
75
A. TAUX D'INTÉRÊT ET TAUX DE CHANGE 78
B. L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 79
C. LES FINANCES PUBLIQUES 81
D. LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL 82
III. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS MACROÉCONOMIQUES
83
A. LA CROISSANCE 83
B. LES MÉNAGES 85
C. LES ENTREPRISES 87
D. LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS 89
E. EMPLOI ET CHÔMAGE 90
F. LES PRIX 91
IV. TENDANCES DES FINANCES PUBLIQUES
92
A. LES RECETTES 92
B. L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 93
1. La masse salariale
94
2. Les consommations intermédiaires
95
3. Les investissements publics
98
4. Les prestations sociales
100
a) Les prestations-maladie 100
b) Les prestations-vieillesse 102
c) Les prestations familiales et le Revenu Minimum d'Insertion 102
d) Les prestations-chômage 103
C. LE BESOIN DE FINANCEMENT ET LA DETTE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 104
Cette note, établie par la Division des Etudes
macroéconomiques du Service des Etudes du Sénat, présente
les résultats d'une projection réalisée par l'Observatoire
français des conjonctures économiques (OFCE) à l'aide du
modèle MOSAÏQUE.
I. CONCEPTION GÉNÉRALE DE L'EXERCICE
•
Cette projection de l'économie française à l'horizon de
cinq ans - 2003 en est le terme - a été
réalisée par l'Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE) à l'aide de son
modèle
de
simulation de l'économie française, MOSAÏQUE. Elle est de
nature essentiellement
macroéconomique
.
Les experts de l'OFCE se sont attachés toutefois à en tirer le
maximum d'indications sur l'évolution des
finances publiques
(principalement au cours des années 1998, 1999 et 2000).
Si les résultats affichés pour les trois premières
années peuvent être considérés comme une
prévision
, les trois dernières années (2001 à
2003) ne décrivent pas le scénario le plus
probable
, mais
plutôt une extrapolation des tendances à l'oeuvre jusqu'en 2000.
Il s'agit ainsi d'
illustrer
, par une projection à cinq ans, les
questions et les choix devant lesquels se trouvent aujourd'hui les responsables
de la politique économique.
• Dans le but de mettre à la disposition des Sénateurs
une telle " illustration ", la projection a
délibérément un caractère
tendanciel
que
l'on retrouve tant dans les évolutions macroéconomiques que dans
celles des finances publiques.
Concernant les
évolutions macroéconomiques
tout d'abord,
les auteurs de la projection ont choisi de prolonger autant que possible les
comportements des agents économiques tels qu'ils ont été
observés sur le passé et tels que les décrit le
modèle.
Ainsi l'impact de la loi du 13 juin 1998
abaissant
la
durée
hebdomadaire légale du travail
de 39 heures à 35 heures,
à partir du 1er janvier 2000, n'est pas pris en compte dans la
projection. En effet, les modalités de mise en oeuvre de la
réduction de la durée du travail dépendent pour
l'essentiel des négociations entre les organisations professionnelles et
sont ainsi, pour l'essentiel, de nature
microéconomique
(accords
salariaux, réorganisation du travail dans les entreprises).
L'introduction en projection d'une hypothèse de nature
macroéconomique
serait apparue hasardeuse et aurait ainsi
perturbé l'interprétation des évolutions décrites
par la projection.
Il est logique dès lors que celles-ci décrivent un prolongement
des tendances lourdes à l'oeuvre dans l'économie française.
Concernant les
finances publiques
par ailleurs, la projection tient
compte de la nécessité de leur redressement, afin de
maîtriser l'évolution de la dette publique et de respecter le
Pacte de stabilité et de croissance souscrit par les Etats signataires
du Traité d'Amsterdam.
Cela se traduit globalement par une hypothèse de
ralentissement
de l'évolution des
dépenses publiques
par rapport à
leur rythme de croissance de longue période. Celles-ci croîtraient
en effet de 2 % par an en
volume
de 1998 à 2003, contre
2,7 % par an entre 1991 et 1997. L'hypothèse ainsi retenue par les
auteurs de la projection traduit toutefois un relâchement de la politique
budgétaire par rapport aux années 1996 à 1998.
• La projection prend en compte la loi du 16 octobre 1997
relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes et
l'objectif de création de
350 000 " emplois
jeunes "
dans le secteur non-marchand.
Les auteurs de la projection ont toutefois considéré que les
créations nettes
d'emplois induites par le dispositif seraient
limitées à 80 % des embauches réalisées (soit
280 000 créations nettes
d'emplois en
trois ans
dans
le secteur non-marchand) et que les 20 % restants seraient intervenus
même en l'absence de cette mesure (celle-ci générant un
" effet d'aubaine ").
• Malgré un ensemble d'hypothèses relativement
" conservatrices ", la projection met en évidence
l'
inflexion de tendances
macroéconomiques. Alors que les
projections réalisées les années précédentes
prolongeraient sur le moyen terme l'atonie de la demande intérieure,
à l'origine de la faible croissance des années 1991 à
1996, le scénario présenté ici décrit un
redressement
de la demande intérieure, en particulier de la
consommation
des ménages. Celui-ci trouve son
origine
dans
l'amélioration de la situation de l'
emploi
observée en
1998 (360 000 emplois supplémentaires en 1998 selon l'INSEE et
200 000 chômeurs en moins environ), qui se traduit par une
accélération de l'évolution du
revenu
des
ménages et par un comportement d'
épargne
plus favorable
à la consommation.
Ce type de reprise de l'activité suscite, selon le modèle, des
enchaînements économiques
favorables
: la baisse du
chômage entraîne une évolution des salaires et du revenu des
ménages plus rapide que par le passé, les perspectives de
débouchés sur le marché intérieur contribuent au
soutien de l'investissement des entreprises malgré la contraction des
débouchés extérieurs, les contraintes d'ajustement des
finances publiques sont allégées par l'effet de
l'accélération de l'activité... Il en résulte que
la croissance affichée en projection (2,6 % par an en moyenne sur
le moyen terme) est nettement plus élevée non seulement qu'au
cours de la période 1990-1997 (1,3 % par an), mais aussi qu'au
cours des exercices de même nature réalisés les
années précédentes.
II. PRINCIPALES HYPOTHÈSES DE LA PROJECTION
A. TAUX D'INTÉRÊT ET TAUX DE CHANGE
•
La probabilité du ralentissement de l'
économie
américaine
, conjuguée à la fragilité du
système financier, rendent probable une détente des
taux
d'intérêt à
court
terme aux Etats-Unis au cours des
trois prochaines années, la reprise de l'activité se traduisant
en fin de période par une remontée des taux
d'intérêt vers leur niveau de 1999 (4,1 %). Les
taux
longs
, qui ont déjà engrangé une forte baisse suite
à la crise asiatique et au repli des capitaux vers des placements moins
risqués, se stabiliseraient autour de 4 % sur le moyen terme.
• La persistance d'un niveau élevé du chômage en
Europe, notamment en Allemagne et en France, l'absence de tensions salariales
et la dépréciation du dollar qui favorise la désinflation
importée, conduisent à envisager, en projection, un pilotage
monétaire
plus
souple
que par le passé. Les taux
d'intérêt à court terme fluctueraient autour de 3 %
sur l'ensemble de la période de projection.
• La
baisse
du
dollar
constatée depuis la crise
financière de la mi-1998
se poursuivrait
en 1999, jusqu'à
un taux de change de 1 euro = 1,24 dollar (soit un dollar
pour 5,33 francs). Cette évolution s'expliquerait par le ralentissement
américain et le décalage de conjoncture entre les Etats-Unis et
l'Europe, ainsi que par la crédibilité de l'euro,
renforcée par la crise asiatique. A l'horizon de la projection, le
dollar connaîtrait une nouvelle baisse par rapport à l'euro, en
raison de la persistance d'un déficit extérieur aux Etats-Unis et
d'un excédent en Europe. Sur l'ensemble de la période 1998-2003,
la parité de l'euro pourrait s'établir en moyenne à
1,22 dollar (soit l'" équivalent " de 1
dollar = 5,42 francs).
Le yen est supposé rester à un bas niveau, de l'ordre de 133 yen
par dollar.
HYPOTHÈSES DE TAUX DE CHANGE ET DE TAUX D'INTÉRÊT
|
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Taux d'intérêt courts |
|
|
|
|
|
|
|
Etats Unis
|
5,5
|
4,1
|
3,4
|
2,9
|
3,6
|
4,1
|
|
Taux d'intérêt longs |
|
|
|
|
|
|
|
Etats Unis
|
5,2
|
4,1
|
4,1
|
4,3
|
4,5
|
3,8
|
|
Taux de change |
|
|
|
|
|
|
|
$/Yen
|
135
|
133
|
133
|
133
|
133
|
133
|
Source : Prévisions OFCE.
B. L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
•
La croissance de l'
économie américaine
, encore vive au
1
er
semestre 1998 (4 % en rythme annualisé), a
été longtemps soutenue par la hausse de la Bourse, la baisse du
taux d'épargne des ménages et le dynamisme de
l'investissement : selon les auteurs de la projection, ces facteurs
devraient s'inverser brutalement en raison de la crise financière et de
la baisse des profits des entreprises. L'économie américaine
entrerait ainsi en récession dès le quatrième trimestre
1998. Ce retournement serait néanmoins de courte durée
grâce à une politique monétaire accommodante. A partir de
2000, l'économie américaine retrouverait un rythme normal
d'activité, avec un taux de croissance de l'ordre de 2,2 % par an
entre 2000 et 2003.
• Divers facteurs, tels que la dépréciation du taux de
change effectif, l'injection de fonds publics dans le système bancaire
ou la relance des programmes de travaux publics, pourraient permettre au Japon
de sortir de la récession (- 2,2 % de croissance en 1998) et de
retrouver une croissance de l'ordre de 2 % par an sur le moyen terme.
• La crise dans les pays d'
Asie en développement
aurait
atteint, selon les auteurs de la projection, son point bas au milieu de
l'année 1998. Après un recul de près de 10 % en 1998,
la production augmenterait de 3 % en 1999 et croîtrait en fin de
période à un rythme annuel moyen voisin de 6 % (contre
8 % en moyenne jusqu'en 1996).
• La surévaluation des monnaies d'
Amérique latine
,
consécutive aux dévaluations en Asie, a conduit à une
forte hausse des taux d'intérêt, afin de prévenir les
attaques spéculatives, de telle sorte que le Brésil, le Mexique
et l'Argentine entreraient en récession en 1999. Les pays
d'Amérique latine retrouveraient par la suite une croissance conforme
à sa tendance de long terme (soit autour de 4 % par an en moyenne).
• Dans cet environnement à court terme particulièrement
dégradé, les hypothèses de croissance pour l'
Union
européenne
(+ 2,7 % en 1998, puis + 2,5 % par an
à partir de 1999) peuvent apparaître optimistes. Elles reposent
sur le constat que, si la dégradation de l'environnement international a
effectivement affaibli la contribution externe à la croissance, la
demande intérieure tend au contraire à se renforcer depuis la
mi-1997, en raison notamment du dynamisme des créations d'emplois. De
plus, l'assouplissement de la politique monétaire et le
relâchement des contraintes d'ajustement budgétaire
créeraient un cadre de politique économique plus favorable que
par le passé.
Si l'on peut s'interroger sur la capacité de l'Europe à
bâtir sa croissance sur son dynamisme interne et à résister
au ralentissement mondial, il faut néanmoins observer que les
hypothèses de croissance européenne retenues en projection
apparaissent relativement
prudentes
lorsqu'on les compare aux
épisodes antérieurs de reprise cyclique (+ 3,4 % par an
en moyenne de 1986 à 1990) ou si l'on prend en considération le
niveau du sous-emploi et des excédents extérieurs, ou la
faiblesse de l'inflation.
PRINCIPALES HYPOTHÈSES D'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
|
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001-2003* |
|
ÉVOLUTION DU PIB EN % |
|
|
|
|
|
- Union
Européenne
(1)
|
2,7
|
2,5
|
2,3
|
2,5
|
* Taux
de croissance annuel moyen sur les années 2001, 2002 et 2003.
(1) Croissance des pays membres pondérée par la structure des
exportations françaises.
(2) En produits manufacturés.
C. LES FINANCES PUBLIQUES
L'évolution des finances publiques est
détaillée dans la quatrième partie de la note.
Les hypothèses retenues correspondent à un
ralentissement
des dépenses de l'ensemble des administrations publiques :
celles-ci ne progressent en volume que de 2 % par an en moyenne de 1998
à 2003, contre 2,7 % de 1991 à 1997. Cette orientation
restrictive est toutefois appliquée en projection avec moins de rigueur
que depuis 1995. Ainsi les auteurs de la projection ont-ils supposé une
poursuite de l'augmentation des
effectifs
de
l'ensemble
des
administrations publiques au même rythme qu'au cours des dix
dernières années et une évolution plus dynamique du
pouvoir d'achat
de
l'
indice
brut du traitement des
fonctionnaires.
Pour l'
Etat
, les hypothèses relatives aux dépenses en 1999
correspondent aux dispositions du projet de loi de finances, soit une
augmentation de 1 % en
francs constants
, maintenue jusqu'en 2003.
Les hypothèses en matière de recettes tiennent compte des mesures
contenues dans le projet de loi de finances pour 1999.
Sur l'ensemble de la période 1998-2003, les auteurs de la projection ont
retenu l'hypothèse d'une progression en volume des
prestations-maladie
de 2,8 % par an en moyenne, contre 1,9 %
par an au cours de la période 1991-1997.
Ce choix s'explique notamment par l'accélération de la croissance
et du revenu des ménages observée en projection, laquelle se
traduirait par une consommation médicale plus dynamique qu'au cours de
la période 1991-1997 (cf. page 100).
L'
ensemble
des
prestations
versées par les organismes de
Sécurité sociale progresseraient en volume de 2,3 % par an
en moyenne.
D. LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL
Le choix
d'une hypothèse d'évolution de la
productivité par
tête
(mesurée par le rapport de la valeur ajoutée aux
effectifs) détermine dans une projection l'
évolution de
l'emploi
résultant du taux de croissance de l'économie. Elle
a ainsi une incidence sur des variables fondamentales, telles que
l'évolution du chômage, des salaires ou de l'épargne des
ménages.
L'augmentation de la productivité par tête retenue dans la
projection s'élève à 1,8 % par an en moyenne. Cette
hypothèse se situe ainsi à mi-chemin entre les évolutions
observées au cours des dix dernières années (soit
+ 2 % par an en moyenne), qui traduisent un
ralentissement
de
l'évolution
tendancielle
de la productivité par
tête, et le
nouveau
ralentissement observé de 1995 à
1997 (+ 1,5 % par an en moyenne), imputable vraisemblablement
à la fois au développement du temps partiel et aux divers
dispositifs d'allégement des charges sur les bas salaires.
Par ailleurs, comme cela a déjà été indiqué,
la projection ne cherche pas à simuler l'impact de la réduction
de la durée légale du travail de 39 heures à 35
heures hebdomadaires.
Il faut observer, au total, que si les hypothèses retenues en
matière de productivité prolongent le mouvement de ralentissement
tendanciel observé depuis une dizaine d'années, elles auraient pu
néanmoins être plus " volontaristes " si les experts de
l'OFCE avaient considéré que le fort enrichissement du contenu en
emplois de la croissance, observé au cours des trois dernières
années, pouvait être
extrapolé
. Ce choix aurait eu
des effets plus
favorables
à l'évolution de l'emploi en
projection.
III. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS MACROÉCONOMIQUES
A. LA CROISSANCE
• L'évolution du PIB et de ses principales composantes est décrite dans le tableau ci-dessous :
ÉVOLUTION DU PIB ET DE SES PRINCIPALES COMPOSANTES
1998-2003
|
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001-2003* |
|
POURCENTAGE ANNUEL DE VARIATION (en volume) |
|
|
|
|
|
- PIB total |
3,0 |
2,7 |
2,3 |
2,5 |
|
- PIB marchand |
3,2 |
2,8 |
2,4 |
2,6 |
|
- Importations |
7,9 |
6,8 |
6,0 |
5,3 |
|
- Consommation des ménages |
3,5 |
3,0 |
2,7 |
2,6 |
|
- Investissement des entreprises |
6,4 |
6,0 |
4,4 |
2,8 |
|
- Investissement logement des ménages |
1,6 |
2,0 |
1,9 |
0,6 |
|
- Exportations |
5,7 |
5,5 |
4,7 |
5,5 |
|
-
Variations des stocks (
contribution à la croissance en points de
PIB)
|
+ 0,5 |
+ 0,2 |
+ 0,1 |
0,0 |
* Taux de croissance annuel moyen pour les années 2001, 2002 et 2003.
Le
profil
de croissance de l'économie française décrit
par la projection peut être décomposé en trois
phases :
- Après une croissance du PIB de 2,3 % en 1997 l'activité
s'accélère en 1998 (+ 3,0 %) et en 1999
(+ 2,7 %). Les taux de croissance ainsi affichés par les deux
premières années de la projection sont sensiblement
équivalents à ceux retenus par le Gouvernement dans les
hypothèses associées au projet de loi de finances pour 1999.
Ce regain de dynamisme s'expliquerait par le redressement de la consommation
des ménages, soutenu par l'amélioration de l'emploi et une
légère accélération des salaires, ainsi que par
l'initialisation d'un nouveau cycle d'investissement des entreprises.
- En 2000, la croissance ralentit (+ 2,3 %), en raison du tassement de la
demande intérieure ;
- Un retour de l'économie française vers son sentier de
croissance
potentielle
, lié à la reprise de
l'activité chez nos principaux partenaires, s'opère en fin de
projection. La croissance annuelle du PIB sur la période 2001-2003
s'établit à 2,5 % en moyenne.
• Le
tableau
ci-dessous décrit l'évolution des
contributions
à la croissance du PIB en projection.
CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE DU PIB
(chiffres arrondis)
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001-2003* |
|
MOYENNES ANNUELLES (en points de pourcentage du PIB) |
|
|
|
|
|
|
- Consommation des ménages |
0,6 |
2,3 |
2,0 |
1,8 |
1,8 |
|
- Investissement logement des ménages |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
|
- Investissement des entreprises |
0,0 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,6 |
|
- Dépenses des administrations |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|
- Variation des stocks |
0,1 |
0,6 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
|
Total de la demande intérieure |
0,7 |
3,8 |
3,2 |
2,7 |
2,5 |
|
Solde extérieur |
1,7 |
- 0,6 |
- 0,4 |
- 0,4 |
0,1 |
|
PIB marchand |
2,5 |
3,2 |
2,8 |
2,3 |
2,6 |
* Contribution moyenne pour les années 2001, 2002 et 2003.
Trois
observations se dégagent :
- la
contribution des échanges extérieurs
, qui a
constitué l'élément déterminant de la reprise de
l'activité en 1997, devient
fortement négative
de 1998
à 2000 ;
- la
demande intérieure
se redresse nettement à partir de
1998 et prend le relais de la demande étrangère
en
début de période
(1998-1999), avant de ralentir par la
suite ;
- la contribution des échanges extérieurs redevient positive en
fin de période sous l'effet de l'
amélioration
de
l'environnement international.
B. LES MÉNAGES
Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques du compte des ménages dans la projection.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉVOLUTION
DU COMPTE DES MÉNAGES
|
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001-2003* |
|
ÉVOLUTION EN POUVOIR D'ACHAT (en %) |
|
|
|
|
|
- Masse salariale |
3,2 |
3,5 |
2,8 |
2,5 |
|
- Prestations sociales |
2,5 |
1,9 |
2,4 |
2,2 |
|
- Revenu disponible brut |
3,1 |
2,5 |
2,2 |
2,4 |
|
CONSOMMATION DES MÉNAGES (en % et en volume) |
3,5 |
3,0 |
2,7 |
2,6 |
|
TAUX D'ÉPARGNE DES MÉNAGES (en points) |
14,3 |
13,9 |
13,4 |
12,9 |
* Taux d'accroissement annuel moyen sur les années 2001, 2002 et 2003 ou niveaux en points en 2003 pour le taux d'épargne.
•
L'évolution du pouvoir d'achat du
revenu des ménages
serait beaucoup plus soutenue sur le moyen terme (+ 2,5 % par an en
moyenne) qu'au cours des six dernières années (+ 1,6 %
par an de 1990 à 1997).
Trois facteurs expliqueraient cette évolution :
- la progression du
pouvoir d'achat du salaire par tête
(secteur
privé) serait de l'ordre de 1,6 % par an en moyenne entre 1998 et
2003 (contre 1 % par an de 1990 à 1997), la baisse du chômage
en début de période renforçant les revendications
salariales et se traduisant par une évolution des salaires plus
dynamique qu'au cours des années récentes
39(
*
)
;
- l'augmentation de l'emploi entraîne une progression de la masse
salariale (+ 2,8 % par an en moyenne), plus rapide que celle du
salaire par tête ;
- enfin, malgré leur ralentissement dont la projection retient
l'hypothèse, les
prestations sociales
contribuent de
manière significative à la croissance du revenu des
ménages (pour 0,7 point par an en moyenne).
|
CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE DU POUVOIR D'ACHAT DU REVENU DES MÉNAGES |
|||||
|
MOYENNES ANNUELLES EN POINT DE POURCENTAGE |
1998 |
1999 |
2000 |
2001-2003 * |
|
|
Revenu disponible brut |
3,1 |
2,5 |
2,2 |
2,4 |
|
|
dont : |
|
|
|
|
|
|
- Salaires bruts |
1,7 |
1,8 |
1,5 |
1,4 |
|
|
- Cotisations sociales (hors CSG) |
1,5 |
- 0,3 |
- 0,2 |
- 0,2 |
|
|
- Prestations sociales |
0,9 |
0,6 |
0,8 |
0,8 |
|
|
- Impôts (y compris CSG) |
- 1,8 |
- 0,2 |
- 0,3 |
- 0,2 |
|
|
- Revenus de la propriété |
0,8 |
0,6 |
0,5 |
0,7 |
|
|
* Contribution moyenne sur la période. |
|||||
On note
par ailleurs dans le tableau ci-dessus les effets du
transfert
d'une
partie des cotisations sociales des salariés vers la contribution
sociale généralisée " élargie "
40(
*
)
. Ce transfert instaure un prélèvement
sur les revenus du capital affecté au financement de la
Sécurité sociale et se traduit par une moindre progression du
revenu des ménages de l'ordre de 0,4 point par an.
• L'évolution de la consommation des ménages
dépend, outre de la progression du revenu disponible brut qui vient
d'être décrite, de celle du taux d'épargne.
En projection, deux facteurs concourent à la baisse du taux
d'
épargne
des ménages : le ralentissement de
l'évolution de leur revenu d'une part, la baisse du chômage,
d'autre part. Ainsi la consommation des ménages progresserait-elle plus
rapidement que leur revenu tout au long de la période de projection
(+ 2,8 % par an en moyenne contre + 2,5 % par an pour le
revenu disponible brut).
C. LES ENTREPRISES
Les principales caractéristiques du compte des entreprises et l'évolution de l'investissement sont décrites dans le tableau ci-dessous :
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉVOLUTION
DU COMPTE DES ENTREPRISES
|
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001-2003* |
|
RATIOS DU COMPTE DES ENTREPRISES (niveaux en points) |
|
|
|
|
|
- Taux de marge 1 |
40,2 |
39,2 |
38,5 |
37,5 |
|
- Taux d'investissement 2 |
14,9 |
15,3 |
15,6 |
15,5 |
|
- Taux d'autofinancement 3 |
110,5 |
102,0 |
97,0 |
95,6 |
|
INVESTISSEMENT
(évolution en volume et en %)
|
6,4 |
6,0 |
4,4 |
2,9 |
* Niveaux en 2003 et taux d'accroissement annuel moyen en volume pour l'investissement sur les années 2001, 2002 et 2003.
1 Taux de
marge : Excédent brut d'exploitation / Valeur ajoutée.
2 Taux d'investissement : Investissement / Valeur ajoutée.
3 Taux d'autofinancement : Epargne brute / Investissement.
La
projection décrit un " cycle d'investissement "
caractéristique d'une période de reprise, cependant de
courte
durée
. L'
effet " accélérateur "
de
l'investissement induit par l'augmentation des exportations en 1997, puis par
le dynamisme de la consommation en 1998, entraîne un net redressement de
l'investissement en 1998 et 1999 (respectivement + 6,4 % et
+ 6,0 %, après - 0,4 % en 1997). Par la suite,
l'investissement décélère pour se stabiliser sur un rythme
d'augmentation proche de celui du PIB.
Il faut observer que le
taux de marge
41(
*
)
des entreprises
diminuerait
de près de
3 points sur la période de projection, ce qui traduirait un
renversement de tendance par rapport à la première moitié
des années 90.
Par ailleurs, le
taux d'autofinancement
des entreprises,
supérieur à 100 % depuis le début des années
90, passerait
sous ce seuil
à partir de 2000, sous le double
effet de la baisse du taux de marge et du dynamisme retrouvé de
l'investissement sur la période 1998-2000.
D. LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS
Dans une
projection macroéconomique, l'évolution des échanges
extérieurs résulte essentiellement de deux variables :
- la
compétitivité-prix
, d'une part ;
- le
différentiel de croissance
entre la France et ses
partenaires, d'autre part : si la croissance de la France est
supérieure à celle de ses partenaires, la demande
étrangère en produits français évoluera moins vite
que la demande française en produits étrangers
(indépendamment des mouvements de compétitivité).
Ces deux variables joueraient de manière défavorable sur les
années 1998 à 2000. Tout d'abord, la baisse du dollar
entraîne une dégradation de la compétitivité
à l'exportation en 1998 et 1999, limitée toutefois par la
modération des coûts salariaux relativement à nos
partenaires non-européens. Au total, la compétitivité
à l'exportation baisse de 0,7 point de 1998 à 2000, avant de
se redresser en fin de période. Par ailleurs, la faiblesse de la demande
adressée à la France par ses partenaires en 1998 et 1999
(résultant des hypothèses décrites page 79)
entraîne une progression plus rapide des importations que celle des
exportations.
Il en résulte un profil contrasté de la
contribution
des
échanges extérieurs à la croissance :
- celle-ci est
négative
de 1998 à
2000 (- 0,6 point de croissance en 1998 puis
- 0,4 point en 1999 et 2000) ;
- elle redevient légèrement positive de 2001 à 2003, sous
l'effet du redémarrage de l'activité chez nos partenaires
non-européens et de l'amélioration de la
compétitivité-prix.
Compte tenu de ces évolutions, la capacité de financement de la
Nation (solde des opérations courantes) se contracte mais reste
cependant élevée. Elle passe de 2,9 % du PIB en 1997
à 2 % en 2000 et 2,3 % en 2003.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉVOLUTION
DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS
|
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001-2003* |
|
POURCENTAGE ANNUEL D'ACCROISSEMENT EN VOLUME |
|
|
|
|
|
- Demande étrangère de produits manufacturés |
6,3 |
5,0 |
6,3 |
5,7 |
|
- Exportations totales |
5,7 |
5,5 |
4,7 |
5,5 |
|
- Importations totales |
7,9 |
6,8 |
6,0 |
5,3 |
|
CONTRIBUTION DES ÉCHANGES
EXTÉRIEURS À LA
CROISSANCE
|
- 0,6 |
- 0,4 |
- 0,4 |
+ 0,1 |
|
TAUX DE
COUVERTURE EN VALEUR
(pourcentage moyen sur la période pour
l'ensemble des biens et services)
|
115,3 |
112,5 |
111,1 |
111,8 |
|
SOLDE
DES BIENS ET SERVICES
(en milliards de francs)
|
245,1 |
206,1 |
184,0 |
225,1 |
|
CAPACITÉ DE
FINANCEMENT DE LA NATION
(en % du
PIB)
|
2,9 |
2,4 |
2,0 |
2,3 |
* Taux de croissance annuel moyen pour les années 2001, 2002 et 2003 ou niveaux en 2003.
E. EMPLOI ET CHÔMAGE
Comme on
l'a indiqué ci-dessus, l'hypothèse retenue pour
l'évolution de la productivité par tête (+ 1,8 %
par an) est plus faible que la tendance observée au cours des dix
dernières années (+ 2 % par an en moyenne), mais plus
élevée que la moyenne des trois dernières années
(+ 1,5 % par an en moyenne de 1995 à 1997).
Selon cette hypothèse, la projection décrit une progression de
l'emploi total de 1 % par an en moyenne entre 1998 et 2003, soit en
moyenne
227 000 créations nettes d'emplois
par an, ou
encore
1,3 million
de créations nettes d'emplois en six ans.
Ce résultat tient compte de la création nette de 280 000
" emplois-jeunes " en trois ans dans le secteur non-marchand.
L'OFCE retient par ailleurs une hypothèse d'augmentation de la
population active
potentielle
de 154 000 par an. L'évolution
de la population active
effective
peut toutefois sensiblement
différer de celle de la population active potentielle : en effet,
en période de ralentissement de l'activité, des actifs potentiels
peuvent renoncer à se présenter sur le marché du travail
(" travailleurs découragés ") ; inversement, en
période d'amélioration conjoncturelle, des personnes
jusque-là découragés se présentent sur le
marché du travail, entraînant ainsi une évolution de la
population active observée supérieure à celle de la
population active potentielle.
Ces phénomènes de "
flexion des taux
d'activité
", simulés par le modèle, se
traduisent en projection par une augmentation de la population active effective
de
198 000 par an
.
Compte tenu de l'évolution plus rapide de l'emploi (227 000
créations nettes par an en moyenne), le nombre de chômeurs diminue
ainsi en moyenne dans la projection de 30 000 par an environ sur la
période 1998-2003. Cette diminution est sensible en début de
période (- 58 000 chômeurs en 1998 et
- 119 000 chômeurs en 1999) ; par la suite, le nombre de
chômeurs se stabilise et tend même à augmenter
légèrement.
Quant au taux de chômage, il passerait de 11,5 % en 1998 à
11 % en 2003. L'essentiel de la baisse se produirait toutefois en
début de période, le taux de chômage se stabilisant autour
de 11 % à partir de 2000.
EMPLOI ET CHÔMAGE
|
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001-2003* |
|
ÉVOLUTION MOYENNE (en milliers) |
|
|
|
|
|
- Emploi total |
305,3 |
386,5 |
219,1 |
151,9 |
|
- Population active totale |
247,3 |
267,0 |
214,3 |
154,1 |
|
- Nombre de chômeurs |
- 58,0 |
- 119,5 |
- 4,8 |
2,2 |
|
- Taux de chômage (au sens du B.I.T.) |
11,5 |
11,1 |
11,1 |
11,0 |
* Evolution annuelle moyenne sur la période et niveau en 2003 pour le taux de chômage.
F. LES PRIX
Une
baisse du taux de marge
des entreprises, comme c'est le cas en
projection (cf. page 88), peut induire des
tensions inflationnistes
si les entreprises souhaitent augmenter leurs prix afin de restaurer leur taux
de marge. Selon le modèle toutefois, le taux de marge ne
s'éloigne pas de manière suffisante du niveau souhaité par
les entreprises pour produire ce type d'enchaînement.
La projection confirme ainsi la tendance à la désinflation de
l'économie française. Les prix du
PIB marchand
comme les
prix à la
consommation
progresseraient de 1,3 % par an en
moyenne.
IV. TENDANCE DES FINANCES PUBLIQUES
Un
modèle macroéconomique tel que le modèle MOSAÏQUE ne
donne qu'une vision globale des finances publiques : évolution de
l'
ensemble de dépenses
des administrations publiques,
évolution des
grandes catégories de recettes
et, enfin,
évolution du
besoin de financement de l'ensemble
des
administrations publiques.
Toutefois, les experts de l'OFCE se sont attachés à en tirer un
maximum d'indications, notamment sur les questions suivantes :
- Quelle est l'
incidence
des évolutions
macroéconomiques
sur les
finances publiques
, en
particulier sur les conditions d'un
équilibre des finances
sociales
?
- Comment la contrainte générale de redressement des finances
publiques peut-elle s'appliquer aux diverses institutions publiques (Etat,
Sécurité sociale et collectivités locales en
particulier) ? Les experts sont ainsi conduits à avancer leurs
propres hypothèses
sur l'évolution
à moyen terme
des dépenses de l'Etat, ainsi que sur celles des prestations
sociales.
- Quelle est l'évolution du
besoin de financement
des
administrations publiques et celle de la
dette publique
qui en
résulte ?
A. LES RECETTES
La
projection des recettes publiques est réalisée à
législation constante, compte tenu des mesures annoncées par le
Gouvernement et de celles actuellement discutées par le Parlement
(projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 1999,
projet de loi de finances pour 1999).
Il a ainsi été tenu compte, notamment, de la baisse de la part
salariale dans la
taxe professionnelle
.
L'exercice suppose également une
stabilisation
de la TVA, des
taux de l'impôt sur les sociétés et des autres
impôts, aux niveaux atteints en 1999.
En effet, l'objectif de réduction du déficit public ne
permettrait pas de revenir sur certaines majorations d'impôt
récemment intervenues. Ainsi, l'augmentation de la fiscalité sur
les sociétés décidée en 1997 est-elle maintenue en
projection.
ÉVOLUTION DES RECETTES DES ADMINISTRATIONS
En % de PIB
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2003 |
|
|
|
|
|
|
Sources : Comptes nationaux. Prévision
OFCE-Modèle MOSAÏQUE.
* Non corrigé des allégements de cotisations sur les bas
salaires.
B. L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
La
projection repose sur l'hypothèse d'un ralentissement
global
des
dépenses des administrations publiques sur la période de
projection (1998-2003) : en francs constants
42(
*
)
, elles progresseraient en moyenne de 2 % par an
contre 2,7 % par an sur la période 1991-1997.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE L'ENSEMBLE
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(déflatées par le prix du PIB marchand)
|
|
1991-1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001-2003 |
|
ENSEMBLE
DES DÉPENSES
|
|
|
|
|
|
|
dont : |
|
|
|
|
|
|
- Masse
salariale
|
2,4
|
2,2
|
3,7
|
3,1
|
2,4
|
1. La masse salariale
En ce
qui concerne les
effectifs
des administrations publiques (Etat,
collectivités locales et hôpitaux), la projection
prolonge
l'évolution moyenne constatée depuis 1985, soit une augmentation
de 40 000 par an des emplois ordinaires. En outre les emplois-jeunes du
début de période accroîtraient au total de 350 000 le
nombre d'emplois dans les administrations
43(
*
)
.
Dans ces conditions, les effectifs des administrations augmenteraient de
1 % par an en moyenne entre 1998 et 2003.
La projection retient l'hypothèse d'une progression moyenne de
0,7 % par an entre 1999 et 2003 du pouvoir d'achat de l'
indice
brut
des
traitements
de la fonction publique. Cela suppose en 1999 et 2000
une
compensation
pour moitié des pertes passées du
pouvoir d'achat de cet indice
(- 0,7 % en 1996 et en 1997).
Par la suite, le pouvoir d'achat du salaire moyen dans la fonction publique
augmenterait de 0,5 % par an.
Au total, la
masse salariale
publique augmenterait de 2,2 % en
francs constants
44(
*
)
en 1998 et, en moyenne, de
2,7 % par an de 1998 à 2003 (contre 2,4 % par an de 1991
à 1997).
2. Les consommations intermédiaires
Pour
l'ensemble des administrations publiques, les consommations
intermédiaires (qui comprennent les
dépenses courantes
des
administrations hors dépenses de personnel, ainsi que les
dépenses militaires en capital
) augmenteraient en volume de
1,5 % par an en moyenne entre 1998 et 2003, soit un taux proche de celui
de la période 1991-1997 (1,6 % par an en moyenne).
Pour les
collectivités locales
, ceci se traduirait par un
ralentissement important (de 4,5 % par an en volume de 1991 à 1997
à 2 % par an de 1998 à 2003).
TAUX
DE CROISSANCE DES CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(Aux prix de 1980)
(en % par an)
|
|
1991-1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001-2003 |
|
-
Administrations centrales
|
- 0,7
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Pour la
Sécurité sociale
, la croissance en volume de cette
catégorie de dépenses
45(
*
)
serait
ramenée à 1,7 % par an en moyenne de 1998 à 2003,
contre 3 % par an de 1991 à 1997.
Les consommations intermédiaires de l'
Etat
ne progresseraient pas
en volume en 1998, puis croîtraient de 1 % par an à partir de
1999. Une réduction plus importante des dépenses militaires
permettrait éventuellement des économies supplémentaires.
Le
graphique
ci-après permet de visualiser l'évolution
relative des consommations intermédiaires des trois agents publics. On
constate que la tendance au
transfert
des dépenses de
l'
Etat
vers les
collectivités locales
se poursuivrait et
qu'en 2003 le volume des consommations intermédiaires des
collectivités locales rejoindrait pratiquement celui de l'Etat.
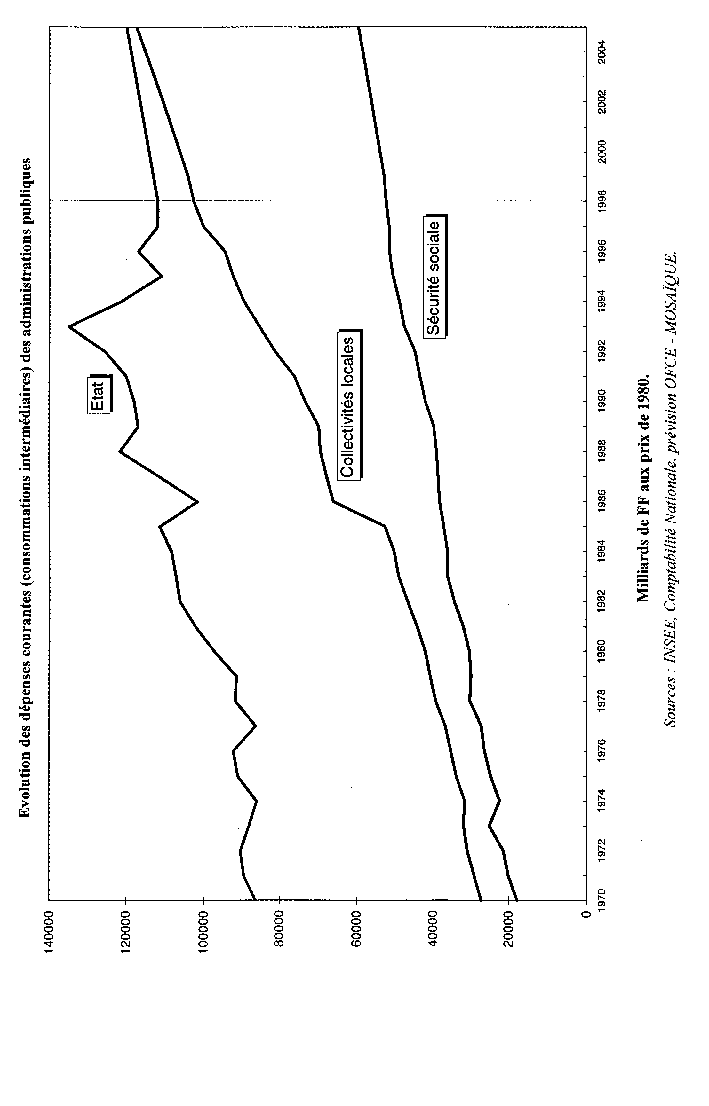
3. Les investissements publics
En matière d'investissements publics (qui, au sens de la comptabilité nationale, ne comprennent pas les dépenses militaires d'équipement), l'hypothèse retenue est celle d'une légère reprise de leur progression en volume (cf. tableau et graphique ci-dessous). Au total, celle-ci atteindrait seulement 1,4 % par an en moyenne, soit un taux de croissance inférieur quasiment de moitié à celui du PIB. Pour les collectivités locales, le taux de croissance serait plus élevé que celui observé de 1991 à 1997. Pour l'Etat, l'augmentation en volume serait limitée à 1,1 % par an. Enfin, les investissements des administrations de Sécurité sociale (qui, dans les définitions de la comptabilité nationale, incluent les investissements hospitaliers) augmenteraient de 1,3 % par an en volume, soit un freinage marqué par rapport à la période 1991-1997.
TAUX
DE CROISSANCE DES CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(Aux prix de 1980)
|
|
1991-1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001-2003 |
|
-
Administrations centrales
|
- 0,5
|
1,6
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
(1)
Ce concept inclut les hôpitaux.
Le
graphique
ci-dessous décrit l'évolution des
investissements publics et leur répartition en fonction des trois
sous-secteurs des administrations publiques.
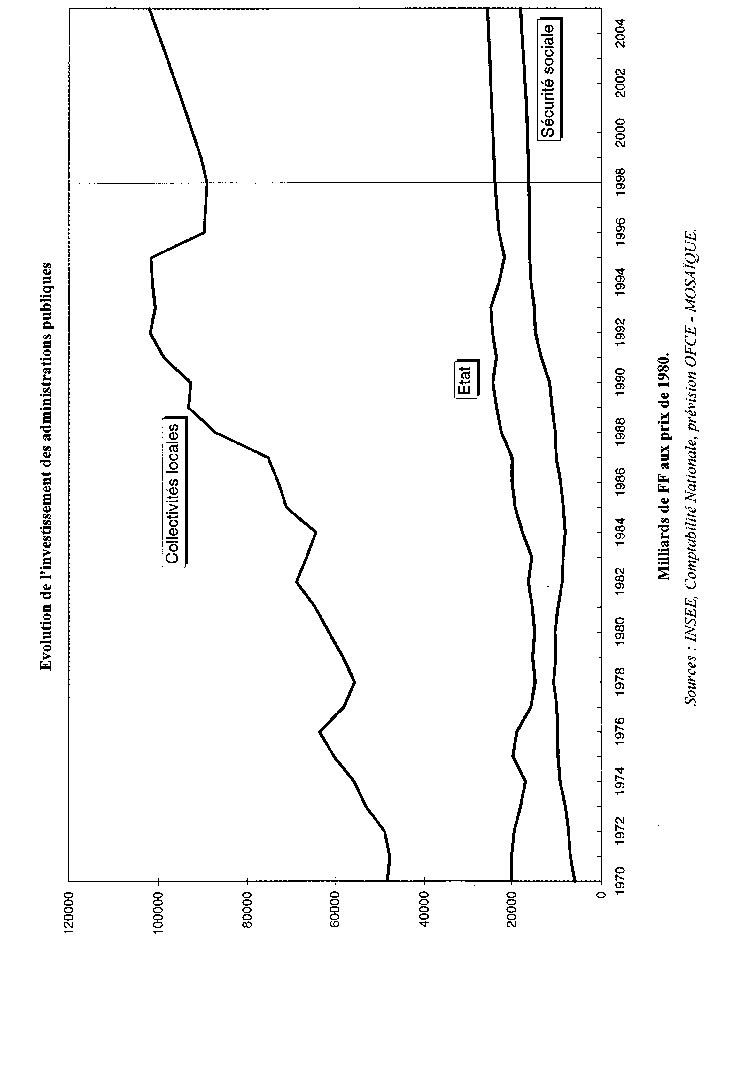
4. Les prestations sociales
a) Les prestations-maladie
Le
ralentissement
de la croissance
tendancielle
des dépenses
de santé observé depuis le début des années 1970 a
été encore plus
marqué
au cours de la
période 1991-1997. En
pouvoir d'achat
, les prestations-maladie
n'ont progressé que de 1,9 % par an en moyenne au cours de ces
années.
Cette évolution semble obéir à deux facteurs :
- la mise en oeuvre de plans de maîtrise des dépenses de
santé en 1993 et 1995 qui ont produit des effets immédiats :
les prestations-maladie n'ont ainsi progressé en pouvoir d'achat que de
0,8 % en 1994 et de 0,5 % en 1997 ;
- le ralentissement de la croissance et du revenu des ménages au cours
de cette période qui se traduit par le ralentissement de la consommation
de soins médicaux.
Les auteurs de la projection ont considéré que les
réformes contenues dans le " Plan Juppé " de 1995 et
dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour
1999 (qui mettent en oeuvre une nouvelle politique de gestion des soins)
pourraient infléchir
durablement
la tendance de l'augmentation
des dépenses de santé. Mais, par ailleurs,
l'accélération de la croissance et du
revenu
des
ménages, observée en projection, se traduirait par une
évolution plus rapide de la
consommation médicale
qu'au
cours des années récentes. Cette analyse s'appuie notamment sur
l'observation de l'évolution de la consommation médicale en 1998,
année de forte reprise économique : la prolongation des
résultats des premiers mois conduit en effet à retenir une
hypothèse de croissance en volume de 3,4 % sur l'ensemble de
l'année.
Au total, et afin de privilégier le caractère tendanciel de cet
exercice, les experts de l'OFCE ont ainsi retenu une hypothèse
d'évolution du pouvoir d'achat des prestations-maladie supérieure
à celle de la période antérieure, soit 2,7 % par an
en moyenne de 1998 à 2003, contre 1,9 % par an de 1991 à
1997.
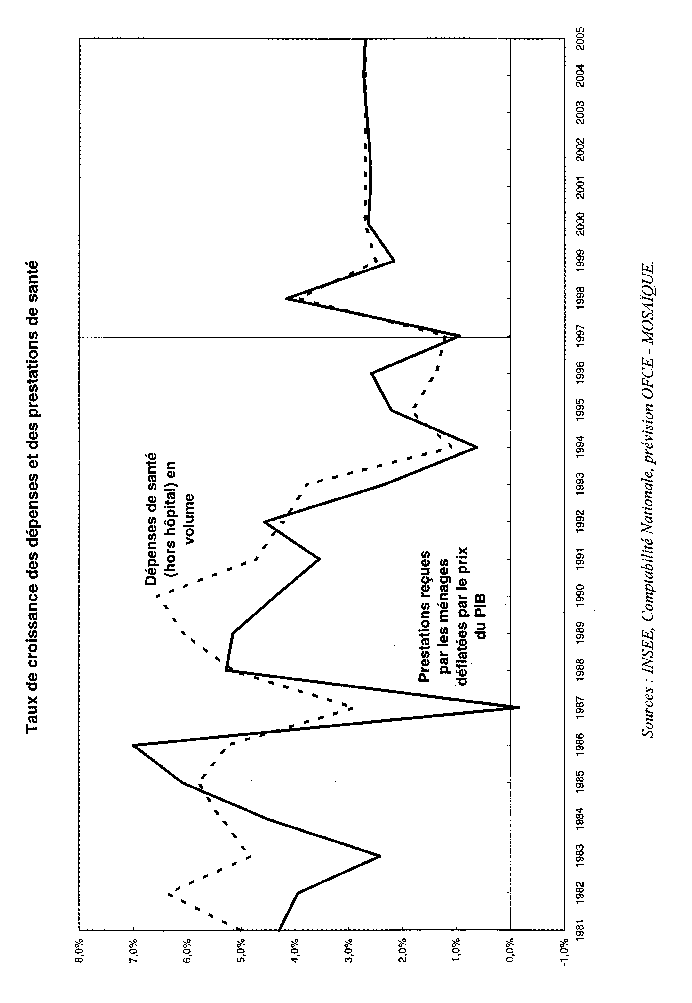
b) Les prestations-vieillesse
La
pression démographique sur les régimes de retraite serait
sensible à partir de 2005, avec l'arrivée à l'âge de
la retraite des classes nombreuses de l'après-guerre. Mais, au cours des
cinq prochaines années, l'arrivée à l'âge de la
retraite des
classes creuses
des années 1940 à 1943 se
traduirait au contraire par un
ralentissement
de l'évolution du
nombre de pensionnés.
Par ailleurs, la progression du montant unitaire des retraites resterait
faible, en raison du maintien de l'indexation sur les prix et de la
montée en charge de la réforme du régime
général (allongement de la période de cotisation
nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein et modification
du calcul du salaire de référence
46(
*
)
).
Les mesures d'équilibrage décidées par les régimes
complémentaires (baisse du rendement) contribueraient à la
maîtrise de leurs dépenses.
L'augmentation du pouvoir d'achat de la
retraite par tête
serait
ainsi limitée à 1 % par an d'ici 2003.
Au total, l'augmentation en volume des
prestations-vieillesse
serait de
2,1 % par an en moyenne de 1998 à 2003 (contre 2,5 % par an en
moyenne de 1991 à 1997).
c) Les prestations-familiales et le Revenu Minimum d'Insertion
Malgré la suppression de la mise sous conditions de
ressources des allocations familiales, la masse des prestations-familiales
progresserait faiblement en raison du ralentissement démographique.
Pour l'allocation-logement, la croissance serait plus rapide, sans
dépasser toutefois celle du PIB.
L'augmentation des dépenses au titre du Revenu Minimum
d'Insertion
47(
*
)
se prolongerait en projection
du fait, notamment, que l'assurance-chômage ne prend plus en charge les
titulaires d'emplois précaires. Néanmoins, par rapport aux
périodes antérieures, on observerait un ralentissement de la
croissance des dépenses allouées au RMI.
L'ensemble
prestations familiales et dépenses pour le RMI
croîtrait ainsi en volume de
2,1 % par an
en moyenne de 1998
à 2003 (après 2,9 % par an de 1991 à 1997).
d) Les prestations-chômage
L'évolution des prestations-chômage serait
influencée en projection par trois facteurs :
- l'évolution en projection du nombre de chômeurs : celui-ci
diminue de 1998 à 2000, avant de se stabiliser par la suite ;
- la diminution de l'indemnité moyenne de chômage
en
début de période
, conséquence de la non prise en
charge par l'assurance-chômage des titulaires d'emplois
précaires ;
- l'hypothèse d'une
revalorisation
des prestations
à
partir de 2000
, en raison de l'amélioration des comptes du
régime d'indemnisation.
L'évolution en volume des
prestations-chômage
recouvrerait
ainsi un profil contrasté : elles augmenteraient de 0,5 % en
1998, diminueraient de 1,7 % en 1999 (en raison de la diminution du
chômage), augmenteraient à nouveau de 3,8 % en 2000 (en
raison de l'hypothèse de l'évolution du régime
d'indemnisation), puis croîtraient de 1,1 % en moyenne de 2001
à 2003.
Au total, les prestations-chômage en volume augmenteraient de 1 %
par an en moyenne de 1998 à 2003 (contre 4,9 % par an de 1991
à 1997).
Comme l'indique le
tableau
récapitulatif ci-dessous, le pouvoir
d'achat de l'
ensemble des prestations sociales
augmente en projection de
2,3 % par an en moyenne, contre 2,6 % par an pour la période
1991-1997.
Les prestations sociales progressent ainsi
moins vite
que le PIB total
(2,6 % par an en moyenne),
contrairement
à la période
1991-1997 (+ 2,6 % pour les prestations sociales et + 1,3 %
pour le PIB).
ÉVOLUTION DU POUVOIR D'ACHAT DES PRESTATIONS SOCIALES
|
|
1991-1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001-2003 * |
|
POURCENTAGE ANNUEL D'ACCROISSEMENT |
|
|
|
|
|
|
-
Famille, logement et RMI
|
2,9
|
2,9
|
1,7
|
1,9
|
2,0
|
* Taux d'accroissement annuel moyen entre 2001 et 2003.
C. LE BESOIN DE FINANCEMENT ET LA DETTE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
•
Exprimé en pourcentage du PIB, le
besoin de financement
des
administrations publiques, au sens de la
Comptabilité
européenne
, se réduirait continûment en
projection : de 2,9 % du PIB en 1998 à 1,2 % en 2003.
L'essentiel de la réduction du déficit public s'opérerait
toutefois en début de période (- 0,6 point de PIB en
1999 et - 0,4 point en 2000) (cf.
tableau
ci-après).
Pour autant qu'il soit possible de passer de la nomenclature de
Comptabilité nationale à celle de la Sécurité
sociale, on peut déduire des
évolutions
macroéconomiques
décrites par la projection et des
hypothèses
relatives à l'évolution des prestations
sociales, que les
comptes des régimes sociaux se
rééquilibreraient progressivement
, sans majoration des
cotisations. En effet, l'augmentation annuelle moyenne des prestations sociales
en valeur entre 1998 et 2003 (3,6 %) serait inférieure à
celle du PIB en valeur (3,9 %) et à celle de la masse salariale en
valeur, qui progresse en projection légèrement plus vite que le
PIB (4,1 %).
En particulier, les comptes du régime d'assurance-maladie ne se
dégradent pas en projection, malgré l'hypothèse retenue
par les experts de l'OFCE d'une accélération des dépenses
maladie par rapport aux évolutions observées de 1991 à
1997 (cf. page 100). Malgré cette hypothèse, celles-ci
progresseraient en effet sensiblement comme la masse salariale.
• Lorsque le taux d'intérêt moyen de la dette publique est
supérieur au taux de croissance de l'économie - cet
écart est communément qualifié d'" écart
critique " -, il faut un
excédent
budgétaire
primaire
- c'est-à-dire hors charges d'intérêts -
pour stabiliser le ratio dette / PIB. Cet excédent stabilisant le ratio
dette / PIB doit être d'autant plus substantiel que le
stock de
dette
existant est élevé et que la
différence
entre le
taux d'intérêt
et le
taux de croissance
est
importante.
L'hypothèse d'une baisse des taux d'intérêt en Europe (de
5,7 % en 1997 à 4 % en 2003 pour les taux à long terme)
et l'accélération de la croissance du PIB observée en
projection concourent à réduire l'écart entre taux
d'intérêt et taux de croissance et, ainsi, le niveau de
l'excédent budgétaire requis pour stabiliser le ratio dette / PIB.
Selon les calculs des experts de l'OFCE, ce niveau est pratiquement atteint en
1999, la dette publique n'augmentant que de 0,2 point de PIB, puis
dépassé par la suite, permettant une réduction de la dette
publique de 2,3 points de PIB entre 2000 et 2003.
Le ratio dette publique / PIB passerait ainsi de 58,4 % en 1998 à
56,3 % en 2003.
L'incidence favorable de la baisse des taux d'intérêt et la
réduction du ratio de dette publique concourraient ainsi à la
diminution de la
charge
nette des
intérêts
versés par les administrations publiques, exprimée en pourcentage
du PIB : celle-ci passerait de 3,2 % en 1998 à 2,7 % en
2003.
ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ DE FINANCEMENT ET DE
LA
DETTE
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(en % du PIB)
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2003 |
|
- Capacité de financement (1) (2) |
- 3,0 |
- 2,9 |
- 2,3 |
- 1,9 |
- 1,2 |
|
- Dette (3) |
57,7 |
58,4 |
58,6 |
58,5 |
56,3 |
(1)
Capacité de financement au sens de la Comptabilité
européenne.
(2)
Résultats tirés du modèle MOSAÏQUE.
(3) Calculs de l'OFCE.
ANNEXE
N° 2
IMPACT DE LA CRISE ASIATIQUE ET INCERTITUDES DANS L'ÉCONOMIE MONDIALE EN
1998-1999 : QUELQUES ÉVALUATIONS AVEC MIMOSA
Etude réalisée par la Division économie
internationale
du Département analyse et prévisions de
l'OFCE
(Hervé LE BIHAN et Christine RIFFLART)
Introduction
Des contraintes internes (taux d'intérêt élevés,
faible demande intérieure, ajustements budgétaires) ont
alimenté une " croissance molle " en Europe depuis le
début des années quatre-vingt-dix. Le dynamisme retrouvé
de la demande intérieure semblait promettre aux économies
européennes pour les années 1998-99 une vigoureuse expansion,
analogue à celle connue de 1986 à 1990. Le choc de la crise
asiatique et son extension à différentes zones émergentes
sont venus mettre en question ce scénario.
Après un retour sur l'émergence et la propagation de la crise
asiatique, notre étude présente une évaluation
macroéconomique quantitative de l'impact sur l'économie mondiale
de la crise asiatique et de son extension aux pays émergents. Elle
illustre ensuite certaines incertitudes caractérisant
l'environnement international actuel : les aléas relatifs
à la crise japonaise ; l'impact de la baisse du dollar ; les
réactions de la politique monétaire à la crise asiatique.
L'étude n'intègre pas cependant le repli récent des cours
boursiers dans les pays de l'OCDE, dans la mesure où une part notable
n'est pas liée directement à la crise asiatique.
La crise asiatique et sa propagation : bref historique
Emergence et crise des économies dynamiques d'Asie
Après le décollage des NPI d'Asie (Corée du sud,
Singapour, Taiwan, Hongkong) pendant la décennie quatre-vingt, une
deuxième génération de pays (Indonésie, Malaisie,
Philippines Thaïlande) a pris le relais, portant le taux de croissance
moyen de la zone Asie en développement à 8,5 %
48(
*
)
par an sur la première moitié des
années quatre-vingt-dix (dont 10,5 % pour la Chine).
La vigueur de cette expansion a été soutenue par une
stratégie d'industrialisation reposant sur trois principes :
développement des exportations, libéralisation des mouvements de
capitaux et stabilité des taux de change face au dollar. La part des
exportations dans le PIB s'est accrue sensiblement pour atteindre 45 % du
PIB dans les NPI et près de 30 % en moyenne dans les autres pays.
Rassurés par l'absence du risque de change et les bonnes perspectives de
rendement, les capitaux étrangers sont venus compléter une
épargne domestique déjà abondante. Les dépenses
d'investissement ont augmenté fortement pour atteindre 43 % du PIB
en Thaïlande et en Malaisie et 30 % en Indonésie au milieu de
la décennie. Cette croissance s'accompagnait de déficits courants
faibles jusqu'en 1994 ; l'excédent de financement externe venait
gonfler les réserves en devises des banques centrales locales.
En 1995, cette croissance apparemment vertueuse a commencé à
montrer ses limites. Le renchérissement du dollar vis-à-vis des
monnaies européennes et surtout japonaise conjuguée à des
tensions sur les prix de production ont affaibli sensiblement la
compétitivité de ces pays, déjà confrontés
à un moindre dynamisme de la demande qui leur était
adressée. Le déficit des balances courantes s'est accru,
particulièrement en Thaïlande et en Malaisie, nécessitant la
mise en place de politique restrictives dans l'ensemble de la zone.
Le ralentissement d'activité a mis à jour les dysfonctionnements
internes qui découlaient de la stratégie de change retenue et de
l'absence de régulation financière. Le maintien de l'objectif de
stabilité des taux de change face au dollar est devenu de plus en plus
incompatible avec la possibilité de mener la stabilisation
conjoncturelle appropriée. L'afflux de capitaux externes, sous forme
d'investissements directs mais aussi de prêts, a donné lieu
à une croissance incontrôlée des crédits bancaires
du fait d'une régulation interne des systèmes financiers
très insuffisante (opacité des comptes, non respect des
règles prudentielles,..). De 1990 à 1997, les taux d'expansion du
crédit bancaire au secteur privé atteignaient 18 % en
Indonésie, Philippines et Thaïlande et 16 % en Malaisie, soit
2 à 2,5 fois plus rapide que la croissance du PIB. En 1997, ces
crédits représentaient 100 % du PIB en Thaïlande et
Malaisie. Enfin, si l'emballement du crédit a nourri l'investissement
productif, il a également été utilisé à des
fins purement spéculatives, notamment sur les marchés boursiers
et immobiliers. En 1996, la capitalisation boursière atteignait
315 % du PIB en Malaisie, 100 % aux Philippines et à
Taïwan contre 110% aux Etats-Unis, 68% au Japon, 29% en Allemagne.
Prenant tardivement et brutalement conscience des limites de cette
envolée financière de plus en plus déconnectée de
la sphère réelle, les marchés ont réagi violemment.
La crise de défiance qui a éclaté le 2 juillet 1997
vis-à-vis du baht thaïlandais (la Thaïlande est le pays qui
présentait le plus de fragilité) s'est traduite par un retrait
massif des capitaux de la zone entraînant la chute des marchés
boursiers et, par un effet de conversion des actifs en dollars, la chute des
monnaies. Ce mouvement s'est propagé dans l'ensemble de la zone. Entre
le début de la crise et le point bas de janvier 1998, les monnaies se
sont dépréciées de 70 % en Indonésie,
50 % en Thaïlande et en Corée du sud, et de 40 % en
Malaisie et aux Philippines.
Le renchérissement en monnaie locale des engagements extérieurs
en dollars, combiné à la forte dévalorisation de l'actif
des établissements financiers, ont conduit à la montée des
créances douteuses et à l'insolvabilité de nombreux
établissements financiers. La crise de liquidités qui s'est
étendue a fragilisé les entreprises et créé
d'importants problèmes à l'offre productive. La Thailande,
l'Indonésie, et la Corée du sud ont été
obligés de recourir à l'assistance financière du FMI.
La Chine dont le risque de change reste faible du fait d'une
convertibilité limitée de la devise, n'a pas été
épargnée par la tourmente. La dévaluation du Yuan en 1994
qui avait relancé la compétitivité à l'exportation
a été effacée par celles des pays voisins. Le soutien
à la croissance recherché à l'extérieur pour
compenser l'effet des restructurations internes, notamment des entreprises
d'Etat, est fortement remis en cause, surtout dans un environnement
international très déprimé.
Des politiques d'ajustement classiques, sous la conduite ou largement
inspirées du FMI ont été mises en place :
relèvement des taux d'intérêt pour stabiliser les
parités et resserrement de la politique budgétaire.
Simultanément, des plans de restructurations des systèmes
financiers locaux ont été proposés dans les pays les plus
sinistrés. En Indonésie, Corée du sud et Thaïlande,
les créances douteuses atteignent 40 % du PIB.
L'activité au premier semestre 1998 a été
particulièrement déprimée en Indonésie et en
Thaïlande (la production industrielle a chuté de près de
20 % un an). En Corée du Sud, Malaisie et Hong Kong, la
récession est installée depuis le début de l'année
(chute du PIB de 6,6, 6,8 et 5 % respectivement sur un an au
deuxième trimestre). La Chine qui évoluait au rythme de 8 %
au second semestre 1997, a ralenti à 7 % ; les inondations de
l'été 1998 pourraient amputer encore de plus d'un point la
croissance. La forte intégration régionale de cette zone
crée un enchaînement dépressif cumulatif renforcé
par le fait que l'économie japonaise qui aurait pu constituer, comme les
Etats-Unis en 1995 pour le Mexique, un moteur de croissance
via
les
exportations, est elle aussi en récession.
L'impact maximal du choc financier en Asie a été atteint vers le
milieu de l'année 1998. Les marchés des changes se sont
stabilisés et dans certains pays (Corée du sud, Thaïlande),
les taux d'intérêt ont pu être desserrés. Par contre,
la baisse du yen à 145 yen pour un $ durant les mois d'été
a contribué à relancer les craintes d'un nouveau round de
dévaluations compétitives dans la région, intégrant
cette fois la Chine. Le scénario retenu dans les prévisions de
l'OFCE (voir OFCE 1998b) considère que le yen retrouvera un niveau de
parité avec le dollar de 133, plus acceptable pour les pays voisins.
Dans ces conditions, on peut attendre une stabilisation de l'activité
dans les pays en crise au deuxième semestre. Au total, la croissance
dans l'ensemble de la zone devrait être nulle en 1998 et repartir
timidement en 1999.
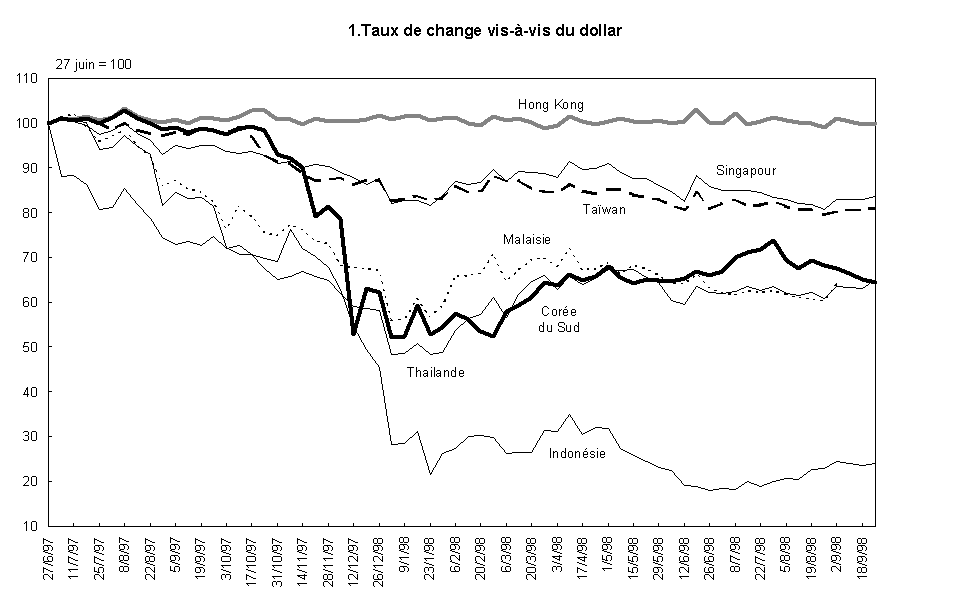
Source
: The Economist
La
baisse du prix du pétrole et des matières premières
Le prix du baril du pétrole est tombé de 19 $ en novembre 1997
à 13,5 $ en mars 1998, puis aux alentours de 12 $ jusqu'à la fin
du mois de septembre. Cette franche baisse a pu être influencée
par différents facteurs, dont des facteurs d'offre, notamment le
relèvement des quotas de production décidé par les pays de
l'Opep en décembre dernier et des niveaux de stocks élevés
chez les pays industriels. Mais elle est essentiellement due au recul de la
demande en provenance d'Asie qui reste un important consommateur. Selon des
estimations du Department of Energy américain faites en juin, l'impact
de la crise sur la demande de pétrole serait d'environ 0,6 mbj.
Malgré la réduction de la production de pétrole
décidée en mars et en juin dernier pour tenter de stabiliser les
cours, les prix du Brent sont restés à un niveau plancher,
plombés par un excédent d'offre qui devrait perdurer en 1999.
Les cours des matières premières sont également fortement
orientés à la baisse du fait de la crise asiatique : en
septembre dernier, l'indice global a baissé de 22 % sur un an, et
celui concernant les métaux de 25 % (- 35 % pour le cuivre).
L'Asie consomme 35 % de la production mondiale d'aluminium, 40 % de
celle de cuivre et 60 % de celle de coton.
La propagation à l'Amérique Latine
La première moitié des années quatre-vingt-dix a
été marquée en Amérique latine par la mise en place
de politiques de lutte contre l'inflation qui ont pesé fortement sur la
croissance régionale : celle-ci a été de 3 %
par an en moyenne dans la région avec des rythmes malgré tout
différentiés selon qu'il s'agisse du Brésil (1,5 %
par an) ou de l'Argentine (6,8 % jusqu'en 1994) et du Chili par exemple.
Ces politiques d'ajustement ont reposé essentiellement sur l'ancrage des
monnaies locales au dollar, soit par un système de currency
board
49(
*
)
comme en Argentine, ou par un
système à crémaillère (
crawling
peg
)
50(
*
)
. Ces politiques ont permis de
réduire significativement l'inflation mais les résultats restent
fragiles. Les capitaux étrangers ont été attirés
par la confiance dans l'absence de risque de change et par de vastes programmes
de privatisations mais leur forte volatilité en fait des facteurs
d'instabilité. Confronté à des problèmes de
compétitivité et à un déficit courant très
élevé en 1994, le Mexique a été contraint à
dévaluer massivement le peso et de faire face à une crise de
défiance. Depuis, le peso flotte librement sur le marché. De
telles turbulences avaient également touché l'Argentine qui avait
dû faire face à une sévère récession. A
l'orée de la crise asiatique, les conditions de croissance
latino-américaine étaient cependant favorables. Les
déséquilibres étaient en voie de résorption
(inflation, endettement extérieur, finances publiques, volatilité
des flux de capitaux). En 1997, l'activité avait progressé de
5 % en moyenne et les perspectives de croissance pour 1998 étaient
satisfaisantes.
L'impact de la crise asiatique en Amérique latine transite par
différents canaux. Tout d'abord, de nombreuses économies sont
fortement exposées à la baisse de la demande en provenance
d'Asie. Ce marché représente 33 % des exportations du Chili,
23 % de celles du Pérou, 15 % de celles du Brésil et
10 % de celles de l'Argentine.
Ensuite, l'avantage de change des pays d'Asie devrait renforcer leur
compétitivité sur les marchés tiers (pour la Corée
du sud, les prix à l'exportation en dollars ont baissé de
20 % sur un an au premier semestre) alors que l'exposition des produits
d'Amérique latine à la concurrence asiatique porte sur la
moitié des ventes à l'étranger. Par ailleurs, la
compétitivité des produits d'Amérique latine est
déjà dégradée du fait de la surévaluation
des monnaies locales.
Par ailleurs, l'effet dépressif de la crise asiatique sur le cours du
pétrole et des matières premières fragilisent certains
pays fortement engagés sur les secteurs primaires, comme le
Vénézuela ou l'Equateur dont les exportations dépendent
à 75 % et 30 % respectivement, du pétrole.
De plus, la crise asiatique a eu des répercussions financières
sensibles. A partir d'octobre dernier, après la chute des cours sur les
principales places boursières asiatiques, une crise de défiance
s'est installée vis-à-vis de l'ensemble des pays
émergents, provoquant une chute des bourses locales et une fragilisation
des changes. Des politiques monétaires restrictives ont
été très rapidement mises en place, créant un
rempart de protection. Au Brésil, pays le plus affecté, les taux
d'intérêt ont doublé pour atteindre 45 % (40 % en
terme réel), créant par un effet pervers, un
renchérissement du service de la dette interne et un creusement du
déficit budgétaire. Le resserrement monétaire
s'était accompagné d'un ajustement budgétaire. Cette
préférence pour des placements plus sûrs (
flight to
quality
) avait fait augmenter les primes de risques en Amérique
latine.
Cette première crise a été suivie d'une période de
rémission de plusieurs mois, qui a permis une certaine détente
monétaire. Mais les turbulences de l'été 1998 en Asie
(nourries par la chute du yen, la récession japonaises et la crainte de
voir dévaluer le yuan chinois), et la crise russe (défaut de
paiements de la dette et forte dévaluation du rouble) ont
alimenté une nouvelle crise de défiance vis-à-vis de
l'Amérique latine, plus sévère que la
précédente.
De nouveau, les politiques d'ajustement sont entrées en vigueur
très rapidement pour freiner l'hémorragie de capitaux : au
Brésil, plus de 30 milliards de $ seraient sortis depuis la
mi-août. Les attaques spéculatives qui sévissent sont
alimentées par plusieurs facteurs structurels : les taux de change
régionaux restent fortement surévalués ; les
déficits budgétaires se creusent (forte dépendances des
recettes fiscales aux exportations de matières premières dans
certains pays, ralentissement de la croissance, hausse du service de la
dette) ; les déséquilibres courants restent
élevés.
Le peso colombien et le sucre équatorien ont déjà
été contraints à la dévaluation (9 et 15 %
respectivement). Les marchés anticipent un décrochage prochain du
peso vénézuelien (crainte d'un défaut de paiement à
la suite des élections présidentielles de décembre
prochain). Le real brésilien reste très fragile.
Face à la propagation à l'échelle mondiale de
l'instabilité financière et des risques qu'elle pose, la
communauté internationale s'implique de plus en plus dans la gestion de
cette crise pour trouver une solution de sortie et tenter de stabiliser les
marchés.
L'hypothèse faite dans cet exercice est que l'Amérique latine
résistera aux pressions des marchés et donc que les principales
monnaies (le réal en particulier) ne dévalueront pas. Il
n'empêche que les grands pays ne pourront éviter la
récession en 1999, et que les autres continueront de pâtir du bas
prix de leurs exportations de matières premières.
L'impact sur les pays de l'OCDE
Les canaux de transmission principaux de la crise aux économies de
l'OCDE
51(
*
)
incluent à la fois les liens
commerciaux, les marchés financiers et les prix des matières
premières. Les effets de la crise jouent dans des sens contraires :
la contraction des importations des pays asiatiques liée à la
fois à la chute de la demande interne et leurs gains de
compétitivité devraient pénaliser les pays de l'OCDE,
tandis que sur les marchés financiers, la
fuite vers la
qualité
provoque une baisse des taux longs favorable à la
croissance.
Les taux d'intérêt de long terme ont rapidement été
baissés dans les pays de l'OCDE : sur les titres publics, ils
atteignent mi-septembre 1998 5,2 % aux Etats-Unis contre 5,6 %
en avril et 6,5 % en juin 1997 ; en Allemagne 4,2 contre 4,9 et
5,6 ; au Japon, 1,0 contre 1,7 et 2,6 .
Il est encore prématuré de dresser un bilan de l'impact
commercial de la crise. A la mi-1998, les gains de compétitivité
des pays asiatiques ne se sont pas traduits par des gains de parts de
marché dans l'OCDE. Cependant une dégradation du commerce
extérieur de l'OCDE vis-à-vis des pays en crise a
déjà été observée dont la source principale
est le recul des volumes exportés. Ainsi dans le cas de la France, les
exportations vers l'Asie ont contribué pour - 1 point à la
variation des exportations totales entre le premier semestre 1997 et le premier
semestre 1998 (voir OFCE, 1998c). L'ampleur du choc pour les différents
pays de l'OCDE dépend de leurs degrés respectifs d'ouverture
extérieure et de présence sur les marchés en crise
(tableaux 1 et 2). Le Japon est le pays de l'OCDE le plus exposé sur les
marchés asiatiques. Les Etats-Unis viennent en seconde position mais la
plus forte part des marchés asiatiques dans leurs exportations est
compensée par un taux d'ouverture plus faible que celui des pays
européens. Si l'on inclut le commerce avec l'Amérique Latine les
Etats-Unis deviennent aussi exposés que le Japon : les exportations
totales vers les deux zones représentent 3,1 et 3,3 % de leurs PIB
respectifs. Pour l'Europe, ce ratio n'est que de 2,2 %.
|
1. Part des pays émergents dans les exportations des grands pays et zones (en % des exportations totales) |
|||||||||||||||||||
|
|
Etats-Unis |
Japon |
Alle-magne |
France |
Italie |
Roy.-
|
UE Nord |
UE Sud |
Autre UE |
Autre Europe |
Autre OCDE |
PECO |
CEI |
Amér. latine |
Moyen- Orient |
Afrique noire |
NPI |
Autre Asie |
|
|
NPI |
8,1 |
15,4 |
1,5 |
1,9 |
2,1 |
3,4 |
1,7 |
0,7 |
1,7 |
3,6 |
3,6 |
2,0 |
3,5 |
2,8 |
5,3 |
7,5 |
7,7 |
14,0 |
|
|
Autre Asie |
5,9 |
13,2 |
2,5 |
2,9 |
2,2 |
4,4 |
2,7 |
1,9 |
2,6 |
2,9 |
4,5 |
2,2 |
5,5 |
2,5 |
5,7 |
2,9 |
13,1 |
5,6 |
|
|
Amér. Latine |
15,5 |
4,4 |
1,9 |
3,9 |
2,8 |
1,8 |
1,3 |
3,8 |
2,2 |
2,8 |
2,4 |
1,5 |
2,0 |
20,1 |
2,9 |
2,0 |
2,4 |
2,8 |
|
|
CEI |
0,7 |
0,7 |
1,1 |
0,9 |
1,7 |
1,6 |
5,3 |
0,9 |
2,4 |
1,0 |
0,8 |
8,3 |
0,0 |
0,7 |
3,8 |
1,1 |
0,9 |
2,0 |
|
|
Source : base de donnée MIMOSA ; année : 1995. |
|||||||||||||||||||
|
2. Part des exportations de marchandises dans le PIB (en % du PIB) |
|||||||||||||||||||
|
|
Etats-Unis |
Japon |
Alle-
|
France |
Italie |
Roy.-
|
UE Nord |
UE
|
Autre UE |
Autre Europe |
Autre OCDE |
PECO |
CEI |
Amér. latine |
Moyen- Orient |
Afrique noire |
NPI |
Autre Asie |
|
|
Biens |
10,4 |
10,0 |
29,8 |
25,1 |
27,5 |
27,2 |
57,6 |
27,6 |
37,7 |
35,7 |
30,5 |
32,2 |
22,6 |
17,6 |
31,6 |
26,2 |
45,1 |
27,7 |
|
|
Source : base de donnée MIMOSA ; année : 1995. |
|||||||||||||||||||
Evaluation quantitative : les hypothèses
Méthode
Cette section présente une évaluation de l'impact de la crise
asiatique sur l'économie mondiale au cours des années 1997
à 1999, réalisée en utilisant le modèle
multinational MIMOSA. La variante présentée met à jour
l'étude réalisée en avril 1998 (voir Régnault,
1998) en incorporant les informations désormais disponibles sur
l'approfondissement de la crise en 1998, ainsi que des hypothèses sur
l'impact des chocs les plus récents (extension à Amérique
Latine et à la Russie).
Si un modèle multinational constitue un instrument adapté
à l'analyse des interactions internationales, il convient de rappeler
les nombreuses incertitudes de ce type d'exercice. D'une part simuler l'impact
de la crise suppose comme référence un scénario d'absence
de crise. La pertinence et la cohérence d'un tel scénario sont
sujettes à caution si l'on considère que les régimes de
change et de financement de la Thaïlande, l'Indonésie etc.
n'étaient pas soutenables à moyen terme. On a ici construit un
scénario fictif de croissance régulière où les pays
émergents poursuivaient leur expansion au rythme tendanciel des
années 1991-96, tandis que le prix des matières premières
évoluaient de façon régulière et que les taux
d'intérêt connaissaient leur évolution cyclique habituelle.
La crise asiatique s'est propagée à nombreuses zones
géographiques et marchés (financiers, matières
premières). Il est difficile et parfois arbitraire de départager
les événements qui doivent lui être rattachés de
ceux qui, bien que simultanés, relèvent essentiellement d'une
évolution autonome. Une telle question se pose par exemple dans le cas
de la crise russe, la crise asiatique ayant au plus un rôle de
déclic compte-tenu de l'ensemble des déséquilibres
internes. Nous avons choisi d'écarter de la variante deux
événements notables des derniers mois : la baisse
récente des cours boursiers dans l'OCDE relève en partie d'une
correction attendue d'une hausse excessive ; son effet sur
l'économie réelle est difficile à évaluer ;
l'aggravation de la récession japonaise en 1998 s'explique surtout par
des facteurs internes ; elle fait cependant l'objet d'une
évaluation séparée. Les hypothèses précises
de notre simulation figurent dans le tableau 3.
Pays asiatiques : scénario de croissance et commerce
extérieur
L'Asie est décrite dans le modèle MIMOSA en deux zones
agrégées : les NPI et le reste de l'Asie. La variante
retient le scénario suivant pour ces deux zones
52(
*
)
:
la croissance du PIB est réduite de 6 % en 1998 et 5 % en
1999 dans les NPI ; et de 7 % et 4 % dans le reste de l'Asie,
la croissance des importations est réduite de 15 % puis de 5
à 7 % en 1999 dans les deux zones ;
la modification des parités est intégrée, mais, en raison
des comportements de marge et de la pénurie de devises, la
dépréciation n'est que partiellement répercutée
dans les prix à l'exportation en dollar des pays asiatiques. Ces
derniers sont plus bas de 10 % à partir de 1998,
les exportations des pays d'Asie sont moins élevées, à la
fois en raison du recul du commerce intra-zone, et en raison des
problèmes de trésorerie et de désorganisation de la
production qui empêchent de tirer pleinement parti du gain de
compétitivité.
Prix des matières premières
Contrairement aux prévisions du début de l'année 1998, le
prix du pétrole ne s'est pas redressé. En moyenne annuelle il est
passé de 19,1 dollar le baril à 13,0 entre 1997 et 1998. Nous
incorporons une baisse de 30 % à partir de 1998 du prix du
pétrole. Le prix des matières premières a également
baissé. Nous introduisons un choc de 10 % à la baisse sur le
prix des matières premières en 1998.
Taux d'intérêt
Les taux d'intérêt courts des Etats-Unis et de l'Allemagne sont
grosso modo
stables depuis 1997. Cependant, nous estimons que dans le
scénario de référence,
i.e.
en l'absence de crise,
une hausse de ces taux aurait accompagné en 1998 et en 1999 le
développement de la reprise européenne et le risque de tensions
inflationnistes aux Etats-Unis. Aussi, notre variante attribue-t-elle à
la crise asiatique une baisse de 0,6 point en 1998 et de 1 point en 1999 des
taux courts dans l'OCDE.
En ce qui concerne les taux longs, en moyenne pour l'OCDE, la variante inclut
des taux longs plus bas de 1,7 point en 1998, de 2 points en 1999 que dans le
scénario " hors crise ". Cette évaluation inclut la
baisse observée ainsi que la hausse évitée liée au
scénario des taux courts. Les différences mineures entre
Etats-Unis, Japon, UE tiennent à l'ampleur inégale de la baisse
observée en 1998.
Taux de change du yen
De mi-1997 à mi-1998 la parité du yen est passée de 121
yens par dollar à 136, soit une baisse de 11 %. Là aussi, il
est difficile d'isoler la part de cette évolution due à la crise
des économies émergentes d'Asie, au travers son impact sur les
perspectives commerciales et financières nipponnes, de celle due aux
évolutions proprement internes au Japon. Nous incorporons donc une
baisse de 5 % du yen à partir de 1998.
La contagion aux autres économies émergentes
A la suite de la contagion de la crise à l'Amérique Latine, la
demande interne, privée et parfois publique, devrait se contracter. Nous
retenons un scénario indicatif d'un recul des importations de
5 % puis de 15 % relativement au compte central. La crise
financière a également frappé la Russie à
l'été 1998, en partie en raison de la chute du prix des
matières premières, principales sources de devises de ce pays.
Elle devrait se traduire par un recul du PIB et des importations de la CEI.
Elle devrait se traduire par un recul du PIB (chiffré ici à
3 % en 1998, 6 % en 1999) et des importations de la CEI
(évalué à 5 % en 1998 et 20 % en
1999).
|
3. La crise asiatique, résumé des hypothèses |
||||||
|
|
Scénario sans crise
|
Effet de
la crise :
|
||||
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
NPI d'Asie |
|
|
|
|
|
|
|
PIB |
|
6,0 |
(a) |
- 0,7 |
- 7,0 |
- 13,4 |
|
Importations |
|
8,5 |
(a) |
- 3,9 |
- 21,7 |
- 26,8 |
|
Prix d'exportation |
|
1,0 |
(a) |
- 0,6 |
- 9,6 |
- 9,1 |
|
Exportations |
|
15,0 |
(a) |
- 2,6 |
- 12,0 |
- 14,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autre Asie |
|
|
|
|
|
|
|
PIB |
|
8,5 |
(a) |
- 2,3 |
- 8,6 |
- 12,5 |
|
Importations |
|
10,0 |
(a) |
- 4,4 |
- 17,2 |
- 21,6 |
|
Prix d'exportation |
|
1,0 |
(a) |
- 1,9 |
- 9,8 |
- 9,5 |
|
Exportations |
|
15,0 |
(a) |
- 1,2 |
- 10,3 |
- 14,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amérique Latine |
|
|
|
|
|
|
|
PIB |
|
4,5 |
(a) |
0 |
- 2,5 |
- 4,5 |
|
Importations |
|
10,0 |
(a) |
0 |
- 5 |
- 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Russie |
|
|
|
|
|
|
|
PIB |
|
2,0 |
(a) |
0 |
- 3,0 |
- 6,0 |
|
Importations |
|
7,0 |
(a) |
0 |
- 5 |
- 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prix du pétrole |
|
19,1 |
(a)(b) |
0 |
- 30 |
- 30 |
|
Prix
des matières
|
|
3 |
(a) |
0 |
- 10 |
- 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux de change |
|
|
(c) |
|
|
|
|
Yen |
121 |
128 |
128 |
0 |
- 5 % |
- 5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux d'intéret court |
|
|
|
|
|
|
|
Etats-Unis |
5,3 |
5,8 |
5,7 |
- 0,25 |
- 0,8 |
- 1,0 |
|
Japon |
1,0 |
1,1 |
1,7 |
- 0,25 |
- 0,6 |
- 0,9 |
|
UE |
3,5 |
4,2 |
4,9 |
- 0,25 |
- 0,7 |
- 1,0 |
|
Taux d'intéret long |
|
|
|
|
|
|
|
Etats-Unis |
6,7 |
7,0 |
7,2 |
- 0,25 |
- 1,6 |
- 1,7 |
|
Japon |
2,4 |
3,0 |
3,7 |
- 0,25 |
- 1,8 |
- 2,0 |
|
UE |
5,9 |
6,5 |
6,5 |
- 0,25 |
- 1,9 |
- 2,0 |
|
Notes :
hypothèses
ex ante
pour taux de change,
taux d'intérêt, prix des matières premières
|
||||||
Les
conséquences de la crise asiatique
Selon notre évaluation (tableau 4), la crise réduit le taux de
croissance mondial de 1,7 % en 1998 et de 1,5 % en 1999. Le
ralentissement dans les pays de l'OCDE
53(
*
)
,
certes moins marqué, est notable : 0,6 %, puis 0,9 %.
L'importance de cet impact provient de l'ampleur du choc initial (le volume des
importations des pays émergents est réduit d'environ 1,2 %
du PIB mondial en deux ans), et aux effets de bouclage que le modèle
prend en compte. Un effet multiplicateur (la réduction des exportations
conduit dans chaque pays à une baisse des revenus et de la demande
interne) et une propagation par les liens commerciaux (des pays peu
exposés directement au choc sont affectés car les pays les plus
touchés réduisent leurs propres importations) sont en effet
à l'oeuvre.
En raison de ses liens commerciaux avec les pays en crise, le Japon est le pays
de l'OCDE le plus touché par la crise. Elle contribue pour 1,4 point au
recul de la croissance japonaise en 1998. Cependant notre estimation de l'effet
de la crise n'est que peu augmentée par rapport à
l'évaluation menée en avril. En effet la
dépréciation du yen permet de limiter la dégradation du
commerce extérieur. Ainsi en 1999, le rythme de croissance des
exportations japonaises est ainsi réduit de 2 points contre plus de 3
pour celui des Etats-Unis. Ces derniers subissent en 1999 l'effet de la
contraction en Amérique Latine, ce marché représentant
15 % de leurs exportations. Leur croissance est réduite de
1 %, recul qui vient aggraver le retournement cyclique en cours aux
Etats-Unis. Moins exposée commercialement, l'Europe est la zone la plus
épargnée par les chocs. Certes elle subit l'effondrement
russe en 1999, mais cette zone (moins de 2 % des exportations de l'UE)
représente pour elle une destination commerciale moins importante que
l'Amérique Latine pour les Etats-Unis. Au total à l'horizon 1999
la crise lui aura fait perdre 4 points d'exportations contre plus de 8 points
aux Etats-Unis et au Japon. La croissance de l'Union Européenne est
amputée de 0,6 point en 1998 et de 0,8 point en 1999 : en l'absence
de crise des pays émergents, la croissance en Europe aurait
avoisiné 3,5 % en 1998 et 1999.
Dans les pays de l'OCDE, la baisse des taux d'intérêt (la hausse
évitée, dans le cas des taux courts) accompagne ce repli de
l'inflation, permettant de tempérer la réduction de la
croissance. Le tableau 5, qui propose une décomposition des effets de la
crise pour l'UE, indique que la baisse des taux d'intérêt
contribue positivement pour 0,6 point à la croissance en 1998
et 0,7 point en 1999, tandis que la contraction réelle dans les pays
émergents exerce une contribution négative de 1,2 puis 1,5 point.
La baisse des taux d'intérêt a selon cette évaluation
divisé par deux l'impact de la crise. Il demeure néanmoins
significatif : dans tout l'OCDE, le chômage augmente, et les soldes
publics connaissent une dégradation mécanique.
La dynamique mondiale de désinflation est alimentée par le cumul
de plusieurs facteurs : la baisse du prix du pétrole et des
matières premières, la baisse du prix des importations due aux
dépréciations, et enfin la hausse du chômage
résultant de la moindre croissance. En 1998 et en 1999, le rythme
d'inflation est abaissé de 0,6 % au Etats-Unis et de 0,4 % en
Europe. Cette désinflation exerce un effet modérateur sur la
crise notamment en stimulant la consommation. Au Japon, et dans les NPI d'Asie,
par contre, les dévaluations vont dans le sens d'un surcroît
d'inflation importé, mais l'ampleur de la récession interne
diminue les tensions inflationnistes.
La crise opère une redistribution des soldes commerciaux à
l'échelle mondiale, déjà partiellement observable dans les
statistiques récentes. Selon nos évaluations, la crise
dégrade à l'horizon 1999 le solde courant américain de 12
milliards de dollars, le solde japonais de 28 milliards, le solde de l'Union
européenne de 73 milliards. Au total le solde courant de l'OCDE se
dégraderait de 130 milliards, redevenant déficitaire comme au
début des années quatre-vingt-dix. En dépit d'un recul
plus important des exportations, les Etats-Unis connaissent une
dégradation du solde courant moindre que l'Europe. En effet ils
bénéficient d'une baisse plus marquée des prix à
l'importation. De plus selon le modèle MIMOSA, les exportateurs
américains ont un comportement de
price maker
tandis que les
européens ajustent à la baisse les prix d'exportation. Enfin
l'effet de compétitivité qui tend à accroître les
volumes d'importations, ne joue que lentement (courbe en J). La
répartition au sein de l'OCDE de la dégradation des balances
courantes reste cependant délicate à évaluer. La
contrepartie du creusement des balances courantes des pays les plus
avancés est le spectaculaire rétablissement des soldes du reste
du monde. L'Asie (hors Japon) améliore ainsi en 1999 sa balance courante
de près de 150 milliards par rapport au scénario sans crise.
L'amélioration pour l'Amérique Latine est de 37 milliards. En
revanche, la zone Moyen-Orient Maghreb est particulièrement
affectée par la chute des importations en provenance d'Asie et celle du
prix du pétrole. Cette zone connaît à la fois un recul
marqué de la croissance et un creusement de la balance
courante.
|
4. Impact de la crise selon le modèle Mimosa |
||||||||||||
|
Ecart au compte central |
||||||||||||
|
Année |
1997 |
1998 |
1999 |
|||||||||
|
PIB en % |
|
|
|
|||||||||
|
Etats-Unis |
- 0,2 |
- 1,3 |
- 2,3 |
|||||||||
|
Japon |
- 0,4 |
- 1,8 |
- 2,8 |
|||||||||
|
Union Européenne |
- 0,3 |
- 0,9 |
- 1,7 |
|||||||||
|
Dragons |
- 0,7 |
- 7,0 |
- 13,4 |
|||||||||
|
Autre Asie |
- 2,3 |
- 8,6 |
- 12,5 |
|||||||||
|
Amérique Latine |
0,0 |
- 2,2 |
- 4,5 |
|||||||||
|
Moyen-Orient Maghreb |
- 1,0 |
- 4,5 |
- 7,9 |
|||||||||
|
CEI |
0,0 |
- 3,0 |
- 6,4 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Monde |
- 0,5 |
- 2,2 |
- 3,7 |
|||||||||
|
Prix de la consommation en % |
|
|
|
|||||||||
|
Etats-Unis |
0,0 |
- 0,6 |
- 1,3 |
|||||||||
|
Japon |
0,1 |
0,1 |
- 0,2 |
|||||||||
|
Union Européenne |
0,0 |
- 0,4 |
- 0,8 |
|||||||||
|
Balance courante en milliards de $ |
|
|
|
|||||||||
|
Etats-Unis |
0 |
8 |
- 12 |
|||||||||
|
Japon |
- 4 |
- 19 |
- 28 |
|||||||||
|
Union Européenne |
- 8 |
- 34 |
- 73 |
|||||||||
|
OCDE |
- 13 |
- 58 |
- 133 |
|||||||||
|
Dragons |
8 |
56 |
99 |
|||||||||
|
Autre Asie |
11 |
39 |
49 |
|||||||||
|
Amérique Latine |
- 2 |
1 |
37 |
|||||||||
|
Moyen-Orient Maghreb |
- 4 |
- 34 |
- 44 |
|||||||||
|
CEI |
0 |
4 |
17 |
|||||||||
|
Chômage en point |
|
|
|
|||||||||
|
Etats-Unis |
0,1 |
0,5 |
1,1 |
|||||||||
|
Japon |
0,1 |
0,5 |
0,9 |
|||||||||
|
Union Européenne |
0,1 |
0,3 |
0,7 |
|||||||||
|
Solde public en point de PIB |
|
|
|
|||||||||
|
Etats-Unis |
- 0,1 |
- 0,3 |
- 0,6 |
|||||||||
|
Japon |
- 0,1 |
- 0,2 |
- 0,4 |
|||||||||
|
Union Européenne |
- 0,1 |
- 0,3 |
- 0,6 |
|||||||||
|
Taux d'intérêt à court terme en point |
|
|
|
|||||||||
|
Etats-Unis |
- 0,3 |
- 0,8 |
- 1,0 |
|||||||||
|
Japon |
- 0,3 |
- 0,6 |
- 0,9 |
|||||||||
|
Union Européenne |
- 0,3 |
- 0,7 |
- 1,0 |
|||||||||
|
Taux de change en % |
|
|
|
|||||||||
|
Japon |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||||||
|
Source : OFCE , modèle MIMOSA. |
||||||||||||
|
5. Impact de la crise des marchés émergents sur l'UE : une décomposition |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Année |
1997 |
1998 |
1999 |
|||||||||
|
Impact sur la croissance de l'UE |
- 0,3 |
- 0,6 |
- 0,8 |
|||||||||
|
dont : |
|
|
|
|||||||||
|
Crise en Asie |
- 0,4 |
- 0,9 |
- 0,6 |
|||||||||
|
Extension à l'Amérique Latine et la Russie |
0,0 |
- 0,3 |
- 0,9 |
|||||||||
|
Baisse des taux d'intérêt |
0,1 |
0,6 |
0,7 |
|||||||||
|
Baisse du prix des matières premières |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|||||||||
|
Baisse du yen |
0,0 |
0,0 |
- 0,1 |
|||||||||
|
Impact sur le taux d'inflation de l'UE |
0,0 |
- 0,4 |
- 0,4 |
|||||||||
|
dont : |
|
|
|
|||||||||
|
Crise en Asie |
0,0 |
- 0,1 |
- 0,3 |
|||||||||
|
Extension à l'Amérique Latine et la Russie |
0,0 |
0,0 |
- 0,1 |
|||||||||
|
Baisse des taux d'intérêt |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
|||||||||
|
Baisse du prix des matières premières |
0,0 |
- 0,4 |
- 0,3 |
|||||||||
|
Baisse du yen |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
Note : en raison des arrondis, le total peut différer de la somme des composantes |
||||||||||||
|
Source : OFCE , modèle MIMOSA. |
||||||||||||
Une mise
en perspective
Pour mettre en perspective les résultats obtenus, il est utile de les
confronter à ceux d'autres travaux. Les résultats de
l'évaluation menée par l'OCDE en juin sont rappelés dans
le tableau 6. Cette étude attribue à la crise un impact à
deux ans sur le PIB de l'UE et des Etats-Unis trois fois moins important que la
nôtre ; un effet est légèrement moins marqué
pour le Japon (2,0 contre 2,8 pour MIMOSA). Pour l'ensemble des pays de l'OCDE,
l'impact calculé par MIMOSA est de 2,2 points de PIB en moyenne contre
0,9 selon l'OCDE.
Une première source de divergence provient des hypothèses sur le
champ de la crise. Ainsi l'asymétrie moindre entre Japon d'une part et
Etats-Unis et Europe d'autre part dans notre simulation s'explique par notre
choix d'associer à la crise une dépréciation du yen. En ce
qui concerne la profondeur de la crise, l'OCDE retient les hypothèses
suivantes : le volume des importations en 1999 est réduit de
34 % en Corée, de 18 % dans le reste de l'Asie ; les taux
d'intérêt réels baissent de 0,5 % aux Etats-Unis et
dans l'Union Européenne. Notre évaluation retient un choc plus
important pour l'Asie et surtout inclut une chute des importations en Russie et
Amérique Latine. Au total le choc
ex ante
sur les importations
des pays émergents est 1,6 fois plus important dans notre simulation
(une baisse de 22 % à deux ans des importations totales des trois
zones concernées Asie, Amérique Latine, Russie contre 14 %
dans la simulation de l'OCDE). Les hypothèses faites sur le taux
d'intérêt sont globalement analogues : si les taux
réels courts sont stables dans notre simulation, les taux réels
longs baissent de près d'un point. Notre simulation retient en outre
l'impact, favorable pour l'OCDE de la baisse du prix de matières
premières.
Si l'on compare grossièrement les deux simulations en normalisant les
hypothèses sur l'ampleur du choc commercial, il apparaît que,
toutes choses égales par ailleurs, l'effet estimé par MIMOSA est
environ 1,5 fois plus élevé que celui de l'évaluation de
l'OCDE. Ce chiffre donne un ordre de grandeur de la différence due aux
propriétés internes des modèles utilisés
(
i.e
. aux choix de spécification, aux différences
économétriques tenant à la période et aux
données d'estimation) et de l'incertitude entourant cette
évaluation.
|
6. Impact de la crise asiatique selon l'OCDE (juin 1998) et MIMOSA |
||||||||
|
|
OCDE |
MIMOSA |
||||||
|
|
PIB (en %) |
Balance
courante
|
PIB (en %) |
Balance
courante
|
||||
|
|
1998 |
1999 |
1998 |
1999 |
1998 |
1999 |
1998 |
1999 |
|
USA |
- 0,4 |
- 0,8 |
- 13 |
- 27 |
- 1,3 |
- 2,3 |
+ 8 |
- 12 |
|
Japon |
- 1,3 |
- 2,0 |
- 12 |
- 22 |
- 1,8 |
- 2,8 |
- 19 |
- 28 |
|
UE |
- 0,4 |
- 0,6 |
- 19 |
- 28 |
- 0,9 |
- 1,7 |
- 34 |
- 73 |
|
Corée |
- 6,8 |
- 9,2 |
+28 |
+34 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Dragons |
-- |
-- |
-- |
-- |
- 7,0 |
- 13,4 |
+ 56 |
+ 99 |
|
Sources : OCDE (1998), et tableau 4 (cf infra). |
||||||||
Les
incertitudes de la conjoncture mondiale 1998-99
La rechute de l'économie japonaise
L'année 1998 a vu la rechute de l'économie japonaise. La
croissance envisagée dans notre prévision d'avril doit être
fortement révisée à la baisse : la chute de
l'activité japonaise en 1998 devrait atteindre 2,2 %, alors que les
observateurs anticipaient au début de l'année une croissance
légèrement positive. L'impact de la crise de l'Asie
émergente, tel qu'évalué plus haut, ne suffit pas à
en rendre compte de cette rechute. Si la politique budgétaire devenue
temporairement restrictive en 1997 a joué un rôle, cette
dégradation conjoncturelle a sa cause principale dans la contraction
spectaculaire de l'investissement privé. Dans une situation de taux
d'intérêt nominaux quasi-nuls, cette contraction s'explique par
les fortes incertitudes sur la croissance nippone, par la croissance du nombre
de faillites, par un comportement bancaire de rationnement du crédit
lié à l'accumulation de créances douteuses et une
normalisation tendancielle du taux d'investissement japonais (voir Passet,
1998).
On simule ici l'impact d'une chute autonome de l'investissement privé de
l'ordre de grandeur de celle intervenue, relativement à
l'évolution prévue au début de l'année 1998. Le PIB
se contracte
ex post
de 2,3 points, améliorant
mécaniquement la balance courante. La hausse initiale des prix doit
être interprété avec prudence : il reflète le
fait qu'historiquement l'ajustement de l'emploi au Japon était lent, en
sorte que selon les équations du modèle, la productivité
diminue fortement en cas de récession, ce qui augmente le coût
unitaire du travail. La variante indique que la conséquence d'un tel
choc sur l'Union européenne ou les Etats-Unis est une réduction
de la croissance de l'ordre de 0,3 point.
Ceci n'implique bien sûr pas que la croissance prévue en avril
pour l'UE doive être à ce point révisée à la
baisse : la demande intérieure européenne s'est finalement
révélée particulièrement dynamique, et notre
prévision d'avril sous-estimait sensiblement la croissance des plus
petits pays européens. Cependant l'intérêt de cette
simulation est d'illustrer le risque que ferait porter à
l'économie mondiale un nouveau report de la reprise japonaise.
|
7. Impact d'une rechute conjoncturelle au Japon |
||
|
Ecart en % au compte central |
||
|
Année |
1998 |
1999 |
|
PIB en % |
|
|
|
Etats-Unis |
- 0,4 |
- 0,4 |
|
Japon |
- 2,3 |
- 2,1 |
|
Union Européenne |
- 0,3 |
- 0,3 |
|
Prix de la consommation en % |
|
|
|
Etats-Unis |
0,0 |
- 0,1 |
|
Japon |
0,5 |
0,0 |
|
Union Européenne |
0,0 |
- 0,1 |
|
Balance courante en point de PIB |
|
|
|
Etats-Unis |
0,0 |
0,0 |
|
Japon |
0,4 |
0,4 |
|
Union Européenne |
- 0,1 |
0,0 |
|
Chômage en taux |
|
|
|
Etats-Unis |
0,1 |
0,2 |
|
Japon |
0,6 |
0,7 |
|
Union Européenne |
0,1 |
0,2 |
|
Solde public en point de PIB |
|
|
|
Etats-Unis |
- 0,1 |
- 0,1 |
|
Japon |
- 0,6 |
- 0,7 |
|
Union Européenne |
- 0,1 |
- 0,2 |
Une
dépréciation du dollar
La prévision présentée en avril retenait une valeur de
1,79 DM par dollar en 1998 et 1,65 en 1999. Si la baisse récente du
dollar correspond à une évolution anticipée, le recul
observé au cours des dernières semaines a été
particulièrement marqué : le dollar a chuté de
8 % en un mois, passant de 1,81 DM fin août à 1,66 fin
septembre. Plusieurs facteurs font porter les risques du côté
d'une accentuation de ce mouvement, et donc d'un niveau plus bas que
prévu du dollar en 1999 : le ralentissement américain,
la perspective d'une baisse des taux unilatérale aux Etats-Unis, et les
réallocations de patrimoine liées à l'introduction de
l'euro.
Pour mesurer les conséquences des incertitudes sur la valeur du dollar,
nous avons réalisé une variante illustrative de baisse de la
devise américaine face à toutes les monnaies. Le dollar est
supposé plus bas de 5 % que prévu à partir de 1999,
ce qui correspond à une valeur de 1,52 DM et 5,10 francs, si l'on prend
comme référence l'hypothèse d'un dollar à 1,60 DM
en 1999, incluse dans la prévision de l'OFCE de septembre (OFCE, 1998b).
Les taux d'intérêt nominaux sont inchangés.
Une telle évolution réduirait la croissance d'environ un
demi-point dans l'Union européenne et au Japon en 1999, et accentuerait
encore la désinflation (tableau 8). L'évolution des balances
courantes est peu tranchée à l'horizon considéré en
raison des effets de " courbe en J " (
i.e.
l'évolution
contradictoire des prix et des volumes). Cette simulation souligne la
nécessité d'une politique monétaire européenne plus
active si les différents risques négatifs associés
à notre projection se confirmaient.
|
8. Dépréciation de 5 % du dollar |
||
|
Ecart en % au compte central |
||
|
Année |
1999 |
2000 |
|
PIB en % |
|
|
|
Etats-Unis |
0,3 |
0,6 |
|
Japon |
- 0,4 |
- 0,8 |
|
Union Européenne |
- 0,5 |
- 0,7 |
|
Prix de la consommation en % |
|
|
|
Etats-Unis |
0,2 |
0,3 |
|
Japon |
0,0 |
0,0 |
|
Union Européenne |
- 0,2 |
- 0,6 |
|
Balance courante en point de PIB |
|
|
|
Etats-Unis |
- 0,1 |
0,0 |
|
Japon |
0,1 |
0,0 |
|
Union Européenne |
- 0,1 |
0,0 |
|
Chômage en taux |
|
|
|
Etats-Unis |
- 0,1 |
- 0,2 |
|
Japon |
0,1 |
0,2 |
|
Union Européenne |
0,2 |
0,3 |
|
Taux de change en % |
|
|
|
Japon |
- 5,0 |
- 5,0 |
|
Union Européenne |
- 5,0 |
- 5,0 |
|
Source : modèle MIMOSA,OFCE. |
||
Un
scénario de baisse concertée des taux d'intérêt
Dans la variante d'évaluation de la crise asiatique, nous avons
supposé que celle-ci avait annulé ou différé la
perspective d'une hausse des taux d'intérêt dans les pays de
l'OCDE. Du fait de la révision en baisse des perspectives de croissance,
une stratégie monétaire plus active peut être
envisagée. La présente simulation illustre une telle
stratégie, en évaluant l'impact d'une baisse concertée des
taux d'intérêt
54(
*
)
. On suppose
que pour contrer la crise, l'Union européenne et les Etats-Unis
abaissent leurs taux à court terme d'un demi-point. En dépit de
l'ampleur de la récession qu'il connaît, le Japon ne peut
participer au mouvement, ses taux courts ayant atteint un niveau plancher
(0,25 % en septembre 1998). On suppose, en outre, que les taux longs
s'ajustent immédiatement,
i.e.
qu'ils baissent d'un demi-point
simultanément. Les taux de change sont supposés inchangés.
Cette simulation étant illustrative, elle est présentée en
année pleine.
La baisse des taux d'intérêt (tableau 9) stimule principalement
l'investissement productif et logement. Dans certains pays, elle provoque aussi
une hausse de la consommation. Dans cette simulation, l'Italie se singularise
en Europe : du fait de la taille de la dette publique, les revenus
d'intérêt net sont une partie importante du revenu disponible des
ménages (près de 10 % contre moins de 3 % en France) et
les ménages subissent un effet revenu défavorable lors d'une
baisse des taux. L'effet y est dépressif sur la consommation et donc
moins expansionniste sur le PIB. Au total, la croissance augmente de 0,2 %
aux Etats-Unis et dans l'UE l'année où la politique est mise en
oeuvre et encore de 0,1 % l'année suivante. Le Japon
bénéficie d'un effet d'entraînement favorable.
Selon le modèle MIMOSA une baisse des taux de l'ordre de grandeur d'un
demi-point soutient ainsi la croissance, mais ne permet pas de faire face
à des aléas très importants, comme par exemple un
prolongement de la contraction japonaise. Aussi si un fort ralentissement se
concrétisait aux Etats-Unis, un recours à la politique
budgétaire serait nécessaire ; il serait facilité par
les marges de manoeuvre disponibles : le solde public devrait être
excédentaire de 0,4 point de PIB en 1998 ; le solde primaire
structurel (hors charges d'intérêt et à conjoncture
moyenne) est excédentaire de 1,7 points de PIB
55(
*
)
. La même nécessité pourrait
apparaître en Europe, où les marges de manoeuvre budgétaire
pourrait sembler un peu moins favorables. Le solde public serait certes
déficitaire de 2 points de PIB en 1998, mais le solde primaire
structurel est excédentaire de 2,5 points de PIB. Le solde effectif est
creusé par le niveau élevé des taux d'intérêt
pratiqués jadis et par l'écart persistent entre la production et
la production potentielle.
|
9. Baisse des taux d'intérêt d'un demi-point en Europe et aux Etats-Unis |
|||
|
Ecart en % au compte central |
|||
|
Année |
1998 |
1999 |
2000 |
|
PIB en % |
|
|
|
|
Etats-Unis |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
|
Japon |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
|
Union Européenne |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
|
Allemagne |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
|
France |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
|
Italie |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
Royaume-Uni |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
|
Consommation en % |
|
|
|
|
Etats-Unis |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
Japon |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|
Union Européenne |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Allemagne |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
|
France |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
Italie |
- 0,1 |
- 0,2 |
- 0,2 |
|
Royaume-Uni |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Investissement productif privé en % |
|
|
|
|
Royaume-Uni |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Etats-Unis |
0,3 |
0,7 |
0,9 |
|
Japon |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
|
Union Européenne |
0,6 |
1,3 |
1,4 |
|
Allemagne |
0,9 |
1,6 |
1,5 |
|
France |
0,5 |
1,2 |
1,3 |
|
Italie |
0,2 |
0,5 |
0,6 |
|
Royaume-Uni |
0,9 |
2,0 |
2,3 |
|
Investissement logement en % |
|
|
|
|
Etats-Unis |
1,0 |
1,2 |
1,1 |
|
Japon |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
|
Union Européenne |
0,6 |
1,0 |
1,2 |
|
Allemagne |
0,5 |
1,3 |
2,2 |
|
France |
1,3 |
1,9 |
1,8 |
|
Italie |
- 0,1 |
- 0,3 |
- 0,4 |
|
Royaume-Uni |
0,8 |
0,8 |
0,5 |
|
Prix de la consommation en % |
|
|
|
|
Etats-Unis |
0,0 |
0,0 |
- 0,1 |
|
Japon |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Union Européenne |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
|
Balance courante en points de PIB |
|
|
|
|
Etats-Unis |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Japon |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Union Européenne |
0,0 |
- 0,1 |
- 0,1 |
|
Chômage en taux |
|
|
|
|
Etats-Unis |
0,0 |
- 0,1 |
- 0,1 |
|
Japon |
0,0 |
0,0 |
- 0,1 |
|
Union Européenne |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,2 |
|
Solde public en point de PIB |
|
|
|
|
Etats-Unis |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
|
Japon |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|
Union Européenne |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
Taux d'intérêt à court et long terme |
|
|
|
|
Etats-Unis |
- 0,5 |
- 0,5 |
- 0,5 |
|
Japon |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Union Européenne |
- 0,5 |
- 0,5 |
- 0,5 |
Références bibliographiques
EQUIPE MIMOSA (1996) : " La nouvelle version de MIMOSA, modèle de
l'économie mondiale ",
Revue de l'OFCE
, n° 58,
juillet.
OCDE (1998) :
Perspectives économiques
, n° 63,
juin 1998
OFCE (1998a) : " Bascule transatlantique, Perspectives pour
l'économie mondiale
", Revue de l'OFCE
, n° 65,
avril.
OFCE (1998b) : " Dans la tourmente financière... Perspectives
pour l'économie mondiale
", Revue de l'OFCE
,
n° 67, octobre.
OFCE (1998c) : " La croissance quand même. Perspectives pour
l'économie française
", Revue de l'OFCE
,
n° 67, octobre.
PASSET O.(1998) " La conjoncture japonaise à la mi-98 ",
Lettre de l'OFCE
, n° 178, septembre.
RÉGNAULT R.(1998) : " Perspectives à moyen terme de
l'économie mondiale",
Rapport du Sénat n° 443
,
Délégation pour la Planification.
ANNEXE
N° 3
RÉSULTATS DES SIMULATIONS RÉALISÉES
À L'AIDE DE MODÈLES MACROÉCONOMIQUES
D'UNE MODIFICATION DU FINANCEMENT
DE LA PROTECTION SOCIALE
I - RÉSULTAT DE LA SIMULATION DU REPROFILAGE DES COTISATIONS
SOCIALES
Le tableau
56(
*
)
ci-dessous propose le
résultat d'une simulation réalisée à l'aide du
modèle multinational MIMOSA d'une baisse des cotisations employeurs
ciblée sur les bas salaires
57(
*
)
, pour un
montant équivalent à 1 point de PIB, dans l'ensemble des
pays européens (soit 85 milliards de francs en France, ce qui
correspond à une baisse du coût du travail de 9 % pour les
salariés concernés), financée par une augmentation des
cotisations sociales sur les autres salariés.
BAISSE
DE 1 POINT DE PIB DES COTISATIONS EMPLOYEURS DANS L'UE,
CIBLÉE SUR LES BAS SALAIRES, FINANCÉE PAR
REPROFILAGE DES COTISATIONS SOCIALES
58(
*
)
Taux de
change et taux d'intérêt endogènes.
Ecart au compte central en %.
|
Effet à ... |
1 an |
3 ans |
5 ans |
6-10 ans** |
|
PIB |
0,2 |
- 0,2 |
- 0,9 |
- 0,6 |
|
Prix |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
|
Solde public* |
0,2 |
0,2 |
- 0,2 |
- 0,1 |
|
Solde extérieur* |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|
Investissement |
0,3 |
- 0,8 |
- 2,8 |
- 1,3 |
|
Emploi |
0,3 |
0,6 |
0,4 |
0,4 |
|
Chômage*
|
- 0,2 |
- 0,4 |
- 0,1 |
- 0,2 |
* En
points.
** En moyenne.
Source
: modèle MIMOSA, OFCE.
A l'horizon de 5 ans, le reprofilage des cotisations sociales se traduirait
ainsi par une amélioration de l'emploi (+ 0,4 %, soit
+ 100 000 emplois environ), mais au prix d'un ralentissement
temporaire de la croissance (- 0,9 point de PIB cumulé).
II - RÉSULTAT DE SIMULATIONS D'UN TRANSFERT DES COTISATIONS SOCIALES
EMPLOYEURS VERS D'AUTRES TYPES DE PRÉLÈVEMENTS
1.
Sous l'hypothèse habituelle des modèles
macroéconomiques selon laquelle la substitution capital / travail est
peu significative en France.
EFFETS
SUR L'EMPLOI À 10 ANS (EN MILLIERS) DU REMPLACEMENT DE L'ASSIETTE
COTISATIONS EMPLOYEURS
PAR UNE ASSIETTE ALTERNATIVE POUR UN MONTANT DE 50 MILLIARDS DE
FRANCS
|
|
Modèle AMADEUS (INSEE) |
Modèle MOSAÏQUE (OFCE) |
Modèle METRIC (1) (Direction de la Prévision) |
|
CSG |
+ 100 |
+ 65 |
+ 100 |
|
Cotisation
à la valeur ajoutée
|
NS
|
- 6
|
|
NS = Non
significatif.
(1) Effets à 5 ans.
Source : Rapports Etat/partenaires sociaux sur l'assurance chômage (1994) et Direction de la Prévision.
2. Sous l'hypothèse selon laquelle le capital et le travail sont en partie substituables
EFFETS
SUR L'EMPLOI À 10 ANS (EN MILLIERS) DU REMPLACEMENT
DE L'ASSIETTE COTISATIONS EMPLOYEURS PAR UNE ASSIETTE ALTERNATIVE
POUR UN MONTANT DE 50 MILLIARDS DE FRANCS
(ET SOUS L'HYPOTHÈSE D'UNE SUBSTITUTION CAPITAL / TRAVAIL)
|
|
Modèle MOSAÏQUE (OFCE) |
Modèle AMADEUS (INSEE) (1) |
|
Cotisation
à la valeur ajoutée
(2)
|
+ 72
|
+
177
|
(1) Sous
l'hypothèse supplémentaire que les administrations ristournent
les bénéfices (en terme de dépenses et de recettes)
résultant des effets positifs de la mesure sur l'emploi. Cette
hypothèse démultiplie l'effet favorable de la mesure.
(2) Cela correspond à une hausse de 2,5 % du coût relatif du
capital par rapport au travail.
(3) Cela correspond à une hausse de 6 % du coût relatif du
capital par rapport au travail.
Source
: Rapports Etat/partenaires sociaux sur l'assurance
chômage (1994) et Direction de la Prévision.
3. L'assiette proposée pour la cotisation à la valeur
ajoutée (CVA)
Les tableaux ci-dessous présentent l'assiette de la CVA à partir
d'une décomposition du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises
françaises en 1996 (en milliards de francs) :
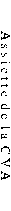
|
Chiffre d'affaires
|
|
Valeur
ajoutée brute
|
|
Valeur
ajoutée nette
|
|
|
|
|
|
|
Profits 565 |
|
Coût
du
travail
|
Valeur Impôts (IS, TP, etc) 475 |
|||||||||
|
ajoutée nette
Cotisations
|
|||||||||
|
3 610
Salaires
|
|||||||||
|
|
|
Amortissements 570 |
|
|
|
||||
Achats de
biens et
services
4 190
4. Qui paie les cotisations sociales ou pourquoi alléger les
cotisations sociales employeurs et non les cotisations sociales
salariés ?
Formellement, les cotisations sociales sont payées pour partie par les
salariés, pour partie par les employeurs.
D'un point de vue strictement économique, la pertinence de cette
distinction est néanmoins débattue : en effet, les
cotisations sociales " patronales ", comme les cotisations sociales
" salariés " financent
in fine
des prestations pour les
salariés immédiates (comme l'assurance maladie) ou
différées (comme les retraites). A priori, il pourrait ainsi
être envisagé de transformer l'ensemble des cotisations sociales
" patronales " en cotisations sociales " salariés "
sans que le coût du travail, ni les salaires nets, ne soient pour autant
modifiés.
Des arguments empiriques plaident toutefois en sens inverse :
- certaines études économétriques suggèrent que les
conséquences d'une hausse des taux de cotisations
" salariés " sont différentes de celles d'une hausse
des taux " employeurs " : dans le premier cas, le coût
total du travail augmenterait finalement moins que dans le second ;
- cela résulterait notamment de ce que les
négociations
salariales
portent sur le salaire brut (hors cotisations sociales
employeurs).
Dès lors qu'il s'agit d'alléger le coût du travail pour
favoriser l'emploi, ces arguments plaident donc pour un allégement
ciblé sur les cotisations sociales
employeurs.
Le
Sénat sur internet : http://www.senat.fr
minitel : 36-15 - code SENATEL
L'Espace Librairie du Sénat : tél. 01-42-34-21-21
1
Cela renforcerait ce que les
économistes nomment la " critique de Lucas ", du nom du Prix
Nobel d'économie en 1995, qui a mis en cause la validité des
modèles économétriques, peu aptes à intégrer
les modifications des comportements des agents résultant
d'" anticipations rationnelles ".
2
Voir Rapport d'information SÉNAT n° 443,
1997-1998, fait par M. René RÉGNAULT au nom de la
Délégation pour la Planification.
3
Tiré de l'expression anglaise "
emerging
markets
", ou marchés émergents, cet anglicisme a
été repris par les économistes pour qualifier les pays en
développement en forte croissance. Puisqu'il semble désormais
entré dans le langage courant, votre Rapporteur emploiera ce terme dans
ce rapport.
4
Selon l'expression de M. Alexandre LAMFALUSSY, ancien
Président de l'Institut Monétaire Européen - Les Echos,
21 octobre 1998.
5
Colloque organisé le 21 octobre 1998 par le Centre
d'études prospectives et d'informations internationales à
l'occasion de son vingtième anniversaire.
6
Le 30 octobre 1998 le dollar valait 5,54 francs.
7
En parités de pouvoir d'achat.
8
En effet, les taux d'intérêt
réels
à court terme se situent actuellement autour de 3 % (3,5 %
pour les taux nominaux - 0,5 % pour l'inflation) et sont ainsi
supérieurs
au rythme actuel de
croissance
de
l'économie européenne (de l'ordre de 2,25 %).
9
Un taux de croissance du PIB en
glissement
indique son
évolution entre deux dates données. Un taux de croissance du PIB
en
moyenne
annuelle indique l'évolution de la valeur moyenne du
PIB au cours d'une année n + 1 par rapport à sa valeur
moyenne au cours de l'année n.
10
L'effet de richesse résulte des pertes patrimoniales sur
les marchés boursiers et conduit les ménages à
reconstituer leur épargne.
11
On peut entendre par " rationnement du crédit "
une situation où les banques refusent de prêter à des
emprunteurs risqués, par opposition à un "
credit
crunch
", où les crédits se raréfient y compris
pour des emprunteurs peu ou pas risqués.
12
Selon l'expression du Directeur Général du FMI, M.
Michel CAMDESSUS.
13
Le gouvernement français a formulé des
propositions en ce sens, dans un mémorandum adressé à ses
partenaires européens en septembre 1998. Celles-ci sont
développées dans le Rapport économique, social et
financier annexé au Projet de loi de finances pour 1999 (pages 56
à 65).
14
Sans évoquer, car cela déborderait du cadre de ce
rapport, le risque de crise sociale dans des pays émergents où
les revenus ont considérablement chuté alors que la protection
sociale y est quasiment inexistante.
15
Au sens économétrique du terme.
16
Ce qui revient à laisser jouer plus librement les
équations du modèle.
17
Qui a valu à son auteur, Franco MODIGLIANI, le Prix Nobel
d'économie en 1985.
18
L'
inversion
des contributions à la croissance
s'est opérée de manière
spectaculaire
en
1997-1998
. En 1997, la contribution des échanges extérieurs
était de 1,7 point de croissance et celle de la demande
intérieure de 0,7 point. En 1998, celle-ci a atteint
3,8 points de croissance alors que la contribution du commerce
extérieur devenait négative (- 0,6 point).
19
Par opposition au chômage conjoncturel lié aux
fluctuations de l'activité. Le taux de chômage structurel est
aussi appelé NAIRU, par transposition d'un sigle anglais signifiant
" taux de chômage qui n'accélère pas
l'inflation ".
20
Cet impact est en effet beaucoup plus sensible en cas de
freinage de la consommation des ménages, qui entraîne une
diminution des recettes de TVA, que dans l'hypothèse d'un ralentissement
de la demande mondiale, les exportations étant exonérées
de TVA.
21
Les indicateurs macroéconomiques disponibles fournissent
en outre des informations délicates à interpréter :
d'un côté, les
excédents commerciaux
de
l'économie française (plus de 2 % du PIB en 1997)
suggèrent que les entreprises françaises sont plutôt
compétitives, donc que le coût moyen du travail est satisfaisant
en France ; de l'autre, la persistance d'un taux de
chômage
élevé
reflète sans doute la difficulté des
entreprises à embaucher. L'excédent de la balance commerciale et
le niveau élevé du chômage pourraient d'ailleurs trouver
leur origine commune dans la faible croissance de l'économie
française par rapport à ses principaux partenaires.
22
Cf T. Piketty, " Les créations d'emploi en France et
aux Etats-Unis, services de proximité contre petits
boulots ", note de la fondation Saint-Simon, 1997, reprise dans la Revue
de la CFDT, novembre 1997.
23
Selon EUROSTAT, la proportion de travailleurs non
diplômés dans la population active s'établissait en 1994
à 39,2 % en France et à 44,3 % en Belgique, contre 16,4 % en
Allemagne et 20,4 % aux Pays-Bas.
24
En pratique, ces deux effets se combinent dans une proportion qui
dépend notamment de l'intensité de la concurrence (celle-ci
favorisant les baisses de prix) et de la situation financière des
entreprises (une situation dégradée les conduisant à
privilégier la restauration des profits).
25 Cf. Economie et Statistique n°301-302, 1997.
26
Il s'agit là d'un résultat
inattendu,
puisque la sensibilité de l'emploi au coût du travail est a priori
moindre à l'échelle de l'entreprise qu'à celle de
l'économie, et surtout plus lente à se manifester, donc plus
difficile à déceler pour le statisticien.
27
Si l'on ajoute à cet effet de structure, l'effet de
relance résultant de toute baisse des prélèvements, des
allégements de charges sur les bas salaires non compensés par
d'autres prélèvements se traduisent à moyen terme selon
ces mêmes estimations par 50 000 à 70 000 emplois
supplémentaires par tranche de 10 milliards de francs. A coût
égal, les allégements de charges sur les bas salaires sont donc
environ deux fois plus créateurs d'emplois que les autres
allégements de prélèvements.
28
" Les allégements de charges sur les bas
salaires ", rapport du Conseil supérieur de l'emploi, des revenus
et des coûts, 29 mai 1996.
29
Cette tendance résulte du déclin relatif de
l'agriculture et de l'industrie, secteurs où les gains de
productivité sont les plus rapides, au profit des services, où
les gains de productivité tels que mesurés habituellement sont
plus lents.
30
Exonérations des cotisations familiales, puis
réduction dégressive, puis fusion des deux réductions en
une ristourne dégressive jusqu'à 1,33 SMIC, enfin, depuis janvier
1998, ristourne dégressive jusqu'à 1,30 SMIC, l'allégement
étant désormais proportionnel à la durée du travail
pour les salariés à temps partiel.
31
Direction de l'animation de la recherche, des études et
des statistiques du ministère de l'Emploi et de la Solidarité.
32
Cf. les annexes du rapport " croissance et
chômage " du Conseil d'analyse économique, 1998.
33
D'un côté les allégements de charges seraient
étendus jusqu'aux salariés rémunérés deux
SMIC, ce qui en réduirait la dégressivité, donc en
limiterait les effets pervers ; de l'autre, cette mesure serait en partie
financée, soit par une hausse de la CSG, soit par des taux de
cotisations sociales croissants à partir de 5/3 du SMIC.
34
Cf. "Alain GUBIAN, " Avantages et inconvénients d'une
modification de l'assiette des cotisations patronales ", Travail et Emploi
n° 72, 1997.
35 Valeur 1994.
36
Dans le cas de la cotisation à la
valeur
ajoutée, au profit du bâtiment, du textile, des
hôtels-cafés-restaurants, et au détriment de
l'énergie, des transports aériens, de l'électronique, dont
la taxation augmenterait dans des proportions considérables : la
rentabilité de ces activités risquerait d'en être
durablement affectée ; dans le cas de taxes sur les profits, en
faveur des entreprises ou secteurs faiblement bénéficiaires (BTP,
textile, certains services), au détriment des services financiers, du
commerce et de la chimie notamment.
37
A l'extrême, si le capital était parfaitement
mobile, le transfert de cotisations sociales vers des taxes sur le capital
pénaliserait ainsi la croissance sans pour autant favoriser l'emploi.
38
Ce système de bonus-malus, analogue à celui de
l'assurance automobile ou de l'assurance pour accidents du travail, est d'ores
et déjà mis en oeuvre dans certains Etats des Etats-Unis
(où il permet de faire endosser aux entreprises jusqu'à 2/3 du
coût des allocations chômage (celles-ci étant toutefois de
montant et de durée beaucoup plus faibles qu'en France).
39
On observe une relation inverse entre salaires et niveau du
chômage - ou " courbe de Phillips " - dans tous les
modèles macroéconomiques.
40
Transfert résultant de la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 1998.
41
Le taux de marge est le rapport de l'excédent brut
d'exploitation à la valeur ajoutée. Lorsque ce rapport diminue,
cela signifie donc que la part des profits des entreprises dans la valeur
ajoutée diminue, et, inversement, que celle des salaires augmente.
42
En prenant les prix du PIB comme déflateur.
43
Les auteurs de la projection ont ainsi supposé une
pérennisation de ces emplois.
44
En prenant les prix du PIB comme déflateur.
45
Dans les définitions de la Comptabilité nationale,
il s'agit essentiellement des dépenses hospitalières hors
dépenses de personnel et d'investissement.
46
Ces mesures sont contenues dans la loi du
22 juillet 1993 sur la sauvegarde de la protection sociale.
47
Ces dépenses sont considérées en
Comptabilité Nationale comme des prestations sociales. Il s'agit
toutefois de prestations sociales versées par l'Etat et non par les
organismes de Sécurité sociale.
48
Calculé avec une pondération en taux de change de
PPA, source BRI.
49
Régime qui oblige la Banque centrale à
détenir en réserves l'exacte contrepartie de la masse
monétaire en circulation dans l'économie,
50
C'est-à-dire de taux de change flottant librement dans une
bande étroite de fluctuations définie par la Banque centrale. La
Banque centrale opte pour une révision planifiée de la
fourchette, ce qui permet des dévaluations graduelles de la monnaie.
51
Nous entendons ici OCDE selon le champ traditionnel, i.e. hors
Corée du Sud, Mexique, Hongrie, Pologne et République
Tchèque.
52
Production, importations, etc. des zones émergentes
étant des variables endogènes au modèle, ce
scénario est introduit dans le modèle en calibrant des chocs sur
la demande intérieure, les prix et les importations des pays d'Asie.
53
Selon le champ traditionnel, soit hors Corée du Sud,
Mexique, Hongrie, Pologne et République tchèque.
54
La baisse de 0,25 point du taux des Fed funds annoncée par
la
Federal Reserve
le 28 septembre constitue un premier pas dans cette
direction.
55 Selon l'évaluation de l'OCDE.
56
Extrait de " L'impact de la
réduction des
cotisations employeurs ", H. LE BIHAN, Revue de l'OFCE, juillet 1998.
57
C'est-à-dire les 30 % de salariés les moins
rémunérés.
58
Le coût du travail des 70 % de salariés les
mieux rémunérés augmenterait ainsi de 1,5 %. En
pratique, cette mesure se traduirait par un " effet de seuil ".
Toutefois, les modèles macroéconomiques ne peuvent
différencier les effets d'une mesure aussi frustre de celle d'un
reprofilage plus progressif.







