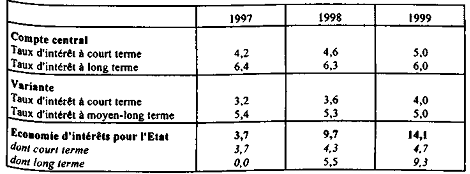Rapport d'information n° 369 (1995-1996) de M. Alain LAMBERT , fait au nom de la commission des finances, déposé le 15 mai 1996
Disponible au format Acrobat (2,2 Moctets)
-
AVANT-PROPOS
-
CHAPITRE PREMIER - LE CONTEXTE
ÉCONOMIQUE
-
CHAPITRE II - LES CONTRAINTES
FINANCIÈRES
-
CHAPITRE III - "ENDIGUER LA DEFLATION DES
RECETTES"
-
CHAPITRE IV - "UNE ACTION FORTE SUR LES
DÉPENSES"
-
ANNEXE N° 1 - SENSIBILITÉ DES COMPTES
PUBLICS À UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE
-
ANNEXE N° 2 - LE PACTE DE STABILITÉ
ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
-
TRAVAUX DE LA COMMISSION
-
I - Audition de M. Jean Arthuis, ministre de
l'économie et des finances, et de M. Alain Lamassoure, ministre
délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sur les
orientations budgétaires pour 1997, le mardi 7 mai 1996, sous la
présidence de M. Christian Poncelet, président
-
II - Audition des principaux instituts de
prévision économique, le mardi 14 mai 1996, sous la
présidence de M. Christian Poncelet, président.
-
III - Examen du rapport d'information de M. Alain
Lambert, rapporteur général, en vue du débat d'orientation
budgétaire pour 1997, le mercredi 15 mai 1996, sous la présidence
de M. Christian Poncelet, président
-
I - Audition de M. Jean Arthuis, ministre de
l'économie et des finances, et de M. Alain Lamassoure, ministre
délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sur les
orientations budgétaires pour 1997, le mardi 7 mai 1996, sous la
présidence de M. Christian Poncelet, président
-
LE DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE
POUR 1997 : DE LA NÉCESSITÉ AUX CHOIX
N° 369
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mai 1996.
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le débat d' orientation budgétaire pour 1997.
Par M. Alain LAMBERT,
Sénateur, Rapporteur général.
(1) Cette commission est composée de MM Christian Poncelet président, Jean Cluzel, Henri Collard, Rolland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Mme Marie Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini, vice présidents, Emmanuel Hamel, René Régnault, Alain Richard, François Trucy, secrétaires; Alain Lambert, rapporteur général, Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann, Michel Sergent, Henri Torre, René Trégouët.
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
La tenue d'un débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat dès le printemps, préalable à l'envoi des lettres de cadrage aux ministres "dépensiers", peut à juste titre être présentée comme un élément important de la revalorisation du rôle du Parlement.
Le Gouvernement a déposé un rapport préparatoire à ce débat, au contenu fort intéressant car il permet de mieux cerner les contraintes qui s'imposent au futur budget de 1997.
Le débat d'orientation budgétaire n'a pas pour objet d'aboutir à un vote sur des propositions. Selon votre commission des Finances, sa vocation doit être double : identifier les grands choix qui devront être proposes au Parlement lors de la prochaine session budgétaire, mais aussi valider le cas échéant les orientations premières esquissées par le Gouvernement.
À quelques semaines des arbitrages internes à l'exécutif, votre commission des Finances a souhaité éclairer le débat d'orientation en examinant successivement :
- les tendances du proche futur économique (chapitre premier) ;
- la nature des contraintes financières s'imposant à la préparation du budget (chapitre II) ;
- l'évolution probable des recettes de l'État au cours de l'an prochain (chapitre III) ;
- les contours de la politique d'économies budgétaires à mener en 1997 (chapitre IV).
CHAPITRE PREMIER - LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Le débat d'orientation budgétaire doit être situé dans le contexte économique du ralentissement de la croissance.
I. RETOUR SUR L'ANNÉE 1995 : UNE CROISSANCE QUI S'ESSOUFFLE
A. DES RÉSULTATS DÉCEVANTS
La prévision initiale de croissance pour 1995 , associée à la loi de finances, était de 3,1 % dans une fourchette de 2,7 à 3,5 %
Finalement, après plusieurs révisions, les comptes de la Nation Publiés par l'INSEE au mois d'avril 1996 opèrent une dernière révision à la baisse 1 ( * ) de laquelle il ressort que le taux de croissance du PIB aura été de 2,1 % en volume au cours de l'année écoulée.
Variation des ressources et des emplois de biens et services entre 1994 et 1995
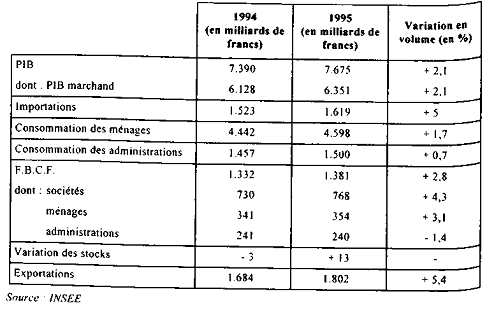
Par rapport à l'année précédente, 1995 est donc une année d'essoufflement de la croissance.
B. DES MOTEURS INSUFFISANTS
Cet essoufflement provient pour l'essentiel de l'évolution des stocks. Celle-ci avait exercé en 1994 un puissant effet favorable sur l'activité économique puisqu'elle avait expliqué près de 60 % du supplément d'activité enregistré cette année là. En revanche, en 1995, la gestion des stocks a été quasiment neutre en termes d'activité économique.
Ainsi, la légère reprise de la croissance de la demande finale intérieure en moyenne annuelle n'aura suffi ni à contrecarrer l'inflexion de comportement des entreprises en matière de stocks ni à en compenser les effets sur le rythme de l'activité économique.
1. Une accélération de la demande...
La demande intérieure finale s'est accélérée en 1995 par rapport à 1994
La consommation finale des ménages a augmenté en volume de 1,7% contre 1,4% en 1994.
L'investissement des sociétés non financières s'est accru de 4,3 %, s oit à un rythme plus de deux fois et demi plus rapide que l'année précédente.
2. ... mais deux caractéristiques défavorables
a) Une ampleur décevante
Malgré une croissance du revenu disponible brut des ménages de 4,4 % en valeur, leur consommation n'a augmenté que de 3.5 %. Le taux d'épargne des ménages s'est donc une fois de plus élevé en 1995, passant de 13,6 en 1994 à 14,3 %. Ce phénomène qui n'est pas, par principe, défavorable, reste inexpliqué par les déterminants traditionnels de l'épargne. Il traduit très probablement un réflexe de précaution des ménages devant un avenir jugé par eux incertain.
Quant à l'investissement des entreprises non financières, son taux de croissance en 1995 n'a pas permis de rattraper le niveau qui était le sien en 1992. En francs courants, les flux d'investissement en 1995 auront été inférieurs de près de 20 milliards de francs à ce qu'ils étaient en 1992.
La prévision associée à la loi de finances pour 1995 tablait sur une croissance de l'investissement des entreprises non financières beaucoup plus importante (9,3 %).
Aux explications traditionnelles sur l'attentisme des entreprises en Période de faible croissance de la demande, la dernière révision des Comptes de la Nation en 1995 ajoute d'autres éléments moins attendus.
La situation délicate des entreprises financières n'est pas une surprise, En revanche, la révision à la baisse de la capacité de financement des entreprises financières peut expliquer pour partie des performances en matière d'investissement moins favorables qu'escompté.
L'estimation portant sur la capacité de financement des sociétés privées a été ainsi ramenée de 131 à 92 milliards de francs en 1993 et de 109 à 47 milliards de francs pour 1994. En 1995, elle est de 41 milliards de francs. Il en résulte que le total des capacités de financement accumulées par les entreprises privées depuis 1993 (180 milliards de francs) est encore inférieur aux besoins de financement des années 1990 à 1992 (284 milliards de francs) 2 ( * )
Il y a dans la persistance de ce besoin de financement des entreprises un facteur de hausse de leur taux d'épargne peu favorable à la croissance.
b) Une durée insuffisante
Décevante dans son ampleur, la croissance économique en 1995 l'a également été du fait de sa durée.
Contributions a la croissance du PIB

En effet l'économie française a, l'an dernier, vu se succéder un premier trimestre dynamique (+ 0,7 % de croissance par rapport au trimestre précédent), deux trimestres où l'activité économique est restée presque stable et, enfin, un quatrième trimestre où elle s'est repliée (- 0,4 % au quatrième trimestre par rapport au troisième).
L'économie s'est ainsi essoufflée si bien que derrière une croissance moyenne de 2,1 % pour l'ensemble de l'année, il y a lieu de faire état d'une ébauche de récession en fin d'année.
Conséquence importante : si l'acquis de croissance 3 ( * ) était au début de 1995 de 1,6 %, il apparaît comme négatif au début de 1996 (- 0,3 %).
II. LES PRÉVISIONS POUR 1996 ET 1997
A. LE CONTENU DU RAPPORT DEPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
1. Un rapport économique et financier ?
Le document déposé par le Gouvernement à l'occasion du débat d'orientation budgétaire contient deux rapports : l'un sur l'évolution de l'économie nationale et des finances publiques, l'autre spécifiquement consacré au débat d'orientation budgétaire.
La communication du premier de ces rapports répond à l'obligation faite au Gouvernement par l'article 38 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances d'adresser au Parlement, en l'absence de dépôt d'un projet de loi de finances rectificative, un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et des finances publiques avant le 1er juin.
Une fois indiqué qu'il y a lieu de se réjouir de la bonne exécution par le Gouvernement de cette obligation juridique, il faut observer que celle-ci n'est, sur le fond, pas pleinement satisfaisante.
Le document présenté n'a, en effet, pas la même portée que le rapport définissant l'équilibre économique et financier que l'article 38 de l'ordonnance susvisée impose au Gouvernement de communiquer en même temps que son projet de loi de finances initial.
On ne peut, en particulier, y trouver d'indications assez précises et détaillées pour qu'y soient définis "l'équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir".
2. La commission des Comptes et des budgets économiques de la Nation
Pourtant, de tels éléments ont déjà fait l'objet d'une communication officielle par le Gouvernement devant l'instance restreinte que constitue la commission des Comptes et des budgets économiques de la Nation à la fin du mois de mars dernier.
À cette occasion, le Gouvernement a, en effet, présenté la première esquisse de ses budgets économiques dont il aurait été souhaitable qu'il communique à l'ensemble du Parlement une version mise à jour à l'occasion de ce débat.
Les budgets économiques de la Nation qui comportent une description détaillée de l'activité de l'économie nationale pour l'année en cours et l'année suivante et sont bâtis à partir de méthodes d'analyse conjoncturelle et du fonctionnement du modèle METRIC, décrivent en détail les perspectives économiques associées aux choix budgétaires du Gouvernement.
Ils apportent une information économique et financière détaillée et cohérente dont la communication aurait été utile au Parlement à l'occasion du débat d'orientation budgétaire.
B. LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA PRÉVISION DU GOUVERNEMENT POUR 1996 ET 1997
Équilibre du PIB en volume
(En %)
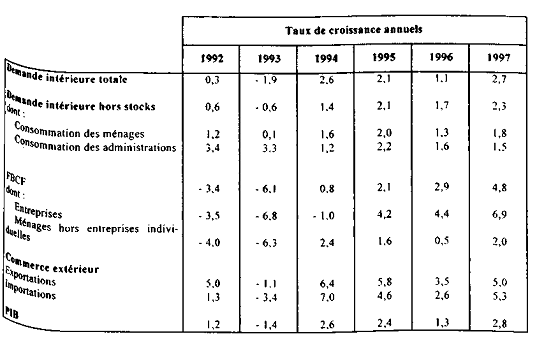
La croissance du PIB s'élèverait à 1,3 % en 1996 -contre une prévision de 2,8 % associée à la loi de finances pour 1996- et s'accélérerait en 1997 où elle serait de + 2,8 % .
La progression de l'activité en 1996 suppose une reprise économique et le retour en cours d'année à une croissance de l'ordre de 2,5 %.
Le scénario de la prévision attribue un rôle central à la demande des entreprises dont l'investissement s'accélérerait. L'investissement des entreprises expliquerait 0,4 point de la croissance en 1996 et 0,7 point des 2,8 % de croissance de 1997. En outre, à un comportement de déstockage les entreprises substitueraient ensuite un comportement inverse si bien que de négative en 1996 la contribution des stocks à la croissance deviendrait positive l'année suivante (0,4 point de croissance en 1997).
La consommation des ménages progresserait de 1,3 % en 1996 puis de 1,8 % en 1997 contre 1,7 % en 1996.
La consommation des administrations s'accroîtrait respectivement de 1,6 % et 1,5 % en 1996 et 1997.
Quant aux échanges extérieurs leur contribution à la croissance resterait positive en 1997 mais moins qu'en 1996 (+0,1 point contre + 0,3 point).
Conséquence de ce scénario, l'emploi salarié resterait stable en 1996 et progresserait de 1,2 % en 1997. Il s'ensuivrait une augmentation du chômage contenue à partir de 1997.
Cette évolution pèserait sur l'accroissement des rémunérations salariales et le pouvoir d'achat du taux de salaire par tête n'augmenterait respectivement que de 0,6 et 1 % en 1996 et 1997.
L'inflation resterait contenue, les prix à la consommation ne progresseraient en moyenne que de 1,8 et 1,7 %.
Enfin, le besoin de financement des administrations publiques passerait de 4 à 3 % du PIB entre 1996 et 1997.
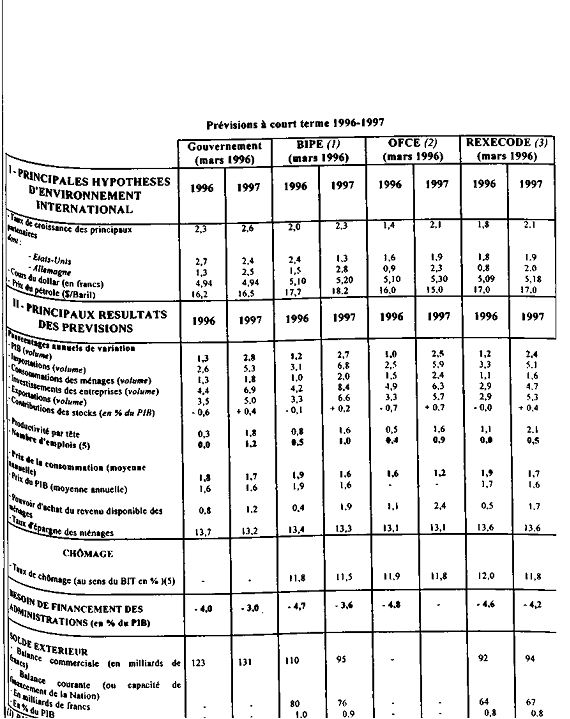
C. DE QUELQUES INCERTITUDES
(1) BIPE : Bureau d'informations et de prévisions économiques
(2) OFCE : O bservatoire français des conjonctures économiques
(3) REXECODE : Centre de recherches pour l'expansion de l'économie el le développement des entreprises
(4) Emplois salariés seulement
(5) Niveau moyen sur la période
Source Service des Études du Sénat. Division des Études Macro-économiques
Le tableau précédent illustre quelques unes des incertitudes qui s'attachent à la prévision du Gouvernement.
1. Quel environnement international ?
La première incertitude est relative à l'environnement international de l'économie française. Les hypothèses des autres instituts de conjoncture sont moins optimistes que celles des services du ministère de l'Économie et des Finances. Ainsi, si selon ces dernières la croissance moyenne de nos partenaires de l'OCDE serait de 2,3 % en 1996, l'OFCE et Rexecode retiennent des chiffres très inférieurs (+ 1,4 et + 1,8 %).
À ce sujet, force est de rappeler que les instituts de prévision allemands estiment que la croissance en Allemagne, qui est notre principal partenaire, ne devrait pas dépasser 0,5 % en 1996.
De la même manière, le dynamisme de l'économie américaine comporte des effets ambigus pour les économies européennes. Porteur d'activité via l'accroissement de la demande adressée à celles-ci, il est aussi à la source d'inquiétude sur ses conséquences potentielles en matière de taux d'intérêt.
2. Quelle réduction des déficits ?
Une deuxième incertitude porte sur les performances réalisées en matière d'assainissement des finances publiques.
Dans le rapport déposé par le Gouvernement pour le débat d'orientation budgétaire, il est souligné que les perspectives de croissance retenues par le Gouvernement pour 1996 et 1997 sont très proches de celles des différents instituts de prévision français.
Ce commentaire est exact, mais il convient d'observer que, derrière la similitude des prévisions de croissance économique, apparaît une très grande différence quant au niveau des déficits publics.
En effet, si le Gouvernement prévoit qu'en 1997 le besoin de financement des administrations publiques atteindra l'objectif fixé de 3 % du PIB, le "consensus" des autres prévisionnistes retient un niveau de déficit de l'ordre de 3,8 % du PIB.
On doit donc relever un vif contraste entre des prévisions économiques convergentes et des prévisions en matière de finances publiques caractérisées par un fort écart entre les perspectives du Gouvernement et celles des autres prévisionnistes.
Derrière ces écarts apparaît en réalité un débat sur la nature des effets à court terme de la réduction des déficits.
Un rappel sommaire des termes de ce débat suffira. Il oppose une vision keynésienne de l'économie, où la réduction des déficits publics exerce son effet dépressif sur l'activité, à une analyse néoclassique, où l'épargne publique provoque les conditions d'une désépargne privée qui vient en compenser les effets.
3. Quels comportements des agents économiques ?
Enfin, le comportement des agents économiques sous-jacent à la prévision de croissance pour 1996 et 1997 suppose la rupture avec certaines tendances.
Il en va ainsi pour le comportement de consommation des ménages. Dans la prévision du Gouvernement la consommation des ménages s'accroît davantage que le pouvoir d'achat de leur revenu. Une telle évolution n'est possible que si la condition d'une baisse du taux d'épargne des ménages est remplie. Elle devrait être de 0,5 point en 1996 et encore de 0,6 point en 1997. La vive croissance de la consommation au premier trimestre de l'année donne du crédit à cette hypothèse. Elle a d'ores et déjà permis de dégager un fort acquis de croissance de la consommation pour cette année. Mais la poursuite de cette tendance demeure hypothétique.
En ce qui concerne les entreprises, l'accroissement de leur effort d'investissement en 1996 suppose qu'elles soient moins sensibles à la conjoncture économique générale qu'au retard à combler dans leur équipement et moins attachées que par le passé récent à rétablir une situation financière certes améliorée mais moins -voir supra- qu'escompté.
La reprise économique décrite par la prévision du Gouvernement est, à l'évidence, envisageable compte tenu des progrès réalisés par l'économie française sur de nombreux fronts : inflation, compétitivité des entreprises, coût du financement...
Il n'en reste pas moins que certaines incertitudes l'entourent.
L'effort d'épargne réalisé par le secteur public sera-t-il compensé par la désépargne des agents privés ?
L'environnement international de la France n'affectera-t-il pas nos marges de manoeuvre ?
Ces incertitudes justifient, à elles seules, une politique des finances publiques prudente d'autant que la composition de la croissance où l'investissement et la demande extérieure devraient continuer de jouer un rôle essentiel dans un contexte de grande modération salariale n'est "a priori" guère favorable à une réduction spontanée des déficits.
CHAPITRE II - LES CONTRAINTES FINANCIÈRES
La souveraineté budgétaire de l'État est menacée à court terme par la montée de l'endettement public : au-delà du respect de nos engagements européens, c'est là le véritable enjeu de la lutte engagée pour réduire les déficits.
Le poids des prélèvements obligatoires exclut de solliciter à nouveau les recettes, et c'est une diminution sans précédent de la dépense publique qui devra s'opérer à partir de 1997.
I. DE LA RÉDUCTION DES DÉFICITS...
Le rapport déposé par le Gouvernement pour le débat d'orientation budgétaire retient quatre raisons "qui motivent la réduction du déficit budgétaire" :
"- le déficit pèse sur le développement économique (...)
"- il faut redonner des marges de manoeuvre au budget de l'État (...)
"- l'effet "boule de neige" constitue à lui seul une raison de réduire rapidement le déficit (...)
"- la réduction du déficit doit nous permettre de participer à l'union monétaire. "
La diminution du déficit budgétaire, présentée comme un impératif depuis avril 1993, apparaît aujourd'hui comme une urgence absolue au moins pour deux motifs.
A. L'EFFET "BOULE DE NEIGE" DU DÉFICIT
1. Du creusement du déficit...
La récession de 1992-1993 a révélé avec brutalité l'ampleur de la dérive du déficit budgétaire : la commission Raynaud évaluait en avril 1996 le déficit "tendanciel" à 333 milliards de francs, la diminution des recettes par rapport aux prévisions étant estimée autour de 106 milliards de francs du fait du ralentissement de l'économie.
Ce quasi-doublement du déficit par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale justifiait en lui-même un effort d'économie, le Gouvernement se fixant au mois de juin 1993 un objectif de réduction du déficit de 333 à 317 milliards de francs.
Toutefois, la récession n'avait fait que révéler un phénomène déjà existant : le creusement autoalimenté du déficit.
2. ...à l'effet "boule de neige"
L'effet "boule de neige" du déficit est apparu clairement dans la loi du 24 janvier 1994 relative à la maîtrise des finances publiques : pour la première fois, une programmation du budget sur cinq ans permettait de faire apparaître le poids budgétaire du financement du déficit, avec une augmentation de la charge de la dette que ne suffisait plus à enrayer la simple maîtrise des dépenses.
C'est le poids de l'endettement public qui s'est alors révélé déterminant dans l'arrêt des orientations budgétaires pour les années à suivre : "la stabilisation, puis la réduction de l'endettement, est l'objectif prioritaire de la politique budgétaire. À moyen terme, seule la stabilisation de l'endettement permettra à l'État de retrouver des marges de manoeuvre budgétaires. Le retour de la croissance ne suffirait pas, à lui seul, à compenser l'effet "boule de neige" de la dette (...) (Rapport annexé à la loi du 24 janvier 1994).
En effet, c'est la combinaison du solde primaire du budget (hors charges de la dette), mais aussi de l'écart entre taux d'intérêt et taux de croissance qui ont constitué les facteurs déclenchants de ce phénomène de "boule de neige". Des taux d'intérêt supérieurs aux taux de croissance ont enclenché un endettement cumulatif, qui n'aurait pu être enrayé que par un excédent primaire : au contraire, le solde primaire du budget s'est même révélé déficitaire à partir de 1992.
FRANCE - Budget État - Passage du déficit d'exécution (brut) au solde primaire
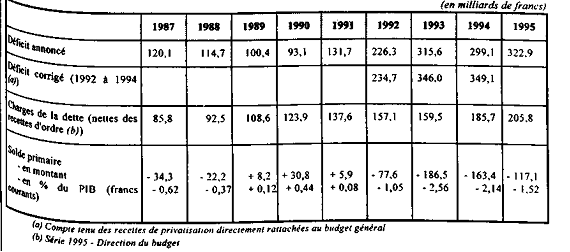
Source Cour des comptes
3. Illustrations
|
Calcul du solde primaire stabilisant la dette en 1996 Les relations décrites ci-dessus permettent de calculer le solde primaire stabilisant le ratio dette/PIB en 1996. Sur la base d'une croissance du PIB en volume de 1,3 % en 1996 (et de 3,1 % en valeur), l'excédent primaire nécessaire en 1996 pour stabiliser la dette publique au sens de Maastricht à son niveau de 1995 (4.064,1 milliards de francs, soit 53,0 % du PIB) serait de 166 milliards de francs, soit 2,1 % du PIB, correspondant à un besoin de financement (y compris charges d'intérêt) des administrations publiques de 1,6 % du PIB en 1996 (à comparer aux 4 % actuellement prévus). Simulation de l'évolution du ratio dette/PIB en 1996 et 1997 Compte tenu d'un déficit prévisionnel (4 % du PIB) supérieur au déficit permettant (selon le calcul présenté ci-dessus) de stabiliser le ratio dette/PIB, celui-ci passerait de 53 % en 1995 à 55,8 % en 1996. En 1997, sous l'hypothèse d'un taux de croissance de 2,8 %, d'une inflation de 2 %, d'une stabilisation des taux d'intérêt à leur niveau d'aujourd'hui et du respect de l'objectif de déficit public au niveau de 3 % du PIB, la dette publique atteindrait 56,9 %. Simulation de l'évolution du ratio Dette/PIB en 1996-1997
Simulation de l'évolution du ratio dette/PIB de
1998 à 2000
Le tableau ci-dessous décrit l'évolution de la dette publique sous l'hypothèse d'une stabilisation du déficit public au niveau de 3 % du PIB et sous les autres hypothèses macroéconomiques suivantes : taux de croissance en volume de 2,5 % par an (soit le taux de croissance potentiel généralement estimé de l'économie française), inflation de 2 % et maintien des taux d'intérêt à leur niveau actuel. |
||||||||||||||||||||||||
|
Dans ces conditions, le ratio dette/PIB passerait de 56,9 % en 1997 à 59,3 % en 2000. Il s'en dégage ce paradoxe -apparent- que le seuil de 3 % fixé par le Traité de Maastricht ne suffit pas pour stabiliser le ratio dette/PIB dans les pays à endettement "moyen" tel que la France, alors qu'il est au contraire suffisant dans les pays à fort endettement (Belgique et Italie) 4 ( * ) . Simulation de l'évolution du ratio Dette/PIB de 1998-2000
|
||||||||||||||||||||
La nécessité de réduire les déficits et de dégager un excédent primaire stabilisant la part de la dette publique dans le PIB apparaît ainsi en toute clarté. Cette conclusion est confortée par les effets finalement assez réduits d'une inflexion des taux d'intérêt sur les charges de la dette.
|
Incidence d'une baisse taux d'intérêts Le tableau ci-dessous décrit l'incidence pour les charges de l'État d'une baisse d'un Point des taux à court et long terme en 1997-1999. Cette variante est calculée par rapport à un compte central fondé sur l'hypothèse d'une légère remontée des taux courts et d'une détente durable des taux longs.
L'économie est de l'ordre de 3,7 milliards de francs la première année, car seule la charge d'intérêt à court terme est initialement affectée. Les économies supplémentaires réalisées les années suivantes (5,5 milliards de francs supplémentaires en 1998, 3,9 milliards de francs en 1999) résultent de l'émission à moindre coût de nouveaux titres pour financer les amortissements et les déficits budgétaires des années 1997-1998. Il convient toutefois de remarquer que ces résultats ne peuvent être utilisés de façon mécanique, car ils sont fortement sensibles aux hypothèses retenues en matière de calendrier et de structure des émissions de titres d'État (part du court et du moyen-long terme). Ils dépendent également des hypothèses de finances publiques sur le moyen terme, les écarts au compte central étant évidemment liés au niveau et à l'évolution de la dette publique retenus dans ce calcul. |
4. L'effet d'éviction des dépenses
a) La logique pluriannuelle
Déjà, la loi quinquennale de maîtrise des finances publiques tirait, en janvier 1994, les conséquences de la réduction du déficit sur le freinage des dépenses : compte tenu de la progression, même ralentie, de la charge de la dette, les autres charges de l'État devaient diminuer à partir de 1995.
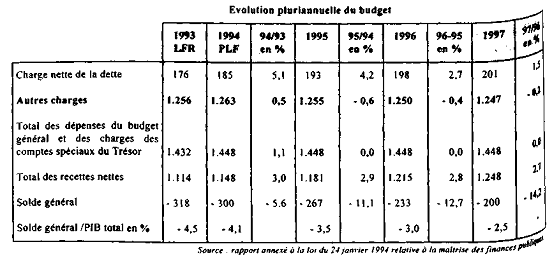
b) 1994 : l'utilisation des plus-values fiscales
L'exécution du budget de 1994 a permis de contenir le déficit, comme prévu, à moins de 300 milliards de francs, mais l'évolution des dépenses : + 2,3 % , a été nettement supérieure à la norme quinquennale de + 0,5 %.
La progression des dépenses du budget général s'explique essentiellement par une ouverture de 32 milliards de francs de crédits dans le collectif de fin d'année, correspondant à une plus-value fiscale de même montant liée à une évaluation trop pessimiste des recettes. "Les principales ouvertures ont porté sur les budgets civils : financement de l'allocation de rentrée scolaire (4,6 milliards de francs), lutte contre l'exclusion (3,4 milliards de francs), intérêts sur la dette et garanties (3 milliards de francs hors remboursements et dégrèvements), emploi et formation professionnelle (3,3 milliards de francs), RMI (2,7 milliards de francs), aides personnelles au logement (2,2 milliards de francs), dotation générale de décentralisation (2,1 milliards de francs), dévaluation du franc CFA (2,1 milliards de francs). De même, une ouverture de 2,6 milliards de francs portait sur les dépenses militaires ordinaires (opérations extérieures)" (Direction du Budget).
c) 1995 : une sollicitation des recettes non fiscales
Dans le cadre de la loi quinquennale de maîtrise des finances publiques, le projet de loi de finances pour 1995 prévoyait une croissance des charges strictement égale à celle des prix, soit + 1,9 %. Les crédits initiaux nets se sont finalement établis à 1.487,6 milliards de francs, soit + 2,3 %.
Toutefois, devant la dégradation des recettes fiscales et la décision de ne pas affecter les recettes de privatisation au budget général, la loi de finances rectificative du 4 avril 1995 a dû aménager le scénario de la loi quinquennale : le déficit budgétaire de l'État devait désormais s'inscrire dans une diminution de l'ensemble des déficits publics à 5 % en 1995, 4 % en 1996, 3 %en 1997.
Le déficit annoncé pour 1995 a été en définitive de 323 milliards de francs, soit 4,2 % du PIB.
Selon la Cour des comptes, ( "Contribution en vue du débat d'orientation budgétaire", 30 avril 1996), le total des dépenses effectives s'établirait en 1995 à 1.596,7 milliards de francs, soit une progression de + 2,9 %. Les recettes auraient progressé de 5,3 %, sous l'effet d'une sollicitation importante des recettes non fiscales : 163,7 milliards de francs, soit + 9,7 %, avec notamment l'inscription d'un prélèvement de 18,5 milliards de francs sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne, et un versement de 15 milliards de francs de la Caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, la Cour estime que la progression des charges réelles a été supérieure, en raison de trois phénomènes :
1°) l'augmentation du taux de TVA affecté au BAPSA de 0,4 à 0,7 %, qui a permis de réduire de 18,7 à 9,1 milliards de francs le montant de la subvention du budget général à ce budget annexe.
2°) la création d'un compte d'affectation spéciale, le "fonds pour l'accession à la propriété", doté de 1 milliard de francs, qui a permis d'éviter d'abonder à due concurrence le budget de l'urbanisme.
3°) le report sur 1996 de 11,9 milliards de dépenses en équipement militaire, liée aux annulations (de régulation) et à la non disponibilité de fait des crédits reportés.
Au total selon la Cour des comptes, "une variation de l'ordre de 4 % traduirait mieux la situation réelle" de l'augmentation des charges.
d) 1996 : des choix difficiles
Compte tenu de l'objectif de réduction du déficit budgétaire de l'État à 3,5% du PIB, et d'une augmentation des recettes évaluée à + 5%, le taux de progression des dépenses est fixé par la loi de finances à + 1,8 %, inférieur à celui de la hausse des prix prévisionnelle (+ 2 %).
Étant donné la progression spontanée des dépenses de dette et de personnel de 33 milliards de francs, l'objectif d'accroissement total des dépenses contenu à 30 milliards de francs a imposé une marge de manoeuvre négative de - 3 milliards de francs.
II. ...À LA RÉDUCTION DES DÉPENSES PUBLIQUES
A. LE POIDS DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
1. Des structures pesantes
L'impératif de faire diminuer le poids de la dépense publique est justifié selon le Gouvernement de façon intrinsèque, par sa part excessive dans l'économie : 54,6 % du PIB, contre 49,8 % en Allemagne.
Si ce poids apparaît d'emblée trop lourd parce que supérieur à la moitié de la richesse nationale, et plus important que dans des pays de niveau de vie comparable, c'est la structure même des dépenses publiques qui devrait faire l'objet de cette comparaison. Or, l'exercice est moins facile, du fait de l'absence de données internationales récentes.
Toutefois, on peut relever, par exemple dans le rapport présenté le 8 novembre 1994, par M. Jacques Méraud au nom du Conseil économique et social, sur "La dépense publique en France" que la part des rémunérations publiques dans le PIB était en France de 13,3 % en 1990, soit plus que le Royaume-Uni - 12,5 % - et nettement plus que l'Allemagne : 9,8 % : ce type de comparaison fait apparaître un poids structurellement plus lourd des structures publiques françaises.
2. La propension à augmenter de la dépense
La nécessité de maîtriser la dépense découle également de sa propension désormais spontanée à progresser. Outre l'effet d'éviction opéré sur les dépenses budgétaires par la charge de la dette, le rapport du Gouvernement évalue les conséquences d'une progression en 1997 des dépenses de personnel et d'intervention, séparément ou ensemble, sur la tendance de 1991 à 1996. L'ampleur de ces progressions : + 22,6 milliards de francs pour les charges de personnel, 20,1 milliards pour les dépenses d'intervention implique une nécessaire correction, qui passe par une recherche d'économies importante.
B. LA DIFFICULTÉ DE MANIER LES RECETTES
La primauté donnée désormais à la réduction de la dépense publique se justifie par les difficultés que rencontre l'État - et les administrations publiques dans leur ensemble - à conserver un niveau de recettes suffisant.
1. L'érosion des recettes fiscales
Les recettes fiscales sont dépendantes d'une croissance devenue plus cyclique, et apparaissent même de plus en plus déconnectées de l'activité. En effet, l'atonie de ces recettes, qui pouvait paraître naturelle en 1993 en tant que conséquence de la récession économique, a persisté en 1994 comme en 1995.
- En 1994, la baisse tendancielle du produit des impôts directs s'est poursuivie ; la croissance du produit fiscal net n'a reposé que sur la TVA et la taxe intérieure sur les produits pétroliers, et davantage du fait de l'incidence des dispositions législatives que de la reprise économique.
- En 1995, la croissance des recettes fiscales s'est à nouveau révélée décevante : + 3,8 %, pour une progression du PIB en valeur de + 4,3 %, et ce malgré les relèvements d'impôts.
2. Les limites à l'augmentation des recettes
Le poids atteint par les prélèvements obligatoires dans l'économie, 45,0 % du PIB en prévision pour 1996, ne permet pas d'envisager une augmentation de la pression fiscale (même si la part des prélèvements effectués pour l'État a nettement diminué au profit de celle des prélèvements sociaux) et tout élargissement d'assiette ou suppression de dépense fiscale significatifs se heurte au préalable de la réforme de l'impôt sur le revenu.
C. L'OBSERVATION DES EXPÉRIENCES PASSÉES
Enfin, comme le soulignait votre rapporteur général lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1996, une étude publiée en octobre 1995 menée sur les politiques budgétaires menées de 1960 à 1992 dans une vingtaine de pays de l'OCDE a montré que dans les cas de réussite de la politique de rééquilibrage, 80 % de la réduction du déficit résultait d'une baisse des dépenses, tandis que, dans les cas d'échecs, l'augmentation des impôts est trois fois supérieure à celle des réductions de dépenses.
CHAPITRE III - "ENDIGUER LA DEFLATION DES RECETTES"
Le niveau des recettes pour 1997 sera bien sûr déterminant dans la lutte pour la réduction des déficits.
Le second objectif -après la réduction des dépenses- de la stratégie budgétaire pour 1997 proposée par le Gouvernement s'intitule : "endiguer la déflation des recettes". Un commentaire de méthode lie cet objectif à la future réforme fiscale. Celle-ci devrait être "progressive, étalée sur cinq ans". Il est, en outre, annoncé que "c'est la baisse des dépenses qui garantira le succès de cette réforme fiscale et enclenchera le cercle vertueux des allégements fiscaux".
Enfin, le guide de la réforme fiscale est livré. Celle-ci doit avoir pour "principes directeurs l'équité, l'efficacité économique et la sauvegarde de l'emploi".
Comment ne pas souscrire à ces principes ? Cependant, en l'état, les modalités de leur mise en oeuvre ne sont pas arrêtées si bien que le débat sur le volet "recettes" de la stratégie budgétaire pour 1997 apparaît un peu désincarné. C'est pour le Parlement l'occasion de demander à être associé à la préparation de la réforme fiscale ; votre commission des Finances rappelle à cet égard les propositions qu'elle avait formulées sur les principes directeurs lui devraient guider une telle réforme, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1996.
En préambule, il apparaît nécessaire de dissiper quelques unes des ambiguïtés qui peuvent naître à la lecture du document déposé par le Gouvernement.
I. DE QUELQUES AMBIGUÏTÉS
A. UN OBJECTIF À L'ÉNONCÉ AMBIGU
"Endiguer la déflation des recettes" c'est vouloir que les recettes soient plus dynamiques qu'elles ne l'ont été dans le passé.
La pertinence de l'objectif ne peut être appréciée sans plus de précisions. D'emblée, il apparaît essentiel d'apporter une réponse à la question suivante : quel est le bon rythme d'augmentation des recettes ?
Répondre à cette question constitue un préalable nécessaire car si l'on n'y prenait garde l'énoncé retenu par le Gouvernement pourrait être compris comme annonciateur de prélèvements supplémentaires destinés à contrecarrer l'érosion de la part des recettes fiscales dans le PIB.
De ce point de vue, la référence dans le rapport du Gouvernement à la "tendance naturelle ... à la prolongation de ce phénomène d'évolution des recettes fiscales sensiblement inférieure à celle du PIB" amène à s'interroger.
Il doit être clair que l'objectif d'évolution des recettes n'est pas de suivre celle du PIB, mais de rester compatible avec le niveau des dépenses afin de réussir à réduire le déficit budgétaire dans les proportions souhaitées.
B. UNE ANALYSE À AFFINER
Pour rendre compte de la médiocrité de l'évolution des recettes dans le passé récent, le rapport du Gouvernement évoque une tendance spontanée à la baisse des recettes fiscales dans le PIB, le dynamisme des prélèvements sur recettes au profit de l'Union européenne et des collectivités locales et le tarissement des marges de manoeuvre procurées auparavant par l'affectation des recettes de privatisation à la couverture des dépenses de l'État.
• Sur le premier point,
on peut en
effet observer que la
pression fiscale de l'État a baissé
si l'on observe le rapport des prélèvements obligatoires
lui revenant dans le PIB.
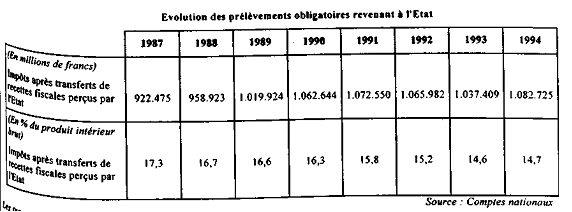
Les transferts de recettes comprennent :
- les transferts de recettes entre administrations publiques (dégrèvement sur impôts locaux pris en charge par l'État, nets des précomptes pour frais de dégrèvements et non-valeurs, solde du compte d'avance sur le produit des impositions, écrêtement de la taxe professionnelle sur les véhicules à moteur, contribution sociale généralisées et recettes du BAPSA)
- les versements effectués par l'État aux institutions communautaires européennes, à partir de 1988, au titre de la quatrième ressource propre assise sur le PNB.
Ainsi, entre 1987 et 1994, le repli de la pression fiscale de l'État a atteint 2,6 points de PIB de sorte que si en 1994 le taux des prélèvements obligatoires de l'État avait été celui de 1987, le niveau des recettes fiscales aurait été supérieur de 260,8 milliards de francs et le déficit contenu à 2 % du PIB.
Cette évaluation certes comptable et qui peut éluder quelques enchaînements économiques importants donne toutefois une idée de importance des transferts intervenus entre l'État et les autres agents économiques depuis une dizaine d'années.
L'origine de ces transferts est sans doute pour partie spontanée mais elle ne l'est pas seulement. Elle réside également dans une série de mesures volontaristes qui ont consisté à alléger le poids de l'impôt 5 ( * ) .
Dans l'ensemble, l'inspiration de ces mesures est louable. Le détail de certaines d'entre elles doit être examiné à l'aune des critères énoncés pour guider la future réforme fiscale.
Mais, au diagnostic d'une réduction spontanée du rendement du système fiscal de l'État il convient d'ajouter pour la sincérité du débat le constat d'un infléchissement volontaire des prélèvements fiscaux opérés par lui.
•
S'agissant du dynamisme des
prélèvements opérés par l'Union européenne
et les collectivités locales
sur les recettes de l'État,
il convient également de dissiper quelques ambiguïtés.
En ce qui concerne le prélèvement au profit de l'Union européenne, sa progression a été, depuis une dizaine d'années, légèrement supérieure à celle du PIB et donc assez sensiblement supérieure à celle des prélèvements obligatoires revenant à l'État.
À l'évidence, l'État et l'Union européenne ont exercé des effets divergents sur le taux de pression fiscale. Si, depuis 1987, le budget des Communautés européennes avait été géré en recettes comme le budget de l'État, une économie de l'ordre de 18 milliards de francs aurait été dégagée en 1994.
Sans dissimuler le problème essentiel posé par le budget européen qui est celui du niveau des dépenses assumées par lui, force est de réaffirmer, comme le Sénat le fait depuis toujours, l'insuffisance de la prise en compte des capacités économiques et financières des États dans le système des ressources des Communautés.
De la même manière, il faut souhaiter que davantage de précisions entourent l'estimation du prélèvement sur recettes effectué au profit de l'Union européenne. À cet égard d'ailleurs, l'évaluation mentionnée par le rapport du Gouvernement n'apparaît pas entièrement satisfaisante. Ainsi, plutôt que de se référer à l'estimation du prélèvement européen pour 1996-89 milliards de francs-, il conviendrait pour apprécier la contrainte budgétaire qu'il comporte de recourir à une fourchette dont le chiffre cité pourrait constituer le degré supérieur.
Il faut rappeler en effet qu'en 1995 le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne avait été évalué à 88 milliards de francs pour une réalisation de 78,2 milliards de francs et que ce phénomène qui améliore la situation de financement de l'État, sans être toujours de cette ampleur, n'en est pas moins fréquent.
En ce qui concerne les prélèvements au profit des collectivités locales il est excessif de les présenter comme empreints d'un particulier dynamisme. Ils n'ont progressé que de 2,6 % en francs courants entre 1991 et 1995, soit nettement moins que le PIB. Ils représentaient 2,08 % de celui-ci en 1991 et 2,03 % en 1995.
Compte tenu de la réforme de la dotation globale de fonctionnement 6 ( * ) intervenue à l'occasion de la loi de finances initiale pour 1994 et qui a détérioré les modalités d'indexation de la dotation au détriment des collectivités locales, la baisse relative des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales a d'ailleurs un caractère mécanique accusé.
Il faut ajouter que la révision à la baisse de l'estimation de croissance pour 1995 pèsera fortement sur la progression de la dotation globale de fonctionnement en 1996, si bien que l'évaluation de son montant mentionné dans le document de préparation du débat d'orientation budgétaire en surestime le poids. Étant donné les perspectives de croissance pour 1996, l'augmentation de ce prélèvement sur recettes devrait être également très modérée en 1997.
Tout ceci milite pour un respect absolu du pacte de stabilité passé entre l'État et les collectivités locales. 7 ( * )
• Enfin, il est vrai que la décision de cesser
d'affecter les recettes de privatisation à la couverture des
dépenses de l'État a constitué un progrès sensible
vers une plus grande sincérité budgétaire.
Toutefois, cette méthode nouvelle n'est pas sans effets sur le niveau des charges de l'État en termes d'économies sur les charges d'intérêt ou les dotations aux entreprises publiques. Son adoption en tant que telle ne prive pas l'État de marges de manoeuvre mais les utilise différemment.
C. L'ÉVOLUTION DES RECETTES FISCALES EN 1995
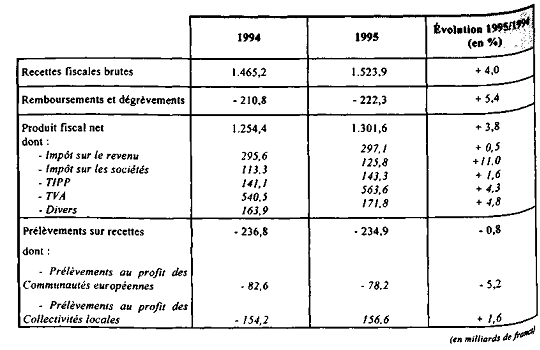
La prévision économique associée à la loi de finances pour 1995 escomptait une croissance de 5,1 % et un produit fiscal net de 1.305,9 milliards de francs, en hausse de 4,1 % par rapport à 1994. Ces deux estimations étaient compatibles avec une élasticité du système fiscal 8 ( * ) égale à 0,80. "In fine", la croissance aura été en 1995 de 3,9 % et les recettes fiscales nettes se seront accrues de 3,8 % au prix d'un alourdissement des prélèvements obligatoires.
Celui-ci a conduit à ajouter à l'évolution spontanée des recettes fiscales un supplément de recettes de l'ordre de 30 milliards de francs essentiellement au titre de la TVA (+ 17 milliards de francs) et de l'impôt sur les sociétés (+ 11 milliards de francs).
Sans ces mesures nouvelles, la variation des recettes fiscales aurait été de l'ordre de 1,4 %, soit une élasticité du système fiscal par rapport à la croissance de 0,35.
Il s'agit là d'un résultat très médiocre.
1. Les recettes de TVA
Les recettes de TVA ont augmenté de 4,3 % par rapport à 1994 malgré le relèvement de 2 points du taux normal de TVA intervenu au mois d'août. En 1994, le produit de cet impôt, avant la majoration évoquée, avait été de 7,2 %. La faible progression de l'assiette - consommation et investissement des ménages, consommation des administrations et importations - est la cause essentielle du médiocre rendement de l'impôt. Mais il faut sans doute s'interroger sur le rendement du recouvrement de la TVA sur les importations intra-communautaires en particulier. De ce point de vue, le parlement attend avec un grand intérêt le rapport que le Gouvernement s'est engagé à lui soumettre.
2. Les recettes tirées de l'impôt sur le revenu
Les recettes tirées de l'impôt sur le revenu sont restées quasiment stables si bien qu'en points de PIB elles ont régressé de 0,15 point : si elles s'étaient seulement maintenues par rapport à l'année précédent, les déficits publics auraient représenté non pas 5 mais 4,85 % du PIB.
Là également, la faible croissance de la base taxable - le revenu disponible brut des ménages avant impôt n'avait cru que de 1 % en 1994 -explique une partie du faible rendement de cet impôt en 1995. Mais des phénomènes d'optimisation fiscale de la part des ménages jouent probablement de plus en plus pour expliquer l'évolution décevante du produit de l'impôt sur le revenu.
3. La TIPP
S'agissant de la taxe intérieure sur les produits pétroliers -la TIPP- qui est la troisième ressource fiscale en importance, son produit n'a augmenté -malgré l'aménagement des droits - que de 1,6 en 1995.
Sur le fond, l'évolution de cette recette traduit de façon directe l'actuelle déformation de la consommation des produits pétroliers. Dans un marché globalement stable, la composante la plus dynamique reste le gazole qui bénéficie d'une taxation allégée.
4. Le médiocre dynamisme des recettes de TIPP a cependant pour corollaire une amélioration de l'assiette de l'impôt sur les sociétés
En 1995, le produit de cette recette s'est accru de 11 %. À législation inchangée, cet accroissement n'aurait pas dépassé 1 % en valeur.
Pour expliquer cette évolution, le ministre délégué chargé du budget a fait valoir lors de son audition par la commission des Finances du Sénat la très forte concentration de l'impôt, levé pour l'essentiel auprès de quelques grandes entreprises, dont le comportement fiscal et comptable rendrait cette recette vulnérable.
En toute hypothèse, le produit de l'impôt sur les sociétés connaît une évolution qui contraste vivement avec la progression du revenu disponible brut des sociétés et quasi-sociétés en 1994 (+ 9,9 %) et 1995 (+ 5,4 %).
D. LES RECETTES FISCALES EN 1996 ET 1997 : DE MULTIPLES INCONNUES
L'évolution spontanée de progression des recettes fiscales en 1996 et en 1997 dépendra d'abord de l'activité économique et également, comme les développements précédents l'ont démontré, de la pérennité des comportements d'évitement de l'impôt.
Les prévisions concernant les recettes fiscales sont, l'expérience le montre, assez hasardeuses. Une mise à niveau s'impose cependant au vu de la révision des perspectives de croissance pour 1996 et des premières prévisions pour 1997.
Les développements qui suivent doivent être compris moins comme une prévision exacte des niveaux de rentrées fiscales à attendre à l'horizon 1997 que comme des tentatives pour cerner l'ampleur des marges de manoeuvre éventuelles qu'ils dégageront.
De ce point de vue, si les perspectives en matière de TVA semblent plus solidement étayables, compte tenu des caractéristiques de ce prélèvement, que celles relatives aux autres impôts, il faut rappeler que le niveau des rentrées fiscales est fortement dépendant de deux variables partiellement imprévisibles (activité économique et comportement d'évitement de l'impôt).
Cette dernière observation ne relève pas seulement d'une prudence de prévisionniste. Elle appelle à forger des méthodes budgétaires rénovées établissant un lien lisible entre les flux de dépenses et les flux de dépenses effectives.
Dans une annexe, à partir d'une étude réalisée par la division des études macro-économiques du Sénat, sont présentés les résultats d'une simulation de l'impact d'un ralentissement de la croissance sur les comptes publics.
1. La TVA
La TVA a représenté en 1995 41,2 % des recettes fiscales nettes de l'État. Son évolution est donc décisive pour apprécier les marges de manoeuvre offertes par les recettes fiscales.
Sous certaines réserves, la TVA budgétaire nette évolue d'une année sur l'autre comme la base taxable. En 1995, les recettes perçues à ce titre se sont élevées à 563,6 milliards de francs, soit une moins-value par rapport aux estimations révisées pour 1995 (573,5 milliards de francs) égale à 9,9 milliards de francs.
La loi de finances pour 1996 prévoit un niveau de la recette de 634,7 milliards de francs, en hausse de 10,7 % par rapport aux estimations initiales pour 1995.
Cette estimation doit être révisée pour deux raisons.
D'une part, les réalisations pour 1995 amènent à modifier la base d'évolution de la recette. Appliquée à son montant effectif pour 1995, le taux de croissance retenu dans la prévision pour 1996 donne une recette de 620,3 milliards de francs.
D'autre part, et surtout, les prévisions économiques servant au calcul de l'évolution de l'assiette taxable pour 1996 ont été profondément modifiées. Celle-ci devrait se traduire par une croissance guère supérieure à 3,4 % en 1996 et à 4,4 % en 1997.
Dans ces conditions, compte tenu de l'application en année pleine à partir de 1996 du relèvement du taux normal de TVA, le niveau de cette ressource devrait être proche de 607,4 milliards de francs en 1996 et de 634,1 milliards de francs en 1997.
Le supplément de recettes serait donc à ce titre de 20 milliards entre 1995 et 1996 et de 26,7 milliards entre 1996 et 1997.
Étant donné les perspectives de croissance du PIB à l'horizon 1997, les recettes de TVA exprimées en part de PIB connaîtraient une légère progression : 7,70 points en 1997 contre 7,34 points en 1995.
Ceci constitue un résultat plutôt favorable en comparaison avec les évolutions récentes. Cependant, il faut rappeler que par rapport à l'estimation du produit de la TVA nette mentionnée par le projet de loi de finances pour 1996, la moins-value fiscale pourrait être pour cette année de l'ordre de 27 milliards de francs.
2. Les principales autres recettes fiscales
Les autres impôts ont représenté 58,8 % des recettes fiscales nettes de l'État en 1995.
Comme l'illustrent les déconvenues souvent rencontrées dans l'art de prévoir les impôts, il serait très hasardeux de souhaiter décrire avec précision le sort du produit de chaque impôt en 1996 et 1997.
Les commentaires sur ce point ne peuvent que viser à évaluer les tendances et à juger des prévisions actuellement disponibles à l'aune de celles-ci.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés l'évaluation associée à la loi de finances retenait un produit fiscal net de 132 milliards de francs. Étant données les recettes effectivement perçues en 1995, la progression des rentrées provenant de cet impôt devrait être de 4,9 % en 1996.
Dans ce domaine, un certain nombre de facteurs comme la révision à la baisse pour le passé des estimations portant sur l'amélioration de l'état financier des entreprises, la baisse des taux d'intérêt et les perspectives de modération salariale tendent à laisser espérer des résultats au moins aussi favorables que ceux envisagés.
Il faut cependant tenir compte des perspectives d'inflexion de la demande adressée aux entreprises en 1996 et des mesures fiscales prises en faveur des sociétés, en particulier à l'occasion de la loi n° 96-314 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Avec toute la prudence nécessaire, il est possible d'estimer, compte tenu des hypothèses d'un maintien du taux de marge des entreprises 9 ( * ) et de la poursuite de leur rétablissement financier, que les perspectives de croissance du produit de l'impôt sur les sociétés pourraient, en dépit des mesures fiscales citées, être parallèles au PIB.
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'évaluation associée à la loi de finances pour 1996 tablait sur 309,4 milliards de francs de recettes.
Compte tenu des recettes effectives de 1995, il faudrait pour parvenir à ce résultat une progression du produit de cet impôt de 4,1 %.
Les recouvrements de rôles effectués chaque année portent sur les rôles émis cette année au titre des revenus de l'année précédente qui représentent la quasi-totalité de l'impôt et sur les rôles émis les années antérieures non recouvrés du fait du mécanisme de l'impôt ou difficilement recouvrables.
Pour évaluer le montant disponible pour l'État au titre de l'impôt sur le revenu, les variables d'approche sont le revenu disponible et les salaires nets des ménages. Les estimations retenues à ce titre dans la loi de finances pour 1996 apparaissent un peu optimistes compte tenu de l'évolution des salaires nets perçus par les ménages en 1995.
La prévision comptait sur une augmentation de 4,5 % tandis que la révision des comptes nationaux l'estime à 3,6 %. Les perspectives dans ce domaine pour 1996 sont peu favorables puisque le revenu disponible brut des ménages ne devrait augmenter que de 2,6 % en valeur.
En conclusion, sur la base de la tendance spontanée des assiettes, les perspectives en matière d'impôt sur le revenu pourraient devoir tenir compte d'une moins-value de l'ordre de 2 milliards de francs en 1996 et d'une évolution en 1997 sensiblement inférieure à celle du PIB.
Ces estimations doivent être corrigées à la baisse du fait des mesures décidées dans la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont l'effet devrait s'exercer à partir de 1997.
S'agissant de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, les recettes effectives ont été assez proches des recettes prévues en 1995.
En l'absence de maîtrise en prévision de l'aléa pétrolier et compte tenu d'hypothèses de réduction spontanée de la recette compensées par un aménagement des droits, il n'y a pas lieu à de plus amples commentaires.
On peut cependant observer que la troisième recette fiscale de l'État -11 % du produit fiscal net en 1995 - évolue sensiblement moins vite que le PIB.
E. LES RECETTES NOS FISCALES
Le recours à des recettes non fiscales a été largement sollicité en 1995. Ainsi, en dépit d'une réduction apparente de leur volume global -163,7 milliards de francs en 1995 contre 199,2 milliards de francs en 1994-, le montant des recettes non fiscales hors privatisations s'est accru de 14,7 milliards de francs l'an dernier, soit une progression de 9,7 %.
La Cour des comptes estime que "de telles hausses des recettes non fiscales ne paraissent pas pouvoir être escomptées de manière durable".
De fait, même si en francs constants le niveau des recettes non fiscales pour 1996 est légèrement inférieur à celui atteint en 1991 ou 1992, certains prélèvements paraissent exceptionnels.
Une appréciation impartiale conduit à estimer que l'an dernier les recettes non fiscales ont été sollicitées pour compenser les moins-values de recettes fiscales dans des conditions qui apparaissent difficilement reconductibles.
F. SYNTHÈSE : UNE ÉVOLUTION FAVORABLE ?
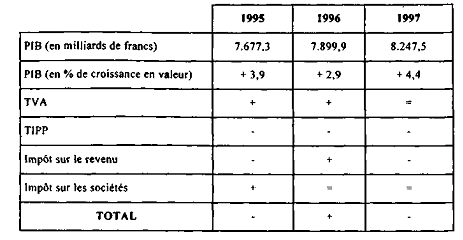
Le tableau ci-dessus présente, de manière synthétique, les évolutions escomptables des principaux impôts comparées à celle du PIB à horizon de 1997. 10 ( * )
Au cours de la période sous revue, les recettes de TVA (42 % des recettes fiscales) devraient s'accroître un peu plus vite que le PIB tandis que celles résultant de la TIPP déclineraient en part de PIB.
Quant à l'impôt sur le revenu -22,8 % du produit fiscal net- son Produit s'accroîtrait plus vite que le PIB en 1996 mais moins en 1997.
Enfin, la part de l'impôt sur les sociétés dans le PIB se maintiendrait.
Au vu des premiers résultats de l'année 1996, un profil temporel se dessine : l'année en cours pourrait être plus favorable du point de vue fiscal que l'année prochaine.
Le début de l'année 1996 enregistre une progression satisfaisante des recettes fiscales.
Évolution comparée des recettes aux premiers trimestres 1995 et 1996
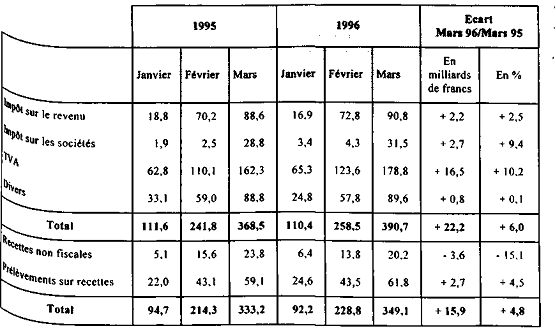
L'évolution prévisible en 1996 et 1997 est paradoxale étant données les perspectives de croissance mais s'explique par les phénomènes suivants : l'extension en année pleine en 1996 du relèvement du taux normal de TVA qui accroît mécaniquement la recette par rapport à l'année précédente, les effets décalés des évolutions du revenu des ménages sur les rentrées d'impôt sur le revenu, les caractéristiques de la reprise peu favorables au dynamisme fiscal...
Spontanément, les recettes fiscales devraient en 1996 et 1997 évoluer sensiblement comme le PIB. Le taux de pression fiscale devrait se maintenir.
Cependant, malgré les incertitudes qui entourent toutes prévisions en la matière, il est raisonnable d'escompter que les prélèvements sur recettes s'accroissent plus vite que le PIB sous l'effet de la contribution française au budget des communautés européennes 11 ( * ) et que les recettes non fiscales, au contraire, évoluent moins vite.
Au total, l'évolution tendancielle des recettes de l'État devrait être légèrement moins rapide que celle du PIB, l'année 1997 se caractérisant par le creusement d'un différentiel.
Hors mesures nouvelles en recettes, tout l'assainissement budgétaire devrait ainsi reposer sur les dépenses publiques dont l'inflexion en part de PIB devra être légèrement supérieure à 1 point en 1997.
CHAPITRE IV - "UNE ACTION FORTE SUR LES DÉPENSES"
Au coeur de la stratégie budgétaire proposée par le Gouvernement, la réduction des dépenses doit être appréciée dans son ampleur et ses modalités.
I. L'AMPLEUR DE L'EFFORT À FOURNIR
A. LA PRÉSENTATION DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement fait l'hypothèse implicite d'un maintien des charges au niveau de 1996 en francs courants, soit 1.552 milliards de francs.
Il évalue ensuite l'ampleur de l'effort à fournir en projetant sur 1997 la progression de chacun des postes de dépenses en 1997 au rythme constaté de 1991 à 1996, ce qui compte tenu du plafond retenu, donne l'ampleur des économies à opérer sur les autres catégories de dépenses.
Progression "spontanée" des dépenses
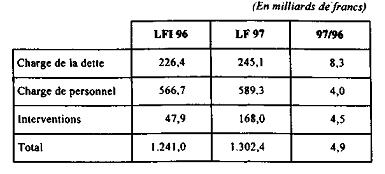
Au total, la progression spontanée des dépenses serait de 61,4 milliards en francs courants.
Il serait donc nécessaire de réduire les autres dépenses à due concurrence.
B. UN DÉBAT À CLARIFIER
1. Les hypothèses de 1996
En 1996, le déficit prévisionnel du budget de l'État s'élève à 287,8 milliards de francs, ce qui "autorise" un déficit des comptes sociaux de 28,2 milliards de francs, afin de contenir le déficit des administrations publiques (316 milliards de francs) sous un plafond égal à 4 % du PIB (7.900 milliards de francs).
2. Les hypothèses et prévisions pour 1997
a) Le retour à l'équilibre des comptes sociaux
Pour 1997, l'hypothèse d'un retour à l'équilibre des comptes sociaux a été posée. Toutefois, les difficultés qui apparaissent en 1996 pour respecter l'objectif initial d'un déficit de 17 milliards de francs amènent à envisager la possibilité de voir persister un déficit spontané en 1997. Auquel cas le retour à l'équilibre serait conditionné à l'institution de prélèvements spécifiques de nature transitoire.
b) Le respect des engagements de Maastricht
Dans l'hypothèse d'un retour à l'équilibre des comptes sociaux, il reviendrait à l'État de réduire son déficit à 3 % du produit intérieur brut.
Sur la base des prévisions économiques du Gouvernement, le produit intérieur brut devrait passer de 7.900 milliards de francs en 1996 à 8.247,6 milliards de francs en 1997 (pour un taux de croissance prévisionnel de 2,8 % et une hausse des prix du PIB de 1,6 %).
Le montant du déficit de l'État ne devrait donc pas excéder 247,4 milliards de francs (3 % du PIB) ; par rapport à 1996, le solde du budget de l'État devrait ainsi s'améliorer de 40,4 milliards de francs. Le niveau attendu des recettes exigerait alors de maintenir les dépenses à un niveau comparable à celui de 1996, soit 1.552 milliards de francs en francs courants. Dans ces conditions, le niveau d'économies à réaliser serait celui de la progression spontanée des dépenses.
Il convient afin de dissiper tout malentendu de rappeler que les économies que le Gouvernement entend réaliser en 1997 ne s'appliquent pas aux dépenses de 1996 mais répondent au souci de compenser la dérive spontanée des dépenses prévisibles pour 1997.
c) La dérive spontanée des dépenses en 1997
Le rapport du Gouvernement s'attache à évaluer la progression spontanée de certaines dépenses et met en lumière une dérive de 61,4 milliards de francs.
Autant les données retenues que les hypothèses posées pour apprécier l'accroissement tendanciel des dépenses de l'État mériteraient quelques précisions.
Sur le premier point, il convient d'observer que l'estimation du niveau de la charge de la dette mentionnée par le document remis au Parlement pourrait être un peu surestimée du fait du changement intervenu dans le traitement des coupons courus dans une perspective d'harmonisation européenne.
L'impact de cette réforme sur le déficit public et sur la dette publique est rappelé dans le tableau qui suit.
Impact sur le déficit public
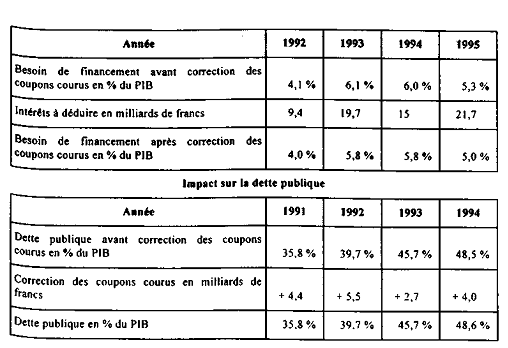
Il en ressort que les chargés d'intérêt et le besoin de financement de l'État sont minorés mais que la dette publique est, elle, majorée.
S'agissant des hypothèses, associées à la simulation de la dérive spontanée des dépenses publiques, plusieurs questions se posent.
La projection est bâtie sur les évolutions tendancielles des dépenses de personnel et d'intervention au cours de la période 1991-1996. Pour les dépenses d'intérêt leur estimation s'appuie sur les hypothèses du rapport économique, social et financier du projet de loi de finances pour 1996.
Sur ce dernier point, il y a lieu d'abord de souligner que l'estimation retenue dans le rapport servant de base au débat d'orientation budgétaire excède de 5,7 milliards de francs l'estimation actualisée dans le rapport économique, social et financier, de la charge nette de la dette en 1997 retenue par la projection quinquennale des finances publiques.
En outre, il est légitime de s'interroger sur les économies que pourraient produire sur ce poste de dépenses une gestion active de la dette répondant à l'inflexion des taux d'intérêt à court terme 12 ( * ) .
En ce qui concerne les dépenses de personnel et d'intervention, le choix de la période de référence (1991-1996) pourrait conduire à en surestimer l'accroissement.
S'agissant de l'évolution de la masse salariale de l'État, la projection se fonde sur une augmentation de 4 % conforme à la moyenne annuelle du taux de croissance observés ces cinq dernières années.
Or, il apparaît qu'en glissement la croissance de la masse salariale versée par l'État s'est sensiblement ralentie à effectifs constants au cours de cette période.
Quant aux dépenses d'intervention, il convient d'observer que leur évolution est davantage tributaire d'hypothèses volontaristes qui rendent délicates la prévision en ce domaine.
On peut donc considérer que la dérive spontanée des dépenses en 1997 est présentée sous des couleurs un peu pessimistes. Toutefois, étant donné le caractère aléatoire des prévisions de recettes, on ne peut reprocher au Gouvernement de faire preuve de prudence en affichant un objectif d'économies de l'ordre de 60 milliards de francs.
II. QUELLES ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES ?
A. LES PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT
Partant du volume des charges de personnel et des interventions, qui représentent au total 793,1 milliards de francs, soit 51,1 % du budget en 1996, le Gouvernement estime que :
1. "Les charges de personnel doivent être maîtrisées"
À cet égard, l'accent est mis sur l'inflation des effectifs constatée au cours des dernières années : 72.300 emplois budgétaires en 8 ans.
2. "Les dépenses d'intervention doivent être au centre de la révision des services votés"
Parmi ces dépenses d'intervention, sont cités les secteurs "les plus importants en masse budgétaire" : les crédits en faveur de l'emploi (139 milliards de francs) et les aides au logement (52,6 milliards de francs), dont l'augmentation continue est rapprochée respectivement de la diminution du chômage par rapport à 1994 et de la décroissance du nombre de nouveaux ménages.
B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission des Finances estime que toute prise de position sur les économies budgétaires possibles suppose une analyse préalable de l'ensemble des dotations, et l'adoption d'une démarche systématique.
1. L'analyse des crédits budgétaires
S'il est vrai que les dépenses de personnel et d'intervention ont un poids déterminant dans le budget de l'État, c'est l'ensemble des dotations budgétaires qui doit faire l'objet d'une démarche systématique de recherche d'économie.
Les crédits du budget de 1996
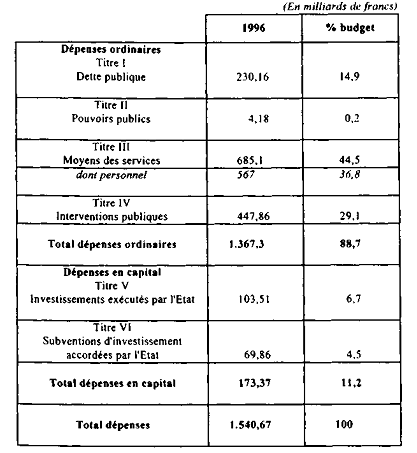
Cette présentation classique fait apparaître l'importance de la charge de la dette (près de 15 % du total), nettement supérieure aux crédits d'investissement (11,2 %). La comparaison avec 1995 fait apparaître la progression de la charge de la dette, des dépenses de personnel et de fonctionnement, la stabilité des interventions et le recul des dépenses d'équipement.
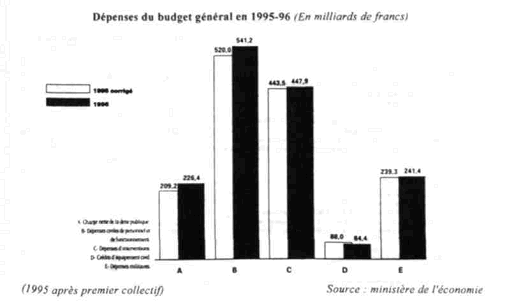
Cette présentation traditionnelle des crédits doit être complétée par deux approches :
a) Un regroupement des dépenses par objectif
Ainsi, la présentation par titre et par partie demanderait à être modernisée. On voit apparaître sous le titre "interventions économiques" (36 % des crédits d'intervention), un pan essentiel des aides à l'emploi, avec les contrats aidés, les exonérations de charges sociales, le reclassement des travailleurs handicapés, alors que la subvention à l'AFPA ou les crédits des stages de formation pour les jeunes apparaissent quant à elles en "interventions éducatives et culturelles".
Le Parlement devrait disposer d'un document budgétaire plus adapté aux réalités, les crédits étant regroupés par vocation : c'est un budget "fonctionnel" qui est ainsi préconisé par votre commission des Finances, et qui permettrait de suivre l'évolution réelle des politiques. Cette présentation, qui devrait transcender les titres et parties est d'ailleurs partiellement réalisée par le ministère de l'économie et des finances, sur les crédits d'intervention adoptés en 1996.
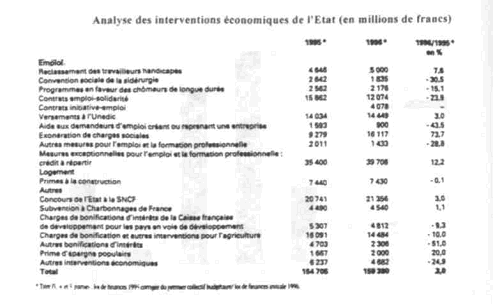
Source : Budget 1996. Soles bleues de Bercy - 96-1
b) Une appréciation de la flexibilité des dépenses
Cette présentation doit se doubler d'une évaluation du degré de flexibilité des dépenses du budget. Votre rapporteur général s'était livré à cet exercice à partir du projet de loi de finances pour 1996, qui permettait de mieux apprécier les possibilités d'économies budgétaires.
Les dépenses étaient ainsi regroupées en six catégories
• Les dépenses
"imposées"
Les dépenses intégralement imposées à l'État sont rares : au-delà des prélèvements sur recettes affectés à l'Union Européenne (qui apparaissent en moindres recettes et non pas en dépenses), des contributions obligatoires aux organisations internationales ou des frais de justice prescrits par les magistrats, les dépenses inéluctables peuvent en fait être modulées à la marge par l'État.
Il s'agit des dépenses ayant un caractère de dette : dette publique, rémunérations et pensions des fonctionnaires -dues à leur statut- pensions des anciens combattants, indexées sur les traitements des fonctionnaires
- la dette publique
Les charges de la dette de l'État, conditionnées par le niveau des déficits antérieurs et l'évolution des taux d'intérêt, sont des dépenses auxquelles l'État ne peut bien sûr se soustraire, une action étant seulement possible sur le calendrier des émissions de titres. Ces dépenses s'élèvent en 1996 à 226.4 milliards de francs, en augmentation de 8,2 %.
- Les pensions et rémunérations des fonctionnaires
Les charges de personnel dépendent du taux fixé pour la revalorisation du point de la fonction publique, du niveau des effectifs, et de l'évolution des carrières. L'État conserve la maîtrise du point de la fonction publique, peut agir -assez marginalement- sur l'évolution des carrières, et maîtriser, à la marge, les effectifs de fonctionnaires, mais pas ceux des pensionnés.
On peut assimiler aux charges de pensions des fonctionnaires les dépenses de pensions des anciens combattants, indexées sur l'évolution du point de la fonction publique, dont l'évolution est toutefois freinée spontanément par la diminution naturelle du nombre des ayant-droits : la dépense est de 21,37 milliards de francs en 1996 au lieu de 21,7 milliards de francs en 1995.
•
Les dépenses de
structures
Dans l'ordre de 1'"inéluctable" décroissant, les dépenses liées au fonctionnement des structures occupent la deuxième place. Sauf à bloquer l'activité d'une administration ou d'un établissement public, voire à en supprimer l'existence, la réduction des dépenses de fonctionnement s'avère difficile à manier même si les exercices de régulation et d'annulation des crédits imposés en cours d'année par la Direction du Budget y ont régulièrement recours.
- Le matériel et le fonctionnement de l'administration
Ainsi, dans le projet de loi de finances pour 1996, les dépenses de matériel et fonctionnement des services progressent de 0,65 %, alors que la norme imposée par la lettre de cadrage envoyée le 8 juin 1995 par le Premier ministre aux ministres dépensiers imposait une diminution de 8 % des dépenses de fonctionnement hors personnel.
- Les subventions de fonctionnement aux établissements publics.
Elles devraient théoriquement être plus facilement modulables, l'établissement pouvant être sommé de procéder à des redéploiements de dépenses, voire de renoncer à certaines opérations. Toutefois, là encore, c'est une progression des dépenses de 3,3 % qui est prévue en 1996, certaines augmentations accordées à des établissements compensant les quelques diminutions opérées.
Ainsi, à la recherche, les subventions de fonctionnement augmentent de 3,5 % et atteignent 19,960 milliards de francs.
La subvention au CNRS progresse de 500,3 millions de francs et atteint 10,676 milliards de francs.
L'exemple du CNRS illustre une autre difficulté à réaliser des économies sur les subventions de fonctionnement : en effet, l'augmentation brutale des moyens de 1996 rattrape les diminutions de crédits des années antérieures, qui n'avaient pas été intégrées dans les programmes de recherche : les économies supposent en effet une évaluation préalable des établissements, et notamment de leurs capacités de redéploiement interne.
- Les subventions d'équilibre
On peut rapprocher des subventions de fonctionnement les subventions versées par l'État afin d'assurer l'équilibre financier de divers régimes, qu'elles interviennent -ou non- dans un cadre contractuel.
• Les dépenses
contractuelles
L'État est aussi lié à des organismes par des liens contractuels qui prédéterminent sa contribution financière.
Il en est ainsi pour :
- le financement de l'enseignement privé sous contrat : 36,91 milliards de francs en 1996,
- les subventions à la SNCF, intervenant dans le cadre d'un contrat de plan,
- le transport gratuit de la presse, prévu dans le cadre d'un contrat avec la Poste : 1,9 milliard de francs en 1996.
On peut sans doute y ajouter d'ores et déjà les dotations de décentralisation (32,5 milliards de francs) dans la mesure où elles sont appelées à s'inscrire dans le pacte de stabilité qui devrait être conclu avec l'État.
•
Les dépenses "à guichet
ouvert"
Une grande part des dépenses d'intervention correspond à des prestations dont l'accès est subordonné a des conditions objectives, fixées par voie législative et réglementaire, qui doivent elles-mêmes être modifiées si l'on veut infléchir la dépense.
Il en est ainsi en 1996 pour :
- L'allégement du coût du travail sur les plus bas salaires : 38,8 milliards de francs,
- les aides au logement versées aux personnes : 27,72 milliards de francs,
- le revenu minimum d'insertion : 23 milliards de francs,
- l'allocation aux adultes handicapés : 20,86 milliards de francs,
- les bourses scolaires et universitaires : 9,39 milliards de francs,
- l'aide juridique : 1,1 milliard de francs.
•
Les dépenses
conditionnelles
Or, proches de la catégorie précédente, ces dépenses sont toutefois subordonnées à un examen de la situation par l'administration.
Entrent dans cette catégorie :
- les actions du Fonds national de l'Emploi : 33,54 milliards de francs dont :
- l'incitation au retrait d'activité (préretraites...): 15,42 milliards de francs
- les contrats emploi solidarité : 10,84 milliards de francs
- les aides à l'agriculture : 12,16 milliards de francs
- le reclassement des travailleurs handicapés : 4.99 milliards de francs.
- Les actions pour la promotion de l'emploi: 1,457 milliards
de francs -dont
900 millions de francs pour l'aide aux demandeurs d'emploi
créant ou reprenant une entreprise.
•
Les dépenses "flexibles"
Il est rare qu'une dépense échappe à toute contrainte législative, réglementaire ou contractuelle.
On doit toutefois considérer que l'État peut agir plus librement sur certains postes de dépenses qui sont, au moins en théorie, quasi discrétionnaires, comme le montrent les économies pratiquées dans le budget de 1996 :
* L'action internationale
Les contributions non obligatoires aux organisations internationales : ainsi, la France diminue-t-elle cette année sa participation à l'Unicef, au Haut commissariat aux réfugiés, au programme alimentaire mondial, ...
En ce qui concerne l'aide au développement, les actions de coopération civile et militaire sont réduites en 1996, respectivement à 2,11 milliards de francs (-200 millions de francs) et à 776 millions de francs (- 7 millions de francs).
* la politique économique
L'État garde la maîtrise, en opportunité, du volume des dépenses de bonification industrielle : 6,94 milliards de francs, ou encore des aides "à la pierre" au logement : 14,8 milliards de francs.
* La lutte contre les fléaux sociaux
L'État est également maître d'interventions d'intérêt général, telles que la lutte contre le SIDA (0,45 milliard de francs), contre la drogue (0,67 milliard de francs), la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme (0,18 milliards de francs).
* La politique culturelle
Au sein du budget de la culture, les actions de "développement culturel et formation" (2,46 milliards de francs), de "soutien" (3,21 milliards de francs), de "recherche"(762 millions de francs), restent très largement discrétionnaires, étant le plus souvent versées sous forme de subvention aux associations.
On peut considérer qu'il en est de même pour les actions en faveur de la jeunesse, de la vie associative, du sport, qui diminuent de 10 millions de francs et s'établissent à 1,1 milliard de francs en 1996 au sein du budget de la jeunesse et des sports.
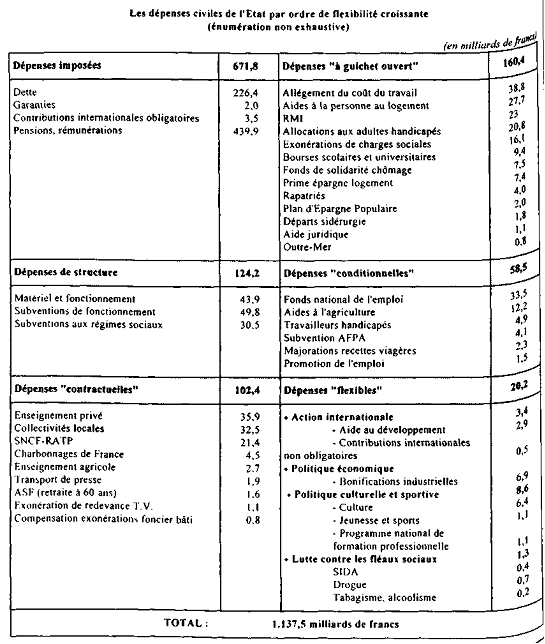
Cette double approche : par objectif et par nature de la dépense devrait permettre de préparer la recherche des économies.
2. Une recherche d'économies systématique
L'ampleur des économies nécessaires justifie que soient passées en revue l'ensemble des dotations ainsi analysées de la manière systématique :
Chaque grande dotation, ou catégorie de dotations, peut donner lieu à une fourchette d'économies -au moins théorique-.
Quelle méthode permettrait d'y parvenir ? Suppression ou réduction de structures, d'effectifs, changements de base de calcul d'allocations, globalisation des crédits, sous-traitance de services, aménagement de calendriers...
Quelles conséquences doivent être envisagées ? Suppression d'actions, transfert sur d'autres postes de compétences, report de programmes... Ce n'est qu'au vu des réponses à ces deux questions que les économies pourront être décidées.
|
L'exemple de la fonction publique Les perspectives d'économies sur les charges de personnel, largement commentées et controversées, illustrent la nécessité d'adopter une telle démarche Ainsi peuvent être comparées deux pistes d'économies : l'absence de revalorisation du point d'indice et l'absence de remplacement des départs à la retraite, au vu des travaux réalisés par les services du ministère de l'économie et des finances à la demande de la division des études macroéconomiques du Sénat. Incidence sur les charges salariales d'une revalorisation de 1 % du point d'indice L'impact de cette mesure sur la masse salariale brute et sur les cotisations sociales versées par l'État employeur est d'environ 0,87 % ; en revanche, la masse des pensions civiles et militaires, et des pensions d'anciens combattants, indexées sur la valeur du point, croît de 1 %. Au total, le besoin de financement de l'État est accru de 5,2 milliards de francs, et le besoin de financement des administrations publiques centrales de 5,6 milliards de francs. Toutefois, il convient de signaler que l'évolution de la valeur de l'indice détermine également celle des salaires des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Au total, la masse salariale brute de l'ensemble des administrations progresse d'environ 7,6 milliards de francs quand la valeur du point augmente de 1 %. tandis que les rentrées de cotisations sociales (perçues par l'État ou les administrations de sécurité sociale) s'accroissent de 0,7 milliards de francs En ajoutant l'augmentation de la valeur des pensions versées par 1'État, par la CNRACL et par l'IRCANTEC, on peut évaluer à environ 9,1 milliards de francs (soit 0,1 % du PIB) l'augmentation du besoin de financement des administrations publiques induite par une hausse de 1 % de la valeur du point de la fonction publique. |
|
Incidence d'une diminution de 10.000 unités des effectifs de l'État (en équivalent temps plein) Sous l'hypothèse d'une stabilité des effectifs et du maintien du pouvoir d'achat des mesures générales, la masse salariale brute de l'État en 1997 serait de 400,3 milliards de francs. Une réduction de 10.000 des effectifs de l'État (soit - 0,45 % environ) par non-remplacement d'une partie des départs à la retraite se traduirait par une économie de 1,2 milliards de francs sur les charges salariales de l'État. Cet effet, somme toute faible, au moins à court terme, s'explique par le phénomène suivant : le salaire des fonctionnaires en fin de carrière est en moyenne 56 % plus élevé que celui des débutants, de sorte que le non-remplacement des sorties induit une augmentation mécanique du salaire par tête, par le biais du vieillissement des effectifs en activité. (On parle alors d'un "effet Glissement-Vieillesse-Technicité positif). Pour une diminution de 25.000 unités des effectifs, l'économie pour l'État la première année est de l'ordre de 3 milliards de francs. À terme toutefois, l'effet d'une baisse des effectifs est plus important : l'effet sur la masse salariale devrait être proportionnel à la réduction des effectifs, soit un gain de 2,1 milliards de francs (sur la base des salaires 1996) dans le cas d'une baisse de 10.000 unités des effectifs de l'État, de 5,25 milliards de francs dans le cas d'une baisse de 25.000 unités des effectifs de l'État. À terme également, les dépenses de fonctionnement liées à une réorganisation devraient diminuer. L'effet financier des deux mesures doit bien sûr être apprécié dans le cadre plus large d'un examen en opportunité. |
3. Des prolongements indispensables
Cette analyse préalable à l'exercice d'économies budgétaires devrait permettre, selon votre commission des Finances, d'apporter trois types d'améliorations dans la discussion budgétaire au Parlement.
a) Un nouveau mode de régulation
Une telle approche des dotations budgétaires, accompagnée d'une marge d'économies possibles, devrait rendre possible une inscription réaliste de dotation pour charges imprévues par ministère, qui serait actée par le Parlement et éviterait la traditionnelle opération de régulation budgétaire forfaitaire.
b) Une présentation pluriannuelle du budget
Afin de mieux évaluer les conséquences des choix arrêtés, le Parlement devrait pouvoir disposer d'une programmation pluriannuelle des grandes catégories de dépenses, le vote du budget ne pouvant plus se situer dans la perceptive stricte de 1'"exercice budgétaire", -et ce d'autant plus que le Parlement est amené à se prononcer sur des lois quinquennales.
c) Des critères d'évaluation
Il n'est bien sûr pas possible de prévoir une évaluation préalable de chaque action avant de réfléchir sur les économies budgétaires.
Toutefois le Parlement paraît être en droit de demander à disposer d'indicateurs simples d'évaluation pour chaque dotation importante. L'analyse des aides à l'emploi et au logement à laquelle invite le Gouvernement en est un bon exemple : ainsi, au-delà du volume effectivement impressionnant des aides à l'emploi (peut-être pas plus que celui du nombre des demandeurs d'emploi ?) devraient pouvoir être appréciés le coût moyen des mesures 13 ( * ) et leur efficacité -au sein d'une échelle-. Actuellement, l'absence de tels indicateurs rend l'examen des crédits peu réaliste. De même, l'effet redistributeur des aides à la personne au logement devrait être pris en compte dans l'examen de l'ensemble des aides au logement.
ANNEXE N° 1 - SENSIBILITÉ DES COMPTES PUBLICS À UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE
On trouvera ici les résultats d'une simulation de l'impact d'un ralentissement de la croissance sur les finances publiques, réalisée à l'aide du modèle METRIC de la Direction de la Prévision.
1. Principales hypothèses de la simulation
a) Hypothèses macroéconomiques :
Les variantes issues du modèle METRIC décrivent les effets sur trois ans (1996-1998) d'une réduction de 1 point de la croissance du PIB marchand en 1996.
Simuler un ralentissement de cette nature suppose d'en déterminer les causes. Celles qui sont présentées dans cet exercice correspondent aux deux scénarios dont on peut supposer à priori que leurs effets sur les recettes fiscales et sociales diffèrent le plus fortement :
- dans un premier scénario, le ralentissement de la croissance résulte d'une moindre progression de la demande mondiale qui entraîne un ralentissement des exportations. Celles-ci n'étant pas assujetties à la TVA, on peut supposer que cette variante est celle qui aura les incidences les plus faibles sur les recettes fiscales ;
- dans un second scénario, le ralentissement de la croissance est imputable à une moindre progression de la consommation des ménages, consécutive à une hausse du taux d'épargne.
Ces deux scénarios sont présentés dans les tableaux figurant à la fin de cette annexe.
b) Hypothèses relatives aux finances publiques :
•
Hypothèses relatives aux recettes
publiques :
On rappelle que les recettes dont l'assiette n'est pas directement liée aux évolutions conjoncturelles (impôts en capital, cotisations sociales des retraités, fiscalité directe locale, etc...) n'évoluent pas dans les variantes présentées.
Concernant les autres types de recettes, les variantes retiennent, pour l'essentiel, les hypothèses suivantes :
- 60 % du produit de la TVA évolue comme la consommation des ménages et 10 % comme leurs investissements.
- Les impôts sur les salaires (taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, versement transport...) progressent comme la masse salariale.
- La progression du bénéfice fiscal des sociétés est égale à celle de leur excédent brut d'exploitation 14 ( * ) . La progression de l'impôt sur les sociétés lui-même tient compte du mécanisme solde-acomptes qui introduit un délai de perception de plus d'un an.
- L'évolution de l'impôt sur le revenu prend en compte l'évolution du salaire moyen par tête en volume, de l'indice des prix et des effectifs salariés de l'année précédente.
- La CSG et le RDS évoluent en fonction de la masse salariale totale et des pensions indexées.
- Les cotisations sociales des organismes de sécurité sociale ont une élasticité de 0,95 à la masse salariale du secteur marchand non agricole 15 ( * ) et les cotisations UNEDIC une élasticité unitaire.
•
Hypothèses relatives aux dépenses
publiques
Les variantes présentées ne prennent pas en compte l'incidence éventuelle d'un ralentissement de la croissance sur le nombre d'allocataires de certaines prestations sociales (RMI notamment).
Les prestations sociales et les salaires publics sont par ailleurs indexés sur les prix, hormis pour 1996 où les évolutions nominales sont déjà fixées.
2. Résultats de la simulation sur le solde des administrations publiques
a) Variante de ralentissement de la demande mondiale :
Si le ralentissement de la croissance résulte d'un ralentissement des exportations, l'effet sur le solde public est quasiment nul la première année et reste faible les deux années suivantes. La capacité de financement des administrations publiques se dégrade d'environ 23 milliards de francs (soit 0,3 % du PIB) en trois ans : - 8 milliards pour l'État, - 15 milliards pour les administrations de Sécurité sociale.
Cette dégradation s'explique par la diminution des recettes de cotisations sociales, liée à la baisse de l'emploi salarié privé (- 0,8 % par rapport au compte central), par la hausse corrélative des dépenses d'indemnisation du chômage, et par le moindre dynamisme de l'impôt sur les sociétés qui ne se manifeste qu'en 1997 et 1998 en raison de son mode de calcul et de recouvrement.
En raison de la faible modification du volume et des prix de la consommation des ménages dans ce scénario, le produit de la TVA et des autres impôts assis sur la consommation n'évolue quasiment pas.
b) Variante de ralentissement de la consommation :
Les impôts assis sur la consommation réagissent immédiatement (- 10 milliards dès la première année), et contribuent fortement à la dégradation ultérieure du solde budgétaire. Les cotisations sociales et les impôts directs, impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu, diminuent nettement la deuxième année, comme dans le scénario précédent.
Le besoin de financement des administrations publiques se creuse ainsi de 14 milliards de francs en 1996 (0,2 % du PIB), et d'environ 16 milliards de francs supplémentaires en 1997. En revanche, le solde ne se dégrade plus la troisième année, en raison d'une légère accélération de la croissance du PIB (liée notamment à la baisse des rentrées fiscales). En fin de période, le déficit public est supérieur de 0,35 % du PIB à son niveau de référence. La dégradation du compte de l'État (et des autres administrations centrales), dont le déficit s'accroît de 17 milliards de francs en trois ans, est plus importante que dans la variante demande mondiale (- 8 milliards de francs).
Impact d'une réduction de 1 point du taux de croissance du PIB en 1996
(Écarts au compte central, en milliards de francs courants)
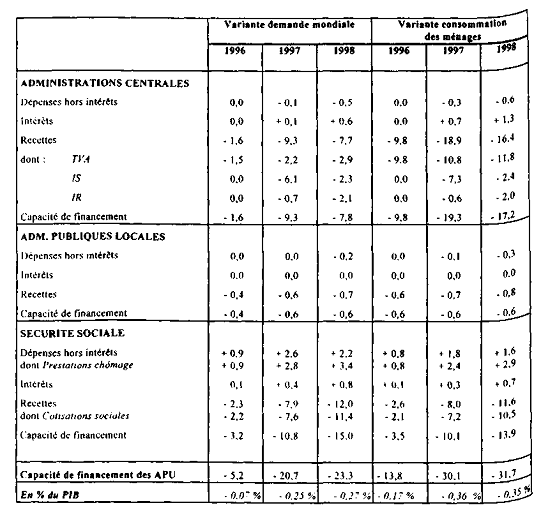
Au total, trois conclusions se dégagent de cette simulation :
- la sensibilité des comptes publics à une réduction de 1 point de la croissance en 1996 varie à court terme selon les facteurs du ralentissement économique : un ralentissement de la consommation a des effets plus importants que celui des exportations ;
- dans les deux cas, le ralentissement de la croissance ne produit ses effets les plus notables qu'au terme d'un délai de deux ans, en raison du décalage dans le temps de la perception des principaux impôts directs ;
- si l'on se réfère aux résultats de cette simulation, la dérive des comptes de la Sécurité sociale prévue pour 1996 (prévision de déficit de 50 milliards de francs contre un objectif de 17 milliards pour le Régime général) ne semble pas seulement imputable au ralentissement de la croissance.
*
* *
3. Que peut-on en déduire quant à l'effet sur les finances publiques de la révision à la baisse des hypothèses de croissance pour 1996 ?
Le compte macroéconomique présenté par le Gouvernement au mois d'octobre 1995 et associé au projet de loi de finances pour 1996, donnait une prévision de croissance pour 1996 de 2,8 %. Celui qui vient d'être présenté à la commission des Comptes du mois de mars dernier retient une prévision de 1,3 %.
Cette différence est due principalement au ralentissement anticipé de la consommation (qui représente 60 % environ du PIB) : sa progression passe de 2,3 % dans la prévision d'octobre 1995 à 1,3 % dans celle de mars 1996. L'effet du ralentissement de la demande étrangère (de 7,5 % en octobre 1995 à 5,9 % en mars 1996) et des exportations (qui ne représentent que 23 % du PIB) est moindre.
Dans ces conditions, on peut approximativement considérer que l'incidence du ralentissement de la croissance en 1996 sur les finances publiques doit être appréciée au vu des résultats de la variante « ralentissement de la consommation ».
Ainsi, pour 1996 et par rapport à la prévision d'octobre 1995, le creusement mécanique du déficit public imputable à l'évolution conjoncturelle, peut-il être évalué à 1,5 %x 0,17 = 0,3 point de PIB. Les experts du Gouvernement ont cependant précisé à l'occasion de la dernière réunion de la commission des Comptes que l'objectif de déficit public de 4 % en 1996 n'en était pas affecté dans la mesure où l'harmonisation de la comptabilisation des soldes publics aux normes européennes (modification de la règle du coupon couru) et le Plan de redressement de la Sécurité sociale compensaient largement les effets mécaniques du ralentissement de la croissance.
Variante de moindre progression de la demande mondiale
(Variations en volume par rapport à un compte de référence)
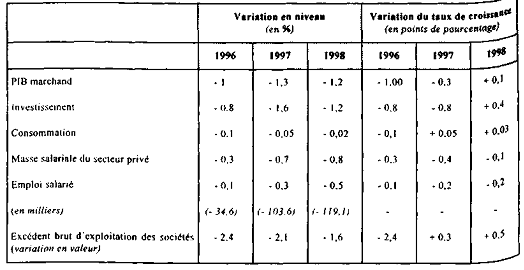
Variante de moindre progression de la consommation
(Variations en volume par rapport à un compte de référence)
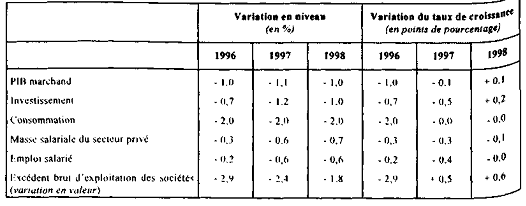
ANNEXE N° 2 - LE PACTE DE STABILITÉ ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
|
Le pacte de stabilité des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales : des engagements à respecter, une réflexion à prolonger Les discussions au sein de votre commission des Finances ont été l'occasion de rappeler au Gouvernement son engagement de respecter, pour 1996, 1997 et 1998, les termes du "pacte de stabilité" voté dans le cadre de la loi de finance initiale pour 1996. Le "pacte" recouvre l'ensemble des concours de l'État aux collectivités territoriales déjà indexés en vertu de dispositions de précédentes lois de finances ; la masse ainsi définie doit progresser selon l'indice prévisionnel d'évolution des prix, l'ajustement étant réalisé au moyen de la suppression de la première part de la dotation globale d'équipement et des ponctions opérées sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle. Quant aux différentes compensations placées hors "pacte" (FCTVA, compensation des dégrèvements et exonérations d'impôts locaux...), si leur montant ne peut, par nature, être préservé par un engagement formel du Gouvernement, leurs modalités de calcul doivent cependant bénéficier d'une stabilisation après les aménagements opérés dans la dernière loi de finances pour ralentir leur progression. Il convient donc sans doute d'imputer à une maladresse l'insertion dans le rapport du Gouvernement (page 48), sous le titre "endiguer la déflation des recettes", d'une remarque d'ensemble sur l'évolution des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales. Votre commission souhaite en tout cas obtenir une confirmation claire que le Gouvernement ne reviendra pas sur la parole donnée à l'automne dernier. Plus fondamentalement, le Sénat avait exprimé le regret que la notion de pacte de stabilité ne soit pas étendue à l'ensemble des contraintes financières imposées par l'État aux collectivités territoriales. La vision unilatérale défendue par le Gouvernement avait du reste empêché que ledit "pacte" fasse l'objet d'un accord conventionnel| signé par les associations représentant les élus locaux. Ceux-ci ne peuvent toujours pas se satisfaire d'une situation caractérisée par la hausse inéluctable de quatre séries de charges procédant d'exigences formulées par l'État : Après une année de pause, la question du financement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) se posera à nouveau, en 1997, à défaut d'un abaissement significatif de la surcompensation. En effet, la stabilisation, en 1996, des cotisations employeur à la CNRACL n'a été acquise que par le report sur 1997 de 4,8 milliards de francs, représentant près de trois points de cotisation employeur, dus au titre des dispositifs de compensation et de surcompensation entre régimes de retraite. L'exercice en cours est d'ores et déjà caractérisé par une exécution extrêmement tendue en trésorerie. En dépit du gel, cette année, de la valeur de l'indice de la fonction publique, les frais de personnel restent fondamentalement stimulés par l'application des accords Durafour : pour la seule année 1996, les mesures de revalorisation sont estimées à 1,5 milliard de francs par le Crédit Local de France. La progression d'ensemble des dépenses de personnel atteindrait, selon la même source. + 4,4 % sur le présent exercice, toutes collectivités confondues un peu plus pour les départements (+5-6 %). et + 8.6 % pour les seules régions. Les dépenses d'aide social e continuent, elles aussi, de progresser à un rythme sensiblement supérieur à celui de la hausse des prix de détail. Leur taux d'évolution avoisine encore, cette année, 5 % pour la moyenne des départements et des contingents communaux Toutefois, des taux plus proches de 10 %, voire supérieurs sont observables, à la lecture des budgets primitifs, pour certains départements et les grandes villes Enfin, l'investissement des collectivités territoriales va devoir se stabiliser à un niveau élevé dans le futur proche. Une étude récente du Crédit Local de France révèle, en effet, que celles-ci, pour satisfaire à diverses contraintes dans les domaines de l'environnement et de la sécurité, devront investir près de. 1.000 milliards de francs sur le quinquennat 1996-2000, soit environ 200 milliards de francs par an, alors que moyenne de ces dernières années s'établit plutôt autour de 150-160 milliards de francs : - pour l'assainissement, une directive européenne oblige les villes à traiter les eaux usées d'ici 2005 au plus tard : de 1995 à 2005, la réalisation de nombreuses stations d'épuration devrait représenter 70 milliards francs d'investissements. Le traitement des eaux pluviales représente un besoin de 80 à 100 milliards de francs supplémentaires ; - le traitement des déchets ménagers devrait se traduire par des investissements d'un montant de 50 milliards de francs d'ici 2002 ; - les projets en cours de réalisation ou à l'étude dans le domaine des transports publics urbains représentent 30 milliards de francs d'ici l'an 2000 ; - les collectivités ont déjà beaucoup investi dans le domaine de l'éducation et devraient encore injecter environ 25 milliards de francs par an dans le financement des travaux de rénovation et de sécurité dans les locaux scolaires (commission Schléret, décret amiante...). L'effet de ciseaux, entre des charges accrues et des recettes qui sont, tendanciellement, en faible progression du fait, notamment, de la stagnation des concours de l'État, devrait ainsi aller en s'accentuant. Les conséquences négatives de cette situation sont claires : les collectivités territoriales ont dû, cette année, comme leurs budgets primitifs en font foi, agir simultanément sur le levier fiscal et sur l'investissement, dans ce dernier cas en dépit des obligations qui s'imposent à elles dès 1996 et dont la liste a été dressée plus haut : - Seuls 20 départements sur 100 et 5 grandes villes sur 45 n'ont pas augmenté les taux de leurs quatre impôts directs. En outre, 60 % des départements interrogés par l'assemblée des présidents de conseils généraux (APCG) envisagent, cette année, une nouvelle baisse de leurs droits de mutation. - En termes d'investissement, les dépenses votées par les conseils généraux (équipement direct et subventions aux communes) seraient globalement en baisse de 1,1 %, mais 20 % des départements interrogés par l'APCG envisagent, dans leurs budgets primitifs, des pourcentages négatifs à deux chiffres. S'agissant grandes villes, frappées de plein fouet par la suppression de la première part de la DGE, une tendance à la baisse des budgets d'investissement est incontestable, même si ces collectivités présentent un profil moins homogène que celui des départements. Les collectivités territoriales peuvent donc légitimement craindre d'être placées dans une situation intenable au cours des prochaines années, en continuant d'accroître les impôts locaux sans parvenir à satisfaire les exigences de tous ordres auxquelles elles demeurent confrontées. Au-delà des termes du "pacte de stabilité", dont le respect par le Gouvernement constitue un minimum une remise à plat du rôle et des ressources des collectivités locales et de leur interaction avec le budget de l'État est ainsi devenue indispensable. L'ardente obligation de réduction du déficit budgétaire de l'État ne doit pas se conclure, en effet, par de nouveaux transferts de charges non compensés aux collectivités locales. Il faut souhaiter que la réflexion générale sur la réforme de l'État et la discussion sur le projet de loi de clarification de la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales seront l'occasion d'un débat qui n'avait pas pu trouver sa place lors de la remise des conclusions du rapport Delafosse. |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I - Audition de M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances, et de M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sur les orientations budgétaires pour 1997, le mardi 7 mai 1996, sous la présidence de M. Christian Poncelet, président
M. Christian Poncelet, président, a rappelé que la commission avait demandé que le débat d'orientation budgétaire ait lieu au Parlement avant l'envoi aux ministres des lettres de cadrage, afin que les débats parlementaires puissent être pris en compte dans les grandes orientations arrêtées pour le budget de 1997.
Après avoir souligné que l'initiative de ce débat d'orientation revenait à la commission des Finances du Sénat, M. Jean Arthuis a rappelé d'emblée la nécessité absolue de procéder à des réformes structurelles qui se traduiraient dans le budget de 1997.
Le ministre de l'économie et des finances a insisté sur la valeur pédagogique que revêtait le rapport déposé par le Gouvernement en vue du débat d'orientation budgétaire, dont l'un des principaux enseignements devait être l'impossibilité pour l'État de retrouver une indépendance financière sans enrayer la dynamique de l'accroissement de l'endettement. Le ministre a, par ailleurs, estimé que les craintes d'un alourdissement des prélèvements obligatoires et l'hypertrophie des secteurs public et parapublic créaient des blocages importants dans l'opinion publique.
Les orientations du budget de 1977 devraient donc prendre en compte l'impopularité croissante de la dépense publique, dont seule la réduction permettra l'allégement des prélèvements obligatoires selon un cheminement défini par le Président de la République. M. Jean Arthuis a estimé que l'action menée par le Gouvernement depuis le mois de mai 1995 était déjà très positive, car elle avait permis notamment une baisse très importante des taux d'intérêt à court terme.
Le ministre de l'économie et des finances a ensuite insisté sur quelques points forts contenus dans le rapport préparatoire au débat d'orientation budgétaire. Ainsi, pour la première fois, le budget de l'État y est présenté en sections de fonctionnement et d'investissement, ce qui permet de constater l'existence d'un déficit de 109 milliards de francs de la section de fonctionnement, s'accompagnant de la nécessite d'emprunter pour financer les charges de personnel et même de la dette, ainsi que la réduction continue des dépenses d'investissement de l'État opérée depuis plusieurs années.
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances, a identifié les quatre raisons majeures justifiant la réduction de l'endettement public: le poids excessif des emplois publics dans l'économie, l'effet d'éviction opéré sur les marchés obligataires par la dette de l'État, la nécessité de redonner des marges de manoeuvre au budget de l'État, et enfin l'obligation de respecter les engagements du Traité de Maastricht.
Le ministre de l'économie et des finances a rappelé l'effet mécanique, au sein du budget de l'État, de l'évolution des charges de la dette et des dépenses de personnel qui avaient abouti, en 1996, à l'obligation -a législation constante - de réduire les autres dépenses de 6 milliards de francs, et il a souligné l'anomalie que représentait l'absence, dans le budget de l'État, de dotations pour charges imprévues, ce qui conduisait régulièrement à la nécessité de geler des crédits au lendemain du vote du budget.
M. Jean Arthuis a ensuite présenté les différentes hypothèses retenues dans le rapport préparatoire au débat d'orientation budgétaire, selon que les charges de la dette, de personnel et d'intervention continueraient à augmenter en 1997 au rythme des années précédentes, séparément ou ensemble, ce dernier scénario aboutissant à la nécessité de réaliser des économies budgétaires supérieures à 60 milliards de francs sur les autres postes de dépenses.
Le ministre de l'économie et des finances a enfin rappelé que la réunion du Gouvernement, tenue le 2 mai sur l'initiative du Premier ministre, avait abouti à la décision collégiale d'adopter des mesures d'économie dont le débat d'orientation budgétaire permettrait d'affiner les contours.
M. Jean Arthuis a conclu par la nécessité de maintenir la confiance dans l'économie française, non pas par le creusement des déficits dont les effets avaient montré leurs limites, mais bien par la réduction de la dépense publique.
À l'issue de cet exposé, M. Alain Lambert, rapporteur général, a tout d'abord souligné la divergence d'appréciation existant entre le Gouvernement et les instituts de prévision sur le niveau des déficits publics atteints en 1996, et s'est interrogé sur la prise en compte de la réduction des déficits sur l'économie dans les prévisions du Gouvernement pour 1997.
Le rapporteur général a ensuite demandé des précisions sur le niveau et la nature des recettes attendues en 1997, compte tenu du ralentissement de la croissance en 1996 et de son faible contenu en recettes pour l'État.
M. Alain Lambert s'est ensuite interrogé sur la possibilité de prolonger le recours à des recettes non reconductibles ou à certaines modifications de nomenclature budgétaire, mises en évidence par la Cour des Comptes pour l'exercice 1995, tout en soulignant la difficulté évidente de réduire le déficit du budget de l'État en période de ralentissement des recettes. Enfin, le rapporteur général a souhaité connaître les scénarios possibles de réduction de la dépense publique envisagés par le Gouvernement, et s'est interrogé sur le rôle que celui-ci souhaitait voir jouer par le Parlement dans le débat d'orientation budgétaire.
En réponse à M. Alain Lambert, rapporteur général, M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, a rappelé que les prévisions du Gouvernement relatives à la croissance, de + 1,3 % en 1996, et entre + 2,5 et 3 % en 1997, étaient proches de la moyenne des prévisions des experts français et des organisations internationales. M. Alain Lamassoure a ensuite estimé qu'après le ralentissement économique observé au cours des trois derniers trimestres de 1995, on assistait à un "redécollage en douceur", comme permettaient de le penser la meilleure orientation de la consommation, le haut niveau des intentions d'investissement et la bonne tenue des exportations. Par ailleurs, les mesures annoncées le 30 janvier dernier et contenues dans la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier devraient permettre d'amplifier cette évolution spontanée positive.
Le ministre chargé du budget a rappelé que les prévisions des instituts sur le niveau des déficits en 1997 étaient effectuées à politique constante, sans prendre en considération des mesures aussi importantes que l'achèvement de la réforme de la Sécurité sociale, ce qui expliquait leur divergence avec les prévisions du Gouvernement.
Par ailleurs, M. Alain Lamassoure a souligné que la réduction des dépenses publiques, dans l'état où se trouvait l'économie française, ne pourrait avoir qu'un effet favorable sur la croissance.
S'agissant des prévisions de recettes pour 1997, le ministre délégué au budget a rappelé que l'exécution du budget de 1995 s'était révélée décevante pour les recettes fiscales, dont le produit n'avait progressé que de + 2 % en valeur contre + 3,9 % pour le PIB, à législation constante. Ainsi, le produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques n'avait augmenté que de + 0,7 %, à cause notamment d'un recours croissant des ménages à la déduction des frais engagés pour les emplois familiaux. De même, le produit de l'impôt sur les sociétés n'avait progressé que de + 3.3 %, du fait du provisionnement, par les grandes entreprises, des pertes liées à la récession économique.
M. Alain Lamassoure a estimé que ces phénomènes devraient disparaître au cours de l'année 1996, le coefficient d'élasticité fiscale par rapport à l'activité économique paraissant se normaliser au vu des résultats du mois d'avril, et il a affirmé qu'au total, l'évaluation d'un montant de recettes fiscales de 1.300 milliards de francs pour 1997 paraissait raisonnable.
Le ministre délégué au budget a ensuite fait part de l'intention du Gouvernement d'appliquer les recommandations de la Cour des Comptes en vue d'une meilleure présentation du budget. Dès 1997, une présentation du budget de l'État en sections de fonctionnement et d'investissement sera réalisée, et plusieurs catégories de recettes extrabudgétaires n'apparaissant jusqu'à présent qu'en loi de règlement figureront désormais dans la loi de finances initiale.
M. Alain Lamassoure a ensuite présenté les principales masses budgétaires subissant jusqu'à présent un effet "boule de neige", et dont la maîtrise se révélait indispensable pour ne pas dépasser le plafond de 1.552 milliards de francs imparti aux dépenses de l'État en 1997.
Outre la charge de la dette liée au montant du déficit et au niveau des taux d'intérêt, les dépenses de personnel demeurent difficiles à réduire, malgré les gains de productivité permis par l'informatisation et les transferts de compétence liés à la décentralisation, ce qui justifie un examen plus attentif des possibilités de réduction d'effectifs.
En troisième lieu, les aides à l'emploi représentent un volume de 138 milliards de francs, en progression de quelque 20 milliards de francs par an, se répartissant entre 44 régimes différents devenus parfois impossibles à déchiffrer. La remise à plat de ces aides, jugée nécessaire par toutes les parties au sommet social du 21 décembre 1995, est d'ailleurs effectuée par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale.
En quatrième lieu, les aides au logement se révèlent également être un poste de dépenses difficilement compressibles, car elles sont issues de la juxtaposition de différents régimes dont le coût progresse de 15 à 20 % par an, alors que les mises en chantier de logements reculent et que le nombre de sans-abri augmente. Enfin, les crédits de la défense, qui ont fait l'objet d'importantes mesures d'économie, devront également être réexaminés a l'aune des décisions portant sur les mesures d'accompagnement des restructurations d'unités, sur la recapitalisation des industries d'armement et sur la réforme du service national.
Un large débat s'est alors instauré.
M. René Ballayer a souhaité savoir si la baisse des taux d'intérêt à court terme était mise à profit pour renégocier la dette publique.
Mme Marie-Claude Beaudeau, après avoir souligné que la hausse des prélèvements obligatoires intervenue en 1995 avait été utilisée pour financer les charges de la dette et les allégements de cotisations patronales, ce qui constituait un transfert réalisé aux dépens des ménages et comportant des effets économiques néfastes, s'est demandé si l'objectif retenu par le Gouvernement d'accroître la déconcentration des contrôles financiers avait un lien avec ses projets de réforme de l'État.
M. René Trégouët s'est inquiété pour l'avenir de France-Télécom des rumeurs selon lesquelles le Gouvernement projetait de prélever une soulte d'un montant de 50 milliards de francs sur cette entreprise, rappelant que le secteur des télécommunications en Europe s'ouvrait à la concurrence et qu'il importait donc de préserver la compétitivité de la France dans ce domaine.
M. Yann Gaillard a estimé que le document présenté par le Gouvernement à l'occasion du débat d'orientation budgétaire représentait une certaine révolution culturelle, dans le sens où l'État s'y trouvait "banalisé" en tant qu'agent économique. Puis, il a indiqué que l'inflexion des dépenses publiques supposait, pour être durable, une réflexion approfondie sur le rôle et les missions de l'État.
M. Philippe Adnot, après avoir souscrit à la démarche du Gouvernement, a souhaité que celle-ci prenne en compte l'ensemble des charges publiques et, en particulier, que ne soit pas éludée la question des transferts de charges de l'État vers les autres agents économiques et plus particulièrement les collectivités locales.
M. Henri Collard a rappelé la nécessité pour l'État de respecter le pacte de stabilité financière passé avec les collectivités locales.
M. Joël Bourdin a jugé que la démarche économique empruntée par le Gouvernement obéissait à une conception économique classique et s'est demandé si, à court terme, elle ne risquait pas de produire d'effets déflationnistes, d'autant que les contraintes financières pesant sur les collectivités locales contraindraient celles-ci à modérer leurs investissements.
Il a ensuite exprimé le souhait que le Gouvernement s'attache à promouvoir un "pacte de non-agression" de l'État vis-à-vis des collectivités locales dont un élément fondamental serait qu'aucun bouleversement des règles s'appliquant à elles n'intervienne sans que des délais leur soient octroyés pour y faire face.
M. Jean Cluzel a exhorté le Gouvernement à saisir l'occasion du débat d'orientation budgétaire pour traduire dans les faits les recommandations formulées par le Sénat. Il a rappelé à ce sujet que la Haute assemblée avait souhaité à plusieurs reprises une reconstruction du budget du secteur audiovisuel dont les événements récents, porteurs de vives suspicions dans l'opinion, témoignaient de l'urgente nécessité.
M. Christian Poncelet, président, s'est alors félicité de l'enrichissement apporté par le Gouvernement à la rénovation de la présentation du budget de l'État à travers la distinction faite entre dépenses de fonctionnement et d'investissement.
Puis, il a souhaité recueillir le sentiment du ministre délégué au budget sur les observations de la Cour des Comptes selon lesquelles 14 % des crédits prévus pour financer le revenu minimum d'insertion étaient détournés de leur objet.
Il a ensuite souligné qu'à la lecture du rapport du Gouvernement, les effets des dévaluations des monnaies anglaise et italienne sur l'emploi dans ces pays apparaissaient mitigés.
Enfin, ayant interrogé le ministre sur les projets du Gouvernement quant à l'incorporation des révisions cadastrales et ayant exprimé son inquiétude face à la croissance des charges supportées par les collectivités locales, il a solennellement appelé à la nécessité de respecter le pacte de stabilité passé par l'État avec celles-ci.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, en réponse a M. Christian Poncelet, président, a indiqué que, s'agissant de l'utilisation des crédits destinés à financer le revenu minimum d'insertion, le Gouvernement prendrait des décisions lorsque lui auraient été remis les rapports des missions parlementaires actuellement en cours sur ce sujet.
Le ministre a par ailleurs souscrit à l'analyse de M. Christian Poncelet quant aux effets des dévaluations sur l'emploi et a souligné que la France se distinguait par rapport à ses voisins par son incapacité à créer des emplois dans le secteur privé.
M. Alain Lamassoure a ensuite indiqué que le pacte de stabilité passé avec les collectivités locales, sur lequel plusieurs autres intervenants dont MM. Philippe Adnot, Joël Bourdin et Henri Collard avaient appelé son attention, ne serait pas remis en cause. Il a, par ailleurs, précisé que les intentions du Gouvernement étaient de mettre en oeuvre, dès le 1er janvier 1998, les résultats de la révision des évaluations cadastrales désormais menées à leur terme, tout en tenant compte de certains problèmes particuliers comme celui de l'évaluation des logements.
En réponse à M. René Ballayer, il a indiqué que le Trésor s'attachait en effet à tirer les conséquences de la baisse des taux en y adaptant les modalités de la gestion de la dette.
Ayant dit son désaccord avec les analyses de Mme Marie-Claude Beaudeau quant aux transferts de charges entre les agents économiques suscités par les prélèvements décidés en 1995, il a observé que la déconcentration des contrôles financiers devrait être la conséquence logique de la déconcentration budgétaire conduite par l'État.
Répondant à M. René Trégouët, il a déclaré que le Gouvernement n'avait pas arrêté sa décision sur le montant de la soulte demandée à France Télécom, mais que celle-ci devrait prendre en considération le transfert de cet établissement vers l'État des charges de pension de son personnel.
Ayant souscrit aux observations de M. Yann Gaillard, il a rappelé que la réforme de l'État actuellement en préparation supposait la mise en place d'indicateurs de gestion dans les administrations publiques.
Ayant répondu à M. Joël Bourdin que la réduction de la dépense publique ne devrait pas avoir d'effets récessifs, il a manifesté son accord avec les observations de M. Jean Cluzel, vice-président, lui indiquant que le Gouvernement prendrait des décisions dans le secteur de l'audiovisuel public après avoir reçu les conclusions de l'audit actuellement en cours.
M. Jean Cluzel s'est alors déclaré convaincu que le Gouvernement aurait certainement à coeur de fonder ses décisions en ce domaine sur la base des conclusions de la commission des Finances du Sénat autant que sur celles d'une commission administrative.
II - Audition des principaux instituts de prévision économique, le mardi 14 mai 1996, sous la présidence de M. Christian Poncelet, président.
M. Alain Chappert, chef du département de la conjoncture à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), a rappelé que le ralentissement économique en 1995 avait surpris par son ampleur ce qui confirmait la tendance à une plus forte réactivité de l'économie française que par le passé. Il a expliqué que, dans un contexte d'atonie générale de la croissance, la France avait pâti de facteurs spécifiques :
• le ralentissement de la consommation sous l'effet
de l'inflexion de la création d'emplois et des incertitudes sur les
politiques de redressement des comptes publics ;
• les mouvements sociaux de fin d'année.
Il a estimé, que le début de l'année 1996 délivrait des messages contrastés avec une bonne tenue du côté de la demande mais une offre encore très hésitante :
• la consommation a connu une forte progression au
premier trimestre -+ 5 % -même si elle s'est infléchie au
mois de mars- - 1,2 %- et dégage ainsi un acquis de croissance de
3 % pour l'année 1996 malgré une stabilisation du pouvoir
d'achat des ménages et grâce, sans doute, à la baisse des
taux d'intérêt et aux mesures fiscales concernant
l'épargne ;
• le taux de croissance de l'investissement se
maintient sur une tendance haussière ;
• cependant, la production, malgré une
amélioration des anticipations des entreprises, demeure atone comme
l'attestent l'activité dans le bâtiment et le recul de l'indice de
la production industrielle au mois de février qui traduit un
phénomène persistant de résorption des stocks.
Conséquence de ces évolutions, les perspectives en matière d'emplois sont donc maussades pour l'année en cours.
Il a estimé qu'au total, un certain optimisme justifié quant à l'évolution de l'économie française ne devait pas dissimuler la dégradation du contexte en Europe que pourraient toutefois contrecarrer le dynamisme des économies extra-européennes et un environnement financier nettement plus stimulant que l'an dernier.
M. Jean-Philippe Cotis, sous-directeur pour les synthèses macroéconomiques et financières à la Direction de la Prévision, a alors présenté la synthèse comparative des prévisions du Gouvernement et des instituts de prévision pour 1997.
Il a d'abord rappelé la convergence entre les prévisions économiques, tout en reconnaissant qu'un écart subsistait en matière de finances publiques.
Pour expliquer que le ralentissement de 1995 avait été plus accusé que prévu, il a fait valoir que, malgré de bons fondamentaux et une croissance dynamique de la masse salariale, les prévisions en France et en Allemagne avaient été déjouées pour des raisons proches :
• le durcissement des conditions monétaires
qui, via l'appréciation du mark, avait surtout affecté
l'Allemagne ;
• une dégradation rapide du climat de
confiance des ménages induite en Allemagne, par la survenance d'une
reprise pauvre en emplois et, en France, par les incertitudes relatives au
redressement des finances publiques.
Il a alors jugé que le scénario de croissance pour 1996 n'avait guère été révisé, l'écart entre les prévisions initiales et celles désormais connues expliquant par le ralentissement de 1995.
S'agissant des perspectives pour 1997, il a indiqué que :
• l'environnement deviendrait plus favorable du point
de vue monétaire et de l'activité économique à
l'étranger ;
• la demande des entreprises s'accroîtrait,
comme le corroborent les enquêtes relatives à l'investissement
industriel, pour rattraper un retard accumulé en ce domaine entre 1990
et 1994 de l'ordre de 40 % ;
• la demande des ménages progresserait
modérément, l'inflexion de l'augmentation du pouvoir d'achat du
salaire par tête étant compensée par celle du taux
d'épargne des ménages ;
• le nombre des emplois serait stable en 1996 mais
s'accroîtrait de 200.000 unités en 1997.
M. Patrick Artus, directeur du service des études économiques de la Caisse des dépôts et consignations a souligné qu'une source majeure d'incertitude provenait de la situation de l'économie allemande et de l'ambiguïté des effets de la croissance américaine, positive en termes de demande adressée à notre pays, mais lourde de risques pour les évolutions monétaires et financières.
Il a ajouté que l'effet de la réduction des taux d'intérêt sur l'épargne et la substitution à une hausse de l'épargne publique d'une baisse de l'épargne privée étaient encore incertains.
Il a indiqué que, de ce point de vue, le premier trimestre de l'année ne laissait pas apparaître de phénomène net de dégonflement de l'épargne.
M. Jean-Paul Betbèze, responsable du service des études du Crédit Lyonnais a alors fait les observations suivantes :
• le contexte politique aux États-Unis
pourrait se traduire par une hausse des taux d'intérêt dans ce
pays qui devrait elle-même entraîner une appréciation du
dollar ;
• l'évolution des crédits et des
dépôts continue d'enregistrer les effets d'un comportement
financier prudent des entreprises ;
• la baisse des taux à court terme a bien
"mordu" sur les conditions de financement de l'économie ;
• des marges existent encore pour infléchir
les taux en France.
M. Michel Didier, président de Rexecode, a rappelé que son institut avait manifesté un grand scepticisme quant aux perspectives de croissance en 1996 et que cette prudence avait été justifiée par les faits.
Puis, il a jugé que le contexte général était celui d'une reprise économique lente et bridée.
Il a fait observer que, le solde financier des entreprises avait évolue de façon beaucoup moins favorable que prévu et que la capacité de financement des entreprises -40 milliards de francs- devait être comparée avec les 4.500 milliards de francs d'endettement financier supportés par celles-ci.
Estimant que la situation avait cessé de se dégrader il a considéré qu'il était prématuré de conclure à une reprise de l'activité économique.
M. Jean-Paul Fitoussi, président de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), a considéré que le consensus des prévisionnistes traduisait l'absence de raisons d'espérer, la reprise économique s'annonçant molle. Il a jugé qu'il n'y avait pas de trésor caché de la croissance et que l'histoire ne révélait pas d'expérience de rebond économique sans hausse des salaires. Évoquant l'environnement international de l'économie française, il a souligné les effets ambigus de la conjoncture allemande dont le ralentissement, dommageable à l'essor de la demande adressée à la France, pourrait offrir des perspectives de détente financière.
Rappelant que la croissance française du début des années 1990 avait été la plus faible enregistrée par notre pays depuis les années trente, il s'est inquiété de ce que la baisse des taux d'intérêt, tardivement enclenchée, s'accompagnait d'un rationnement du crédit aux petites et moyennes entreprises. Il a en outre estimé que les prévisions économiques n'intégraient sans doute pas entièrement l'ensemble des effets du surcroît probable de restrictivité budgétaire.
M. Philippe Sigogne, responsable du département de la conjoncture à l'Observatoire français des conjonctures économiques a jugé qu'il existait actuellement une vraie question allemande, stratégique du point de vue des perspectives en matière de monnaie unique, liée au niveau de la parité du mark nettement surévaluée.
M. Christian de Perthuis, directeur du département des prévisions et analyses macro-économiques au bureau d'information et de prévision économiques (BIPE), a tout d'abord souligné le risque représenté par la combinaison d'une baisse de l'activité en Allemagne, principal marché à l'exportation de la France, et d'une forte reprise de l'activité économique aux États-Unis, engendrant une hausse des taux d'intérêt. Toutefois, les prévisions du BIPE écartent ce risque et incorporent un simple sursaut de l'activité économique aux États-Unis s'achevant en ralentissement en fin d'année.
Il a ensuite expliqué les mécanismes par lesquels le deustchemark de monnaie forte, était devenue aujourd'hui une monnaie surévaluée. L'existence de très importants différentiels d'inflation entre les pays européens au début des années 1980, l'Allemagne jouissant elle-même d'un taux modéré de hausse des prix, permettait, en effet de pallier les conséquences d'une réévaluation de la monnaie allemande. Or, ce levier a progressivement disparu sous la pression de l'ouverture des marchés financiers et de la mise en concurrence des économies.
S'agissant des perspectives en matière de comportement des ménages et d'évolution des taux d'épargne, M. Christian de Perthuis a fait part d'analyses qui n'indiquent pas une reprise, dans l'immédiat, du crédit à la consommation. Il a cependant nuancé ces propos en précisant que plusieurs indices auguraient d'un rebond assez important dans le secteur de la construction de logements en 1997.
Concluant son intervention, il a souhaité rappeler que l'existence d'une capacité d'investissement des entreprises n'impliquait pas la concrétisation d'une décision d'investissement. En outre, a-t-il souligné, lorsque la décision d'investir est prise, les grands groupes industriels français ont tendance, à l'heure actuelle, à privilégier le développement à l'étranger plutôt que sur le territoire national.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a alors interrogé les intervenants. Il leur a demandé :
• si l'inflexion du taux d'épargne des
ménages était une hypothèse robuste et quelles seraient
les conséquences économiques si elle ne se produisait pas,
• quels seraient les effets pour la France d'une
croissance nulle en Allemagne,
• si la réduction des taux
d'intérêt à court terme avait été
suffisamment répercutée dans les conditions de financement
offertes aux agents économiques,
• et quelles explications l'on pouvait donner au
phénomène d'enrichissement de la croissance en emplois.
M. Patrick Artus, directeur du service des études économiques de la Caisse des dépôts et consignations, a considéré que l'enrichissement de la croissance en emplois pouvait être directement relié à la baisse du coût du travail peu qualifié acquise moyennant des dispositifs sans doute perfectibles du fait des effets de seuil provoqués par eux et que ce phénomène concernait pour l'essentiel le secteur des services.
M. Michel Didier, président de Rexecode, a jugé que la réorganisation de la politique de l'emploi devrait dans un premier temps s'attacher à simplifier les régimes d'aides. Il a rappelé que la croissance du nombre d'emplois en 1995 avait été due pour moitié à l'emploi non marchand et pour un quart à la progression des emplois aidés ce qui n'était pas une performance satisfaisante en particulier du fait de son coût pour les finances publiques.
M. Jean-Paul Betbèze, responsable du service des études du Crédit Lyonnais, a estimé que la répercussion de la baisse des taux par le système financier avait été réalisée dans toute la mesure compatible avec la réglementation des pratiques de vente à perte. À ce sujet, il a rappelé les problèmes posés aux banques françaises par les modes de tarification bancaire et que leur rentabilité moyenne était tout juste égale au quart de la rentabilité normale dans le secteur.
M. Jean-Philippe Cotis, sous-directeur à la Direction de la Prévision, a souligné que, si une croissance nulle en Allemagne aurait des effets mécaniques sensibles sur l'activité en France, elle s'accompagnerait d'évolutions des taux d'intérêt et de change qui pourraient les compenser. Jugeant que le coût du travail peu qualifié était en France très supérieur à la moyenne européenne, il a estimé que la baisse des charges sociales ne faisait que corriger cet excès si bien qu'on ne pouvait en toute rigueur la qualifier d'aide à l'emploi.
M. Alain Chappert, chef du département de la conjoncture à l'INSEE, a rappelé que le phénomène d'enrichissement de la croissance en emplois était récent et qu'il fallait en affiner l'analyse pour en apprécier la signification. Il a précisé que la révision à la baisse des capacités de financement des entreprises provenait non d'une révision à la baisse de leur épargne, mais d'une correction à la hausse de leurs investissements et du niveau de leurs stocks.
M. Patrick Artus, directeur du service des études économiques de la Caisse des dépôts et consignations, a souligné que la variation des taux d'épargne des ménages répondait de leur part davantage à un comportement d'emprunteur qu'à un comportement de créancier.
Un large débat s'est alors instauré.
M. René Ballayer a souhaité savoir si les difficultés rencontrées par l'économie allemande étaient de nature à remettre en cause les perspectives d'unification monétaire en Europe et quel était le sentiment des intervenants sur les effets économiques de cette unification.
M. Jean-Paul Fitoussi, président de l'OFCE, a considéré que l'aversion des allemands pour la dépréciation de leur monnaie pouvait être considérée comme une sérieuse garantie pour le processus d'unification monétaire. Il a estimé par ailleurs que le sens commun commandait d'imaginer que les décisions en la matière seraient prises sur la base d'une appréciation politique.
M. Jean-Paul Betbèze, responsable du service des études du Crédit Lyonnais, a considéré que les marchés financiers avaient d'ores et déjà intégré cette dernière donnée.
M. Michel Didier, président de Rexecode, a souligné l'ambiguïté du concept de convergence rappelant qu'au-delà des performances de chacun au regard des critères du traité d'union monétaire, il fallait considérer le chemin parcouru sur la voie d'un rapprochement économique entre les différents pays et que de ce point de vue beaucoup avait été fait.
M. Jean-Philippe Cotis, sous-directeur à la Direction de la prévision, a indiqué que le système de change que nous connaissons, intermédiaire entre un système de monnaie unique et un système de changes flexibles, avait démontré ses limites.
M. Christian de Perthuis, directeur au BIPE, a estimé que les réflexions devraient désormais porter par priorité sur les actions budgétaires à promouvoir en régime de monnaie unique.
M. Patrick Artus, directeur du service des études économiques de la Caisse des dépôts et consignations, a considéré qu'on pouvait attendre de la création d'une monnaie unique la mise en oeuvre d'une politique monétaire relativement accommodante mais que subsisteraient les problèmes posés par la coordination des autres politiques économiques que sont les politiques sociale et salariale. Il a insisté sur l'importance de définir des parités d'entrée en monnaie unique adaptées sans quoi les effets sur les appareils industriels pourraient être très défavorables.
M. Roland du Luart a relevé le pessimisme des intervenants et s'est demandé si celui-ci ne serait pas accru si chacun d'entre eux tirait toutes les conséquences du nécessaire assainissement des finances publiques.
M. Jean-Philippe Cotis, sous-directeur à la Direction de la prévision, a voulu tempérer l'impression pessimiste donnée par les prévisions économiques en soulignant qu'elles étaient compatibles avec une croissance en glissement proche de 2,5 % en 1996.
M. Michel Didier, président de Rexecode, a rappelé que les pays développés étaient confrontés à un problème collectif, l'écart entre leur croissance effective et leur croissance potentielle, et a indiqué que si ce nouveau régime de croissance devait persister cela renforcerait la nécessite d'un aménagement des finances publiques dans ces pays.
M. Jean-Philippe Cotis, sous-directeur à la Direction de la prévision, a alors souligné qu'il existait deux façons de considérer les effets d'une réduction du déficit public :
- l'une, keynésienne, associant la baisse des déficits à un repli de l'activité, au terme de laquelle certains modèles parviennent à la conclusion qu'une baisse du déficit égale à deux points du produit intérieur brut amène une inflexion de l'activité de 0,75 point de cette même grandeur ;
- l'autre qui démontre que l'augmentation du déficit public entre 1990 et 1994 s'est traduite par un relèvement du taux d'épargne privée et amène à poser la question des incidences d'un défaut d'assainissement des comptes publics sur les taux d'intérêt.
M. Joël Bourdin a considéré que nos problèmes économiques avaient une composante monétaire importante et s'est demandé s'il n'y avait pas une alternative conduisant à un dosage plus équilibré des politiques monétaire et budgétaire.
M. Jean-Paul Fitoussi, président de l'OFCE, a jugé que la réduction des déficits publics était justifiée mais que la question était, en effet, celle de savoir comment y parvenir aux moindres coûts pour l'économie.
M. Alain Richard a souligné le fait qu'il y avait été frappé, lors de la dernière audition par la commission des instituts de conjoncture, par le consensus qui s'était dégagé sur le constat d'une dégradation de la compétitivité extrême de l'économie française.
M. Alain Chappert, chef de département à l'INSEE, a confirmé l'existence de ce problème de compétitivité qui s'est traduit par des pertes de marché à l'exportation. Il a ajouté que, curieusement, cette évolution n'avait pas été clairement perçue par les entreprises concernées.
M. Patrick Artus, directeur du service des études économiques de la Caisse des dépôts et consignations, a insisté sur la rupture fondamentale que représente la persistance de taux d'intérêt réels supérieurs au rythme de la croissance.
En second lieu, il a fait observer qu'en certaines circonstances la réduction du déficit budgétaire était un accélérateur de croissance : le rétablissement des finances publiques est obtenu par une réduction de la dépense, sans majoration des recettes, et la confiance manifestée par le contribuable permet d'éviter la constitution d'une épargne de précaution. La France doit respecter ce schéma si elle ne veut pas subir une violente récession en 1997.
Il a ajouté qu'il fallait distinguer les déficits cycliques et les déficits structurels. Réduire les premiers, qui ne constituent pas un frein à la croissance, serait une erreur. Fin revanche, les seconds, doivent être combattus.
M. Christian Poncelet, président, rappelant que certains préconisaient une hausse des salaires pour relancer l'économie mais que l'explication apportée à la situation délicate de l'économie allemande résidait précisément dans l'excès de croissance des salaires en Allemagne, a demandé aux intervenants leur sentiment sur ce paradoxe.
M. Jean-Philippe Cotis, sous-directeur à la Direction de la prévision, a estimé qu'il était difficile de fixer une allure donnée à l'évolution des salaires dans un pays. Puis, il a rappelé que, si sur moyenne période, la masse salariale avait augmenté dans des proportions identiques aux États-Unis, en Allemagne et en France, la répartition de cette croissance avait été très différente selon les pays. Consacrée à la création de nouveaux emplois aux États-Unis, elle avait débouché en Allemagne sur un partage par moitié entre le salaire individuel et de nouveaux emplois et, en France, essentiellement sur une augmentation du salaire par tête qui avait dû ensuite être largement amputée par des prélèvements nouveaux.
M. Jean-Paul Fitoussi, président de l'OFCE, a tout d'abord souhaité indiquer que les exemples étrangers d'ajustement des finances publiques réussis -l'Irlande, la Suède et le Danemark- n'étaient pas entièrement convaincants, car ils s'étaient souvent accompagnés de dévaluations et ils concernaient des économies largement ouvertes sur l'extérieur pour lesquelles le raisonnement sur les effets économiques d'une réduction des déficits doit être particulier.
Rappelant que l'assouplissement de la politique monétaire n'avait, jusqu'à présent, pas apporté d'effets réellement significatifs et que la politique budgétaire avait une orientation restrictive, il a considéré qu'additionner à cela une politique salariale rigoureuse ne pouvait conduire qu'à un défaut de perspective de croissance. Il a estimé qu'il faudrait desserrer les politiques monétaire et salariale.
M. Christian de Perthuis, directeur au BIPE, a jugé qu'il existait un dilemme entre l'augmentation des salaires et la diminution indispensable des coûts salariaux. Il a considéré que la politique salariale devait rester le choix des entreprises mais que l'évolution du pouvoir d'achat des ménages résultant, elle, d'une série d'enchaînements faisant jouer les phénomènes de redistribution, c'était sur cet aspect qu'il fallait agir.
Enfin, il a souligné que l'analyse selon laquelle il faudrait distinguer déficit public structurel et déficit public conjoncturel devait être complétée par la considération selon laquelle tout déficit conjoncturel devenait, compte tenu de l'état des finances publiques, un déficit structurel.
M. Alain Lambert, rapporteur général, s'est alors demandé si la gestion des finances publiques ne butait pas, en France, non seulement sur des réalités conjoncturelles mais aussi sur de rigidités structurelles particulières à notre pays. Il s'est par ailleurs interrogé sur la pertinence de l'effet d'éviction, évoqué ces derniers temps, opéré par l'emploi public au détriment de l'emploi privé et sur les opportunités offertes par une gestion active de la dette publique.
M. Jean-Philippe Cotis, sous-directeur à la Direction de la prévision, a estimé que la technique budgétaire traditionnellement pratiquée par la France n'avait guère été adaptée au caractère de plus en plus cyclique de l'activité économique, comme le démontrait l'expérience des années 1988 à 1990 où les suppléments de recettes provenant de la croissance avaient servi à financer des dépenses publiques sans considération du déficit.
M. Jean-Paul Betbèze, responsable du service des études du Crédit Lyonnais, estimant que notre pays se caractérisait en général par un défaut de stratégie, ce que démontraient assez les conditions dans lesquelles était préparée son entrée dans la monnaie unique, a vivement souhaité l'instauration d'une gestion plus active de la dette publique qui passerait, en particulier, par un raccourcissement du terme des émissions.
M. Michel Didier, président de Rexecode, a considéré que le financement de l'emploi public faisait peser un poids très lourd sur le secteur privé et, en particulier, sur le secteur industriel confronté à une intense concurrence mondiale.
Il a ajouté que, pour réduire les dépenses publiques, il fallait orienter les décisions à partir de l'évaluation des effets économiques de chacune d'entre elles, mais qu'il fallait également renforcer la réflexion autour des effets d'allocation économique des finances publiques qu'avait eu trop souvent tendance à occulter l'analyse de leurs effets de stabilisation.
Il a estimé que la question primordiale était d'apprécier la productivité comparée de la dépense selon les secteurs où elle intervient.
M. Jean-Paul Fitoussi, président de l'OFCE, a jugé qu'en période de déficit d'emplois le problème à résoudre était celui de l'augmentation du volume d'emplois et que la suppression des emplois publics n'était pas a priori une garantie de réussite.
Il a souscrit à l'analyse selon laquelle la dépense publique devait être jugée à l'aune de sa capacité à dégager de fortes externalités pour l'économie et qu'il serait par conséquent peu avisé de pratiquer une réduction homogène des dépenses de chaque administration.
Il a cependant considéré que la ligne de partage ne pouvait passer en la matière entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'infrastructure. Il a, en particulier, rappelé que si ces dernières se traduisaient immédiatement par un gonflement du chiffre d'affaires des entreprises, leurs effets économiques n'étaient pas nécessairement supérieurs à terme aux effets de certaines dépenses de fonctionnement, citant l'exemple des dépenses de formation.
M. Christian Poncelet, président, s'est alors interrogé sur les mesures à mettre en oeuvre dans l'hypothèse où tous les pays de l'Union européenne n'adopteraient pas la future monnaie unique.
M. Patrick Artus, directeur du service des études économiques de la Caisse des dépôts et consignations, a répondu en distinguant le cas des pays manifestant la volonté d'entrer en monnaie unique de celui des pays réticents à cette perspective.
Il a considéré que pour les premiers une solution serait de confier leur politique monétaire à la Banque Centrale Européenne dans la période intermédiaire et que, pour les autres, des pénalités devraient leur être appliquées si leur comportement monétaire perturbait le fonctionnement du marché unique.
III - Examen du rapport d'information de M. Alain Lambert, rapporteur général, en vue du débat d'orientation budgétaire pour 1997, le mercredi 15 mai 1996, sous la présidence de M. Christian Poncelet, président
À titre liminaire, M. Alain Lambert, rapporteur général, a rappelé que le Gouvernement avait déjà accepté de tenir un débat d'orientation au Parlement au printemps 1990, mais que la discussion avait davantage porté sur l'analyse de la situation et de la politique économiques que sur les orientations budgétaires elles-mêmes. Il a estimé que l'exercice aujourd'hui proposé était différent. Le Gouvernement demande cette fois en effet au Parlement d'apporter son soutien à la réduction programmée des déficits publics et esquisse le volume et les orientations des économies budgétaires pour 1997.
Le rapporteur général a exprimé le souhait que le Sénat soit au rendez-vous pour valider des hypothèses -si celles-ci lui paraissent prudentes- mais aussi pour poser au Gouvernement les questions indispensables à la bonne compréhension des enjeux.
Présentant les hypothèses de croissance retenues par le Gouvernement, il a indiqué qu'un regard rétrospectif sur l'exercice 1995 révélait un essoufflement de la croissance, la consommation des ménages n'ayant pas tenu ses promesses et les flux d'investissement restant largement en-deçà des prévisions. Pour 1996, la prévision du Gouvernement est désormais arrêtée à + 1,3 %, compte tenu d'une accélération attendue de l'investissement et d'une bonne tenue de la consommation et des exportations. En 1997, la croissance s'accélérerait et atteindrait + 2,8 %, en raison d'une nouvelle amplification de l'investissement, d'un comportement de restockage des entreprises et d'une légère augmentation de la consommation des ménages.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a souhaité toutefois nuancer ces perspectives en soulignant les incertitudes du scénario envisagé par le Gouvernement. En premier lieu, la croissance allemande devrait être particulièrement faible en 1996. Ensuite, le Gouvernement retient un objectif de déficits ramenés à 3 % du produit intérieur brut, alors que le consensus des prévisionnistes estime le niveau des déficits à 3,8 %. Enfin, rien ne peut garantir que les ménages puiseront dans leur épargne afin de pouvoir consommer davantage et que les entreprises chercheront à combler leur retard en matière d'investissements. Le rapporteur général a en conséquence privilégié l'hypothèse d'une croissance encore très modérée l'année prochaine.
Après l'analyse de la conjoncture, il a présenté les hypothèses relatives à l'équilibre du budget pour 1997, en rappelant, tout d'abord que la réduction des déficits correspondait évidemment aux obligations nées du Traité de Maastricht, mais répondait également à un impératif de souveraineté nationale. De ce point de vue, la réduction des déficits publics à 3 % du PIB l'année prochaine doit devenir une donnée et non plus une simple hypothèse.
Le rapporteur général a ensuite indiqué que s'agissant des recettes, le Gouvernement retenait pour 1997 un montant de 1.300 milliards de francs, soit une progression modérée par rapport à 1996. En effet, des moins-values sont attendues sur l'exercice en cours par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale : 27 milliards de francs pour la taxe à la valeur ajoutée, et environ 2 milliards de francs pour l'impôt sur le revenu. Les prévisions sont plus optimistes en matière d'impôt sur les sociétés, du fait des mesures fiscales récentes, du redressement de la demande, et de l'arrivée à son terme du phénomène de provisionnement observé dans les grandes entreprises. Enfin, les ressources non fiscales qui se sont élevées à 163,7 milliards de francs en 1995, en sollicitant notamment un prélèvement de 15 milliards de francs sur la caisse des dépôts et de 18,5 milliards de francs sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne, ne pourront sans doute pas être renouvelées au même niveau en 1996 ni en 1997.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a estimé qu'en conséquence le niveau de 1.300 milliards de francs retenu par le Gouvernement lui paraissait être le bon ordre de grandeur. Il a ensuite relevé que l'obligation de ramener le déficit du budget de l'État, en 1997, à 3 % du produit intérieur brut amenait le Gouvernement à étudier l'hypothèse d'un maintien en francs courants des dépenses budgétaires, soit 1.552 milliards de francs. Il a ajoute que l'évolution spontanée des principaux postes de dépenses étant de l'ordre de 60 milliards de francs, l'effort d'économies pouvait être évalué au même montant.
Puis, le rapporteur général a rappelé que le Gouvernement appelait l'attention du Parlement sur trois postes de dépenses. Tout d'abord les charges de personnel qui atteignent 566,7 milliards de francs et ont été alourdies par la création de 72.300 emplois au cours des huit dernières années. Ensuite, les aides à l'emploi qui s'élèvent à 138 milliards de francs en 1996. Enfin, les aides au logement fixées cette année à 52,6 milliards de francs.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a estimé que cette approche devait être complétée par une double démarche : une analyse des dépenses et une recherche de méthodes permettant de réaliser des économies.
Sur le premier point, il a rappelé les six catégories de dépenses classées par ordre de flexibilité croissante, dans un tableau inséré dans le rapport de la commission sur le projet de loi de finances initiale pour 1996. Premièrement, les dépenses "imposées", qui ont un caractère de dettes, et sur lesquelles l'action de l'État ne peut être a priori que marginale, sans être nulle, Deuxièmement, les dépenses liées au fonctionnement des structures, difficiles à manier sauf à bloquer l'activité d'une administration ou d'un établissement public, voire à en supprimer l'existence. Troisièmement, les dépenses contractuelles regroupant les dotations déterminées dans le cadre des accords liant l'État à un tiers. Quatrièmement, les dépenses dites "à guichet ouvert" que sont les prestations dont l'accès est subordonné à des conditions objectives fixées par voie législative et réglementaire, tels le revenu minimum d'insertion ou les exonérations de charges sur les bas salaires. Cinquièmement, les dépenses "conditionnelles", subordonnées à un examen en opportunité par "administration, telles les actions financées par le fonds national de l'emploi dans le cadre des plans sociaux des entreprises. Enfin, sixièmement, les dépenses "flexibles" sur lesquelles l'État est censé pouvoir agir librement, comme l'aide au développement ou les subventions aux associations sportives et culturelles.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a alors indiqué que devait être appliquée à cette classification une "grille" d'économies potentielles, ce qui suppose que le Gouvernement ait résolu deux questions préalables : le pourcentage maximal d'économies qu'il est possible de faire supporter à chaque dotation ou catégorie de dotation et la méthode permettant d'y parvenir. Il a estimé que seule cette analyse systématique permettrait au Parlement de disposer d'une vue d'ensemble, préalable à l'exercice des choix d'économies à réaliser.
En conclusion de son propos, le rapporteur général a proposé trois voies d'amélioration des méthodes d'examen du budget. Il a tout d'abord jugé souhaitable l'instauration d'un nouveau mode de régulation et proposé l'inscription d'une dotation pour charges imprévues par ministère qui serait actée par le Parlement et éviterait la traditionnelle opération de régulation budgétaire forfaitaire. Il a ensuite demandé une présentation pluriannuelle du budget permettant au Parlement de mieux évaluer les conséquences des choix arrêtés. Il a enfin estimé indispensable que le Parlement dispose de critères simples d'évaluation préalablement à l'examen des grandes dotations budgétaires.
Le rapporteur général a, pour finir, déclaré qu'il attendait les remarques et- les suggestions des commissaires afin de fixer les orientations définitives de son rapport.
M. Philippe Marini a estimé que la validation des orientations proposées par le Gouvernement dans son rapport constituait un exercice de confirmation, l'obligation de réduire les déficits publics apparaissant de façon régulière dans les différentes lois de finances et ayant été sanctionnée par une loi quinquennale.
Il a ainsi jugé que la seule véritable question était de savoir s'il existait un consensus sur la nécessité impérieuse de recouvrer notre souveraineté par la réduction du besoin public de financement.
Il a considéré qu'à défaut d'alternative, le Gouvernement devrait imposer une réduction pérenne de la dépense sans renoncer à agir sur les charges que le rapporteur général a placées dans son tableau parmi les moins flexibles, à savoir les dépenses "imposées" et les dépenses "de structure". Il a estimé que le Gouvernement ne devrait pas hésiter, le cas échéant, à réduire le format de certaines structures publiques, établissements publics, directions centrales et services déconcentrés de l'État. Enfin, en matière de rémunérations, M. Philippe Marini a estimé qu'il convenait de s'astreindre à une politique de réduction quantitative de la fonction publique par le non remplacement des départs à la retraite et le recours à des intervenants externes pour la réalisation de certaines tâches.
M. Christian Poncelet, président, a alors fait observer que la décentralisation, qui aurait dû être neutre en termes de progression du nombre des fonctionnaires, s'était en réalité traduite, notamment dans le secteur de l'action sociale, par la création de services départementaux continuant d'être doublés par les services déconcentrés de l'État.
M. Jean-Philippe Lachenaud a indiqué qu'il retirait de l'audition des instituts de prévision de la conjoncture, tenue la veille par la commission, le sentiment d'une absence de consensus et de l'existence de nombreuses incertitudes sur les hypothèses macro-économiques du Gouvernement. Il a jugé celles-ci un peu trop optimistes et souhaité que la commission exprime une certaine prudence à leur encontre.
L'intervenant a ensuite estimé qu'il était impossible de chercher dans le même temps à réduire le déficit budgétaire et à procéder à une baisse significative des impôts.
Revenant sur les prévisions élaborées par les instituts, il a fait observer leur grand scepticisme vis-à-vis de la capacité de la France à mener une politique budgétaire suffisamment restrictive.
Il a ensuite souligné l'erreur de méthode du Gouvernement qui insiste sur la nécessité d'une réduction drastique du déficit budgétaire, dès 1997, alors que la plupart des mesures qu'il préconise ne commenceront à porter réellement leurs fruits qu'au-delà du prochain exercice. Il a jugé plus réaliste de prévoir une programmation sur trois ans des ajustements à réaliser pour chacun des trois grands secteurs mis en exergue dans le rapport Gouvernemental : la fonction publique, le logement et les aides à l'emploi.
M. Henri Collard a estimé que la réduction des déficits publics ne s'imposait pas uniquement à l'État mais également aux régimes sociaux ainsi qu'aux entreprises du secteur public, comme Air France et la SNCF.
Il a ensuite fait observer que rien dans le rapport déposé par le Gouvernement pour le débat d'orientation budgétaire n'apportait la garantie que les collectivités locales ne participeront pas l'an prochain à la réduction du déficit de l'État par le biais de transferts de charges non compensées. De ce point de vue, l'affirmation par M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, devant la commission, que les termes du pacte de stabilité seraient respectés ne lui a pas semblé constituer une protection suffisante.
Rappelant enfin la mission effectuée par plusieurs membres de la commission auprès du Congrès des États-Unis, en janvier 1995, il a fait observer que, dans ce pays, le budget fédéral faisait l'objet d'une programmation pluriannuelle et il a suggéré que la France s'inspire du modèle américain en prévoyant que les orientations budgétaires seront dorénavant fixées au début de chaque législature.
M. Christian Poncelet, président, est alors intervenu pour souligner le caractère aléatoire de la dépense publique qui relativise la portée de toute programmation pluriannuelle.
M. Joël Bourdin a relevé l'importance des mécanismes monétaires dans les prévisions élaborées par les instituts de conjoncture. Il a estimé que l'appréciation du franc par rapport au deutsche mark, conséquence de la mauvaise situation économique qui prévaut en Allemagne, risquait de créer un "Corset déflationniste" similaire à celui subi par notre pays dans les années 1930. Il a ainsi jugé regrettable le fait que l'indépendance accordée à la Banque de France conduise aujourd'hui le Gouvernement à refuser toute allusion aux problèmes monétaires, pour centrer son discours sur le seul budget de l'État, alors qu'il existe pourtant des alternatives à la situation actuelle.
Il a ensuite approuvé l'objectif de réduction des déficits publics, relevant le mauvais exemple donné par l'État aux ménages et aux collectivités locales lorsqu'il assure ses charges de fonctionnement par une augmentation de la dette. Il a toutefois plaidé pour une approche prudente de la réalisation de cet objectif, faisant observer qu'une contraction trop forte des dépenses publiques pouvait avoir un effet récessif sur les recettes.
M. Maurice Blin a souligné le fait que la part dans le produit intérieur brut des prélèvements obligatoires revenant à l'État était passée de 39,2 % en 1993 à 34,7 % en 1995. Cette contraction n'a en fait été rendue possible que par la chute de l'investissement financé par l'État et le transfert de sa charge sur les collectivités locales.
Il a ensuite jugé qu'au-delà de la réduction du nombre des fonctionnaires une réflexion qualitative sur la fonction publique s'imposait. En effet, à côté d'administrations caractérisées par un sureffectif, les structures en contact avec le public souffrent souvent d'une insuffisance de personnels.
Il a estimé que cette analyse qualitative pouvait être étendue aux dépenses de l'État : alors que les fonctions régaliennes pâtissent d'une absence évidente de moyens, un interventionnisme économique inefficace s'est développé au point que les représentants du patronat remettent aujourd'hui en cause l'utilité des aides à l'emploi. M. Maurice Blin a, à ce sujet, exprime l'idée qu'une réduction de la taxe à la valeur ajoutée serait sans doute plus efficace pour relancer la consommation que l'octroi de subventions publiques.
Il a enfin fait observer qu'en matière de contrats de plan, les retards pris par l'État dans le financement de sa quote-part bloquent la réalisation de projets au détriment d'une saine gestion de leurs finances par les collectivités locales.
M. Michel Mercier a tout d'abord souligné les qualités rédactionnelles et pédagogiques du rapport déposé par le Gouvernement en vue du débat d'orientation budgétaire. Il a toutefois estimé que si la distinction des dépenses relevant de la section de fonctionnement et de celles appartenant à la section d'investissement présentait un certain intérêt, il n'était pas possible de pousser trop loin la comparaison entre l'État et les collectivités locales.
Il a ensuite considéré que la réduction des déficits publics était la seule orientation possible, et que les questions en suspens portaient en fait sur les moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de cet objectif. Plaidant pour qu'un consensus national se réalise sur un retour à un déficit maîtrisé, il a dit toutefois se méfier des solutions trop brutales et a défendu le principe d'un étalement dans le temps des mesures à prendre.
Abordant précisément la question des moyens, M. Michel Mercier a tout d'abord fait observer qu'en matière de recettes, le budget de 1997 devrait être construit avec une amputation de 15 milliards de francs duc aux avantages fiscaux consentis dans le cadre des lois de finances votées depuis l'été 1995 et de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Il a affiché sa conviction qu'il était pratiquement impossible de réduire concomitamment le déficit public et les impôts.
S'agissant des coupes à opérer dans les dépenses elles-mêmes, il a souligné la faiblesse de la marge réelle dont dispose le Gouvernement. En matière de fonction publique, en effet, les allégements d'effectifs, pour souhaitables qu'ils sont, demanderont du temps pour être mis en oeuvre, et comme l'a signalé M. Maurice Blin, des emplois devront continuer d'être créés dans certaines structures. S'agissant ensuite de la renégociation de la dette publique, la baisse des taux courts permettra certes de réaliser quelques économies, mais il ne faut pas espérer que celles-ci porteront sur des montants significatifs dans l'optique de la réduction du déficit budgétaire. Enfin, il a rappelé que, selon le Gouvernement lui-même, 15.000 emplois avaient été supprimés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics au cours du premier trimestre 1996, ce qui impliquait d'aborder avec beaucoup de prudence la question de la réduction des aides au logement.
Envisageant l'hypothèse d'une situation économique qui permettrait une réduction des impôts, M. Michel Mercier a estimé que celle-ci devrait prendre la forme d'une diminution de la taxe sur la valeur ajoutée, combinée avec une réduction du coût du travail, et ciblée sur certains secteurs économiques, notamment la restauration et les services.
M. Michel Charasse a rappelé que le précédent débat d'orientation budgétaire, qui s'était déroulé alors qu'il était lui-même ministre du budget, avait suscité peu d'intérêt de la part des parlementaires.
Il a estimé que l'exercice proposé se situait à la limite des champs respectifs de compétences des pouvoirs exécutif et législatif, la préparation des projets de loi de finances incombant, dans un régime parlementaire, au Gouvernement exclusivement. À ce sujet, il a tenu à souligner les qualités de forme et de contenu du rapport déposé par le Gouvernement pour le débat d'orientation budgétaire, notant en particulier la volonté de transparence de ses auteurs.
Il a cependant regretté que le rapporteur général, dans son intervention, ne se soit pas interrogé plus avant sur la pertinence des données fournies par le Gouvernement pour la confection du budget de 1997.
M. Michel Charasse a, en effet, évalué l'effort d'économie à réaliser dans le cadre du prochain exercice entre 90 et 92 milliards de francs, au lieu du chiffre de 60 milliards de francs avancé par le ministère de l'économie et des finances. Il a expliqué qu'à la dérive automatique de 60 milliards de francs, il convenait d'ajouter 43 milliards de francs correspondant à la réduction du déficit budgétaire de 288 milliards de francs en 1996 à 245 milliards de francs en 1997. Par ailleurs, le Gouvernement n'aurait pas tenu compte dans ses évaluations de la majoration prévisible des prélèvements sur recettes au profit des communautés européennes et des collectivités locales, soit respectivement 6 milliards de francs supplémentaires et 3 milliards de francs.
En outre, le coût en année pleine des avantages fiscaux votés depuis l'été 1995, soit 15 milliards de francs, n'apparaîtrait pas non plus dans les chiffrages effectués par la direction du budget.
M. Michel Charasse a ainsi évalué l'effort d'économie à réaliser l'an prochain à 127 milliards de francs avant prise en compte des plus-values fiscales prévisibles. À ce sujet, il a contesté le chiffre de + 45 milliards de francs de plus-values avancé par le Gouvernement, estimant qu'il devait être amputé de 8 à 10 milliards de francs afin de tenir compte de la révision à la baisse des prévisions de croissance pour 1996 et de sa répercussion sur 1997 ainsi que des moins-values fiscales d'ores et déjà enregistrées sur l'année en cours et dont les conséquences se prolongeront sur le prochain exercice.
Au total, a-t-il calculé, l'effort d'économie à fournir en 1997 pour atteindre l'objectif de déficit de 3 % du PIB inscrit dans la loi quinquennale porte donc bien sur 90 à 92 milliards de francs et non sur 60 milliards de francs.
Reprenant ensuite une à une les pistes d'économies proposées par le Gouvernement, M. Michel Charasse a souligné le rendement relativement faible d'une action massive sur le secteur de la fonction publique. En effet, même en cumulant des mesures aussi lourdes que le non-remplacement de tous les départs à la retraite, le gel de la revalorisation du point d'indice ainsi que celui du "glissement -vieillesse-technicité" (GVT), le gain n'atteint que 25 milliards de francs, soit un montant sensiblement inférieur à celui des économies à réaliser l'an prochain.
M. Michel Charasse a ensuite approuvé la remarque de M. Maurice Blin faisant valoir le caractère contestable des aides à l'emploi dès lors que les choix d'embauché des employeurs sont déterminés davantage par les perspectives de production que par les allégements fiscaux qui leur sont offerts.
Il a souhaité que le rapporteur général procède à une analyse des conséquences, notamment sur les secteurs d'activité privés, des mesures éventuelles de réduction des dépenses d'investissement inscrites aux titres V et VI du budget général.
Le même intervenant s'est ensuite montré sceptique sur la possibilité de mener de front des politiques de réduction du déficit budgétaire et d'allégement des prélèvements obligatoires. Il a jugé qu'en effet un abaissement des impôts, à défaut de porter sur des masses significatives, n'aurait aucune portée.
M. Michel Charasse a cependant estimé, sur ce chapitre, qu'il convenait d'examiner l'ensemble des régimes d'exonérations fiscales et de supprimer ceux qui ne seraient pas justifiés. Enfin, a-t-il affirmé, à masse de ressources fiscales inchangée, une réflexion s'impose sur une meilleure répartition de l'effort entre les impôts sur la consommation, particulièrement sollicités, et les impôts directs, qui représentent une part traditionnellement faible des rentrées budgétaires.
Poursuivant son intervention, M. Michel Charasse a ensuite demandé au rapporteur général qu'il mentionne, dans le rapport de la commission, la question des déficits sociaux. Ceux-ci auraient dû, selon les projections du Gouvernement, s'établir à 17 milliards de francs en 1996 et être complètement résorbés en 1997. Or, il apparaît d'ores et déjà que le besoin de financement des régimes sociaux serait de l'ordre de 45 milliards de francs cette année, ce qui rend hypothétique l'objectif de suppression du déficit retenu pour le prochain exercice et, par voie de conséquence, la réduction à 3 % du produit intérieur brut de l'ensemble des besoins de financement publics.
Estimant que le Sénat devait exercer son rôle de chambre de réflexion, M. Michel Charasse a réclamé un débat d'orientation dépassionné, soulignant la part qu'il avait lui-même prise, en tant que ministre du budget, dans la dérive des charges publiques au début des années 1990, mais pointant également du doigt l'incapacité des Gouvernements, depuis le changement de majorité en 1993, à inverser la tendance à l'expansion de la dépense publique.
Il a ainsi rappelé que 8.100 emplois budgétaires nets avaient été créés en 1996 et que le déficit n'avait pu être contenu que grâce à des mesures fiscales devant procurer, selon ses estimations, un supplément de 200 milliards de francs d'impôts nouveaux en année pleine.
En conclusion de son intervention, M. Michel Charasse a estimé qu'il était difficile de reprocher aux fonctionnaires des avantages qu'ils ne doivent qu'à la faiblesse de l'État et des collectivités locales.
À ce sujet, il a indiqué qu'il comptait interroger le Gouvernement sur ses projets en matière de temps de travail dans la fonction publique, faisant observer que le simple respect des 39 heures permettrait de pallier les conséquences du non-remplacement des départs à la retraite, notamment dans la police.
Il a estimé enfin que l'objectif de réduction des déficits publics pouvait bénéficier d'un certain consensus, non pas seulement parce qu'il résulte du Traité de Maastricht, mais aussi parce qu'il est indispensable d'enrayer un accroissement de la charge de la dette qui ne profite qu'aux banques.
M. Christian Poncelet, président, a souligné le fait que la politique de "réhabilitation de la dépense publique" conduite par le Gouvernement de M. Michel Rocard, à la fin des années 1980, avait engendré le déficit budgétaire dont la résorption était aujourd'hui au coeur du débat d'orientation.
M. Guy Cabanel a qualifié d'illusoire le retour à l'équilibre des comptes sociaux inscrit dans les prévisions du Gouvernement. Il a rappelé qu'en effet le déficit affectant ces comptes atteindra de 40 à 50 milliards de francs cette année au lieu des 17 milliards de francs initialement annoncés, et il a fait observer que la caisse d'amortissement de la dette sociale rencontrait certaines difficultés à se financer sur le marché obligataire, ce qui interdit toute perspective de reprise par cette structure des charges nées du déficit enregistré en 1996.
Il a, en outre, exprimé la conviction que les ordonnances adoptées par le Gouvernement au mois d'avril ne permettront d'assainir la situation que de façon progressive et que, dans ces conditions, un retour à l'équilibre des comptes sociaux n'est envisageable qu'à l'horizon 1999.
M. Roland du Luart a estimé que s'il existait un consensus pour réduire les déficits publics, cet objectif n'étant pas seulement lié aux contraintes issues du Traité de Maastricht, il fallait, pour parvenir au résultat voulu, "frapper un grand coup" par une réduction massive des dépenses. À ce sujet, il a dit avoir été marqué par l'exemple de pays, comme le Canada, qui ont su redresser la barre alors que leurs finances publiques sombraient.
Il a cependant souhaité des actions ciblées épargnant certains secteurs. Au sein de la fonction publique, si l'on peut effectivement s'interroger sur le taux de remplacement des départs à la retraite pour un certain nombre de corps, il semble en revanche exclu de réduire le nombre des policiers ou des enseignants, ce qui n'interdit pas, comme l'avait souligné M. Michel Charasse, de veiller à imposer à ces catégories un régime effectif d'heures de travail conforme aux principes légaux en vigueur. Dans le même ordre d'idée, il paraît difficile de s'en prendre aux aides personnelles au logement.
M. Roland du Luart a, en sens inverse, souligné l'importance des fraudes dont se rendent coupables les organismes de formation professionnelle. Il a plaidé pour une recentralisation de cette compétence couplée avec une réflexion sur les aides à l'emploi.
Au chapitre des dépenses contractuelles, il a fustigé l'attitude de la SNCF qui, en dépit d'une situation financière catastrophique, propose des tarifs particuliers pour des voyages effectués par des couples, y compris du même sexe.
Enfin, M. Roland du Luart a souhaité obtenir confirmation du rapporteur général que les dépenses en capital au profit du fonds d'aide et de coopération s'élevaient bien à 2 milliards de francs, ainsi qu'il apparaît dans le tableau distribué dans le cadre de son intervention liminaire.
M. Christian Poncelet, président, a exprimé des doutes sur la capacité des Français à modifier leur comportement, faisant observer qu'il avait entendu dans la bouche des commissaires d'excellents diagnostics mais aucune proposition concrète.
Notant que la situation très difficile des finances publiques exigerait de taire les différences partisanes, il s'est interrogé sur l'existence d'un climat permettant l'émergence d'un consensus entre tous les Français.
Il s'est déclaré surpris de constater, à la lecture du rapport déposé par le Gouvernement pour le débat d'orientation budgétaire, que les économies des pays dont la monnaie a connu une importante dévaluation ces dernières années, Royaume-Uni et Italie notamment, n'avaient pas créé d'emplois dans le secteur privé, voire en avaient supprimé.
M. Christian Poncelet, président, a contesté le chiffrage avancé par M. Michel Charasse pour l'évaluation des économies à réaliser au titre de l'exercice 1997, faisant valoir que le Gouvernement tiendrait ferme sur le cap d'un déficit limité à 288 milliards de francs cette année et gagerait, par conséquent, toutes les dépenses imprévues et les moins-values de recettes par des annulations à due concurrence de crédits.
Reprenant la parole, M. Michel Charasse a maintenu l'exactitude de son analyse, faisant remarquer que même si le Gouvernement respectait son engagement de déficit pour 1996, la révision à la baisse des prévisions de croissance pour cette année contraignait à recaler la base servant au calcul du montant prévisible des recettes perçues l'an prochain.
Répondant aux différents intervenants, M. Alain Lambert, rapporteur général, a rappelé, en écho aux critiques de méthode que lui avait adressées M. Michel Charasse, qu'il avait d'abord souhaité entendre les remarques et les suggestions des commissaires avant de décider du contenu de son rapport.
Reprenant les propos de M. Philippe Marini, il a estimé que dès lors qu'il y aurait un consensus de toutes les forces politiques représentées au sein du Parlement, la Nation pourrait y adhérer et le pays aurait la force de s'appliquer le régime de rigueur qui s'impose.
Réagissant aux propos de M. Jean-Philippe Lachenaud, le rapporteur général a estimé que, même après avoir entendu les scénarios des instituts de prévision, les hypothèses économiques élaborées par le Gouvernement ne lui semblaient pas trop optimistes.
Il a, à son tour, jugé que le Gouvernement pouvait difficilement procéder simultanément à la réduction du déficit budgétaire et à un abaissement significatif des impôts.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a ensuite justifié la formule du débat d'orientation budgétaire tout en reconnaissant que, par la date à laquelle il intervient, il risquait de fragiliser le Gouvernement.
En réponse à M. Joël Bourdin, il a souligné l'importante baisse des taux à court terme constatée ces derniers mois, qui allège la composante monétaire des difficultés économiques traversées par notre pays. Il a ajouté que l'absence de maîtrise tant des autorités politiques que des banques centrales sur les évolutions des changes et des taux plaidait pour une mise en place rapide de la monnaie unique.
Il s'est enfin déclaré sensible à la remarque selon laquelle la réduction des dépenses publiques doit être précisément ciblée si le Gouvernement souhaite éviter qu'elle n'entraîne un effet récessif sur l'activité économique.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a ensuite répété que l'apparition d'un consensus autour de la réduction des déficits publics dépendait des forces politiques. Il a estimé que le débat d'orientation budgétaire n'aurait servi à rien s'il apparaissait en définitive à nos concitoyens comme un débat de techniciens et ne provoquait pas une prise de conscience.
S'agissant de la proposition de M. Michel Mercier de procéder à une baisse ciblée de la taxe à la valeur ajoutée, il a tenu à rappeler que la TVA constituait à l'heure actuelle l'impôt le plus rentable pour le budget de l'État.
Abordant enfin le chapitre des aides au logement, il a convenu qu'il convenait d'être vigilant à l'égard des conséquences que pourrait avoir leur démantèlement. Il a précisé à ce sujet que le Gouvernement n'avait d'ailleurs mentionné pour l'heure que les aides à la personne et non les aides à la pierre qui viennent de bénéficier d'un renforcement dans le cadre des dernières lois de finances et de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
En réponse à M. Michel Charasse, le rapporteur général, a estimé, à son tour, que le Sénat, par son mode de désignation, devait être le lieu d'un débat d'orientation budgétaire sérieux et responsable.
Revenant sur les hypothèses budgétaires avancées par le Gouvernement pour 1997, il a précisé que les moins-values fiscales enregistrées en 1996 par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale seraient, conformément à l'engagement très ferme du ministère de l'économie des finances, gagées par des annulations de dépenses. Le déficit prévisionnel de 288 milliards de francs pour le présent exercice sera donc tenu et l'effort d'économie de 60 milliards de francs à réaliser sur l'exercice 1997 repose ainsi sur des évaluations fiables.
Le rapporteur général a ensuite reconnu que le ciblage des mesures à prendre en matière de réduction de la dépense publique était délicat à opérer. S'agissant tout d'abord de la fonction publique, le gain réalisé grâce à la non revalorisation du point d'indice, soit 9,2 milliards de francs, est sensiblement plus élevé que celui procuré par le non remplacement des effectifs partant à la retraite, soit 2,5 milliards de francs, mais la première mesure est plus difficile à faire accepter à l'opinion publique que la seconde.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a également mis en avant l'impossibilité de supprimer, d'un seul coup, l'enveloppe de 138 milliards de francs consacrée annuellement aux aides à l'emploi.
Il s'est déclaré défavorable à la remise en cause dans l'immédiat exonérations fiscales, faisant valoir que certaines d'entre elles venaient seulement d'être instituées par le législateur et que leurs suppression poserait un problème de lisibilité de la politique Gouvernementale.
Abordant enfin la question du déficit des comptes sociaux, le rapporteur général a interrogé les commissaires sur l'opportunité d'aborder avec franchise les conséquences de la dérive de ces comptes en expliquant aux contribuables que toute aggravation se traduirait inéluctablement par un relèvement à due concurrence de la contribution sociale généralisée.
Réagissant à ces propos, M. Guy Cabanel a rappelé que l'existence d'un résultat négatif, en 1996, de 40 à 50 milliards de francs pour les comptes de la sécurité sociale était d'ores et déjà assurée et que celui-ci ne serait pas pris en charge par la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES). Il a exprimé des doutes sur la possibilité de faire admettre aux français le principe d'un apurement de ce nouveau passif par un relèvement de la contribution sociale généralisée.
M. Michel Charasse a suggéré au rapporteur général d'affiner sa présentation en rappelant que le Gouvernement avait annoncé son souhait de revenir, en cours d'exercice, au déficit initialement prévu pour 1996, soit 17 milliards de francs, grâce à un train d'économies. Il conviendra donc de demander à l'exécutif si et selon quelles modalités il pourra tenir son engagement.
Le même intervenant a souhaité, à ce sujet, que soit instituée une CSG spécifique alimentant les régimes spéciaux de sécurité sociale afin que les Français perçoivent le coût de la préservation de certains avantages acquis.
Reprenant la parole, M. Alain Lambert, rapporteur général, a estimé que l'intervention de M. Roland du Luart mettait bien en relief les choix qui s'offrent au Sénat pour le débat d'orientation budgétaire : soit se ranger derrière le Gouvernement et valider les pistes de réflexion qu'il propose, soit le précéder en désignant précisément les secteurs où des efforts devront être consentis ainsi que les modalités de mise en oeuvre de réduction de la dépense.
M. Jean-Philippe Lachenaud a estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'un consensus se dégage dans le cadre du débat d'orientation budgétaire et il a exprimé des doutes sur la volonté des représentants de l'opposition de conserver le ton non partisan utilisé devant la commission.
Il a plaidé, une nouvelle fois, pour une approche réaliste de l'exercice de réduction de la dépense publique, jugeant qu'il n'était pas réaliste d'évoquer une diminution brutale des charges liées à la fonction publique ainsi qu'au logement ou aux aides à l'emploi. Il a exprimé sa préférence pour une annonce par le Gouvernement d'un processus par étape, réparti sur deux ou trois ans.
LE DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR 1997 : DE LA NÉCESSITÉ AUX CHOIX
La souveraineté budgétaire de l'État est menacée à court terme par la montée de l'endettement public : au-delà du respect de nos engagements européens, c'est là le véritable enjeu de la lutte engagée pour réduire les déficits.
Le poids des prélèvements obligatoires exclut de solliciter à nouveau recettes fiscales et c'est une diminution sans précédent de la dépense publique qui devra s'opérer à partir de 1997.
Le débat d'orientation budgétaire doit permettre d'associer le Parlement à une entreprise aussi cruciale, en l'invitant à exprimer ses choix à quelques semaines des arbitrages budgétaires.
* 1 Précédemment, la croissance pour 1995 était estimée à + 2,4 % .
* 2 Ces révisions, si elles traduisent pour beaucoup une révision à la hausse des investissements et des stocks des entreprises, démontrent aussi qu'une légère progression de l'investissement se traduit directement par une inflexion des capacités de financement des entreprises à des niveaux peu favorables à un désendettement substantiel de celles-ci
* 3 L'acquis de croissance pour une année équivaut à ce que serait la croissance en moyenne annuelle si l'activité économique demeurait au niveau atteint lors du dernier trimestre de l'année
* 4 Dans ces pays en effet, un déficit de 3 % signifie un excédent primaire élevé (6 % pour la Belgique, 8 % pour l'Italie) suffisant pour stabiliser la dette. L'Italie est par ailleurs un parfait exemple de la dynamique "explosive" de la dette : celle-ci est passée de 60 à 120 % du PIB entre 1980 et 1995, rendant l'ajustement nécessaire aujourd'hui pour stopper cette évolution particulièrement drastique.
* 5 Elle a, au surplus, été rendue possible, pour une grande part, par des transferts de charges de l'État vers les collectivités locales.
* 6 Celle-ci représente près des 2/3 des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales.
* 7 Voir pour de plus amples développements l'annexe 2 : le pacte de stabilité financière entre l'État et les collectivités locales.
* 8 Rapport entre la variation des recettes fiscales et la variation du PIB
* 9 Rapport de leur excédent brut d'exploitation dans le PIB
* 10 Les signes + = et - signifient une évolution des impôts plus rapide, du même rythme et moins rapide que le PIB respectivement.
* 11 Dont le dynamisme reste difficile à apprécier et serait en tout état de cause compensé par l'effort consenti par les collectivités locales dans le cadre du pacte de stabilité.
* 12 Les effets mécaniques de celle-ci sont présentés par ailleurs.
* 13 La Cour des comptes estimait ainsi en 1994. dans une étude réalisée à la demande de votre commission des Finances, qu'un contrat emploi-solidarité coûtait à peu près trois fois plus cher qu'un contrat de retour à l'emploi
* 14 Cette relation, très imparfaitement vérifiée dans le passé constitue cependant un pis-aller
* 15 C'est-à-dire qu'une augmentation de 1 % de la masse salariale entraîne une augmentation de 0,95 % du produit des cotisations sociales.