Rapport n° 476 (2011-2012) de MM. Alain CLAEYS, député et Jean-Sébastien VIALATTE, député, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, déposé le 13 mars 2012
Disponible au format PDF (1,3 Moctet)
N° 4469 N° 476
____ ___
ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2011 - 2012
____________________________________ ___________________________
Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale Enregistré à la présidence du Sénat
le 13 mars 2012 le 13 mars 2012
________________________
OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
________________________
RAPPORT
sur
L'IMPACT ET LES ENJEUX DES NOUVELLES TECHNOLOGIES D'EXPLORATION ET DE THÉRAPIE DU CERVEAU
Compte rendu des auditions publiques des 29 juin 2011 et 30 novembre 2011
Annexes
Par MM. Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte,
Députés.
__________ __________
Déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale Déposé sur le Bureau du Sénat
par M. Claude BIRRAUX, par M. Bruno SIDO,
Premier Vice-Président de l'Office Président de l'Office
_________________________________________________________________________
AUDITION PUBLIQUE SUR
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
D'EXPLORATION ET DE THÉRAPIE DU CERVEAU : ÉTAT DES
LIEUX
Mercredi 29 juin 2011
OUVERTURE
M. Alain Claeys, rapporteur, député de la Vienne. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, Jean-Sébastien Vialatte et moi-même, à qui l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a confié cette nouvelle étude. Pour rappeler le processus de décision au sein de notre assemblée, c'est le président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale qui a saisi l'Office d'une demande d'étude sur l'impact et les enjeux des nouvelles technologies d'exploration et de thérapie du cerveau. Cette saisine s'inscrit assez naturellement dans les débats que nous avions initiés à l'Office dans le cadre de l'évaluation de la loi relative à la bioéthique, lors d'une audition publique du 26 mars 2008, qui s'intitulait « Exploration du cerveau, neurosciences : avancées scientifiques, enjeux éthiques ».
C'était en quelque sorte une première sur cette thématique au Parlement. Plusieurs membres du conseil scientifique de l'Office avaient alors appelé notre attention sur la nécessité de cerner l'impact juridique et social des recherches sur le cerveau à la lumière des nouvelles technologies. Ils nous avaient convaincus de la nécessité de prendre en compte les interrogations éthiques suscitées par ces nouvelles technologies lors de la révision de la loi précitée.
En 2008, nous nous posions des questions, toujours d'actualité, à propos de ces nouvelles technologies. Que lit-on ? Que dépiste-t-on ? Que soigne-t-on ? Peut-on attribuer un sens ou un contenu aux données obtenues grâce aux nouvelles techniques d'imagerie ? Peut-on déduire les causes biologiques d'un comportement ou d'une maladie mentale ? Quel est leur pouvoir prédictif, et comment les diagnostics prédictifs, pour certains troubles, sont-ils accueillis et ressentis par les patients et leurs familles alors qu'aucun traitement n'existe ? Enfin, quels sont les effets du dépistage précoce quand il n'y a pas de remède et qu'un risque de stigmatisation existe ?
Cette première approche, très riche en enseignements, nous a permis de formuler des recommandations qui ont conduit la mission du bureau de l'Assemblée Nationale relative à la loi de bioéthique, comme la commission spéciale de l'Assemblée Nationale constituée à cet effet, à s'interroger sur l'impact de ces technologies en plein essor, notamment en termes éthiques et juridiques.
Ainsi, la loi relative à la bioéthique, qui vient d'être adoptée, confie au Comité consultatif national d'éthique et à l'Agence de la biomédecine un rôle de veille et d'alerte sur le développement de ces technologies. En outre, un nouveau chapitre est inséré dans le code civil. Il est intitulé : « de l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale ». Ces nouvelles dispositions prévoient, d'une part, que les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertise judiciaire et, d'autre part, -je cite- que « le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité ».
Ce consentement révocable, sans forme et à tout moment, doit mentionner la finalité de l'examen. Il s'agit de protéger les personnes et de permettre le développement de ces technologies à des fins scientifiques et médicales. On tend à éviter un détournement d'usage de ces technologies. Voir le cerveau en fonctionnement, déceler les traces d'un apprentissage, détecter une pathologie, la compenser par des implants comme cela nous a été présenté lors de nos visites à NeuroSpin, plus récemment à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et il y a quelques jours à Grenoble, cela interroge et fascine. Les patients gravement atteints de la maladie de Parkinson, de troubles obsessionnels compulsifs, voire de dépression profonde voient leur comportement modifié par des implants.
S'il s'agit de traiter une maladie grave et invalidante, ces techniques qui combinent neuroimagerie, stimulation par des implants, utilisation des interfaces homme/machine, ne relèvent que du consentement éclairé du patient et du colloque singulier entre lui et son médecin traitant.
Pourtant, lors de nos auditions, nous avons été frappés par une demande récurrente de cadres, voire de guides de bonnes pratiques de la part des équipes médicales confrontées à ces technologies. Bien évidemment, il ne nous appartient pas, en tant que législateur, d'élaborer un guide de bonnes pratiques dans ce domaine. Cela relève, comme le prévoit la nouvelle loi, des compétences de la Haute autorité de santé. En revanche, il nous revient de relayer ce questionnement qui relève des relations entre la science et le citoyen, et de favoriser un débat, comme nous nous efforçons de le faire à l'Office, par des auditions publiques comme celle-ci.
À ce stade de nos travaux les principales questions qui semblent se dégager sont les suivantes. Au niveau général, on pourrait ainsi les formuler. Comment utiliser au mieux les nouvelles connaissances obtenues dans le domaine de la neuroimagerie et des neurosciences ? Quels sont les enjeux éthiques et sociétaux de leur développement ? Comment assurer l'égalité d'accès aux soins et à la liberté de choix des patients ? Comment limiter la pression des intérêts économiques ? Comment assurer l'information du public et la communication ?
Des questions plus ciblées porteraient sur les critères d'utilisation de ces technologies. Comment les utilise-t-on quand il s'agit d'une recherche sur des personnes bien portantes ? Comment gérer des découvertes fortuites de pathologies sur une personne souhaitant ne rien savoir ? Faudra-t-il annoncer un risque maladie d'Alzheimer après un diagnostic précoce alors que la personne n'a pas encore de symptômes? Que se passe-t-il quand on soigne un patient atteint de troubles obsessionnels compulsifs, de la maladie de Gilles de la Tourette ou d'une maladie de Parkinson ? En implantant des électrodes dans le cerveau, modifie-t-on sa personnalité ? Peut-on augmenter ses performances cérébrales, comment et dans quelle mesure ? Comment éviter un dévoiement de ces techniques ? Il y a en outre, des questions plus spécifiques sur les techniques elles-mêmes portant notamment sur leur degré de fiabilité. La mise en place de structures adaptées à des recherches interdisciplinaires progresse-t-elle? C'est l'un des objets de l'audition publique d'aujourd'hui que de tenter d'y répondre.
Les sujets ne manquent donc pas. Jean-Sébastien Vialatte précisera encore l'esprit de cette journée. Je voudrais vraiment vous remercier de consacrer cet après-midi au Parlement, pour éclairer la représentation nationale sur un des sujets qui, je le pense profondément, sera essentiel dans l'avenir.
M. Jean-Sébastien Vialatte, rapporteur, député du Var. Je voudrais tout d'abord m'associer aux remerciements d'Alain Claeys à votre égard et vous dire, comme il l'a souligné, que cette étude arrive à un moment important, car on assiste à une prise de conscience collective de l'impact des maladies du cerveau.
Chacun d'entre nous a dans sa famille ou parmi ses relations une personne qui souffre d'une pathologie relevant d'un dysfonctionnement du cerveau ; c'est une des premières causes de maladie ou de handicap qui frappe les patients, portant une atteinte parfois durable à leur vie sociale et professionnelle. Ces pathologies touchent une population de plus en plus grande à mesure que s'accroît l'espérance de vie, et elles ont un impact direct ou indirect fort sur l'économie. Ainsi, selon l'OMS, 35% des dépenses liées à la maladie, proviendront de troubles du cerveau.
D'après une étude récente, menée il y a six ans dans les pays de l'Union européenne, le coût total des maladies du cerveau s'élevait en 2004 à 386 milliards d'euros, 135 milliards d'euros pour les seuls soins, 78 milliards d'euros pour l'hospitalisation, et 179 milliards d'euros étant attribués aux arrêts de maladie et à la baisse de productivité consécutive à un handicap permanent. Ces dépenses représentent en 2004 une charge moyenne de 829 euros par an et par habitant en Europe. Cette évaluation est bien sûr à revoir à la hausse, compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, du vieillissement de la population, et partant, de l'augmentation de l'incidence des maladies neurologiques et psychiatriques.
En France, la majeure partie des charges a été attribuée aux affections psychiatriques, soit 28 milliards d'euros, les affections neurologiques ayant été évaluées à 29% des coûts. Pouvoir bénéficier des nouvelles technologies est donc un enjeu de santé publique majeur, à la fois pour les patients et leurs familles, mais aussi pour les finances publiques.
Par ailleurs, les progrès des neurosciences soulèvent des questions d'ordre éthique classiques, telles que le déroulement des expérimentations ou le consentement éclairé de personnes atteintes de maladies neurologiques recrutées pour des essais scientifiques. Cependant, la question du consentement éclairé se pose dans ce domaine avec une acuité particulière, qu'il s'agisse d'essais sur des personnes en bonne santé apparente, ou sur des patients. Ainsi, des patients atteints par la maladie d'Alzheimer devraient-ils être utilisés comme sujets de recherche, alors même qu'ils n'ont pas la capacité cognitive ou l'autonomie pour prendre cette décision ?
Des expériences sur des personnes en bonne santé posent question, car ces technologies permettent de diagnostiquer, mais aussi de prédire, avec un certain degré de certitude, l'existence d'une pathologie grave. Cette question est posée avec une fréquence accrue, notamment dans le cadre de maladies neurodégénératives.
Grâce aux nouvelles techniques de détection des états de conscience, les familles demandent des évaluations. Si les évaluations diverses et les tests sont négatifs, délivrer une information reconnaissant l'existence d'un état végétatif risque d'être porteur d'une violence extrêmement forte.
Par ailleurs, ces nouvelles techniques entraînent une intrusion dans l'intimité en raison des informations, même limitées, qui peuvent être obtenues. Des réserves devraient donc être émises quant aux délais et modalités de conservation, afin d'assurer la confidentialité des données.
Face à une demande de soins qui s'accroît, les interrogations quant aux techniques d'exploration et de traitement du cerveau sont fortes. Le cerveau n'est pas un organe comme les autres. Les pathologies qui l'atteignent touchent à l'intimité, au comportement, à la personnalité des patients. On assiste ainsi à un mouvement contradictoire bien connu à l'Office parlementaire, une sorte de fascination quant aux promesses de la science, dans un domaine où les pathologies sont sévères et handicapantes, et par ailleurs, des craintes alimentées à tort, mais aussi parfois à raison, par un mouvement anti-science, qui craint une subordination de l'humain à la technologie. Nous savons que ces techniques peuvent être dévoyées, que les données qu'elles génèrent doivent être protégées. Nous reviendrons sur ces aspects importants lors d'une audition que nous projetons d'organiser le 30 novembre prochain.
Aujourd'hui, il nous revient de dresser un état des lieux des avancées technologiques à l'oeuvre. L'après-midi est organisé en trois tables rondes qui vont être précédées des propos introductifs de Monsieur Hervé Chneiwess directeur de recherche, groupe « Plasticité gliale et tumeurs cérébrales » au Centre de psychiatrie et neurosciences de la faculté de médecine Paris-Descartes, membre du conseil scientifique de l'OPECST, et Monsieur Bernard Bioulac, co-directeur de l'Institut thématique multi-organismes : neurosciences, sciences cognitives, neurologie et psychiatrie de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN).
PROPOS INTRODUCTIFS
M. Hervé Chneiweiss, directeur de recherche, groupe « Plasticité gliale et tumeurs cérébrales » au Centre de psychiatrie et neurosciences de la faculté de médecine Paris-Descartes, membre du Conseil scientifique de l'OPECST . Je vous remercie d'avoir organisé cette mission et cette journée d'audition, et je remercie les différents experts de renommée internationale qui viennent aujourd'hui nous éclairer sur les techniques d'exploration du cerveau.
Avant de nous lancer dans l'ivresse du progrès, dans le mouvement de la technique, il apparaît qu'évoquer le cerveau, c'est d'abord parler de ce qui fonde notre individualité. Et il est merveilleux de souligner que le XX ème siècle sera le siècle de la biologie, de la biologie intégrative, de la capacité de faire la synthèse des connaissances liant la molécule à la façon dont l'organisme entier fonctionne. C'est bien le cerveau qui est l'organe où cette biologie intégrative sera à l'oeuvre de façon magnifique, et j'entends par magnifique, l'émerveillement que nous avons chaque jour au laboratoire, et plus généralement en neurosciences, à découvrir le mode de fonctionnement du système nerveux, et de cet organe qui permet la pensée.
Ce cerveau, protégé par sa boîte crânienne, insensible à la gravité grâce au liquide céphalorachidien, semble à l'abri, nous ne le sentons pas, et de fait, il est totalement insensible. Mais à lui seul, il consomme un quart de l'énergie que nous produisons chaque jour, alors qu'il représente moins de 3% du poids de l'organisme. C'est donc l'organe privilégié du corps humain.
On évoquera sans doute un mouvement absolument incroyable du progrès dans la période la plus récente, mais l'histoire de l'exploration du cerveau est inhérente à l'histoire de l'humanité. On a trouvé dans des fouilles préhistoriques des traces de crânes avec des trépanations, et des sutures, ce qui prouve que le patient avait survécu. Sur les pyramides égyptiennes, dans le premier codex de 2000 av. J.-C., on a découvert les codes d'utilisation du pavot et de la morphine. L'homme a toujours cherché à lutter contre la souffrance, et il a tout de suite reconnu que certains extraits de plantes pouvaient y contribuer. Dans le plus ancien papyrus connu, celui d'Edwin Smith, il y a déjà des notions approfondies sur des pathologies du système nerveux : la description par exemple de l'hémiplégie, qu'on retrouvera dans la Bible. « Que j'oublie ma droite et que ma langue colle à mon palais si je t'oublie Jérusalem », c'est la description de l'hémiplégie droite.
Alcméon de Crotone au VI ème siècle av J.C. place dans le cerveau le siège de la raison. Hippocrate et Platon le suivront. À Alexandrie, au III ème siècle av. J.-C., on assiste vraiment à une explosion des recherches sur le système nerveux, avec Straton de Lampsaque, un maître, précepteur du fameux Ptolémée II Philadelphe, celui de la bibliothèque d'Alexandrie et du Phare. Avec ses élèves, Hérophile et Erasistrate, il va décrire l'anatomie du cerveau, les circonvolutions, distinguer les vaisseaux des nerfs, et surtout expliquer que l'âme fonctionne selon les lois de la nature. On est au IIIème siècle av. J.-C. Il faudra plus de vingt siècles avant que l'Occident redécouvre les principes de l'école d'Alexandrie.
En Occident, les Français ont une bonne place, ainsi François Magendie, qui applique au début du XIXè siècle la chimie à l'organisme et considérera effectivement que les lois naturelles, s'appliquent au corps humain. Grâce à la chimie des imprégnations argentiques dérivées de la photographie, on rentrera dans l'ère des neurosciences modernes avec Camillo Golgi, qui décrira une technique d'histologie, et Santiago Ramón y Cajal. Tous deux mettront en évidence que le système nerveux est formé de cellules qui communiquent les unes avec les autres. Grâce à ces techniques, avec le prix Nobel donné à Golgi et Cajal en 1906, on arrive au début de l'ère moderne des neurosciences.
À peu près au même moment à la fin du XIXème siècle, les physiologistes de l'école allemande, Emile Dubois-Reymond et Hermann Von Helmhotz démontreront tout l'aspect de fonctionnement électrique, qu'on retrouvera probablement tout à l'heure avec les descriptions de l'électro-encéphalogramme à haute densité et numérisé.
En parallèle, Claude Bernard contribue au début de la pharmacologie, qui initiera après la Seconde Guerre mondiale, la neuropharmacologie. C'est la compréhension des molécules libérées lorsque le potentiel d'action, ce courant électrique, arrive à la fin de l'axone, qui libère une molécule chimique, le neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur va interagir avec un récepteur. C'est la base d'à peu près tous les médicaments que nous utilisons aujourd'hui.
Donc la modernité dont on va parler, la modernité d'exploration, la modernité de transfert à la clinique humaine, c'est l'histoire entière de l'humanité qui peut encore une fois la résumer. Est-ce à dire, pour venir à des questions plus sociétales, que nos cellules pensent ?
De ce point de vue-là, les choses commencent à la fin du XIXe siècle avec deux précurseurs de la méthode anatomo-pathologique Xavier Bichat et Paul Broca. Comment mettre en relation une altération du fonctionnement, et en particulier de la cognition, même si pour Broca, ce sera la parole, avec des régions cérébrales ? En utilisant des lésions cérébrales, comme celles induites par un accident vasculaire cérébral (AVC). Nos utilisateurs actuels des IRM poursuivent dans cette voie sans avoir à attendre le décès du patient. Sherrington de son côté, toujours à la fin du XIXe siècle, avait entamé lui aussi une exploration neurophysiologique des fonctions cérébrales, et il avait commencé à les localiser, dans certaines régions du cerveau, en étudiant des modifications de la circulation cérébrale en relation avec certaines fonctions du cerveau.
Évidemment, et je laisserai la parole aux spécialistes, le grand bond en avant consistera en la mise au point, au tournant des années quatre-vingt, des techniques d'imagerie cérébrale. Ce sera la Tomographie par émission de positions (TEP), d'imagerie par résonance magnétique (IRM)) et de sa version résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) et la Magnétoencéphalographie (MEG). On fera très attention, dans tous ces phénomènes, et je suis sûr que les spécialistes l'expliciteront de façon très claire, aux questions de résolution spatiale. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? Je viens de vous parler de cellules. Il est bien sûr hors de question aujourd'hui, avec le type d`imagerie que je viens de citer, de voir une cellule ou des cellules, contrairement au microscope confocal ou biphoton qui permet de voir une cellule. Avec les techniques d'imagerie utilisées couramment chez l'homme, il est question de voir des assemblées de cellules : 1mm cube donc plusieurs millions de cellules.
On évoquera aussi le temps. Un neurone fonctionne dans l'ordre de la milliseconde. Il faudra donc discuter la résolution temporelle de ces méthodes, et donc de ce qui est accessible à ces méthodes, compte tenu de leur résolution temporelle. Cela vous expliquera aussi qu'il n'y a pas une seule méthode à utiliser, mais une combinatoire de différentes méthodes d'exploration du fonctionnement cérébral. Ces méthodes ne permettent pas seulement d'avoir accès au fonctionnement des neurones. Il ne vous étonnera pas que j'évoque les cellules gliales, qui sont même un peu plus nombreuses et tout aussi communicantes entre elles, mais ni avec les mêmes constantes d'espace, ni avec les mêmes constantes de temps -ici la seconde- ni avec les mêmes champs électromagnétiques. Par contre, quand on étudiera la consommation d'oxygène, la consommation de glucose, c'est de ces cellules gliales qu'on étudiera plus directement le fonctionnement, et indirectement le fonctionnement des neurones.
On mentionnera les molécules marquées, et c'est là où il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Quand on évoquera l'Oxygène 15, une molécule radioactive à décomposition rapide, ou du Fluor 18, on parlera de radioactivité, mais d'une radioactivité dont les constantes de temps de demi-vie sont faibles, sans danger pour la personne humaine, et à l'inverse, essentielle à l'exploration du fonctionnement cérébral normal, et dans certains cas, de son application au diagnostic ou à la thérapeutique.
On soulignera, j'en suis sûr, que l'acquisition d'une image en IRMf correspond à la répétition d'une tâche dans l'état actuel des choses. Répétition d'une tâche dans un environnement particulier, celui du laboratoire, crâne pris dans une machine. On se situe dans la science, dans la recherche, dans l'exploration, on n'est pas dans une explication du comportement de chacun d'entre nous au quotidien. Nos questionnements seront d'abord de compréhension, pour essayer de comprendre comment une trace peut arriver à se fixer, à plus ou moins long terme. Vous avez abordé la question de la maladie d'Alzheimer, c'est l'effacement de certaines traces ou la perte des labels qui permettent de retrouver ces traces.
Et donc forcément, on évoquera l'éthique. Puisqu'il a été dit qu'on y reviendrait le 30 novembre, je ne l'aborderai pas ici, sauf pour distinguer deux dimensions : l'une est l'éthique des connaissances acquises dans le champ des neurosciences, c'est celle qui nous concerne directement, surtout dans cette enceinte ; l'autre peut questionner sur le fonctionnement cérébral : comment sommes-nous des individus éthiques ? Cette neurobiologie de l'éthique, au fond, est une partie de la neurobiologie de la cognition, et elle ne sera pas abordée dans cette enceinte.
Je conclurai sur trois questions ou trois points qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est de vous mettre en garde, même si je suis le premier à m'en émerveiller, sur la fascination des images. On verra tout à l'heure, j'en suis sûr, de très belles images en couleur. Il faudra toujours se rappeler dans quelles conditions ces images ont été obtenues. Le cerveau ne fonctionne pas en couleurs. Ce sont des couleurs qui sont codées par des scientifiques au laboratoire. Cela nécessite des répétitions de tâches, des conditions de paramétrage. C'est l'ensemble du cerveau qui fonctionne. Certaines régions fonctionnent plus particulièrement que d'autres, mais le danger serait de remettre au goût du jour technique une certaine phrénologie, comme l'avait fait Gall avec « la bosse des maths » ou « la bosse de l'amour maternel ».
Cela m'amène à un deuxième point important : il faut toujours se méfier de la confusion entre le normal et le pathologique. S'il y a bien un domaine où le pathologique a apporté beaucoup à la compréhension du fonctionnement normal, c'est bien le système nerveux. Et pourtant, le système nerveux normal n'est pas simplement un système pathologique réparé. Il convient également de se méfier de ce qui est nécessaire, de ce qui est exclusif. Quand on lit quelque part qu'on a repéré le noyau de l'amour ou le noyau du dégoût, je reprendrais une image de l'un de mes maîtres en neurologie, François Lhermitte, qui disait : « si vous placez une bombe sur le pont Alexandre III, ou si vous y faites des travaux, vous aurez des embouteillages dans la moitié de Paris. Ce n'est pas pour cela que la fonction circulatoire automobile est sur le pont Alexandre III. »
Enfin, nous allons explorer un cerveau particulier. On verra les images de cerveau, mais comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me font le plaisir de m'écouter à l'instant, ce n'est pas la situation de la vie réelle. Un cerveau unique n'existe jamais. Un cerveau est toujours en interaction avec d'autres cerveaux. On réservera la prochaine séance à l'aspect philosophique, le regard de l'autre de Levinas ou d'autres visions neuro-éthiques, mais dès aujourd'hui, on peut partir de la constatation qu'il en est ainsi dans notre fonctionnement à tout instant. Et je prendrais comme exemple, pour conclure, un article publié l'an dernier dans Proceedings of the National Academy of Sciences of the United , (PNAS). Une équipe américaine a fait l'expérience d'un récit, soit en anglais, soit en russe, à des gens ne comprenant que l'anglais, et en enregistrant en simultané l'imagerie cérébrale de celui qui racontait le récit et l'imagerie cérébrale de celui qui écoutait le récit. On se rend compte, que pour comprendre, pour qu'il y ait une compréhension de la part de celui qui écoute, il faut qu'il y ait une synchronisation avec celui qui raconte le récit. Une certaine image se forme quand le récit se fait en anglais. Mais on se rend compte aussi que très rapidement, celui qui écoute anticipe certains aspects du récit, et que cette anticipation est liée à la compréhension du récit. Nous ne sommes pas des cerveaux isolés. Nous sommes des cerveaux qui passent leur temps à détecter l'intention de l'autre et à anticiper sur les événements. Ces aspects du cerveau humain dans son activité réelle devront être à tout moment gardés en considération.
M. Jean-Sébastien Vialatte . Je vous remercie de ce panorama et donne la parole à Monsieur Bioulac.
M. Bernard Bioulac, co-directeur de l'Institut thématique multi-organismes : neurosciences, sciences cognitives, neurologie et psychiatrie neurosciences de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN). Je vais très simplement centrer mon propos introductif sur l'organisation de la recherche sur le système nerveux, et évoquer le fonctionnement de ce qui est désormais appelé l'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé, et dans cette Alliance, l'Institut multi-organismes l'ITMO Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie. L'AVIESAN est née il y a plus de deux ans. Elle a pour objectif d'une part de rapprocher les différents opérateurs, qu'ils soient des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), des universités, des centres hospitalo-universitaires (CHU), d'autres instances comme l'Institut Pasteur, l'Institut de recherche sur le développement (IRD) et, d'autre part, d'essayer de coordonner les objectifs en matière de recherche scientifique et de recherche translationnelle ce qui a été souvent une certaine faiblesse dans la recherche française. Ces objectifs sont les suivants :
- coordonner l'analyse stratégique, la programmation scientifique et la mise en oeuvre opérationnelle de la recherche en sciences de la vie et de la santé,
- donner un nouvel essor à la recherche translationnelle en accélérant le transfert des connaissances fondamentales vers leurs applications cliniques,
- favoriser la transdisciplinarité en ouvrant la biologie et la médecine aux apports des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'informatique, des sciences de l'ingénieur, des sciences humaines et sociales,
- veiller à la cohérence des projets en matière de thématiques et d'infrastructures,
- assurer la valorisation clinique, économique et sociale des connaissances, en facilitant notamment les partenariats industriels
- harmoniser et simplifier les procédures administratives des laboratoires en vue de libérer la créativité et l'excellence des équipes,
- définir des positions communes en matière de recherche européenne et de coopération internationale,
Cette Alliance regroupe dix instituts thématiques qui recouvrent les grands champs disciplinaires de la recherche, et les neurosciences représentent l'un de ces instituts thématiques : sciences cognitives, neurologie, psychiatrie. L'essentiel des chercheurs, des personnels administratifs et techniques : les ingénieurs techniciens administratifs (ITA), et des enseignants-chercheurs qui sont rassemblés dans l'institut de neurosciences, représentent 23% à 24% par rapport au CNRS ou à l'INSERM, qui sont les deux grands éléments, mais il y a aussi le CEA, l'INRA, l'INRIA. Donc, la recherche sur le système nerveux est une partie extrêmement importante dans les deux principaux EPST.
Les missions des Instituts multi-organismes (ITMO) recouvrent les missions de l'AVIESAN :
- faire émerger une vision stratégique nationale,
- coordonner l'action des acteurs de la recherche publique, en particulier les organismes de recherche, les universités, les CHU et les agences de moyen,
- oeuvrer à une meilleure valorisation de la recherche, une meilleure reconnaissance nationale et internationale, un partenariat renforcé avec les associations de malades,
- organiser les transversalités entre les domaines thématiques.
L'ITMO Neurosciences est codirigé par Alexis Brice, qui était dans une unité INSERM au départ, et maintenant INSERM-CNRS, et moi-même. Des chargés de mission, partagés entre l'INSERM et le CNRS nous aident dans ce travail, Nous sommes entourés par un groupe d'experts, dont certains présents aujourd'hui balaient l'ensemble des disciplines et des sous disciplines des neurosciences. La provenance de ces chercheurs, de renommée nationale et internationale, recouvre à la fois les universités, les CHU, le CNRS, l'INSERM, mais aussi le CEA, l'INRIA, l'INRA, avec en outre, des liens avec l'Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé (ARIIS), et l'industrie pharmaceutique. Il y a là une volonté de cohérence dans la stratégie de la recherche scientifique et de la recherche translationnelle. Les périmètres de l'institut, concernent à la fois la recherche fondamentale et la recherche clinique (de la biologie des cellules neurales à la physiologie de la perception et de l'action, y compris la cognition et les comportements, du développement au vieillissement) et les neurosciences cliniques (maladies neurologiques et psychiatriques, déficits des organes des sens).
La recherche fondamentale, particulièrement importante, n'est pas du tout, comme on a pu le croire au départ, sacrifiée au profit des neurosciences cliniques. Nous savons très bien qu'un équilibre est indispensable entre ces approches. Elles sont complètement complémentaires et n'ont rien de contradictoire. Les forces en neurosciences représentent 550 équipes de recherché, 3300 chercheurs, ingénieurs et post doctorants, 18 Centres d'investigation clinique, 4200 publications par an et 220 millions d'euros (salaires exclus).
L'Ile-de-France regroupe presque 50% des forces de recherche (EPST, universités et CHU). Ensuite, il existe un certain nombre de sites plus ou moins importants. La question est de savoir si nous avons les moyens dans notre pays, avec le développement des grandes technologies, en particulier des plates-formes technologiques, de ne pas reconcentrer davantage. C'est une question importante pour la représentation nationale et pour l'exécutif. Il est évident que la dispersion n'est pas facile à gérer en termes budgétaires. Néanmoins, l'émergence provient quelquefois de la dispersion.
À côté de ces forces en neurosciences, cliniques et fondamentales, vous avez les centres d'investigation cliniques (CIC) qui associent chaque fois l'INSERM et un CHU, où est pratiquée la recherche clinique. La répartition des CIC est assez cohérente dans notre pays, dans le domaine des neurosciences, et plus particulièrement des mouvements anormaux et de la psychiatrie.
Il est important d'avoir présent à l'esprit la façon dont se sont répartis les programmes liés au Grand emprunt : la répartition des différents éléments qui le constituaient, les concours, les réponses aux appels d'offre : Cohortes, Equipements d'Excellence (Equipex), les Instituts hospitalo-universitaires (IHU), les infrastructures et les Laboratoires d'excellence (Labex), est faite au niveau du territoire national. Il y a un seul IHU en neurosciences, il est parallèle à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. En revanche, il existe plusieurs Labex. Cette répartition recoupe un peu la carte des forces en neurosciences, indiquée au départ, mais pas complètement.
Comment se répartissent les différents sous champs disciplinaires des neurosciences en termes de pourcentages en France ? Par rapport aux autres disciplines, les neurosciences occupent entre 20 et 22% des domaines de recherche. La déclinaison en termes de sous champs disciplinaires plus précis montre que la recherche fondamentale est représentée par la recherche en neurosciences cellulaire et moléculaire, et les neurosciences intégratives, auxquelles il faut ajouter la recherche en développement. La recherche physiopathologique clinique est de l'ordre de 33%. Ce qui veut dire que dans notre pays, la recherche fondamentale est particulièrement prédominante, même si elle a des visées translationnelles. La recherche strictement clinique est moins importante en pourcentage que la recherche fondamentale, qu'elle soit strictement fondamentale ou fondamentale à visée translationnelle.
Il existe également des fondations sur le territoire : la fondation nationale d'Alzheimer; la fondation de psychiatrie « FondaMental », dirigée par le Pr Marion Leboyer, localisée en région parisienne, mais disposant d'un réseau sur l'ensemble du territoire; le réseau thématique de recherche et de soins ; Organes des sens « Voir et Entendre » ; maladie neurologiques « NeuroDis » à Lyon ; le premier réseau thématique de recherche avancée (RTRA) Recherche fondamentale à l'école des Neurosciences de Paris.
Quels sont les enjeux ? J'insisterai sur trois enjeux, et j'en ajouterai deux autres.
Commençons par les enjeux médicaux ; ils sont importants ; tout à l'heure, ils ont été stigmatisés. J'ai repris les chiffres de la Commission européenne. Le coût des maladies du cerveau est représenté par un ensemble qui est de l'ordre de plus de 400 milliards d'euros, dont 294,7 milliards d'euros sont dédiés au fardeau des maladies psychiatriques. En France, elles représentent environ 110 Milliards d'euros si on compte tout, c'est-à-dire le soin, le péri soin, la perte de productivité et la perte de qualité de vie. Les maladies neurologiques coûtent cher (83,9 milliards d'euros) mais beaucoup moins que les maladies psychiatriques. Quant à la neurochirurgie (7,5 milliards d'euros), elle coûte cher, certes, mais beaucoup moins que la neurologie, et surtout que la psychiatrie. Les enjeux médicaux que nous retenons et que nous rappelons sans arrêt dans le cadre de l'ITMO rejoignent bien sûr les préoccupations majeures. Ce sont : la détection et le diagnostic précoce des maladies, l'identification des facteurs de susceptibilité génétiques, épigénétiques et environnementaux, la meilleure compréhension des bases moléculaires et cellulaires, les traitements préventifs et innovants dans toutes leurs formes (pharmacologie, médecine régénérative, thérapie cellulaire et génique, remédiation cognitive, etc.).
Nous avons particulièrement mis en exergue deux exemples concernant les maladies du système nerveux élargies à la psychiatrie. Il s'agit premièrement des maladies neurodégénératives, où il est vrai qu'un certain nombre de découvertes ont changé le traitement et le pronostic : l'identification des gènes en cause dans les formes familiales, la prise en compte des facteurs de susceptibilité, le traitement de la maladie de Parkinson par stimulation cérébrale profonde, le développement des biomarqueurs, la création de nombreux modèles animaux, la possibilité d'isoler des cellules souches ou de reprogrammer des cellules, puis de les différencier en neurones. Ceci indique que nous devons, dans les grandes orientations que nous poursuivons, continuer les recherches, y compris les recherches à visée fondamentale sur la pathogénie, sur la physiopathologie des maladies, en utilisant de nouveaux modèles animaux, de nouveaux biomarqueurs. Il est aussi très important de développer des approches multimodales de diagnostic et de pronostic, d'imaginer des traitements à visée plus prédictive et plus préventive.
La recherche en psychiatrie est le deuxième exemple mis en exergue. Le coût de la psychiatrie est considérable dans le budget des États. C'est sûrement à ce niveau-là que des efforts sont nécessaires et indispensables. Concernant la recherche dans ce champ disciplinaire, il y a eu des retards de thérapie pour des raisons historiques, thérapeutiques. Malgré cela, il faut souligner quelques découvertes importantes sur le plan génétique ou sur le plan des hypothèses qu'on avance maintenant dans certaines pathologies psychiatriques, et des innovations thérapeutiques. Mais il est sûr qu'il faut un effort budgétaire considérable à ce niveau-là. J'indique par exemple que dans la recherche biomédicale, la recherche en psychiatrie au sens strict du terme ne représente que 2% du budget de la recherche biomédicale au total ; donc un coût considérable pour la société et un effort de recherche tout à fait insuffisant.
J'en viens aux enjeux scientifiques et commencerai par les enjeux médicaux car ils touchent directement la société et l'homme. Les enjeux scientifiques restent à tout moment présents dans notre préoccupation. Il s'agit, au plan fondamental, de poursuivre le décryptage du code neural, dans toutes ses formes au niveau du neurone, des synapses, des interactions avec la glie, et de comprendre les règles d'intégration qui sous-tendent les grandes fonctions sensorielles, motrices, cognitives et comportementales en intégrant les différents niveaux d'analyses et en combinant les méthodes. Il s'agit également d'identifier les règles d'interactions de l'esprit humain avec l'environnement, mais aussi au niveau des études des grandes fonctions cognitives, de la plasticité et de la meilleure compréhension du vieillissement normal et du vieillissement pathologique.
Un des éléments que nous avons également mis en exergue dans nos préoccupations et que nous faisons partager à la communauté des neurosciences, c'est l'utilisation des neurosciences théoriques et computationnelles pour mieux comprendre et mieux traiter le système nerveux central : dans le développement des interfaces cerveau-machine, dans tout ce qui touche les sciences de l'éducation et de l'apprentissage, et également, et j'insiste à nouveau, sur la meilleure compréhension des fonctions cognitives, qui trouvent leur acmé au niveau du fonctionnement du psychisme humain, qu'il soit normal ou pathologique.
Quant aux enjeux technologiques, les grandes découvertes déjà évoquées impliquent le développement de l'imagerie fonctionnelle qui permet une cartographie dynamique des fonctions cérébrales, de l'imagerie multimodale et de l'imagerie moléculaire, de l'imagerie microscopique électronique et optique. Les grandes orientations visent à inclure l'imagerie dans l'arsenal thérapeutique de la médecine personnalisée, à l'utiliser comme biomarqueur, et à favoriser le développement des techniques d'imagerie (IRM bas champ, imagerie multimodale), et à augmenter la résolution spatiale et temporelle.
Autre enjeu technologique que nous avons mis en avant : la biologie systémique, c'est-à-dire tout ce qui aidera à surmonter la complexité du système nerveux en créant les ponts, les liens de l'infiniment petit à l'infiniment grand, en pratiquant ce qu'on appelle des approches multi-échelles. Ceci est particulièrement important et définitivement majeur dans la collecte, le traitement et le stockage des données, les grandes banques de données nécessaires qu'il faut renforcer, voire créer, et également dans la modélisation conceptuelle, qu'elle soit neuromimétique ou biomimétique.
Parmi d'autres enjeux, on mentionnera les enjeux socio-économiques, exigeant de meilleures transversalités, de meilleurs ponts avec les sciences de l'ingénierie, tout ce qui touche les interfaces homme-machine, cerveau-machine, l'ergonomie cognitive particulièrement importante, mais aussi tout ce qui touche l'éducation. Il est important qu'il y ait de meilleurs liens entre les neurosciences, qu'elles soient fondamentales, translationnelles ou cliniques, avec les sciences humaines et sociales, particulièrement dans le domaine de la psychiatrie, avec justement le rapprochement entre la psychiatrie biologique et une psychiatrie plus humaniste, plus philosophique. Ce pont doit se faire entre ces deux approches qui ont été divergentes trop longtemps.
On a déjà évoqué les enjeux éthiques et juridiques. Ils concernent l'imagerie fonctionnelle, et la stimulation cérébrale profonde. D'autres les évoqueront pour la maladie de Parkinson ou pour des pathologies plus psychiatriques, avec toujours l'interrogation de savoir si l'on peut utiliser de telles approches pour contrôler l'état subjectif des patients. Ils concernent aussi la psychopharmacologie et bien sûr les grandes questions qui touchent les cellules souches et le diagnostic génétique, comme on l'a déjà évoqué.
Pour conclure, cet institut thématique multi-organismes « neurosciences » au sens élargi du terme, depuis maintenant plus de deux ans, essaie d'animer, de proposer, de coordonner les efforts dans ce champ extrêmement important. Il essaie également de servir de bras de levier avec l'exécutif, avec des instances comme l'Agence nationale de la recherche (ANR), pour faire inscrire des programmes de recherche, puisque les EPST n'ont plus la possibilité directement d'inscrire des lignes budgétaires dans de grands programmes de recherche, d'être des acteurs auprès de l'ANR entre autres, pour que les grandes questions socio-économiques soient prises en considération, particulièrement la psychiatrie.
Grâce à cette action, nous avons obtenu cette année une ANR directement liée à la recherche sur les maladies mentales. J'espère que l'année prochaine il y aura une ANR dédiée à l'utilisation des neurosciences computationnelles dans les approches multi-échelles. Voilà cette démarche, progressive, peut-être à petits pas, mais indispensable pour coordonner et renforcer les neurosciences comme task force au niveau de notre pays.
M. Jean-Sébastien Vialatte. Je vous remercie Messieurs pour ces propos introductifs qui ouvrent d'intéressantes perspectives. Nous passons ensuite à la première table ronde qui porte sur : l'exploration du cerveau : quelles avancées technologiques ?
L'EXPLORATION DU CERVEAU : QUELLES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES ?
M. Jean-Sébastien Vialatte. Je donne la parole au professeur Didier Dormont
M. Didier Dormont, professeur des universités, praticien hospitalier, spécialiste en neuroimagerie, chercheur au centre de recherche de l'ICM . J'ai situé ma présentation dans le cadre du soin avancé, c'est-à-dire de la thérapeutique. Ce sont les applications avancées de l'imagerie, telles qu'elles ont complètement bouleversé la prise en charge des pathologies neurologiques chez les patients ces dernières années. Cyril Poupon vous parlera de recherche. Je vous montrerai comment, ces dernières années, ces applications très avancées sont entrées en pratique courante dans le soin chez les patients.
D'abord, un petit rappel historique de l'imagerie cérébrale : c'est une histoire que beaucoup d'intervenants dans cette salle ont vécue. Premier bouleversement, c'est la découverte du scanner dans les années soixante-dix par Sir Godfrey Hounsfield, prix Nobel 1979. La petite histoire veut que la société britannique EMI, qui a découvert le scanner, se soit financée grâce à l'argent provenant du succès des Beatles. Il faut bien comprendre l'explosion de l'amélioration des techniques du scanner. Les premiers appareils mettaient plusieurs minutes pour faire une coupe et ne permettaient d'explorer que le cerveau. Aujourd'hui, les scanners de dernière génération permettent d'explorer le corps entier, depuis l'extrémité des orteils jusqu'à la partie supérieure du crâne en quelques secondes. Le deuxième grand progrès en imagerie arrive dix ans après, avec la découverte de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Les premières images sur lesquelles tout le monde s'ébahissait étaient souvent des images de sclérose en plaque. Pour obtenir une image, cela prenait trente minutes. Ensuite, les progrès se sont faits dans la rapidité, dans la résolution, ainsi qu'en termes de multi-modalité, c'est-à-dire qu'on a été capable de développer de très nombreuses applications différentes. Par exemple, la spectroscopie qui donne des informations biochimiques in vivo , l'IRM fonctionnelle déjà mentionnée, l'IRM de diffusion, l'IRM de perfusion, etc.
L'une des révolutions de ces dernières années, c'est le passage de l'imagerie invasive des vaisseaux qui alimentent le cerveau à l'imagerie non invasive. Auparavant, pour visualiser les vaisseaux intracrâniens en particulier, il fallait faire une artériographie. Cela demandait soit de piquer directement la carotide, soit de monter un cathéter à l'intérieur de l'artère. Le taux de complications était très significatif. Maintenant, l'imagerie est quasi non invasive, soit par l'angio-scanner, soit grâce à l'angio-IRM qui permet d'explorer les vaisseaux. Ce fut un changement très important pour les patients.
Deuxième révolution, en particulier dans la prise en charge d'une pathologie très grave et très fréquente que sont les accidents ischémiques cérébraux, c'est l'IRM de diffusion. Cette technique a été décrite par un Français, Denis Le Bihan en 1986 dans l'article Princeps. Elle n'a été vraiment appliquée que depuis ces dix dernières années, avec l'apparition de séquences extrêmement rapides. C'est la seule méthode qui permet de visualiser un accident ischémique dans les premières heures. Vous voyez sur l'écran les images de quelqu'un qui s'est bouché l'artère carotide interne droite. Sur les séquences classiques d'IRM, on ne voit rien. En revanche, sur la séquence de diffusion, on voit très clairement l'accident ischémique. Et sur l'angio-IRM, réalisée dans le même temps, on voit l'occlusion de l'artère qui explique cet accident ischémique. C'est vraiment une révolution de la prise en charge de l'accident ischémique, parce que cela permet de voir les lésions, de voir leur importance. Comme maintenant on a une attitude très agressive dans le traitement, surtout dans les premières heures de ces lésions, cela change complètement le traitement de ces patients.
Étant neuroradiologue, je parlerai de la neuroradiologie interventionnelle qui est également en plein essor. Cette partie de la neuroradiologie consiste à traiter les malformations vasculaires, en particulier les anévrismes. Dans le temps, on appelait cela des « bombes dans la tête ». En cas d'hémorragie méningée, le taux de mortalité est de 30%. Le traitement est en train de basculer complètement, du traitement chirurgical au traitement radiologique, c'est-à-dire endo-vasculaire, par la mise en place, à l'intérieur des vaisseaux, de bobines de platine qui permettent de traiter ces malformations de l'intérieur.
En ce qui concerne l'IRM, les grands progrès de ces dernières années, c'est l'imagerie multimodale, avec une application très importante dans la prise en charge des tumeurs malignes, des cancers du cerveau. Je prends l'exemple d'un patient, dont on voit très bien la lésion en séquence FLAIR - l'acronyme FLAIR provient de l'anglais ( Fluid Attenuated Inversion Recovery ) -. On la retrouve également sur une séquence classique d'IRM. Mais sur l'imagerie multimodale réalisée dans le même temps, on analyse en spectroscopie et on voit une élévation très importante du pic de Choline, qui traduit le métabolisme de la tumeur, la multiplication cellulaire, permettant ainsi de juger de son degré de malignité.
L'IRM de perfusion est un autre élément extrêmement. Sur le schéma, on voit l'hyper-perfusion de la tumeur, et c'est très important pour diagnostiquer le type de tumeur et également pour la prise en charge en particulier, avec certains traitements anti-angiogéniques que l'on va pouvoir suivre grâce à cette imagerie de perfusion.
L'IRM fonctionnelle a de très grandes applications en neurosciences, mais également des applications pratiques au quotidien pour les patients. En préopératoire, elle permet de mettre en évidence où sont les zones fonctionnelles par rapport à la tumeur. On voit par exemple une écoute d'histoire, avec la visualisation de la zone du langage temporal, et un test de fluence verbale qui met en évidence une activation de la zone de Broca. On identifie bien la position de ces zones fonctionnelles par rapport à la tumeur, ce qui permet de faire des interventions à la fois les plus totales possibles, mais également sans entraîner de déficit pour le patient.
Autre élément important, ce sont les techniques de tractographie, que l'on effectue également maintenant, et de plus en plus souvent en préopératoire, ce que demandent de plus en plus les chirurgiens. Elles permettent de suivre les grands faisceaux pyramidaux et donc de suivre le mouvement de la partie contre-latérale du corps, dont la position est suivie par rapport à la tumeur dans cette même lésion. Toutes ces techniques multimodales permettent de préparer une intervention de façon nettement plus précise que ce que l'on faisait auparavant.
L'imagerie moléculaire fait vraiment des bonds de géant à l'heure actuelle et les nouvelles molécules existent déjà, mais elles sont encore du domaine de la recherche. Cela va poser des problèmes éthiques. Dans la maladie d'Alzheimer par exemple, comme vous le savez, il y a deux types de lésions : les plaques amyloïdes et les zones de dégénérescence neurofibrillaire. On a maintenant des marqueurs TEP de la plaque amyloïde, et non seulement des marqueurs TEP, mais des marqueurs F18, c'est-à-dire que, a priori , ils devraient pouvoir être utilisés dans n'importe quel centre TEP et non pas uniquement dans les centres qui disposent d'un cyclotron et de chimie « chaude ».
Je prends le cas d'un patient atteint d'une maladie d'Alzheimer. On peut voir des zones rouges qui correspondent à toutes les zones où il y a des plaques amyloïdes. Il y a une très bonne corrélation entre l'accumulation des plaques amyloïdes et les zones d'hypométabolisme. Plus il y a de plaques amyloïdes et plus le patient a un hypométabolisme.
La problématique éthique est de deux ordres : il n'existe pas de traitement très efficace à l'heure actuelle, et en plus, toutes les données de la littérature semblent montrer que cette positivité des marqueurs de la plaque amyloïde est sûrement très précoce par rapport à la maladie, voire peut probablement s'observer chez des sujets totalement sains, ne présentant aucune pathologie, mais qui ont déjà le début de la maladie que l'on va bientôt pouvoir visualiser avec des molécules qui seront disponibles. Cela peut donc poser de très gros problèmes...
M. Alain Claeys. Par rapport à ce diagnostic aujourd'hui, qu'est-ce qui est dit au patient ?
M. Didier Dormont. Ce n'est pas moi qui explique, puisque je suis spécialiste en imagerie médicale. Je laisse cela à mes collègues neurologues et spécialistes d'Alzheimer qui disposent de tout un protocole d'approche du diagnostic, en particulier pour le patient et pour sa famille. En tous cas, j'ai choisi le cas d'un patient qui est dans un protocole thérapeutique et dans un protocole de recherche, avec un Comité de protection de la personne (CPP) 1 ( * ) etc... Je ne sais d'ailleurs pas très bien ce qu'il est prévu de leur dire, dans le cadre de ce protocole spécifique. Simplement, comme on n'a pas encore une grande certitude à l'heure actuelle sur l'efficacité de ces marqueurs, on peut quand même rester un peu dans le flou. Mais il est sûr qu'il y aura un progrès considérable dans les années futures. On aura des molécules qui nous permettront de savoir que dans tel pourcentage de cas, quand vous avez cette molécule, quand vous marquez, vous développerez la maladie. On se retrouvera dans le même type de problème qu'avec le dépistage génétique de certaines maladies, comme la chorée de Huntington, où l'on sait que certains patients, bien qu'encore sains, vont développer la maladie. Et l'on sait même à quel âge, dans certains cas.
Au niveau du législateur, des questions seront posées peut-être sur l'utilisation de ce type de marqueur. On peut imaginer des gens très anxieux, d'une soixantaine d'années, ayant des anxiétés quant à leur mémoire, et qui pourraient vouloir se faire faire ce type de dépistage. Cela pose un problème s'il n'y a pas de thérapeutique à leur proposer.
Je terminerai sur des applications qui ne sont pas tout à fait courantes, mais qui commencent à se développer à très grande vitesse. Ce sont toutes les techniques dites d'anatomie computationnelle, les méthodes qui vont permettre non plus de faire une description des images que va voir le neuroradiologue, mais de faire une analyse mathématique des images.
Voici l'exemple du logiciel développé par l'équipe du laboratoire Cogimage, par Marie Chupin, Olivier Colliot et la regrettée Lyne Garnero. Ce logiciel fonctionne sur des IRM tout à fait basiques, morphologiques, qui permettent de segmenter automatiquement l'hippocampe et de mesurer son volume. Là aussi, c'est un marqueur précoce de la maladie d'Alzheimer, puisqu'on sait qu'une chute du volume de l'hippocampe est corrélée avec un risque élevé de passage vers une maladie d'Alzheimer.
Dans le domaine des applications de recherche, une autre technique développée par Guillaume Auzias, S. Baillet et Olivier Colliot, le recalage diphéomorphe, est basée sur les sillons. Habituellement, lorsqu'on regroupe des données sur le cerveau, on a tendance à utiliser un recalage assez grossier, puisqu'il est basé sur un repérage des structures internes du cerveau. Le système de recalage diphéomorphe basé sur les sillons est une technique qui permet de recaler les cerveaux de plusieurs sujets à partir de l'anatomie de leurs sillons.
Il existe énormément d'applications de ces méthodes. À l'heure actuelle, l'imagerie fait des progrès non seulement en termes de techniques disponibles, mais également en termes de méthodes d'analyse disponibles, qui passeront de plus en plus du laboratoire à l'application clinique. Il est certain que ces types d'application, comme la mesure d'un volume de l'hippocampe, qui peut être un véritable biomarqueur de risque du développement d'une maladie, par exemple la maladie d'Alzheimer, vont passer du laboratoire aux applications pratiques.
M. Alain Claeys. Je vous remercie de cet exposé et donne la parole à M. Cyril Poupon.
M. Cyril Poupon, chef du Laboratoire de résonance magnétique nucléaire (NeuroSpin/Laboratoire d'imagerie et de spectroscopie - LRMN) au CEA. Je vais me faire le porte-parole des avancées technologiques apparues ces dernières années pour l'exploration du cerveau. En particulier, je me focaliserai sur l'imagerie par résonance magnétique (IRM) à très haut champ. Je dirige le laboratoire de résonance magnétique nucléaire du centre NeuroSpin du CEA. Dès le début des années 2000, le CEA a fait le pari que l'imagerie à très haut champ permettrait d'améliorer la résolution spatiale et temporelle.
Pourquoi améliorer cette résolution spatiale et temporelle ? Prenons l'image d'un hippocampe, une structure atteinte dans la maladie d'Alzheimer, sur un imageur conventionnel en clinique à 3 Teslas, (et notons qu'encore peu de services hospitaliers sont dotés d'IRM à 3T), et prenons la même image obtenue sur un imageur à 7T. La résolution est bien améliorée. Certes, le fonctionnement cérébral est important, mais la structure aussi a du sens, parce que la fonction se situe dans une structure la plupart du temps. Nous avons donc fait le pari à la fois d'essayer d'améliorer cette résolution spatiale pour mieux appréhender les structures, et également pour améliorer la résolution temporelle.
Le plateau technique du centre NeuroSpin nous permet, d'une part, d'avoir un imageur à 3T que nous qualifierons d'imageur clinique conventionnel, et d'autre part, d'avoir accès au seul imageur clinique doté d'un champ s'élevant à 7T en France. Le même imageur sera prochainement installé à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons décidé de nous lancer dans un projet un peu pharaonique, visant à concevoir l'aimant du futur et l'imageur du futur. En fait, nous sommes actuellement en train de construire le premier aimant doté d'un très haut champ statique de 11,7 T. C'est un projet d'importance, franco-allemand, co-financé du côté français par l'Oséo et du côté allemand par la BMFM. Son objectif d'atteindre une résolution spatiale encore plus élevée que ces 300 microns actuellement possibles à 7T, pour descendre à l'échelle de la colonne corticale autour de la centaine de micromètres.
Je voudrais également rappeler l'importance de l'imagerie préclinique. Nous avons deux imageurs, un imageur à 7 Teslas standard, l'autre est le premier prototype au monde à 17 Teslas. Son intérêt est majeur pour pouvoir établir les modèles de la structure et du fonctionnement du cerveau, mais également des modèles des pathologies cérébrales. Si l'on prend l'exemple d'une souris transgénique dotée de plaques amyloïdes, on se rend compte qu'à 7 T, on commence à deviner des plaques amyloïdes, et qu'à 17 T, elles deviennent beaucoup mieux résolues. Pourquoi augmente-t-on le champ ? Dans un premier temps, c'est véritablement pour augmenter la résolution spatiale des données d'imagerie.
Faire de l'imagerie médicale, c'est travailler dans un environnement essentiellement pluridisciplinaire, dans lequel se retrouvent des physiciens et des électroniciens, mais également des biologistes et cliniciens au contact desquels sont établis et affinés les modèles biophysiques des mécanismes du fonctionnement cérébral ou des modèles physiopathologiques des maladies neurodégénératives ou psychiatriques. Nous avons également énormément besoin de l'expertise des experts en traitement de l'image, des traiteurs d'image, des mathématiciens et des statisticiens pour mener des études de groupes. Évidemment, tout ceci se fait au service de la clinique. L'objectif est de mieux comprendre la structure saine pour potentiellement mieux comprendre la structure qui dysfonctionne.
Voici l'état de l'art de ce que nous sommes actuellement en mesure d'analyser. Je me suis focalisé sur deux modalités d'imagerie, l'imagerie anatomique et l'imagerie de diffusion. Andréas Kleinschmidt vous présentera plus tard l'imagerie fonctionnelle.
D'une simple image IRM anatomique, nous sommes aujourd'hui en mesure d'extraire tous les sillons, de les reconnaître individuellement. L'automatisation de cette tâche se révèle être une aide très précieuse pour le neurochirurgien qui doit pouvoir intervenir rapidement. Il en est de même pour toutes les structures cérébrales. Les outils de traitement de l'image qui permettent d'isoler de manière automatique toute structure cérébrale sont devenus essentiels à la pratique des neurosciences cliniques, et il s'agit à travers l'utilisation des très hauts champs d'augmenter la résolution spatiale d'un facteur d'échelle.
L'autre révolution provient sans doute de l'imagerie de diffusion au cours de la décennie passée, car elle reste la seule modalité d'imagerie qui permet d'accéder à l'information de connectivité anatomique du cerveau humain in vivo . Nous savons déjà observer l'activité du cerveau grâce à l'imagerie TEP ou l'IRM fonctionnelle; nous savons également comment mesurer les principales structures du cerveau grâce à l'IRM anatomique, mais nous étions un peu aveugles au regard de cette connectivité anatomique qui est pourtant le support de transit de l'information entre les différentes aires fonctionnelles. On sait que cette connectivité peut être parfois lésée dans certaines pathologies et l'on n'avait pas de moyen de l'analyser. L'imagerie de diffusion apporta cette pierre à l'édifice de l'imagerie médicale.
Ceci est l'état actuel des techniques qui reposent essentiellement sur des données de résolution standard et sur des outils d'analyse en traitement d'image. Mais voici ce qui se profile demain à travers l'imagerie par résonance magnétique à très haut champ. Non seulement nous serons capables de regarder le manteau cortical, mais par exemple, grâce à cette image acquise à 7 T, nous serons en mesure d'aller regarder les couches corticales. Le manteau cortical est organisé en couches, et les couches corticales ont des fonctions différentes. L'amélioration de la résolution au niveau du cortex nous permettra, d'une part, de mieux analyser la structure de ce cortex, d'en observer d'éventuelles atrophies, d'autre part, de mieux localiser la fonction à l'aide de l'imagerie fonctionnelle. Il sera alors envisageable de détecter quelle couche du cortex s'est activée et cette information pourra être mise à profit au niveau de l'étude des réseaux fonctionnels.
L'autre révolution qui est en marche reste encore à travers l'imagerie de diffusion. Pour la plupart des cliniciens, l'imagerie de diffusion, c'est la méthode d'inférence de la connectivité structurelle. Mais elle se révèle également puissante pour étudier la cytoarchitecture à l'échelle cellulaire, c'est-à-dire qu'à l'échelle du voxel on ne mesure plus simplement une intensité, qui caractérise le tissu, mais on est en voie d'être capable de mesurer une distribution de la taille des cellules. Prenons l'exemple d'une tumeur qui peut engendre un gonflement cellulaire. Si dans chaque voxel, on est capable de mesurer combien la taille des cellules a été modifiée, on est alors en présence d'un nouvel outil de biopsie virtuelle qui permettra potentiellement d'éviter le geste chirurgical nécessaire pour prélever un échantillon de la tumeur. On pourra suivre l'évolution de l'architecture à l'échelle cellulaire grâce à l'IRM. Tout ceci repose sur l'imagerie par résonance magnétique à très haut champ et sur l'utilisation conjointe de gradients puissants.
J'illustre mes propos à l'aide d'un projet collaboratif entre le centre NeuroSpin, en charge de son pilotage technologique, et l'équipe du professeur Marie Vidailhet (CR-ICM) en charge de sa coordination clinique. L'utilisation de l'imagerie à très haut champ permet de mieux caractériser les syndromes parkinsoniens. Quel est son intérêt majeur ? Prenons l'exemple d'une imagerie conventionnelle clinique d'une coupe axiale du tronc cérébral : on ne note absolument aucun contraste au niveau des structures profondes du tronc cérébral. En revanche, si l'on réalise la même acquisition à 7 T, la présence de fer dans les structures profondes du tronc cérébral induit un contraste qui les révèle. L'intérêt est évident. Pour nombre de patients parkinsoniens, l'implantation d'une stimulation profonde peut être envisagée. Avant l'émergence de l'imagerie à très haut champ, il y avait peu de moyens de localisation précise de la cible d'implantation, et la présence d'un fort contraste au niveau des structures du tronc est en voie de révolutionner la pratique d'implantation des électrodes de stimulation profonde.
Le travail du CEA en qualité d'intervenant sur l'innovation technologique a été de rendre cette imagerie exploitable. L'imagerie à très haut champ est un défi technologique et nombre de difficultés techniques sont à surmonter avant d'obtenir des images de très grande qualité et très grande résolution. Non seulement le CEA travaille au développement de nouveaux imageurs à très haut champ, mais il s'investit également beaucoup pour développer de nouveaux outils de traitement de l'image, qui permettent d'extraire automatiquement les structures du cerveau humain, les noyaux du tronc cérébral dans le cas du projet scientifique que je vous décris. En définitive, l'existence d'un binôme développement technologique/ recherche clinique est à mon avis fondamental, et représente la clé du succès de l'innovation dans le domaine des techniques d'imagerie du cerveau. L'un ne va pas sans l'autre.
L'imagerie à très haut champ repose sur de nombreuses innovations technologiques, mais également sur beaucoup d'anatomie computationnelle ou de traitement de l'image pour exploiter ces données, et faire progresser les connaissances sur le cerveau humain pour mieux le soigner in fine .
Enfin, je voudrais souligner que ce projet d'étude des syndromes parkinsoniens a été financé en partie par le monde associatif, l'association France Parkinson, l'école des Neurosciences Paris-Ile-de-France, que le professeur Bioulac citait précédemment, la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) de l'Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP-INSERM) et l'Agence Nationale de la Recherche.
Quel est le futur au niveau de l'analyse des données ? Dans le passé, les études en neurosciences cognitives ou cliniques reposaient sur de petites cohortes d'une vingtaine ou d'une trentaine de sujets sains, ou d'une vingtaine de patients. Il est fondamental de changer d'échelle. Nous avons besoin de constituer de très larges cohortes qui apporteront la puissance statistique nécessaire pour mieux comprendre l'évolution du cerveau dans toutes ses dimensions, en couvrant toutes les étapes d'évolution du cerveau de son développement in utero jusqu'à sa phase de vieillissement normal.
Pourquoi a-t-on besoin de ces larges cohortes ? Il y a une très forte variabilité structurelle et fonctionnelle du cerveau humain. De petites bases ne sont pas suffisantes. Par exemple, si l'on s'intéresse à un supposé patient, pour définir des biomarqueurs d'imagerie qui permettent de pronostiquer une pathologie, il faut que la variabilité de mesure du biomarqueur ne soit pas supérieure à la variabilité interindividuelle de la structure chez l'ensemble des sujets. Pour ceci, on a besoin d'une puissance statistique relativement élevée. Cela repose essentiellement sur la constitution de larges cohortes.
Je conclurai en vous présentant le nouveau Centre d'analyse et de traitement de l'image (CATI). Issu d'une décision du plan Alzheimer, ce centre a vocation à être une infrastructure nationale au service de l'étude par imagerie IRM et TEP des grandes cohortes nationales qui seront constituées pour mieux diagnostiquer, comprendre, pronostiquer, voire soigner les pathologies du cerveau. La codirection est partagée entre le CEA, acteur de l'innovation technologique, et l'ICM, qui vient avec toute son expertise en recherche clinique. Cette structure permettra de commencer à collecter, à l'échelle française, ces larges cohortes de données, afin d'isoler les biomarqueurs d'imagerie de la maladie d'Alzheimer.
La première mission donnée au CATI, qui va de l'acquisition jusqu'au traitement des données, concerne le pilotage, l'analyse et l'acquisition de la cohorte nationale Memento du plan Alzheimer. Il est évident qu'une structure de ce type aura tout intérêt à devenir une grosse infrastructure nationale, qui permettrait à terme de gérer les grandes cohortes nationales, dans un cadre bien défini, avec bien entendu une ouverture à toutes les pathologies du cerveau.
M. Jean-Sébastien Vialatte. Je vous remercie de ces précisions. La parole est à M Vincent Navarro ;
M. Vincent Navarro, praticien hospitalier, neurologue, chercheur au centre de recherche de l'ICM. Je traiterai des avancées spécifiquement dans le domaine de l'épilepsie, en me focalisant sur les avancées neurophysiologiques. Il y a eu énormément de progrès dans le domaine de l'imagerie structurelle, il faut savoir que pour comprendre le cerveau, son fonctionnement physiologique mais également pathologique, on a besoin de voir l'activité des cellules du cerveau que sont les neurones. L'intérêt de l'électrophysiologie par rapport à l'imagerie, c'est de pouvoir suivre le comportement du cerveau au cours du temps, avec une grande précision temporelle, et donc d'être capable de suivre l'activité des neurones à une échelle de la milliseconde, voire inférieure à cette durée.
L'autre intérêt, c'est de pouvoir suivre le comportement de ces neurones, de ces populations de neurones au cours du temps, d'avoir une mesure itérative pendant des minutes, des heures, voire des jours. Il faut concevoir que cette capacité à mesurer l'activité des neurones peut se faire grâce à des enregistrements non invasifs - ce sont des électrodes posées sur le scalp de sujets, de patients, mais également par le biais de stratégies plus invasives, intracérébrales, pour aller dans des structures profondes, inaccessibles autrement.
J'évoquerai plutôt les nouvelles technologies qui sont issues des approches intracérébrales, mais il faut savoir qu'aujourd'hui l'électroencéphalogramme (EEG) de scalp a bien évolué, grâce non seulement à la technologie, la numérisation des signaux EEG, mais aussi au couplage de ces signaux à des enregistrements vidéo, permettant des analyses beaucoup plus fines.
Aujourd'hui, les patients épileptiques peuvent être traités par des médicaments. Il existe près de 500 000 patients en France, dont 30% résistent au traitement. Il est donc nécessaire de disposer de stratégies thérapeutiques différentes, et donc d'aller chercher les zones du cerveau qui sont responsables des crises, et d'essayer d'opérer ces patients. On a donc besoin, pour arriver à cette fin, d'avoir tout un panel de technologies nouvelles, qui vont nous donner la possibilité de définir quelle est la zone à opérer.
Évidemment, on a recours à l'EEG non invasif, l'EEG de scalp. On réalise des enregistrements 24/24h, 7/7j., chez les patients, pour attendre que les crises surviennent. Les crises ne surviennent pas toujours là où on les attend. Ensuite, on a recours à toute cette stratégie d'analyse multimodale de l'imagerie cérébrale, cela a été développé auparavant. On distingue :
1) l'IRM structurelle à la recherche d'une petite lésion. Là encore, le fait d'avoir des champs magnétiques très élevés, nous permet aujourd'hui de découvrir de petites malformations qui n'étaient pas visibles il y a quelques années.
2) l'imagerie fonctionnelle, qui va nous aider à trouver le foyer, que ce soit la tomographie par émission de positons au fluorodeoxyglucose (TEP-FDG), qui peut nous montrer qu'il y a une zone en hypo métabolisme, un mauvais fonctionnement, ce qui nous attire vers la zone épileptogène, ou encore le SPECT, ( Single Photon Emission Computed Tomography (en français, tomographie computée à émission de photon unique). Pendant une crise d'épilepsie, on injecte un traceur radioactif capté préférentiellement par les régions concernées par la crise. Cette image est ensuite comparée à celle en dehors des crises d'épilepsie. L'ensemble est recalé ensuite sur l'IRM du patient, et on voit alors une zone qui se détache, c'est souvent la zone d'où partent les crises.
Parfois, au cours de ces explorations, il ne nous est pas possible de définir la zone à opérer, et donc on a recours à des explorations intracérébrales, avec des électrodes, qui sont implantées dans la profondeur du cerveau ou au niveau sous-dural, c'est-à-dire au niveau de la surface du cortex cérébral. Ces investigations, réalisées avec de nombreuses électrodes, mais dans une région déjà limitée du cerveau, nous permettent, le plus souvent, d'aller déterminer avec précision la zone, le contact, d'où vont partir les crises, et donc d'aller proposer une opération sur cette zone, tout en préservant le reste du cerveau.
La chirurgie de l'épilepsie partielle, lorsqu'elle est possible au terme de ce bilan et grâce à cette technologie, nous permettra d'obtenir une guérison, ce qui est absolument fantastique chez les patients qui pouvaient faire jusqu'à huit crises par jour. À la suite d'une chirurgie, ils peuvent être totalement guéris de leur épilepsie, et sans séquelle neurologique. Évidemment, il faut encore progresser, parce qu'il y a des situations où l'on ne peut pas proposer de chirurgie, soit parce qu'on est dans une zone fonctionnelle, inopérable, soit parce qu'il y a plusieurs foyers. Et là, il faut développer d'autres stratégies thérapeutiques, soit des stimulations électriques, soit recourir à de nouveaux médicaments.
À présent, j'aimerais vous présenter les avancées plus récentes, mais focalisées au domaine de l'exploration EEG intracérébrale. Initialement, ces enregistrements étaient analysés dans des bandes de fréquence qui étaient classiquement entre 1 Hz (1 cycle par seconde) et 30 à 40 Hz. Aujourd'hui, grâce au système de numérisation et aux amplificateurs qu'on utilise, on peut s'intéresser à des rythmes, soit extrêmement lents, soit extrêmement rapides. Jusqu'alors méconnus, ces rythmes, peuvent vraisemblablement être d'une grande aide au diagnostic de la zone à opérer. Si l'on prend un exemple d'enregistrement intracérébral avec un signal EEG, il est possible de détecter sur une seule électrode des rythmes très rapides à 250 Hz (250 oscillations par seconde), très peu amples, mais qui indiqueront quelle est la zone d'où partent les crises. Ce sont donc des situations qui nous aident, nous les cliniciens, à déterminer avec précision le foyer épileptogène.
Le développement de nouveaux outils mathématiques est l'autre point intéressant. Les signaux EEG sont complexes : des chercheurs, des ingénieurs ont développé une série de méthodes plus ou moins sophistiquées, qui nous permettent d'aller voir ce que l'oeil n'est pas capable de déterminer. Une application serait la possibilité de détecter des signes avant-coureurs de la crise d'épilepsie sur les signaux EEG, alors que lorsqu'on regarde les signaux, on ne perçoit pas de modification. Par des analyses mathématiques assez sophistiquées, dont certaines dérivent de la théorie du chaos, on peut observer des changements infraliminaires, qui pourraient être utilisés à bon escient pour alerter le patient de l'imminence d'une crise. Ce projet, que nous partageons avec plusieurs équipes depuis plusieurs années, se fait dans le cadre d'un projet européen, avec des collaborateurs allemands, portugais et italiens. L'idée étant, sur une énorme base de données d'enregistrements intracérébraux - nous avons plus de 200 patients - d'appliquer plus de 40 méthodes d'analyse des signaux différentes, afin de développer un outil vraiment adapté, qui soit à la fois suffisamment sensible et spécifique. Et peut-être, dans le futur, rêvons un peu, d'avoir un système semblable à celui d'un pacemaker , qui analyserait le signal EEG et qui alerterait en temps réel le patient de l'imminence d'une crise.
Autre point assez novateur, c'est le recours à des électrodes de très petite taille. Lorsqu'on explore en intracérébral les patients épileptiques, on utilise classiquement des électrodes qui ont un diamètre d'environ 1 mm, permettant de mesurer des activités de milliers ou de dizaines de milliers de neurones. Il est aujourd'hui possible d'insérer des faisceaux de microélectrodes, d'un diamètre de 40 microns, permettant de mesurer des populations de neurones bien plus faibles, de quelques cellules à une dizaine de cellules. Le principe étant d'insérer ces faisceaux de microélectrodes au sein des électrodes conventionnelles qui sont creuses. Ce petit faisceau de 8 microélectrodes émerge à l'extrémité interne des électrodes classiques.
Ce type d'innovation devrait peut-être aussi améliorer nos capacités à identifier des zones à opérer, et également de mieux comprendre la physiopathologie des crises. On ne comprend toujours pas comment le cerveau épileptique peut être normal pendant des heures et basculer brutalement dans la crise d'épilepsie. Le fait d'avoir la capacité, chez un sujet vivant, de suivre le comportement de quelques cellules, de quelques neurones, devrait nous fournir des informations absolument cruciales. Prenons l'exemple d'un enregistrement intracérébral avec des microélectrodes et des macroélectrodes chez un patient éveillé. On peut recueillir des activités dites multi-unitaires, c'est-à-dire que ce sont quelques dizaines de neurones qui s'expriment et qu'on arrive à suivre, pour voir des activités épileptiques se greffer sur ces comportements de neurones.
Un autre intérêt lié à l'utilisation de ces électrodes, cette fois plus axé sur la recherche, consiste à chercher à identifier plus précisément le codage neuronal de fonctions cérébrales. On a aujourd'hui cette capacité incroyable de pouvoir suivre le comportement de neurones uniques. Voyons comment se comporte ce neurone en réponse à des stimulations cognitives. Ceci se fait également grâce à toutes sortes de techniques un peu sophistiquées du traitement des signaux. Lorsqu'on a cette activité multi-unitaire correspondant à des dizaines de neurones, il est possible de faire un tri des potentiels d'action, de parvenir à retrouver un potentiel d'action spécifique qui correspond à un neurone, et de suivre son activité au cours du temps. On entend battre, non pas le coeur du neurone, mais le potentiel d'action de ce neurone, et ensuite on peut appliquer une stimulation cognitive, montrer des visages, connus ou inconnus, et voir si ce neurone va répondre. Dans un exemple de présentation effectuée chez un patient à qui l'on montre toute une série de photos de personnalités connues ou inconnues, de médecins qu'il connaissait, on observe comment se comporte le neurone. En l'occurrence, on a pu identifier que le neurone isolé répondait plutôt à l'entourage, en fait au médecin qui s'occupait du patient. La présentation dure une seconde, et l'on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu présentation de cette image, le neurone a déchargé, ce qui signifie qu'il reconnaissait l'image. En quelque sorte, on a accès à des informations assez spécifiques de reconnaissance de visages ou d'autres fonctions cognitives.
Pour conclure, je reprendrai les termes employés par M. Bioulac : quand on travaille sur le cerveau, on se doit d'avoir une approche multi-niveaux. On a vu que les microélectrodes nous permettent d'appréhender le comportement d'un neurone, mais il ne faut pas oublier que le cerveau, ce sont des milliards de neurones qui dialoguent en permanence. Il faut donc comprendre comment cette information, certes très intéressante, très focale, sur le comportement d'une cellule, s'intègre dans le cadre de ce fonctionnement global. Plus on a d'approches à des échelles différentes, plus on peut essayer de comprendre ces interactions. Le fait de pouvoir travailler chez des patients épileptiques nous permet de disposer de toutes ces échelles : l'enregistrement de scalp, qui nous donne une échelle vraiment macroscopique, globale, intégrée ; l'enregistrement intracrânien classique, qui fournit une échelle intermédiaire ; et puis ces microélectrodes, qui sont le dernier maillon de l'activité. L'ensemble de ces résultats peut être également interprété au vu parfois des données que l'on peut acquérir chez des patients qui sont opérés. Lorsqu'ils sont opérés, on peut recueillir la pièce opératoire et l'analyser au microscope, faire des tranches afin d'avoir une analyse encore plus poussée à l'échelle cellulaire. Dans notre équipe, on a pu montrer des comportements tout à fait particuliers de cellules neuronales épileptiques. On peut vraiment obtenir toute la chaîne depuis le neurone unique jusqu'à un ensemble intégré.
M. Jean-Sébastien Vialatte. Je vous remercie et donne la parole à Monsieur Sylvain Ordureau, fondateur de UsefullProgress .
M. Sylvain Ordureau, fondateur de UsefullProgress . Nous sommes une société privée dont le centre de recherche est basé à l'Université Paris Descartes à Paris. Les chercheurs, les étudiants et les professeurs, peuvent accéder à nos logiciels de visualisation 3D en ligne pour pratiquer la dissection virtuelle ou apprendre l'anatomie de manière interactive et collaborative. Des examens radiologiques (CT scan, IRM, échographie) sont à leur disposition sur n'importe quel Mac, PC ou tablette électronique (iPad). Les examens et les images produites peuvent être partagés. L'interprétation est totalement reproductible puisque les paramètres d'espace de travail sont conservés et le calcul 3D est identique en tout point. La puissance de calcul est déportée depuis notre Cloud basé à Toronto (Canada). Ainsi chacun dispose d'une chance égale d'interpréter un examen radiologique en 2D/3D pour peu qu'il dispose d'une connexion à Internet.
Le sujet de mon intervention portera sur l'IRM et de l'IRMf (IRM fonctionnelle). Plus particulièrement sur la mesure physique, l'information extraite, la reproductibilité des images et leurs interprétations notamment au niveau du cerveau. L'IRM et de l'IRMf sont toutes les deux des modalités radiologiques qui permettent de « voir » à l'intérieur du corps humain. Pour comparer les deux technologies, nous pouvons prendre l'exemple d'une vue aérienne. L'IRM peut être assimilée à une vue aérienne diurne. Elle nous renseigne sur la topographique ce qui revient à une imagerie de l'anatomie du cerveau. La vue nocturne, est comparable à la « fonction » IRMf, qui nous donne une information sur l'activité des zones survolées. Un manque d'éclairage peut montrer que le terrain est inhabité ou, qu'il y a une absence d'activité. Les lumières générées par une circulation d'automobiles peuvent donner une indication sur la densité du trafic.
C'est le propre de l'IRMf de visualiser les activités cérébrales ainsi que certaines déficiences dans les cas de pathologies du cerveau. Aujourd'hui, certains individus tentent de nous faire croire que l'on peut visualiser le cheminement de la pensée en vue d'une étude psychologique d'un patient. Comme si les lumières visibles des voitures qui circulent nous donnaient une indication sur la nature des déplacements ou de leur motif. Évidemment, nous ne savons rien de leurs activités, et nous ne pouvons conclure sur leur nature psychologique. C'est la limite physique de notre mesure. On ne peut pas prédire la psychologie à partir de l'anatomie ou même de la fonction telle qu'elle est aujourd'hui mesurée. Je parle bien sûr des machines classiques. À NeuroSpin, c'est un peu de la science-fiction pour nombre de personnes. Concrètement, un patient aujourd'hui accède en général à un des IRM à 1,5 Teslas. La médecine NeuroSpin ne lui est pas facilement accessible.
Quant à l'aspect physique de l'IRM, il consiste à imposer un champ magnétique 750 000 fois supérieur à celui du champ terrestre dans une salle confinée (cage de Faraday). Chaque atome qui nous compose tourne sur lui-même et est orienté magnétiquement (Pôle nord, Pôle sud). Les atomes d'hydrogène contenus dans les parties molles de notre corps, réagissent bien à la variation d'orientation du champ magnétique imposé par l'IRM. Cette capacité à s'orienter et à revenir à l'état initial permet la mesure. C'est un peu comme dans une boite de nuit, lorsque le DJ lance un tube musical tout le monde se met à danser. Une fois le morceau terminé chacun revient à sa place. Cependant, certains éléments peu réactifs ne souhaitent pas danser.
En IRM sur 1 million d'atomes, seuls quelques uns ne suivent pas le mouvement. C'est la résonance magnétique. Chaque élément de l'espace est ainsi mesuré. Suivant le niveau de réponse au signal magnétique imposé par l'aimant principal, une information sera stockée. Cette information sera traduite en dégradé de gris. Le blanc correspondra au liquide riche en eau, le noir correspondra à la zone composée de calcium ou d'un autre composant amagnétique. Le signal comporte un moment T1 (activation du signal) et T2 (désactivation du signal). Il existe différentes séquences d'IRM avec une combinaison de T1 et de T2 (long/court) qui donnent des images et des résultats très différents. Au niveau cérébral, cela permet de bien dissocier par exemple la substance blanche (connections, pensée inconsciente) de la substance grise (pensée consciente).
L'IRM produit des images en coupe contenant des pixels colorés en dégradés de gris. Chaque Pixel ( Picture Element ) est une information sur la qualité du signal capté dans sa zone spatiale donnée. Ensuite, l'assemblage des coupes permet de recréer un volume et par voie de conséquence, le corps du patient. Cette représentation est une abstraction mathématique. C'est le reflet d'une réalité. La précision dépend de la machine, de l'opérateur et de la préparation du patient. Le niveau de détail ne descend pas en dessous du dixième de millimètre dans le plan de la coupe. En revanche, l'espace entre les coupes est souvent supérieure au millimètre.
Ceci soulève un autre problème après celui de l'interprétation fonctionnelle et anatomique. Si je dois faire une mesure de l'épaississement du corps calleux pour une quantification hypothétique de l'apprentissage, un écart de 1,5 mm entre les tranches donne une faible précision dans la mesure. D'où un certain manque de reproductibilité des résultats. Le corps calleux ne va pas se développer sur plusieurs millimètres. L'échelle de mesure est donc insuffisante avec les IRM du marché. Nous pouvons aussi augmenter la puissance du champ magnétique pour obtenir des images plus fines. Cependant il faut prendre garde à la toxicité magnétique... Ce qui soulève encore un autre problème, celui de la dose encaissée par le patient.
Mais revenons sur le problème de la mesure du corps calleux puisque c'est l'outil de référence aujourd'hui. Suivant le seuil choisit par l'observateur pour faire la mesure nous allons obtenir des résultats différents. Il y a des risques de biais et d'erreur dans l'évaluation de la mesure. L'épaississement du corps calleux est-il dû à la diminution du nombre de neurones, ou à une modification de la vascularisation, ou à l'augmentation des fibres nerveuses? Ce sont les questions que l'on se pose encore, puisque l'on n'a pas la définition suffisante pour y répondre. Pour donner une signification au résultat, il faudrait faire des prélèvements ou alors utiliser des machines encore plus précises. On est encore très loin du compte.
Concernant l'IRMf, la télévision nous a montré un bon nombre de sujets « fantaisistes», où certains « chercheurs » prétendent aujourd'hui voir dans le cerveau, les zones de l'amour, etc. Essayons de comprendre comment ces chercheurs sont arrivés à ce genre de conclusions pour le moins saugrenues. Le patient est placé dans une machine IRMf. Cette machine est extrêmement bruyante. On lui envoie des stimuli, des images, des sons ou des questions. Le contexte est totalement expérimental. Comment sortir des informations précises de ces machines-là, en dehors du contexte scientifique? Ensuite on récupère le signal et on va superposer la fonction enregistrée sur un cerveau moyen, c'est à dire un modèle de cerveau qui n'est pas celui du patient. L'anatomie vient de l'IRM, pas de la fonction. C'est pourquoi il n'est pas rare devoir des signaux apparaître à l'extérieur de la surface cérébrale. Alors comment être certain qu'un signal est décelé sur tel ou tel sillon si ce n'est pas l'anatomie du patient lui-même? Cela revient à prendre une photo d'une ville la nuit que l'on superposerait avec la carte d'une ville « moyenne » ou la même ville des années auparavant.
Les images obtenues sont des comparaisons d'activations suivant un stimulus. Il existe une variabilité anatomique plus ou moins importante entre chaque patient. Vous avez sans doute vu cette image, en 2007, d'un patient qui souffrait d'une encéphalite exceptionnelle par la taille (le liquide céphalo-rachidien avait plaqué la masse cérébrale sur les parois du crâne). Si vous appliquez à ce patient des protocoles classiques de l'IRMf, on n'a plus du tout le même repère. C'est toute la limite de l'atlas cérébral pour recaler les images. Dans ce cas précis, le patient souffrait juste d'une faiblesse de la jambe gauche. Bien que différent, cela ne l'empêchait pas de vivre et ni d'avoir un QI normal. Cela montre « la plasticité cérébrale ». Le cerveau a cette capacité de se développer tout au long de notre vie. En chirurgie, cela permet justement d'attaquer certaines zones sans altérer les fonctions.
En résumé, nos outils d'imagerie actuels permettent de visualiser dans l'espace les fonctions et l'anatomie du cerveau. C'est une aide au chirurgien pour préparer ses interventions, et un vecteur de communication entre le patient, le radiologue et le spécialiste. C'est à la portée de tous. Mais, nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'aller au-delà. Nous ne pouvons déterminer la psychologie d'un individu à travers nos outils actuels. Et quand bien même nous disposerions d'appareils plus puissants, il faudrait écrire une nouvelle sémiologie, c'est-à-dire une nouvelle interprétation des images obtenues. Nous ne soignons pas les images mais bien les patients.
M Alain Claeys. Je vous remercie de cet exposé et j'ouvre le débat.
DEBATS
M. Yves Agid, membre fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), professeur de neurologie, membre de l'Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d'éthique (CCNE). Je souhaitais répondre à la question de M. Claeys : que fait-on quand on trouve quelque chose chez quelqu'un qui est dans un protocole de recherche ? Que dit-on au malade ? Je ne sais pas où en sont les législateurs, mais j'ai trouvé des articles, dont je n'ai plus tout à fait les termes exacts, mais qui m'ont paru être une base de travail assez intéressante. Au fond, dès lors que les personnes ont donné leur consentement, on se retrouve face à quatre situations.
- L'IRM cérébrale est normale ; à ce moment-là, il ne se passe rien de spécial.
- On trouve une petite anomalie, dont on sait qu'elle n'est pas évolutive. C'est un peu comme d'avoir un bouton sur le nez, on a cela de naissance et c'est tout. La proposition est de ne rien dire.
- On découvre une anomalie sur laquelle on hésite un peu. Elle a l'air bénigne, elle n'a pas l'air grave, mais cela demanderait peut-être une exploration. À ce moment-là, on rassure le patient. On lui explique: « écoutez, il vaudrait peut-être mieux faire une IRM de comparaison, je vous conseille d'aller voir votre médecin. »
- On trouve par exemple un gliome, une tumeur potentiellement évolutive. À ce moment-là, et ce doit être écrit dans le consentement, on prévient le patient, on organise une visite médicale.
C'est une procédure. Je ne sais pas si cela existe au plan législatif, mais je trouve que c'est une bonne base de discussion.
M. Olivier Oullier, professeur de psychologie à l'Université d'Aix-Marseille, conseiller scientifique au Centre d'analyse stratégique . Un commentaire du point de vue du non-médecin qui doit faire face à ce type de situation au cours d'une de ses expériences utilisant l'IRM fonctionnelle. C'est-à-dire quand, avec le médecin obligatoirement présent, nous découvrons ce genre d'anomalies sur les images cérébrales anatomiques.
Lorsque nous soumettons les protocoles expérimentaux au comité d'éthique de l'organisme promoteur de la recherche, puis au Comité de protection des personnes (CPP) et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), il est écrit dans les formulaires de consentement éclairé, que les volontaires ne peuvent participer aux expériences qu'à la condition d'accepter d'être informés en cas de découvertes d'anomalies sur les images cérébrales anatomiques. Cela nous est imposé par le CPP.
Mais au delà de l'aspect purement légal, je souhaiterais aussi aborder la situation « humaine » dans laquelle se retrouve la personne qui n'est pas médecin, et qui donc n'a pas la compétence, ni le droit d'informer son sujet qui sort du scanner sur ce qu'il vient de détecter. Lorsque vous vous trouvez face à une personne dont la première question en sortant du scanner IRM, après avoir participé à une expérience, est généralement : « est-ce que tout va bien ? » et que vous êtes obligé de la regarder, et de lui répondre sans l'informer, c'est une situation inconfortable. Et encore, l'inconfort du scientifique n'est rien en comparaison de ce qui va se passer pour cette personne. Dans ce cas-là, nous en référons, comme évoqué, au médecin présent qui est porteur du protocole auprès des instances éthiques et de protection des personnes.
Il y a vraiment une réflexion à mener d'un point de vue humain, éthique et législatif, sur ces situations dans lesquelles la condition médicale du participant à l'expérience change au cours de l'expérience. Il est considéré comme un sujet sain, d'un point de vue neurologique, en début d'expérience et, suite aux anomalies découvertes sur les images anatomiques, il devient patient pour le médecin, porteur du projet de recherche. La réflexion notamment sur une préparation à gérer au mieux l'aspect humain de ces situations est nécessaire pour le volontaire tout d'abord, mais aussi pour toutes les personnes qui seront présentes.
M. Alain Claeys. Dans ces centres d'imagerie cérébrale, quelle est la place fonctionnelle du médecin par rapport à l'équipe d'une façon générale ? Je crois qu'on avait abordé ce sujet lorsqu'on avait visité les installations du centre NeuroSpin au CEA. Y a-t-il obligation d'un médecin dans l'équipe ? Comme cela se passe-t-il ?
M. Cyril Poupon . À l'arrivée, qu'il s'agisse d'un volontaire sain ou d'un patient, il est reçu par une équipe médicale dotée d'infirmières, de manipulateurs radio. Il subit un interrogatoire avec un médecin. Tous les médecins qui suivent les protocoles se trouvent listés dans les CPP. Tout est donc fait dans les règles de l'art. Puis, le médecin qui l'a inclus dans le protocole de recherche, qui a accepté qu'il passe un examen IRM, le revoit à la sortie. À noter également que les données d'imagerie anatomiques sont systématiquement revues par un radiologue qui peut être amené à reconvoquer le sujet en cas d'anomalie détectée. En notre qualité de scientifiques non cliniciens, nous devons respecter les règles d'éthique qui imposent la présence obligatoire d'un médecin d'inclusion in situ qui assure l'ensemble de ce suivi, tout en respectant le secret médical.
M. Hervé Chneiweiss . Juste une question sur la « neurologie prédictive » pour prolonger ce point et avoir l'avis des différents intervenants. Les machines vont se développer. Effectivement, aujourd'hui il y a encore peu d'IRM 3 Teslas, mais il y en aura beaucoup dans le courant qui vient. D'autres techniques vont se généraliser. Par exemple, la technique de visualisation des plaques amyloïdes, avec le 18F ou le 18FDG, deviendra disponible. Or on rentre là dans une dimension de la médecine prédictive qui est incertaine, surtout par rapport au fait que l'on sait, en autopsie post-mortem , que la plupart des personnes âgées présentent des plaques sans que cela soit symptomatique d'une maladie d'Alzheimer. Comment allons-nous gérer, en termes de santé publique, de demande du public d'accès à un examen, de prise en charge si l'on doit prendre en charge tous les patients chez qui l'on a détecté des plaques ? Comment voyez-vous la gestion de l'accès à l'examen et de ses conséquences ?
M. Jean-Sébastien Vialatte . En quelque sorte, vous envisagez cet examen, à moyen terme, comme un moyen de dépistage courant.
M. Hervé Chneiweiss . Je pose la question : prédiction ou « prédictologie »? Je pense qu'on est devant un problème, qui a été un peu suggéré : vieillissement normal/vieillissement pathologique. C'est une question, aujourd'hui, on se trouve encore dans une incertitude scientifique. Parallèlement, des machines deviendront disponibles. Aujourd'hui, elles sont en nombre restreint, et plutôt dans des hôpitaux publics ; demain, elles seront accessibles dans différents centres. Et puis, en dehors des machines, il y a des techniques. Par exemple, il y a la technique d'utilisation de marqueurs. On se situe là dans un cas différent de celui de la chorée de Huntington, où malheureusement, dès lors qu'on a le diagnostic de la mutation, l'on sait que tôt ou tard, avec une incertitude de trois à cinq ans, la personne développera la maladie. Si l'on a une mutation du gène BRCA1, on sait que tôt ou tard la personne aura un cancer du sein ou de l'ovaire, ou les deux. On est là dans des éléments qui sont vraiment à visée diagnostique.
En neurosciences du vieillissement, des maladies dégénératives, on se trouve dans une dimension aléatoire, avec une potentialité. Et j'ouvre la question, parce que c'est un énorme problème en termes de santé publique. Est-ce qu'on mettra toute la population sous surveillance ou sous examen ? Peut-être d'ailleurs, parce que quand M. Cyril Poupon parle de normativité, en essayant d'avoir une cohorte de cerveaux, il y a la cohorte à un instant T, mais est-ce que la variabilité individuelle entre le moment où l'on a vingt ans, quarante ans, soixante-dix ans, sera prise en considération ? Et qu'en est-il de la plasticité du cerveau ? Voyez les questions que pose, en termes de santé publique, l'accessibilité ou l'encadrement de l'accessibilité à ces examens.
M. Yves Agid. Je crois que la question d'Hervé Chneiweiss a deux aspects. Il y a d'abord le problème du passage du normal au pathologique. Qu'est-ce que le vieillissement cérébral ? Qu'est-ce que le vieillissement en général ? Mon idée, c'est qu'il n'y a pas de vieillissement normal. Le vieillissement est différentiel. Vous avez des centenaires qui ont la peau d'une femme de vingt ans et qui ont perdu la tête, et vice-versa. Le cerveau est tellement compliqué par rapport au reste de l'organisme car chaque petite partie du cerveau vieillit à des moments différents. Quand on a cent ans, on a forcément des quantités de parties du cerveau qui fonctionnent moins bien, même si on a l'air apparemment normal. La limite entre les deux est très difficile à voir. Par exemple, on sait très bien que de nombreuses personnes ont beaucoup de plaques séniles et ont une mémoire tout à fait normale, ils n'ont pas de maladie d'Alzheimer. Je pense qu'on fera des progrès. Mon attitude, c'est de s'en tenir à la clinique et au contexte social. C'est l'art du médecin.
La deuxième question posée est dramatique. C'est le problème éthique de l'imagerie. Il y aura tellement d'IRM, du fait de la multiplication des centres d'IRM car Messieurs les députés,-j'en profite pour le dire-, il paraît qu'on est assez en retard en France par rapport à d'autres pays européens... Mais cela évoluera, et on aura à disposition des IRM cérébrales, un peu comme on faisait des radios de poumons autrefois. Rappelez-vous, à la médecine du travail, tout le monde avait une radio des poumons, c'est fini maintenant, je crois car il n'y a presque plus de tuberculose ici. Les centres d'IRM vont donc se multiplier. Or la différence entre une radio des poumons et une IRM, c'est que la radio de poumon, on vous la donnait et vous en faisiez ce que vous voulez, alors que l'IRM est sur informatique, posant le grand problème des banques de données, notamment dans les hôpitaux, mais aussi ailleurs, dans les centres de recherche, etc., avec une accessibilité en principe fermée. En principe, mais je vais vous raconter une anecdote. J'ai rencontré un médecin qui recevait un patient, le patient lui explique qu'on lui a fait une IRM quelque part, le médecin lui répond : « ce n'est pas un problème. » Il manipule son petit ordinateur, il entre dans les banques de données des hôpitaux de Paris je ne sais pas comment, et il voit l'IRM... Didier, j'espère que cela ne vous arrive pas trop souvent !
M. Didier Dormont . Cela m'étonnerait énormément qu'il soit rentré dans la banque de données des hôpitaux de Paris.
M. Yves Agid . Peut-être pas les hôpitaux de Paris, ce n'est pas une attaque personnelle.
M. Didier Dormont . Je pense qu'on fait allusion à quelque chose de très particulier. On est devant les représentants du peuple. Il ne faut dire que des choses certaines. Je sais que certains centres privés, au lieu de donner un CD sur lequel se trouvent les données, donnent la possibilité au médecin prescripteur d'accéder aux données de l'IRM de son patient. C'est peut-être ce cas-là. Dans tous les cas, en ce qui concerne la banque de données de l'AP-HP, vraiment, il est impossible d'y avoir accès de l'extérieur.
M. Yves Agid . Je retire donc ce que j'ai dit. Mais c'était un problème philosophique que je voulais poser. Le problème de la multiplication de l'accessibilité à l'IRM, de sorte qu'il se pose une question, soit de suppression des sources, soit d'anonymisation comme on le fait en génétique. Il y a une grande analogie entre les problèmes de la génétique des années soixante quinze et ceux de l'IRM cérébrale maintenant, avec la puissance que vous avez vue.
M. Cyril Poupon . Je voulais juste préciser que dans ces centres de recherche, nous sommes bien évidemment soumis au règlement de la CNIL et toutes les données sont anonymisées, sauf pour le manipulateur radio et l'équipe médicale. À titre d'exemple, lorsque je procède à un examen IRM, je connais des codes qui ne sont jamais le nom, ni le prénom, ni la date de naissance. Ce n'est pas le cas des centres hospitaliers qui n'ont pas cette contrainte.
M. Didier Dormont . Juste un petit détail sur le secret médical. Dans le passé, avant l'arrivée de l'informatisation, un individu mal intentionné aurait sans doute pu en revêtant une blouse blanche avoir accès par effraction, à des éléments de dossier de certains patients, dans certains services hospitaliers.
M. Alain Claeys . Ce que vous dites n'est pas rassurant.
M. Didier Dormont . Je parle de ce qui aurait pu arriver dans le passé. Ce type de problème ne me semble plus possible à l'heure actuelle du fait de la grande amélioration de la sécurité dans les hôpitaux et de la mise en place de nombreuses procédures pour améliorer le respect de la confidentialité.
M. Yves Agid . Cependant, la différence avec le passé, réside dans l'informatisation, c'est-à-dire les banques de données informatisées.
M. Didier Dormont ...Mais qui sont maintenant complètement anonymisées.
M. Bernard Bioulac . La question sera de savoir si véritablement, on arrivera à une situation dans laquelle la médecine prédictive deviendra une réalité quotidienne ce qui est vraisemblable. Reste à savoir si à ce moment-là, on s'en remettra à l'éthique de la pratique médicale, à l'éthique des médecins, ou s'il faudra un encadrement minimal législatif. C'est un débat récurrent. On l'a fait pour les dossiers médicaux. Cela faisait partie d'ailleurs de la première loi sur la bioéthique, à savoir l'extension à la loi de 1978 Informatique et Liberté. Que faudra-t-il faire ? Restera t-on purement pragmatique à l'anglo-saxonne, le médecin face à sa conscience, sachant ce qu'il doit dire ou ne pas dire, ou alors, envisagera-t-on un encadrement minimal ou maximal, avec l'utilisation des données nominatives. Le problème est là.
M. Hervé Chneiweiss . Certes, il faut toujours faire la part des choses, mais cela concerne aussi le législateur. Une des dimensions essentielles aujourd'hui de la recherche, que ce soit en imagerie ou en biologie moléculaire, c'est la capacité d'intégrer les données. Alors il faut le faire en respectant l'anonymat des patients, puisque quand on rentre un échantillon, on anonymise, tout en étant capable d'annoter à tous les niveaux, c'est-à-dire d'annoter une image avec la clinique, d'annoter une séquence génétique, et demain le génome entier avec l'imagerie, avec l'anatomopathologie. Je pense à ma chapelle particulière pour les tumeurs cérébrales.
La question de la recherche de données sur les cohortes est très importante, que ce soit les cohortes évoquées par Cyril Poupon, que ce soit l'une des plus grandes au monde dont on dispose en France, la cohorte 3C, constituée depuis près d'une vingtaine d'années sur trois cités, et qui a suivi les personnes au cours du temps. Tout en respectant l'anonymat des patients, parce qu'ils deviennent un échantillon de l'étude, la question reste d'être capable d'annoter les échantillons et d'effectuer un suivi. C'est une mine de découvertes à une échelle infiniment supérieure à ce qui a été fait dans le domaine cardiovasculaire avec l'étude de Framingham qui a complètement changé la façon de faire de la médecine à partir des années cinquante. L'étude de Framingham, c'étaient 40 000 personnes d'une ville suivies pour leurs risques cardiovasculaires. Aujourd'hui, on a besoin de faire cela aussi dans le domaine des maladies neurologiques et des maladies psychiatriques, on a besoin d'annoter. Au nom de la sécurité, ou de la protection de la vie privée des personnes, il ne faut pas élever des barrières telles que l'utilité des cohortes, la recherche et l'impact que cela peut avoir sur la santé publique, en soient perturbés.
M. Cyril Poupon . Je voulais juste préciser également que toute personne qui entre dans une cohorte a possibilité de se retirer de cette cohorte à tout moment.
M. Sylvain Ordureau . Mon bureau est placé à côté de celui du don des corps à la faculté de médecine de Paris. On reçoit des patients très particuliers, puisqu'ils donnent leur corps à la science une fois qu'ils sont décédés. Aujourd'hui, on accède à énormément de données radiologiques, qui évitent la dissection réelle, mais passent par la dissection virtuelle. Les 8000 étudiants de la faculté de médecine de Paris peuvent accéder à cette base de données, anonymisée, qui permet d'obtenir une grande variabilité de l'anatomie. On voit des aortes qui ont des formes assez bizarres. On s'aperçoit qu'il y a une grande variabilité dans le corps.
Le deuxième point, c'est la toxicité magnétique. Il faudra aussi fixer la limite de la dose au niveau du scanner. Si on passe un grand nombre de personnes, il faut vraiment envisager la toxicité magnétique avant tout. On utilise du 1,5 Teslas, on passe à du 3T, et on va vers du 7T. Que se passe-t-il ? Comme vous le savez, il y a un peu d'électrochimie dans le corps humain. À chaque fois qu'on passe des doses magnétiques, il se passe des choses, forcément.
Enfin, je travaille aussi sur le problème de l'obésité. Le gouvernement a lancé un plan obésité. L'idée, c'était de la mesure physique encore une fois. Pour les obèses, on a la balance, on dispose des balances Tanita avec électronique, cela ne sert à rien du tout, mais ce n'est pas grave... On constate qu'au niveau de la mesure, on n'est pas à jour. La seule mesure valable, c'est le scanner ou l'IRM. L'IRM, c'est 20 minutes, le scanner, c'est 4 secondes. Donc on va utiliser le scanner car l'avantage du scanner, c'est qu'on fait un examen complet. On va donc observer beaucoup d'éléments. On peut voir des petites pêches dans le poumon, ou des petites lésions dans le foie. Dans ce cas-là, on est obligé de délivrer un compte rendu au patient. Il y a toujours un clinicien avec nous. On travaille avec des cliniciens à ce sujet. Pour les sujets obèses, comme pour les cas évoqués ici, je pense qu'il va falloir des phénotypes. On ne dispose pas de phénotypes d'obèse aujourd'hui. Vous êtes en surpoids, vous êtes gros, ou trop gros, mais il n'y a pas de phénotype. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la répartition de la graisse est vraiment capitale. Cela pourrait même déterminer le phénotype de certaines personnes. Donc une meilleure mesure, un meilleur diagnostic, et donc un meilleur traitement pour éviter les récidives.
Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, si un jour on s'oriente vers une médecine prédictive, il faudrait se calquer aussi sur ces modèles-là, en utilisant toutes les cohortes disponibles. Nous avons une base de données assez gigantesque de cas, sur lesquels on a demandé aux patients de donner leur corps virtuel à la science. Cela peut servir à l'enseignement, mais aussi au phénotypage dans le futur.
M. Jean-Sébastien Vialatte . Je vous remercie, nous abordons maintenant la deuxième table ronde : « l'impact des avancées sur l'exploration et le traitement du cerveau ».
L'IMPACT DES AVANCÉES SUR L'EXPLORATION ET LE TRAITEMENT
M. Jean-Sébastien Vialatte. Nous abordons maintenant la deuxième table ronde : « l'impact des avancées sur l'exploration et le traitement du cerveau » le Professeur Philippe Vernier qui préside la société française de neurosciences a la parole.
M. Philippe Vernier, professeur de neurologie, directeur de recherche, président de la Société française de neurosciences . Je voudrais commencer par redire que la communauté française des neurosciences est importante, tant en nombre qu'en qualité. Elle représente en effet à peu près 22% de la recherche en biologie en France et jouit d'une reconnaissance internationale incontestable. Nombre de nos chercheurs sont mondialement connus dans leur discipline.
La Société française de neurosciences (SFN) représente l'ensemble des neurosciences françaises, dont le champ est très vaste. Il va de la biologie du développement du système nerveux aux sciences cognitives, et il partage des frontières aussi bien avec la physique, les mathématiques ou la chimie qu'avec les sciences humaines et sociales, la philosophie par exemple. Il est important de considérer les neurosciences dans leur ensemble, car comme l'a bien rappelé Hervé Chneiweiss, l'unicité du cerveau est une découverte historique mais récurrente. On redécouvre régulièrement que le cerveau est un organe d'une grande cohérence interne dont le caractère est indissociable de la pensée.
Par exemple, la dichotomie entre la psychiatrie d'un côté et la neurologie de l'autre, en France ou dans d'autres pays du monde, a fait du tort à ces disciplines, en introduisant une frontière artificielle entre les approches des pathologies cérébrales. Il est essentiel de considérer le cerveau et le système nerveux dans leur ensemble. À cet égard, la SFN, qui représente l'ensemble des neurosciences, peut être un interlocuteur privilégié pour vous, messieurs les députés. C'est une communauté scientifique qui est bien organisée, comme l'a expliqué Bernard Bioulac, avec une concentration des équipes de recherches dans des centres bien identifiés, et cette concentration est garante de la qualité des travaux qui peuvent y être effectués.
La raison principale de mon intervention sera de redire les enjeux majeurs que représente cette discipline. Je crois que vous avez rappelé que l'Organisation Européenne des Sciences pour le Cerveau, l' European Brain Council , dont la SFN fait partie, a conduit en 2006 la première étude européenne sur l'impact des maladies du cerveau sur nos sociétés, du point de vue économique et social 2 ( * ) . Elle vient de terminer une étude sur les grands enjeux et les impacts les plus importants des neurosciences dans les dix années à venir. Le document est déjà public et doit être présenté au Parlement européen à la rentrée prochaine 3 ( * ) .
Quels sont les grands enjeux qui ont été identifiés ? Ce sont en tout premier lieu, les questions de développement cérébral et de plasticité du cerveau tout au long de la vie, y compris les mécanismes de son vieillissement, normal et pathologique. Aujourd'hui on sait que la biologie du développement cérébral est un champ de recherche considérable pour comprendre un grand nombre de pathologies, en particulier les maladies psychiatriques. Ce qui n'est pas partout clairement exprimé c'est qu'une pathologie résulte toujours de facteurs multiples, intrinsèques, génétiques par exemple, et environnementaux, dont la confrontation conduit à une réponse inadaptée de l'organisme.
L'environnement physique et social influe de manière déterminante sur le développement du cerveau, cette influence dépendant du moment où elle se produit. On n'aura pas les mêmes effets si un composé toxique ou une modification de l'activité des neurones survient très tôt au cours de l'embryogénèse, ou s'il intervient beaucoup plus tard au cours du développement, y compris dans la petite enfance. Les effets délétères peuvent être extrêmement sévères si un facteur environnemental ou social agit très tôt au cours du développement du cerveau, alors qu'ils sont souvent moindres ultérieurement.
Il est des périodes critiques dans le développement cérébral dont on sait aujourd'hui que la perturbation peut provoquer des pathologies, les plus connues étant le déficit d'attention avec hyperactivité, dont le diagnostic a d'ailleurs parfois été exagérément porté dans certains pays comme les États-Unis, les différentes formes d'autisme, ou certaines formes de schizophrénie. Cet impact de l'environnement sur le développement cérébral est essentiel à prendre en compte, en particulier quand il s'agit de mettre en avant la dimension prédictive des découvertes en génétique humaine.
Les facteurs génétiques sont des facteurs de risque comme les autres, plus ou moins grands selon les cas, mais il n'existe presque jamais pas de déterminisme direct d'un facteur intrinsèque, génétique ou extrinsèque, environnemental, sur le développement d'une pathologie donnée. C'est pourquoi, il est essentiel de que l'approche des pathologies conserve sa dimension proprement médicale, la seule capable de faire la part des facteurs de risques et de l'histoire individuelle de chaque patient.
Un second enjeu majeur pour les neurosciences, est la relation entre la structure et la nature des fonctions cérébrales et le développement de pathologies neuro-dégénératives et psychiatriques. Il n'y a pas d'un côté des maladies de l'esprit et de l'autre des maladies du cerveau. Toute pathologie cérébrale peut affecter la façon qu'à chaque individu « d'être au monde », son comportement au sens large. La grande question reste aujourd'hui, comme au temps de Claude Bernard de comprendre comment les modifications de l'anatomie et du fonctionnement cérébral peuvent affecter nos comportements et comment y remédier. Il faut encore insister ici sur le coût des maladies du cerveau et en particulier sur le fait que les maladies psychiatriques constituent dans notre pays, comme dans la plupart des pays occidentaux, l'une des parts les plus coûteuses de la santé publique. Ceci doit être mis en parallèle avec le très faible effort de recherche en psychiatrie en France en particulier, mais aussi dans la plupart des pays occidentalisés 4 ( * ) .
M. Alain Claeys. La France est-elle en retard par rapport à d'autres pays ?
M. Philippe Vernier . Oui, notamment par rapport aux États-Unis, à l'Allemagne et au Royaume-Uni. C'est un constat général, mais notre pays a plus souffert que d'autres de la dichotomie entre psychiatrie et les autres domaines des neurosciences, en particulier la neurologie. Encore une fois, on a trop longtemps agit comme s'il y avait d'un côté le cerveau, de l'autre l'esprit.
M. Alain Claeys. Partagez vous tous cet avis ?
M. Hervé Chneiweiss. C'est l'essentiel pour nous tous. Il existe un organe qui est le substratum de toute pensée. Que ses réseaux de cellules permettent l'émergence de la pensée reste essentiellement un mystère. Il existe une interaction forte et constante avec l'environnement, qui ne permet jamais de démêler les facteurs intrinsèques des facteurs environnementaux. Il est évident qu'il faut étudier tous ces facteurs sans aucun ostracisme ni aucun tabou, et les étudier d'un point de vue matériel n'a rien de choquant.
M. Philippe Vernier . Les philosophes le disent depuis l'Antiquité, la pensée a une base matérielle, le cerveau, le cerveau dans un corps. La véritable question est de déterminer comment les facteurs intrinsèques de la construction et du fonctionnement cérébral agissent. La construction du cerveau est un processus éminemment complexe avec des propriétés particulières émergeant à chaque niveau d'organisation, qu'il soit moléculaire, cellulaire ou plus intégré, du réseau de cellules jusqu'à l'organe entier. L'un des enjeux est de comprendre comment à partir des propriétés élémentaires de chacun des composants du système nerveux, ces propriétés émergent dans l'organisme. Un autre enjeu majeur est de comprendre comment l'environnement interagit avec cette organisation, et sur ce point, on n'a que peu progressé.
On pourrait prendre l'exemple de la douleur, domaine encore très mal connu, paradoxalement. Des recherches récentes ont montré que nous sommes très inégaux face à la douleur et on ne sait pas vraiment pourquoi. Il semble que les seuils de perception des stimuli douloureux varient d'une personne à l'autre, que l'apprentissage du sens et de la réponse à la douleur soit fortement culturel, mais ces données nouvelles n'ont pas encore trouvé d'applications dans le domaine médical. La prise en charge de la douleur demeure insuffisante et insatisfaisante.
Les recherches en matière de prévention des handicaps, de toute nature, ainsi que de traitement du risque pathologique, la mise en oeuvre de méthodes de réhabilitation psychologique et physique, sont indigentes en France et dans le monde, comme s'il s'agissait d'un sujet tabou, et ce bien que le coût sociétal en soit considérable. L' European Brain Council a appelé l'attention des pouvoirs publics sur ce point. Pour ce qui est du domaine du diagnostic et de la thérapeutique, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que mes collègues ont dit.
Je voudrais revenir sur la double illusion que le cerveau donne à penser ou à mal penser à la fois au chercheur et au médecin. D'un côté persiste ce dualisme vain entre cerveau-pensée, mais de l'autre se répand dans les média l'idée qu'en comprenant mieux les mécanismes de fonctionnement du cerveau, on pourrait arriver à prédire nos comportements et lire nos pensées. On en est loin, malgré le caractère spectaculaire de certaines expériences. Il faut se garder de ces dérives de raisonnement, et cette double erreur du cerveau duel et du cerveau déterminé doit être bien comprise et gardée à l'esprit.
Je souhaitais aussi attirer l'attention sur un aspect important de l'organisation et du financement du système de recherche français. La recherche sur le cerveau est aujourd'hui principalement internationale, et c'est une dimension que notre pays ne prend pas assez en compte. Les chercheurs travaillent en réseau avec leurs collègues étrangers, et beaucoup de projets sont en réalité transnationaux. Notre recherche est connue et reconnue, mais notre pays n'est pas assez attractif. L'organisation de la recherche en France est incompréhensible hors de nos frontières : sa complexité la rend illisible et son financement est trop fragmenté. Pour attirer de jeunes chercheurs, il faut rassembler des fonds en provenance de sources très diverses. Nous ne pouvons pas offrir des packages comme en proposent les pays anglo-saxons. C'est un handicap. Nos chercheurs en revanche sont très attirés par l'étranger, qui offre souvent de meilleures conditions d'exercice, des salaires plus élevés, surtout pour les chercheurs confirmés, et la compétition ne se fait plus à armes égales.
Je souhaiterais enfin insister sur un autre enjeu crucial, c'est l'absolue nécessité de préserver les expérimentations animales. La quasi-totalité de la recherche en neurosciences se fait chez l'animal. Nous avons besoin d'animaleries bien organisées, régulées. Pour comprendre les mécanismes fondamentaux de fonctionnement du cerveau, organe éminemment complexe, on dispose aujourd'hui de modèles animaux (la souris, le poisson zèbre, la mouche drosophile...) permettant d'appréhender cette complexité dans ses dimensions spatiale (du nanomètre au centimètre) et temporelle (de la milliseconde à l'année). Pouvoir analyser, simultanément et en temps réel, l'effet de molécules sur des organismes vivants est essentiel pour comprendre les effets chez l'homme, par exemple. La question des modèles animaux est l'une de celles sur lesquelles achoppent aujourd'hui la recherche, fondamentale ou appliquée, et la recherche thérapeutique en particulier. L'effet de certaines molécules à visée thérapeutique doit être testé d'abord chez l'animal.
La législation européenne recommande de se passer des animaux lorsque c'est possible, c'est-à-dire tant qu'on peut obtenir les mêmes résultats in vitro , mais l'organisme, par ses propriétés émergentes n'est pas réductible à ses molécules ou à ses cellules. Il faut donc à un moment ou à un autre de la démarche thérapeutique pouvoir procéder à des tests in vivo . De plus, aujourd'hui, nous manquons de bons modèles animaux des pathologies humaines. Si on a tant de mal à développer des traitements de la maladie de Parkinson, c'est avant tout parce qu'il n'existe pas de bon modèle de cette maladie neurodégénérative, non plus que pour tant d'autres. Les recherches dans cette voie doivent donc se développer.
La question des modèles animaux est essentielle parce que les méthodes de la biologie évoluent. L'étude du système nerveux, de statique, est devenue dynamique. Jusqu'à très récemment les résultats des expériences se traduisaient par des images fixes, qu'il s'agisse de données biochimiques, anatomiques ou physiologiques. Mais les images ne disent jamais plus qu'une bonne métaphore. Selon le mot de Clausewitz, « la carte n'est pas le territoire », et chaque image doit être interprétée pour pouvoir en corréler les données avec une réalité biologique. Aujourd'hui, les techniques permettent de voir et de manipuler in vivo , en temps réel, les molécules, les cellules, les tissus.
Il n'y a que chez l'animal que l'on peut mener l'intégralité des investigations permettant de passer de l'échelle cellulaire à l'échelle des comportements globaux, voire de l'animal entier, avec les cinétiques spatiales et temporelles nécessaires à la compréhension des phénomènes biologiques. La modélisation des phénomènes chez l'animal permet aussi de les corréler aux images obtenues chez l'homme par IRM fonctionnelle par exemple. Ce continuum entre recherche fondamentale et appliquée exige d'améliorer l'organisation de la recherche et de prendre en compte en même temps les enjeux éthiques et scientifiques.
M. Alain Claeys . J'ai une question sur les modèles animaux. Au-delà des risques de directive européenne, quelles sont les difficultés qu'on rencontre au niveau de ces modèles ?
M. Philipe Vernier . Bernard Bioulac pourrait en parler sans doute mieux que moi. Il y a deux types de problèmes. Le premier, qui a déjà été un peu abordé, est d'ordre pédagogique. Il s'agit de pouvoir expliquer à la société la nécessité de travailler sur les animaux pour que les mouvements antivivisectionnistes aient moins d'influence, et de permettre au grand public de comprendre la réalité et les enjeux du travail des chercheurs. Travailler sur les animaux aujourd'hui, est une activité très encadrée, qui doit suivre des règles extrêmement strictes. J'ai coutume d'expliquer que les animaux sont mieux traités que les êtres humains, et à bien des égards, ce n'est pas si faux.
Le second problème essentiel, c'est celui de l'utilisation de modèles animaux les plus proches de l'homme. Aujourd'hui, les problèmes éthiques sont relativement peu importants lorsqu'on travaille sur des poissons ou des souris. En revanche, ils sont très importants lorsqu'on utilise des primates non humains, qui sont pourtant, comme on l'a bien vu tout à l'heure, des intermédiaires essentiels pour pouvoir passer des modèles d'animaux « simples » comme la souris, à l'homme. La recherche sur les primates non humains est absolument indispensable. Aujourd'hui, il est essentiel que nos politiques se rendent comptent de cela et que ces types de recherche puissent être défendus et maintenus.
M. Hervé Chneiweiss . Je voudrais ajouter un mot sur le problème de la pérennité des moyens. Il a été évoqué tout à l'heure les cohortes, il a été évoqué maintenant les modèles animaux. Cela prend une longue durée et c'est une ressource qui doit perdurer. C'est impossible dans le cadre de simples contrats ANR, de 2 ou 4 ans, d'assurer la pérennité de plates-formes, ou de ressources ou de cohortes. Il faut réfléchir au financement de longue durée de ces ressources.
M. Victor Demaria, chargé des relations avec le Parlement à l'INSERM . C'était pour compléter ce qu'avait dit Hervé Chneiweiss sur les deux problèmes des expérimentations animales et des associations. Les expérimentations animales nécessitent une continuité. Les associations contre la vivisection sont très peu nombreuses. L'INSERM effectue une veille et estime que seulement une centaine de personnes en tout en France sont actives, mais produisent beaucoup de dégâts. La nouvelle directive européenne nous pose problème, sans pour autant mieux protéger les animaux. Dans le cas des neurosciences, le problème des primates est fondamental. On assiste à une perte de compétitivité au niveau de la recherche française et européenne, car les Chinois sont prêts. Ainsi, avec moins de préoccupations éthiques, pour moins cher, on peut faire les mêmes manipulations ailleurs.
M. Bernard Bioulac. Je voudrais aller tout à fait dans ce sens, et comme l'a rappelé aussi Philippe Vernier, la recherche en primatologie expérimentale doit être particulièrement sauvegardée par la représentation nationale et par l'exécutif, parce que l'on est en grande difficulté en Europe. Jusque-là, la France était un peu protégée, mais véritablement on sent que cela deviendra très difficile. Aujourd'hui, des chercheurs français vont faire des expériences en Chine. Il faudrait y prendre garde. L'approche en primatologie expérimentale est irremplaçable, que ce soit sur les fonctions cognitives au plan strictement fondamental, mais aussi pour l'ensemble de la modélisation animale.
M. Alain Claeys. Je vous remercie de cet éclairage, Monsieur Luc Mallet vous avez la parole.
M. Luc Mallet, psychiatre, chercheur au centre de recherche de l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) . Je vais illustrer, avec quelques exemples précis, comment les techniques de stimulation cérébrale profonde, pour lesquelles je préfère le terme de neuromodulation implantée, ont permis en psychiatrie ces dernières années de proposer des traitements innovants pour des maladies qui représentent un enjeu de santé publique. En effet, ce sont des malades pour lesquelles on pouvait proposer dans le passé des interventions de chirurgie plutôt mutilantes, et qui ont montré une résistance à toute approche, soit médicale, soit psychothérapeutique, de leurs troubles. J'insisterai donc sur le fait que c'est une approche profondément multidisciplinaire, qui allie la psychiatrie, la neurologie, la neurochirurgie, l'électrophysiologie, la neuroanatomie, la psychologie clinique et expérimentale et la neuroimagerie.
Un bref rappel sur le cadre technique. Il s'agit d'implanter des électrodes le plus souvent au coeur du cerveau. Ces électrodes sont introduites par voie stérotaxique, donc sans ouvrir totalement le crâne et le cerveau. Le ciblage fait également l'objet d'un repérage électro-physiologique pendant l'opération, la technique permettant que les patients soient éveillés. Ensuite, ces électrodes sont reliées par un câble sous-cutané à un stimulateur, un générateur d'impulsions. Il s'agit bien d'une stimulation chronique, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui repartent avec un stimulateur en marche, et un courant généralement à haute fréquence délivré de façon chronique.
Comme vous le savez, le développement de cette technique a permis que plus de 100 000 patients dans le monde à ce jour aient été implantés pour des maladies du mouvement, dont environ 80 000 parkinsoniens. Lors de ces implantations, avec un succès sur la maladie de Parkinson, sont venues les premières observations de modification comportementale, soit au bloc pendant des stimulations-tests, soit en post-opératoire, avec par exemple induction de sorte de tableaux dépressifs rapidement constitués et rapidement régressifs, c'est-à-dire absolument réversibles après modification des paramètres. Ce que ces observations nous ont montré de façon décisive, c'est la possibilité qu'en modulant de façon très précise de toutes petites zones au coeur du cerveau, qu'on appelle les « ganglions de la base », on agissait sur des comportements, des affects, des cognitions, alors que jusqu'à présent, était surtout mis en avant, le rôle de ces petites structures dans la motricité.
On a pu également progresser quelque peu et montrer comment ce paradigme de la stimulation permet de faire progresser les connaissances en physiopathologie tout en soignant les patients. Nous avons pu montrer que la stimulation de zones très précises, par exemple, dans une petite zone qui s'appelle « noyau sous-thalamique », qui est toute petite (à l'échelle des millimètres) pouvait induire un état d'excitation et d'euphorie. On avait aussi montré, grâce à un travail collaboratif avec le CEA, qu'on activait des zones cérébrales particulières dues consécutivement à la stimulation haute fréquence de ces petites structures.
Ce type de travail a permis de repenser l'architecture anatomique, le rôle des circuits entre le cortex et ces zones profondes, et en particulier le rôle de petites zones qui semblent être liées à des processus de décision ou de motivation, par exemple.
Parmi ces travaux, nous avons également pu construire un protocole, grâce à des observations faites sur des patients parkinsoniens qui étaient suivis, et chez lesquels on avait observé la disparition de troubles psychiatriques associés ou préexistants à la maladie de Parkinson, en tout cas à l'expression de la maladie de Parkinson. Ce protocole a été une première en France. Il a rassemblé dix CHU, soit plus d'une centaine de personnes. Sa mise en place a été contemporaine de la saisine par le Professeur Benabid du Comité national consultatif d'éthique à l'époque, pour réfléchir sur la possibilité de mettre en place cette technique de stérotaxie fonctionnelle dans les maladies psychiatriques. C'était une précaution qu'avait prise M. Benabid pour que la chirurgie ne retombe pas dans les excès de la psychochirurgie du passé. Nous avons donc pu construire un protocole vraiment innovant et passionnant, pour lequel on a montré l'efficacité d'une intervention sur une partie du noyau sous-thalamique, dans le traitement des troubles obsessionnels compulsifs.
Les patients à qui s'adressent ces techniques sont des gens profondément handicapés, qui sont absolument incapables d'avoir une vie normale. On peut ainsi observer une personne à tous les moments de la journée et voir qu'elle est totalement envahie de rituels. Lorsqu'elle essaie par exemple de sortir de sa chambre, cela lui prendra un certain temps, car, comme elle doit absolument marcher sur des lignes très précises du sol, c'est extrêmement difficile et elle est obligée de s'y reprendre plusieurs fois. Avec ce type de patients, nous avons des résultats tout à fait importants à la suite de la stimulation.
Nous avons aussi obtenu des résultats dans d'autres maladies, telles la maladie des tics ou de Gilles de la Tourette. Avec une stimulation du globus pallidus interne, on constate un résultat de 75% à 80% d'amélioration sur les tics chez ces patients extrêmement handicapés.
Beaucoup plus récemment, nous avons pu mettre en évidence le fait qu'il y avait des caractéristiques électrophysiologiques des neurones qui étaient prédictives de la réponse des patients au traitement. Nous venons de publier ces résultats qui représentent peut-être une première étape vers des biomarqueurs. Nous marchons un peu sur les traces des travaux en épilepsie, qui sont plus avancés qu'en psychiatrie ; nos enjeux sont identiques, c'est-à-dire pouvoir analyser les activités des neurones dans les structures que nous ciblons.
Nous avons fait un film illustrant une opération montrant une représentation d'un cas de stéréotaxie avec une image IRM et la reconstruction de trajectoires d'exploration électrophysiologique. Deux types d'activité sont montrés : soit des activités unitaires, ce sont des neurones uniques enregistrés pendant l'intervention ; soit des assemblées de neurones, grâce à l'électrode implantée en post-opératoire qui recueille des champs de potentiels permettant d'obtenir l'activité électrique de ces assemblées de neurones. Tout un champ de recherche neurophysiologique est absolument une révolution ; il concerne très peu de patients, mais permet de bâtir des modèles tout à fait intéressants, comme nous l'avons fait à la suite de cette étude sur les troubles obsessionnels compulsifs. Pour cette étude, nous avons pu étudier des activités de neurones unitaires en lien avec un comportement de vérification expérimentale que nous induisions au bloc opératoire. Ce type de résultats a permis de lancer tout un programme avec de l'électrophysiologie humaine, du comportement et de l'imagerie cérébrale, mais également des travaux sur les primates. Je suis convaincu comme Philippe Vernier et Bernard Bioulac de l'intérêt des recherches chez le primate, qui sont absolument indispensables à cette étape de la recherche.
Ce type de démarche nous a aussi permis récemment de proposer un projet qui a été inclus dans l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, sur les concepts de motivation par exemple, qui sont très développés actuellement, et pour lesquels nous avons de bons corrélats entre des mesures objectives répétées et des corrélats neuronaux très précis. On peut décliner la motivation, par exemple en psychiatrie, sous plusieurs formes : le déficit de motivation, comme on en trouve dans la dépression ou dans des formes d'apathie avec syndromes neurologiques, les excès de motivation, comme on peut en avoir dans l'impulsivité, et enfin les déviances de motivation, que l'on peut retrouver dans les troubles obsessionnels compulsifs ou dans les addictions.
Il existe une potentialité de recherche translationnelle très importante. Par exemple, récemment, des modèles animaux de sensibilisation à la cocaïne ont montré l'intérêt peut-être d'aller stimuler, d'aller moduler l'activité de structures profondes pour le traitement des addictions à la cocaïne, sachant que dans cette population humaine, il y a aussi des patients dans des états désespérés sans aucun traitement qui marche.
Enfin, il faut rappeler la nécessité d'organiser en amont la psychiatrie, dans une interface soins-recherche. Cela ne pourra se faire que si on peut vraiment mettre en place des centres d'évaluation clinique d'excellence, des centres experts, pour prendre en charge et évaluer de façon rigoureuse et scientifique ces patients résistants.
En conclusion, on est donc parvenu à mettre en place un cercle vertueux de recherche physiopathologique, qui a vraiment apporté la stimulation cérébrale profonde. Ce n'est pas une fin en soi. Mais elle a ouvert une fenêtre sur le cerveau tout à fait unique, et elle nous permet d'aller de modèles animaux à des applications chez l'homme. En retour, les observations chez l'homme, à la fois en imagerie, liées à la stimulation de ces zones, et en peropératoire, liées à la physiologie, permettent de reconceptualiser les relations entre ces zones profondes et le cortex, et d'affiner en retour des modèles animaux. J'espère que nous aurons les moyens de poursuivre cette recherche pendant assez longtemps.
M. Philipe Vernier . En écho à ce que Luc Mallet vient de présenter, on n'a pas parlé d'un développement technologique très important ces dernières années, et qui a des implications importantes pour ce type de traitement, c'est l'optogénétique, c'est-à-dire la possibilité, en activant simplement par la lumière des molécules transgéniques, de stimuler ou d'inhiber les neurones. Aujourd'hui, la méthode, très simple et peu agressive, est surtout utilisée chez l'animal comme une sorte d'alternative à la stimulation par les électrodes. Mais le transfert de ce type de molécules chez l'homme n'est pas impossible, via des cellules que l'on peut greffer, qui peuvent s'intégrer dans les réseaux de neurones. Et il y a à l'heure actuelle des recherches sur le primate qui ont commencé dans divers centres, y compris en France. Ce sont des possibilités de stimulation nouvelles qui nécessiteront sans doute des encadrements.
M. Jean-Sébastien Vialatte. Je vous remercie et donne la parole à Monsieur Andréas Kleinschmidt, conseiller scientifique auprès du directeur de l'Institut d'imagerie biomédicale du CEA.
M. Andréas Kleinschmidt, conseiller scientifique auprès du directeur de l'Institut d'imagerie biomédicale du CEA-NeuroSpin/Laboratoire de neuro-imagerie cognitive (LCOGN) . Je suis neurologue de formation, chercheur INSERM depuis 2005 ; ce qui préoccupe les neurologues, c'est le rapport entre les symptômes d'un patient et une pathologie cérébrale. Je présenterai l'apport des outils modernes de neuroimagerie à cette question.
La question est classique et s'est posée de façon scientifique au XIX ème siècle, notamment avec les travaux de Paul Broca. Je commencerai sur cet aspect historique. Dans le patrimoine français de neurologie, les deux cerveaux décrits par Paul Broca ont un problème de langage, de parole, d'expression. Ces cerveaux-là ont été récemment soumis à l'imagerie par résonance magnétique, qui a révélé, à la différence de ce que Paul Broca a vu à l'autopsie, à savoir une lésion essentiellement corticale de la matière grise à la superficie, des lésions à la fois de la matière grise et de la matière blanche, incluant notamment certains faisceaux de fibres. Ce constat a relancé un débat selon lequel les symptômes des patients étaient liés plutôt à cette atteinte du cortex ou aux lésions de la matière blanche. Cela n'est pas simplement de la curiosité scientifique ; évidemment, c'est aussi pertinent pour les approches thérapeutiques qu'on peut imaginer.
De nos jours, on peut répondre à cette question classique avec les outils de neuroimagerie. À titre d'exemple, nous l'avons fait pour le syndrome de Gerstmann. C'est un syndrome relativement rare, décrit il y a plus de quatre-vingts ans. Les patients perdent quatre facultés : le calcul, ils ne sont plus en mesure de distinguer la gauche et la droite, ils ne reconnaissent plus leurs doigts et ils ne savent plus écrire. Cette combinaison est assez spectaculaire.
Nous avons demandé à des sujets sains d'effectuer les tâches dans lesquelles les patients atteints d'un syndrome de Gerstmann échoueraient. Et l'on observe, dans une région que nous avons ciblée, le lobe pariétal gauche de l'hémisphère dominante, les zones d'activation pour les quatre différents types de tâches que je viens de citer et qui correspondent aux symptômes. On voit qu'il n'y a pas une seule zone qui présente un recouvrement à travers les zones d'activation liées aux quatre tâches. Il y a un bon voisinage, mais il n'y a pas identité. Donc, il est peu probable qu'une lésion corticale puisse entraîner ce symptôme. En fait, on pourrait imaginer qu'une très grande lésion, qui recouvre tout cela, provoquerait ce syndrome, mais il y aurait d'autres problèmes en plus, notamment une aphasie, c'est-à-dire des troubles du langage, ou une apraxie, c'est-à-dire des troubles d'action organisée.
Pour répondre à la question de l'origine du syndrome, nous avons pris ces zones d'activation comme point de départ pour tracer des fibres. Grâce à l'imagerie de diffusion de l'eau, on observe que ces fibres sont liées aux différentes zones d'activation. On a pu ainsi mettre en lumière une espèce de goulet d'étranglement, une petite zone, où l'on peut imaginer qu'une lésion dans la matière blanche entraînerait une disconnection des zones d'activation dans le cortex. Ce dysfonctionnement présenterait ces symptômes-là.
Ce constat se fait grâce à une combinaison entre l'imagerie de structure, qui est le traçage des fibres, et l'imagerie fonctionnelle, l'activation. Un point est à souligner. Cette recherche s'est faite chez le sujet sain. Il est tout à fait important de continuer les recherches sur le sujet sain pour améliorer notre compréhension des pathologies.
Un travail remarquable, déjà évoqué par Cyril Poupon, consiste à identifier quelles fibres vont constituer quels faisceaux, les faisceaux qui permettent la communication entre les neurones. Dans ce cas, on passe de la connectivité dite structurelle, -les câbles- à la connectivité dite fonctionnelle. C'est la communication entre les neurones par les signaux électriques qui s'effectue très rapidement, et surtout, cette communication est tout le temps active.
Même en l'absence d'une action ouverte ou d'une stimulation extérieure, il y a une activité neuronale, et en fait aussi mentale, très active. Cela donne un moyen, sans faire appel à un paradigme ou à une tâche particulière, d'investiguer cette communication, cette activité spontanée dans le cerveau, en interrogeant les fluctuations de cette activité spontanée, qui heureusement sont assez lentes, dans la durée. Si l'on fait cela pour un jeu de régions, on peut représenter la force de corrélation, de communication, le lien fonctionnel entre les différentes régions du cerveau. On passe d'une vision ségrégationniste du fonctionnement du cerveau à une vision beaucoup plus intégrative.
Pourquoi cela nous intéresse-t-il ? Si vous imaginez que dans un tel système fortement interconnecté il y a une lésion, par exemple un accident vasculaire cérébral (AVC), on pourrait très bien penser que les effets ne sont pas restreints à la région de la lésion, mais qu'ils se répercutent sur le reste du cerveau qui est resté intact. Nous avons étudié une population de témoins pour ensuite pouvoir étudier des patients individuellement, suite à un AVC. Les résultats font apparaître des arêtes qui représentent la communication spontanée, la communication intrinsèque du cerveau qui est altérée à la suite d'un AVC et cette altération semble liée aux conséquences fonctionnelles d'un AVC, comme par exemple une hémiparésie ou des troubles de l'attention.
Quelle est la nature exacte du lien avec ce que nous observons ? La communication interne altérée n'est-elle qu'un épiphénomène de la lésion ? Peut-être s'agit-il seulement de neurones perdus suite à la lésion qui déterminent le tableau clinique qu'on rencontre ? Comme on ne peut pas résoudre cette ambiguïté à un instant donné, on a fait un suivi longitudinal de l'AVC à 3 mois et à 6 mois. On observe alors qu'il y a beaucoup moins d'arêtes plus tard, alors que la lésion reste la même. En parallèle, on note une amélioration du tableau clinique. Cela nous fait comprendre que, par ces outils de neuroimagerie, on peut obtenir un corrélat du tableau clinique du patient.
C'est intéressant pour comprendre les mécanismes de plasticité, la réorganisation, mais aussi pour évaluer d'éventuelles approches thérapeutiques. C'est très important, parce que cela nous suggère aussi qu'éventuellement, ce n'est pas forcément en reconstituant des cellules perdues suites à l'AVC qu'on pourrait améliorer le tableau clinique, mais en modulant la communication interne dans le cerveau qui est restée intacte. C'est une approche fondamentalement différente.
Pourquoi nous sommes-nous intéressés par cette question ? J'ai représenté les maladies neurologiques dans la perspective des DALY ( Desease-Ajusted Life Years) , un paramètre utilisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour quantifier l'impact global des maladies. Les DALY sont déterminés par le nombre d'années perdues, soit à cause d'un décès précoce, soit à la suite d'un handicap sévère. On constate que pour les maladies neurologiques, les DALY liés aux AVC dominent largement l'impact des maladies, plus que toutes les autres maladies confondues, y compris la maladie d'Alzheimer. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé une collaboration avec le professeur Yves Samson du service des urgences cérébro-vasculaires à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est sans doute aussi pour cela que ce projet a été financé par la Fondation pour la recherche médicale.
M. Alain Claeys . Je vous remercie beaucoup, et donne la parole au professeur Marie Vidailhet.
Mme Marie Vidailhet, professeur des universités, praticien hospitalier, neurologue, chercheur au centre de recherche de l'ICM. C'est toujours très difficile de parler après des collègues qui ont dit des choses passionnantes et toutes vraies. Vous allez retrouver un certain nombre de mots clés dans ce que je présenterai aujourd'hui. En tant que neurologues, deux choses nous importent.
La première, c'est de prendre en compte les enjeux de santé publique, c'est-à-dire les maladies fréquentes. Ce graphique sur les DALY a permis de constater que parmi les maladies neurologiques en cause, il y a l'épilepsie et l'AVC déjà évoquée et la maladie de Parkinson dont on va maintenant parler. 150 000 personnes sont touchées en France par cette maladie. D'une part, c'est une maladie dont on connaît un certain nombre de lésions neuropathologiques, et d'autre part, nous disposons de traitements pour prendre en charge les personnes atteintes, mais les résultats sont parfois incomplets ou varient (fluctuations thérapeutiques). En fait, c'est justement dans cette différence entre le résultat espéré par le patient et le résultat offert par la médecine, que le défi va se poser.
Nous sommes à une époque charnière où nous ne pouvons pas nous contenter des succès déjà obtenus, mais nous devons franchir les limites de la thérapeutique. Aussi, je voudrais attirer votre attention sur ce qui pourrait être fait, ou en tout cas, sur la manière d'envisager les problèmes et de procéder. Parmi eux, il y plusieurs points tels que la capacité prédictive des facteurs de devenir, et l'identification des facteurs de risque puisque tous les sujets ne sont pas égaux devant la maladie. C'est là-dessus que je vais m'arrêter dans un premier temps.
Le deuxième point, reviendra sur ce qu'ont expliqué nos collègues en imagerie fonctionnelle, à savoir comment percer les mécanismes qui sous-tendent les maladies et dont on ne perçoit rien en imagerie classique. Pourtant il se passe des choses extrêmement complexes et souvent néfastes à l'intérieur des circuits. Il s'agit donc d'une part, d'essayer de percer le mystère de la relation entre circuit et fonction, ou circuit et dysfonction, et d'autre part, d'essayer de savoir ce qui sera bénéfique à l'intérieur de ce circuit, et éventuellement compensateur, ou négatif c'est-à-dire un essai du système pour lutter contre la maladie qui pourrait être délétère.
À chaque fois qu'on pense plasticité, on pense à un système vertueux qui reconstruit et qui sera bénéfique, mais la plasticité peut être éventuellement négative, et donc il faut savoir comment on peut moduler - et vous avez vu qu'un autre mot clé était la modulation, de manière invasive, ou non invasive, c'est-à-dire non agressive.
Comment essayer d'obtenir une prédiction du pronostic des lésions « invisibles » qui constituent la maladie ? En faisant une recherche combinée dans laquelle toutes les personnes autour de cette table sont alliées. Il faudra une recherche de marqueurs biologiques et génétiques, une recherche clinique avec l'évaluation motrice et non motrice, faite sans dichotomie entre le corps et l'esprit, des quantifications de troubles précis qui reflètent des dysfonctionnements sous-jacents (étude des mouvements oculaires et des troubles du sommeil). Il faudra quantifier, évaluer, prédire, éventuellement traiter la marche et les chutes qui sont des facteurs de handicaps sévères, de dépendance ensuite, de coût social et personnel enfin. Ce sont des problèmes importants de santé publique. L'IRM haute résolution, nous permet de détecter des anomalies, peut-être avant même que les personnes développent des symptômes.
Grâce à ces techniques extrêmement sophistiquées et en combinaison avec les marqueurs cliniques que nous étudions, nous pourrons peut-être arriver à savoir que les patients développent des troubles particuliers. En prenant en charge ces patients un peu différemment, on espère les aider à développer des mécanismes de compensation, et donc retarder un peu ces fameuses années dont on vient de parler.
En clair, tous ces éléments nécessitent une analyse intégrée, et peut-être d'identifier des groupes, des groupes de marqueurs, des groupes de profils, ou des profils de sujets en relation avec non seulement ces lésions, mais surtout les mécanismes qui sous-tendent ces lésions. Je vous donne deux exemples.
Dans le premier exemple, on recherchera des anomalies dans des structures du tronc cérébral qui sont en particulier en lien avec les troubles de la marche et de l'équilibre. Ces structures sont d'ailleurs analysées grâce à l'imagerie humaine en clinique et en recherche clinique par Stéphane Lehericy. Je remercie Cyril Poupon et NeuroSpin qui nous a permis d'obtenir ces belles images-. Ceci nous a conduits à une analyse comparative de la pathologie et des modèles animaux. Je fais ici un plaidoyer pour le couplage entre recherche chez l'humain et recherche animale, en particulier chez le primate, une manière d'aborder des mécanismes difficiles d'accès chez l'humain.
Dans le deuxième exemple, on abordera la stimulation cérébrale profonde qui a été développée de manière pionnière dans la maladie de Parkinson. Les mécanismes de la stimulation commencent à être élucidés, mais on ne connaît pas très bien le rôle de la densité cellulaire, aussi bien neuronale que gliale dans l'activité du réseau neuronal, dans l'activité de la thérapeutique. Je fais donc vraiment un plaidoyer pour l'électrophysiologie de la cellule de l'animal jusqu'à l'humain.
Que regarde-t-on? On regardera des circuits neuronaux et leurs fonctionnalités, des neurones mais également de la glie, et des connections, en particulier, une connectivité entre cortex et structure profonde, les noyaux gris centraux. Ce sont nos enjeux pour les maladies fréquentes. Aller vraiment à chaque étape, et avoir une recherche intégrée, à la fois imagerie et physiologie, les deux étant étroitement couplés.
Comment va-t-on moduler ces circuits une fois qu'on les a identifiés ? En quoi ont-ils un rôle négatif dans la maladie, ou positif ? C'est par exemple par la stimulation cérébrale non invasive. J'ai choisi pour exemple la stimulation magnétique transcrânienne. Je vous montre sur la vidéo un sujet tranquillement installé. On repérera la zone que l'on veut stimuler par neuronavigation. On peut choisir exactement la zone que l'on doit stimuler et moduler l'activité cérébrale, augmenter ou diminuer l'excitabilité cérébrale. Ainsi, on peut moduler cette plasticité cérébrale pour essayer d'aller dans un sens « vertueux », lutter autant que possible contre une plasticité cérébrale qui serait délétère, et ainsi modifier le mouvement anormal. Ces modulations sont importantes, car elles peuvent mettre en jeu des mécanismes de compensation.
De nombreuses questions restent à élucider. Comment éveiller une compensation ? Comment éteindre un processus délétère ? Et ceci en mettant en jeu des méthodes non invasives et accessibles assez facilement. Or il existe déjà des techniques invasives (stimulation cérébrale profonde) très performantes. Cette modulation invasive va évidemment apporter un bénéfice thérapeutique. Sur la vidéo, vous voyez une dame qui va très mal, avec des mouvements anormaux très sévères. Ensuite, on la voit qui s'améliore énormément sous stimulation. Mais malgré le succès déjà obtenu, le principe est de reculer les frontières de la thérapeutique. Il faut essayer de comprendre à travers les circuits, éventuellement à travers des modèles animaux sur lesquels les circuits sont testés, quelles sont les autres cibles thérapeutiques que nous pouvons essayer de développer grâce à un affinement de la stimulation cérébrale profonde couplée à la physiologie et à l'imagerie.
M. Alain Claeys. Je vous pose une question stupide. À Grenoble, on a eu ces mêmes images. Les patients donnent-ils leur accord pour être filmés ?
Mme Marie Vidailhet. Oui.
M. Alain Claeys. Parce que moi, ça me choque de voir cela...
Mme Marie Vidailhet . Je comprends, mais je voudrais aussi vous expliquer dans quel esprit ces vidéos sont faites : les patients sont prêts à témoigner de l'effet bénéfique de la technique afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Ces informations permettent de convaincre et de rassurer. Cette vidéo a été publiée dans The New England Journal of Medecine (un des plus lus et des plus prestigieux journaux médicaux), avec l'accord de la dame. Elle est accessible par toute personne qui peut entrer dans le site du journal, justement parce qu'elle l'a accepté, et l'a souhaité. Autrement, je n'aurais évidemment pas montré une vidéo, vous le comprenez bien, et surtout pas sans l'accord des personnes concernées.
La décision pour un patient de se faire opérer est difficile, il souhaite avoir des informations et des témoignages, et aussi se projeter dans l'avenir et répondre à la question « qu'est-ce que vous allez faire de cette récupération de fonction ? » Cette discussion est extrêmement difficile, même après discussion avec l'équipe médicale. Si d'autres patients ont la motivation de rendre accessible leur vidéo à une large assemblée, c'est justement pour véhiculer un encouragement, pour témoigner du parcours qu'ils ont fait, des avantages, mais aussi éventuellement des limites d'une technique, et d'aider d'autres personnes à s'engager dans cette recherche ou dans cette thérapeutique.
M. Alain Claeys. Je vous remercie de ces explications et donne la parole à Monsieur Charles-Ambroise Valery qui dirige l'unité de radio chirurgie, gamma-knife de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
M. Charles-Ambroise Valéry, neurochirurgien, directeur médical de l'unité de radiochirurgie, gamma-knife , hôpital de la Pitié-Salpêtrière . Vous le savez, une unité gamma-knife de radio chirurgie a été implantée récemment dans la région. Cet équipement est encore assez rare sur le territoire national, comparé à d'autres pays. C'est l'occasion de vous expliquer comment cette technique fonctionne, ce qu'elle peut apporter, et ce qu'on peut en espérer.
Je voudrai déjà souligner le fait que la relation entre l'exploration du cerveau et les traitements découlant de cette exploration est assez particulière, et cela rejoint un peu le thème de la table ronde. Il y a un lien très étroit entre les deux. Ce que l'on observe, la cible que l'on détermine, peut rapidement ensuite devenir l'objet d'un traitement, par cette technique-là, avec toutes les précautions qui s'imposent.
D'abord un mot sur la radiochirurgie, c'est un concept neurochirurgical inventé par un neurochirurgien suédois dans les années cinquante, Lars Leksell. Il avait ainsi défini la radio chirurgie comme étant « la délivrance d'une dose d'irradiation élevée en une seule fois sur un petit volume intracrânien, en évitant les tissus sains environnants et en laissant le crâne intact » . On trouve deux notions : la notion de ciblage précis et la notion de dose unique.
Comment effectue-t-on ce ciblage ? Un cadre qui est fixé sur la tête du patient de façon invasive, sous anesthésie locale au moment de la procédure. Ce cadre sera ensuite être repéré lorsqu'on effectuera l'imagerie avec le cadre en IRM et en scanner. Plusieurs mesures sont effectuées afin de repérer au mieux la cible. Quant au bistouri du radio-chirurgien, ce sont des mini-faisceaux de quelques millimètres produits par de petits collimateurs qui convergent sur la cible choisie. La dernière forme du gamma-knife, qui est très évoluée, ce sont 192 mini-faisceaux qui convergent en un point au centre de l'appareil, et sont produits par des sources de cobalt. On s'arrangera pour placer la cible choisie exactement au point de convergence de ces 192 mini-faisceaux.
La première étape consiste, par informatique, à effectuer une dosimétrie, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour créer la dose nécessaire et suffisante pour modeler parfaitement la lésion à traiter, de façon à ne pas léser les tissus environnants, tout en traitant efficacement la lésion. Ensuite, le patient est allongé sur un lit qui peut être orienté dans les trois plans de l'espace, il sera avancé dans la machine. La cible sera placée au point de convergence de ces 192 mini-faisceaux qui réaliseront le traitement. La tête du patient rentre dans la machine. Le lit sur lequel il est allongé, et auquel est fixé son cadre, s'oriente dans les trois plans de l'espace, ce qui permettra d'amener la cible exactement au point de convergence des mini-faisceaux, réalisant ainsi en un ou plusieurs temps le traitement de la ou des lésions qui ont été auparavant repérées. On verra ensuite par transparence la ou les lésions qui ont été traitées en une ou plusieurs fois, et chaque fois, l'ensemble du corps avec la tête fixée sur la table se déplacent de façon à amener encore une fois la cible au point de convergence de ces mini-faisceaux.
Il est évident que dans ce type de traitement, les contrôles qualité sont très importants. Ils sont très rigoureux et très fréquents de façon à s'assurer de la parfaite précision de l'orientation de ces mini-faisceaux sur la cible. À l'heure actuelle, les données mondiales montrent une expansion importante des indications de cette technique. Les pathologies concernées au premier plan sont les tumeurs malignes, en particulier les métastases cérébrales. Viennent ensuite les tumeurs bénignes comme les neurinomes et les méningiomes. Puis ensuite certaines pathologies vasculaires, notamment les malformations intraveineuses, et enfin certains troubles fonctionnels, comme les névralgies du trijumeau.
Deux exemples me paraissent intéressants. Il y a les métastases, dont l'incidence est en forte progression. 150 000 cas sont décrits chaque année aux États-Unis et concernent des patients fragiles dont le pronostic vital est en jeu, si la maladie cérébrale n'est pas contrôlée rapidement. On observe une efficacité significativement supérieure aux traitements classiques que sont la chirurgie ou l'irradiation classique. En effet, le taux de récidive locale est de 10% contre 50% pour la chirurgie classique, avec une préservation de la qualité de vie des patients, c'est-à-dire l'absence de complications chirurgicales, l'absence de trépanation, et une durée d'hospitalisation courte et c'est très important.
En ce qui concerne les neurinomes, qui sont des tumeurs bénignes à croissance lente, le pronostic est d'abord fonctionnel, puisque cette tumeur altère d'abord l'audition, la motricité faciale, voire la sensibilité de l'hémiface et l'équilibre de la marche, et secondairement, le pronostic vital. On observe une bien meilleure préservation de l'audition utile (80% versus 40%) et de la mobilité faciale (>95% versus de 40 à 80% selon les séries) dans le cadre des neurinomes de petite taille traités par radio chirurgie par rapport à la chirurgie traditionnelle. Et ceci sans complication chirurgicale, avec une durée d'hospitalisation courte.
J'ai fait une présentation rapide de cette technique qui est essentiellement multidisciplinaire. Selon le décret du 21 mars 2007, elle associe les neurochirurgiens, les radiothérapeutes, les physiciens médicaux et des neuroradiologues. L'unité actuelle qui a été ouverte associe plusieurs institutions : les hôpitaux de l'AP-HP, la Fondation ophtalmologique Rothschild, sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), suivant les recommandations de l'Institut national du cancer (INCA), de la Haute autorité de santé (HAS) et des sociétés savantes.
M. Jean-Sébastien Vialatte, député. Je vous remercie. Nous en venons à notre dernière table ronde.
LES INTERROGATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
M. Jean-Sébastien Vialatte, député. Nous abordons maintenant la table ronde sur «Les interrogations scientifiques et techniques ». Le professeur Anne Fagot-Largeault a la parole.
Mme Anne Fagot-Largeault, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences . Je limiterai mon propos à deux brèves remarques. La première a trait, grâce au progrès des connaissances, à la meilleure qualité des diagnostics et en particulier à la capacité prédictive améliorée qu'on est désormais en mesure d'offrir au patient. Lorsque j'ai participé à la préparation du plan Alzheimer, j'ai souvent entendu dire qu'on devait développer les diagnostics précoces. On commence en effet à entrevoir la possibilité de réaliser le diagnostic de la maladie d'Alzheimer avant même l'apparition de ses premiers signes.
J'ai lu récemment dans un excellent article du journal américain Hastings Center Report, qui est selon moi, le meilleur journal pour l'information et la réflexion bioéthique, que, si l'on est en mesure de faire de bons et fiables diagnostics précoces sur les maladies neuro-dégénératives, alors on doit prévoir l'augmentation des demandes de suicide assisté. En effet, toute personne qui apprendra être atteinte d'une maladie à l'évolution, pour l'heure inexorable, pourra revendiquer un droit de décider du moment de sa propre mort. Cela nous amène alors à rediscuter de la légitimité d'aider les personnes qui le souhaitent à mourir. Comment faire face à ces revendications ? Comment les recevoir autrement qu'en faisant miroiter de faux espoirs thérapeutiques ? C'était juste une question.
Ma seconde remarque, qui est en fait complémentaire de la précédente, est que si on veut éviter une épidémie de suicides tout en continuant d'améliorer la performance diagnostique, il faut réfléchir aux problèmes de société qui résulteront de ces diagnostics à la fois plus fins et plus précoces. Là-dessus, j'ai eu connaissance il y a quelques mois, d'un projet de recherche qui a été financé et vient de démarrer en Suède. Ce projet, qui associe sciences humaines et sociales et les médecins, porte sur le devenir de sociétés démocratiques dans lesquelles une partie de la population âgée sera consciente de vivre avec une maladie dégénérative, disons avec un cerveau abîmé, détérioré. On ne pourra pas mettre tous ces patients dans des hôpitaux. Les personnes qui sauront et dont l'entourage saura qu'ils sont malades, continueront à mener une existence normale, avec une certaine aide peut-être, dans une démocratie normale. Ils feront leurs courses, iront à la banque, voteront... Quelle aide leur apporter ? Comment concevoir la vie démocratique quand une partie des citoyens est diminuée mentalement ? Notre système français à l'égard des personnes diminuées est le plus souvent un système d'exclusion. Il s'agit de réfléchir à la manière d'inclure ces personnes dans la vie démocratique. Il m'avait semblé en lisant le projet de recherche que j'avais à évaluer, que c'était une bonne idée et qu'il était intéressant de réfléchir à ces questions dès maintenant.
M. Alain Claeys . Je vous remercie, Madame et tous les sujets que vous abordez feront l'objet de réflexions au Parlement. La parole est au Professeur Yves Agid, membre du Comité consultatif national d'éthique .
M. Yves Agid, membre fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), professeur de neurologie, membre de l'Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d'éthique (CCNE). J'ai choisi de parler des problèmes éthiques soulevés par l'imagerie cérébrale, car le CCNE s'est autosaisi de ce sujet. L'imagerie constitue déjà un enjeu, car de nombreux problèmes se posent dans notre société pour tous les comportements normaux ou anormaux, depuis la naissance, même avant la naissance jusqu'à la fin de la vie et aussi pendant toute l'existence. Il y a trois raisons pour lesquelles la neuro-imagerie pose problème.
La première, c'est qu'on vit un changement de société, avec une ouverture vers l'information et dans le même temps un souhait de protéger la vie privée et la confidentialité.
La deuxième, ce sont les progrès fantastiques des neurosciences. Le cerveau n'est pas un organe comme les autres, ne serait-ce que parce qu'il est le seul à pouvoir réfléchir à son propre fonctionnement. Il comprend 100 milliards de cellules nerveuses et, comme l'a dit Hervé Chneiweiss, beaucoup plus de cellules gliales que l'on ne mentionne guère. On évoque toujours l'homme neuronal, mais il existe peut-être un homme glial. On commence seulement à comprendre comment le cerveau fonctionne ou dysfonctionne.
Une troisième raison réside dans les progrès fantastiques de la neuroimagerie. Je voudrais à cet égard faire une parenthèse : on débat ici de techniques sophistiquées, mais on est quand même loin de la pratique neurologique de tous les jours, où je rappelle quand même que le dialogue et la relation avec le malade priment toujours. On a déjà insisté sur la multiplicité des clichés due aux nombre d'installation, et à leur plus grande accessibilité, qui posera un réel problème : une IRM deviendra-t-elle aussi banale qu'une radio du poumon ?
Étant donné la puissance de ces méthodes, la littérature scientifique et médicale pullule d'observations qui présentent un caractère de dangerosité. Je ne citerai que deux titres d'articles de la prestigieuse revue Science : Les bases neuronales de la décision - c'est peut-être provocateur, on entrevoit les mauvaises interprétations qui peuvent en être faites si, par exemple, des capitaines d'industrie lisent cela et en concluent qu'il faut se faire faire une IRM avant de prendre une décision - ou bien, autre titre effrayant, Le bien, le mal et le cortex cingulaire antérieur - comme si les notions de bien et de mal étaient situées dans une partie du cerveau faisant moins d'un centimètre carré ! Il existe donc un problème de média.
De manière plus sérieuse, la neuroimagerie soulève deux ordres de questions. De nombreux d'articles ont été publiés pour expliquer que la neuroimagerie pouvait aider à analyser la personnalité. On peut faire la distinction entre des personnes extraverties et impulsives, par exemple les fameux novelty seekers (ceux qui se jettent d'un pont avec un élastique autour du pied), et au contraire des personnes plus introverties. Par rapport à une population-témoin, les novelty seekers ont une réactivité différente à un certain nombre de tests en imagerie.
Par ailleurs, la neuroimagerie peut aussi être utilisée pour constater la vérité et la fausseté. Certains tests peuvent le montrer. Si on montre à une population des informations contraires à ce qu'elle pense, cela va allumer des zones particulières de son cerveau. Autre exemple : la sexualité. On montre des images à connotation sexuelle à des homosexuels et à des hétérosexuels, ce qui permet ensuite de faire le diagnostic de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité. Ce sont des résultats scientifiques, mais à l'échelle individuelle, cela n'a évidemment aucun sens. Encore plus graves sont les tests que l'on fait passer pour distinguer la race : on montre des images de Noirs à des Blancs et inversement, on fait de petits calculs et on en déduit la couleur de leur peau. Vous le constatez : on en revient à des questions éthiques du temps passé et ceci est assez inquiétant. Je cite ces exemples pour poser le problème. On peut aussi chercher à anticiper, rechercher quelqu'un qui ment, reconnaître quelqu'un qui dit un mensonge, distinguer les vrais et les faux souvenirs, faire de la prédictivité... On pourrait multiplier les exemples.
Je vais simplement vous résumer l'ensemble des problèmes éthiques posés à la lumière de cette littérature. Il existe d'ailleurs un journal américain de neuro-éthique, Neuroethics , qui consacre de nombreux articles à ces sujets. On pourrait distinguer les risques en deux catégories : les risques sociétaux et les risques liés à la méthode.
Du point de vue sociétal, comme dans la vie quotidienne on peut distinguer les tendances à la dépression, à l'euphorie, à l'obsession. Vous imaginez facilement l'intrusion qui peut résulter dans la vie privée si les l'IRM fonctionnelles (IRMf) sont à disposition, et aussi l'utilisation susceptible d'en être faite dans toute une série de questions sociétales majeures comme le recrutement pour un emploi, les jurys de concours... Il paraît qu'on a tenté d'utiliser ce type d'examen pour recruter dans l'armée, mais le plus grand problème, réside dans recours à ces tests devant les tribunaux. Je raconte toujours l'histoire de cet homme ayant étranglé sa femme puis jeté son corps du haut du douzième étage d'un immeuble et qui a réussi à New York à échapper à toute condamnation, son avocat ayant plaidé l'irresponsabilité en s'appuyant sur des clichés d'IRM et de PET-scan qui révélaient un énorme kyste, qui était en fait un simple kyste arachnoïdien bénin, en aucun cas susceptible d'altérer la conscience de la personne. Il existe d'autres cas similaires. Une mauvaise utilisation de la neuroimagerie devant les juridictions posera des problèmes.
M. Alain Claeys . L'utilisation de ce type d'images est-elle réglementée aux États-Unis ? Est-elle autorisée dans certains États ? Expressément interdite dans d'autres ? En France, la loi de bioéthique est très claire sur ce point.
M. Yves Agid. Je ne peux pas vous répondre. En France, à l'occasion de la révision des lois de bioéthique, un large débat a eu lieu au Parlement pour savoir s'il était possible d'exciper de clichés de neuroimagerie devant les tribunaux. Il me semble qu'il est impossible d'empêcher qu'un jour, un avocat cherche à en tirer parti. Si un patient a un glioblastome au milieu du cortex frontal, ce pourra être présenté comme une excuse s'il a commis un crime. En revanche l'utilisation systématique de l'IRMf pose un problème. Dans la loi de bioéthique finalement, l'utilisation de la neuroimagerie est autorisée en justice...
Par ailleurs, l'utilisation de l'IRMf, je m'exprime là sous le contrôle de mes collègues spécialistes, soulève des problèmes éthiques en tant que méthode même. La première raison est liée à la multiplication et l'accessibilité des appareils qui posent la question de l'anonymisation des examens. La seconde raison concerne la méthode elle-même : quand on observe une hypo ou une hyperactivité dans le cerveau d'un patient, on ne mesure pas l'activité des cellules nerveuses proprement dites, mais un débit sanguin cérébral, car lorsqu'un neurone s'active, il a besoin d'énergie et il se produit une petite augmentation du débit sanguin. C'est en fait encore plus compliqué, puisque les neurones ne représentent que la moitié des cellules du cerveau. Dans certaines structures comme le thalamus, les cellules gliales sont vingt fois plus nombreuses, dans le cortex, deux fois plus. En réalité, on ne dispose que d'une mesure indirecte, sans compter que le débit sanguin cérébral peut être modifié par quantité de facteurs - chaleur, état émotionnel... Enfin, on ne peut que raisonner sur des moyennes. Cela n'a aucun sens à l'échelle individuelle. D'où l'aberration de vouloir s'en servir en justice.
Enfin, d'une façon générale, l'IRMf conduit à faire une corrélation entre un fait biologique et un comportement ou une pensée. Or, ce n'est pas parce qu'une modification de comportement entraîne une modification d'activité cérébrale que la réciproque est vraie. On peut constater une activité très importante dans une zone donnée du cerveau, qui n'est pas du tout le centre du comportement en question, cela peut être un effet indirect. Une lésion dans une zone donnée du cerveau peut aussi provoquer des dysfonctionnements à distance, une hyperactivité dans une zone donnée ne signifie pas nécessairement que l'essentiel se passe là. Voilà donc des réflexions conceptuelles qu'il faut garder en tête quand on parle d'éthique.
Je ne voudrais pas apparaître complètement conservateur et dire qu'il ne faut pas utiliser l'IRM. D'un côté, on a les tenants du « People lie, brain waves don't lie » « les hommes mentent, pas les ondes cérébrales »), mais ce n'est qu'un fait biologique. D'autres répondent que l'IRMf constitue un apport supplémentaire et pourrait compléter certaines études psychologiques, permettant notamment de diminuer l'écart-type . C'est à mon avis prématuré, mais il faut rester ouvert ; vu les progrès fantastiques permis par les IRM de très haut champ, on comprend de mieux en mieux comment fonctionne le cerveau. Il existe des modèles permettant d'interpréter très intelligemment de grandes fonctions mentales comme le langage, la mémoire, le calcul, la conscience...
Pour conclure, en termes éthiques, la neuroimagerie constitue une révolution dans la connaissance et le traitement de certaines pathologies cérébrales, comme la radiographie du poumon l'avait été pour les pathologies pulmonaires. En revanche, du point de vue sociétal, son utilisation chez des individus sains soulève des problèmes considérables, auxquels la nouvelle loi de bioéthique n'a que partiellement répondu.
M. Alain Claeys . Je vous remercie et donne la parole au Professeur Bertrand Fontaine
M. Bertrand Fontaine, professeur des universités, praticien hospitalier, neurologue, directeur scientifique de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). La recherche est aujourd'hui mondialisée. La compétition internationale est rude et on ne peut l'ignorer. Un équilibre doit être trouvé entre l'avancée du savoir et l'impératif de protection des personnes. Les chercheurs qui travaillent en France sur le cerveau sain ont aujourd'hui des difficultés, le cadre très contraignant qui leur est imposé rendant difficiles les expérimentations. Ils prennent donc du retard, ou vont faire leurs expériences à l'étranger. Il faudrait harmoniser les règles éthiques de par le monde, au moins dans les pays comparables.
M. Alain Claeys . Quelles exigences éthiques impose-t-on en France et qui n'existent pas dans d'autres pays ? Pouvez- vous nous citer des exemples ?
M. Bertrand Fontaine . Pour réaliser des études comportementales sur sujets sains, même s'il ne s'agit que de faire passer des tests ne nécessitant aucune exploration invasive, il faut en France recueillir l'avis d'un comité d'éthique. Cela n'est pas requis dans d'autres pays européens.
M. Alain Claeys. En tant que chercheur vous le percevez comme une contrainte insurmontable et non comme une nécessité ? Par rapport à votre propre questionnement de chercheur, avez-vous besoin de ce comité d'éthique ?
M. Bertrand Fontaine . Il faut y réfléchir. Le comité d'éthique est indispensable. Une autre question est celle de la lourdeur des protocoles, notamment de la responsabilité médicale qui y est associée.
M. Didier Dormont. Une grande enquête a été faite sur un grand nombre de laboratoires européens. Pour des études strictement comportementales n'exigeant aucune exploration invasive, dans de nombreux pays européens, on n'exige pas que l'investigateur principal soit médecin. Cette exigence pose de gros problèmes en France, d'autant qu'est également exigé un promoteur, ce qui crée des lourdeurs supplémentaires. Dans la plupart des pays européens, c'est l'institut ou l'université qui couvre les recherches en matière d'assurance.
M. Bernard Bioulac . La loi actuelle permet de déroger à l'exigence d'un investigateur médecin. Nous rencontrons souvent ce problème au CNRS, où nous avons beaucoup de chercheurs en psychologie expérimentale chez l'homme. Un décret en Conseil d'État, qui n'a jamais été publié, devait établir la liste des expériences pouvant être conduites par un investigateur principal non médecin. Une solution est de prendre un médecin acceptant d'être le promoteur. Votre collègue député Olivier Jardé avait déposé une très intéressante proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine...
M. Alain Claeys. Elle faisait l'unanimité à l'Assemblée. Le Sénat l'a, hélas, dénaturée et en CMP, l'ensemble a été rejeté.
M. Bernard Bioulac . Il faudra sortir de cette situation inextricable.
M. Alain Claeys . Nous avons saisi le ministre.
M. Bertrand Fontaine. Maintenant je voudrais exposer trois points qui concernent les conséquences sociétales de notre projet d'Institut hospitalo-universitaire (IHU) d'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Notre projet est d'essayer de faire que des maladies neurologiques chroniques, aujourd'hui invalidantes, ne le soient plus. Notre ambition n'est pas de guérir ces maladies, mais d'amoindrir le handicap qui en résulte. Comme l'a expliqué Mme Fagot-Largeault, dans dix ans, nous allons nous retrouver avec une population importante de personnes chez qui aura été diagnostiquée une prédisposition à développer une maladie neurologique et qui seront identifiées comme tels. Leur cas sera semblable à celui des personnes porteuses d'une mutation génétique pouvant les conduire à développer une maladie, à une échéance inconnue. Il faut dès maintenant réfléchir aux moyens de les protéger. Dans notre système, être malade signifie bien souvent être exclu du secteur économique, on ne peut plus travailler, on ne peut plus contracter de prêt, et donc on doit vivre de la solidarité.
Si nous réussissons dans notre projet, ces personnes seront malades, reconnues comme telles, mais ne seront pas handicapées. On a déjà connu une situation semblable avec le Sida : aujourd'hui, grâce à de nouveaux traitements, des personnes infectées par le virus peuvent vivre quasi-normalement, mais elles ont encore des difficultés à faire reconnaître tous leurs droits, même si des progrès ont été accomplis. Les personnes atteintes de certaines maladies neurologiques, sans qu'en résulte chez elles de handicap, pourraient théoriquement jouer un rôle important dans le secteur économique, duquel elles risquent pourtant d'être exclues si on ne les protège pas.
Aujourd'hui, lorsqu'on pense santé, on pense dépenses et, au final, coût pour le pays. Je me félicite que certaines propositions de la commission Marescaux, dont j'ai eu l'honneur de faire partie et qui était chargée de faire des propositions sur l'avenir des CHU, aient été reprises dans le cadre du grand emprunt. Cette commission a essayé de démontrer que la santé pouvait aussi être source d'innovation. On espère que la santé sera demain ce qu'est aujourd'hui l'Airbus pour notre économie. Le pari en a été fait avec les investissements d'avenir. Nous avons bien conscience d'expérimenter dans notre institut hospitalo-universitaire. Je suis convaincu que le succès sera au rendez-vous et que nous devons nous s'inscrire dans une dynamique liant davantage santé et économie afin de pouvoir consacrer davantage à la santé dans le futur, car personne ne peut raisonnablement croire qu'on dépensera moins. Il faut que les chercheurs français déposent davantage de brevets et que cela enrichisse la nation.
M. Alain Claeys. Un mot sur le grand emprunt puisqu'il se trouve qu'hier la Mission d'évaluation et de contrôle, dans le cadre de ses travaux sur les financements extra-budgétaires de la recherche dont je suis, avec mes collègues Jean-Pierre Gorges et Pierre Lasbordes, le rapporteur, auditionnait le nouveau président de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), M. Didier Houssin. On a choisi pour le grand emprunt de faire systématiquement appel à des jurys internationaux. Je n'y suis pas hostile mais il faudrait parallèlement que l'État affiche ses priorités dans le choix des thématiques. Ainsi le cancer n'a-t-il pas été retenu comme priorité. Dans un pays comme la France, s'il faut certes prendre toutes les précautions pour retenir les sujets de recherche, l'État doit dire ce qu'il souhaite dans un certain nombre de domaines, en particulier la santé.
M. Bertrand Fontaine. Le choix de jurys internationaux est extrêmement sage. Nous ne pourrions évaluer l'excellence de nos projets nationaux, sans provoquer de querelles de chapelle ni de luttes d'influence. C'était la seule manière de faire valoir l'excellence française. Parmi les IHU retenus, un sera consacré au cancer. Les projets retenus par le comité de pilotage couvrent tous les champs de la santé, dont le cancer, qui a bénéficié d'un financement non négligeable dans le cadre de l'appel d'offres IHU, bien que n'ayant pas été retenu dans les six priorités.
M. Alain Claeys. Il n'est pas incompatible de mettre en place des jurys internationaux et de fixer certaines priorités. Dans sa conférence de presse d'il y a deux jours, le Président de la République a d'ailleurs donné un certain nombre d'orientations. Aucune autre intervention sur ce point ? Professeur Olivier Oullier vous avez la parole.
M. Olivier Oullier, professeur de psychologie à l'Université d'Aix-Marseille et conseiller scientifique au Centre d'analyse stratégique . Mon propos portera principalement sur la variabilité des données issues de scanner d'IRM fonctionnelle (IRMf) et ira dans le sens de celui d'Yves Agid.
Travaillant à la fois dans un laboratoire de recherche à Aix-Marseille Université et pour une institution de conseil et de recherche en politique publique, le Centre d'analyse stratégique (CAS) 5 ( * ) , j'essaie de combiner deux angles de vue complémentaires. Les questions théoriques, pratiques, éthiques, sociétales autour des neurosciences animent nos recherches, au sein du laboratoire autant que dans le programme « Neurosciences et politiques » publiques, dont je partage la responsabilité avec Sarah Sauneron depuis 2009 au CAS.
La question de la fiabilité du matériel, des données et des interprétations qui peuvent être faites en neurosciences est centrale. J'appartiens à une génération qui a toujours connu l'imagerie cérébrale. Ayant pu bénéficier de ses apports dès le début de notre carrière, nous sommes extrêmement critiques et nos attentes et exigences sont élevées en ce qui concerne la qualité du signal et la reproductibilité des données.
L'exigence de qualité des données vaut autant pour le diagnostic médical et la recherche qui se nourrissent mutuellement, que pour certaines applications, aussi improbables et discutables d'un point de vue éthique soient-elles, que certains aimeraient en faire. On ne peut donc pas éluder le problème de la variabilité des données. Ainsi, cette variabilité, longtemps considérée comme du « bruit » autour du signal, peut s'avérer être une source d'information autant pour le cerveau lui-même que pour le chercheur qui analyse les données 6 ( * ) . De fait, cette variabilité doit être considérée avec un égard particulier pour d'éventuelles interprétations et élaborations de théories du fonctionnement du cerveau.
Préparant cette audition, j'ai relu la thèse de Jean-Luc Anton, publiée en 1996 7 ( * ) , dans laquelle il évoquait tous les problèmes liés aux variabilités de l'IRMf à cette époque.
Une première source de variabilité peut tenir à l'appareil lui-même, une autre à des interférences pendant la collecte des données (signal, rapport signal/bruit, dérives temporelles, artéfacts, ...).
Ensuite, il convient de ne pas oublier non plus que nous observons un changement de signal qui, en IRMf, n'est pas une mesure directe de l'activité cérébrale proprement dite, mais une estimation de la consommation d'énergie, elle aussi indirecte suite à des modifications du champ magnétique. De plus, ces estimations, souvent calculées par contraste, s'effectuent sur la base du postulat suivant : un « réseau cérébral qui travaille plus, consomme plus d'oxygène », et du droit de comparer cette consommation entre deux parties du cerveau -qui ont de forte chances de ne pas avoir la même concentration de neurones, par exemple.
Dès lors, rechercher le centre d'une activité ou d'un comportement dans le cerveau reviendrait à faire l'hypothèse que le cerveau fonctionnerait de manière très localisée et spécialisée. Ce n'est pas aussi simple, bien heureusement pour notre fonctionnement car, comme d'autres l'ont dit et écrit avant moi, nous ne pourrions pas nous poser toutes ces questions et échanger aujourd'hui si le cerveau n'était pas aussi complexe !
On parle aujourd'hui de cognition distribuée et incarnée car il est bien difficile de montrer qu'une zone unique est « responsable » d'une activité ou d'un comportement. Les récents travaux utilisant des mesures de connectivité fonctionnelle à l'intérieur de certains réseaux cérébraux ont même permis de questionner la dichotomie raison-émotions au niveau neurobiologique 8 ( * ) et celle entre des soit-disant processus moteurs qualifiés de manière erronée de « bas niveau » et une cognition qui serait de « haut niveau » 9 ( * ) .
Nous pouvons, en revanche, montrer qu'une zone et/ou qu'un réseau participe à certains comportements. Si l'on utilisait la « philosophie » de l'IRMf pour mesurer la consommation d'énergie lors du décollage d'une navette spatiale, on verrait beaucoup d'énergie consommée dans les boosters et, par contraste, aucune au niveau des microprocesseurs de l'ordinateur de bord car sa consommation d'énergie est négligeable en comparaison, alors même que son rôle est primordial. Comme je l'ai déjà évoqué, il faut donc être très prudent dans les comparaisons de consommation estimée d'oxygène entre deux parties du cerveau. Par exemple, peut-on la comparer entre le cortex préfrontal et le cervelet, dans lesquels les concentrations de neurones sont bien différentes ?
À ces variabilités inhérentes au signal s'ajoutent celles liées à la méthode de traitement, à d'éventuels mouvements du sujet dans l'appareil - tout mouvement fait perdre du signal et quelques millimètres de décalage dans la position de la tête peuvent faire passer une activité d'un sillon à un autre du cerveau -, et, bien sûr, à la variabilité anatomique individuelle.
Toutes les questions, que Jean-Luc Anton, et d'autres, posait en 1996, demeurent d'actualité quinze ans plus tard. Une thèse publiée l'année dernière montre à quel point ses questions restent d'actualité 10 ( * ) . Bien qu'elles soient centrales, ces questions n'ont pas été traitées au même niveau dans la littérature neuroscientifique que les éventuels liens entre activité cérébrale et comportement, par exemple. Cela n'est pas sans conséquence dans l'appréhension sociétale des applications, effectives ou fantasmées, de l'utilisation au quotidien de l'imagerie cérébrale. Par effective je parle de l'existence de ces applications en tant que telles -voire d'un marché qui les exploite- et non de leur validité scientifique. Comme je l'ai déjà évoqué à cette tribune lors d'une précédente audition, l'histoire nous montre malheureusement que le fait qu'une technique ou théorie ne soit pas généralisable et/ou validée scientifiquement n'a jamais empêché son commerce.
J'aimerais maintenant évoquer brièvement une étude très intéressante dans laquelle cinq volontaires ont été scannés par neuf scanners IRMf différents dans lesquels ils ont réalisé la même tâche, un jour donné puis le lendemain. Les résultats révèlent une variabilité pouvant être élevée d'un appareil à l'autre dans la qualité des données brutes que les auteurs proposent de réduire à l'aide d'un filtre spécialement développé par leurs soins 11 ( * ) . Une recherche bibliographique sur les questions de reproductibilité et de variabilités des mesures d'IRMf montre l'absence de consensus dans un sens comme dans l'autre : les résultats sur la variabilité inter- et intra-sujet étant eux aussi très variables !
Il ne faut pas pour autant en conclure que ces mesures ne sont pas fiables. Toute méthode, de l'électrocardiogramme à l'échographie révèle de la variabilité dans les mesures qu'elle fournit. Il convient néanmoins de prendre cette variabilité en compte dans les modèles et dans les interprétations, a fortiori quand ces dernières sont, souvent à tort, généralisées.
Autre facteur qui peut jouer : la capacité d'adaptation du cerveau à court terme grâce aux processus d'apprentissage. Le fait que l'activité cérébrale enregistrée soit différente quand un individu effectue une tâche à T et à T+1 n'est pas lié seulement à la variabilité de la machine. Toutefois, sans modèle de fonctionnement du cerveau, il est difficile de distinguer le pourcentage de variance expliquée par la familiarisation à la tâche, l'apprentissage et/ou la machine.
Enfin, Hervé Chneiweiss et d'autres ont insisté sur la nécessité d'appréhender chaque individu dans sa singularité, et non pas (uniquement) des données « moyennées » 12 ( * ) . De nombreuses études utilisant l'IRMf portent sur des échantillons de moins de quarante personnes recrutés dans des campus nord-américains et ne sont donc pas généralisables. Un article publié dans Behavior and Brain Sciences l'année dernière, intitulé « The WEIRD est people in the world » 13 ( * ) , insiste sur le fait que la plupart des expérimentations réalisées aujourd'hui le sont sur des sujets issus de sociétés occidentales, instruites, industrialisées, riches et démocratiques, d'où l'acronyme anglais WEIRD ( western, educated, industrialized, rich, democratic) qui constitue un jeu de mots, weird signifiant aussi bizarre en anglais. Cet article montre que ces résultats de psychologie et de neurosciences cognitives que nous avons tendance à généraliser sont généralement obtenus sur des populations de sujets WEIRD qui sont plus des exceptions que véritablement représentatifs de la population globale.
Cette absence de représentativité vaut pour des tâches aussi différentes que la perception visuelle, la catégorisation, l'induction ou le raisonnement moral. Nous réalisons ainsi que certains traits psychologiques que beaucoup considèrent comme universels ou invariants, sont en fait particuliers à un groupe de sujets et non généralisables sur la seule base d'une expérience de laboratoire.
Je donnerai un autre exemple dans un domaine sur lequel nous avons travaillé : l'apport des sciences comportementales et de l'étude du cerveau à la prévention en santé publique 14 ( * ) , notamment pour ce qui est du comportement alimentaire. Voir de la nourriture entraîne une activité cérébrale extrêmement variable chez les individus, selon notamment leur appartenance religieuse ou culturelle. Une méta-analyse indique ainsi une légère augmentation significative d'activité dans trois aires cérébrales, communes chez 40% des sujets, auxquels on demande juste de regarder de la nourriture. Un récent article du journal de l'Académie des sciences de New York 15 ( * ) montre que la reproductibilité pour une tâche identique réalisée dans des scanners IRMf est inférieure à 50%.
À quoi tient cette variabilité ? On se focalise aujourd'hui sur les technologies, les appareils, une forme de course à la puissance des machines, avec toujours plus de Teslas, encore qu'en ce domaine le plus ne soit pas toujours synonyme du mieux : ainsi pour les études sensorimotrices dans le cervelet, il semble qu'un scanner IRMf 1,5T soit préférable à un 3T.
Les statistiques établies sur plusieurs cerveaux, auparavant grossières, sont devenues plus fines avec des méthodes de recalage sur les sillons - je pense aux travaux de Guillaume Auzias, Olivier Coulon en France ou Armin Fuchs aux États-Unis pour ne citer que quelques unes des personnes qui font un travail remarquable dans ce domaine. Nous disposons donc de comparaisons beaucoup plus fiables qu'avant, qui ont permis de réelles avancées.
Mais étudier en tant que tel un cerveau isolé, n'échangeant aucune information, ne sert à rien. Ce qui est intéressant, ce sont les échanges au sein du cerveau lui-même, avec le corps qui l'abrite et ses environnements, physique et social. À quoi il faut rajouter la complexité du passé et du futur, qui se manifeste dans les intentions. Il n'est pas possible de tenir compte de tout cela, pas seulement pour des raisons technologiques, mais aussi théoriques. Tout simplement, parce que le cerveau est un système complexe, à savoir que même si nous connaissions parfaitement le fonctionnement de tous ses éléments constitutifs, nous ne pourrions pas en inférer son fonctionnement dans sa globalité. Cette complexité naît à la fois de sa structure et de ses interactions.
Existe-t-il des théories permettant de mieux comprendre les phénomènes observés à différents niveaux et surtout comment se relient ces niveaux ? Nous nous y employons dans le domaine de la prise de décision par exemple 16 ( * ) . Le cerveau étant un système complexe, son fonctionnement répond au principe d'auto-organisation. Dans une dynamique partagée, on étudie la concomitance d'événements à différentes échelles, allant de l'activité des réseaux de neurones au comportement et réciproquement 17 ( * ) . La question se pose aussi à propos des resting states , dont on a peu parlé, de l'activité résiduelle après activité ou encore de la connectivité fonctionnelle 18 ( * ) pour lesquels nous avons, notamment, en France, Viktor Jirsa et le Virtual Brain Project 19 ( * ) -consortium international qu'il dirige et auquel j'appartiens- au sein duquel le développement de modèles de neurosciences computationnelles est aussi important que les applications qui peuvent en découler au niveau expérimental comme médical.
Toutes ces questions font écho à des travaux qui, il y a presque vingt ans déjà, montraient, grâce à la magnétoencéphalographie, que des transitions de phase dans l'activité cérébrale avaient lieu au même moment que des transitions de phase au niveau comportemental, lors de l'accomplissement de tâches sensorimotrices 20 ( * ) : Deux phénomènes simultanés se déroulant à des niveaux extrêmement éloignés. Malgré les travaux sur la métastabilité cérébrale de Kelso, Singer, Haken et d'autres, on s'interroge encore sur cette simultanéité et son origine. Ce qui est clair est qu'on ne peut lier de manière directe et univoque l'activité de quelques millimètres cubes de matière cérébrale à un comportement complexe, comme, hélas, cela est trop souvent le cas dans les interprétations des résultats issus de l'imagerie cérébrale.
Avant de songer à utiliser l'IRMf dans des activités quotidiennes, la plus grande prudence s'impose. Prenons l'exemple de l'utilisation des données issues des neurosciences par la justice 21 ( * ) . Suite à l'organisation du premier séminaire en France sur ce que d'aucun appelle désormais « neurodroit » 22 ( * ) nous finalisons actuellement au Centre d'analyse stratégique un rapport sur le sujet qui sera publié en 2012. Nous espérons dans ce cadre échanger sur le sujet avec le Comité consultatif national d'éthique, l'Agence de la biomédecine et l'OPECST. Aujourd'hui, les données d'imagerie cérébrale peuvent être produites devant un tribunal aux États-Unis mais aucune n'a encore jamais été acceptée comme preuve à charge dans ce pays. Ces données ne sont pourtant que des compléments d'information. Nul n'a jamais été condamné outre-Atlantique sur cette seule base, comme cela a été le cas en Inde (même si la décision a par la suite été annulée), mais l'on se rapproche toujours plus du moment où une décision fera jurisprudence. Pourra-t-on un jour identifier des différences cérébrales structurelles entre des psychopathes et des personnes qui a priori ne le sont pas ? Le doit-on ? Si nous le pouvions, aurions nous le droit de ne pas utiliser ces données ?
Que cela semble encore de la science-fiction en France ne doit pas empêcher d'y réfléchir, à la fois pour améliorer la qualité des données et résoudre les problèmes éthiques que cela soulève. Le législateur ne s'y est d'ailleurs pas trompé lors de la révision des lois de bioéthique, cette année en reprenant certains de nos travaux pour modifier la loi et nous en sommes honorés. La France, toujours pionnière en matière de bioéthique, est à ma connaissance le seul pays ayant pour l'instant un volet spécifique aux neurosciences dans ces lois de bioéthiques.
Prenons un exemple, celui d'une personne jugée pour vol. Avant de prétendre exploiter l'activité cérébrale qui pourrait être observée chez la personne soupçonnée, il convient de penser aussi à l'extrême diversité des raisons possibles d'un vol : une personne qui vole parce qu'elle a faim ne se sentira pas coupable et risque donc bien d'avoir une activité cérébrale différente de celle qui vole pour voler. Toutes ces variabilités doivent être prises en compte. C'est, hélas, un voeu pieux face à toutes les démarches volontairement réductionnistes auxquelles nous participons dans nos laboratoires faute mieux ... pour l'instant et les interprétations et exploitations qui en sont faites souvent malgré nous.
En dépit de toutes ces limites, l'IRMf est un formidable outil qui nous apprend chaque jour un peu plus. Si beaucoup de secteurs privés investissent massivement dans les neurosciences et l'imagerie cérébrale, ce n'est toujours pas par philanthropie ni par amour de la recherche théorique. C'est qu'il y a de l'information à glaner. Il faut toutefois bien distinguer la réalité scientifique, si réalité scientifique il y a, de la réalité économique et marchande qui émerge autour des neurosciences.
En conclusion, au delà des questions techniques, il faut que nous avancions et développions plus de programmes de recherche fondamentales nous permettant d'élaborer des modèles de fonctionnement du cerveau sans oublier toutefois que réalité scientifique n'est pas vérité et qu'elle a de forte chance d'être malmenée voire contredite dans d'autres contextes.
M. Florian Occelli, étudiant en neurosciences . Forme-t-on déjà la société civile, et si oui comment, à interpréter et utiliser l'information brute obtenue en IRMf ? Je pense par exemple aux juges et aux jurés.
M. Olivier Oullier . La même question s'est posée il y a quelques années pour les tests ADN, bien qu'aucun parallèle scientifique ne devrait être fait avec l'imagerie cérébrale puisque pratiquer un test ADN, c'est comparer deux échantillons collectés à la même échelle, alors que lire des résultats d'imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est inférer un lien entre une activité cérébrale estimée et un comportement. Une demande sociétale peut se faire jour, d'autant que certains problèmes récents rencontrés par exemple lors d'expertises psychiatriques, poussent à explorer d'autres voies.
Que nous le déplorions ou que nous l'encouragions, il faudra former des personnes, des experts, mais il faut avoir conscience de la difficulté de la tâche, alors qu'ici même autour de cette table, entre spécialistes, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Comment former des experts, si un jour il doit y en avoir, à même d'interpréter des données issues des neurosciences et d'informer un tribunal de la manière la moins subjective possible? Il y a déjà tellement de subjectivité dans l'établissement du protocole et du traitement, avant même d'évoquer celle inhérente à l'interprétation des résultats. Les limites seront à la fois pratiques et éthiques.
M. Jean-Sébastien Vialatte . Au terme de cette audition, il me reste à vous remercier tous de votre contribution à nos travaux.
De nombreuses pistes ont été ouvertes et bien des questions ont été posées. Certaines ont trait à l'éthique, d'autres à la confidentialité, (la nécessité de disposer de larges cohortes souligne cela avec encore plus d'acuité), d'autres à l'usage qui pourrait être fait d'images cérébrales par la justice, les assurances ou les employeurs. Le problème évoqué par Mme Fagot-Largeault, de l'attitude à adopter dès lors qu'aura été dépistée chez une personne une prédisposition à une maladie neuro-dégénérative, est important. Je n'oublie pas non plus l'inquiétude exprimée par plusieurs d'entre vous quant à la possibilité de continuer à faire des recherches sur les grands primates. Nous avons bien noté également l'absurdité qu'il y a à consacrer si peu des crédits de recherche à la psychiatrie alors que les maladies du cerveau représentent 35% des dépenses d'assurance maladie. Il faut appeler l'attention des pouvoirs publics sur cette aberration. Nous nous y emploierons.
Pour l'heure, nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle audition en novembre où nous aborderons plus au fond les problèmes éthiques soulevés par les neurosciences.
AUDITION PUBLIQUE
SUR
EXPLORATION ET TRAITEMENT DU CERVEAU : ENJEUX ÉTHIQUES ET
JURIDIQUES
Mercredi 30 novembre 2011
AUDITION PUBLIQUE SUR :
« EXPLORATION ET TRAITEMENT DU CERVEAU :
ENJEUX ETHIQUES
ET JURIDIQUES »
PROPOS INTRODUCTIFS
M. Alain Claeys, député, rapporteur. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être présents parmi nous dans le cadre de cette deuxième audition publique de l'Office consacrée à l'exploration et au traitement du cerveau, pour réfléchir ensemble aux défis éthiques et juridiques lancés par ces technologies qui fascinent tant nos concitoyens et parfois les inquiètent à juste titre. Comme le savent ceux d'entre vous qui ont déjà participé à des auditions publiques, il s'agit de s'informer et d'informer, de débattre dans un contexte volontairement interdisciplinaire, en assurant la transparence des travaux menés au cours de chaque étude.
Permettre au Parlement d'évaluer en toute indépendance et au-delà des clivages politiques, les enjeux stratégiques et sociaux des avancées scientifiques et technologiques, telle est la mission de l'Office, seul organe commun aux deux chambres du Parlement.
Il s'agit pour les rapporteurs que nous sommes de suggérer si nécessaires, les réformes législatives ou règlementaires susceptibles de pallier les carences constatées. Il s'agit le plus souvent de faire des recommandations, de rappeler des règles de bonnes pratiques. En outre, les auditions publiques ont également pour objectif de débattre dans un contexte interdisciplinaire d'avancées scientifiques à cette période particulière où fleurissent des interrogations, des peurs, mais aussi des espoirs sur le progrès scientifique et technique.
L'audition d'aujourd'hui permettra nous l'espérons de dresser un tableau précis des enjeux principaux des recherches menés pour explorer, connaître et traiter le cerveau. Ce n'est pas la première fois, que l'Office s'intéresse à ces nouvelles technologies puisque dès mars 2008, dans le cadre de l'évaluation de la loi relative à la bioéthique, notre attention avait été attirée sur les problématiques que leur développement engendre. D'ailleurs, certaines des personnalités entendues en 2008 nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, et nous nous en réjouissons.
Nous avons pu constater, lors de la première audition publique en juin dernier, que d'importants progrès avaient été réalisés depuis 2008 répondant d'ailleurs à un immense besoin de connaissance et de traitement de maladies neurodégénératives et/ou psychiatriques. Les enjeux en termes de santé publique sont considérables, ainsi selon les estimations publiées en octobre dernier par l'OMS, une personne sur 4 sera atteinte d'un trouble mental à un moment donné de sa vie. En Europe, selon une étude de septembre dernier, 38,2% de la population souffrent de troubles concernant le cerveau. Les maladies les plus fréquentes sont les troubles anxieux (14%), l'insomnie (7%), la dépression majeure (6,9%), le déficit d'attention avec hyperactivité (5% chez les jeunes), la démence (30% chez les plus de 85 ans). Des millions de patients souffrent de maladies neurologiques : traumatismes cérébraux, maladie de Parkinson ou d'Alzheimer et sclérose en plaques. On ne constate pas d'augmentation du taux d'ensemble depuis l'étude précédente, en 2005, sauf pour les démences séniles du fait de l'augmentation de l'espérance de vie.
Alors que les recherches sur le cerveau font l'objet d'investissements considérables, les soins apportés aux malades et leur accompagnement social restent insuffisants. Lors de nos déplacements, en France, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis, nous avons constaté que des outils de plus en plus performants fournissaient des données, des images d'une extrême précision permettant par exemple de localiser les tumeurs, d'obtenir des précisions sur les échanges biochimiques et biophysiques, et en outre de déceler avec plus de précisions l'existence de telle ou telle pathologie neurologique, voire psychiatrique.
Des recherches plus cognitives sont en cours ; elles visent, tel le projet BlueBrain , à comprendre le fonctionnement du cerveau pièce par pièce, module par module et à créer un cerveau artificiel grâce à une gigantesque base de données approvisionnées à l'échelon mondiale. D'autres recherches visent à rentrer, en quelque sorte, dans l'intimité de la prise de décision, ouvrant des horizons passionnants mais qui inquiètent les chercheurs eux-mêmes quant aux risques d'usage détournés.
Comme je l'avais rappelé lors de la précédente audition, la loi de bioéthique du 7 juillet 2011 fait pour la première fois référence aux neurosciences et à la neuroimagenie dont elle tend à encadrer l'utilisation. Ces nouvelles dispositions prévoient d'une part que « les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d'expertises judiciaires » , et d'autre part que « le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité ».
Ce texte, inspiré des recommandations de l'Office et de la mission du bureau relative à la révision des lois de bioéthique, a été peu débattu. Il ne contient aucune disposition contraignante concernant notamment la protection des données issues de l'imagerie, faisant fi de l'une des préoccupations principales de la mission d'évaluation de l'Office. Cette situation ne rend pas aisée le travail de la Commission de l'Informatique et des Libertés (CNIL) dont nous avons entendu des responsables, qui nous ont fait part de leur demande d'un encadrement plus strict.
Il reste que la nouvelle loi relative à la bioéthique confie au Comité national consultatif d'éthique et à l'Agence de la biomédecine un rôle de veille et d'alerte sur le développement des technologies d'exploration et de traitement du cerveau. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que des membres du CCNE et les responsables de l'Agence de la biomédecine viennent s'exprimer aujourd'hui.
À ce stade de notre mission, bien des questions restent en suspens. Les techniques d'imagerie médicale offrent des vues de plus en plus précises sur le cerveau en fonctionnement. Que représentent ces images alors que le cerveau est plastique ? S'agit-il de reconstructions arbitraires faites à partir de signaux métaboliques, qui ne montrent que des corrélations entre l'état mental du sujet et l'activité cérébrale ? Peut-on alors leur attribuer un sens ou un contenu ? Par exemple en déduire les bases cérébrales, donc les causes biologiques, d'un comportement ou d'une maladie mentale ? Nos comportements, nos décisions peuvent-ils être décortiqués telles des mécaniques biologiques ? Les outils diagnostiques aident-ils à prédire les troubles psychiques, leur cause, leur évolution, ou les réponses aux traitements ?
La « manipulation » des cerveaux et des comportements par des drogues de l'humeur, de la mémoire, de l'éveil, par des implants cérébraux ou des greffes de cellules pourrait-elle devenir une pratique courante ? La recherche biomédicale et en sciences humaines et sociales pourra-t-elle aider la société à affronter ses peurs face aux défaillances psychiques, comme face à des progrès qui la fascine ?
Ces multiples interrogations alimenteront les débats de cette journée d'audition. Grâce à votre expertise, je souhaite qu'on puisse les hiérarchiser, pour éclairer le législateur, pas forcément pour légiférer, mais pour aider au développement de ces recherches, et formuler des recommandations sur certains points comme le stockage des images et des données, sujet d'actualité, à l'heure où de grands groupes spécialisés dans l'imagerie médicale réfléchissent sur ces sujets.
M. Jean-Sébastien Vialatte, député, rapporteur. Je m'associe aux remerciements de mon collègue. Quelques constats et questions. Les progrès de la neuroimagerie permettent de voir le cerveau fonctionner et d'explorer des mécanismes cérébraux qui sous-tendent la mémoire, les pensées, les émotions, les comportements. Les possibilités d'intervention et de traitement du système nerveux sont aujourd'hui multiples et ne cessent de croître, que ce soit avec des molécules chimiques, ou des procédés plus ou moins invasifs tels que l'imagerie cérébrale, la stimulation magnétique transcrânienne, les implants ou les neuroprothèses. Les systèmes d'interfaces homme/machine se développent pour pallier des handicaps, mais aussi pour accroître les capacités des individus.
Du fait du vieillissement de la population, l'incidence des maladies neurodégénératives et des accidents vasculaires cérébraux s'accroît et exige un accompagnement social adapté. Or que sait-on des mécanismes dégénératifs, de leur origine ? Quelles sont les préventions possibles ? Le dépistage est-il utile ? Quelles sont les solutions thérapeutiques ? Quelle sera la place du handicap, de la déficience cérébrale dans une société de la compétition ?
Nos moyens se multiplient pour aider à la performance physique, intellectuelle, soutenir la mémoire - ou l'oubli - intervenir par neurochirurgie, neurostimulations, neuroappareillages, greffes de cellules ou de nanodispositifs, lesquels fusionnent électronique et neurones et contribuent à la convergence des technologies. Quels sont ces outils ou drogues et leurs usages ? Quels sont les intérêts économiques en jeu ? Qui y aura accès ?
La rapidité avec laquelle neurosciences et neuroimagerie conquièrent notre société est déconcertante. Les progrès dans ce domaine sont très médiatisés, ce qui raccourcit le temps consacré à la réflexion pour en définir le sens et les conséquences. L'avancée technique est mise en oeuvre avant même que l'on ait pu réfléchir à son impact. Or l'expertise confortée par la neuroimagerie et les neurosciences est souvent interprétée comme une vérité ce qui nourrit de fortes espérances concernant le traitement et la prévention des maladies neuropsychiatriques très invalidantes et questionne cependant. Que devra-t-on soigner avec quelles possibilités et quelles limites? Ce sera l'objet de notre première table ronde.
Quelles seront les implications éthiques et juridiques de ces avancées ? Comment annoncer et gérer la découverte par imagerie d'une pathologie neuropsychiatrique incurable, alors que la personne ne présente aucun symptôme?
Qu'advient-il en effet du concept de responsabilité individuelle si l'on admet qu'un comportement déviant trouve une origine cérébrale ? Cela est d'autant plus étrange que l'imagerie par résonance magnétique (IRM), ne peut fonctionner que si la personne étudiée est consentante. Malgré ces avertissements, la littérature regorge de résultats laissant croire que l'imagerie cérébrale permettrait de prévoir la déviance, voire d'anticiper ou d'expliquer un comportement délictueux au mépris d'ailleurs de l'existence démontrée de la plasticité cérébrale.
En France, aucun procès utilisant la neuroimagerie comme preuve unique n'a encore eu lieu, mais ce n'est pas le cas aux États-Unis où elle a été utilisée dans nombre de procès au pénale comme au civil. Du détecteur de mensonge classique utilisé à l'embauche à des procédés plus sophistiqués de détection du mensonge par IRM, cet usage est répandu aux États-Unis, il pourrait si on n'y prend pas garde gagner l'Union européenne.
Comment limiter les risques d'utilisation abusive des informations diagnostiquées et leur impact prédictif par la justice, les compagnies d'assurances ou les services de marketing? Ces thèmes seront sans doute abordés lors de la deuxième table ronde.
Jusqu'où peut-on modifier l'humain ? Pour quoi faire ? Avec quels risques ? Le cyborg sportif ou militaire intégrant la machine dans l'homme, est-il nécessaire ? Le recours à ces technologies pour augmenter artificiellement la performance est possible. Mais qu'adviendra-t-il si l'on commence à les mettre en oeuvre pour augmenter la mémoire, améliorer les vitesses de calcul, ou toutes sortes de performances dans des contextes militaires ou sportifs ? Qui décidera de la frontière entre réparation et amélioration, alors que le coût de ces technologies en réduira l'accès ? Risque-t-on de modifier l'humain ou plus simplement le comportement d'une personne ? Ces sujets seront débattus lors de la troisième table ronde.
Le développement exponentiel de l'imagerie cérébrale et des neurosciences couplé à celui des nanotechnologies, des biotechnologies et de l'informatique induit une accélération de leur convergence. Cela génère des inquiétudes et un besoin de débattre. On sait que les images cérébrales influencent fortement celui qui les regarde. En quoi changent-elles les perceptions de chacun et plus globalement de la société ? Comment s'organise l'interaction entre ces avancées, les exigences et attentes d'une société fascinée et parfois instrumentalisée par les images.
Le détournement à des fins non thérapeutiques de ces techniques par des manipulateurs d'images soucieux d'influencer les choix, et les décisions progresse. Le nombre d'entreprises dédiées au neuromarketing n'a cessé de croître. Quel est l'impact de ces techniques ? Nous nous interrogerons sur ces perceptions lors de la quatrième table ronde.
M. Alain Claeys. La parole est à Hervé Chneiweiss qu'il n'est plus nécessaire de présenter et qui est membre du conseil scientifique de l'Office.
M. Hervé Chneiweiss, directeur de recherche, groupe «Plasticité gliale et tumeurs cérébrales» au Centre de psychiatrie et neurosciences de l'Université Paris-Descartes, membre du Conseil scientifique de l'OPECST. Une fois de plus, on s'aperçoit que l'Office joue particulièrement bien son rôle, en sortant de la spécificité de chaque champ disciplinaire - scientifique, juridique et éthique - pour élaborer une politique. Vous avez bien précisé le sujet. Aussi m'emploierai-je à simplement le situer.
Il s'agit d'abord à mon sens d'identifier les tensions, la discussion éthique devant s'efforcer de mettre en balance les arguments. Comme vous l'avez expliqué, le premier impératif est celui du soin, qu'il soit lié au handicap constitué- la sclérose en plaque étant le premier handicap pour les jeunes - ou à la perte d'autonomie liée aux maladies neurodégénératives et aux maladies psychiatriques. Vous avez évoqué la santé publique. La maladie est un aléa qui dépend peu du mode de vie de l'individu pour les maladies neurologiques. Au contraire, les addictions, les troubles du sommeil sont des exemples mêmes de pathologies qui n'existent que dans un contexte social. Le second impératif à considérer sera donc que tout système nerveux, tout cerveau agit dans un environnement social. Nous y reviendrons.
Vous avez également évoqué l'impératif économique. En termes de dépenses de santé, il s'agit bien sûr d'une charge, mais aussi d'un investissement et dès lors qu'on évoque l'éducation, la lutte contre le handicap, le traitement de la maladie même cet investissement peut devenir une source colossale d'innovations technologiques et de richesses. Le fameux rapport sur la convergence Nano-Bio-Info-Cognitif (NBIC) que portait Newt Gingrich, à l'époque Speaker de la Chambre des Représentants - aujourd'hui un des candidats républicains à l'élection présidentielle américaine - envisageait ainsi en centaines de milliards de dollars le marché potentiel de cette convergence, le cerveau étant au centre de cette convergence. Selon une récente étude, les maladies neurologiques et psychiatriques représentent un coût, ou un marché, évalué à 798 milliards d'euros en 2010 pour les 27 pays de l'Union européenne.
Face à cela, nous sommes confrontés au questionnement moral. Le cerveau reste la dernière frontière de notre intimité, le lieu d'exercice de notre liberté sur lequel est fondé tout notre système politique. Une telle situation oblige à retrouver une nouvelle définition sociale de cette liberté, sachant que l'essentiel de notre activité est inconsciente. Les intervenants, à n'en pas douter, montreront qu'on peut être libre, même si nous ne sommes pas conscients de cette liberté.
Par ailleurs, des questions se posent sur la mise à disposition des moyens d'intervention sur notre cerveau, générant de nouvelles tensions entre soins et utilisations « déviantes », et je pense en particulier à l'amélioration cognitive : mythe ou réalité ? S'il y a bien une chose claire pour le système nerveux, c'est que plus n'est pas synonyme de mieux. Voyez l'exemple de la mémoire. Des neuropsychologues comme Alexander Luria ont mis en avant des exemples d'hypermnésies, de sujets qui retiennent tout, mais ne sélectionnent rien. Ce sont souvent des personnes malheureuses et mal insérées dans la société. Il ne s'agit donc pas d'augmenter des capacités, comme on le ferait avec un stockage de mémoire pour un disque dur d'ordinateur, mais d'accroître la capacité de traitement de cette information. Ces questions suscitent d'abord des craintes, celles d'abus, mais on peut également penser à des conséquences positives comme améliorer nos méthodes d'enseignement, ou mieux comprendre des processus sociaux comme la violence.
Améliorer pour qui ? Améliorer quoi ? Telles sont les questions essentielles, dans une société de la compétition, de la productivité, exigeant toujours plus de chaque individu. En oubliant le lien social et le fait que ce sont en général des processus coopératifs dans les sociétés humaines qui produisent les meilleurs résultats, on risque d'élaborer de très mauvaises décisions. Je l'ai déjà dit : il faudra systématiquement réinscrire le cerveau de chacun de nous dans son environnement social.
On pourrait reprendre les travaux de Michel Foucault sur le souci de soi, la pratique de la parésia chez les Grecs et les Romains, pratique qui tendait à produire un discours de la vérité sur soi-même. Je vous renvoie au Souci de soi de Michel Foucault, et à ses deux derniers séminaires, où il démontre avec brio comment le souci de soi et la capacité d'un discours vrai sur soi-même n'existent que dans le regard de l'autre et l'interaction avec les autres. Un cerveau isolé n'existe pas, même si c'est cet objet que nous étudions bien souvent. Encore faut-il souligner que certaines expériences tendent à étudier maintenant les performances étonnantes de ce cerveau social. Citons une expérience récente consistant à mettre deux personnes dans deux IRM fonctionnelles en parallèle et on cherche alors à analyser les couplages des activités des cerveaux entre une personne et l'autre. Cette expérience démontre que la compréhension d'un récit dépend de la capacité de l'auditeur d'anticiper les événements de ce récit.
Une autre question d'éthique apparaît : le dépistage. Dépister pour qui, dépister pour quoi ? Nos machines vont nous permettre de diagnostiquer de plus en plus tôt une maladie neurodégénérative. À quoi bon dépister si on ne dispose d'aucun moyen de prévention ou de traitement ? Cela induira des interrogations sur les maladies pour lesquelles l'imagerie et les biomarqueurs commencent à apparaître, sans que les traitements soient au rendez-vous. Dépister au risque de la stigmatisation ? Avec Jean-Claude Ameisen, nous avions travaillé sur les tests de dépistage de l'autisme dans le cadre du comité d'éthique de l'INSERM. Quelles sont la fiabilité et la sensibilité du test ? Que signifie un vrai positif sur dix cas, et donc neuf faux positifs, sur lequel se sera porté le regard inquisiteur ou affolé des parents et de l'entourage? Quel est le risque de déterminer des terrains favorables à l'éclosion éventuelle d'une maladie neurologique ou psychiatrique? Vous avez mentionné l'assurance. On pourrait y adjoindre l'emploi ou, plus simplement le mode de vie (alimentation, sport, interactions sociales).
Le rôle de la science, est de comprendre et, si possible, de prédire. Il faut éviter de confondre le dépistage de processus élémentaires et la possibilité d'exercice d'un pouvoir ou d'une maîtrise sur ces processus. Avoir la maîtrise de la langue, c'est être capable de lire tous les livres d'une bibliothèque, mais cela ne vous permet pas de prédire qui aura le prix Goncourt l'année prochaine.
Depuis les expériences fondatrices de Benjamin Libet, voici vingt-cinq ans, on sait que nos processus mentaux sont inconscients, que nous anticipons tout, et que nous recréons le monde autour de nous. Imaginez simplement que la structure de notre rétine contient une tâche aveugle. Comme les taureaux, nous devrions avoir un scotome, un trou aveugle au centre de l'oeil. Or notre cerveau reconstitue une image complète. C'est vrai aussi de l'anticipation que nous faisons de chaque chose, y compris de récits, comme l'ont démontré des expériences d'imagerie cérébrale.
Des horizons nouveaux s'ouvrent à nous, pour soigner les troubles, pour le vivre ensemble aussi. « On entre en éthique quand à l'affirmation pour soi de la liberté s'ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit. Je veux que ta liberté soit », expliquait Paul Ricoeur. Tel est l'enjeu de l'éthique, mais aussi de la science et de la politique. Nous verrons aujourd'hui comment les merveilleuses avancées en neurosciences peuvent alimenter la liberté de l'autre et comment, grâce au législateur, nous pourrons mettre des limites à ces entraves à la liberté de l'autre.
En 2014, la semaine européenne du cerveau aura lieu. Comme introduction à cette journée, je vous propose de visionner un clip de l' European Brain Council
Il est procédé à la diffusion du clip.
M. Jean- Sébastien Vialatte. Je vous remercie pour cette présentation et appelle les intervenants de la première table ronde, intitulée : Que doit-on soigner ? Possibilités et limites ?
QUE DOIT-ON SOIGNER ? POSSIBILITÉS ET LIMITES ?
M. Grégoire Malandain, directeur scientifique adjoint à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA). Je présenterai brièvement l'activité de l'INRIA en matière d'exploration et du traitement du cerveau. L'INRIA est un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) tourné vers les mathématiques et l'informatique. Aussi pourrait-on s'interroger sur le lien avec le cerveau, les sciences de la vie ne faisant pas partie de notre champ d'investigation. Comme tout EPST, nous avons plusieurs missions, la première, de recherche, mais aussi des missions importantes de transfert et de valorisation. C'est dans ce deuxième cadre qu'on peut comprendre le transfert vers les sciences de la vie.
L'INRIA est organisé en cinq domaines de recherche. Les quatre premiers tournent autour de notre coeur de métier : l'informatique et les mathématiques. Le cinquième est tourné vers les applications. Aussi sommes-nous convaincus que les sciences de l'information peuvent conduire à des avancées majeures dans des domaines applicatifs. Parmi tous ceux dans lesquels on peut retrouver les sciences de l'information, on en distingue quelques-uns que l'on considère comme prioritaires, à savoir l'environnement et les sciences de la vie.
Pour les afficher comme priorités de l'Institut, nous avons créé un domaine à part entière, dans lequel on essaie de favoriser la recherche mêlant les sciences de l'information et de la communication, à ces domaines applicatifs privilégiés que sont l'environnement et les sciences de la vie. Telles sont les raisons pour lesquelles une partie de la recherche de l'INRIA se trouve tournée vers les sciences de la vie. L'INRIA est convaincu que, dans ses stratégies scientifiques, les sciences de la communication sont un apport considérable.
L'autre spécificité de l'INRIA est son organisation en équipe-projets. Il s'agit de petites structures, de dix à trente personnes, avec quelques permanents. Chacune de ces structures est chargée d'un projet scientifique très précis et proposé dès le début. Une telle organisation permet une recherche configurable, la vie des équipes-projets étant réduite dans le temps. Aussi, les configurations des chercheurs et des équipes peuvent être différentes au cours du temps, et sont beaucoup plus adaptables aux préoccupations sociétales, aux nouveaux sujets de recherche. Bien que l'envergure de chaque équipe soit réduite d'un point de vue scientifique, nous sommes aussi adaptables en mettant en place des actions incitatives, coordonnées, qui permettent de regrouper plusieurs équipes, plusieurs compétences, et pas seulement celles du domaine applicatif. Elles peuvent ainsi intégrer des équipes de domaines fondamentaux en mathématique ou en informatique, pour traiter de problèmes d'envergure, comme la modélisation d'organes entiers. Pour cela, il faut des spécialistes de l'organe, mais aussi des spécialistes en calcul numérique ou en informatique.
Que peut-on soigner ? Plutôt que d'essayer de répondre à cette question, l'INRIA n'ayant pas vocation à y répondre du fait de sa spécialisation informatique et technique, je dresserai un panorama des activités de cet organisme dans l'exploration et le traitement du cerveau. Ce panorama débutera par les neurosciences calculatoires ou computationnelles. De fait, nous allons tenter de modéliser pour comprendre, modéliser pour expliquer, mais aussi pour prédire. Les chercheurs de l'INRIA manipulent des objets mathématiques. Aussi vont-ils mettre au point des modèles du cerveau, du neurone, d'une assemblée de neurones, mais aussi d'un réseau d'aires corticales, chacune avec sa fonction. Les applications des neurosciences computationnelles visent évidemment une meilleure compréhension du fonctionnement, telle la compréhension du système olfactif, qu'on essaie de modéliser complètement. À des échelles plus grandes, on tend vers des applications plus ciblées, comme comprendre les mécanismes de l'anesthésie. Pour cette étude précise, un chercheur de l'INRIA a obtenu une bourse du Conseil européen de la recherche (CER- ERC), un des buts de cette recherche étant de comprendre pourquoi l'anesthésie a parfois des disfonctionnements ou pourquoi le patient ressent parfois des douleurs. De la modélisation, on peut passer à des applications thérapeutiques.
À l'échelle fonctionnelle, on essaiera de comprendre comment fonctionne un réseau d'aires corticales, ou bien la mémoire, pour des applications relatives aux troubles de la mémoire, telle que dans la maladie d'Alzheimer, et comment stimuler le cerveau pour retarder ces troubles. On essaiera également de comprendre le lien entre la vision humaine et la vision par ordinateur. Sur ce sujet, un chercheur confirmé, Olivier Faugeras, a bénéficié d'une bourse CER pour faire le lien entre la vision humaine et la vision par ordinateur, son champ d'investigation premier étant la compréhension des mécanismes de la vision dans le cerveau. Enfin, la compréhension de l'activité corticale permet aussi de construire des modèles d'interface entre le cerveau et l'ordinateur.
Certaines modélisations ne sont pas liées au cerveau, mais aux pathologies. Tout un champ de notre investigation porte sur la modélisation des tumeurs et de leur croissance. Comment une tumeur naît et se développe ? Quels sont les mécanismes impliqués au niveau cellulaire, mais aussi macroscopique ? Au niveau cellulaire, le cycle de vie des tumeurs et des cellules permet d'optimiser la thérapie. Nos chercheurs travaillent ainsi sur la chronothérapie : comment adapter le temps de délivrance des médicaments pour optimiser l'acte thérapeutique ? Au plan macroscopique, on essaie de comprendre la croissance tumorale, car il y a ce qu'on voit de la tumeur dans l'imagerie et ce qu'on ne voit pas, à savoir les infiltrations microscopiques. Nous sommes ainsi convaincus que pour obtenir une radiothérapie adaptée, il faut définir les marges non par rapport à ce qu'on voit, mais par rapport à ce qu'on estime être l'invasion microscopique de la tumeur. Sur ce sujet, il existe un modèle mathématique de croissance des tumeurs, qui prendra en compte un certain nombre de données personnalisées du patient, comme la direction des fibres de matière blanche, direction privilégiée pour l'invasion tumorale, mais aussi l'anatomie du patient.
Certains modèles sont physiologiques pour la tumeur, mais mécaniques pour toutes les contraintes liées aux tissus et aux déformations qui interviendront On dispose ainsi de modélisations sur l'agrégation des protéines amyloïdes, pour comprendre de quelle manière elles s'agrègent, se polymérisent. Par la construction de modèles, on essaie de comprendre quelles sont les pistes thérapeutiques qu'on pourrait essayer de mettre en oeuvre pour empêcher la polymérisation, recherche fondamentale qui renvoie à toutes les maladies amyloïdes, de type Alzheimer ou aux maladies à prions.
Si l'on prend l'exemple d'une croissance de tumeur simulée, qui envahit le cerveau par effet de masse, on montre que la tumeur repousse les structures du cerveau, comme le ventricule. Aussi peut-on modéliser la croissance de la tumeur, en prenant en compte toutes les contraintes biomécaniques liées à cet apport de matière dans le milieu clos, à l'intérieur du crâne, qu'est le cerveau. Ce faisant, on peut mieux prédire et mieux définir l'invasion microscopique.
Quelles informations peut-on extraire de l'imagerie anatomique ou morphométrique ? En la matière, on dispose de modèles mathématiques de courbe et de surface. L'objectif est de tendre vers des réalisations dans un cadre formel bien posé. On essaiera de réaliser des modèles moyens au sein de populations. Lorsqu'on extrait des surfaces, on se demande comment faire des moyennes de surface : avec des nombres, faire des moyennes est simple, mais avec des objets c'est plus compliqué ; cela exige des cadres mathématiques qui le permettent. Les applications concernent l'imagerie, l'extraction des fibres dans le cerveau, l'étude de populations et de groupes. Pour l'autisme, par exemple, on pourrait mettre en évidence une différence de forme de l'hippocampe.
Comment passer de conclusions sur une étude de groupe à un diagnostic personnalisé et individuel ? C'est toute la difficulté, étant entendu que ce n'est pas parce que l'on obtient des résultats sur des groupes qu'on peut en déduire des conclusions directes pour un diagnostic individuel. Il est possible d'utiliser ces outils dans toute série d'études cliniques.
En matière d'imagerie anatomique, il convient de souligner l'apport d'expertise à un niveau individuel, tels les atlas anatomiques numériques qui serviront à la radiothérapie, lorsqu'il faut contrôler la quantité de radiation sur des organes à risque. L'INRIA collabore une société française, Dosisoft, qui développe un logiciel de planification de radiothérapie. Un atlas de noyaux gris centraux est utilisé pour l'implantation d'électrodes pour le traitement des symptômes de la maladie de Parkinson ; ce travail réalisé en collaboration avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, permet de savoir à quels endroits placer les électrodes. Un transfert vers une société a été réalisé, preuve que l'INRIA procède de la construction de la recherche jusqu'au transfert. On est aussi particulièrement actif s'agissant de la sclérose en plaque, raison pour laquelle l'institut participe au traitement des données dans le projet de cohorte sur ce sujet financé dans le cadre du grand emprunt des infrastructures d'avenir. En matière de stimulation magnétique transcrannienne, une start-up de l'INRIA s'occupe de la neuronavigation pour voir comment positionner au mieux l'appareil de stimulation pour viser une zone précise du cerveau.
En matière de neuroscience cognitive, on étudie l'activation du cerveau au niveau local, et du réseau, pour comprendre comment le cerveau fonctionne dans son ensemble, afin de modéliser et prédire son activité lorsqu'il sera soumis à certains stimuli. Il s'agit aussi de reconstruire l'activation à partir de données de magnéto-encéphalographie, avec des applications directes en matière d'interface ordinateurs/cerveaux.
Pour ce dernier sujet d'actualité à l'INRIA, plusieurs pistes de recherches sont explorées, d'abord en matière de traitement des signaux, pour reconnaître l'activation, puis chercher les activités cérébrales cibles qu'on utilisera pour la détection, et pour développer des appareillages optimaux pour la capture de cette activation. D'autres pistes touchent aux traitements des données et aux paradigmes d'interactions adaptés. Comment faire, à partir de signaux qu'on capture, pour proposer à l'utilisateur une manière d'utiliser ces paradigmes pour atteindre un but.
En matière d'application, on pense aussi à toutes les situations de handicap. La première application qu'on peut imaginer est le déplacement d'une chaise roulante commandée par la pensée. La recherche en la matière ouvre des perspectives dans bien d'autres domaines, comme la navigation sur Internet, l'accès aux jeux vidéo, dimension ludique qui permet de donner aux personnes en situation de handicap l'accès au monde de tous, et d'éviter un phénomène d'exclusion. S'agissant du cerveau, l'INRIA s'est focalisé sur des interfaces non invasives, avec un cadre externe. C'est pour des considérations éthiques que nous avons fait ce choix, même si d'autres se lancent dans l'invasif.
Il faut bien comprendre que ces recherches sont par nature interdisciplinaires ou pluridisciplinaires. C'est un axe applicatif identifié comme priorité à l'INRIA par son plan stratégique. Dans le domaine des sciences de la vie, ce sont 31 équipes sur 178 qui sont concernées. La diffusion se fait à différents niveaux, la première étant académique. En matière d'imagerie médicale, on remarquera que l'INRIA est à l'origine d'une revue majeure du domaine, Medical Image Analysis . La diffusion est aussi logicielle. Aussi existe-t-il un logiciel phare et reconnu de l'INRIA pour les interfaces cerveaux/ordinateurs non invasifs. Mais on encourage aussi une diffusion industrielle par des transferts.
Cette recherche ne s'effectue que dans un cadre pluridisciplinaire, en collaboration forte avec des équipes médicales ou cliniques. L'interface se fait à différents niveaux. L'INRIA accueille ainsi des chercheurs pluridisciplinaires, des équipes communes à l'université ou à l'INSERM. Ces collaborations permettent d'identifier en amont les problématiques.
Que soigner ? Ce n'est pas l'INRIA qui décidera ce que sont les objets d'intérêt en termes thérapeutiques pour le cerveau, mais des collaborateurs scientifiques. Ces collaborations perdureront pendant la recherche, pour être sûr que notre recherche a un intérêt, allant jusqu'aux problématiques de validation. On notera ainsi que l'INRIA est présent dans trois des Instituts hospitalo-universitaires (IHU) sur les six acceptés lors du dernier appel à projet.
Modéliser totalement un cerveau ? En matière de défis scientifiques, la complexité est de plus en plus grande dans les modèles, mais aussi dans les données. De fait, on dispose de plus en plus de données, hétérogènes et multimodales. Nous sommes confrontés à des problèmes liés à la validation des modèles, à la personnalisation. La dimension éthique doit être prise en compte avec les interfaces cerveaux/ordinateurs non invasives, en raison de l'apport éthique pour les handicapés : comment réaliser les études ? Il faut de la réactivité par rapport à l'actualité, les avancées étant très rapides. Comment parvenir à construire des consortiums pluridisciplinaires et interdisciplinaires pour répondre aux enjeux ?
M. Jean- Sébastien Vialatte . Je vous remercie pour ce panorama et donne la parole à M. Andréas Kleinschmidt, conseiller scientifique auprès du directeur de l'Institut d'imagerie biomédicale du CEA.
M. Andréas Kleinschmidt, directeur de recherche, conseiller scientifique auprès du directeur de l'Institut d'imagerie biomédicale du CEA-NeuroSpin/Laboratoire de neuroimagerie cognitive (LCOGN). Neurologue de formation et directeur de recherche dans une unité INSERM implantée au centre CEA de Saclay, je travaille dans un institut dédié à la neuroimagerie à haut champ, NeuroSpin.
Comme neurologue, je crois qu'une première réponse à la question « que doit-on soigner » est fournie par l'épidémiologie. En la matière, deux paramètres sont pertinents. La première est la prévalence et répond à la question suivante : combien, à un moment donné, de patients sont-ils atteints d'une maladie donnée ? La seconde est l'incidence, et répond à la question suivante : combien de patients se présenteront dans une année avec le diagnostic d'une maladie ? Selon ces deux paramètres, la maladie la plus pertinente, ce sont les accidents vasculaires cérébraux, (AVC) suivie, au niveau de l'incidence, par la maladie d'Alzheimer, en rapide croissance. La répercussion sur la prévalence est cependant moins importante, sachant qu'il s'agit de patients pour la plupart âgés. La situation est différente pour l'épilepsie qui démarre bien plus tôt dans la vie, et génère une forte prévalence.
Un troisième paramètre à prendre en compte est l'impact de ces maladies. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) utilise le paramètre des années perdues du fait d'un décès précoce ou d'un handicap sévère - espérance de vie corrigée par an Disability Adjusted Life Year (DALY)- les maladies neurologiques représentent plus de 10 % des DALY, toutes maladies confondues. En y ajoutant les maladies mentales, on atteint un taux de plus d'un tiers des DALY dus aux dysfonctionnements du cerveau. Pour les maladies neurologiques, les AVC ont le plus d'impact, suivis par la maladie d'Alzheimer ; même une maladie comme la migraine, considérée comme banale, prend de l'importance.
Quel est l'apport de la neuroimagerie ? Quelle est la pratique clinique ? En matière d'AVC, si un patient se présente dans un service spécialisé, on peut, grâce à l'IRM, en un quart d'heure obtenir plusieurs informations, relatives aux neurones qui sont en train de mourir par manque d'oxygène, la région des neurones en péril du fait d'un débit sanguin réduit, et l'occlusion de l'artère à l'origine de l'AVC. Si le patient se présente rapidement après le début des symptômes, on peut appliquer une thrombolyse et guérir l'accident. Il faut cependant admettre que moins de 10 % des patients bénéficient de ce traitement.
La maladie d'Alzheimer qui, contrairement à l'AVC, est lente et progressive, commence souvent à un âge avancé, avec une période de transition. De nos jours, grâce à une combinaison de plusieurs marqueurs, et de la neuroimagerie, on parvient à des possibilités de prédire la conversion pendant cette phase transitoire vers un état justifiant le démarrage d'un traitement efficace. Cependant, les effets liés à ces traitements sont très faibles et peu satisfaisants, au point qu'en Angleterre, la sécurité sociale ne rembourse plus ces médicaments.
Quels sont, en matière de maladies neurodégénératives, les bénéfices liés à l'application de l'imagerie à haut champ ? La maladie de Parkinson concerne une famille de neurones, qui vont mourir dans un noyau central qu'on appelle la substance noire. On la traite souvent par médicaments, le traitement pouvant être satisfaisant pendant plusieurs années. Si le traitement fluctue chez certains patients, on peut implanter des électrodes pour effectuer une stimulation cérébrale profonde. Grâce à la neuroimagerie, la structure la plus ciblée est bien mieux identifiable.
Dans le cas de l'épilepsie, la neuroimagerie permet de mettre en évidence une altération de la structure et du volume de la région du cerveau d'où émergent les crises. Elle permet de clarifier l'origine de l'épilepsie, et d'informer en vue d'une approche neurochirurgicale.
Dans le cas de la sclérose en plaque, la neuroimagerie est par exemple utile lorsqu'un patient se présente avec une inflammation du nerf optique comme premier et seul symptôme. Grâce à l'IRM, on pourra le cas échéant mettre en évidence plusieurs manifestations préalables de cette maladie qui ont précédé l'épisode actuel, sans pour autant générer des symptômes, ce qui justifie le démarrage d'un traitement d'immunomodulation qui réduira la fréquence et l'impact des épisodes futurs de cette maladie.
À l'heure actuelle, nous disposons donc de moyens de diagnostic bien plus considérables qu'il y a dix ans. Il reste cependant certains verrous de diagnostic. Pour la plupart des maladies neurologiques, l'origine étiologique est inconnue. Pour limiter les AVC, on peut conseiller de ne pas fumer ou de manger sainement. Il est déjà plus difficile d'éviter de vieillir, autre facteur de risque majeur pour un AVC. Tous confondus, les facteurs de risque connus expliquent seulement 50 % de la variabilité dans les AVC. Reste donc le manque de connaissances très important, pour une maladie aux causes souvent considérées comme banales et dépendantes de l'amélioration du comportement du patient.
Pour l'origine des grandes maladies neurologiques, on pourrait soupçonner qu'il existe toujours une base génétique, mais on n'est pas en situation d'identifier les gènes ou leurs altérations qui expliquent une maladie. On a identifié des gènes qu'on peut considérer comme des facteurs de risque ou susceptibilités de développer une maladie. Nous sommes très loin de faire le lien entre ces altérations génétiques et les mécanismes qui détermineront le moment et la nature de la manifestation de la maladie. Néanmoins, la capacité de diagnostic est relativement bonne, on se trouve souvent en mesure de détecter une maladie et de prendre les mesures préventives avant des manifestations cliniques.
À mon sens, les verrous sont plutôt thérapeutiques, la plupart des traitements dont on dispose, étant purement symptomatiques, à l'exception, sans doute, de ceux pour la sclérose en plaque. On se trouve donc face à un problème éthique important, qui tient à la dissociation entre notre capacité de diagnostic et nos moyens de traitement. N'est-il pas problématique de s'orienter vers une médecine prédictive ? Ainsi, si l'on peut, grâce à l'étude génétique ou d'autres biomarqueurs, prédire les risques de survenue de certaines maladies, on n'est pas en mesure d'offrir les moyens de les prévenir.
M. Jean- Sébastien Vialatte. Je vous remercie pour cette présentation et donne la parole à M Lionel Naccache, professeur de médecine, neurologue, chercheur en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM).
M. Lionel Naccache, professeur de médecine, neurologue, chercheur en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Que peut-on soigner ? Possibilités et limites ? J'ai adapté ce titre à un type d'exploration, les explorations fonctionnelles que la neuroimagerie peut nous offrir. La neuroimagerie fonctionnelle utilise des techniques comme l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomographie à émission de positron (TEP) Positron emission tomography (PET) en anglais, PETscan électro-encéphalogramme (EEG) ou les techniques électro-magnétoencélographiques (MEG), tout ce qui peut donner à voir du fonctionnement de l'activité cérébrale.
En premier lieu, il est important de souligner que le développement de ces techniques ne s'accompagne pas d'un appauvrissement de l'expertise clinique. Lorsqu'on évoque l'application médicale de ces outils, d'aucuns pensent qu'on voit tout, qu'on n'aurait plus besoin de procéder à un examen clinique, ou que l'IRM se substituerait au médecin ou au soignant. À mon sens, cette idée est largement fausse, plus on développe ces outils, plus les besoins d'expertise se font sentir. Avec une IRM, on observe de nombreux phénomènes. Or la relation entre ce que l'on voit sur une image et ce que le patient présente comme troubles est encore plus difficile à comprendre que lorsque l'on ne disposait pas du tout d'images ou bien d'images de moins bonne qualité, comme avec le scanner. Le développement de ces techniques présuppose un développement d'une expertise de compétence clinique de nos collègues.
M. Alain Claeys . Sur ce point précis, y a-t-il un fossé entre la qualité de l'image et l'interprétation clinique ?
M. Lionel Naccache. Comme Andréas Kleinschmidt, j'ai une activité de neurologue et de chercheur. Lorsque vous êtes neurologue clinicien, vous êtes face à des situations où vous avez du mal à interpréter les images. Dans le cas par exemple d'hyper signaux de la substance blanche chez un sujet de soixante ans, mettre en relation ces images avec son état cognitif, son état vasculaire, est une question difficile. Autre exemple, avec une IRM médullaire pour un patient qui se plaint d'un lumbago ou d'une sciatique, vous observerez de nombreuses perturbations. Pour autant, mettre en relation des images avec ces symptômes n'a rien d'évident. On entend tous les jours des informations sur une inadéquation de l'image avec un tableau clinique. Le développement de ces techniques exige de développer nos compétences cliniques.
Il faut ajouter les progrès considérables en matière d'imagerie. Quand j'ai commencé à la pratiquer il y a quinze ans, je n'aurais pas pu imaginer les avancées actuelles. Cette notion de vitesse est importante, notamment au regard du contexte juridique. Il faut, selon moi, pouvoir conserver une certaine souplesse, la formalisation juridique pouvant se révéler obsolète deux ans après. On a du mal à prévoir la capacité d'évolution de ces techniques.
La place de la recherche avec les malades est importante et particulière dans ce domaine. La recherche avec les malades du cerveau a un double sens. Comme partout en médecine, la recherche est faite pour soigner les malades. Mais l'étude du cerveau malade apprend surtout le fonctionnement du cerveau normal. En 2014, on célébrera les 150 ans de la découverte de Pierre-Paul Broca. Lorsqu'on étudie un patient qui présente une lésion de l'aire de Broca, on en apprend plus sur les aires du langage du cerveau de l'homme en bonne santé. En étudiant des amnésiques, on met en évidence d'autres formes de mémoire. Ce faisant, on enrichit notre connaissance du fonctionnement normal du cerveau.
La recherche avec les malades du cerveau est donc à double sens. Elle est extrêmement informative, surtout dans le domaine des neurosciences, quand les patients « caricaturent » une fonction mentale, ce qui nous permet de comprendre cette fonction.
Sur les explorations fonctionnelles, il faut bien avoir en tête une limite très importante. Bien souvent, les tests fonctionnels n'ont de valeur que s'ils sont positifs. Si un test est négatif, on ne peut bien souvent pas en conclure grand-chose. On peut ainsi commencer à faire des tests en IRM fonctionnelle ou en potentiel évoqué, qui utilisent de l'EEG, pour inférer l'état de conscience. Un malade avec lequel on ne peut pas communiquer est-il conscient ou pas ? Lorsque ces tests sont positifs, il est possible de répondre par l'affirmative, mais quand ils sont négatifs, ce qui est un cas fréquent, on ne peut pas répondre. Or, ils peuvent être négatifs pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la question posée. Ce n'est en revanche, pas le cas de l'imagerie structurale, car si vous cherchez par cette technique une tumeur, et si l'examen est négatif, vous pouvez être assez certain de la réponse.
Dans le cas d'un test de conscience et de la situation d'un malade qui ne communique pas, on cherche à savoir s'il est conscient en lui faisant écouter des sons. Si le malade dort sans qu'on le sache, il n'est donc pas conscient, ce qui ne signifie pas qu'il ne l'est jamais. Question moins triviale : peut-être est-il éveillé, mais sourd ou aveugle ? Un patient peut être conscient, mais avoir du mal à comprendre le langage, avoir une attention qui fluctue ou être incapable de maintenir une attention pour réaliser une tâche cognitive. Tel n'est pas le cas pour les tests fonctionnels pour des raisons triviales et complexes. Les tests fonctionnels auront, dans bien des situations, une valeur prédictive très forte quand ils sont positifs, mais beaucoup plus faible quand ils sont négatifs. Une partie de cette réponse n'est pas uniquement liée à un problème de technique, mais à la question posée avec des tests fonctionnels.
L'exploration fonctionnelle par la neuroimagerie peut essayer de résoudre trois questions. La première est d'inférer un corrélat causal, d'essayer de mettre en évidence l'activation d'un réseau d'aires cérébrales, causalement impliqué dans une tâche ; question très importante, qui commence à avoir des implications cliniques ; ce n'est pas de la science- fiction. Lorsqu'un chirurgien veut opérer un malade et souhaite connaître ses aires du langage, on procède souvent à un test pharmacologique, le test dit de Wada ; on injecte dans une carotide un barbiturique pour anesthésier un hémisphère et voir si le patient perd le langage et déterminer ainsi la latéralisation du langage. Depuis une dizaine d'années, des équipes cliniques utilisent une exploration moins invasive, en recourant à l'IRMf pour guider une chirurgie.
La deuxième question est d'inférer un état mental. Le patient en face de moi, qui ne communique pas avec moi, est-il dans le coma, dans un état végétatif ou conscient ? L'utilisation de la neuroimagerie pour y répondre est en plein développement. La semaine dernière, un article a été publié dans The Lancet par l'équipe d'Adrian Owen sur la mise en évidence avec l'EEG de patterns qu'on peut décoder avec l'aide de classificateurs mathématiques, qui permettent de mettre en évidence sur un essai, que le patient a essayé de bouger sa main droite à une question posée. Cela fait l'objet de plusieurs résultats intéressants qui demandent à être vérifiés. Ceci n'est pas à l'état de transfert technologique, mais de résultats très intéressants.
La question la plus difficile est non pas d'inférer un état mental, mais un contenu mental. À quoi pense le sujet lorsque je suis en face de lui, sans le lui demander ? Cette interrogation recouvre bien plus d'enjeux éthiques, étant entendu qu'il s'agit d'un domaine de recherche très vivant. Dans une IRM, on ne peut savoir ce que vous pensez. Décoder le code neural d'un individu pour savoir à quoi il pense reste un fantasme, nous en sommes loin, et l'on peut en discuter.
L'interface transdisciplinaire avec nos collègues est importante, et je pense à la collaboration sur l'utilisation d' Openwiews avec l'équipe d'Anatole Léquiller ou avec les collègues de NeuroSpin. Nous disposons de moyens qui permettent de faire avancer les recherches, notamment sur les interfaces cerveau/machine qui pour la recherche clinique, pourraient être des outils très intéressants.
M. Alain Claeys . Je vous remercie pour cet exposé et donne la parole au Professeur Yehezkel Ben-Ari, fondateur et directeur honoraire de l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée (IMED).
M. Yehezkel Ben-Ari, fondateur et directeur honoraire de l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée (IMED). Comment passe-t-on d'une recherche fondamentale, qui n'a à l'origine aucun but, à une application qui permettra de guérir des malades ? C'est une question tout à fait fondamentale. Je pense par exemple à un diurétique en phase de test pour soigner les épilepsies et l'autisme. Quand ces maladies débutent-elles ? On a de bonnes raisons de penser que la plupart ne débuteront pas avec les signes cliniques, mais bien avant.
Sans faire un cours de biophysique, je rendrai rapidement compte d'une expérience très simple effectuée avec des collègues, il y a une vingtaine d'années. On trouve du chlore dans les neurones, le même qui permet de nettoyer les piscines. Ce chlore est enrichi dans les cellules et joue un rôle crucial dans la détermination du volume des cellules et l'inhibition cérébrale. Si le taux de chlore est très bas dans les cellules, le système sera inhibiteur, et ce sera le contraire si ce taux est très élevé. Bon nombre de molécules anxiolytiques ou analgésiques, comme le Valium et autres, agissent par ce système, en en renforçant l'efficacité. Autrement dit, le taux de chlore intercellulaire déterminera si le Valium aura une action inhibitrice ou facilitatrice, s'il agira comme on l'entend, de façon anxiolytique ou pas. Or, on s'est aperçu il y a une vingtaine d'années que, dans leur jeunesse, les neurones contiennent beaucoup de chlore. Le Valium que prendra une femme enceinte pour atténuer son anxiété aura un effet opposé sur son cerveau et sur celui de son embryon. Cette observation simple m'a demandé vingt ans de recherche pour la comprendre. Ce résultat est important parce qu'il met en évidence qu'aucun courant ionique n'est identique dans un cerveau jeune et un cerveau adulte. Le cerveau jeune n'est donc pas un petit cerveau adulte : c'est un cerveau qui a ses règles et ses lois, et donc sa pharmacopée. Donner à un nourrisson un produit destiné à l'adulte est une aberration.
Cela pose un problème majeur pour la grossesse. Des molécules comme la benzodiazépine peuvent avoir des effets opposés chez la mère et l'embryon ou le foetus. Tous les courants diffèrent, obligeant à une pharmacopée spécifique de la grossesse, du nourrisson et du jeune bébé. Faut-il rappeler que beaucoup de femmes enceintes consomment du cannabis qui agit sur le système que je viens de décrire ? Qu'en est-il du Prozac ou des antiépileptiques sur lesquels des études sont en cours de publication. C'est un problème redoutable pour le clinicien, car un antiépileptique permettra à une femme enceinte épileptique de ne pas faire de crise, pour ne pas avorter. Pour autant, on ne doit pas lui administrer un produit tératogène, comme certains le font. À partir d'une observation naïve, on parvient donc faire des découvertes imprévues.
Deuxième exemple plus spectaculaire : il y a quelques années, nous avons découvert, avec mes collègues, que pendant l'accouchement, le taux de chlore dans les cellules baisse transitoirement, et de façon spectaculaire, atteignant des niveaux qu'on n'observera jamais plus. Cela signifie que l'accouchement s'accompagne d'une sorte d'anesthésie du bébé. Lorsqu'il naît, il est pratiquement anesthésié, le taux de chlore baissant considérablement parce que l'ocytocine, l'une des hormones qui déclenchent le travail chez la femme, est responsable de cette baisse de chlore. En même temps qu'elle déclenche le travail chez la femme enceinte, elle a une action analgésiante sur le bébé à naître et une action neuroprotectrice.
S'agissant de l'anoxie, il faut savoir que les accidents d'anoxie pendant l'accouchement sont l'une des principales causes d'épilepsie et de maladie neurologique grave. Or l'ocytocine pendant l'accouchement, joue un rôle majeur pour protéger le cerveau, elle a une action importante dont il vaut mieux tenir compte. Les implications sont évidentes car pendant la naissance, l'ocytocine passe par le chlore, et un diurétique qui bloque l'entrée du chlore agit de même. Cela soulève des questions importantes vis-à-vis du travail prématuré, que l'on bloque souvent avec des antagonistes de l'ocytocine, ce qui n'est pas forcément une bonne idée.
Autre exemple, pour toute une série de pathologies cérébrales, on a découvert que le chlore augmentait dans les cellules. Dans un tissu épileptique, les neurones se comporteront comme s'ils étaient jeunes, ils accumulent du chlore. Du coup, on comprend pourquoi des molécules antiépileptiques agissant sur ce système peuvent avoir des effets paradoxaux ou ne pas agir du tout. Que peut-on faire pour améliorer la situation ? Les diurétiques que l'on prend pour soigner l'hypertension et vider les volumes d'eau, bloquent l'entrée de chlore au niveau des reins sur un transporteur. En le bloquant chez des épileptiques, on a pensé que ce serait une façon de réduire le chlore, pour réinstaller une inhibition dans le cerveau. Des essais thérapeutiques sont en cours dans toute l'Union européenne et aux États-Unis, chez des bébés de deux jours qui présentent des encéphalopathies gravissimes. Ce point ne concerne pas que l'épilepsie. Il concerne aussi le trauma crânien, les AVC et la moelle épinière. Dans tous ces cas, les neurones lésés se comportent de façon paradoxale, et on commence à comprendre pourquoi.
Je travaille sur l'autisme depuis plusieurs années. On donne rarement, voire jamais du Valium à des enfants autistes, pour ne pas les rendre encore plus agités. Est-ce à dire que le chlore serait élevé chez les enfants autistes ? On a réalisé un essai pilote, qui a très bien marché. Un autre est en cours de publication. Une de mes collègues qui travaille à Harvard avec des adolescents autistes ; elle mesure à quelle vitesse un visage est gai ou triste. Par IRM, on s'aperçoit qu'avant le traitement, les régions du visage ne sont pas activées. Dix mois plus tard, après traitement par diurétique, ces images sont activées.
Vous voyez de quelle manière on parvient à un traitement à partir d'une observation fondamentale, qui ne prédestinait pas d'en arriver là. Comme disait Pasteur, il n'y a pas de recherches appliquées, mais des applications de la recherche fondamentale. Il faut donc développer la recherche cognitive, c'est l'évidence.
Depuis quarante ans, on sait que la pathologie nous enseigne de quelle manière la physiologie fonctionne. Les neurones pathologiques ont donc des propriétés de neurones immatures. Que fait-on d'un tel constat ? En ce moment même, on essaie d'appliquer des molécules qui bloquent uniquement les courants immatures et non pas les courants adultes dans un cerveau adulte, pour ne bloquer que l'activité paradoxale de ces neurones immatures. Lorsqu'une agression génétique ou environnementale se produit au cours du développement du cerveau, celle-ci ralentit le programme génétique. Les neurones ne migrent pas là où ils devraient. Ce faisant, ils gardent des propriétés électriques de neurones immatures, aussi vont-ils gêner le voisinage, empêcher les cartes corticales d'agir comme il faut. Si l'on prend conscience que la plupart de ces maladies ne naissent pas à l'âge où apparaît un symptôme clinique, mais bien avant - c'est très clair pour les épilepsies, et, je suis prêt à le parier, pour la maladie de Parkinson -, il est donc évident que les agressions précèdent l'expression clinique de la maladie.
Vous avez abordé un point important, en évoquant la plasticité, on nous annonce le projet Blue Brain. De quoi s'agit-il ? D'un neurone du cortex, déconnecté de son milieu naturel, mis dans une tranche, où l'on identifiera tous ses courants. Ce n'est pas un modèle, or en réalité, il existe des centaines de neurones différents, dans un cerveau adulte normal, ou dans un cerveau immature. Imaginez une personne souffrant d'un trauma crânien ou d'une AVC. Ces neurones vont mourir et ceux qui restent à côté bourgeonneront, produisant une plasticité réactive. Ils établiront des connexions aberrantes, qui participeront au symptôme lui-même. Un cerveau qui a subi une lésion n'est pas un cerveau normal, mais un cerveau normal avec des neurones en moins, et en plus des neurones qui agissent de façon aberrante. On vient de publier un article sur l'épilepsie, où l'on montre que se forment des connexions aberrantes, qui n'existent pas dans le cerveau normal. Bref, la plasticité réactive est absolument cruciale.
DEBAT
M. Alain Claeys . Quelles conclusions tirez-vous sur le projet Blue Brain ?
M. Yehezkel Ben-Ari . Je suis sceptique.
M. Andréas Kleinschmidt . Il faut distinguer ce projet, qui est coordonné à Lausanne, d'un projet en cours de préparation, le Human Brain Project, qui fait participer plusieurs équipes françaises. Ce deuxième projet, d'une autre envergure, a d'autres objectifs. Cela dit, il est difficile de le juger, il n'est pas publié. Je partage les réserves vis-à-vis du projet Blue Brain .
M. Yehezkel Ben-Ari . Le projet Blue Brain , si j'ai bien compris, est un projet d'1 milliard pour construire un cerveau à partir de neurones de cortex de souris dont les courants sont totalement identifiés. C'est pour le moins aberrant.
M. Yves Agid, membre fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), professeur de neurologie, membre de l'Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d'éthique (CCNE). En effet, pour autant, cela n'exclut pas l'intérêt de comprendre comment fonctionne un élément neuronal élémentaire dans un contexte limité, le projet Blue Brain s'intéressant, si mes souvenirs sont bons, à une colonne du cortex cérébral. Une telle approche est certainement originale.
Cela étant, la plasticité cérébrale, dont a fait état Yehezkel Ben-Ari, est essentielle. On imagine toujours qu'un infarctus cérébral produit un trou, qui sera recolonisé. Il y a en effet des neurones qui peuvent compenser. Mais il peut aussi y avoir des neurones aberrants ; ainsi une maladie comme la dystonie est une maladie du développement. C'est le cas de nombreuses maladies psychiatriques, qui sont d'origine neuro-développementale, avec des connexions aberrantes. C'est un point qui ne sera pas abordé dans le projet Blue Brain . De surcroît, le contexte est essentiel, un cerveau isolé n'a aucun sens ; cependant il faut bien avoir une approche réductionniste au départ.
M. Yehezkel Ben-Ari . Sans doute, mais cela pose deux problèmes. Celui des finances, si je disposais de crédits, autant avouer que je ne les mettrais pas dans Blue Brain . Le deuxième problème concerne la communication et la mode. Il ne se passe pas un jour sans annonce de guérison d'une maladie après la découverte de tel ou tel gène ; or, rien ne vient. Sur l'autisme, on compte entre 1000 et 2000 mutations possibles ; on ne le guérira pas par thérapie génique : il faut cesser de rêver. La thérapie génique pour ce genre de maladie est à oublier.
On prétend ensuite qu'on greffera des neurones ; pour l'heure, le succès n'est pas au rendez-vous, et de la modestie s'impose. Il faut reconnaître qu'en neurologie, on ne disposera pas demain d'une molécule type aspirine, qui permet de soulager le mal de crâne. Il convient d'accepter nos limites, d'éviter les communications intempestives qui dominent et ont la durée de vie d'un soupir. Le problème est compliqué et prend du temps.
Pour l'aborder, il faut vraiment comprendre comment un cerveau fonctionne, cela ne se fera pas uniquement avec des modèles ou de grandes idées. À supposer qu'on connaisse la fonction de chaque neurone dans le cerveau, encore faut-il les assembler et savoir comment ils fonctionnent. Un ensemble de neurones dans un réseau ne constitue pas un modèle mathématique, mais un ensemble de réseaux qu'il faut enregistrer ; aujourd'hui, on sait comment l'enregistrer, mais il faut comprendre comment il fonctionne dans des conditions physiologiques et pathologiques. À défaut, on n'ira pas dans la bonne direction.
M. Yves Agid . Pour ma part, je suis favorable au projet Blue Brain pour une autre raison : il permet la convergence des financements. Au lieu d'avoir des financements éparpillés, on dispose d'un grand projet, qui pose des questions fondamentales. Aura-t-on la réponse ? Peut-être pas, mais c'est la règle du jeu de la science. Ensuite, ce projet est extrêmement formateur pour l'ensemble des chercheurs du monde. Des idées vont émerger dans tous les sens, qu'elles soient négatives ou positives. C'est un problème de politique scientifique. Le projet Soleil des physiciens coûte des milliards ; de leur côté, les biologistes développent des recherches éparpillées. Pour les politiques, c'est un réel dilemme.
M. Grégoire Malandain . Je rejoins Yves Agid sur le projet Blue Brain et le projet Humain Brain . De tels projets sont le lieu de rencontres pluri et interdisciplinaires. Il faut que les spécialistes de la modélisation mathématique puissent débattre avec les biologistes d'un même objet. De nouvelles idées et de nouvelles pistes de recherches peuvent apparaître. Cela dit, de tels projets n'ont pas vocation à tout aborder. Modéliser un cerveau dans des conditions normales sera difficile, modéliser toutes les situations pathologiques, à mon sens, ne fait pas partie de l'envergure du projet. Je suis convaincu qu'on peut disposer de modélisations méthodologiques et mathématiques de neurones, et d'assemblées de neurones. Une telle démarche ne se fait pas de manière cloisonnée, sans les biologistes, elle suppose une expérimentation, une validation d'expérimentations, et des discussions avec les biologistes.
L'objectif n'est pas de disposer de modèles mathématiques pour leur beauté, mais d'obtenir des modèles explicatifs de ces assemblées de neurones, pour l'explication et la prédiction. Il faut pouvoir disposer de modèles prédictifs qui permettront d'explorer de nouvelles pistes. En matière d'échanges cellulaires, on s'est rendu compte, au vu de la littérature, que le modèle qu'on construisait n'était pas capable d'expliquer toutes les données de la littérature, et qu'il existait un facteur considéré comme pas important, qui, en fait, l'était. C'est le modèle qui permet de prédire une telle chose. Cela ne se produit pas tout seul, mais par confrontation entre méthodologistes et biologistes. C'est pourquoi il est important de préserver ces lieux où l'on peut se rencontrer et discuter.
M. Jean Claude Ameisen, professeur de médecine, président du Comité d'éthique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), membre du Comité consultatif national d'éthique (CCNE). Il y a, me semble-t-il, un parallèle que l'on peut faire entre le projet Blue Brain et le projet « Génome humain ». Ce fut une entreprise remarquable d'un point de vue technologique, extrêmement coûteuse en termes de financement et d'effort humain, qui a défriché le terrain et mis à disposition des chercheurs énormément d'outils. Mais contrairement à ce que disaient la plupart de ses promoteurs, cela a été un point de départ. Le séquençage du génome humain n'a, en tant que tel, été source d'aucune découverte significative. Ce fut, simplement, une aide technique considérable apportée aux véritables recherches, celles qui posent des questions, et explorent l'inconnu. L'investissement, considérable, était-il proportionné par rapport à ce qui aurait pu être consacré au financement de ces recherches ? C'est une tout autre question. Reste que ce fut une plate-forme d'aide technique formidable. En ce qui concerne, le projet Blue Brain , je crois qu'on fait la même confusion que beaucoup ont faite initialement pour le projet génome humain, entre développement d'outils technologiques et véritable avancée des connaissances. Les grandes entreprises technologiques, si elles peuvent être utiles, ne conduisent jamais, ou presque jamais, en elles-mêmes, à des révolutions scientifiques.
M. Yehezkel Ben-Ari. Sauf que, dans le projet génétique, le cadre était clairement défini. Or, nous discutons d'autre chose, d'une structure bien plus complexe. Je travaille sur l'épilepsie depuis près de quarante ans. Voilà trente ans qu'on réalise des modèles sur le neurone épileptique. Or ce que nous avons découvert n'a rien à voir avec un modèle. Je ne suis pas contre les modèles, estimant cependant indispensable que les cadres soient bien définis. Or, dans le projet qu'on discute, je ne pense pas que les cadres soient bien définis. Un modèle est toujours valable lorsqu'on dispose de suffisamment de données pour pouvoir prédire quelque chose.
M. Alain Claeys . Nous en venons à la dernière intervenante de cette table ronde, le professeur Marie-Odile Krebs, directrice adjointe du Centre de psychiatrie et neurosciences de l'hôpital Sainte-Anne.
Mme Marie-Odile Krebs, professeur des universités, directrice adjointe du Centre de psychiatrie et neurosciences de l'hôpital Sainte-Anne, co- responsable de l'équipe physiopathologie des maladies psychiatriques . Je remercie les organisateurs de cette journée de me donner l'occasion de m'exprimer pour donner le point de vue du psychiatre. On vient de souligner que certains modèles pouvaient être un lieu de rencontres multidisciplinaires. À mon sens, de tels lieux sont indispensables, et pourraient se trouver au lit du patient.
Premier constat : les maladies psychiatriques sont des maladies extrêmement complexes. Comme l'a bien souligné Yehezkel Ben-Ari, ce sont des maladies qui évoluent au cours du temps. Les syndromes ne sont pas stables. Un même patient peut avoir une forme de maladie, puis glisser d'une maladie à une autre. Vous avez rappelé les chiffres concernant le coût social et humain de ces maladies. Traditionnellement, on s'accorde à reconnaître qu'elles représentent 20% des dépenses de santé, qu'une personne sur quatre sera touchée. Certaines études estiment même qu'une personne sur deux, à l'âge de 65 ans, aura été confrontée à un trouble mental.
La notion de « trouble mental » fait peur et entraine un rejet : trop normal pour être pathologique (dépression), trop effrayant pour être envisagé (psychose). Où est le normal, le pathologique ? Qui n'a pas eu de moments dépressifs dans sa vie ? Un moment dépressif, nous sommes bien d'accord, n'est pas une maladie. Mais lorsque s'y ajoutent des critères de gravité et des conséquences sur le fonctionnement, on entre dans le pathologique qui relève de soins.
Ces maladies sont parfois difficiles à différencier : une diminution de fonctionnement dans ses capacités d'autonomie chez une personne d'un âge respectable peut être une dépression ou un début de démence, ou, comme c'est souvent le cas une association des deux. Une crise d'adolescence peut révéler un trouble anxieux, dépressif ou une entrée dans la schizophrénie. Si l'implication en termes de prédiction est immense, le paradoxe actuel est que certaines mesures thérapeutiques ne nécessitent pas toujours de poser un diagnostic définitif dans ces formes débutantes.
Ce sont des maladies à déterminisme complexe, à facteurs génétiques et environnementaux qui interagissent entre eux. Les périodes critiques de développement et de maturation cérébrale sont également critiques dans l'expression des maladies psychiatriques. La plupart des maladies psychiatriques entrent dans un modèle de « vulnérabilité ». Les personnes présentant des signes de vulnérabilité ont un risque accru de développer des troubles, mais la plupart des personnes vulnérables, et c'est une bonne nouvelle, ne deviennent pas malades. Par exemple, pour la schizophrénie, si près d'un dixième de la population présente des marqueurs de vulnérabilité, on peut estimer qu'un dixième de ces personnes développeront réellement la maladie.
Certains facteurs environnementaux, comme le stress, la consommation de substances favorisent la révélation de troubles anxieux, dépressifs, et psychotiques. Le cannabis par exemple est un facteur de déclenchement pour certaines personnes vulnérables, et ce pour des consommations très réduites, ce qui en fait une question de santé publique évidente.
Quels sont les besoins non résolus en psychiatrie ?
En fin d'année dernière, un numéro de Nature sur la schizophrénie a révélé que les grandes industries pharmaceutiques se détournent de cette maladie extrêmement invalidante, par manque de modélisation ou de modèles pour aider à la compréhension des troubles. Une révélation catastrophique, quand 1% de population générale est touchée. La situation n'est guère meilleure pour la dépression et plusieurs besoins restent non résolus :
- les résistances thérapeutiques : on estime ainsi à près de 30% le nombre de patients souffrant de troubles dépressifs, anxieux ou psychotiques, résistants aux traitements disponibles. Il faut donc continuer à développer de nouvelles méthodes de traitement et de prises en charge, étant entendu qu'il ne s'agit pas uniquement de se focaliser sur le médicament.
- les symptômes cognitifs :on sait réduire les hallucinations chez les patients souffrant de schizophrénie, mais les traitements classiques, les antipsychotiques, sont très peu efficaces sur les symptômes cognitifs. Les techniques de remédiation cognitive sont prometteuses et nécessitent d'être développées.
- les interventions à visée préventive : peut-on prévenir l'évolution ? Les premiers programmes intervention précoce tendent à montrer que oui. Il faut pouvoir poursuivre l'identification des marqueurs prédictifs fiables et valider la nature des interventions thérapeutiques.
Les formes résistantes de troubles psychiatriques soulèvent deux types de questions sur le plan diagnostique. S'agit-il de formes particulières de maladies ou des phénomènes associés empêchant l'action des médicaments ? Quelles sont les thérapeutiques de recours ? Il s'agit de thérapeutiques de stimulation, électro-convulsivo-thérapie, et plus récemment la stimulation magnétique trans-crânienne.
La psychiatrie bénéficie aujourd'hui du savoir-faire développé dans les maladies neurologiques sur la neuromodulation utilisant la stimulation cérébrale profonde dans certaines pathologies extrêmement résistantes et invalidantes. Des travaux menés sur les troubles obsessionnels compulsifs et sur les troubles dépressifs résistants ont montré des résultats intéressants et l'apport thérapeutique potentiel est évident. Est-ce éthique ? Je le crois. Les psychiatres sont souvent obligés de se justifier lorsqu'ils utilisent la stimulation, alors que « tout serait dans la tête » et que « la dépression ne serait pas si grave que cela ».
Certains considèrent qu'il suffit d'acheter une paire de baskets et de faire du sport pour aller mieux. C'est faux. Une « vraie » dépression nécessite un traitement. Et lorsque les traitements sont inefficaces, il faut pouvoir proposer des alternatives à ces personnes totalement invalidées dans leur fonctionnement le plus basique. C'est éthique, puisqu'il faut soigner et faire reculer les limites de la résistance au traitement, mais cela exige de s'entourer d'un certain nombre de précautions éthiques.
M. Alain Claeys . Ce ne serait donc pas naturellement éthique ?
Mme Marie-Odile Krebs . À mon sens, aucun acte de soins n'est éthique en soi, il s'agit toujours d'apprécier les bénéfices et les risques dans une situation donnée. La difficulté pour la psychiatrie est de disposer de critères objectifs pour définir une dépression résistante. C'est plus difficile à mesurer que pour des syndromes moteurs. La question éthique est plus facilement sortie du contexte de soin et, au-delà de nos représentations médicales, certains font référence à des d'autres représentations de la santé mentale, y compris philosophiques. En réalité, comme pour les troubles neurologiques, on a besoin d'avis d'experts, d'études pour savoir quelle est la bonne cible pour arriver à moduler les cibles en fonction de l'individu, d'autant que les tableaux cliniques étant hétérogènes, il est vraisemblable qu'on aura besoin d'une adaptation individuelle.
Concernant les troubles cognitifs, une initiative très importante du National Institute of Health (NIH) constatant l'absence de prise en charge des troubles cognitifs dans les essais thérapeutiques, a donné lieu à l'initiative MATRIX . L'objectif était de sélectionner les principaux domaines cognitifs, avec un certain degré de consensus, pour les inclure systématiquement dans les essais cliniques. Ce programme a été aujourd'hui transféré vers un domaine bien plus translationnel, portant sur le développement de nouvelles tâches cognitives sur la base des neurosciences cognitives, ayant comme caractéristiques d'être transposable chez l'animal et utilisables en imagerie.
Sur le plan européen, l' Innovative Medecine Initiative (IMI), associant public-privé, a pour but de développer nouvelles méthodes pour le traitement de la dépression et de la psychose, en termes de médicament, mais aussi de thérapies cognitives. En pratique, ces projets exigent d'intégrer des données multimodales hétérogènes et multicentriques issues des différents centres de psychiatrie.
La réalité virtuelle est un développement technologique très intéressant dans l'évaluation et le traitement de certains troubles cognitifs, y compris dans son adaptation au niveau individuel. Certains patients ont des difficultés dans la représentation de leur propre personne et de leur mémoire autobiographique. Certains dispositifs permettent d'enregistrer jour après jour, à différentes heures de la journée, un certain nombre de situations que vit le sujet pour l'aider à analyser ce qui se passe, afin de l'aider à se resituer dans ce contexte. Il s'agit de techniques de remédiation cognitive passionnantes, qui ne posent pas particulièrement de problème éthique (hormis la gestion des données personnalisées et personnelles dont la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) se charge.
Sur la question du repérage précoce des pathologies psychotiques, la France a un travail important à accomplir. Notre système de soin permet essentiellement de soigner les personnes lorsqu'elles arrivent dans une phase aiguë, lors du premier épisode, souvent dans le deuxième. Pourtant, le début biologique de la maladie est probablement bien antérieur, en particulier dans le cas des troubles psychotiques. Les psychoses sont des pathologies sévères, dont le pronostic est amélioré par une prise en charge précoce, dont les signes avant-coureurs sont repérables, pendant une période prodromique suffisamment longue (deux et cinq ans, parfois dix)... Tous les pré-requis sont là pour proposer des interventions à visée préventive.
Bien que l'incertitude sur le diagnostic final, encore plus grande à ce stade, les programmes mis en place dans d'autres pays montrent qu'il est utile de repérer avant la phase de transition psychotique les patients dits à « haut risque de transition », présentant des symptômes prodromiques.
Quels sont les risques ? Quelle stigmatisation ? Quelle est notre capacité à prédire les bons patients à soigner ? Quels sont les traitements à leur proposer ?
En termes de santé publique, il s'agit de savoir à quel stade il est licite d'apporter des soins. Il n'est pas question de soigner des personnes présentant des « marqueurs de vulnérabilité » n'ayant aucun symptôme ni aucune plainte. En revanche, les symptômes prodromiques s'associent déjà à une détresse psychologique, une gêne, une altération dans le fonctionnement social, scolaire ou professionnel. L'enjeu est de repérer les meilleurs critères prédictifs pour leur proposer des soins adaptés non stigmatisants. Il ne s'agit pas forcément de précipiter la prescription d'antipsychotiques, dont on connaît les risques d'effets indésirables, par exemple en termes métaboliques. Une publication dans une grande revue rapporte que les Omega-3 contenus dans les huiles de poissons et qui ont un effet neuroprotecteur, réduisent le risque de transition psychotique. Certaines prises en charge comme les thérapies cognitives apparaissent également intéressantes.
Il est certainement utile de poursuivre la recherche de « biomarqueurs » d'évolution (clinique ou faisant appel à des moyens complémentaires d'exploration, biologiques, cognitifs, cérébraux) et la recherche de traitements spécifiques de cette phase, ceux-ci n'étant vraisemblablement pas les mêmes que précédemment. On se trouve là dans un cadre de santé publique différent, mais aussi dans un cadre scientifique différent par rapport à la psychiatrie classique, devant nous faire réfléchir la nature des symptômes et des moyens dont on dispose pour les combattre. Combien de patients faut-il traiter pour éviter une transition psychotique ? 4 avec les critères actuels. Ce qui permet éthiquement de proposer de tels programmes de prévention, si les traitements sont adaptés et peu stigmatisants. Par comparaison, on accepte de traiter 13 patients souffrant d'hypertension voire 160 patients souffrant d'hypertension légère pour empêcher une complication grave.
Quels sont les apports de nouvelles technologies ?
Tout d'abord, peut-on se baser sur la génétique pour déclencher des programmes de soins ? Les travaux de génétique en psychiatrie sont complexes, car rarement répliqués. Les études sur l'ensemble du génome ont montré qu'il existe une telle hétérogénéité qu'on ne peut déterminer un gène de la schizophrénie. Des résultats plus récents, utilisant les techniques de séquençage de nouvelles générations, montrent que, comme pour l'autisme, il y aurait dans certains cas une mutation rare chez les patients. Comme l'a expliqué l'intervenant précédent, nous sommes bien loin de la thérapie génique chez ces malades. La valeur prédictive est faible, certaines anomalies génétiques sont associées à 30 % de troubles psychotiques, mais elles ne permettent pas des programmes de soins, de prévention de santé publique, sans compter que la valeur diagnostique est nulle.
Certain outils issus des nouvelles technologies sont un apport très intéressant pour étudier les modifications cérébrales, morphologiques ou fonctionnelles, associés aux troubles psychiatriques. Une étude chez des jeunes patients à haut risque de transition psychotique, suivis de façon longitudinale, a montré qu'une réduction discrète dans certaines régions cérébrales est associée avec le risque de survenue d'une conversion psychotique. Plus intéressant, de nouvelles techniques de calcul et d'analyse permettent une interprétation du risque de déclencher un trouble psychotique au niveau individuel. Certes, rien n'est abouti, et ce n'est pas sur une IRM isolée qu'on pourra déterminer le risque de transition psychotique.
Un dernier point central en psychiatrie, à la frontière entre clinique et recherche est le suivant : comment décrire et se faire une représentation des maladies psychiatriques ? La nosographie classique est insuffisante et l'on a besoin d'une palette d'outils de caractérisation extrêmement vaste, qui va bien sûr d'éléments très biologiques, jusqu'à la reconstruction d'un profil fonctionnel, voire de trajectoires de vie, incluant les dimensions familiales. L'intégration des données sera difficile : elle requiert d'accéder à ces moyens d'intégration de données pour l'instant développées dans d'autres champs (génomique, prédiction des catastrophes etc...), ce qui passe bien sûr par des interactions étroites entre psychiatres, chercheurs en neurosciences et ingénieurs.
En conclusion, les nouvelles technologies sont évidemment extrêmement importantes en termes de thérapeutique, de définition de marqueurs prédictifs ou de diagnostics dans les troubles psychiatriques. Des approches multidisciplinaires dans des lieux proches des patients, des infrastructures bioinformatiques sont nécessaires. La diversité des tableaux cliniques et les frontières nosographiques encore incertaines rendent nécessaire, plus que dans tout autre domaine médical, de s'orienter vers une médecine individualisée, tant pour l'estimation des risques évolutifs et que pour la définition des schémas thérapeutiques. C'est l'une des attentes de l'adaptation des nouvelles technologies au champ psychiatrique.
J'insiste sur un enjeu éthique. Des programmes de prévention de la psychose fleurissent dans différents pays, en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. La France, elle, a dix à vingt ans de retard. Il faut rapidement emboîter le pas et promouvoir ce champ crucial tant sur le plan clinique et de santé publique, qu'en termes de recherche et d'amélioration des connaissances sur le fonctionnement cérébral et l'amélioration des soins.
M Alain Claeys . Je vous remercie pour cet exposé et donne la parole au professeur Michel Bourguignon, commissaire de l'Autorité de sûreté nucléaire
M. Michel Bourguignon, professeur de biophysique, Université de Paris Île-de-France Ouest, commissaire de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Le rôle du médecin est d'abord de soigner sans nuire. Aussi vais-je vous parler de la justification des examens d'imagerie médicale irradiants, examens largement utilisés dans le domaine de la neurologie. Du fait du risque correspondant à l'utilisation des rayonnements ionisants, des points particuliers doivent être mis en avant.
L'autorité de sûreté nucléaire, dont je suis l'un des commissaires, joue un rôle particulier dans le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Applicable à la médecine, son rôle s'applique à la sûreté des appareillages et à la protection contre les rayonnements, pour protéger les patients. Dans le cadre des travaux présentés lors de cette réunion, on constate que le risque des rayonnements ionisants prend une place particulière du fait de la répétition des examens, et d'un phénomène en train d'émerger, celui de la radiosensibilité individuelle qui n'est pas un phénomène mineur.
Quelles sont les expositions aux rayonnements ionisants ? Les trois-quarts sont constitués par la radioactivité naturelle, sur laquelle on n'a pas prise. Un quart est constitué par le médical, et un pourcentage minime par les activités de l'industrie nucléaire. Pour ce quart médical, la dose efficace était de 0,8 mSv il y a quelques années. Une étude publiée en 2010 par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et l'Institut national de veille sanitaire (InVS) a mis en évidence une augmentation de 47 % en cinq ans des doses médicales. On ne dispose pas de beaucoup de statistiques françaises, mais des statistiques mondiales établissent que, entre 1993 et 2008, le nombre d'examens de radiodiagnostic et de médecine nucléaire a été multiplié par 2,5 et 2 respectivement et que la fréquence des examens augmente rapidement, passant de 0,8 par patient et par an à 1,3.
D'après des statistiques américaines, l'exposition médicale était extrêmement faible en 1983 et a bondi de 0,3 à 3 mSv en l'espace de 23 ans, la part du scanner étant la plus importante devant la radiologie interventionnelle en forte augmentation. Cette évolution est également vraie pour les pays en voie de développement. Dans les pays les plus développés, on dénombre 8 % d'examens au scanner qui correspondent à 47 % de la dose. Dans les pays les moins développés de la planète, on dénombre plus de scanners en pourcentage, avec une dose plus importante. C'est la preuve que ces pays s'équipent de scanners, machines aujourd'hui responsables de 42 % de la dose, contre 34 % en 2000. Au Japon, on compte 93 scanners par million d'habitants, contre 35 aux États-Unis et 16 en France. Pratiquement une personne sur quatre a un examen radiologique par an au Japon, aux États-Unis et en France. Les doses finissent par n'être pas négligeables, un patient japonais étant exposé en moyenne à 10 mSv par an, contre 6,6 aux États-Unis, 5,2 en France (mais pour l'ensemble de la radiologie et pas seulement le scanner).
Cette tendance à l'augmentation des doses s'explique par le développement des dispositifs les plus performants, qui sont les plus irradiants. Les actes les plus utiles dans tous les domaines (scanner du corps entier, coloscopie virtuelle, coroscanner, radiologie interventionnelle...) sont aussi les plus dosants. L'accroissement des doses est aussi dû à des raisons essentiellement médicales. Les investigations sont non invasives et ont remplacé quantité d'autres investigations antérieures, notamment chirurgicales. Elles constituent un apport essentiel au diagnostic et au traitement, en particulier la radiologie interventionnelle. Elles jouent un rôle de plus en plus important dans l'orientation de la stratégie thérapeutique, le suivi des traitements, surtout en cancérologie, sans doute moins en neurologie. On constate aussi une augmentation pas souhaitable, liée à la répétition d'examens inutiles.
En France, on utilise le scanner au lieu de l'IRM pour nombre d'explorations du cerveau, faute d'IRM à notre disposition. C'est un problème propre à la France, qui dispose de 8 appareils par million d'habitants, contre 35 aux États-Unis et plus au Japon.
La radiologie interventionnelle aux États-Unis a aujourd'hui une dose efficace du même ordre de grandeur que celle du scanner. La dose reçue en moyenne par un patient aux États-Unis ou au Japon n'est pas négligeable. En outre, on continue à faire des radios du crâne, alors que tout le monde affirme qu'elles ne servent le plus souvent à rien.
Quels sont les risques ? Le risque épidémiologique de cancer du fait des rayonnements ionisants à forte dose et fort débit de doses a été évalué, après Hiroshima et Nagasaki à 5 % par Sievert. Aux faibles doses de la radiologie, il n'y a pas de démonstration de survenue de cancer. Si le risque existe, il est très faible. Cependant, nombreux sont ceux qui font des calculs de risque et estiment, en appliquant des modèles de risque, que la radiologie est responsable de décès aux quatre coins du monde. Récemment, la commission internationale de protection radiologique (CIPR) a redit qu'on ne devait pas appliquer la dose collective pour faire des calculs de risque en appliquant 5 % par Sievert.
La radiosensibilité est plus grande pour l'embryon et l'enfant, mais aussi la femme. La sensibilité du cerveau aux rayonnements ionisants est assez faible comparée à d'autres organes. Encore n'y a-t-il pas que le cerveau dans le champ d'investigation lorsqu'on explore la tête, mais aussi le cristallin de l'oeil, qui est sensible. Les cataractes détectées de plus en plus précocement sont-elles liées aux rayonnements ?
La radiosensibilité individuelle est un phénomène nouveau, qui commence à être largement exploré. C'est un phénomène bien connu en radiothérapie pour les fortes doses. La radiosensibilité individuelle entraîne des défauts de signalisation cellulaire et de réparation des lésions de l'ADN, en particulier dans un contexte où le cycle cellulaire n'est pas bien contrôlé. On vient de démontrer récemment qu'elle peut exister à faibles doses. C'est une préoccupation majeure, qui concerne entre 5 et 10 % de la population, l'effet pouvant aller de 1 à 10.
Les techniques qui bouleversent la donne sont des techniques d'immunofluorescence. La première a été décrite en 2003 sur les histones H2AX, qui permettent de voir les cassures double brin. Aujourd'hui, on est en mesure de voir les effets d'une dose de 1 mGy. Les effets d'une simple radio se voient désormais très bien au niveau cellulaire. On assiste également à une floraison de tests d'immunofluorescence, comme celui du marqueur MRE11, qui permet de voir des cassures double brin mal réparées.
Il apparaît donc que les risques sont liés à la progression des doses dans les expositions médicales et à la répétition des examens chez un même patient. La radiosensibilité plus grande de certains patients fait que le risque est plus élevé, mais on ne sait l'évaluer ni individuellement, ni collectivement. Or si l'on ne réagit pas, d'ici 15 à 20 ans, l'épidémiologie nous montrera sûrement des choses qui ne sont pas souhaitables.
L'imagerie médicale a une place centrale et indiscutable pour l'exploration du cerveau en neurologie et en psychiatrie. Elle est un diagnostic préalable aux soins ou à l'exploration de recherches. Le scanner permet une exploration rapide en urgence, raison pour laquelle on l'utilise beaucoup, notamment si on ne dispose pas d'IRM. L'IRM a une place particulière, vitale et décisive, pour différencier le ramollissement de l'hémorragie cérébrale.
La tomographie par émissions de positons (TEP) a grandi très fortement en France, et a une place de plus en plus grande pour l'exploration biochimique du cerveau. Sans doute est-elle plus utile pour la recherche que pour l'application de routine. Mais le scanner et la TEP sont des technologies irradiantes. La justification médicale de l'examen est donc centrale. On ne devrait réaliser que des examens utiles, des examens dont le résultat positif ou négatif modifie la prise en charge ou conforte le diagnostic du clinicien.
On devrait donc toujours se poser des questions avant de réaliser un examen d'imagerie médicale irradiant. L'examen a-t-il déjà été appliqué ? En ai-je besoin ? En ai-je besoin maintenant ? Est-ce bien l'examen indiqué ? Est-ce que je peux en faire un autre, non irradiant, comme une IRM ? Ai-je bien posé le problème ? Il faut prêter une attention particulière aux patients les plus radiosensibles, comme les enfants et les femmes, les personnes ayant une hyper- radiosensibilité individuelle ou une susceptibilité particulière au cancer. On constate de plus en plus l'existence d'un carrefour commun de la signalisation et de la réparation de l'ADN, commun à la cancérogénèse, et dont le rayonnement ionisant n'est qu'un des perturbateurs. La radiologie se justifie, et nous organiserons une campagne sur ce sujet en 2012.
M. Jean-Sébastien Vialatte . Je vous remercie et donne la parole à Hervé Chneiweiss pour quelques mots de conclusion
M. Hervé Chneiweiss . Quelques mots de conclusion sur cette première table ronde. Je soulignerai le dynamisme de la recherche en neurosciences. En pointillés, on a entendu que les financements n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Si l'on parvenait à réaliser quelques économies sur des examens inutiles, il faudrait les réinvestir. La discussion de l'allocation des ressources a peu de sens entre de grands projets à un milliard d'euros comme Blue Brain et des projets plus focalisés portés par des équipes innovantes. Rappelons qu'on compte 500 équipes en France de niveau international classées A ou A+ par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), et que l'Agence nationale de la recherche (ANR) attribue 23 lignes de crédits chaque année en neurosciences pour une valeur moyenne de 400k€ sur trois ans. Il y a donc un problème.
Deuxième point que je retiens, il faut sortir de la vision mécanique du corps, comme un magasin de pièces détachées, pour tendre vers une dynamique du vivant : physiologie, physiopathologie et nouvelle physiologie après la pathologie.
Troisième point, la question du terrain et de la vulnérabilité contraint à s'interroger sur la population. Quelle population surveiller ? Faut-il mettre tout le monde sous surveillance ? Comment repérer les sujets à risque ? Faut-il faire le bonheur malgré soi ou prévenir le malheur ? Il faut regarder les choses telles qu'elles sont, en prenant des précautions pour protéger chaque individu, il ne faut pas négliger le besoin. Il faut donc définir les critères de prévention et éviter la stigmatisation.
Je retiens enfin que les acteurs ne demandent qu'à se fédérer. C'est de cette manière qu'on parviendra à avancer, en permettant à ces fédérations de disposer de moyens à plus long terme, pour se réaliser.
QUELLES IMPLICATIONS ÉTHIQUES ET JURIDIQUES ?
M. Alain Claeys. Nous abordons maintenant la deuxième table ronde. Monsieur Jean-Claude Ameisen, vous avez la parole .
M. Jean Claude Ameisen, professeur de médecine, président du Comité d'éthique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), membre du Comité consultatif national d'éthique (CCNE). Le sujet est fascinant, et extraordinairement large. Les neurosciences ont pour ambition d'une part de contribuer à permettre de soigner les patients, de soulager la souffrance provoquée par des maladies extrêmement graves ; et d'autre part, de tenter d'explorer, de comprendre, voire de modifier les mécanismes impliqués dans ce que nous avons de plus intime, nos émotions, nos souvenirs, nos pensées, nos sentiments, nos espoirs, nos craintes. Les neurosciences ont aussi pour but d'explorer la nature des mécanismes biologiques qui nous permettent d'élaborer la démarche scientifique et la démarche éthique. Ainsi les neurosciences interrogent les déterminants de leur propre activité. Elles s'interrogent sur les déterminants biologiques de la démarche éthique, et la démarche éthique s'interroge à son tour sur les implications, en termes humains, d'une telle approche réductionniste. Rarement, sans doute, réflexion scientifique et réflexion éthique n'ont été aussi intriquées.
La démarche scientifique est interrogation sur ce que nous sommes et devenons capables de faire, la démarche éthique est interrogation sur la façon dont nous devons utiliser ces connaissances et ces possibilités d'intervention nouvelles pour inventer librement notre avenir, dans le respect de la vulnérabilité de ceux qui nous entourent. Chaque avancée majeure des sciences du vivant - qu'il s'agisse de la théorie de l'évolution, de la génétique, ou des neurosciences - fait naître de nouvelles interrogations éthiques. Et les questions éthiques majeures que pose la biologie tiennent non seulement à ses applications techniques, mais avant tout aux bouleversements qu'elle entraîne au niveau des représentations que nous nous faisons de nous-mêmes et des autres, et aux effets que ces transformations peuvent avoir sur nos conduites et nos valeurs.
Depuis 150 ans, la révolution darwinienne a progressivement estompé l'idée de l'existence de frontières absolues entre des entités qui semblaient jusque là appartenir à des catégories qualitativement distinctes : la matière et le vivant ; l'animal et l'humain ; le corps et l'esprit... Ces représentations nouvelles peuvent donner un sentiment d'émerveillement, mais aussi de désenchantement, ou de réification, d'autant que la recherche scientifique explique, prédit et manipule d'autant mieux ce qu'elle étudie qu'elle fait abstraction d'une partie de la singularité de ce qu'elle étudie. L'exemple extrême en est la formalisation mathématique dans laquelle l'objet d'étude se réduit à une équation, une courbe ou un nuage de points. Lorsqu'il s'agit de l'humain, comment réconcilier cette vision que les sciences nous proposent de nous-mêmes comme objets de forces aveugles qui nous contrôlent avec le sentiment que nous avons chacun d'être sujet et acteur de notre propre vie ? Comment faire en sorte que les sciences ne nous rendent pas étrangers à nous-mêmes et aux autres ?
Nous nous vivons chacun comme un je qui dit tu et nous , écrivait il y a quatre-vingts ans le philosophe Martin Buber, alors que la science parle de nous en disant il ou elle ou ça. Et il nous faut à chaque fois réapprendre à mettre ce que nous apprenons en tant que il ou elle ou ça au service d'un je et tu pour pouvoir construire un nous .
Certains des problèmes éthiques liés aux développements des neurosciences ne sont pas spécifiques à ce domaine, même s'ils y prennent une particulière acuité. Il en est ainsi de la notion ambiguë de « normalité ». Plus on mesure et quantifie, et plus on a tendance à confondre « normal » avec fréquent, et plus on risque de confondre rare, unique et singulier avec anormal et pathologique. Et à demander à la médecine d'effacer la singularité. La réflexion sur la notion de « normal » doit être permanente car, dans tous les domaines de la biologie et de la médecine, il existe toujours un risque de réduction de la complexité d'une personne aux seules données révélées par une grille de lecture biologique unidimensionnelle, conduisant à une tendance à la hiérarchisation, et à des possibilités de stigmatisation, de discrimination ou d'exclusion. Ce que l'évolutionniste Stephen Jay Gould a appelé la Mal-mesure de l'homme . Une personne est toujours plus que ce qu'on peut en mesurer.
Lionel Naccache a évoqué Broca, le grand découvreur des aires cérébrales de la parole. Mais il faut se souvenir aussi que Broca a commencé, à la même période, durant les années 1860, comme beaucoup d'autres scientifiques dans le monde, à rechercher des « preuves » biologiques à de supposées différences intellectuelles, mentales, entre les différentes populations humaines, ce qu'on appelait alors les « races » humaines. Et il connaît déjà par avance la réponse à la question qu'il prétend explorer. Il utilise la science non pas comme une démarche de questionnement, d'exploration de l'inconnu, mais comme une démarche de pseudo-validation a priori de ses préjugés culturels, d'une idéologie fondée sur le mépris. Et ces mêmes types de démarches dites « scientifiques », ont été utilisées à la même époque pour justifier l' « infériorité » et l'immaturité intellectuelle et affective des femmes par rapport aux hommes, ce qui permettait de donner une raison « scientifique » à l'interdiction faite aux femmes de voter et d'avoir accès aux études.
Il y a aussi la question du déterminisme, qui n'est pas spécifique aux neurosciences. Toute science essaie de rechercher des relations de causalité. Qui dit déterminisme, dit tentation de prédire. Mais paradoxalement, parler de l'avenir c'est toujours parler du passé, car les prédictions sont fondées sur une extrapolation à partir du passé. En fait, l'avenir ne sera souvent ni une simple répétition, ni une simple variation, quantifiable à l'avance, à partir du passé. L'environnement change. Et les mêmes relations de causalité, opérant dans un environnement différent, pourront provoquer des effets très différents . Par ailleurs, dans la quasi-totalité des cas, une prédiction valide sera de nature probabiliste. Pour exprimer la probabilité qu'un événement survienne chez une personne, il faut au préalable inscrire la personne dans un groupe formé d'autres personnes qui partagent avec elle, indépendamment de leurs très nombreuses différences, certaines caractéristiques particulières que l'on veut étudier. Et les prédictions concerneront non pas une personne donnée, mais le devenir du groupe dans lequel on l'a rangée.
Il y a plusieurs façons très différentes de définir un risque. Définir un risque qu'on pense ne pouvoir éviter, c'est une démarche de prédiction. Définir un risque, et proposer une démarche qui permettrait de l'éviter, c'est une démarche de prévention. La question importante, d'un point de vue éthique, est de savoir si cette prévention sera proposée au bénéfice de la personne, ou si c'est la personne qui sera considérée comme un risque dont il faudrait nous protéger à ses dépens. Le problème éthique surgit quand la prédiction, en termes probabilistes, devient une source d'exclusion, de discrimination ou d'enfermement pour chacune des personnes qu'on a incorporées dans le groupe. Je citerai deux exemples, dont l'un qui est entré dans la loi. Le premier exemple, c'est la tentative récurrente - et scientifiquement absurde - de dépister dès l'âge de trois ans des signes qui prédiraient une délinquance grave et violente à l'âge adulte. Veut-on rendre service aux enfants ? Ou veut-on plutôt protéger, aux dépens de ces enfants, la société du risque que l'on imagine qu'ils lui font courir ? Ce qui est évident, c'est que le risque de stigmatisation de ces enfants est majeur.
Le deuxième exemple est la rétention de sûreté. Le maintien en prison de personnes qui ont effectué leur peine parce que des facteurs prédictifs, de nature statistique, suggèrent, à partir d'une extrapolation d'un passé qui concerne d'autres personnes, qu'elles risqueraient de récidiver. Lorsque ces facteurs prédictifs suggèrent que 60 % des personnes qui partagent ces caractéristiques vont récidiver, on décide de garder enfermés les 40 % de personnes dont ces mêmes statistiques disent qu'elles ne récidiveront pas. C'est, me semble-t-il, la négation même du principe de respect de la présomption d'innocence, dans une dimension très étrange, celle de l'éventualité d'un crime à venir... Et il ne s'agit pas d'une indication de soins psychiatriques, mais d'une poursuite de l'emprisonnement...
En neurosciences, la prédiction prend une dimension particulière car on touche aux intentions, aux sentiments, aux pensées, aux comportements, à ce que nous avons de plus intime et de plus humain. Et des études ont mis en évidence qu'indépendamment de toute prédiction, le simple fait de dire, de décrire, peut avoir des effets considérables. L'observation, quand elle est formulée, est rarement neutre. Par ailleurs, pour obtenir une réponse claire en recherche, il est souvent utile de modifier la question, de la réduire à des éléments testables. Mais le risque est d'oublier cette démarche lorsque l'on interprète et que l'on communique les réponses. Ainsi, les recherches sur la notion complexe de l'intelligence ont-elles été souvent confondues avec la simple mesure d'un unique paramètre, le quotient intellectuel. À la suite des expériences remarquables de Benjamin Libet, il y a trente ans, les questions philosophiques touchant au libre arbitre se sont réduites à la question de savoir si, une fois qu'on a pris la décision d'appuyer sur un bouton, la mise à exécution de cette décision s'effectue consciemment ou pas. C'est un sujet passionnant, qui suggère que l'exécution d'une décision, comme la conscience, a une composante intermittente et rétrospective. Mais, contrairement à ce qui a été souvent écrit par des chercheurs en neurosciences, je ne pense pas que cela suffise pour affirmer la non-existence de cette notion très générale, très complexe et profondément ambiguë que l'on appelle le libre arbitre.
Une question éthique importante, qui est en lien avec la notion de « normalité », concerne la tendance fréquente, lorsqu'on découvre un traitement permettant de modifier certains comportements inhabituels, à en déduire automatiquement que parce qu'on peut modifier ces comportements il s'agit de comportements pathologiques, de maladies. L'administration dans certains pays de la Ritaline à plusieurs millions de jeunes enfants un peu agités et distraits traduit la tentation à médicaliser des problèmes qui relèveraient plutôt de d'un accompagnement familial et scolaire.
Dans notre pays, la prescription extrêmement importante d'antidépresseurs par des médecins généralistes traduit une médicalisation de problèmes affectifs, familiaux ou sociétaux. Le risque est que cette tendance à médicaliser une souffrance causée par exemple par des difficultés de conditions de travail, ou par la perte d'un emploi, serve d'alibi à une absence de volonté de modifier les causes sociétales de ces souffrances.
Une autre série de questionnements éthiques est plus spécifique aux neurosciences : elle concerne le rôle des émotions dans les décisions rationnelles, le rôle des processus inconscients, des influences inconscientes, des images subliminales, des phénomènes de reconstruction de la mémoire... La possibilité fascinante de mesurer des sensations subjectives à partir de l'exploration des activités du cerveau. Que nous apporte la possibilité de mesurer la douleur, cette sensation par définition subjective, en examinant le cerveau ? Cette approche permet-elle de mieux prendre en compte la douleur, et la souffrance ? Ou risque-t-elle, au contraire, de se substituer à l'écoute ?
Il y a aussi, et Lionel Naccache l'a évoqué, les possibilités récentes, extraordinaires, de tenter d'entrer en communication, indirectement, par l'analyse de leurs activités cérébrales, avec des personnes en état végétatif, qui ne peuvent plus communiquer. Elles ouvrent évidemment de merveilleuses perspectives. Mais le risque, comme cela commence à être envisagé dans certains services de réanimation, est d'abandonner les personnes en état végétatif chez lesquelles on ne trouve pas ces facultés. Il faut donc accorder une extrême importance à ce qui, dans le fonctionnement cérébral, traduit la richesse du monde intérieur de l'autre, et nous permet d'entrer en relation avec ce monde intérieur, tout en évitant de conclure qu'une absence de ces corrélats est une preuve de l'absence de ce que l'on recherche.
Je suis très troublé par une caractéristique particulière à notre pays, qui concerne les relations entre développement de la recherche, applications en neurosciences, et solidarité humaine. Nous disposons d'une recherche en neuroscience de très grande qualité, avec des résultats spectaculaires dans le domaine applications thérapeutiques, telle la stimulation profonde par implants intra cérébraux pour traiter la maladie de Parkinson, découverts il y a plus de vingt ans par Alim-Louis Benabid. Cependant, notre pays, qui a réalisé des avancées thérapeutiques extraordinaires dans le domaine des neurosciences, a tendance, contrairement à d'autres pays, à isoler ou à abandonner les personnes ayant un handicap dit « mental », intellectuel, cognitif, comportemental ou relationnel, qu'on ne peut pas guérir. Cet isolement et cet abandon causent par eux-mêmes des souffrances, en isolant ces personnes et en les empêchant de vivre avec les autres, parmi les autres. C'est pire encore pour les personnes atteintes de maladies psychiatriques graves, car, contrairement aux personnes atteintes d'handicaps cognitifs, ces personnes font peur. Un grand nombre de malades psychiatriques se retrouvent ainsi dans la rue, sans domicile, ou sont en prison. Lors de la préparation, au CCNE, de notre avis « santé et médecine en prison », nous avons été effarés de constater le nombre de personnes atteintes de maladies psychiatriques graves qui, au lieu d'être soignées, étaient emprisonnées.
L'environnement joue pourtant un rôle très important, non seulement pour nous, mais même pour de petits animaux : depuis une dizaine d'années, des travaux réalisés chez des souris indiquent que, si l'on « enrichit » leur environnement, des maladies neurodégénératives induites peuvent être considérablement freinées, voire prévenues, en permettant à ces souris de vivre dans un environnement enrichi, qui stimule leurs activités mentales, affectives, psychiques, et physiques soit en injectant des produits toxiques pour le cerveau, soit en provoquant un accident vasculaire cérébral, soit en introduisant dans les gènes une séquence particulière provoquant une maladie neurodégénérative. On néglige trop ce qu'un environnement affectif, culturel et social peut apporter en termes de prévention et de bien-être, y compris dans le cas des maladies neurodégénératives.
D'un point de vue épidémiologique, les travaux du groupe de Michael Marmot en Angleterre, mettent en avant un différentiel qui peut aller jusqu'à quinze ans dans la survenue de l'invalidité et de la perte des fonctions cognitives chez les personnes âgées, en fonction de facteurs qui remontent à leur jeunesse, et qui concernent, la richesse de leur environnement éducatif, social, culturel et affectif. On ne prend pas assez en compte, dans notre pays, le fait que la manière dont nous construisons notre société, notre manière de vivre ensemble, a des conséquences majeures non seulement en termes de mal-être, de souffrance ou de bien-être, mais aussi en termes de santé ou de maladie, d'invalidité, d'espérance de vie et de mort prématurée.
Une autre question concerne l'utilisation des neurosciences en justice pour rechercher la « vérité ». En fait, il s'agit plutôt de rechercher des signes qui traduiraient la sincérité ou le mensonge, ou des intentions. Mais il y a une grande différence entre la sincérité et l'intention, qui sont de l'ordre des sensations et des sentiments, et la vérité qui concerne des faits. Intention ne signifie pas responsabilité. Et sentiment de responsabilité, voire certitude de culpabilité, ne signifie pas avoir commis l'acte que l'on se reproche. Les enfants pensent souvent, et les adultes parfois, que lorsqu'ils ont souhaité la mort d'une personne, et que ce voeu se réalise, ils sont coupables de sa mort. Leur intention est authentique ; leur sentiment de culpabilité sincère. Cela ne nous dit rien, en termes judiciaires, sur la « vérité ». Et cela fait longtemps que l'on sait que des aveux apparemment les plus sincères ne valent pas preuve de culpabilité réelle. Il me semble qu'il y aurait un risque certain à être persuadé que l'aveu que l'on pourrait tirer, par devers la personne, de l'analyse de ses activités cérébrales, aurait une valeur de preuve absolue.
Il y a, en fait, deux questions distinctes. La première consiste à se demander jusqu'où les neurosciences pourraient permettre de mettre en évidence le mensonge, la sincérité, l'intention, la culpabilité... C'est une question d'ordre scientifique. La seconde est d'une autre nature. Elle consiste, s'il s'avérait que les neurosciences avaient une efficacité dans ce domaine, à se demander s'il conviendrait d'avoir recours à ce type d'investigation, dans le cadre d'une démarche judiciaire dans laquelle le droit de ne pas répondre, la confidentialité des conversations avec l'avocat,... ont été progressivement considérés depuis des siècles comme des garants d'un procès équitable, respectant les droits de la défense dans le cadre de la recherche de la vérité. En témoigne l'évolution récente de notre législation concernant la garde à vue.
En d'autres termes, si l'on devenait soudain capable de tirer des renseignements importants en lisant à travers le crâne d'une personne, cette approche devrait-elle automatiquement être mise en pratique du seul fait qu'elle serait devenue possible, un peu comme si on estimait qu'à partir du moment où l'on dispose de micros miniatures, invisibles, il deviendrait souhaitable de les utiliser pour écouter les conversations d'un accusé avec son avocat (ou d'un juré, ou d'un juge, ou de l'avocat, ou du procureur...) du seul fait que c'est devenu techniquement possible ? Les avancées de la science transforment en possibles ce qui jusque-là était de l'ordre de l'impossible : elles ne répondent en rien à la question de savoir si ces nouveaux possibles sont souhaitables, ou non souhaitables.
Il y a dans le processus de la justice, dans la manière dont les lois sont formulées et appliquées, une dimension qui dépasse l'objectif de régulation de nos conduites, de notre façon de vivre ensemble : une dimension pédagogique, qui traduit les valeurs qui fondent notre société. Afficher l'idée que la vérité d'une personne n'est pas dans ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, dans la façon dont elle se comporte et interagit avec les autres, mais dans ce que l'on peut mesurer de ses activités cérébrales est un message déshumanisant qui risque de réduire la personne à ses paramètres biologiques.
Le terme de « personne » - qui définit aujourd'hui les droits et la dignité de chaque être humain - fait référence, étymologiquement, au masque que les comédiens portaient dans l'Antiquité lorsqu'ils jouaient un rôle au théâtre. L'illusion que la transparence totale permet de découvrir la vérité est une idée dangereuse. Elle porte en elle le risque d'oublier ce qui fait de chaque être humain une personne - une dignité qui dépasse tout ce qu'on peut mesurer, quantifier et analyser d'un point de vue scientifique.
Parmi toutes les démarches scientifiques actuelles, les neurosciences sont l'une des plus extraordinaires et des plus fascinantes. Vouloir prendre le temps de réfléchir avant d'appliquer est sans doute le meilleur tribut que l'on peut rendre à l'importance et à la valeur humaine que l'on attache à cette démarche.
M. Jean-Sébastien Vialatte. Je vous remercie de ces explications et donne la parole à Madame Hélène Gaumont-Prat, directrice du laboratoire de droit médical de l'Université Paris VIII.
Mme Hélène Gaumont-Prat, professeur de droit privé à l'Université Paris VIII, ancien membre du Comité consultatif national d'éthique. Je tiens tout d'abord à remercier M. Alain Claeys et M. Jean-Sébastien Vialatte pour l'organisation de cette journée. C'est un grand honneur pour moi que d'intervenir aujourd'hui pour vous présenter l'impact des neurosciences sur le droit.
L'accélération des recherches sur le fonctionnement du cerveau, fait naître des espoirs mais aussi des interrogations et des inquiétudes. L'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale et des « données cérébrales » issues de la recherche sur le cerveau se rapproche des questionnements posés par les tests génétiques et les « données génétiques » au plan éthique et juridique : en effet, la connaissance de l'information cérébrale et des caractéristiques neurales de l'individu comme celle de l'information génétique, débouche sur une transparence de l'homme pour le meilleur et pour le pire: - pour le meilleur, parce qu'elle intéresse la médecine, la recherche et les industries de santé dans la perspective du traitement des maladies neurologiques. - pour le pire, parce qu'elle peut être détournée de son objectif premier et servir des théories réductionnistes et déterministes, dangereuses pour les libertés. C'est tout le danger d'un savoir absolu sur l'homme lié aux risques d'atteinte au respect de la vie privée et de discrimination. À l'instar de la protection instituée pour les données génétiques en 1994, les données cérébrales ont fait l'objet d'un encadrement protecteur et respectueux des droits de la personne dans la nouvelle loi du 7 juillet 2011.
J'aborderai cette analyse en trois points : - les implications éthiques - le régime juridique actuel - les améliorations à apporter à ce régime juridique.
Les questionnements éthiques identifiés permettent au législateur de mieux cerner les enjeux et les risques pour réglementer utilement ce nouveau domaine, car face aux avancées scientifiques, le droit est très souvent suiveur.
Quelques dérives sont potentiellement envisageables : tout d'abord, le détournement à des fins non thérapeutiques des implants cérébraux. Actuellement, ceux-ci sont utilisés à des fins thérapeutiques pour de nombreux parkinsoniens. Qu'adviendrait-t-il si l'on acceptait de les poser pour augmenter la mémoire ou améliorer les vitesses de calcul à la demande des employeurs ou des employés désireux de candidater à certains types de postes ? Cela ne conduirait-il pas à envisager la question d'une inégalité sociale à l'emploi induite par l'accès à ces techniques ?
Une autre dérive serait d'accepter l'IRMf comme détecteur de mensonge soit dans la vie quotidienne, soit spécifiquement dans le domaine judiciaire : aux États-Unis un marché se développe autour des techniques d'imagerie cérébrale car des entreprises spécialisées 23 ( * ) prétendent pouvoir «détecter le mensonge» à l'aide des techniques d'IRMf dans plus de 93% des cas. Elles interviennent dans le cadre de litiges avec des assurances ou d'entretiens d'embauche afin de départager « scientifiquement » la vérité du mensonge. Les données des neurosciences bénéficient aujourd'hui d'un intérêt croissant également en matière judiciaire: constitueraient-t-elle une nouvelle version du « détecteur de mensonge », ce qui est interdit en France ?
Un domaine se développe, le neuromarketing, qui vise à améliorer l'impact des campagnes publicitaires ou de communication grâce aux neurosciences. Cela est-il conciliable avec notre conception de l'autonomie de la volonté ? Enfin, peut-on attribuer à ces techniques un pouvoir prédictif ? Comment les diagnostics prédictifs pour certains troubles sont-ils reçus par les patients et leurs familles alors qu'aucun traitement n'existe ? Il en est de même des effets du dépistage précoce quand il n'y a pas de remède et qu'un risque de stigmatisation existe ?
Dans un domaine voisin, la demande sécuritaire de plus en plus importante incite les gouvernements à rechercher des indicateurs biologiques de dangerosité de l'individu. La question est donc bien de déterminer la valeur prédictive réelle du test envisagé, qui actuellement reste probaliliste, et non de valider de manière pseudo-scientifique des préjugés sociaux, inconciliables avec les droits fondamentaux de la personne.
Ainsi, les questionnements éthiques sont de divers ordres. Comment assurer la protection de l'intimité de l'individu, la confidentialité de ces données face aux dangers d'exploitation abusive par un tiers, notamment dans le domaine de l'emploi ou de l'assurance, comme cela a pu être envisagé en matière de tests génétiques ?
J'en viens au régime juridique de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 24 ( * ) qui a été pionnière, en ce sens que les lois précédentes relatives à la bioéthique n'avaient jamais fait allusion à l'encadrement des neurosciences. C'est le résultat d'un certain nombre de rapports, dont le rapport de l'Office 25 ( * ) de 2008, qui mettait l'accent sur l'importance de l'encadrement.
La loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique a défini un encadrement des applications des neurosciences en réglementant l'accès aux techniques de l'imagerie cérébrale 26 ( * ) afin de créer un cadre protecteur des droits de la personne et en les soumettant aux grands principes bioéthiques inscrits au code civil. Elle en circonscrit le domaine d'accès en fonction de trois finalités reconnues comme légitimes, (finalité médicale, de recherche scientifique et judiciaire) afin de limiter les conséquences potentiellement graves pour l'homme, à l'image du régime élaboré dans le domaine de la génétique pour réglementer dès 1994 « les techniques d'investigations génétiques », les tests génétiques.
Le nouvel article 16-14 du code civil prévoit que « Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d'expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. »
Deux règles sont inscrites au code de la santé publique, sur la prescription et la réalisation des examens et le rôle d'évaluation et de suivi conféré au Comité national consultatif d'éthique, à l'Agence de la biomédecine et à l'Office parlementaire.
On observe qu'il s'agit d'un régime calqué sur le régime qui encadre les tests génétiques, qu'on retrouve aux articles 16-10 et 16-11 du code civil. En prenant modèle sur ce régime, le législateur a-t-il répondu aux inquiétudes ? La détermination du domaine réservé à ces trois finalités est-elle suffisante ?
La finalité judiciaire introduite (accès de l'imagerie cérébrale aux domaines de l'expertise judiciaire 27 ( * ) ) n'est-elle pas prématurée au regard du manque de fiabilité de ces techniques pour l'utiliser en matière judiciaire ? Cette disposition suscite le débat autant par la fascination que l'imagerie cérébrale provoque, à l'instar de la preuve par l'ADN qualifiée de « reine des preuves », que par l'inquiétude générée. Le rapport de l'OPESCT en 2008 s'était prononcé contre son intégration au domaine judiciaire. Actuellement, pour évaluer l'irresponsabilité pénale d'un accusé, les psychiatres appuient leurs expertises sur l'examen clinique et sur des entretiens. L'imagerie du cerveau n'est pas sollicitée. Son introduction par la loi n'est elle pas de nature, par la force que présente l'image à influencer la décision ? L'analyse des travaux préparatoires éclaire le sens donné à l'article 16-14 du code civil. Un rapport de Jean Léonetti (Rapport n°3111 28 ( * ) ), faisait mention de cette finalité judiciaire, en invoquant l'expertise judiciaire et le fait que l'imagerie cérébrale pouvait s'adjoindre, comme dans toute expertise, au rapport de l'expert, en vue, par exemple d'apprécier l'irresponsabilité pénale. Le rapport indiquait bien qu'il ne s'agissait en aucun cas d'en faire un détecteur de mensonge. Ainsi, l'utilisation d'une technique si complexe, sujette à des interprétations différentes 29 ( * ) (selon les réglages techniques et les logiciels utilisés), et dont la fiabilité reste très incertaine devra-t-elle être prise avec précaution lors de l'expertise judiciaire.
Quelles pourraient être les améliorations juridiques ultérieures ? Entre ces deux régimes, celui consacré aux empreintes génétiques et aux tests génétiques, et le régime actuel encadrant l'imagerie cérébrale, la similitude n'est pas totale. Tout d'abord, la loi du 7 juillet 2011 ne prévoit pas de sanctions pénales spécifiques en cas de mésusage de la technique d'imagerie cérébrale, en violation de l'article 16-14 du code civil, contrairement aux atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques sanctionnées aux articles 226-25 à 226-30 du code pénal.
Ensuite, la loi a ignoré le risque de discrimination spécifique lié à l'utilisation de données cérébrales, bien que ceci ait été évoqué lors des travaux parlementaires et qu'un projet d'article 16-15 du code civil envisageait que « nul ne peut faire l'objet de discriminations sur le fondement des techniques d'imagerie cérébrale », projet d'article supprimé par la suite.
Pourtant il aurait été facile de s'inspirer de l'article 16-13 code civil prévoyant que « Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques », dont l'atteinte à ces dispositions est visée à l'article 225-1 et sanctionnée à l'article 225-2 du code pénal.
En conclusion, on perçoit, à la lecture de tous les rapports parlementaires préparatoires à la loi, une unité dans la réflexion de bioéthique. Par conséquent, il semblerait normal de trouver une traduction juridique pour l'ensemble des questionnements identifiés.
DEBAT
M. Alain Claeys . J'ouvre le débat, avez-vous des observations ? J'ai rappelé en introduction de mon propos les nouvelles dispositions de la loi relative à la bioéthique. Il est exact qu'elle ne met pas en place l'encadrement qu'Hélène Gaumont-Prat a mentionné, et qui constitue une piste de travail importante pour nous.
M. Hervé Chneiweiss . La précision sur la finalité ne pose-t-elle pas une question dans le contexte des cohortes ? On dispose désormais de banques de données en imagerie cérébrale très importantes, qui peuvent résulter d'études menées depuis dix ans. Lionel Naccache a recommandé de conserver de la souplesse pour tenir compte des évolutions et des questionnements nouveaux qui peuvent survenir. L'inscription de la finalité de la recherche, et d'une finalité restrictive dans le consentement, ne va-t-elle pas limiter la potentialité de ces cohortes, alors que l'utilisation de ces banques d'images avec d'autres idées de recherche que celles mises en avant par la loi peut être légitime ?
Mme Hélène Gaumont-Prat . On l'a déjà vu en matière d'identification et d'examen des caractéristiques génétiques. Le consentement donné pour tel examen pouvait-il être utilisé pour un autre ? À l'époque, la réponse avait consisté à dire qu'il fallait demander un consentement large, puis la loi du 6 août 2004 a apporté des précisions en introduisant également la notion de consentement éclairé lié à la finalité de l'examen.
M. Alain Claeys. Je vous remercie de ces précisions et donne la parole au professeur Yves Agid.
M. Yves Agid, membre fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), professeur de neurologie, membre de l'Académie des sciences, et du membre du Comité consultatif national d'éthique (CCNE). Le Comité national consultatif d'éthique a pris la décision d'aborder la question des neurosciences qui, comme on l'a compris, touche bien des personnes dans ce monde. Avec Ali Benmakhlouf ici présent et un groupe de travail, nous avons décidé pour commencer de traiter de la neuroimagerie, sujet qui paraissait relativement simple à aborder et s'est avéré, de fait, difficile. Je distinguerai pour commencer deux cas particuliers : celui de la pathologie et celui de la population générale. En pathologie, l'IRM est une totale révolution, surtout pour les neurologues, pour le diagnostic, le pronostic, la thérapeutique. Elle le deviendra à l'évidence pour les psychiatres. Comme toujours, l'IRM révèle presque toutes les lésions du système nerveux. Mais elle donne des résultats sans qu'on ait de connaissances sur la situation des malades.
Je pense au travail d'une équipe de Toronto, qui a étudié les effets de la stimulation cérébrale chez des malades atteints de maladie d'Alzheimer à un moment relativement précoce de leur maladie, avec des résultats favorables. Or, lorsqu'on y regarde de près, les résultats sont surtout visibles en imagerie ; mais lorsqu'on se penche sur ceux concernant les fonctions cognitives, ils sont discutables. Les résultats sont présentés de telle manière que, sur six malades, on laisse entendre que non seulement il n'y a pas d'aggravation, mais qu'il y a peut-être une amélioration de l'état des patients. C'est finalement le résultat de l'imagerie qui permet la publication. Il n'empêche que l'étude est intéressante, car elle concerne l'activation de la fonction de l'hippocampe, dont on sait qu'elle joue un rôle très important dans le contrôle de la mémoire.
L'IRM en pathologie s'apparente à la radio du poumon pour les pneumologues au siècle dernier : une totale révolution. En recherche, elle ouvre des perspectives sur la qualité de l'approche clinique, et c'est un cercle vertueux. Cependant, il risque d'arriver ce qui s'est produit en pneumologie avec le développement de l'examen clinique du poumon. On ne peut néanmoins pas comparer un poumon où l'on distingue quelques types cellulaires, au cerveau constitué de milliards de cellules avec des milliers de types cellulaires différents.
Le système nerveux dans son ensemble concerne ce qui permet l'adaptation de l'individu. Toute résultante de cette adaptation est motrice : je bouge les doigts, je bouge mon corps, je dis des paroles, j'active mes lèvres, ma langue, mon larynx : toutes ces actions sont motrices. L'observation de ce comportement sensorimoteur est le travail du médecin et du psychologue (on sait que tout médecin doit être un bon psychologue) car ce comportement traduit de l'intellect, de l'affect, et la conjonction des deux.
À cet égard, l'IRM est un outil très précieux. L'IRM permet d'étudier le comportement, en reflétant l'activité d'un certain nombre de cellules nerveuses dans le cerveau, à la fois dans le temps et dans l'espace. On arrive avec des machines perfectionnées à une résolution de l'ordre du millimètre cube. Mais si en plus de la pathologie, on utilise cet outil pour apprécier la qualité de la personnalité humaine, cela induit des risques.
S'agissant des faits, il faut distinguer l'étude de la personnalité humaine par l'IRM fonctionnelle et celle de situations sociales particulières. S'agissant de la personnalité humaine, des travaux ont montré des hypo et des hyper activités de petites parties du cerveau pour les émotions élémentaires. De manière plus subtile, on peut y reconnaître des personnalités intraverties ou extraverties, des personnalités ayant des addictions, des tendances sexuelles particulières. On peut y étudier aussi la prise de décision, ce qui attire ceux qui font du marketing ; on pourrait même imaginer sélectionner les politiques sur leur capacité de décision.
Il est aussi possible d'en déduire pour certains des attitudes morales. Ainsi, des articles étonnants ont été publiés sur le problème du racisme, en comparant des sujets de race noire à des Blancs et vice-versa. Les résultats, mais je ne suis pas spécialiste, sont assez douteux. Des études de neuroimagerie ont même été faites sur le sujet de l'expérience mystique, de l'altruisme. Une étude est ainsi parue sur le « centre de l'altruisme ». Pour moi, c'est délirant. Il ne faudrait pas que ces images soient utilisées sans consentement ou à l'insu des patients, ce qui renvoie au problème des banques de données et de leur accessibilité.
À la limite, l'analyse de la personnalité humaine peut se traduire par le mindreading . On peut ainsi coller un visage, un ustensile, un animal sur un groupe de neurones. Plusieurs chercheurs ont montré que des chiffres pouvaient se plaquer avec une remarquable spécificité sur des endroits très précis, sur des systèmes de neurones distribués topographiquement bien organisés. Si l'on montre des objets, on peut, dans 95 % des cas prédire que vous avez vu un couteau de cuisine ou un chat. Il s'agit de recherche.
J'en viens à l'application à des situations sociales particulières, qui représente un autre risque. En neuroéconomie, on peut ainsi identifier des aptitudes de décision, avec leur corrélat anatomique, ou des capacités de motivation, et ce, avec une certaine précision. Je n'insisterai pas sur l'utilisation de ces techniques devant les tribunaux, sauf à souligner que ce sujet peut intéresser des situations politiques. Je pense aux centres d'immigration, au terrorisme, et à la détection du mensonge, déjà effectuée par des tests végétatifs périphériques. Je citerai enfin le problème de l'amélioration des performances et des comas végétatifs. Telle est la brève liste des questions qui sont posées par l'utilisation de l'IRM, notamment fonctionnelle, dans des conditions « normales ».
Quelles en sont les limites? On peut les classer en deux catégories : celles liées à la machine elle-même et celles liées à son utilisation. Les premières sont bien connues. On mesure un débit sanguin central dans des capillaires qui reflètent une activité neuronale et non l'inverse. Les neurones étant, pour moi, des routes : un neurone comprend des terminaisons nerveuses, des dendrites, un corps cellulaire, et des cellules gliales, qui sont plus représentées dans le cerveau que les neurones. L'autre problème lié à la machine est celui du signal sur un bruit de fond. On procède à des soustractions. Cela a une bonne signification, à condition qu'on répète les mêmes mesures chez un individu et qu'on « pool » plusieurs individus comparés à des groupes témoins. À l'échelle individuelle, ce type de moyenne est inapplicable. La différence entre une activation et le bruit de fond non spécifique est de l'ordre de 1 à 2 %, ce qui est très faible.
Concernant les biais et les limites liés à l'utilisation de la machine, il faut savoir que l'imagerie, avec ses belles couleurs, n'est qu'un reflet, (un corrélat) très éloigné du fonctionnement neuronal. On mesure des voxels par informatique. Des interprétations sont à faire en fonction des différents stades de l'utilisation de l'outil mathématique. La responsabilité de l'utilisateur est donc majeure.
Les banques informatisées, problème très grave s'il en est, il peut concerner la pratique médicale. En principe, toutes les données sont protégéés, mais elles pourraient être utilisées de manière frauduleuse, par exemple devant les tribunaux. C'est moins clair pour les banques d'images utilisées en recherche, qui sont aussi protégées. L'accessibilité des banques informatisées de neuroimagerie pose des problèmes voisins de ceux de la génétique. Quant aux situations inattendues, un code de bonne conduite pourrait facilement les résoudre.
Les biais particuliers de l'IRMf posent la question de l'illusion pour mesurer ce qu'est une pensée. Si on lit les philosophes, les psychologues, les médecins et les scientifiques, on s'aperçoit que chacun a sa définition. On peut mesurer ce qui se produit au sein des routes neuronales, dans certaines cellules nerveuses, mais on n'a pas accès au contenu sémantique. De plus, on ne se soucie pas des autres cellules nerveuses.
Enfin, ce n'est pas parce qu'un comportement se traduit par une image que la mise en évidence de cette image traduit un comportement. De surcroît, ce n'est pas nécessairement l'endroit qui est le plus activé dans le cerveau qui traduit l'importance fonctionnelle. Comme il s'agit de réseaux de neurones qui sont topographiquement organisés, mettant en jeu l'ensemble du cerveau, l'important sur le plan fonctionnel peut être ce qui se trouve à distance, de manière indirecte et atténuée. Cela se passe comme dans les journaux : vous faites part d'une information, certains journalistes s'emparent du plus apparent, alors que tel n'est pas le sens du message, qui apparaît de manière plus discrète.
En résumé, la neuroimagerie reflète ce qui se passe dans le cerveau au niveau des routes cérébrales, qui sont les neurones, mais ne met pas en évidence la sémantique. Le fantasme est là. Il faut être très prudent. Cela dit, « images don't lie but people lie »... La neuroimagerie se développera de façon considérable, comme son utilisation et ses conséquences pour étudier la personnalité humaine à l'échelle personnelle, familiale, professionnelle et sociale. Pourquoi ? Parce que les méthodes vont s'améliorer de façon considérable. Des machines toujours plus puissantes seront disponibles. En réduisant le champ des possibles, diront certains : c'est un argument supplémentaire qui renforce le faisceau d'arguments qui permet d'analyser la personnalité de quelqu'un. C'est peut être un élément additif, mais il est bien au second plan par rapport à la clinique, le meilleur reflet de ce qui se passe dans le cerveau étant l'observation et l'écoute.
M. Alain Claeys . Je vous remercie de ces explications, et donne la parole au Professeur Paolo Girolami de l'Université de Turin.
M. Paolo Girolami, professeur à l'Université de Turin, chercheur laboratoire d'éthique médicale de l'Université Paris-Descartes. On a prononcé ce matin les noms de Paul Ricoeur ou de Michel Foucault. Pour ma part, je souhaite partir de l'étymologie, observant qu'un de vos grands linguistes, Emile Benveniste, a travaillé sur la racine « med » de la médecine. Cette racine désigne des notions assez différentes entre elles, mais toutes réductibles au concept de mesure, une mesure appliquée aux choses avec l'autorité typique de l'acte de gouverner, une mesure capable de rétablir l'ordre dans une perturbation 30 ( * ) .
L'idée de médecine comprend les concepts de mesure, d'autorité et d'ordre, et toutes les notions qui y sont liées. Le concept de mesure renvoie au remède au mal, à la médicalisation de la société, le « prédictionnisme » à la maîtrise du présent et du futur. L'autorité renvoie à l'autoritarisme, le paternalisme, étant une dérive dans la médecine. L'ordre, lui, renvoie à la norme et à son contraire, l'anormalité, la réflexion de Canguilhem étant essentielle sur ce point. 31 ( * )
Je vais me concentrer sur deux auteurs importants, capables d'interpréter deux courants importants de la pensée contemporaine. Le premier est John Harris, qui évoque l' enhancing evolution 32 ( * ) . Cet auteur prend l'exemple de l'école. Si celle-ci nous permet d'avoir des élèves plus beaux et intelligents, en meilleure santé, pourquoi le refuser ? Imaginons une médecine capable d'améliorer les hommes sur le plan psychique et physique, de faire des hommes plus intelligents, plus beaux, en meilleure santé. Pourquoi la refuser ? Quant à la discrimination, pour John Harris, celle-ci vaut pour les handicapés comme pour les autres. Dans le but de faire comprendre que l'amélioration relève de la bienfaisance, il développe cet exemple à propos de la neurologie : un neurologue expliquera à son patient qu'il peut traiter les troubles dérivés de la lésion de son cerveau, mais qu'il y a un problème, car la thérapie régénérative qu'il utilisera lui redonnera toutes les fonctions perdues ; il disposera ensuite d'un cerveau amélioré avec une intelligence et une mémoire plus performantes. Le neurologue ne manquera pas de conclure qu'il est désolé, attitude paradoxale 33 ( * ) .
Pour Harris, il faut intervenir sur la loterie naturelle, la mission de la médecine étant l'amélioration de l'être humain. Hans Jonas s'oppose totalement à une telle conception 34 ( * ) . Pour lui, la loterie de la vie est un bien. Elle permet la diversité, qui est une richesse, fonction de l'équilibre entre les forces de la nature. Elle est la source de l'étonnement qui accompagne le nouveau. Bref, elle est liberté. Qui doit décider de l'excellence des exemplaires et selon quels paramètres ? Pour Hans Jonas, il est plus facile d'établir ce qu'on ne veut pas plutôt que ce qu'on veut, le mal plutôt que le bien. « Certes, explique Hans Jonas, il est indiscutable que des maladies comme la schizophrénie et l'épilepsie ne sont pas désirables, mais vaut-il mieux un esprit froid ou un coeur chaud, une grande sensibilité ou une grande robustesse, un tempérament docile ou rebelle ? » 35 ( * ) . Dans une telle conception, la mission de la médecine est de restaurer la santé. C'est une mission de restitution.
Aldo Schiavone est un philosophe italien, qui a écrit un livre intitulé Histoire et destin 36 ( * ) . Dans ce livre, il estime que le mot d'amélioration n'est pas un mot interdit. L'homme est le fruit d'une amélioration physique et psychique continue depuis l'Antiquité. Il observe aussi, ce qui peut être discuté, que le patrimoine génétique de l'humanité a augmenté grâce à l'introduction des antibiotiques. Grâce aux antibiotiques de nombreuses personnes ont la possibilité de survivre à la mortalité infantile et ainsi de transmettre « artificiellement » leur patrimoine génétique 37 ( * ) .
Les trois « med » de la médecine se déclinent ainsi. La médecine est le remède au mal de la maladie et de la souffrance. Elle est une médiation entre la maladie et la santé, entre la santé perdue et la maladie éprouvée, etc. Elle doit pondérer ce qui est bon pour restituer la santé à l'homme 38 ( * ) .
L'amélioration peut être liée à une capacité à accroître des guérisons. Pour Jonas, il faut utiliser l'amélioration, non pour améliorer l'homme et créer un homme nouveau (le surhomme) à la manière de Nietzsche 39 ( * ) , mais pour créer de meilleures conditions afin de guérir les personnes ; il y a un devoir d'amélioration à travers la guérison 40 ( * ) . Il en serait ainsi en neurologie, où de nombreuses maladies rares ne sont pas encore guérissables.
Woody Allen explique dans « Woody et les robots» (1973) que son cerveau n'est pas son organe préféré ( My brain...that's my second favorite organ! ). La médecine semble victime de ce même stéréotype. Elle doit mieux connaître le cerveau. En effet, elle souffre d'une vision dualiste, qui vient de Descartes, qui a séparé le corps machine et l'esprit, la res cogitans et la res extensa . Par conséquent, nous sommes témoins d'une vision réductionniste et mécanique du cerveau. Les incertitudes de la science sont relatives aux états de conscience, aux rapports entre la conscience, les émotions, et l'expérience subjective 41 ( * ) . Tout diagnostic neurobiologique, par rapport à la vérité du témoin et de l'accusé, ressort de la faiblesse des connaissances, et d'une vision mécanique des fonctions du cerveau. La question de l'imagerie a été longuement évoquée dans le milieu judiciaire. Or, je suis médecin légiste : l'école médico-légale de Turin, où j'ai été formé, a été fondée par Lombroso 42 ( * ) . Aussi suis-je toujours très méfiant face à toute tentative de réduire un phénomène complexe comme la criminalité aux modifications morphologiques du corps humain.
Pour mieux connaître le cerveau, expérimenter et franchir de nouvelles frontières, je considère qu'une des clés d'entrée dans le monde de la neurobiologie est l'interdisciplinarité, notamment une collaboration renouvelée entre les neurobiologistes, les psychologues et les philosophes de l'esprit, et je pense aux philosophes qui s'occupent de logique et de développement de l'esprit, dont la contribution à la connaissance de l'homme me paraît essentiel. Il ne s'agit pas de créer quelque chose de nouveau, l'homme tel qu'il est étant déjà d'une grande richesse.
DEBAT
M. Jean- Sébastien Vialatte. Je vous remercie, j'ouvre le débat.
M. Hervé Chneiweiss. On constate une tension permanente sur cette question de l'amélioration. On trouve même dans la Bible que le destin de l'homme est d'achever l'humanité. S'agit-il d'améliorer un homme ou un de ses aspects, ou l'humanité. Jusqu'à présent, l'éducation a eu pour objectif d'élargir l'autonomie de l'individu, de lui donner plus d'outils, d'agir et d'interagir. L'un des dangers évoqué est qu'à force d'analyser des propriétés particulières d'un cerveau individuel, on isole de plus en plus des individus particulièrement efficaces dans un domaine donné. Mais ils seront de plus en plus inefficaces dans leur sociabilité. Notre questionnement ne porte pas sur le soin nécessaire ou l'amélioration des capacités d'autonomie, objectif louable, mais sur notre capacité de faire cela au bénéfice des intersubjectivités. Quelle que soit l'objectivation qu'on est capable de faire des phénomènes biologiques, il faut garder l'idée qu'on parvient à vivre ensemble dans la pluralité de nos subjectivités. Quelle que soit l'objectivation du cerveau, le fait d'être ensemble dans un corps social, instruments juridiques compris, c'est une interaction de subjectivités.
M. Lionel Naccache. Cette deuxième session a été pour moi très instructive. La notion d'éthique prend son sens lorsqu'on est face à une situation d'incertitude. Face à une incertitude, la manière de se débarrasser d'un problème éthique est d'éliminer l'incertitude. Une confusion entre science et scientisme revient souvent à vouloir faire dire à des données scientifiques, plus qu'elles ne veulent dire. C'est une façon de réduire, dont on voit bien toutes les dimensions péjoratives. En écoutant Jean-Claude Ameisen, j'ai le sentiment qu'un autre extrême peut nuire à la réflexion éthique et tendre à vouloir réduire l'incertitude dans l'autre sens, dans le sens humaniste.
À mon sens, il ne faut pas avoir peur de la connaissance objective qu'une technique scientifique peut donner. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que peut apporter une donnée, mais de la prendre à une juste valeur, sans la réduire. Qu'on songe aux données sur la subjectivité du mensonge en imagerie cérébrale. Toutes les personnes qui effectuent de l'imagerie cérébrale dans ce domaine sont alimentées par une richesse psychologique, faisant la différence entre la représentation subjective et un réel qui peut être distant. Prendre comme exemple la mise en évidence d'un pattern de mensonge chez une personne, qui peut être un mensonge subjectif, ne correspond pas à une situation pouvant avoir un impact juridique. Ce n'est pas faire honneur à la complexité.
De même, sur l'aspect médical, je partage totalement avec lui la dimension « montagne magique ». Qu'on songe, comment à l'époque de Thomas Mann, on s'occupait des malades. Cela donne à voir d'une société. Pour ma part, je suis étonné par les réseaux de prise en charge des malades, dans des situations de maladies qu'on ne sait pas soigner, comme la maladie de Charcot, où des maladies qu'on sait soigner, mais pas guérir, comme la sclérose en plaque. Il existe bien des situations présentant des insuffisances majeures en France, mais je ne pense pas qu'on ait un regard aussi radical, et qu'on ne s'intéresse qu'aux maladies que l'on peut soigner.
M. Jean Claude Ameisen. La France a été condamnée en 2004 par le Conseil de l'Europe, et c'est le seul pays européen du Conseil qui ait fait l'objet d'une telle condamnation, pour non accès à la scolarisation des enfants atteints d'autisme. Lorsque les troubles neurologiques n'affectent pas les fonctions cognitives, affectives ou comportementales, on constate une grande sollicitude, parce qu'il s'agit d'une maladie du cerveau qui ne se traduit que dans le corps. Lorsqu'il y a atteinte des capacités cognitives au niveau relationnel, on observe une tendance à préférer l'isolement ou l'abandon. En Suède, les institutions pour personnes atteintes de handicaps cognitifs, relationnels ou comportementaux ont été fermées depuis plus de dix ans. Toutes les personnes atteintes de handicap dit « mental », lorsqu'elles sont enfants, sont scolarisées. Lorsqu'elles sont adultes, qu'elles soient atteintes de traumatisme crânien, d'autisme, de maladie d'Alzheimer ou de trisomie 21, elles vivent chez elles, ou dans de petits appartements, avec des accompagnateurs. En France, nous sommes profondément en retard.
Je souhaitais souligner cette discordance tragique entre de remarquables avancées thérapeutiques et cet état d'abandon des personnes atteintes de handicap mental qu'on ne peut guérir. Le seul but de la médecine n'est pas de guérir, mais de permettre à une personne de vivre le mieux possible lorsqu'on ne peut pas modifier son état. C'est dans ce sens aussi que nous devons faire porter tous nos efforts. La tarification à l'activité à l'hôpital traduit le même problème. C'est l'acte médical technique « utile » parce qu'il permet de guérir le patient, qui est considéré comme valable. Le fait d'aider une personne à vivre avec les autres, de soulager sa souffrance, de l'accompagner, ce qui ne procède le plus souvent pas d'un acte technique, thérapeutique au sens classique du terme, est de plus en plus dévalorisé. Une telle situation n'est pas propre aux neurosciences, mais prend un relief particulier, étant donné que les neurosciences s'intéressent à ce qu'il y a de plus humain en nous.
Concernant le deuxième point, je considère que la réflexion éthique, en science, doit avoir une dimension épistémologique. Que signifie la découverte scientifique dont on veut tirer des applications ? Que signifie détecter, au niveau des activités cérébrales, quelque chose qui traduirait un mensonge ? C'est une question scientifique fascinante. Mais cette démarche éthique ne s'arrête pas à cette seule dimension épistémologique. Quand bien même dans des domaines restrictifs précis, il y aurait une possibilité d'interpréter dans le cadre d'une procédure judiciaire, des résultats sur le mensonge, la sincérité, le sentiment de culpabilité ou d'innocence d'une personne, devrions-nous les utiliser sous prétexte que la science soudain le rend possible ? C'est une question éthique qui dépasse la dimension épistémologique.
Dans le cas d'une personne qu'on vient d'arrêter, le fait qu'elle ait le droit de se taire et d'avoir un avocat ne contribuera évidemment pas, si elle est coupable, à la faire avouer. Mais respecter les droits de la défense, c'est concilier la volonté de faire surgir au mieux la vérité, établir et sanctionner les responsables, obtenir réparation des préjudices, et préserver le droit de chacun à un procès équitable. Jusqu'où devons-nous nous restreindre parce que nous pensons que le maintien d'un certain degré d'opacité n'est pas dû à notre incapacité à rendre les personnes transparentes, mais au respect de leurs droits fondamentaux ? C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué cette notion de masque, l'étymologie même du terme de personne. Les sociétés totalitaires sont celles qui ont eu, à un certain moment, le rêve ou le cauchemar de la transparence totale.
M. Yves Agid. Le scientifique qui utilise ces méthodes a une bonne connaissance des limites des méthodes qu'il emploie au regard des tâches imposées, surtout pour des phénomènes aussi complexes que les fonctions mentales. Je me suis intéressé aux publications sur le mensonge, sujet important pour les tribunaux. On constate des biais considérables. Le premier est que ces études ont été réalisées chez des sujets jeunes, des étudiants auxquels on demande de mentir. On leur montre une rose, puis on leur demande de dire que c'est un chien. C'est pour le moins artificiel. Deuxièmement, dans une cour de justice, il y a des facteurs confondants, comme l'anxiété ou la peur. Le troisième problème, bien connu des neuropsychologues, est la dimension d' effort demanding . Mentir suppose un effort intellectuel, de mettre en jeu ses ressources mentales. Ce sont des facteurs confondants. Les études sur le mensonge ont donc de nombreuses limites.
Mme Marie-Odile Krebs. Je suis tout à fait d'accord avec les propos sur l'abandon, situation qui concerne les jeunes patients souffrant d'autisme, mais aussi les patients souffrant de schizophrénie. En écoutant, je me rends compte de la grande difficulté de représentation de ces pathologies complexes que sont les troubles psychotiques et la schizophrénie. N'a-t-on pas du mal à se représenter la souffrance psychique, qui sous prétexte d'être psychique, deviendra moins sérieuse que la souffrance ou la douleur physique ? Vaut-il mieux être froid ou être réactif et avoir beaucoup d'émotions ? Certes, la schizophrénie peut s'accompagner d'une froideur affective, d'une distance. Mais la difficulté pour les patients est la grande détresse dans laquelle ils sont plongés et leur souffrance psychique. Il faut donc travailler sur cette représentation, y compris dans la population générale, étape incontournable des programmes de communication et de prévention.
S'agissant des études sur la personnalité et l'imagerie cérébrale, il faut rappeler qu'elles ont été développées dans des contextes expérimentaux précis, sur des populations qui présentent un trouble de la personnalité. La vraie vie est beaucoup plus complexe. Se pose la question de la généralisation possible et de l'interprétation possible dans un autre contexte, notamment judiciaire. Je suis pour ma part très circonspecte sur le fait d'autoriser l'utilisation de l'imagerie fonctionnelle dans les tribunaux, car dans notre monde submergé d'images, on convainc dès qu'on montre une image.
M. Jean-Michel Besnier, professeur de philosophie à l'Université de Paris IV-Sorbonne, chercheur au Centre de recherche en épistémologie appliquée (CREA), (CNRS/École Polytechnique). Une anecdote pour rebondir sur le propos de Jean-Claude Ameisen. Si les neurosciences se laissaient instrumentaliser au service d'une volonté de transparence, elles s'exposeraient à être immorales, car le mensonge est la condition de la morale. Nous sommes des êtres humains parce que nous pouvons dire ce qui n'est pas, le contraire de ce qui est. Nous ne collons pas aux choses. Le devoir être est possible parce que le mensonge est permis. Je me méfie donc beaucoup de toute entreprise qui se servirait de la science pour pourchasser le mensonge, et qui serait déshumanisante.
M. Jean Claude Ameisen. En ce qui concerne les personnes atteintes de handicaps, et notamment les enfants, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur ce que nous attendons de l'école. Si l'on attend essentiellement des apprentissages et des performances précises, stéréotypées, plus les élèves sont homogènes, plus ils se ressemblent, et plus on atteindra facilement ce but. Si l'on attend aussi une capacité à construire des relations humaines et sociales complexes, une ouverture sur l'autre, sur tous les autres, alors la diversité des élèves, y compris la présence d'élèves atteints de handicaps, devient essentielle. Ce qui freine actuellement l'insertion des enfants handicapés à l'école, c'est que la société conçoit l'école comme une course d'obstacles vers l'acquisition individuelle de performances particulières, et non pas comme un apprentissage collectif de la construction et de l'invention d'une société ouverte, innovante, où peuvent se conjuguer liberté et solidarité.
M. Hervé Chneiweiss. Être présent dans l'environnement social participe d'une intégration, mais plus encore d'une forme de traitement. On l'a bien vu pour la maladie d'Alzheimer, en soulignant l'importance d'un environnement enrichi. C'est encore plus vrai pour l'autisme ou pour des patients anxiodépressifs ou schizophrènes.
Cela dit, et je m'adresse à Lionel Naccache, les travaux que vous menez sur les états de conscience et la capacité à détecter certaines activités cérébrales, pourraient-ils déboucher sur une redéfinition de la mort et de la capacité de prélèvement en déterminant l'irréversibilité de l'atteinte de l'organe ?
M. Lionel Naccache. Non, car tous ces marqueurs fonctionnels qui sont à notre disposition ont une valeur, une limite très forte, à savoir leur aspect négatif, l'absence de réponse. Lorsqu'on retrouve un signe de conscience chez un patient, on doit pouvoir dire qu'il est conscient maintenant, qu'il est dans un état qui autorise la conscience. Lorsqu'on ne retrouve pas cet indice, rien ne permet d'affirmer que le patient n'est pas conscient. Cette question que vous évoquez est posée par d'autres personnes. Parvenir à montrer qu'un individu a perdu la conscience de manière irréversible, est-ce ouvrir un nouveau cadre médico-légal ? Ce problème est soulevé et discuté dans plusieurs articles.
M. Grégoire Malandain. Le maintien à domicile ou dans la société des personnes en situation de handicap dépasse le cadre de la médecine. Bien souvent, cela demande un aménagement de l'environnement, du contexte autour de la personne pour effectuer ce maintien à domicile. Des études montrent que rester dans un environnement familier permet de freiner l'évolution des pathologies . A contrario, n'avoir qu'une réponse médicalisée à ces problèmes conduit à un sentiment d'exclusion beaucoup plus fort. Il y a un effort à accomplir pour permettre le maintien à domicile ou dans la société de ces personnes. Les derniers appels à projets de l'Europe mettent souvent en avant cette notion de mieux vivre.
Un mot sur les études de groupe et des grandes bases de données. Lorsqu'on réalise ces études de cohortes, on essaie de garantir un maximum de sécurité en anonymisant les images, en cryptant les données. En revanche, il est parfois possible, en matière d'imagerie cérébrale, de reconnaître la personne en reconstruisant le visage, ce qui n'est pas vrai pour les autres données. C'est une dimension supplémentaire, rarement évoquée.
INTERFACE HOMME/MACHINE : RÉPARATION OU AUGMENTATION ?
M. Jean-Sébastien Vialatte. Nous en arrivons à la troisième table ronde qui sera l'occasion de nous interroger sur l'interface homme/machine. Le professeur Jean-Michel Besnier a la parole.
Jean-Michel Besnier, professeur de philosophie à l'Université de Paris IV, chercheur au Centre de recherche en épistémologie appliquée (CREA), (CNRS/École Polytechnique). Je vais centrer mon propos sur les représentations mentales induites par les technologies, en particulier l'imagerie cérébrale. Ce faisant, je retrouverai quelques observations déjà formulées par Jean-Claude Ameisen. À mon sens, il existe un imaginaire de l'imagerie cérébrale, que les médecins peuvent encourager ou dissuader. La question de l'éthique afférente à l'imagerie cérébrale tient sans doute à la réponse qu'on peut donner à cet imaginaire qui se développe dans le public, ou qu'on souhaite vouloir contrecarrer.
Les techniques d'exploration et de visualisation du cerveau ont eu un résultat sur le plan des représentations mentales que l'on s'en fait au sein du public : elles ont banalisé le cerveau, au point que, chez un grand nombre de nos contemporains, le cerveau apparaît de plus en plus comme un organe comme un autre, dont les signaux chimiques d'interactions sont de mieux en mieux identifiés, et comparables à ceux de n'importe quel autre organe. C'est un effet de désenchantement, qui explique sans doute une certaine tolérance aux réductionnismes dans la façon dont les résultats des neurosciences sont présentés au public. Le fonctionnement du cerveau, évoque facilement celui d'un ordinateur, au moins depuis 1958, lorsque John Von Neumann a publié son fameux livre, Le cerveau et l'ordinateur. Quand ce n'est pas l'ordinateur qui sert de référence, le cerveau, est apparenté à une simple glande, mobilisant des neurotransmetteurs pour assurer le transfert de l'information.
Cette banalisation du cerveau, facilitée par les technologies de modélisation, de simulation et de visualisation, accrédite une représentation simplifiée de l'humain. De plus en plus, les technologies développent chez nos contemporains une représentation d'eux-mêmes simplifiée. La technologie est en général efficace, quand elle opère une simplification de l'objet à comprendre, simplification sans doute plus grave dans le domaine de l'imagerie cérébrale. Au fond, on pense que même si le cerveau est complexe, même si son exploration exige une infrastructure technique considérable, il n'est pas plus que l'embrouillamini de milliards de neurones reliés entre eux par un immense réseau de câbles et de connexions, dans lesquels circulent des impulsions électriques ou chimiques. La complexité n'empêche pas qu'on projette sur elle de la simplicité. Qu'est-ce en effet que la complexité, sinon l'intrication de chaînes causales simples en elles-mêmes ?
Du coup, une représentation schématique se dégage de l'ensemble, qui engage nos contemporains sur une pente non seulement antispiritualiste, mais surtout cynique. L'esprit n'a plus rien de mystérieux, ce que les scientifiques savent depuis longtemps. S'il n'a plus rien de tel, on peut s'en passer et s'en tenir au neuronal, en oubliant même les cellules gliales.
Au fond, la tâche aveugle qui justifiait les performances les plus hautes de l'humanité, les facultés cognitives, le pouvoir symbolique, la culture, est en passe de se laisser réduire à un dispositif physicochimique, sans spécificité. La banalisation a raison du questionnement qui appelait jadis la métaphysique. Pour autant, rien n'empêchera d'affirmer que cette simplification de l'humain équivaut à une déshumanisation, autrement nommée machinisation ou animalisation de l'humain. Du reste, les spéculations post-humanistes passent tantôt du côté de l'animalisation, tantôt de celui de la machinisation, oubliant dans les deux cas, la spécificité de l'humain.
Les spéculations post-humanistes en tirent facilement argument. Elles se représentent les technologies comme l'instrument qui devrait aider l'homme à fusionner avec les machines, et ce d'autant plus facilement qu'elles trouveront dans les neurosciences, les arguments d'une mécanisation de l'esprit, tel est le fantasme de base. On l'a rappelé : le nerf de la démonstration antihumaniste des sciences du cerveau consiste dans l'abandon de la notion de libre arbitre, imposée par les observations neurophysiologiques de l'activation neuronale impliquée dans les mécanismes de décision. On a rappelé au moins par deux fois l'importance des expériences de Benjamin Libet, qui datent de trente ans et ont fini, dans l'esprit du public instruit, par se résumer au fait que toute prise de décision consciente est toujours précédée par une activation neuronale. Par conséquent, nous serions dépossédés de l'initiative de ce que nous faisons consciemment par le cerveau, un cerveau qu'on réifie.
La conséquence tirée par cette mise en évidence de la caducité de la notion de libre arbitre explique les cris d'orfraie d'un certain nombre de philosophes, comme Jürgen Habermas, Francis Fukuyama, et d'autres, qui proclament que les neurosciences sont en passe de nous permettre de modifier, voire de supprimer la nature humaine, puisqu'on pourrait agir sur les causes des comportements que paraissent révéler les circuits synaptiques grâce à l'imagerie cérébrale.
Celle-ci est mythifiée, hyperbolisée, au point que les questions les plus intimes afférentes à la nature humaine se trouvent bouleversées. L'imagerie cérébrale, est réputée être un instrument qui facilite la réparation des dysfonctionnements, et qui devrait permettre l'augmentation des performances. Ces technologies permettraient de faire passer de l'homme diminué à l'homme augmenté : telle est la grande thématique aujourd'hui. Ce qui permet de parer à la diminution devrait permettre de réaliser l'augmentation. Est-ce pour cela qu'on désire de plus en plus idéaliser le handicapé ? Je n'en sais rien, mais c'est une interrogation qui pourrait intéresser les sociologues.
La neuropharmacologie offre de booster le cerveau, en modifiant l'humeur ou la conscience, grâce à l'intervention sur les neurotransmetteurs, ou en agissant sur des récepteurs appropriés. Chez certains transhumanistes ou technoprophètes, l'augmentation est accueillie comme une promesse susceptible de relayer celle du LSD censé jadis modifier la perception et ouvrir ainsi sur de nouveaux possibles. Dans l'histoire des utopies posthumanistes, la personne de Timothy Leary, ce chantre tardif du posthumanisme et ce prophète du LSD, occupe une place singulière, qui fascine bon nombre de jeunes séduits par ces utopies.
Les psychostimulants sont à mon sens le symbole de la banalisation du cerveau, induite par l'accès supposé facile et immédiat à son fonctionnement, grâce à l'imagerie. En tant qu'organe à part entière, le cerveau est accessible aux manipulations.
Les techniques d'exploration et de visualisation du cerveau entretiennent ainsi dans le public des illusions dangereuses. L'idée qu'il suffirait de voir pour comprendre, de voir pour simuler, et de voir enfin pour reproduire ce que l'on cherche à comprendre est un préjugé scientiste vieux comme le monde. C'est un préjugé qui conduit aux ambitions de créer un cerveau artificiel, et c'est bien ainsi que Henry Markram a présenté la première fois au grand public son projet : la création d'un cerveau artificiel sur la base d'une modélisation des colonnes corticales. Un tel cerveau permettrait de comprendre les pathologies, mais aussi d'imaginer des dispositifs permettant de télécharger le contenu de la conscience sur des puces de silicium. Une telle idée est typiquement scientiste, et on peut être préoccupé de constater à quel point elle exerce un pouvoir de fantasmatisation et de quelle manière elle entraîne la croyance d'un certain nombre de naïfs.
Les fantasmes d'immortalité associés à cet up-loading du contenu du cerveau, sommairement apparenté à la conscience, reposent sur un préjugé non seulement scientiste, mais aussi très archaïque. Ils impliquent la supposition que le cerveau et la conscience soient une seule et même chose, et que sauvegarder premier donnerait les moyens d'immortaliser la seconde, en mettant complètement de côté la part de l'épigénétique, c'est-à-dire du contexte environnemental nécessaire au fonctionnement du cerveau. Les neurobiologistes le disent pourtant clairement : il n'y a pas de cerveau isolé. Or de tels fantasmes relèvent d'un schéma d'explication et d'une rhétorique qui supposent que le cerveau est isolable.
Ce qui rend possible ce genre d'illusions est la simplification de la représentation de l'humain, qui résulte de la fascination avec laquelle nous cédons aux technologies lorsqu'elles nous donnent à voir. Ces technologies ont un privilège sur les autres : elles facilitent cette simplification de l'humain, en l'exposant à être réduit à l'élémentaire d'un fonctionnement quasi mécanique. C'est bien là que les neurosciences menacent de rendre la psychiatrie superflue. Elles héritent d'une simplification de la psychologie au schéma béhavioriste, réduction qui s'est trouvée exploitée par la cybernétique et par le projet de réalisation d'un homme artificiel. Voir l'activité des neurones, pense-t-on, ce serait accéder à la psychologie des patients. C'est une illusion qui justifie le désintérêt croissant pour la relation de langage du soignant avec son patient.
Lors des tables rondes précédentes, nous n'avons pas eu besoin de parler du langage, parce que nous étions absorbés par l'exploration permise par l'imagerie cérébrale, une exploration qui fait naturellement l'impasse complète sur la dimension du langage, de l'intentionalité, de l'intériorité, sur tous ces fondements de la culture humaine. Le discours en première personne, qui intéresse la phénoménologie, laisse complètement place au discours en troisième personne, c'est-à-dire à l'observation neurobiologique. Tel est le problème que se posent les philosophes lorsqu'ils s'intéressent aux neurosciences : comment réarticuler le discours en première personne avec le discours en troisième personne ?
Le privilège actuel des neurosciences profite du discrédit du langage qui accompagne l'essor des technologies cognitives en général. La simplification de l'humain est une manière de lui couper la parole pour mieux le réifier ou l'instrumentaliser. Au fond, la vie psychique n'a plus d'autre sens que de se laisser visualiser et d'appeler l'éventuelle réparation des dysfonctionnements du cerveau. Le savoir des neurosciences, ajouté aux techniques d'exploration cérébrale, produit l'illusion que la réparation de l'humain peut servir à l'augmenter. L'être diminué, destinataire de la neuropharmacologie, devrait pouvoir servir la cause de l'être augmenté, figure de proue du post-humaniste. À mon sens, nous sommes face à une illusion dont le public ne prend pas encore la mesure, mais que les neurobiologistes les plus clairvoyants mettent en avant.
Je pense à toutes ces observations qui mettent en évidence que la Ritaline, le Modafinil, les amphétamines peuvent soulager, voire réparer le comportement désordonné des malades atteints de maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, mais aussi que ces médicaments n'augmentent chez les êtres sains que les comportements les moins humains, à savoir les automatismes, la puissance de calcul, la mémoire procédurale. Ces psychostimulants favorisent en définitive des activités qui n'ont pas besoin de la réflexion et du raisonnement. Compter sur eux pour augmenter les performances humaines, c'est entretenir un leurre ou suggérer le peu qu'on attend de l'humain
L'augmentation, si elle était confiée aux psychostilmulants, concernerait les facultés et les comportements les moins complexes chez les humains, et conforterait la machinisation et la simplification de l'humain, telles que les exigences socio-économiques peuvent les souhaiter, mais pas une vie orientée par des idéaux éthiques ou culturels.
J'ai formulé quelques objections contre la banalisation du cerveau qui contribue à minimiser la spécificité de l'humain, et contre les illusions qui conduisent à passer sans solution de continuité de l'approche réparatrice à l'ambition d'augmenter l'homme. J'en conclus qu'il faut peut-être poser aux acteurs de la technoscience quelques questions essentielles ; par acteurs, j'entends les médecins qui utilisent les technologies, mais aussi les ingénieurs qui les conçoivent. Sont-ils prêts à aider le public à se faire une idée moins hyperbolique de leurs instruments ? Sont-ils prêts à les aider à comprendre que l'imagerie cérébrale est une machine à construire des images, et pas à livrer immédiatement la réalité supposée derrière les images ? Expliquer le fonctionnement de l'IRM peut permettre de désabuser le public porté à croire ce qu'il voit plutôt qu'à faire preuve de réflexion. Un tel effort pédagogique contrarierait la rhétorique des effets d'annonce, si fréquente de nos jours.
Par ailleurs, les acteurs de la technoscience sont-ils prêts à affronter la question éthique posée par la maîtrise du vivant en général : comment faire en sorte que les innovations biotechnologiques ne s'accompagnent pas d'un appauvrissement, d'une simplification de l'image que l'humain aurait de lui-même s'il se pensait avant tout comme un être de culture destiné à incarner les idéaux humanistes représentés par les grandes questions relatives au bien, au beau, au vrai ou au juste ?
M. Jean-Sébastien Vialatte. Je vous remercie de cet éclairage, je me tourne vers le professeur Jean-Didier Vincent.
M. Jean-Didier Vincent, professeur à l'Université Paris-sud Orsay, directeur de l'Institut Alfred Fessard, membre de l'Académie des Sciences et de l'Académie nationale de Médecine. En écoutant Jean-Michel Besnier, j'ai le sentiment de me retrouver avec lui quelques années en arrière, lorsqu'on siégeait dans le même comité d'éthique, où l'on a découvert ensemble le transhumanisme. Cette découverte m'a incité à passer quelques temps dans la Silicon Valley , où j'ai rencontré les esprits les plus farfelus et les plus brillants sur un espace de 100 km de profondeur, à Stanford. J'ai été ébloui, étonné, tout en ayant le sentiment d'un grand vide. Confronté à la présence de René Girard, j'ai constaté un décalage étonnant entre nos conversations et le travail de ces universitaires. J'ai notamment rencontré un fabriquant d'algorithmes pour implémenter le cerveau, et d'autres, souvent des pratiquants, qui avaient le sentiment de venir aider Jehovah dans son oeuvre et pas de lui faire obstacle.
J'ai écrit récemment un livre sur le transhumanisme et je m'apprête à publier à la rentrée avec Pierre-Marie Lledo un ouvrage qui s'intitulera Un cerveau sur mesure . D'un côté j'y crois, et même beaucoup, de l'autre, je vieillis, et perçois le désordre de l'âge sur mes neurones, qui accentue constamment mes troubles cognitifs. Les désordres de l'âge rendent, de plus, métaphysique, on aspire à l'humain, on finit par prier. La métaphysique est donc encore de ce monde, et Dieu sait si nous sommes des bêtes transcendantales. Certains dansent, disaient Jacques Prévert, d'autres entrent en transe : cela s'appelle la transcendance.
Pour en venir aux frontières entre le cerveau réparé et le cerveau augmenté, celles-ci sont très fragiles, reposant l'une et l'autre sur les mêmes procédés d'intervention sur le cerveau, qui sont devenus considérables. On a dû déjà évoqué de la séparation entre la psychiatrie et la neurologie, qui reste peut-être encore un problème préalable embarrassant.
Sous la direction de Marie-Odile Krebs, j'ai effectué un séjour de cinq mois dans un service qui accueillait de vrais fous à Saint Anne, ceux qu'on n'a pas le droit de laisser sortir. Cette expérience m'a plongé dans des abîmes de réflexion sur la nature humaine, bien plus que ma fréquentation des transhumanistes. Autant reconnaître que nous ne sommes pas au bout de nos peines : lorsqu'on se trouve devant autant de souffrance dans un cerveau humain, on se dit qu'on a le droit de tout tenter pour le soulager, comme on commence à le faire avec des drogues ou de l'électricité. Quoi qu'il en soit, le problème body/mind ne se pose plus, le cerveau est malade, et on le sait bien, ce n'est ni l'esprit, ni l'ordinateur. Quand quelqu'un habite votre cerveau, ou que vous êtes un grand bipolaire, ou que vous ne pensez qu'à vous suicider, c'est que le cerveau va mal et qu'il faut si possible le réparer.
Ne fait-on pas cependant fausse route ? Ne se laisse-t-on pas déborder par cette peste qu'a été la cybernétique ? De fait, la plus grande concentration de savants qu'on ait vue au monde à ce jour fut sur le projet Manhattan qui s'est soldé par la réalisation de cette misère qu'est la bombe atomique. On y rencontre l'équipe de Norbert Wiener avec ses projets de machines intelligentes et le pauvre Alan Turing qui en est mort, lui qui a résolu le problème du décodage d' Enigma . Jamais il n'y eut autant d'intelligence à l'oeuvre qu'à cette époque. Tout cela pour la création d'une machine intelligente qui devait se substituer à l'homme.
Depuis, le projet n'a pas changé, il s'agit de travailler au service du complexe militaro-industriel, le plus fournisseur de crédits pour ces recherches dans les technologies convergentes.
Vous pouvez savoir ce qu'ils font, tant la transparence est absolue : l'expérimentation se passe in vivo , en Afghanistan ou ailleurs, où l'on utilise des cyber-soldats, d'une efficacité redoutable, puisqu'ils tuent ennemis et civils tout en étant pratiquement invincibles, grâce à la progression des avancées des technologies convergentes (nanotechnologies, technologies de l'information, biotechnologies et technologies du cerveau). Elles ont permis de totalement modifier la structure du soldat qui s'avance dans le désert, avec de petits nanorobots, fabriqués avec des nouveaux matériaux, capteurs de tous les organes des sens qui apportent toute une série d'informations géographiques et autres. Elles permettent au soldat, par une interconnexion entre son cerveau et les bras exécutifs, de déclencher automatiquement l'envol de petits avions qui ne manqueront pas leur cible et y compris quelques centaines de personnes autour.
Le nouvel humanisme me paraît toujours sortir de cette illusion qu'a été la grande synthèse cybernétique, objet des fameuses conférences de Macy pendant cinquante ans. Celles-ci ont totalement empoisonné le terrain. On n'a pas idée à quel point les technosciences et ce qu'on appelle les sciences cognitives - abus de langage épouvantable - ont envahi et pollué tout le champ disciplinaire, comme je le dénonce dans mon futur livre.
Ce sujet regarde l'État, notamment nos représentants pour distribuer des financements. Encore faut-il qu'ils sachent bien à qui ils les donnent. Inutile, à mon sens, de développer les centres de photographie d'intérieur, où l'on prétend photographier la pensée, avec des machines qui coûtent très cher et dont les résultats sont pour le moins décevants. Mon ami Antonio Damasio, qui a mis en bande dessinée le cerveau, en accord avec la théorie de Spinoza, a réalisé un raccourci d'une haute spiritualité et d'une intensité philosophique rarement atteinte dans les représentations et l'utilisation de l'imagerie. Cela lui donne un avantage considérable, car lorsqu'il vous explique quelque chose, il a une image à montrer. Or, comme l'a bien dit Jean-Michel Besnier, tant qu'on ne dispose pas d'images, on ne voit rien. Jalousie, diront certains. Les dessins de mes ouvrages sont dessinés à la plume, avec l'aide d'un artiste, toujours le même, Durkheim.
Cependant, les maladies du cerveau représentent 40 % des dépenses en santé publique en Europe, qui compte 6 millions de Parkinsoniens, 2 millions de victimes d'accidents vasculaires cérébraux et 2,5 millions d'épileptiques. En France, on compte environ 800 000 malades d'Alzheimer. Les maladies mentales, elles aussi, sont nombreuses, étant entendu qu'on continue à opposer les maladies mentales et les maladies du cerveau. Certains restent dans ce clivage dont ils n'arrivent pas à sortir ; étant moi-même neuropsychiatre, je sais que mes collègues psychiatres connaissent la neurologie ; de lui-même, le clivage se réduit. Quelques psychanalystes résistent, mais ils sont contents lorsqu'on a quelques neurones à leur fournir pour appuyer leur théorie des pulsions. Quand au complexe d'OEdipe, on s'en accommode très bien.
À l'avenir s'agissant des maladies mentales, un des grands problèmes de société sera la relation entre la justice et les malades mentaux. Voyez le cas d'Anders Brevik confronté aux Norvégiens qui « veulent sa peau », et qui est manifestement un grand schizophrène, un grand paranoïaque (le diagnostic peut être fait par téléphone). Il est difficile de résoudre ces problèmes, dans une société qui demande toujours plus de sécurité. Pour interner un malade arrêté sur la voie publique, l'intervention d'un juge est nécessaire. On fait de moins en moins confiance au psychiatre. Bref, le problème des relations entre la justice et la maladie mentale reste ouvert. Qu'il serve d'alibi pour une campagne présidentielle n'est rien, mais c'est la souffrance du malade qui est derrière.
De quoi dispose-t-on pour soigner les malades ? Quelles recherches développe-t-on ? La thérapie génique est une alternative récente pour guérir ou soulager les malades. Il existe plusieurs possibilités d'intervention : utiliser des vecteurs qui transporteront dans le cerveau le gène défaillant et le cibler, recourir aux nanotechnologies, piste extrêmement sûre pour l'avenir, qui remplacera le virus utilisé comme vecteur, l'utilisation d'un virus étant un frein.
Pour la maladie d'Alzheimer, dont, on commence à trouver quelques gènes, preuve que cette maladie est plus héréditaire qu'il n'y paraît, ces découvertes permettront de mettre au point des modèles qui donneront des pistes pour développer de nouveaux médicaments, mais ce n'est pas demain qu'on pourra s'attaquer efficacement à cette maladie. C'est sans doute au niveau de la neurobiologie proprement dite qu'on assistera aux progrès les plus considérables, grâce à l'utilisation d'une meilleure connaissance du cerveau dans ce qu'il a d'organique, dans les cartes qui le représentent, ses différentes facultés, ses différentes fonctions. Le cerveau est plastique et dynamique, évolue tout au long de la vie, y compris dans la vie foetale. Les cartes ne sont pas définitives ; la carte n'est pas le territoire, mais le territoire est capable d'agir sur ces cartes.
Il a sûrement déjà été question des modifications des cartes de représentation d'un membre, des représentations du nerf somesthésique, comment des sujets nés avec l'absence d'un hémisphère peuvent tout faire avec l'hémisphère restant. On connaît le cas d'un sujet qui avait une grosse lésion dans la pariétale droite, qui n'avait plus de sens de l'espace. On a pu le rééduquer et voir apparaître l'utilisation d'un autre centre sur le cortex gauche, qui ne lui a plus permis de calculer, le centre calculateur ayant servir de vicariance.
C'est dire à quel point le cerveau est malléable et peut être façonné. Angela Sirigu l'expliquera car elle a pu montrer à partir d'une main greffée qu'on pouvait récupérer ses nerfs de commande. Nombre d'améliorations se produiront avec les interfaces cerveau/machine passées du stade expérimental au stade efficace, pour la réhabilitation des membres fantômes ou la possibilité d'activer non une prothèse mais une prosthèse, un membre de remplacement à partir d'un ordre donné par le cerveau, sans qu'il y ait une liaison intrinsèque. En cas d'amputation, elles serviront à commander les muscles pectoraux, qui recevront le signal, pour commander une prothèse qui répondra au cerveau.
Ces expériences relèvent de la physique amusante, cela consiste par exemple à pouvoir dire « salut » avec sa pensée, parce qu'on a appris à reconnaître, par magnétoencéphalographie, les lettres « s », « a », « l » et ainsi de suite. Mais étant administrateur du Centre d'handicapés La Force , endroit où l'on trouve le plus d'handicapés mentaux, cérébraux, n'ayant jamais parlé de leur vie, je sais que cela peut aider à améliorer leur état. En effet, s'ils ont conservé une petite fonction motrice avec un muscle, on peut, grâce à un ordinateur, leur faire déclencher des lexigrammes, pour qu'ils puissent communiquer par une parole visuelle avec leur entourage, et dialoguer. Alors qu'on pensait qu'ils étaient des légumes et qu'ils étaient oubliés sur une chaise, ils ont pu grâce à ces techniques acquérir un statut social. Ces personnes ont une âme. La plasticité du cerveau, lorsqu'on joue dessus à l'aide d'ordinateurs, permettra de remédier à bien des troubles du fonctionnement du cerveau.
Au passage, je m'efforce de réhabiliter le concept d'âme, ce qui agace certains collègues qui préfèrent parler de psyché. Par âme, j'entends tout ce qui relie le cerveau au corps. Épicure l'a qualifié de cri de la chair : c'est le corps qui s'exprime dans le cerveau, et celui-ci à travers le corps avec le monde, et dans le monde, l'autre. C'est l'ensemble qui donne lieu à une activité psychique, à laquelle sont nécessaires toutes ces activités que les philosophes déplorent ne plus voir au premier rang, qui sont l'intentionnalité ou la conscience.
Dans ce domaine, on a réalisé bien des progrès, mais on a laissé un peu de côté l'affect, où se loge ce qui fait le propre de l'homme, la psyché, les sentiments, cette possibilité de parler et de dire à l'autre son amour ou sa haine, et de fonder une société qui repose essentiellement sur un échange subjectif. Ces subjectivités s'affrontent et se compensent pour obtenir une conscience de soi. Je n'aime pas le concept de conscience, pour moi, c'est une apparition : on est conscient que quand on est conscient ; cela n'existe que quand cela apparaît.
Des travaux très sérieux réalisés au Massachusetts Institute of Technology (MIT) montrent que lorsqu'on est conscient d'un choix qu'on vient de faire : prendre ce verre, aller à droite ou à gauche, le cerveau a déjà préparé les signaux plusieurs secondes avant. On se trouve loin des expériences de Libet, qui étaient très critiquables sur le plan méthodologique. La conscience n'est pas un artefact, mais une apparition, donc plutôt une illusion. Nous avons l'illusion d'être conscient, mais probablement 96 % de notre activité n'est pas consciente, je n'ai pas dit inconsciente.
Quant à l'esprit, il n'est pas là ; il y a l'âme, la psyché, la souffrance, la douleur, l'amour et la haine de l'autre, tous ces sentiments qui font que nous sommes des êtres humains, et que nous sommes les seuls animaux capables de le dire, le risque étant que l'homme cesse d'être un homme, pour devenir une machine à qui on apprendrait à tuer ou à jouir. Les transhumanistes pensent qu'on peut provoquer l'orgasme avec des puces bien placées, ou avec l'optogénétique : avec un simple flash lumineux dans des noyaux, l'orgasme se produirait quand on veut. Soyez solidaires et entraidez-vous : la paix sera assurée entre les hommes, et l'on se débrouillera comme on pourra avec ce qu'auront laissé les technosciences. C'est sur ce message anarchiste que je conclurai.
M. Alain Claeys. Je vous remercie de cet exposé informé et donne la parole au professeur François Berger.
M. François Berger, professeur de médecine, directeur général et exécutif de CLINATEC-CEA, Institut des neurosciences et CHU de Grenoble. Vous m'avez demandé de témoigner des recherches en cours à Grenoble, dans ce que Jean-Michel Besnier a nommé l'environnement technoscientifique, en particulier dans le domaine des développements de l'interface cerveau/machine.
Je suis en désaccord total avec lui sur un point, et je m'exprimerai en médecin. Le cerveau n'est nullement banalisé par les neurosciences et les approches technologiques développées pour le comprendre et le traiter. Il reste un territoire totalement inexploré, où notre opérabilité, malgré des concepts « charlatans », reste très insuffisante en regard des besoins des patients, si on compare les ruptures technologiques obtenues par exemple dans le domaine du cancer. Une des raisons est l'inaccessibilité du cerveau. Le cerveau, et c'est ce qui est fascinant dans les neurosciences, est donc tout sauf banal : il reste unique, personnel et d'une complexité encore largement incomprise. Du coup, aucun outil ne peut actuellement influer significativement sur la liberté d'un sujet, qu'il soit malade ou sain.
Le concept d'interface cerveau/machine est une réponse à cette inaccessibilité. À Grenoble, nous en avons une vision beaucoup plus large, ouverte par les travaux d'Alim-Louis Benabid sur la neurostimulation cérébrale. C'est un concept large d'interface entre le cerveau et la technologie, qui va du diagnostic à la thérapeutique. C'est un positionnement d'accessibilité au patient, invasif mais non lésionnel et qui reste parfaitement éthique. À mon sens, nous avons une obligation éthique d'accéder au cerveau qu'on ne comprend pas, sachant que les drogues peuvent aussi provoquer des effets secondaires redoutables avec parfois une efficacité très réduite.
Dans des conditions de risque/bénéfice bien mesuré, il faut accéder au cerveau pour mieux le comprendre et agir de façon thérapeutique. C'est tout le sens des recherches technologiques qu'on mène à Grenoble. Il s'agit d'une recherche technologique pour réaliser des développements dans le domaine des micros nanotechnologies, à l'interface avec le vivant au sens large. L'efficacité de la neurostimulation à haute fréquence développée par Alim-Louis Benabid est un très bon paradigme de ce positionnement thérapeutique, invasif mais non lésionnel : la neurostimulation à haute fréquence apporte une solution thérapeutique exceptionnelle pour des patients ayant un handicap majeur non résolu par les thérapeutiques classique.
Au sens strict, le Brain computer interface ou interface cerveau-machine ( BCI ou ICM) vise à répondre au handicap d'un patient tétraplégique, en captant son activité cérébrale volontaire, en la décryptant, et en l'utilisant pour commander un effecteur externe qui peut être une souris d'ordinateur, un fauteuil roulant, le choix grenoblois étant d'aller jusqu'à l'exosquelette. Quelles sont les réponses technologiques au plan international ? Ce sont d'abord des stratégies externes captant l'activité électrique cérébrale à la surface du crâne. Pour l'heure, elles relèvent plutôt du jeu vidéo et n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Ce sont ensuite des interfaces plus invasives corticales, à la surface du cerveau, et des interfaces implantées, qui pénètrent le cortex cérébral. On voit toute l'importance qu'auront les développements dans le domaine de la micro-nano-ingénierie, du fait de la miniaturisation, de la multifonctionnalité, qui assurera une intégration la plus symbiotique possible.
Les premières publications chez l'homme ont été réalisées par l'université de Duke, avec des implants situés au niveau du cortex. Elles font la démonstration qu'on peut disposer d'une commande volontaire d'outils extrêmement simples comme une souris d'ordinateur, preuve que le cerveau n'est pas banalisé. Au passage, de telles pratiques sont discutables, l'éthique de cette expérimentation pouvant être contestée du fait de la réaction cicatricielle du cerveau qui après plusieurs semaine rend souvent inefficace cette stratégie. Plus récemment, des travaux ont été réalisés chez l'homme, avec une approche moins invasive, sur un patient sur lequel on a implanté des électrodes à la surface du cortex. la stratégie est donc moins invasive et ces premiers essais ont démontré la validité de l'approche dite ecoG.
Le choix grenoblois, a été de décider que ces développements devaient se faire dans une synergie avec les technologues, MINATECH et le campus GIANT associant la micro-nano-électronique, des développements dans le domaine de l'énergie, de la physique, des grands instruments et de la biologie. Sous l'égide d'Alim-Louis Benabid et de Jean Therme, le projet a consisté à implanter un centre de recherche biomédicale sur le site du CEA.
Il s'agit d'accélérer les processus de validation clinique des dispositifs médicaux innovants, à l'interface avec la pathologie au sens large, en augmentant ensemble la vitesse de validation et la sécurité pour répondre aux besoins nouveaux, en particulier imposés par les nouvelles règles européennes, dans le domaine de la biocompatibilité, tout en ouvrant le centre aux académiques et aux industriels, dans le cadre d'un hôtel à projet. Le bâtiment de 6 000 m² sera livré courant décembre, comprend d'abord un secteur de packaging et d'intégration système, point très important. Il faut donc pouvoir créer des prototypes compatibles avec une utilisation chez l'homme.
L'expérimentation animale, en particulier sur les gros animaux et les primates, est indispensable avant qu'elle se fasse sur l'homme. C'est sur ce point que la diffusion des succès médicaux doit être contrôlée. Dans le domaine du glioblastome, je guéris dans mon laboratoire toutes mes souris. Cependant, malheureusement, je vois la plupart des patients mourir. Il est donc essentiel de pouvoir continuer à faire de l'expérimentation sur des primates en France. L'une des spécificités de CLINATECH, est son secteur pré clinique, avec une expérimentation sur les primates, de l'imagerie multimodale et moléculaire chez le primate, grâce à un bloc opératoire gros animal, assez similaire à celui qu'on pourra utiliser chez l'homme. En la matière, développer des modèles alternatifs pose une obligation éthique. Un premier modèle « tumeur cérébrale » chez le porc a ainsi été développé pour éviter d'en réaliser un chez le primate. La finalité est l'utilisation chez l'homme. Pour cela, il faut assurer la biocompatibilité, ce dont s'occupe un secteur d'histologie et de biologie moléculaire. Il s'agit de disposer de la meilleure biocompatibilité prédictive possible.
La logique ultime est l'application clinique, la particularité de CLINATECH étant de disposer d'un secteur médical, une unité médicale du CHU de Grenoble, sorte d'enclave sur le site du CEA, avec six lits, tous les outils pour disposer de multimodalité en imagerie, avec un bloc opératoire ouvert à toute innovation technologique multimodale nécessaire pour prouver les concepts technologiques, et l'innocuité des dispositifs testés pour la première fois chez l'homme.
Le projet BCI grenoblois a pris le parti pris de mettre un implant à la surface du cerveau, étant entendu que nous pensons qu'il n'est actuellement pas éthique de créer des implants corticaux. Il s'agit de mettre au point un implant non temporaire, un dispositif global bénéficiant du savoir faire électronique Grenoblois qui puisse rester implanté, ce qui nous différencie des autres équipes. Pour la validation de ce dispositif, un protocole clinique de repérage chez les patients a été initié. Le défi est celui de l'électronique, la biocompatibilité. Le verrou, qui est actuellement loin d'être levé, est de déterminer une signature qui permettra, à terme, de faire fonctionner un exosquelette. Actuellement, personne n'est capable de le faire fonctionner, et nous restons à 5 ou 6 degrés de liberté. Il faut donc être extrêmement modeste. Un BCI ferait-il marcher un individu ? Pour l'heure, aucune équipe internationale n'est capable d'atteindre cet objectif, sachant qu'une bonne interface cerveau machine associée à de prothèses robotiques performantes comme celle développée par le CEA LIST peut améliorer de façon significative le handicap d'un patient avec peu de degrés de liberté ; un essai clinique devrait commencer fin 2012.
Il faut souligner que l'on peut bénéficier du savoir-faire du CEA pour anticiper les technologies du futur. S'il ne paraît pas éthique d'utiliser des implants corticaux, c'est parce qu'ils provoquent une réaction cicatricielle inflammatoire considérable. Aussi, la plupart des implants réalisés à l'université de Duke ont-ils été retirés au bout de quelques mois. Si on met des nanostructures comme des nanotubes de carbone sur ces dispositifs implantés, et c'est un projet financé par l'ANR, on neutralise la réaction gliale, on améliore la détection électrophysiologique, et l'on parvient à disposer d'implants plus symbiotiques, qui persisteront à long terme. Un projet européen est en cours pour tester des alternatives aux nanotubes de carbone, du nano-diamants ou du graphène. Les mécanismes de ces nanostructures visent la neutralisation de la réaction gliale. Avec ces nanostructures, on peut avoir une interface régénérative, jouer sur les cellules souches et stimuler une régénération neuronale.
Ce concept d'interface doit nous permettre aussi de mieux comprendre les pathologies cérébrales. C'est un enjeu de premier plan, car s'il existe thérapies ciblées en cancérologie, il n'en existe pas ou peu dans les maladies neurodégénératives, parce qu'on ne connaît pas les cibles. On a ainsi pu montrer un concept d'interface cerveau/biomarqueur, fonctionnelle, compatible avec des études génomiques et protéomiques.
Une technologie a été développée ; elle utilise des micro-structurations sur du silicium, pour faire des empreintes moléculaires et évoluer vers des nano-structurations, voire des dispositifs injectés par la circulation, avec des éléments qui commencent à apparaître comme les électrodes solubles, qu'on pourrait adresser localement. Ce sera testé dans les tumeurs cérébrales, par l'hôpital Saint Anne, les CHU de Grenoble, d'Angers et Henri Mondor. L'enjeu est de disposer de cibles thérapeutiques nouvelles pour les pathologies neurodégénératives, nous permettant dans ces pathologies de bénéficier de la « révolution » des thérapies ciblées dont bénéficient actuellement les pathologies cancéreuses.
Comment doit-on réinventer la régulation des essais cliniques ? On réalise de nombreux d'essais de phase 3, avec des centaines de patients. Dans Nature Médecine , une publication a montré qu'il était possible de guérir les gliomes avec des toxines. Pour valider l'efficacité thérapeutique, on a réalisé un essai de phase 3. Dix ans après, on s'est aperçu que cela ne marchait pas : aucune augmentation de survie et des effets secondaires rarissimes. Aussi pousse-t-on, notamment la Food and Drug Admnistration (FDA) , à développer des stratégies alternatives d'essai clinique de preuve de concept, qui seront essentielles dans ces technologies implantées. L'imagerie multimodale et la biologie moléculaire doivent permettre de montrer que la technologie fonctionne, module les cibles, et qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Ce faisant, on disposera d'une bonne prédictivité sur les effets secondaires. C'est un point très important, qui commence à être accepté en France par les agences de régulation. Il nous faut aussi innover dans le domaine de la biocompatibilité. L'imagerie multimodale et moléculaire est un outil qu'on pourra utiliser. L'objectif est donc de développer plus vite et avec plus de sécurité, l'innovation technologique au service des patients.
Ces technologies innovantes mettent à disposition des outils prosthétiques de plus en plus symbiotiques. La convergence technologique multifonctionnelle met à disposition des dispositifs qui assureront le diagnostic, la thérapeutique et la surveillance de l'efficacité thérapeutique. Elle apporte une nouvelle dimension de l'action médicale dans le cerveau, qui renforce encore le rôle du médecin classique qui doit parler à son patient pour lui expliquer la technologie qu'on va implanter. Toutes les technologies qu'on développe actuellement à CLINATECH sont accompagnées d'une étude d'impact sociétale sur les patients, pour savoir comment les expliquer, et comment elles sont perçues. Nous participons à un projet Européen réfléchissant à l'éthique et l'impact sociétal des micro-nanotechnologies implantées dans le cerveau.
La frontière entre réparation et l'amélioration pourrait poser problème, mais actuellement, il faut reconnaître que la question ne se pose pas, compte tenu du manque d'efficacité de ces technologiques. Il faut prendre garde à l'éthique fantasmatique. Bien des éléments discutés ne sont pas entrés dans la réalité. Il est aussi important de discuter d'un point de vue éthique les petits riens qui vont au lit du malade. Nous avons une obligation de rigueur. Je comprends Jean-Michel Besnier, les scientifiques cèdent parfois à la médiatisation de miracles, ce qu'il faut à tout prix éviter. Pour l'heure, les essais BCI réalisés chez l'homme n'apporte presque rien au patient.
Cela dit, il faut financer les travaux et prendre garde aux réductions des supports économiques dans le domaine de la santé et de la recherche. On peut, et cela a bien été montré dans le domaine de la neurostimulation, financer des neurostimulateurs qui coûtent très cher, dans la mesure où ils réduisent le handicap et rapportent en termes d'économie de santé et de valeurs sociétales.
Quant aux enjeux éthiques, il nous faut affronter les critiques, parfois violentes à Grenoble, même si elles sont issues de groupes très minoritaires et non démocratiques. Dans notre domaine, on a pu déplorer des dérives majeures, comme la lobotomie, validée initialement pour des pathologies psychiatriques très rares, puis diffusée de façon incontrôlée. Les dérives cachent bien souvent le non contrôle de la technologie. Ne nous régulez donc pas trop ; les régulations actuelles ralentissent déjà beaucoup la mise en place des essais cliniques, mais surtout, surveillez-nous. Il est extrêmement important que, de façon très précoce, soient mis en oeuvre des mécanismes d'information pour informer la société, et aussi de surveillance pour savoir ce que deviennent ces technologies lorsqu'elles sont utilisées chez les premiers patients.
M. Jean-Sébastien Vialatte. Je vous remercie pour ces informations précises. Madame Angela Sirigu, vous avez la parole.
Mme Angela Sirigu, neuropsychologue, directrice de recherche, Institut des sciences cognitives de Lyon (CNRS/Lyon I). Je traiterai des interfaces qu'on utilise en neurosciences, bien plus simples que celles qui viennent d'être évoquées. Elles font appel à moins de technologies, mais fonctionnent très bien. D'après B. F. Skinner, l'un des principaux représentants du courant des behavioristes, on ne peut pas étudier l'activité mentale des sujets. Ce qu'on peut étudier et analyser est externe et visible. Aujourd'hui, on peut non seulement examiner l'activité interne des sujets, mais aussi la décoder ; c'est une grande avancée dans les neurosciences.
On distingue plusieurs types d'interfaces. Lorsqu'on plonge l'individu dans la réalité virtuelle et la simulation, le sujet porte un casque et se retrouve dans un environnement complexe. Même si cet environnement est irréel, cet environnement peut être réel pour le cerveau. D'autres interfaces sont plus complexes, comme les projets de décodage et de contrôle de la pensée réalisés par des laboratoires américains et qui viennent d'être évoqués par mes collègues.
Les interfaces de réalité virtuelle sont très utilisées en thérapie comportementale. Dans certains cas, elles sont très utiles, notamment pour les phobies. Pour une phobie comme la peur de l'avion, on parvient à des résultats très intéressants. Elle est aussi utilisée pour l'agoraphobie, les sujets qui ont des problèmes pour se déplacer dans des lieux très ouverts. La réalité virtuelle a été également utilisée en Suède dans les centres de grands brûlés, pour lesquels les changements de pansements sont très douloureux ; les plonger dans un environnement qui simule une réalité de froid peut rendre ces opérations supportables pour le patient et très faciles à faire pour le médecin. Ce type de technique, il faut le souligner, est plus efficace et mieux supporté que la morphine.
Dans mon laboratoire, nous avons étudié pendant longtemps des patients amputés qui ont des douleurs fantômes. Ce ne sont pas des douleurs périphériques, mais strictement centrales. Pour réduire ce type de douleurs très handicapantes, nous avons utilisé une interface très simple. Chez un patient amputé par exemple du coté gauche, nous avons enregistré les mouvements de la main droite et on les a projetés sur un écran d'ordinateur en les faisant apparaître du coté amputé ; le patient les visualise ainsi comme s'il s'agissait de sa main gauche qui bouge. Soumis à l'expérience, les patients ont l'impression d'une sensation de mouvement réel du coté amputé. Pour leur cerveau, le mouvement se déroule de manière bien réelle au point d'éprouver des sensations d'effort. Le patient peut être ainsi fatigué de faire des mouvements, alors qu'il ne fait rien. Plus intéressant, avec l'IRM, après un entraînement de huit semaines à cette illusion du mouvement, on constate que le cortex moteur, qui ne s'activait pas avant l'entraînement, s'active de façon très importante après. Qui plus est, l'activation du cortex moteur est bien corrélée avec l'abaissement de la douleur dans le membre (amputé) fantôme. Or ces patients ont une douleur résistante à la morphine. Par une simple illusion visuelle, une simple visualisation des mouvements qu'ils ne sont plus capables de faire, on les immerge dans des situations au cours desquelles leur cerveau pense que leur membre amputé bouge. Ce faisant, on restaure l'activité fonctionnelle du cortex moteur, région importante pour le mouvement, et on influence très fortement le ressenti de la douleur.
Comment une telle illusion se produit-elle ? Ces patients n'ont plus de jambes ou de bras, mais on peut, dans leur cerveau, plus particulièrement leur cortex moteur, induire des mouvements que le sujet effectuait avant sa paralysie.
Il existe donc des représentations du mouvement qui persistent dans le cerveau, en dépit du fait que l'organe pour effectuer le mouvement a disparu. Un bras bionique peut se servir de cette information, des représentations activées pouvant le piloter. Ces représentations envoient des commandes à des nerfs, au niveau du système périphérique. Les chirurgiens peuvent sectionner les muscles toujours présents, et modifier la trajectoire des nerfs qui contrôlaient les muscles de la main, et les greffer dans différentes parties des muscles pectoraux.
Lorsque le patient active dans le cortex moteur les représentations correspondant aux mouvements de la main, une commande est envoyée vers les muscles restants (par exemple les biceps ou les pectoraux) et ceux-ci à leur tour, activent le bras mécanique. Dans ce cas, le cerveau « croit » effectuer des mouvements de la main, même si en réalité les muscles correspondants ne sont pas ceux qui normalement bougent la main. Seuls deux patients ont participé à cette expérience, qui fait appel à un équipement extrêmement lourd.
Il faut noter que le degré de liberté de mouvement que cette prothèse peut exécuter est assez limité, puisqu'elle ne permet que d'ouvrir et fermer la main. D'où l'intérêt des greffes biologiques, réalisées récemment par le professeur Jean-Michel Dubernard. Les résultats sont beaucoup plus impressionnants que les neuroprothèses du projet de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) . Plusieurs patients ont désormais des greffes de mains. Il est important de retenir, d'un point de vue neuroscientifique, qu'on a pu montrer que les bras et les mains du donneur peuvent être bien réintégrés dans le cortex moteur de ces patients. Une intégration se réalise au niveau cérébral, et s'accompagne d'une qualité de vie assez impressionnante, avec des mouvements manuels, qu'on ne peut réaliser avec les neuroprothèses.
Les interfaces artificielles de bras robotiques mises au point par différents laboratoires américains n'ont pu se réaliser que grâce à une recherche préalable chez les primates. C'est de fait la source des connaissances qu'on applique ensuite aux malades. Ces prothèses permettent aux patients tétraplégiques, d'effectuer des mouvements extrêmement simples, pilotés par la région du cortex moteur. Lorsqu'on active cette région, on provoque des mouvements bien précis. À mon sens, on ne peut actuellement décoder que les mouvements des différentes parties du corps, et rien d'autre de plus complexe.
Piloter différents bras mécaniques est une chose, encore faut-il obtenir un retour sensoriel, pour obtenir la sensation d'avoir effectué le mouvement, preuve que le mouvement nous appartient. Un article paru dans Science il y a une semaine, a montré qu'on pouvait non seulement piloter des objets externes avec la pensée, mais aussi redonner les sensations des objets qu'on touche, simplement avec la pensée. Des expérimentations ont été réalisées sur le singe. Il s'agit là d'avancées majeures, car ces systèmes permettent le retour sensoriel.
Cette recherche pose-t-elle des problèmes éthiques ? Sommes-nous en train de décoder des pensées privées ? Ce qu'on peut décoder, ce sont des mouvements très simples, une activité du cortex moteur. Selon moi, on ne peut rien décoder d'autre que le mouvement que le sujet de l'expérimentation est en train d'effectuer. Quels sont les risques et les bénéfices ? Pour un patient tétraplégique, envoyer des méls, bouger un curseur, est déjà beaucoup, même si ces actions peuvent nous paraître très limitées.
Jean-Michel Besnier a évoqué les avancées des neurosciences, en estimant que les découvertes du fonctionnement cérébral pouvaient retirer quelque chose à la spécificité humaine. Pour ma part, je ne le crois pas, estimant très important qu'on puisse accroître nos connaissances en neurosciences, étant entendu qu'on est bien loin de comprendre comment fonctionne le cerveau. Il n'y a rien à cadrer, rien à limiter. S'il faut limiter ou encadrer, ce sont les personnes qui sont en dehors des neurosciences et qui se servent de leurs résultats à des fins qui ne sont pas scientifiques.
M. Alain Claeys. Je vous remercie, Madame de cet exposé argumenté. Suscite-t-il des réactions ?
DEBAT
M. Jean-Michel Besnier. Vous mettez le doigt là où ça fait mal. Lorsque vous présentez comme vous venez de le faire ces découvertes, le public ne manquera pas de conclure qu'elles sont très simples. Comment n'avait-on pas déjà pensé à dériver les nerfs du membre amputé vers le thorax pour produire l'image mentale ? Il s'agit d'un schéma extrêmement simple. L'idée que la pensée est toute puissante est l'idée maîtresse que le public retient. Du coup, vous apparaissez comme des simplificateurs de l'humain. Vous réduisez l'humain à quelque chose de l'ordre du mécanisme, car les difficultés que vous rencontrez sont complètement méconnues du public.
Mme Angela Sirigu. Nous avons en effet changé. Auparavant, on pensait qu'il n'y avait pas de plasticité dans le cerveau. Dès lors qu'on a reconnu qu'il était plastique, on s'est mis à étudier les changements. La différence de points de vue a donné une impulsion à des recherches qui ont étudié la plasticité.
M. Alain Claeys. Je vous remercie, Monsieur Le Coz vous avez la parole.
M. Pierre Le Coz, professeur de philosophie, faculté de médecine de Marseille, président du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vice-président du CCNE. Je vous remercie de me permettre de participer à ces débats, dont il est important qu'ils demeurent contradictoires, pour garder leur crédibilité. Augmenter notre connaissance du cerveau permet de réparer notre relation aux personnes atteintes qui souffrent de troubles neurologiques ou psychiatriques. En effet, il arrive trop souvent, hélas, que ces pathologies suscitent notre effroi. On le voit, par exemple, dans notre rapport à l'épileptique. La connaissance de l'ancrage neurologique de l'épilepsie a permis de réduire avantageusement l'éventail des fantasmagories populaires, les explications fantaisistes qui gravitaient autour de cette maladie. De fait, la personne épileptique a été perçue pendant longtemps comme porteur du Mal. Être épileptique, c'était être la proie d'un démon qui s'emparait du malade pour exhiber sa puissance envoûtante et maléfique.
Grâce à la recherche, nous progressons lentement mais sûrement vers une approche plus rationnelle de cette maladie ; il faut continuer sans relâche dans cette voie car les visions superstitieuses ont la vie dure. Pour l'anecdote, une association de solidarité envers les personnes atteintes d'épilepsie s'est ainsi tournée vers une célébrité qui a exigé 40 000 euros pour participer à une campagne de promotion en faveur de la solidarité auprès des personnes atteintes d'épilepsie. Le motif était qu'en compromettant son image en posant avec des personnes atteintes, elle subissait un préjudice qui dégradait sa représentation populaire. C'est dire que les malades n'ont pas seulement à souffrir de leurs maux organiques, somatiques ; ils souffrent également, et plus encore parfois, du regard collectif. C'est pourquoi, les patients ont raison d'attendre davantage de progrès des neurosciences que de progrès de la solidarité. Notre soutien à la recherche doit être inconditionnel.
La connaissance par les neurosciences est déjà curative en elle-même, dans la mesure où elle nous aide à disposer d'une vision plus rationnelle des maladies. Elle participe d'une cure de désintoxication idéologique. Ces connaissances achèvent de nous débarrasser des interprétations pseudo-psychanalytiques, dont nous ne soulignerons jamais assez à quel point elles ont pu être néfastes et malfaisantes. Les grilles de lecture psychanalytiques ont été cruelles, sadiques, par effet de culpabilisation. Nous devons garder en mémoire ces sinistres explications, jusqu'à Françoise Dolto qui a cautionné les explications de Bruno Bettelheim sur l'autisme.
J'évoque là une certaine tendance de la psychanalyse, une psychanalyse sauvage, sommaire et méchante. Je ne parle pas d'une psychanalyse empirique, critique et prudente, capable de se repositionner. On pourrait aller jusqu'à expliquer que les sciences du cerveau apportent à la psychanalyse l'opportunité de trouver un second souffle, la possibilité de retrouver ses marques dans le champ du soin psychique, après toutes ces décennies de dévoiement vis-à-vis desquelles les sciences du cerveau nous permettent de prendre de salutaires distances.
Les connaissances que nous dispense l'exploration du cerveau sont curatives en un autre sens. Elles contribuent à améliorer le rapport de l'entourage familial au malade. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple, le fait de montrer sur une image à des aidants ou des proches, une coupe longitudinale d'un cerveau atteint d'une maladie d'Alzheimer et de la comparer à celle d'un cerveau normal peut avoir des effets bienfaiteurs immédiats. Soudainement, les proches comprennent que leur interprétation du comportement de cette personne atteinte de la maladie d'Alzheimer était erronée. Ils pensaient qu'elle faisait « semblant » de ne pas comprendre ce qu'on lui disait, qu'elle y mettait de la « mauvaise volonté ».
Grâce aux savoirs des neurosciences et à l'usage de l'imagerie cérébrale, les interprétations fausses, purement subjectives, sont réduites à néant. Une prise de conscience s'opère soudainement. Ainsi, paradoxalement, la déshumanisation d'autrui peut humaniser notre relation avec lui. L'objectivation est au service de la restauration d'une intersubjectivité débarrassée de ses a priori erronés.
De même, lorsque l'accès de violence d'un homme s'éclaire à la lumière de sources de dysfonctionnement d'ordre cérébral, nous sommes émancipés de notre tentation de la vengeance. Nous cessons d'en faire le bouc-émissaire de notre propre agressivité. Nous savons dorénavant qu'il subit lui-même son état de violence. Nous renonçons à notre envie de lui jeter des pierres et de le torturer. Les neurosciences, avec le concours de l'imagerie cérébrale, peuvent nous expliquer ce qui s'est passé. Là encore, une meilleure connaissance est conforme au principe éthique de bienfaisance.
Pour les familles des victimes, l'idée qu'un violeur d'enfant a agi sous l'effet de déterminants d'ordre cérébral peut plus facilement apaiser des rancoeurs et des désirs de vengeance que si elles lui prêtent un libre arbitre. Les Stoïciens, notamment Marc Aurèle, considéraient que nous pouvions accéder à la sagesse plus facilement lorsque nous avions une vision déterministe de l'homme. Si nous nous représentons l'être humain comme un ensemble de particules matérielles, et non comme un être doté d'une âme et d'une intentionnalité, nous pouvons appréhender l'agressivité dont il fait preuve avec plus d'humanité et d'indulgence. Imaginez une personne qui vous agresse et vous donne un coup de pied dans un tibia : vous pourrez y faire aussi peu de cas que si vous vous étiez cogné contre une chaise, sachant que cet homme est déterminé par des facteurs multiples.
Avouons au passage que les neurobiologistes n'ont pas appris grand-chose aux philosophes sur ce point. Que le libre arbitre n'existe pas, en philosophie nous le savons depuis longtemps, depuis 2 600 ans ! Il suffit de réfléchir à la causalité pour se rendre compte que l'idée d'une cause qui ne soit pas l'effet d'une cause antérieure est dénuée de sens, impensable. Socrate disait déjà que « nul n'est méchant volontairement ». La méchanceté égoïste et même la cruauté qui consiste à trouver du plaisir à faire mal, ne s'expliquent absolument pas par un libre arbitre, une idée au demeurant inconnue des Grecs. Le libre-arbitre est une fiction idéologique inventée par la modernité individualiste. Les Grecs connaissent la nécessité ( Ananke ), à laquelle Zeus lui-même ne peut pas se dérober.
Dans la mesure où à leurs yeux les comportements pathologiques dérivent des passions, de l'ignorance, des troubles de l'esprit, des « passions de l'âme » (et nullement d'une intention méchante de produire du mal), les philosophes de l'Antiquité n'auraient sans doute pas été surpris par les progrès des neurosciences.
Quant aux les dérives possibles des progrès de l'exploration du cerveau, l'histoire des techniques montre qu'il n'existe pas de technologies qui n'aient été déviées de leur finalité originaire ; les finalités initiales ont toujours été captées à des fins autres. Qu'on le veuille ou non, les neurosciences seront détournées à des fins que nous ne connaissons pas encore.
Un motif de prudence dans l'usage de ces nouvelles techniques réside dans l'oubli du passé. On est fondé à craindre que la nouvelle génération des psychiatres n'aie pas la mémoire de la psychiatrie, qu'elle connaisse mal l'histoire de la psychiatrie, de la lobotomie, des électrochocs. Les psychiatres qui exercent ne connaissent pas « Vol au-dessus d'un nid de coucou » , un film emblématique qui date d'il y a bientôt 40 ans. C'est ainsi qu'à Marseille certains psychiatres (minoritaires) de la nouvelle génération, la génération « high-tech » de la « psychiatrie de pointe », vont dans des établissements scolaires faire de l'initiation à l'éducation sanitaire auprès des jeunes, en leur expliquant -et je n'invente rien- que les antidépresseurs ont fait leur temps, et qu'aujourd'hui la sismothérapie permet de guérir les grands dépressifs beaucoup mieux que ne font les antidépresseurs dont tout le monde s'accorde à reconnaître que les effets thérapeutiques ont été surestimés.
Il y a là un motif de méditation sur les risques à venir : les nouveaux psychiatres ne seront-ils pas tentés après le scandale du Médiator, de se représenter ces techniques d'intervention cérébrale non médicamenteuses, comme étant moins intrusives ? Un peu d'électricité dans le cerveau, finalement, ne serait-il pas moins insidieux que la contamination des circuits neuronaux par des substances médicamenteuses toxiques qui encrassent et grippent la tuyauterie synaptique ? Aujourd'hui les psychiatres sont généralement méfiants, mais comment les psychiatres de demain se représenteront-ils ces techniques ? Ne penseront-ils pas que les médicaments sont de l'ordre de la préhistoire de la psychiatrie ?
Enfin, une réflexion éthique anticipative serait également à conduire sur l'impact des techniques d'intrusion dans le cerveau sur les émotions. Certes , a priori, on cherche uniquement à réguler la vie émotionnelle quand elle est pathologique ; on veut seulement juguler les paroxysmes anxieux, amoindrir l'angoisse aigüe, laquelle, selon certains neurologues, pourrait accentuer la récurrence ou l'expression symptomatique d'une maladie neurologique. Par exemple, l'épileptique qui aurait des angoisses aiguës pourrait être plus exposé à des crises d'épilepsie. Cependant, comment faire la différence entre des émotions normales et des émotions pathologiques ?
Si, à mes yeux, l'action sur les émotions, même bien intentionnée est éminemment problématique, c'est parce que nous ne pouvons pas nous passer des émotions. Si nous n'avons pas peur, nous n'avons plus aucun moyen de repérer les dangers. La peur aiguise notre vigilance. De même, l'angoisse nous est nécessaire pour prendre conscience de nos conflits de valeurs. Si nous assistons aujourd'hui à cette réunion, c'est parce que nous sommes accessibles à des phénomènes d'angoisse sur l'avenir des neurosciences. Nous avons besoin de l'angoisse pour nous avertir que nous sommes en présence de problèmes ; les émotions sont des systèmes d'alarme qui nous avertissent que des valeurs sont en jeu. Sans les émotions, nous ne pouvons pas savoir quelles sont nos valeurs.
Un jeune épileptique, par exemple, éprouvera une angoisse parce qu'il ira s'amuser avec ses amis, se distraire en boîte de nuit et consommer de l'alcool, ce qui suppose qu'il ne prenne pas ses traitements. Ou alors s'il prend ses traitements, il se prive des plaisirs ludiques de la convivialité avec ses amis et il éprouvera une angoisse de passer à côté d'occasions de plaisir qui ne se reproduiront peut-être pas souvent dans sa vie. Est-ce une angoisse pathologique ? Non, car il est face à un véritable dilemme moral, tel que n'importe qui pourrait le vivre. De cette situation surgit un motif de questionnement éthique : en voulant réparer le cerveau, ne va-t-on pas en même temps produire des effets d'anesthésie émotionnelle qui feraient perdre conscience aux personnes « guéries » de la portée éthique de leurs émotions ? Prenons garde que sous l'effet de la banalisation de l'imagerie cérébrale, nous n'en venions pas à transformer nos émotions en choses affectives, en cibles. Les émotions qu'on montre sur des écrans n'ont aucun rapport avec ce que nous éprouvons, Henri Bergson a décrit cela à mon sens de manière définitive dans sa réflexion sur l'hétérogénéité de la durée et de l'espace.
Comment légiférer à propos des interventions sur le cerveau ? On pourrait envisager un cadre qui soit calqué sur celui du diagnostic prénatal, et réserver l'usage des nouvelles thérapeutiques aux affections neurologiques graves et incurables, de façon dérogatoire, et pour lesquelles il n'existe pas d'alternative thérapeutique en l'état actuel de nos connaissances. En ce qui concerne le diagnostic prénatal, il me semble que nous disposons de résultats concluants. Depuis la loi de 1994, la médecine prénatale a été très bien régulée, en évitant les listes de pathologies pour lesquelles on pourrait accepter un diagnostic préimplantatoire ou prénatal. Vingt ans après, on peut considérer que les médecins ont été protégés par la loi d'une demande débridée de la part de la société.
De la même façon, les neurochirurgiens, les neurobiologistes, les psychiatres qui seraient confrontés à une demande sociale croissante réclamant l'aide de ces thérapeutiques nouvelles -comme des demandes contre les addictions au tabac par exemple-, seraient protégés par une loi-cadre. On éviterait des effets insidieux. Par exemple, qu'en sera-t-il des campagnes de prévention contre le tabac le jour où l'on sait qu'une intervention neurochirurgicale permet de neutraliser le foyer de l'addiction ? N'en viendrions-nous pas à dédramatiser la consommation du tabac ? Ne va-t-on pas entrer dans des dérives ? J'appelle le législateur à encadrer ces pratiques en les réservant à des affections graves et incurables, pour lesquelles il n'existe pas de thérapeutiques préventives ou curatives.
M. Alain Claeys. Je vous remercie de votre intervention ; y a-t-il des questions ou des réactions ? J'ouvre le débat sur cette table ronde.
DEBAT
Mme Marie-Odile Krebs. La psychopharmacologie, reste un souci constant, y compris chez les jeunes psychiatres que nous formons dans nos hôpitaux. Nous organisons une formation sur cette matière, et refusons du monde tous les ans. Soyez donc rassurés. Si ces jeunes psychiatres n'ont pas vu Vol au-dessus d'un nid de coucou , les patients, et un certain nombre d'associations se chargent de leur rappeler cette vision et cette représentation des électrochocs. Cette technique est passée d'un stade assez primaire à celui d'un véritable outil thérapeutique qui, à défaut, laisserait sans traitement 30 % des patients présentant des pathologies psychiatriques graves ; il faut le rappeler.
Vous avez cité l'exemple de l'angoisse d'un patient qui pense qu'il ne doit pas prendre ses médicaments lorsqu'il consomme de l'alcool. Sur ce point, il y a dérive : un dilemme, une inquiétude, peuvent provoquer de l'anxiété. Cependant, on connaît bien la différence entre une émotion normale et une émotion pathologique qui débordera totalement quelqu'un et entraînera des gestes suicidaires, des scarifications, des réactions comportementales sans aucune commune mesure avec ce que vous décrivez. S'il y a partage de déterminisme, l'émotion pathologique présente des tableaux extrêmement différents de l'émotion normale.
Vous avez par ailleurs souligné qu'il fallait réserver certaines thérapeutiques, comme la stimulation profonde à des pathologies sévères, pour lesquelles il n'existe pas d'autres traitements. J'ose imaginer que vous n'incluez pas l'électro-convulsivothérapie, malheureusement insuffisamment prescrite actuellement, dans ces technologies. Vous avez oublié la psychiatrie, j'espère que c'est un oubli et que vous incluez naturellement les pathologies psychiatriques sévères, qui doivent pouvoir bénéficier des nouvelles technologies comme les affections neurologiques.
M. Pierre Le Coz. Oui bien sûr. Dans la loi sur le diagnostic prénatal que j'ai choisie pour modèle, il n'est pas fait mention des disciplines concernées (il peut être proposé par un médecin de la reproduction, un gynécologue obstétricien, un échographiste ou un généticien). Ici, de la même façon, c'est la gravité incurable qui compte et non pas la spécialité du praticien concerné.
M. Hervé Chneiweiss. On met le doigt sur le désenchantement du monde. Le corps en général et le cerveau en particulier comme une matière. Cela a-t-il commencé il y a 2 600 ans ? Lors de l'audition du mois de juin dernier, on l'avait situé plutôt autour de 300 ans av. JC. avec l'école d'Alexandrie, Straton, Hérophile, qui a commencé à décrire le système nerveux dans sa matérialité, en relation avec les philosophes grecs. En France, deux siècles seulement depuis l'époque de François Magendie jusqu'à aujourd'hui, ont fait du corps une matière, certes, mais vivante. On a commencé avec les sels minéraux, puis la chimie organique et les matières vivantes. S'il révèle l'organe cérébral, ce désenchantement est largement compensé par toutes les découvertes extraordinaires que sont le maintien de l'activité, la plasticité, la réorganisation, et l'extraordinaire complexité que représente le système nerveux, que l'expression pathologique soit psychiatrique ou neurologique. De fait, les neurosciences sont en train d'établir la grande réconciliation de cette coupure épistémologique.
L'épilepsie est au fond une maladie fonctionnelle autant que peut l'être la dépression. Dans certains cas, on trouve des lésions dans des épilepsies secondaires. Très souvent, on n'en trouve pas. La coupure faite par les pères fondateurs de la psychiatrie, les Cabanis, Pinel, et ceux de la neurologie, les Charcot et autres, est train de se réduire. Il ne faudrait pas rouvrir une guerre inutile.
Quant aux actions, point qui pourrait être promu dans le rapport, la France participe activement à une action internationale, la semaine du cerveau, la troisième semaine de mars. Non seulement, on peut l'utiliser pour décrire les merveilles de ce qu'est la découverte du cerveau, mais aussi pour réfléchir, comme nous le dit Hannah Arendt, à penser ce que nous faisons. Quelles que soient les révélations scientifiques, il faut penser cela dans un contexte humain.
M. Grégoire Malandain. Le sujet de la table ronde portait sur les interfaces entre le cerveau et l'ordinateur. Une partie des intervenants a centré son propos sur ce sujet, d'autres ont été plus généralistes. Vu de ma lorgnette, j'ai le sentiment qu'il reste un champ énorme à explorer dans ce domaine, avec des explications extraordinaires à venir. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'au tout début de ce qu'on peut réaliser avec ces interfaces. Pour l'aide aux personnes en situation de handicap, on a parlé de la chaise roulante, des exosquelettes, qui sont les premières applications évidentes et triviales pour le déplacement. D'autres applications ont été mises en avant, comme l'écriture de courriels ou la navigation sur Internet, lesquelles permettent aux personnes en situation de handicap d'avoir une vie sociale et d'interagir avec la société.
Jean-Michel Besnier a souligné un danger, un fantasme. Notre compréhension serait décuplée dès lors que l'on parvient à voir le cerveau, à enregistrer un signal. Or, lorsqu'on réalise des interfaces cerveau/ordinateur, on essaie de trouver un signal significatif qu'on est capable d'interpréter pour effectuer une commande. Ainsi on utilise l'activation des zones motrices, qu'on parvient bien à distinguer. Ce faisant, on peut faire bouger un curseur sur un ordinateur : écrire « salut ». On ne décrypte pas les lettres « s », « a », et les autres. C'est faire bouger le curseur sur l'ordinateur, en disant « je pense à bouger la jambe droite ou gauche ». Décrypter ce qu'on est en train de penser ? C'est un fantasme.
Par ailleurs, vous nous confiez la responsabilité de la communication vers le grand public. Or, nous ne sommes jamais en prise avec lui. Si on publie des articles de vulgarisation, le journaliste fait fi de toute la partie explicative pour ne conserver que la partie sensationnelle. C'est une vraie difficulté.
M. Alain Claeys. Il ne faut pas généraliser. De vrais efforts pédagogiques sont réalisés par la presse ou la radio.
M. Hervé Chneiweiss. Dans le domaine de la publication scientifique, les neurosciences sont l'un des domaines de l'édition scientifique dans lequel les contributions sont les plus nombreuses.
Par ailleurs, je modérerai un peu l'enthousiasme concernant toutes ces expériences qui ont pu être réalisées sur des librairies d'images de représentations, où l'on demande aux gens de penser à une pomme, une chaise ou une voiture et où après, avec d'autres séries d'images, on parvient à des pourcentages de l'ordre de 70 %, où l'on est capable de déterminer la catégorie d'objets auxquels ils sont en train de penser, en référence à la libraire constituée à l'origine.
M. Grégoire Malandain. Lionel Naccache l'a bien souligné. On est capable de distinguer par rapport à quelque chose de connu, mais on n'est pas capable d'inférer avec quelque chose d'inconnu.
QUELS IMPACTS SUR LA SOCIÉTÉ ?
M. Alain Claeys. Nous en arrivons à la dernière table ronde qui porte sur les impacts de ces technologies sur la société. Madame Catherine Vidal, dont les efforts pour rendre compte de ces questions dans les média sont à souligner, vous avez la parole.
Mme Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Je vous remercie. Nous allons aborder les questions de société. L'impact des neurosciences sur le grand public est une question qui me préoccupe tout particulièrement. En guise d'introduction, j'évoquerai le cas de ce patient, homme de 44 ans, marié, père de deux enfants, menant une vie professionnelle normale, qui se plaignait d'une légère faiblesse de la jambe gauche. Il est allé consulter à l'hôpital de la Timone, où il a subi plusieurs examens, entre autres une IRM 43 ( * ) .On s'est rendu compte que son crâne était rempli de liquide et que son cerveau était réduit à une mince couche collée sur les parois du crâne (voir figure jointe). Cette personne souffrait à la naissance d'hydrocéphalie. À l'époque, les médecins lui ont posé un drain à la base du cerveau, pour évacuer le liquide en excès. Le drain s'est bouché. Progressivement, la pression du liquide a fini par refouler le cerveau sur les parois du crâne, processus qui s'est effectué sans entraîner aucune gêne dans la vie de cette personne.
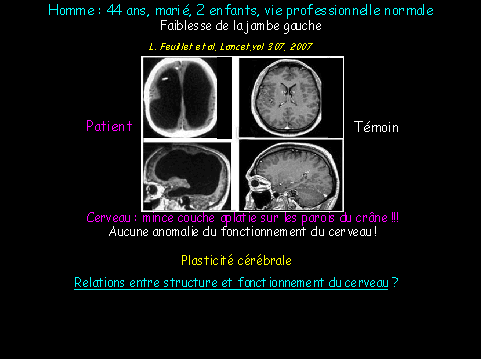
Ce cas est une illustration frappante des capacités de plasticité du cerveau. On peut d'ailleurs imaginer que si ces images avaient été connues du temps de l'enfance du patient, il aurait été étiqueté comme futur handicapé mental, avec les stigmatisations qu'on imagine pour son avenir. Ce cas met aussi le doigt sur une question qui, pour nous, neurobiologistes, reste très énigmatique, à savoir celle de la nature des relations entre la structure et le fonctionnement du cerveau. À l'heure actuelle, on est bien en peine de comprendre comment un cerveau, avec une forme aussi invraisemblable, est capable d'assurer les mêmes fonctions qu'un cerveau normal.
Avec ce patient hydrocéphale, on est bien loin de la vision classique des localisations cérébrales avec leurs différentes fonctions - vision, audition, touché, motricité et langage - qui seraient localisées dans des zones spécifiques du cerveau. Cette vision localisationiste nous vient de loin, du XIX ème siècle, avec la phrénologie de Frantz Joseph Gall, pour qui les bosses du crâne reflétaient les facultés mentales sous-jacentes. Gall a ainsi défini vingt-sept facultés innées ou forces fondamentales, localisées dans le cerveau, dont l'amour de la progéniture, le talent poétique, mais aussi le penchant au meurtre, au vol, la compassion et le sens moral.
Où en sommes-nous au XXI ème siècle ? Peut-être pas si loin, si l'on en croit les travaux d'imagerie cérébrale par résonnance magnétique (IRM consacrés à l'étude des valeurs morales et sociales. Si on consulte les bases de données des publications scientifiques, et qu'on tape les mots clés « morale et IRM », on s'aperçoit qu'entre 1990 et 2000, on comptait 5 publications, contre 110 entre 2000 et 2010. Quant aux mots clés « comportements antisocial, violence et IRM », on passe de 7 à 250 publications dans le même temps.
Jorge Moll 44 ( * ) , un des grands spécialistes de la morale en IRM, s'est intéressé aux réactions du cerveau face à la présentation de photos illustrant des scènes à contenu social, comme des enfants errant dans les rues, où des scènes à contenu moral, comme une scène de crime. À la vision de ces différentes images, l'examen IRM montre que les scènes morales et sociales activent des régions différentes du cortex cérébral. Jorge Moll s'intéresse en particulier à ce qui se passe dans le cerveau de personnes qui souffrent de psychopathologies antisociales, pour lesquelles il observe une réduction de l'épaisseur du cortex cérébral dans les régions activées par les scènes morales. Jorge Moll déclare que « le comportement antisocial, l'insanité morale, la violation de l'ordre moral et la pédophilie ne peuvent être réduits à des influences culturelles, car ces comportements se sont toujours manifestés dans l'histoire, et quelles que soient les cultures. Les bases neurobiologiques du comportement antisocial sont attestées par les études d'imagerie montrant une réduction de la matière grise dans le cortex cérébral. »
Il s'agit là d'une conclusion hâtive sur la signification des variations de l'épaisseur du cortex, compte tenu de nos interrogations sur les relations entre la structure et le fonctionnement du cerveau, et sur les difficultés d'établir un lien de causalité avec les troubles du comportement.
Notre cerveau, je le rappelle, est constitué de 100 milliards de neurones, connectés entre eux par un million de milliards de synapses. Or 90 % de ces milliards de synapses se fabriquent après la naissance. C'est précisément sur la formation de ces circuits de neurones que l'environnement et l'apprentissage joueront un rôle très important. On utilise le terme de plasticité cérébrale pour qualifier cette capacité du cerveau à se modeler et à se façonner en fonction de l'expérience vécue 45 ( * ) .
On a étudié le cerveau des pianistes par imagerie cérébrale 46 ( * ) . Les musiciens professionnels sont très prisés par les spécialistes de la plasticité cérébrale ; ils ont en effet commencé très tôt l'apprentissage d'un instrument et continuent à l'âge adulte. Cet apprentissage laisse des traces dans le cerveau ; chez les pianistes, on observe ainsi un épaississement du cortex dans les régions qui contrôlent la coordination des doigts et l'audition. On pense que ce phénomène d'épaississement est dû à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Cet épaississement est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance.
Autre expérience intéressante illustrant la plasticité cérébrale à l'âge adulte 47 ( * ) : on a demandé à des étudiants d'apprendre à jongler avec trois balles. L'exercice étant difficile, ils y parviennent au bout de trois mois. On observe alors un épaississement des régions cérébrales qui contrôlent la coordination motrice et la vision. Et quand les étudiants cessent de s'entraîner et qu'ils perdent leur habileté à jongler, on constate que les régions du cortex précédemment épaissies rétrécissent. Cette observation intéressante montre que, dans certains cas, les changements d'épaisseur du cortex peuvent être réversibles quand la fonction n'est plus sollicitée.
Un des apports majeurs de l'imagerie cérébrale en IRM est d'avoir démontré ces capacités de plasticité cérébrale. Elle met en évidence que le cerveau se remanie en fonction de l'expérience vécue, et ce, à tous les âges de la vie. C'est un point très important dans l'interprétation des images en IRM. Cela signifie que la présence de différences cérébrales entre individus n'implique pas que ces différences soient inscrites dans le cerveau depuis la naissance, ni même qu'elles y resteront gravées. L'IRM nous apporte un cliché instantané de l'état du cerveau. En d'autres termes, détecter des variations d'épaisseur du cortex ne permet pas d'expliquer le passé, ni de prédire le devenir d'une personne. Ce point est fondamental dans les débats actuels sur la délinquance, à l'heure où certains voudraient utiliser l'IRM dans les cours de justice, d'autres pour le dépistage des enfants turbulents à l'âge de trois ans, sous prétexte qu'ils pourraient être des délinquants plus tard 48 ( * ) .
Une expérience a été réalisée aux États-Unis sur soixante enfants d'âge moyen de onze ans, qui étaient désobéissants, provocateurs, irritables et irrévérencieux (7). 49 ( * ) L'IRM a montré dans le cerveau de ces enfants une réduction de l'épaisseur du cortex dans la région cingulaire antérieure. Les auteurs n'ont pas hésité à en conclure qu'il s'agissait d'un signe précoce d'un futur comportement antisocial et délinquant. On se trouve manifestement dans un cas une interprétation abusive des images en IRM par rapport à nos connaissances sur la plasticité cérébrale, d'autant plus que le cerveau des enfants est en cours de maturation et qu'on n'est pas capable d'établir de lien de causalité avec le comportement.
Un autre sujet de préoccupation concerne l'imagerie cérébrale et les stéréotypes sexistes dans les publications scientifiques 50 ( * ) . On entend ainsi dire que « les différences de matière grise et blanche du cortex peuvent expliquer les moindres performances des femmes dans l'orientation spatiale. » « L'IRM fonctionnelle confirme que les hommes ont un jugement moral basé sur le raisonnement et la justice, tandis que les valeurs morales des femmes reposent sur les émotions. ». On peut citer aussi le président de l'université de Harvard, Larry Summers, qui a déclaré que « la faible représentation des femmes dans les matières scientifiques s'explique par leur incapacité innée dans ces domaines . »
C'est face à cette menace de dérives sexistes que s'est constitué en 2010 un réseau international, dénommé Neuro-Gendering 51 ( * ) , dont les travaux seront publiés en 2012, dans un numéro spécial de la revue américaine Neuroethics. Son objectif est, d'une part, de défendre une éthique dans la production des savoirs et d'éveiller la responsabilité des chercheurs sur l'impact de leurs travaux dans un contexte social et anthropologique; et d'autre part, de concourir à diffuser des informations de qualité vers le grand public, pour promouvoir une image positive de la recherche scientifique, en particulier à la lumière des connaissances sur la plasticité cérébrale.
C'est cette même intention qui anime des chercheurs, comme Judy Illes à Stanford ou Eric Racine à Montréal, qui s'intéressent aux implications éthiques et sociales des neurosciences contemporaines. Ils ont publié en 2010 une revue très intéressante sur la couverture médiatique dans la presse écrite de 1 256 articles scientifiques publiés entre 1995 et 2004 dans des revues anglo-saxonnes de haut niveau 52 ( * ) . Ils ont évalué en particulier la part des explications techniques dans la description des travaux de recherche sur le cerveau avec les différentes technologies existantes. On constate que l'absence d'explication technique est largement majoritaire. En ce qui concerne le ton de la narration dans la description des expériences, l'optimisme l'emporte sur la vision critique.
Une expérience très pertinente intitulée « Seeing is believing » , « Voir c'est croire » a été publiée en 2008 53 ( * ) . On a demandé à des étudiants en thèse dans un laboratoire de neuroscience, d'évaluer un faux article scientifique fabriqué de toutes pièces pour l'expérience. Cet article prétendait que regarder la télévision améliore les performances en arithmétique, au motif que les mêmes zones du cerveau sont activées quand on fait un calcul mental et quand on regarde la télévision. Une partie des étudiants a reçu l'article en question, avec comme illustration des histogrammes pour quantifier les activations du cerveau. L'autre groupe d'étudiants recevait le même article, avec des images IRM du cerveau. Les résultats ont montré que le contenu scientifique de l'article était jugé plus crédible par les étudiants lorsque les résultats étaient présentés sous forme d'images du cerveau.
Pour conclure, je citerai les propos d'Edouard Zarifan 54 ( * ) , déclarant que « la recherche en neuroimagerie est scientifique, mais ses interprétations sont scientistes. Voir le cerveau penser est une métaphore poétique. On ne voit d'ailleurs que des listes de chiffres qui sortent des machines et que l'on transpose avec des codes de couleur pour représenter la silhouette d'un cerveau. Seule la parole du sujet qui s'exprime permet d'avoir accès au contenu de sa pensée ».
M. Alain Claeys. Je vous remercie pour cet exposé et donne la parole au professeur Olivier Oullier.
M. Olivier Oullier, professeur de psychologie à Aix-Marseille Université, conseiller scientifique au Centre d'analyse stratégique.
Mesdames et messieurs, permettez-moi tout au long de cet exposé d'être un « humain augmenté », grâce à cet instrument que beaucoup d'entre nous utilisons pour améliorer nos performances : des lunettes. Messieurs les Députés, vous m'aviez invité il y a plus de trois ans 55 ( * ) à m'exprimer pour la première fois en ce lieu sur les problématiques liées à l'utilisation des neurosciences au quotidien, non seulement dans les pratiques scientifiques et médicales mais aussi hors des laboratoires de recherche au sein desquels elles sont historiquement pratiquées.
J'ai depuis eu l'opportunité d'être invité à plusieurs reprises à échanger avec l'OPECST notamment dans ses auditions parlementaires et ainsi de participer au processus de révision de la loi de bioéthique promulguée le 7 juillet 2011. À titre personnel, ainsi qu'au titre du programme « Neurosciences et politiques publiques » dont nous avons la responsabilité avec Sarah Sauneron au sein du Département Questions sociales du Centre d'analyse stratégique 56 ( * ) , recevez nos remerciements pour nous avoir consultés mais aussi pour avoir fait de nous des acteurs de cette première : l'inclusion d'une section sur les neurosciences et l'imagerie cérébrale dans une loi de bioéthique. La loi française est pionnière en ce domaine, ce qui n'est pas sans susciter discussions et débats. Mon propos portera de fait sur l'impact des neurosciences sur la société, mais aussi de la société sur les neurosciences.
Il y a vingt ans, le magazine Science publiait l'un des premiers articles scientifiques présentant des résultats d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle 57 ( * ) (IRMf). Cette étude portant sur le cortex visuel, allait initier un corpus pléthorique de travaux publiés dans la littérature scientifique, neuroscientifique et dans les médias, contenant ces belles images de cerveaux en trois dimensions qui nous fascinent. Aujourd'hui, la base de données PubMed 58 ( * ) propose près de 300 000 réponses pour la seule entrée « fMRI » 59 ( * )
L'IRMf nous a permis de constater, si besoin était, que le cerveau, les neurosciences et les disciplines associées n'échappent pas au pouvoir des images. Ces images du cerveau procurent, au spécialiste comme au néophyte, l'illusion de la compréhension de notre système le plus complexe 60 ( * ) . De fait, l'intérêt pour les neurosciences, hors des laboratoires de recherche scientifique et médicale qui en découlent, ne cesse donc de croître.
Une chose n'a toutefois pas changé depuis la première audition parlementaire que vous avez menée : la politique de l'autruche pratiquée par une partie des acteurs académiques des neurosciences, en France comme à l'étranger, par rapport à l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Permettez-moi d'étayer rapidement cette assertion.
Tant que les finalités des travaux sont valorisées d'un point de vue sociétal, comme pour mieux comprendre la schizophrénie, la dyslexie, les addictions ou chercher à analyser les processus d'apprentissage des enfants pour élaborer des programmes scolaires plus adaptés, cette méthodologie est considérée comme valide. Mais dès lors que les applications envisagées sont d'ordre plus mercantile, tout d'un coup cela n'apporterait plus rien et ne serait que pseudo-science. L'acceptabilité sociale du but de l'utilisation de l'imagerie cérébrale fonctionnelle semblerait donc être un modulateur de la validité scientifique de cet outil. Ceci, d'un point de vue scientifique stricto sensu , n'est pas acceptable. Bien évidemment, d'un point de vue éthique, le questionnement est légitime. Mais il convient, a minima , de reconnaître que si la neuroimagerie permet d'apporter certains éléments de compréhension du comportement humain, de tels apports existent indépendamment du caractère public ou privé des applications qui en sont faites.
De plus, comme je l'ai déjà évoqué lors de précédentes auditions, il convient de bien différencier l'état de l'art dans une discipline scientifique et les pratiques commerciales qui en sont faites. Dans certains cas, la question du bon fonctionnement et de la validité scientifique d'une méthode devient malheureusement secondaire. L'histoire regorge d'exemples d'applications de découvertes scientifiques qui, bien que non validées par ceux qui en sont les instigateurs et les acteurs, ont été commercialisées et ont donné lieu à de fructueuses entreprises commerciales. En d'autres termes, si le produit est attractif, il y aura toujours des individus pour le vendre et d'autres pour l'acheter, quelle que soit sa qualité.
Les neurosciences ne font pas exception à la règle comme en témoigne le nombre sans cesse croissant d'individus s'auto-proclamant spécialistes du neuromarketing, dans le secteur privé qui compte désormais plus de 120 sociétés proposant de tels services, mais nous le savions déjà. Un phénomène plus récent est l'apparition d'universitaires qui, alors qu'ils n'ont jamais véritablement pratiqué les neurosciences au niveau expérimental, ni publié dans des revues neuroscientifiques réputées, indexées, internationales et à comité de lecture se réclament aussi du neuromarketing. Au mieux ont-ils lu une certaine littérature qui traite des sciences du cerveau. Mais lire un ouvrage sur l'armée de l'air n'a jamais transformé le lecteur en pilote de chasse.
Un exemple récent, aussi risible que dangereux, si l'opinion publique vient à assimiler imagerie cérébrale et approximations (pour ne pas dire plus) du neuromarketing- est illustré dans une tribune publiée le 30 septembre dernier par le New York Times 61 ( * ) . Un gourou du marketing, auteur de cette tribune, nous explique le rapport spécial que nous aurions avec nos iPhones. Il dit avoir réalisé une expérience qui montrerait une activation de l'insula corrélée à un sentiment positif envers ce populaire téléphone mobile. Il en conclut sans ménagement que sommes « amoureux » de nos iPhones. Cet exemple de corrélation inverse révèle les dangers, d'une recherche qui n'a ni été validée, ni expertisée, ni critiquée par les pairs, surtout lorsqu'elle est publiée dans un média généraliste leader au plan mondial.
Une chose n'a donc pas changé : l'attrait des médias pour les explications neuroscientifiques de nos comportements. Mais nous avons aujourd'hui plus de matière pour contrer de tels détournements des sciences du cerveau. Le corpus scientifique et les outils de meta-analyse toujours plus efficaces, nous permettent d'avoir des données sur de grands nombres d'études. Ainsi, l'une de ces méta-analyses montre que l'insula est active dans plus de 30 % des publications utilisant l'IRMf. Les interprétations associées à son implication dans un processus cognitif sont extrêmement variées, allant d'émotions négatives (dégoût) au codage d'informations viscérales. Il est de fait impossible de faire une corrélation simple et catégorique entre l'activité de cette partie étendue du cerveau et une émotion positive. Quant à faire rentrer l'amour (qui plus est pour un appareil électronique) dans l'équation, inutile de plus en dire.
Ce qui est malheureux dans l'exemple que je viens d'évoquer est qu'un quotidien parmi les plus respectés au monde, publie des résultats et des interprétations qui n'ont pas été soumis à l'expertise de la communauté scientifique internationale. Or, moi qui ne suis pas spécialiste de physique nucléaire, quand je lis un article dans la presse réputée, j'ai une tendance naturelle, comme beaucoup, à croire les sources. Nombreux sont ceux qui ont dû avoir une telle attitude envers les neurosciences suite à cette tribune et prendre son contenu pour argent comptant.
Heureusement, une contre-offensive a rapidement été menée par Russ Poldrack, l'un des meilleurs spécialistes au monde des questions d'imagerie cérébrale. Avec de nombreux spécialistes de neurosciences, nous avons co-signé un droit de réponse 62 ( * ) , pour réfuter les affirmations farfelues en rappelant que ce quotidien n'en était pas à son coup d'essai en ce qui concerne la publication de résultats d'imagerie cérébrale non validés et sur-interprétés. Un épisode encore plus problématique encore avait en effet eu lieu en 2007, lors des primaires pour les élections présidentielles américaines 63 ( * ) .
Ce genre de publications pose un problème relatif à la perception des neurosciences par le grand public, les élus et toutes les personnes qui ont à décider des politiques scientifiques. Si le grand public associe trop fréquemment l'imagerie cérébrale et les images du cerveau avec le marketing, il se demandera - et on l'a déjà fait - pourquoi continuer à financer des études et des scanners IRMf si tous pensent qu'elles ne servent qu'à vendre des produits. Or, ce n'est pas le cas. Cependant, quand bien même, existe-t-il un corpus scientifique qui met en évidence les limites de l'extrapolation à partir de l'imagerie cérébrale de comportements d'achat, cette connaissance ne suffit pas. Il faut que nous réfléchissions à une façon de communiquer sur les bonnes pratiques scientifiques, mais aussi sur les résultats qui peuvent être exploitables et transférables hors des laboratoires.
Pour en revenir à cette politique de l'autruche, il est également intéressant de constater que les consommateurs qui sont la cible des sociétés de marketing, sont les mêmes qui intéressent la prévention en santé publique. La France a eu une approche pionnière au cours des deux dernières années, avec la publication par le Centre d'analyse stratégique d'un rapport sur les nouvelles approches de la prévention en santé publique qui propose d'affiner les campagnes de prévention en santé publique, sur la base d'informations des sciences comportementales et du cerveau 64 ( * ) . Citons aussi le plan présidentiel sur l'obésité 65 ( * ) et son séminaire inaugural de recherche qui ont promu cette approche. Au-delà de la dimension liée à l'endocrinologie qui prédomine souvent dans les questions d'obésité, l'aspect hédonique et les informations qui émanent des neurosciences cognitives et de la neuroimagerie, ont été mis en avant.
Il y a un apport de nouvelles connaissances qui est manifeste en matière de prévention. Cependant, il ne s'agit pas d'une révolution ou de remplacer ce qui est utilisé, mais de le compléter, de l'affiner, à l'aune de résultats inédits issus des sciences comportementales au sens large. Psychologie, économie comporte-mentale, sciences cognitives et du cerveau sont encore trop souvent laissées de côté par la prévention en santé publique, alors que les apports de ces disciplines seraient bien utiles pour gagner en efficacité.
Quelles sont les bonnes pratiques ? Que doit-on faire ?
Envisager les résultats d'analyse du fonctionnement du cerveau de manière isolée, je l'ai déjà dit et redit, ne sert pas à grand-chose. Encore faut-il les replacer dans un contexte. Or il est très difficile d'avoir une expérience écologique sur un comportement de consommateur lorsque l'on est à l'intérieur d'un scanner IRMf. J'ai été membre du jury et directeur d'une thèse soutenue hier 66 ( * ) où l'imagerie cérébrale a été utilisée pour cerner les ressorts de certaines intoxications domestiques. L'utilisation de l'imagerie cérébrale n'est venue qu'en « bout de course », c'est-à-dire au terme d'un travail de quatre ans qui a débuté par le tri de près de 40 000 dossiers médicaux dans un Centre antipoison, et qui s'est poursuivi par l'analyse de 500 entretiens médicaux entre consommateurs et toxicologues, dont une quarantaine ont été retranscrits, et de 3 expériences comportementales. Une fois ces données analysées, certaines questions élucidées, il s'est avéré que l'utilisation de l'IRMf pouvait être pertinente afin de savoir si les food imitating products (e.g., un gel douche présenté sous les traits d'un jus de fruits) provoquent chez le consommateur des réponses au niveau du système gustatif qui sont similaires à celles d'un jus de fruit par exemple. Une grande partie de l'analyse et de l'apport pour la prévention en santé publique de ces travaux, qui a attiré l'attention de la Direction générale de la santé et des consommateurs (DG-SANCO) de la Commission européenne 67 ( * ) , vient des liens entre observations de terrain et données comportementales qui sont exploitées.
L'apport de l'imagerie cérébrale ne se fait qu'après avoir analysé les facteurs comportementaux et identifié une question à laquelle la neuroimagerie peut apporter des éléments de réponse que les autres niveaux d'analyse ne parviennent pas à élucider. Ce que je souhaite que l'on retienne ici, est que notre démarche première n'a pas été de mettre des sujets dans un scanner et ensuite de voir quelles activations cérébrales étaient trouvées, mais d'utiliser l'IRMf en complément d'une analyse de terrain pour répondre à une question de santé publique autour de certaines pratiques commerciales.
La révision de la loi de bioéthique nous interpelle sur une autre utilisation des neurosciences au sein des politiques publiques avec un droit d'exception pour les procédures judiciaires : « Art. 16-14. - Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d'expertises judiciaires » 68 ( * ) .
L'utilisation des sciences du cerveau et de la neuroimagerie dans les tribunaux 69 ( * ) , que l'on désigne aujourd'hui sous le néologisme de « neurodroit » est un autre point sur lequel nous travaillons au Centre d'analyse stratégique. Nombre des intervenants de l'audition qui nous réunit aujourd'hui sont à ce sujet intervenus au cours du premier séminaire sur l'utilisation des neurosciences dans les procédures de justice que nous avons organisé en 2009 70 ( * ) . Nous publierons au premier trimestre 2012 un rapport à ce sujet, fruit de plus d'un an de travail avec des experts français et internationaux issus des neurosciences, de la psychiatrie, de la psychologie, du droit, des politiques publiques, de philosophie et de psychiatrie.
Parmi toutes les questions soulevées par ce thème de travail, permettez-moi de revenir sur la force des explications neuroscientifiques. Des expériences de psychologie expérimentale ont en effet montré la force de persuasion du recours à des images ou à du vocabulaire issus des neurosciences 71 ( * ) . Une expérience, plus récente, a été réalisée sur 300 jurés, qui devaient statuer sur la culpabilité d'une personne dont on leur disait qu'elle mentait 72 ( * ) . Les jurés étaient divisés en quatre groupes. Un groupe possédait une information qui provenait du détecteur de mensonge « classique », celui qui mesure la réponse électrodermale, électro-physiologique, un autre groupe recevait les données d'analyse faciale thermique et un troisième les données obtenues grâce à l'IRMf. Un quatrième groupe contrôle ne disposait d'aucune information sur une quelconque méthode d'aide à la détection de mensonge.
Sans surprise, c'est le groupe qui possédait les images obtenues par IRMf qui a prononcé le plus de verdicts de culpabilité. Cependant, la suite de cette expérience est très intéressante, elle est encourageante et donne un certain espoir. À partir du moment où ces jurés ont reçu l'information pertinente sur les limites des scanners IRM et de leur utilisation dans les tribunaux, la proportion de jurés ayant déclaré l'accusé coupable est revenue au niveau du groupe contrôle. Autrement dit, une information délivrée de manière efficace par des personnes compétentes peut arriver à changer la perception, donc contrer certains biais de cette attraction pour les images cérébrales. Pour autant, savoir que nous nous trompons et que quelque chose ne fonctionne pas, n'a jamais été un gage pour éviter de renouveler les erreurs.
Ainsi, le psychologue Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, a travaillé au début de sa carrière sur les biais comportementaux pour l'armée israélienne en procédant à des prédictions sur la qualité et le leadership de certains des apprentis soldats 73 ( * ) Il a ainsi pu mettre en évidence très peu de corrélation entre ses prédictions et le devenir de ces soldats au sein de l'armée. Malgré la connaissance de cette faible corrélation, lui-même a continué à pratiquer les mêmes tests, à utiliser les mêmes heuristiques pour parvenir à ces conclusions, parce qu'il y avait une demande qui émanait de sa hiérarchie.
En ce qui concerne le neurodroit, nous pouvons considérer qu'il existe une certaine demande sociétale pour de nouvelles techniques qui nous permettraient d'analyser avec plus de précision le comportement des personnes impliquées dans un procès, qu'il s'agisse des juges, des témoins, des accusés ou des jurés. Mais une demande, aussi pressante soit-elle, ne justifie pas la précipitation et ce malgré la récente crise de l'expertise psychiatrique dans l'appareil judiciaire qui constitue un terrain fertile pour l'utilisation des neurosciences dans les tribunaux. Un des derniers cas rendus publics - mais il y en a pratiquement toutes les semaines, ce qui ne rend pas notre travail aisé pour traiter ce sujet - a eu lieu en Italie, où une personne, qui a reconnu avoir tué sa soeur, avait dans un premier temps été condamnée à perpétuité. Sur la base d'une méthode qui permet de comparer l'évolution des volumes cérébraux et des tests génétiques, certains experts admis par les tribunaux italiens, ont estimé que le condamné n'était pas totalement responsable de ses actes. Sa peine a ainsi été commuée de perpétuité à vingt ans d'emprisonnement, sur la base de la combinaison des tests génétiques et des images par résonance magnétique 74 ( * ) .
Aujourd'hui, l'état de nos connaissances en imagerie cérébrale ne devrait pas nous permettre de statuer sur la culpabilité, les prédictions, et le pourcentage de récidives éventuelles d'un individu sur la seule base de données de neurosciences. Toutefois, l'utilisation de ces techniques dans nombre de pays nous invite à engager une réflexion poussée. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre démarche, en proposant un ensemble de discussions sur des questions dont certaines peuvent déranger j'en conviens. Car même si, aujourd'hui, cela relève de la prospective, voire, dans certains cas de la science fiction, une réflexion sur des scenarii où le recours aux neurosciences dans les procédures judiciaires deviendrait plus fréquent nous apparaît nécessaire. Dans de tels cas, qui serait l'expert auprès du tribunal , alors que nous avons peine parfois à nous mettre d'accord, entre acteurs des neurosciences, sur les seuils de significativité, la variabilité des signaux et l'interprétation des données ? Comment former de tels experts ? Et former les acteurs du procès à ces nouvelles connaissances ?
Dans certaines expériences, une même personne qui fait la même tâche dans la même journée, n'a parfois pas les mêmes patterns d'activation. La même tâche réalisée par la même personne dans différents scanners IRMf peut donner des patterns d'activation différents. On ne dispose donc pas forcément des outils pour distinguer ce qui relève de la variabilité liée à l'outil, à la différence des scanners, mais aussi aux phénomènes d'apprentissage. Si nous sommes confrontés à « une course à l'armement » des scanners et à une meilleure définition, il faut aussi pousser le travail sur les modèles des fonctionnements du cerveau afin de toujours mieux comprendre. Je fais partie du consortium Virtual Brain Project 75 ( * ) , sur trois continents, avec dix groupes de chercheurs qui explorent les liens entre les aspects théoriques et pratiques des neurosciences et si l'on peut affirmer une chose, c'est que les liens entre activité cérébrale et comportement sont tout sauf linéaires, directs et univoques.
Dans nos communications, nous avons tendance, lorsqu'on dispose de résultats saillants, à plus ou moins sciemment les généraliser à toute la population. Or, aujourd'hui, une des questions coûteuses en temps et en argent est celle de la différenciation des individus et de l'analyse de leurs comportements. Il convient d'avoir une approche différentielle des cerveaux et de la façon dont on va juger, accompagner, voire aider. Aux États-Unis, deux groupes travaillent sur des méthodes de neuro-feed-back , sur les réactions du cortex préfrontal, pour essayer d'apprendre aux sujets à contrôler leur envie de tabac en leur donnant des informations sur la façon dont leur cerveau fonctionne. Ce sont des pistes à explorer dans le domaine de la prévention comme celle du contrôle des impulsions violentes par exemple.
En matière de prédiction, enfin, un article récent a fait débat sur la détection des pédophiles grâce à l'IRMf. Cette étude illustre le débat contradictoire et salutaire au sein de cette assemblée, comme au sein de la communauté neuroscientifique. Une équipe de la faculté de médecine de Kiel a ainsi publié un article dans lequel des personnes identifiées comme pédophiles et non pédophiles ont été exposées à l'intérieur d'un scanner IRM à des images d'enfants et d'adultes nus. Grâce à un algorithme, on nous annonce un taux de détection au-delà de 90 %, de personnes pédophiles 76 ( * ) .
Avant même de s'interroger sur la validité de cette expérience, des questions se posent, auxquelles aucune réponse n'est fournie. Nous parlons souvent, et à juste titre, de la nécessité du consentement éclairé en médecine comme dans la recherche scientifique. A-t-on dit aux sujets avant qu'ils ne participent à cette expérience qu'ils seraient exposés à des images d'enfants nus une fois dans le scanner IRMf ? Où a-t-on été chercher les images d'enfants nus qui ont servi de stimuli dans l'expérience ? Qui a autorisé l'utilisation de telles images ? Comment ont-elles été sélectionnées ? Je laisse travailler votre imagination...
En France, fort heureusement, ce genre d'expériences ne pourrait être accepté par un Comité de protection des personnes. Mais tous les pays ne traitent pas la bioéthique de la même manière. Malheureusement, et j'en appelle au législateur, s'agissant des lois de bioéthiques, la législation européenne n'est pas harmonisée, loin s'en faut. La loi française en la matière peut apparaître contraignante, mais il suffit de se rendre dans certains pays frontaliers pour réaliser à quel point le patient et le sujet sont protégés en France. En effet, certains de nos voisins n'ont pas de loi de bioéthique et il est malheureusement facile d'y réaliser des expériences que l'on n'autoriserait pas en France.
Au final, ces expériences que l'on critique, permettent aussi d'avoir ce débat et de pouvoir communiquer, en essayant d'être le plus raisonnable et efficace possible, sur les bonnes pratiques et les limites de l'imagerie cérébrale et, plus généralement, des neurosciences.
Doit-on pour autant penser que la connaissance est dangereuse ?
À mon sens, elle est tout sauf dangereuse ; elle est salutaire ; mais son utilisation peut, elle, devenir dangereuse si elle n'est pas contrôlée. Certes, nos résultats peuvent être utilisés sans que nous ayons été consultés, il n'est pas rare que des personnes extérieures au monde de la recherche scientifique et médicale fassent dire des choses incohérentes à nos données. Mais nous avons aussi notre part de responsabilité dans la façon dont nous communiquons.
Depuis l'audition du 26 mars 2008, une chose n'a pas changé : ma conclusion, à savoir que recherche, connaissance et débat contradictoire, tout comme la diffusion la plus efficace et la plus posée possible des résultats scientifiques, restent les meilleurs remparts contre les dérives inexorables de l'utilisation et du détournement de certaines de nos pratiques en neurosciences. Ces dérives peuvent nous paraître inéluctables mais nous avons nombre d'arguments et de techniques pour les contrer et faire valoir les bonnes pratiques à commencer par faire entendre nos voix dans la littérature scientifique et en dehors. Je vous remercie à travers vos auditions parlementaires de nous y aider.
M. Alain Claeys. Je vous remercie et donne la parole à M. Olivier Houdé
M. Olivier Houdé, professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes, directeur du Laboratoire de Psychologie du Développement et de l'Éducation de l'enfant (LaPsyDÉ), CNRS. Je suis très honoré par votre invitation. Je vous présenterai les premières recherches qu'on réalise en France et à l'étranger sur la plasticité liée à l'apprentissage, la pédagogie et l'éducation.
Les recherches que l'on mène dans ce domaine portent sur des questions de connaissance, d'exploration des mécanismes de plasticité qui, de l'enfant à l'adulte, peuvent être provoqués par l'apprentissage, la pédagogie et l'éducation au sens général. Elles prennent leur origine dans des questionnements scientifiques bien antérieurs à l'imagerie cérébrale, anatomique et fonctionnelle. On étudie comment se construit l'intelligence chez l'enfant : il s'agit d'étudier la permanence des objets, l'unité des objets physiques et humains, que le cerveau du bébé doit d'abord construire, puis leur quantification via le traitement du nombre, qui conduira par l'éducation aux mathématiques, à la catégorisation, au traitement qualitatif des objets, aux taxonomies.
Quand ces traitements ne portent plus seulement sur des objets concrets, physiquement présents ou mémorisés, mais sur des idées, des hypothèses, des propositions logiques, on accède au raisonnement. Ces fondamentaux cognitifs se trouvent au coeur de ce qui est mobilisé par le cerveau à travers les apprentissages formels et informels.
Différents modèles existent en psychologie du développement de l'enfant. Le plus connu et le plus classique est celui du psychologue suisse Jean Piaget, qui décrivait le fonctionnement de l'enfant par grands stades ou marches à gravir, d'un stade sensorimoteur du bébé à l'abstraction logique chez l'adolescent et l'adulte, en passant par des stades intermédiaires. C'est une vision linéaire, hiérarchique et rigide du développement. À partir d'un tel modèle, et Catherine Vidal l'a bien montré, on peut facilement stigmatiser une trajectoire et l'enfermer.
Les modèles actuels contestent cette dimension linéaire du progrès cognitif chez l'enfant. On sait aujourd'hui que le cerveau fonctionne de façon beaucoup plus dynamique et non linéaire, avec, à tout âge du développement, selon les enfants, les contextes, plusieurs stratégies cognitives. Les courbes que je vous présente ressemblent à des vagues qui approchent d'un rivage. C'est tout l'intérêt de l'usage de l'imagerie médicale chez les enfants du tout venant, y compris les enfants sains, pour la compréhension des mécanismes fondamentaux de l'apprentissage. Chacune de ces vagues correspond à une stratégie cognitive de catégorisation, de dénombrement, de raisonnement, et mobilise elle-même un réseau cérébral qui peut fluctuer à différents âges, ce qu'on appelle la macrogenèse, ou à un âge donné au cours d'un apprentissage, la microgenèse. L'exemple des jongleurs ou des musiciens dont on a fait état est ainsi un exemple de microgenèse.
Sur deux clichés d'imagerie obtenus dans mon laboratoire, on observe le cerveau des mêmes individus avant et après la correction d'une erreur de raisonnement. On a demandé, dans un exercice où il s'agit d'effectuer une tâche de raisonnement logique, hypothéticodéductif, de sélectionner deux formes géométriques qui rendent une règle fausse. La règle est : s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. L'exercice est très simple : on peut tout mettre, sauf un carré rouge et un cercle jaune, de telle sorte que notre cerveau, notamment sa partie préfrontale, sélectionne dans ses formes géométriques, un antécédent vrai et un conséquent faux, selon le principe d'une table de vérité logique, connue depuis l'Antiquité.
Or, spontanément, notre cerveau ne fonctionne pas de manière logique, mais par bricolage perceptif visuo-spatial. Ces biais de raisonnement, identifiés notamment par le prix Nobel Daniel Kahneman, sont-ils irrépressibles, cristallisés dans le cerveau ? Un effet d'apprentissage et de pédagogie peut-il entraîner une reconfiguration ? C'est sur ce point que s'inscrit la psychopédagogie expérimentale, utilisant l'imagerie médicale. On peut voir si telle ou telle intervention pédagogique entraîne non seulement un changement des comportements, mais, simultanément, une reconfiguration chez les mêmes individus, des réseaux neuronaux impliqués. Certaines interventions pédagogiques fonctionneront, d'autre pas. Il s'agit donc d'un outil supplémentaire qui informe sur la nature de la stratégie cognitive. Selon les régions, on trouve une stratégie plutôt visuo-spatiale ou logico-sémantique. On découvre aussi le rôle des fonctions exécutives, les capacités de contrôle du comportement, des stratégies, grâce auxquelles on peut inhiber une réponse impulsive, inadéquate dans un cas (par exemple le carré rouge et le cercle jaune), adéquate dans l'autre.
À mon sens, les neurosciences ont un devoir d'humilité et de service à l'égard de l'éducation et de la pédagogie. Étant moi-même à l'origine instituteur et professeur des écoles, je reste donc animé par ce souci permanent, y compris le souci de transfert psychopédagogique dans les classes. Dans les académies, sous la vigilance des recteurs, des inspecteurs de l'éducation nationale, des professeurs, des classes volontaires, nous avons un large réseau d'écoles avec lesquelles nous travaillons avec un mécanisme d'appropriation. Il s'agit de groupes de recherche formation/action. Nous leur présentons par exemple les recherches que je viens d'exposer sur une ou deux journées. Les professeurs sont libérés de leur classe, et identifient des difficultés qu'ils rencontrent en classe et sur lesquelles ils butent, avec lesquelles leurs moyens pédagogiques habituels ne fonctionnent pas. Quand tout va bien, la pédagogie naturelle n'a pas besoin d'être éclairée et aidée par les neurosciences.
Ces professeurs se disent alors qu'ils pourraient s'approprier, à leur façon, telle ou telle découverte pour la développer en classe. On leur donne des conseils de contrôle expérimental, étant entendu qu'il ne s'agit pas de faire une expérience dans la classe. Comme la médecine guidée par les évidences scientifiques, il pourrait y avoir une pédagogie guidée par certaines évidences scientifiques. C'est le cas de la psychologie expérimentale. Ce pourrait l'être en partie par l'imagerie cérébrale. Aucun citoyen n'imaginerait que son médecin puisse ne pas se tenir informé des avancées scientifiques les plus récentes concernant les différents organes qu'il examine. Il est difficile d'imaginer qu'il ne puisse pas en être de même à l'égard des psychologues et des éducateurs pour le cerveau, siège des apprentissages et de l'intelligence. Si l'on considère que l'éducation n'est pas du soin, mais que l'un et l'autre sont aussi importants, on peut commencer à avoir les mêmes exigences à l'égard des éducateurs et des pédagogues.
Il ne s'agit pas de leur faire peur. Lorsque vous allez vers les classes et les écoles en faisant des conférences grand public dans le milieu de l'éducation, dès l'instant où vous montrez de telles images, et Pierre Le Coz l'a très bien expliqué, on constate que la déshumanisation humanise. Lorsqu'un professeur des classes constate que, par une intervention pédagogique, il se produit une interaction naturelle avant et après apprentissage, quand on met deux fois l'individu dans la caméra et qu'on constate que le cerveau bouge, cela donne une force extraordinaire au pouvoir éducatif. Cela montre qu'il a un impact réel sur le cerveau.
Nous venons de publier une étude, dont La Recherche a diffusé les résultats au grand public dans son numéro de novembre, sous le titre « Comment nous devenons intelligents : ce que révèle l'imagerie cérébrale », faisant suite à un Portfolio de février 2009 qui annonçait déjà l'étude et que le magazine avait titré : « Les enfants prêtent leurs cerveaux à la science. » Cette expérience s'est réalisée dans le cadre de la loi Huriet sur des enfants sains d'écoles volontaires, avec accord des parents, en partenariat entre le CNRS et l'éducation nationale, sans bénéfice direct. L'objectif est d'alimenter la recherche fondamentale au service de la connaissance des mécanismes d'apprentissage et de plasticité du cerveau. Ce sont des enfants de grande section de maternelle jusqu'au CM2 qui ont participé à l'expérience. L'information aux enfants s'est réalisée par des livrets, des posters. On a introduit l'idée de mesure du corps, d'instrumentation, les enfants devant être sensibilisés au fait qu'ils rencontreront des professionnels de la mesure. On les sensibilise à l'idée de radiographie. Peu à peu, on a interrogé l'enfant sur la connaissance de son cerveau, à quoi il sert, puis on l'a sensibilisé à l'IRM. Peu à peu, on a obtenu le consentement légal des parents et l'accord de l'enfant, étant entendu que l'expérience pouvait s'arrêter dès qu'ils le souhaitaient. Ceci a supposé un travail considérable de préparation psychologique dans les écoles, avec une fausse IRM ludique, un casque de chevalier en carton qui simule l'antenne de l'IRM, un faux tunnel en tissu pour apprendre à l'enfant à être allongé et confiné. On lui a appris à utiliser l'ordinateur, l'outil numérique, les boutons réponse (voir l'illustration ci-dessous).

En parallèle, nous venons de réaliser une grande méta-analyse sur 4 210 sujets de 4 à 17 ans pour savoir, comment de par le monde - les recherches par IRM sur l'enfant se multipliant - on prépare les enfants. En règle générale, l'expérimentation plaît aux enfants, lorsqu'on leur a bien expliqué les choses, notamment avec la métaphore du vaisseau spatial. Cependant, c'est un fait que les enfants bougent. Dans ce cas, les données ne sont pas utilisables. Il y a donc un temps d'entraînement à l'immobilité, par le jeu de la statue dans la cour d'école. Le jour de l'IRM, on leur dit « statue », et l'enfant est tout content d'intégrer dans un cadre technologique une consigne qu'il peut facilement maîtriser.
Dans le cas de notre étude, de nombreux parents ont dit qu'ils n'auraient jamais imaginé leur enfant capable d'un tel contrôle et de participer à une expérience de ce type. En effet l'enfant reste parfaitement immobile deux fois un quart d'heure dans l'IRM. Dans le premier quart d'heure, on lui présente un dessin animé qu'il aura choisi la veille et on enregistre simplement l'anatomie (la structure) de son cerveau. Dans le deuxième quart d'heure, c'est la partie fonctionnelle : on introduit une tâche cognitive qu'il a à réaliser. Selon que l'enfant réussira ou échouera dans la tâche qu'on lui demande d'effectuer, on analysera les régions qui seront corrélées aux progrès cognitifs et à la correction d'une erreur.
Par exemple, pour deux alignements de jetons égaux en nombre mais de longueur différente (les jetons étant plus ou moins écartés) et disposés au-dessus ou au-dessous d'une ligne sur un écran d'ordinateur, l'enfant dira qu'il y a autant de jetons parce qu'il possède en mémoire, dans le cerveau, un schème de conservation du nombre. En dépit de la transformation visuo-spatiale, le nombre de jetons reste le même. Mais cela exige de l'enfant de mobiliser son cortex préfrontal et d'inhiber une réponse impulsive, du type « il y a plus de jetons en dessous parce que c'est plus long », réponse classique jusqu'à l'âge de sept ans. Il s'agit donc d'un exemple de tâche critique, où l'on peut bien cerner la capacité qu'a l'enfant à changer de stratégie dans le cerveau pour une même tâche. C'est ce qu'on observe au travers d'une macro-genèse : comment, à travers les âges, la réussite dans une tâche logico-mathématique simple mais très critique du point de vue du contrôle des stratégies cognitives et des impulsions, l'enfant apprendra à mobiliser conjointement des régions pariétales, liées au nombre, et des régions préfrontales dédiées aux fonctions exécutives d'inhibition d'une stratégie erronée (ici, « longueur = nombre ») et de switching vers la bonne stratégie (voir l'illustration ci-dessous).
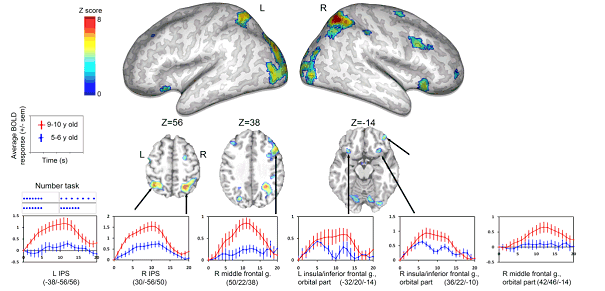
On peut aussi, de façon plus précise, corréler ce qui se passe dans ces régions avec des tâches que l'enfant résout par ailleurs à l'école, étant entendu qu'on ne peut pas tout faire dans l'IRM, compte tenu du temps de concentration et de la nécessité technique de répétition des items pour une même tâche. On procède donc en parallèle à toute une batterie de tâches cognitives dans un contexte écologique et scolaire, par exemple pour tester les capacités d'inhibition de l'enfant, qui doit dénommer sur une image le corps d'un animal. Dans un cas, le corps est compatible avec sa tête, dans un autre cas, il entre en interférence (non correspondance) avec sa tête. Aussi l'enfant doit-il inhiber une impulsion dans le cas d'un conflit cognitif - exactement comme avec le nombre et la longueur dans la tâche passée sous IRM. Il s'agit donc d'un contrôle expérimental externe pour corréler la capacité d'inhibition de l'enfant en général avec les régions préfrontales qu'il mobilise dans l'IRM pour la tâche logico-mathématique.
On dispose avec cette étude spécifique de l'image du cerveau d'une cohorte d'enfants des écoles, qui peut être utilisée de façon anonyme, et à titre d'exploration. Nous venons également de publier, puisqu'on dispose maintenant de près de dix ans de recherche en imagerie cérébrale chez l'enfant sain, une première méta-analyse incluant 842 enfants dans des tâches de lecture, de calcul, de fonctions exécutives (inhibition, flexibilité, etc.), pour essayer de dégager les résultats solides qui en ressortent (voir l'illustration ci-dessous : en vert la lecture, en bleu le calcul et en violet les fonctions exécutives).
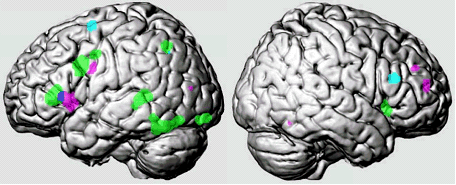
En entrant dans un même logiciel d'analyse, en homogénéisant toutes les données d'imagerie cérébrale obtenues dans les laboratoires du monde entier, avec des hypothèses et des populations différentes d'enfants, on essaie de dégager pour le même type de tâches cognitives et scolaires ce qu'on trouve comme dénominateur commun et invariant. Cette première méta-analyse montre des régions-clés pour ces fonctions cognitives. C'est un indicateur. Une équipe américaine a immédiatement (en 2011) repris les régions d'intérêt de notre méta-analyse pour chercher une corrélation avec l'expertise en lecture chez l'enfant et l'adulte. Ils ont ainsi trouvé des résultats totalement surprenants par rapport à l'aire visuelle des mots et de la lecture, preuve de la dynamique de la recherche en ce domaine.
Dans notre laboratoire, les expérimentations d'imagerie cérébrale ont lieu le mercredi, jour où les enfants n'ont pas classe. Le lendemain, à l'école, spontanément, ils discutent du cerveau, de science, d'épistémologie, de ce qu'ils ont réalisé la veille. L'idée qu'on puisse « faire de la philosophie » ou avoir une réflexion épistémologique naïve dès quatre ou cinq ans nous a été racontée par les professeurs des grandes sections de maternelle, ce qui les a beaucoup étonnés. Il ne faut donc pas attendre le secondaire ou l'université pour faire des cours sur l'esprit, le cerveau, l'anatomie, et susciter à ces sujets une conscience réflexive et un débat.
Ce domaine de recherche neuropédagogique ouvre donc, sous des aspects scientifiques et humains multiples, riches, les perspectives d'un débat de bioéthique de l'éducation (ou de la « neuro-éducation »), qui n'est pas le même que celui de la santé et du soin. Références 77 ( * ) .
M. Alain Claeys. Je vous remercie, de cet exposé. Professeur Benmaklouf, vous avez la parole.
M. Ali Benmaklouf, professeur de philosophie, membre du CCNE, président du comité consultatif de déontologie et d'éthique de l'institut de recherche pour le développement (IRD). Yves Agid a rappelé le contexte dans lequel nous travaillons au CCNE pour un rapport sur l'imagerie fonctionnelle. Permettez-moi de donner quelques indications philosophiques. En 1980, Georges Canguilhem, dans un article intitulé « Le cerveau et la pensée », soulignait que la connaissance rapide et supposée des fonctions du cerveau ferait qu'on développerait de la théorie par intérêt pratique. La demande sociétale, induit parfois une forme de développement des neurosciences. Canguilhem, pour sa part, s'étonnait de« la rapidité avec laquelle la connaissance supposée des fonctions du cerveau etait investie dans des techniques d'intervention, comme si la démarche théorique était suscitée par un intérêt de pratique . »
En premier lieu, on observe une tension entre l'incertitude scientifique et la précision scientifique. Très souvent, au plan sociétal, on constate une soif de certitude, une volonté de savoir. Est-ce du fer ? Le scientifique, à l'analyse, répond que c'est 95 % de fer et 5 % d'autres matières. La précision fait quitter la certitude. Il me paraît ainsi très important de souligner que nous ne sommes pas sur le même plan lorsqu'on dialogue au niveau sociétal entre une soif de certitude et une demande de précision. Ce qu'on apprend par l'IRMf, et Catherine Vidal l'a bien rappelé, constitue un instantané, qui ne peut jamais refléter toute l'activité permanente du cerveau, et surtout la manière dont il interagit avec son contexte et son environnement. En outre, il y a des conditions artificielles pour l'examen, qui suppose le consentement. Cette complexité conférée par la précision n'est parfois pas audible au niveau sociétal, où l'on reste souvent bloqué sur une demande de certitude, et pas tant de précision.
On a beaucoup évoqué le processus mental et la base cérébrale. Le premier suppose la seconde. Cependant, qu'entend-on par processus mental ? Depuis le début de la réunion, le mot a été utilisé comme si les choses allaient de soi. Aussi donnerai-je deux exemples qui, pour un philosophe, indiquent la possibilité de croiser les travaux des neurologues et des psychiatres, mais aussi de montrer les limites d'une réflexion possible allant de la réflexion philosophique à la réflexion neurologique ou psychiatrique.
Premier exemple : la lecture. Il existe des hésitations à lire, une tension à lire, une difficulté à reconnaître certaines formes d'écriture, une capacité à lire distincte de la récitation par coeur. Qu'est-ce que lire sous l'emprise de la drogue ou comme dans un rêve ? Plusieurs indications permettent de signaler que la capacité de lecture est de pouvoir faire correspondre des sons à des signes écrits ; mais pour pouvoir déplier cette capacité, il est difficile de la ramener à un processus qui serait susceptible d'être codé.
Deuxième exemple : comment accède-t-on aux idées générales ? Là aussi, le moment logique de la capacité n'est jamais le moment chronologique du déroulement d'un processus quelconque. Pour paraphraser Aristote, je perçois un élément individuel, puis, à un certain moment, ce n'est ni Socrate, ni Platon, mais l'homme, l'être humain, et je perçois l'être humain derrière l'individu. De nombreux philosophes expliquent que ce moment est difficilement réductible à une quelconque psychologie, et qu'il s'agit d'un moment capacitaire, logique, et non pas chronologique.
Il existe des croisements possibles avec les neurosciences ; cependant, les croisements ne sont pas une réduction. J'ai été très sensible aux propos d'Angela Sirigu sur les représentations du cerveau. Pendant longtemps, les philosophes ont résisté à l'idée que le cerveau pouvait représenter ; ils l'ont réduit à une activité sensori-motrice, et je pense à Henri Bergson, qui n'admettait pas cette idée. Les exemples d'Angela Sirigu sont très probants sur les possibilités de représentation du cerveau, et elle a été très prudente, en soulignant que ces représentations n'indiquaient pas pour autant une réelle capacité de penser.
On a mentionné à plusieurs reprises Broca et le devenir de ses découvertes. Or ce n'est pas parce qu'une fonction du langage dépend d'une localité cérébrale, que cette localité intervient exclusivement dans l'usage de la langue. Mobiliser une partie du cerveau, ce n'est pas la faire coïncider exclusivement avec une fonction. C'est un point qu'il faut répéter.
Quant aux liaisons et à leur caractérisation, Canguilhem, à partir des travaux de Kurt Goldstein sur les blessés de la Grande guerre, a souligné que les réactions pathologiques ne l'étaient jamais par rapport à une capacité antérieure, mais qu'elles redistribuaient une compensation. Le malade remanie sans cesse, et cette modification fait qu'on ne peut parler en termes négatifs d'absence de telle ou telle fonction. C'est pourquoi il rappelait la règle d'or de John H Jackson : notez ce que le patient comprend réellement, et évitez des termes tels « a-mnésie », « a-lexie », de surdité verbale, etc . Cela ne sert à rien de dire qu'un malade a perdu ses mots, tant qu'on ne spécifie pas dans quelle situation typique ce déficit a eu lieu. Cela peut être relié à la détection de mensonge. Lorsqu'on demande à quelqu'un de dire « non », il peut échouer, car affirmer est très élaboré. Si on me dit « ton nom est John », je répondrai « non » par une interjection, « non », qui aura une valeur d'interjection, pas de déclaration.
S'agissant des usages abusifs de l'IRM, j'ai été très sensible à l'analogie mise en avant par Helène Gaumont-Prat sur les données génétiques. Pour ma part, je ferai l'analogie avec l'avis 98 du CCNE sur les dérives de la biométrie. « Le changement de finalité de la biométrie, peut aller jusqu'au détournement de finalité. » En matière de procédures judiciaires, il s'agit d'un détournement de finalité. L'IRMf, si importante pour la recherche médicale et la thérapie, se trouve détournée, sans que sa finalité soit complètement changée. Jean-Claude Ameisen a rappelé le cas de la mise en place de la détention de sûreté ; elle a été accompagnée du rapport de Jean-François Burgelin, qui précise « qu'il est nécessaire de ne pas laisser l'opinion publique dans l'illusion qu'il est possible de déterminer avec certitude si un individu est ou non un récidiviste en puissance . » Là encore, l'opinion publique, relayée par une certaine propagande, voudrait cette certitude. La science, elle, donne de la précision, pas de la certitude.
J'ai été également très étonné de constater que le mensonge soit pris comme un exemple notoire, alors qu'il s'agit d'un jeu très complexe, et non pas d'un jeu primaire. Tous les concepts sémantiques sont très complexes : désigner, se référer à, exister, dire que cet arbre existe : Ludwig Wittgenstein soulignait que seuls les philosophes peuvent se poser cette question. « Qui est déloyal à l'égard de la vérité, disait Montaigne , l'est à l'égard du mensonge. » Où se trouve le repérage réel du mensonge dans ces conditions ?
Il est abusif de croire qu'une image cérébrale fonctionnelle rendra compte de la signature épigénétique. Nous sommes tous d'accord. Sans doute est-ce l'occasion de rappeler qu'à côté des principes éthiques que nous rappelons bien souvent, non malfaisance, bienfaisance, justice, autonomie, il faut ajouter le critère de la pertinence scientifique, qui se pose pour l'IRMf de façon aiguë.
Je conclurai par cinq remarques. La première est la question des données, plusieurs fois signalée. La mise à disposition de la collectivité d'un grand nombre de données d'imagerie est un vrai problème, sans compter qu'il y a un risque d'erreur croissant. Plus on accumule de données, plus leur croisement entre différentes institutions engendrera un grand coefficient d'erreur.
La deuxième est l'intrusion de la neuroimagerie dans la vie quotidienne. Ne risque-t-on pas de banaliser l'idée qu'on puisse déterminer des tendances humaines ?
La troisième est un point méthodologique important, brain waves do not lie , les ondes ne mentent pas, l'image ne ment pas. C'est un point de vue logique très important, pour signaler le caractère non déclaratif d'une image. Une proposition peut toujours être affirmative ou négative, ou être posée sous forme de questions. Une image est nécessairement positive. La positivité de l'image indique son caractère concret et solide, sur laquelle se cristallisent des besoins de certitude qui sont déplacés.
La quatrième est qu'en médecine, la technique de l'IRMf est très utile pour ce qui relève de la personnalité dite normale, mais ne fonctionne pas pour l'instant pour des personnalités à comportement catastrophique. Je reste cependant prudent, le principe de précaution utilisant une incise importante : au moment donné des connaissances que nous avons.
La cinquième et dernière remarque est que pour l'avenir, même si certains pensent que dans la population dite normale, l'utilisation de l'IRMf peut être un auxiliaire utile, il a été démontré au cours de la réunion qu'il ne fallait pas secondariser le colloque entre le médecin et le patient, en se reposant uniquement sur l'IRMf. Il reste cependant important d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur les connaissances néfastes en termes de risque de dérives sécuritaires, malheureusement associées à cet outil qui induit une grande fascination.
M. Alain Claeys. Je vous remercie et donne la parole à Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice générale de l'Agence de la Biomédecine
Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice générale de l'Agence de la Biomédecine (ABM). Je n'apporterai sur le sujet aucun élément de fond, mais un élément de réponse institutionnelle.
L'Agence de la biomédecine a été présente par mes collaborateurs tout au long de cette réunion et lors de la précédente car les neurosciences sont une compétence nouvelle, dont le législateur a bien voulu nous charger. Dans la loi relative à la bioéthique, il a exprimé d'une manière très claire la volonté que le Parlement, le Gouvernement et, au-delà, le peuple français soit mieux informé, ait une meilleure connaissance des neurosciences. Si celles-ci sont déjà anciennes, elles quittent le laboratoire pour passer à la médecine clinique, et ne concernent plus seulement des cas exceptionnels et passent dans une sorte de routine. C'est pourquoi elles inquiètent. Cette inquiétude, qui s'étend aux usages non médicaux, est sans doute ce qui a justifié l'accent mis par le législateur lorsqu'il a souhaité que, parmi la biomédecine, les techniques de neurosciences fassent l'objet d'une attention particulière. Ainsi, a-t-il chargé un certain nombre d'acteurs de veiller sur cette nouvelle médecine.
Il a d'abord demandé que des règles de bonnes pratiques soient élaborées, et fassent l'objet d'un arrêté ministériel, point qui ne relève pas de l'Agence. En revanche, il l'a chargée de veiller à élaborer une information à destination du Parlement et du Gouvernement, sur les neurosciences et leurs évolutions, et les problèmes éthiques qu'elles pourraient soulever. Par ailleurs, il a demandé que cette information fasse l'objet d'un point spécifique dans le rapport annuel de l'Agence.
C'est donc chaque année que nous devrons revenir devant vous avec un point d'étape et une réflexion sur ces questions, leur évolution scientifique, mais aussi les problèmes éthiques qui pourraient être soulevés ; ce point annuel étant parallèle à d'autres points qui peuvent être apportés de manière plus solennelle par des instances comme le Comité consultatif national d'éthique.
À l'Agence, ce sujet a fait l'objet d'une réflexion ; cependant, nous n'avons pour l'instant rien mis en oeuvre, ne disposant pas des textes, ni des moyens qui vont avec. Nous avons réfléchi à la manière dont nous allons prendre en main cette mission dont nous avons été chargés. À l'évidence, les neurosciences n'entrent pas dans les compétences traditionnelles de l'Agence de la biomédecine. Celle-ci est chargée de la greffe d'organes, de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaine. Elle n'est pas chargée des neurosciences. Dans la loi, le législateur utilise d'ailleurs une périphrase, mettant en avant, à propos du rapport annuel, les mots suivants : « sur ses domaines de compétences et sur les neurosciences. »
M. Alain Claeys. L'exécutif pourra en tirer les conclusions qui s'imposent.
Mme Emmanuelle Prada-Bordenave. Cela dit, le deuxième point de notre réflexion tend à reconnaître qu'il faut répondre à la demande qui nous est adressée, avec la conviction forte qu'il est de notre devoir - du devoir des agences sanitaires et du ministère - de faire comprendre et de transmettre les informations sur les techniques médicales nouvelles, lorsqu'elles arrivent et inquiètent. L'expérience de l'Agence tend à lui faire dire que c'est possible. Elle l'a réalisé dans le domaine des greffes, à l'époque de l'Etablissement français des greffes quand il lui fallait expliquer comment, à partir d'un mort, soigner un vivant, et plus récemment par des campagnes d'information concernant l'assistance médicale à la procréation et le don de gamètes. Elle est en train de commencer à le faire sur la génétique, science à la fois médicale et de recherche, qui inquiète beaucoup.
L'Agence s'attellera à faire de même pour les neurosciences, en utilisant des recettes qui ont fait preuve d'efficacité, depuis la création de France Transplant et de l'Établissement français des greffes. Elle se retournera vers les acteurs, qui sont peu ou prou les participants de cette réunion. On les rencontrera, pour apprendre à les connaître, comprendre ce qu'ils font, avant de transmettre un message sur ce dont il est question. On va évidemment déployer une veille bibliographique y compris sur Internet. Comme dans les autres disciplines, la greffe, l'assistance médicale à la procréation et la recherche sur l'embryon, l'Agence fera appel aux personnes compétentes, pour qu'elles soient à l'amorce de la réflexion et tracent quelques pistes dans un groupe de travail. Puis nous pourrons enchaîner sur la formulation des enjeux, des difficultés éventuelles et des recommandations que l'on pourrait transmettre.
La mission que vous nous avez confiée n'est pas impossible. Nous essayerons de la remplir, en rendant compte du mieux possible de ce que sont les neurosciences en France, et de leurs enjeux aujourd'hui, sans adopter une approche de type régulation, encadrement, surveillance ou contrainte. Tel n'est pas notre rôle, ni notre but.
CONCLUSION
M. Alain Claeys. Nous voici arrivés au terme de cette journée. Nous disposons désormais d'une grande quantité de matière pour réfléchir.
Dans les semaines qui viennent et en début d'année, le rôle de l'Office sera de rendre un premier rapport pour dégager un certain nombre de lignes de force. Nous aurons deux tâches. La première sera de décrire où nous en sommes. La deuxième sera de trouver le chemin entre ce qui relève de la recherche fondamentale, qui est nécessaire, et de ce qui relève des applications potentielles qui éventuellement doivent être encadrées ou réglementées. Tel est le rôle du Parlement. Nous aurons à préciser un certain nombre de points particuliers, qu'on recensera, et qui exigeront sans doute quelques autres auditions pour préciser les choses.
M. Hervé Chneiweiss. Je tiens à remercier tous les collègues qui sont venus apporter leur expertise et le personnel de l'Office pour l'organisation de cette journée. Je souhaite également redire l'impérieuse nécessité de la recherche, et à quel point les acteurs sont prêts à venir apporter leur expertise et ouvrir leur questionnement. Être un scientifique, comme l'a rappelé Ali Benmaklouf, c'est d'abord se poser des questions. Nous nous les posons au regard des premiers résultats. « Que vaudrait , explique Michel Foucault en introduction du tome 2 de son histoire de la sexualité, l'acharnement du savoir s'il ne devait et autant que faire se peut assurer l'égarement de celui qui connaît » et j'ajouterai l'émerveillement et l'étonnement de celui qui connaît ?
M. Alain Claeys. Il faudra que l'exécutif traduise les décisions du législateur pour l'Agence de la biomédecine, qu'il ait le talent de préciser les missions ; et je pense qu'il ne faut pas tarder. Il ne faudrait pas que ces questions arrivent dans le grand public -et cela arrivera dans les mois qui viennent- sans qu'à l'échelon législatif comme exécutif, la réflexion ait été menée. À défaut, on fera face à des incompréhensions, des simplifications, et éventuellement des peurs. Je tiens à ce que ce travail législatif et celui de l'Agence s'effectuent en amont, avant que ce sujet n'envahisse nos écrans et la presse. Il faudra effectuer ce travail si l'on veut éviter que la notion de progrès puisse être détournée de son sens et conduise à une négation de ce progrès par des peurs infondées.
Mme Angela Sirigu. Comme neuroscientifique, je tiens à faire un dernier commentaire. Au terme de cette audition, je suis effrayée par les conclusions qui sont tirées, sous le prétexte d'encadrer la recherche en neurosciences. J'avoue ne m'être pas rendue compte des effets des travaux en neurosciences au plan sociétal. C'est la première fois que je le réalise. Or je constate que les conclusions que vous tirez reposent sur des idées fausses. Utiliser l'IRMf pour lire la pensée des autres, est absolument faux.
M. Alain Claeys. Je n'ai rien dit de tout cela. J'ai simplement souligné qu'il fallait que les chercheurs puissent travailler le plus librement possible, pour que les connaissances progressent. S'il y a à encadrer certaines applications, il faudra le faire, et cela existe déjà dans la loi. Je me suis rendu aux États-Unis. J'y ai visité une entreprise qui fait fonctionner des scanners et des IRM au profit de sportifs. Or des personnes y travaillent pour les tribunaux, en utilisant ces machines comme détecteurs de mensonge. C'est un problème très concret : va-t-on l'autoriser en France ou pas ? Le législateur devra se pencher sur ce genre de questions.
Mme Angela Sirigu. Les neuroscientifiques sont contre, et nous l'avons clairement dit.
M. Alain Claeys. Depuis que je suis membre de l'Office parlementaire et que je travaille, notamment sur les lois bioéthiques, je n'ai jamais fait une proposition pour brider la recherche scientifique. J'ai bien souvent regretté des réactions ambiguës de la loi. Sur ce sujet, comme sur tous ceux qui concernent le vivant, on doit concilier deux choses : permettre aux chercheurs, de façon pluridisciplinaire, de chercher dans des conditions parfaites, société de la connaissance oblige, et condamner certaines applications que nous jugeons tous condamnables. Il faut faire en sorte que des charlatans ne puissent ternir le travail des chercheurs, et que ces pratiques puissent être interdites.
Mme Angela Sirigu. Nous sommes totalement d'accord.
M. Alain Claeys. D'autres observations ? Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre présence et de la qualité de vos interventions.
COMPTE-RENDU DE L'AUDITION DU 15 NOVEMBRE 2011 DU
PR. JEAN-PIERRE CHANGEUX, ANCIEN DIRECTEUR DE L'UNITÉ DE
NEUROBIOLOGIE MOLÉCULAIRE À L'INSTITUT PASTEUR,
PROFESSEUR
HONORAIRE AU COLLÈGE DE FRANCE ET
À L'INSTITUT
PASTEUR
Mon exposé traitera de questions générales de neuroscience et de certains aspects de la recherche fondamentale qui soulèvent nombre de problématiques éthiques. Il s'agit d'une information réciproque et je me tiens à votre disposition pour tout échange de vues complémentaire.
Pour commencer, je rappellerai le coût des pathologies du cerveau dans 30 pays européens : pour une année typique est de l'ordre de 165 millions de personnes, soit 38% de la population totale de ces pays seront victimes de troubles neuropsychiatriques soit un coût total de 798 milliards d'euros. Cette statistique est bien documentée et publiée 78 ( * ) . Ce sont les pathologies du système nerveux qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale, environ 30% du coût total, comparé au cancer, aux maladies cardio-vasculaire ou infectieuses.
Ce constat édifiant n'a malheureusement pas entrainé la prise de conscience attendue du monde politique qui aurait dû se concrétiser par des décisions administratives et financières majeures. Le financement de la recherche en ce domaine reste bien inférieur à celui du cancer, des technologies de l'information, de l'agriculture et de bien d'autres domaines, tant au niveau européen que national. Une fraction importante de la population âgée est atteinte de la maladie d'Alzheimer et le coût de prise en charge deviendra énorme dans les années proches. Tant sur le plan théorique qu'appliqué, c'est pour moi, le domaine le plus important de la recherche biologique, voire de la recherche scientifique tout court.
Qu'est-ce que le cerveau ?
Un réseau extraordinairement complexe de : près d'une centaine de milliards de neurones et d'environ 1 million de milliards de contacts synaptiques dans le cortex cérébral
On est en présence de l'objet physique, peut-être le plus complexe, existant dans la nature même parmi les objets conçus par les physiciens et les informaticiens. Cette immense complexité et cette diversité lui confèrent des propriétés exceptionnelles. Quelles sont-elles ? Comment peut-on mettre en relation de manière générale l'organisation de notre cerveau avec les fonctions psychologiques et cognitives ?
Le cerveau est composé de neurones formant un réseau discontinu. Depuis la fin du XIXème siècle, certains, comme Camillo Golgi, ont défendu la thèse « continuiste » selon laquelle le réseau cérébral était continu. Cette position idéologique permettait, selon eux, d'expliquer que l'âme puisse passer plus facilement d'une cellule à l'autre...
Grâce, en particulier, aux travaux pionniers de Santiago Ramón y Cajal, il est désormais démontré que le cerveau est constitué de cellules nerveuse, ou neurones, qui sont en contact les unes avec les autres, au niveau de synapses où les membranes cellulaires des cellules en contact sont en contiguïté et non en continuité. Dans le cerveau circulent des signaux électriques qui se propagent à une vitesse relativement lente, inférieure à la vitesse du son, et donc très inférieure à celle des signaux d'ordinateur. Ces signaux sont intégralement descriptibles en termes de transport ionique, et donc réductibles à des mécanismes physicochimiques. Lorsque le signal nerveux arrive à la frontière entre deux cellules nerveuses, la question de la communication de l'information à travers la synapse -du pré-synaptique au post-synaptique- se pose. Le signal électrique ne passe pas, la chimie prend alors le relais. À l'arrivée de l'influx nerveux dans la terminaison nerveuse, l'électro-sécrétion d'une substance chimique, un neurotransmetteur, a lieu dans l'espace synaptique. Celui-ci diffuse très rapidement et vient se fixer à un récepteur spécifique sur l'autre face de la synapse. Cette transmission s'effectue en l'espace d'une milliseconde. Mais une régulation d'efficacité de la synapse, plus lente (dizaines de millisecondes), peut avoir lieu par la suite.
Les signaux nerveux ne sont pas simplement provoqués par la stimulation des organes des sens, ils peuvent aussi être produits spontanément par des systèmes décrits intégralement par des circuits moléculaires. L'activité spontanée peut s'observer avec des neurones isolés en culture mais est également identifiables dans le cerveau. Notre cerveau est en fait une remarquable machine chimique, constamment en activité, dont le fonctionnement devrait pouvoir être, tôt ou tard, intégralement décrit en termes physico-chimiques. C'est un point important à retenir. Une preuve symbolique évidente en est que si on donne à un sujet un anesthésique général, il perd conscience. Donc, il existe une chimie de la conscience. La relation entre les propriétés moléculaires et les fonctions supérieures du cerveau est sans ambiguïté, une relation de causalité, mais nous sommes encore loin de l'avoir comprise dans sa totalité. C'est l'enjeu de la neuroscience à venir.
Quelles sont les conséquences du constat : le cerveau machine chimique?
Comme les agents pharmacologiques sont des substances chimiques, ils agissent sur des cibles moléculaires particulières. Il apparaît évidemment nécessaire de poursuivre l'identification des composants chimiques universels du cerveau de l'homme, afin de concevoir et construire des agents pharmacologiques ciblés sur ces composants élémentaires. Or, si on examine comment s'effectue actuellement la recherche de nouveaux médicaments par les grandes sociétés pharmaceutiques (d'abord motivées, selon moi, par le profit immédiat sans intérêt autre que financier pour les besoins de santé à court et à long terme de nos sociétés), on constate malheureusement un déclin de la synthèse de nouveaux médicaments et de leur mise sur le marché. Pour des pathologies comme la maladie d'Alzheimer, la schizophrénie ou la dépression qui concernent un très grand nombre de personnes, pas ou très peu de médicaments nouveaux. Il n'en existe aucun pour la maladie d'Alzheimer. Pour la schizophrénie, les neuroleptiques existants, sont insuffisants.
Il s'agit là pour moi du premier problème éthique à résoudre par la neuroscience : faire en sorte que la recherche puisse progresser dans ce domaine; et établir des conditions raisonnables et éthiques de développement de la recherche, dans la conception des nouveaux médicaments et leur mise sur le marché.
À cet égard, ce qui se passe en ce moment, est catastrophique pour la qualité de vie de nos sociétés. La solution que je suggère est la mise en place, par exemple par un riche mécène (telle la Wellcome Foundation en Angleterre), d'une Grande Fondation Internationale, de droit privé et reconnue d'utilité publique (comme l'Institut Pasteur), qui se consacre à la conception, au développement et à la mise effective sur le marché de médicaments ciblés sur les pathologies du cerveau de l'Homme.
Il faut certes s'attendre à ce que l'action de ces nouveaux médicaments agissant sur le système nerveux s'accompagne d'effets secondaires indésirables. Par exemple, un stimulant cognitif aura vraisemblablement des effets addictifs. Les lois sont ainsi faites qu'on interdit la mise sur le marché de tout médicament actif sur le système nerveux qui a le moindre effet secondaire. Or, dans la lutte contre le cancer, on accepte les effets secondaires considérables des médicaments anticancéreux utilisés en chimiothérapie. Pour les agents pharmacologiques actifs sur le cerveau, cela n'est pas le cas.
Il devient nécessaire pour les maladies neuropsychiatriques très invalidantes de ré-examiner, avec toute les précautions éthiques nécessaires les risques d'effets secondaires éventuels, au-delà d'un inadéquat « principe de précaution ». Il se peut qu'on trouve par exemple de nouveaux médicaments permettant de traiter 80% des malades atteints d'Alzheimer, mais qui auront des effets secondaires chez certains malades. Quelle décision prendre alors ? Pour les médicaments du système nerveux, cela pose un problème éthique réel, extrêmement sensible. Mais en définitive c'est la relation bénéfice-risque qui doit être examinée et cela avec beaucoup d'attention.
Dans quelle mesure les neurosciences peuvent-elles rendre compte des conduites humaines et donner lieu à la simulation des conduites humaines?
Selon moi on en est loin d'atteindre ce but, mais des progrès se produiront certainement dans ce domaine. Les progrès de la chimie et de la technologie du cerveau changeront-ils notre conception du psychisme et le concept d'esprit? C'est la vieille histoire, dans nos sociétés occidentales, du clivage entre le cerveau et l'âme : le dualisme platonicien et cartésien d'un côté ; et à l'opposé, l'analyse neuroscientifique d'aujourd'hui. La conception qui émerge de nos jours considère qu'il n'existe pas de clivage entre le cerveau et l'esprit, et que les deux sont intimement liés dans une relation de causalité réciproque. Cette conception moniste n'est pas récente, elle était déjà celle des philosophes pré-socratiques et de Spinoza.
Les recherches sur le cerveau nous amènent-elles à modifier notre conception du soi et de la personne humaine ?
Sans doute oui, elles la renouvellent, mais ne l'éliminent pas. On peut espérer accéder à une nouvelle conception neuroscientifique et éthique de la personne humaine, averti des difficultés soulevées par les questions de la liberté et de la responsabilité personnelle. Pour nombre d'entre nous, être humain, c'est se sentir libre et ce fait n'est pas incompatible avec une conception neuroscientifique du cerveau. À ce jour, ces questions essentielles ne sont pas évoquées publiquement, mais elles ressurgiront un jour. Au comité de l' Human Brain Simulation Project dont je fais partie, nous avons été amenés à les poser et à en débattre.
Plusieurs niveaux de variations et d'organisation s'emboîtent dans le cerveau humain
Le cerveau est certes une machine chimique, mais aussi un organe très complexe dont il faut essayer de comprendre la complexité. La thèse que je défends depuis plusieurs années et qui semble maintenant partagée, est qu'il existe plusieurs niveaux de variations et d'organisation qui s'emboîtent dans le cerveau humain et qui doivent être pris en considération pour toute approche scientifique du cerveau de l'homme. Schématiquement ces niveaux sont les suivants :
- l'évolution des espèces : l'évolution au niveau génétique, qui s'est poursuivie depuis des millions d'années ( Homo habilis, H. erectus, H. sapiens ...) avec variabilité du génome ;
-l'évolution au cours du développement ontogénétique, et au niveau postnatal avec la mise en place d'une bonne partie de la connectivité du cerveau avec effets de l'environnement;
-l'interactivité du cerveau avec le monde extérieur, et son environnement externe : problème central sur lequel de nombreuses questions éthiques viennent se greffer ;
-l'état d'activité des neurones, la dynamique de la pensée, la variabilité d'activité spontanée des efficacités synaptiques. Les temps psychologiques de notre cerveau sont relativement lents, de l'ordre de 100 millisecondes ; le cerveau possède des capacités bien supérieures à l'ordinateur sur le plan cognitif ; mais on ne peut pas demander au cerveau humain de rivaliser avec un ordinateur sur le plan de la vitesse de la transmission de l'information qui est de l'ordre de la vitesse de la lumière ;
-l'évolution sociale et culturelle produite et internalisée par le cerveau de nos ancêtres a déposé des mémoires extra-cérébrales avec lesquelles nos cerveaux peuvent interagir au cours de vie du sujet (les oeuvres d'art, les écrits, les données électroniques...).
Ainsi il faut concevoir notre cerveau comme synthèse d'un ensemble d'évolutions internalisées qui incluent l'évolution des espèces, le développement embryonnaire, le développement postnatal et qui continuent à se produire chez l'adulte chez lequel une certaine forme de plasticité cérébrale persiste . Doivent évidemment être prises en compte les niveaux d'organisation et échelles d'analyse passant du moléculaire au cellulaire, puis aux réseaux de neurones, aux grands ensembles de neurones pour en arriver aux fonctions de rationalité et de vie sociale qui caractérisent l'espèce humaine par rapport aux autres espèces. Ce schéma inclut des possibilités de régulation de bas en haut et de haut en bas, de sorte qu'en particulier la vie sociale ou les états de conscience peuvent avoir des effets sur les organisations neuronales sous-jacentes. Telles sont les grandes lignes permettant d'une part, de mettre un peu d'ordre dans la compréhension du cerveau humain, et d'autre part, d'éviter de prétendre qu'il existe un lien absolu entre gène et psychisme, ou que si on comprend toute la chimie, on comprendra toutes les consciences.
Comment le cerveau s'est-il organisé ?
La structure et le fonctionnement de notre cerveau sont certes chimiques, mais sont aussi organisés. Il s'agit de comprendre maintenant comment celui-ci s'organise. Pour commencer, on se trouve confronté à l'évolution paléontologique, le passage des ancêtres communs aux singes et à l'espèce humaine au niveau du génome. Cette évolution génétique nous confronte à un paradoxe fascinant : on trouve le même nombre de gènes chez la souris et chez l'homme et celui-ci est de plus fort modeste 20-25.000 seulement (voir en particulier les travaux de séquençage du génome de l'homme et de la souris par Craig Venter et le Human genome project ). Il existe d'autre part d'importantes identités de séquence entre les deux génomes. Comment comprendre dans ces conditions la relation entre le génotype - qui change peu - et le phénotype cérébral - qui se manifeste par une extraordinaire augmentation de complexité? Certaines maladies neurologiques sont certes associées à des mutations de gènes uniques mais, en fait, ce n'est pas tellement l'apparition de gènes nouveaux qui a engagé l'évolution du cerveau de l'homme mais plutôt des changements quantitatifs modestes du nombre et de l'expression de gènes existants !
Une recherche en cours aux États-Unis dans le cadre du « Thousand genome project », a réalisé la séquence complète du génome de 1000 individus et révélé principalement des changements du nombre de copies géniques. L'hypothèse est que des changements de ce type ont entraîné des modifications considérables de l'organisation du cerveau et des comportements concernés au cours de l'évolution. L'évolution de nos ancêtres se serait produite à la suite de changements quantitatifs et pas uniquement qualitatifs au niveau génétique. On constate des changements du nombre de copies géniques (qui entrainent souvent des pathologies cérébrales) communs à toutes les ethnies chez l'homme, mais aucun changement de ce type n'est noté chez le chimpanzé.
C'est pourquoi, l'hypothèse peut être suggérée que ce sont des réseaux d'expression génique dans lesquels les gènes interagissent entre eux (et pas des gènes indépendants) qui entraînent des changements majeurs dans les réseaux de neurones cérébraux. Des modèles ont été proposés qui rendent compte de l'important accroissement relatif de la surface de notre cortex préfrontal au cours de l'histoire évolutive de notre espèce. Il doit donc exister un réseau d'interactions géniques propre à l'Homo sapiens distinct de celui des grands singes et de nos ancêtres directs. On se trouve en présence d'une sorte de « patrimoine génétique propre à l'espèce humaine ».
Des mutations, changements de copies géniques peuvent certes produire des changements importants au niveau de notre cerveau mais sans altérer le génome humain dans son ensemble. Ceci pose évidemment de nombreuses questions éthiques. Il faut toutefois éviter d'en tirer des conclusions trop rapides comme le font parfois les media; par exemple il n'est pas légitime d'associer un gène à un comportement (le gène de l'intelligence, le gène du langage, le gène de la violence...). Il est vrai qu'il existe un nombre limité de déterminants géniques, mais si comme cela a été dit leur altération peut entrainer des changements de fonctions cérébrales, cela ne veut pas dire que ces quelques gènes déterminent exclusivement ces fonctions. On constate une importante variabilité génétique d'un individu à l'autre, mais celle-ci se produit au sein d'une enveloppe génétique commune propre au cerveau humain.
Se pose alors la question fondamentale de l'existence d'un universalisme éthique des humains. Je défends la thèse affirmant qu'il existe des prédispositions éthiques communes à tous les êtres humains. Il s'agit là d'une question toujours controversée même si elle apparait plausible.
Par ailleurs, comment mettre en relation génome et troubles psychiatriques? La connaissance du génome peut-elle permettre de prédire les conduites humaines normales ou pathologiques ? La réponse à ces questions a des conséquences éthiques majeures avec en particulier la manière de prendre en charge les patients atteints de troubles mentaux. Par exemple, la psychanalyse freudienne considère tragiquement l'autisme comme résultant d'une maltraitance qui culpabilise les mères alors qu'il s'agit d'un trouble dont les prédispositions génétiques sont incontestables....
Améliorer les fonctions du cerveau, le transhumanisme ?
Cette question très sensible se pose principalement aux États-Unis où un mouvement très actif, le transhumanisme, défend des thèses, qui même si elles peuvent paraître extrêmes, sont parfois partagées par le grand public et fréquemment relayées par la presse. Il prône l'usage des sciences et des techniques afin «d'améliorer » - «d'augmenter» - les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains . Il s'exprime par exemple à travers la préoccupation de certains parents qui veulent accroitre artificiellement les dispositions cérébrales de leur enfant avec un peu d'ADN, des cellules souches, des drogues variées... Ceci pose un redoutable problème éthique.
Le développement du cerveau est un thème de recherche fondamental.
Le poids du cerveau est multiplié par cinq du nouveau-né à l'adulte. La mise en place d'environ 50% de la connectivité du cerveau se produit après la naissance. Cette connectivité ne se développe pas comme on connecte les circuits d'un ordinateur, mais progressivement par essais et erreurs successifs et emboités. À chaque étape de la croissance synaptique, le plus souvent exubérante, l'activité cérébrale, soit spontanée, soit provoquée, élimine certaines connexions et en stabilise d'autres. Cette évolution est encadrée par des déterminants génétiques qui spécifient par exemple la cible à atteindre ou le trajet des axones en croissance et forment ce que l'on peut appeler une « enveloppe génétique ». C'est pourquoi, j'avais suggéré dans « l'Homme neuronal » qu'« apprendre, c'est éliminer », ce qui avait surpris à l'époque, mais cette thèse semble aujourd'hui être passée dans le domaine public. Dans l'enveloppe générale du monde des synapses, l'élimination se manifeste clairement en fin de parcours par une chute du nombre total de synapses même si production/élimination se produisent constamment au cours du développement. Vers l'âge de 10-12 ans, on constate un pic maximum et ensuite une chute avec un changement radical à l'âge de la puberté. La violence des jeunes que le monde politique ne comprend pas toujours peut être mise en parallèle avec une réorganisation très profonde de la connectivité du cerveau. C'est une étape critique essentielle dans le développement du cerveau de l'homme. Il faut en percevoir les conséquences majeures dans la prise en charge des adolescents trop souvent laissés à eux-mêmes.
Le développement post-natal est une donnée très importante du cerveau humain. Lorsqu'il est apparu en Afrique il y a quelque 150 000 ans Homo sapiens vivait environ 30 ans. Il passait environ la moitié de sa vie à construire son cerveau...Ce développement prolongé permet la mise en place de la culture : à la fois sa production et son internalisation. Le mécanisme de stabilisation des synapses assure la transmission culturelle d'une génération à l'autre. Ceci conduit à un espace de variabilité supplémentaire qui s'observe chez des individus génétiquement identiques dont la connectivité cérébrale varie d'un cerveau à l'autre. Par ce processus d'épigénèse, on se trouve au-delà du déterminisme proprement génétique, bien que toujours sous le contrôle des gènes. On laisse entrer une contribution importante de l'interaction avec l'environnement dans la mise en place de l'organisation du cerveau adulte avant même la naissance et surtout après.
Le travail comparatif de Stanislas Dehaene et de son groupe sur les illettrés et les personnes sachant lire a montré que l'apprentissage de la lecture entrainait un changement de l'ensemble de la connectivité du cerveau. Notre cerveau internalise, incorpore, des informations provenant de l'extérieur au niveau de la connectivité synaptique. Des «circuits culturels» sont donc présents et même particulièrement abondants dans notre cerveau concernant langage parlé, écriture, vie sociale, art, religion.... Ceci souligne l'importance de l'éducation - et tout particulièrement de l'éducation laïque - dans le développement du cerveau de l'enfant, et en particulier de l'adolescent. Cette empreinte culturelle précoce existe, ne serait-ce que pour le langage, dès la première enfance. Chacun peut le voir en Belgique, dans lequel des discriminations surprenantes fondées sur la langue trouvent leur origine dans l'apprentissage local du flamand ou du français; leur interprétation neurobiologique est évidente. De même, pour certaines maladies comme la schizophrénie, liées au départ à des prédispositions génétiques, on pense aujourd'hui que ces effets géniques interviennent dans la synaptogénèse et que l'épigénèse synaptique se trouve altérée très précocement au cours du développement créant le phénotype schizophrénique de l'adulte.
Cependant le processus fonctionne dans les deux sens : d'un côté, des gènes altèrent l'épigénèse, de l'autre, la prise en charge module, voire modifie les effets géniques. Il existe même une possibilité de compensation de certains déficits génétiques. Par exemple une mutation génique peut être compensée au cours du développement par des processus d'épigénèse, mais une fois que l'épigénèse a eu lieu, les effets sont quasiment irréversibles. Le problème central devient la prise en charge précoce de l'enfant chez lequel le déficit a été identifié précocement. C'est pourquoi , un diagnostic précoce est particulièrement important si l'on veut arriver à une meilleure prise en charge. Cela se vérifie pour le traitement de la dyslexie mais cela est également plausible dans le cas de la schizophrénie pour laquelle la pharmacologie de l'adulte est insuffisante du fait d'une prise en charge trop tardive.
Pour progresser, il faudrait effectuer, des diagnostics génétiques précoces, afin de concevoir de nouveaux agents pharmacologiques qui puissent agir très tôt sur le développement synaptique lui-même, mais ceci reste un problème considérable à la fois scientifique et éthique. Bien des troubles du cerveau adulte se développent en effet au cours des dix premières années de la vie. La connectivité se met en place dans nos synapses à la suite de la propre histoire de chaque individu, de l'histoire familiale et culturelle environnante. La diversité culturelle et le relativisme des représentations culturelles incluant le langage, les règles sociales, les systèmes philosophiques, symboliques et religieux en sont l'une des conséquences idéologiques les plus intéressantes. Il existe des mécanismes neurobiologiques d'accès à la conscience
La thèse que j'ai développée avec Stanislas Dehaene -avec qui je travaille depuis plus de vingt ans- est qu'il existe des bases neurales d'accès à la conscience. Notre hypothèse neurale est que des neurones pyramidaux du cortex à axone long établissent une interconnectivité à longue distance au sein de notre encéphale, créant un espace de travail neuronal conscient. Ces neurones sont très abondants dans le cortex de type 2, qui inclut le cortex préfrontal et aussi pariéto-temporal-cingulaire. Nous pensons qu'une sorte de circuit global interconnecte l'ensemble et contribue à l'espace conscient. Il est notable que l'expansion du cortexpréfrontal, déjà mentionnée au cours de l'évolution du cerveau chez les ancêtres de l'Homme, s'accompagne d'un enrichissement en neurones à axone long et de ce fait des capacités cognitives de l'espace conscient. Cette hypothèse est mise à l'épreuve avec diverses expériences de mesures psychophysiques d'accès à la conscience.
On présente par exemple au sujet successivement des diapositives représentant des figures complexes ou masques, un mot, un vide, brièvement mais dans un ordre variable. On constate que le sujet ne perçoit pas la même chose suivant l'ordre de présentation du mot, du masque, du vide. Par exemple un mot encadré par deux vides est lu et perçu consciemment alors que le mot encadré par deux masques n'est pas subjectivement vu par le sujet. Il s'est donc produit dans le premier cas un traitement conscient des données, dans l'autre un traitement non conscient. Si on compare les images cérébrales obtenues avec le sujet dans un cas et dans l'autre, on constate, que la perception consciente entraine une activation très importante du cortex préfrontal-pariéto-temporal-cingulaire, c'est à dire de l'espace de travail neuronal conscient. On peut aussi déceler des perturbations de l'accès à la conscience chez le schizophrène. Il existe bien des bases neurales de l'accès à la conscience, à la conscience de soi et à la conscience du corps. Cela suscite d'abondantes questions d'éthique.
Aspects positifs :
Une communication sans parole entre sujets conscients ou entre sujet et machine devient possible. Par exemple, à condition que le sujet s'y prête, on enregistrera par une méthode électrophysiologique, EEG par exemple, des ondes qui correspondent à la commande cérébrale d'un geste moteur et celle-ci pourra ensuite être utilisée pour commander des prothèses. Un tel dispositif peut être très utile pour les handicapés. Bien d'autres conséquences positives sont à prévoir.
Aspects négatifs :
Ces méthodes permettront tôt ou tard une lecture des pensées, avec un risque réel d'intrusion dans la vie privée, de publicité subliminale, de contrôle des conduites humaines. La réflexion doit s'étendre également aux aspects neurochirurgicaux (avec en mémoire la lobotomie par Moniz), aux stimulations cérébrales, et aux traitements pharmacologiques (en se rappelant le lavage de cerveau dans les camps chinois de rééducation)...
Toutes les expériences en cours montrent qu'il existe une compatibilité entre nos connaissances du cerveau de l'homme et l'idée de se sentir libre, de donner un consentement éclairé. On peut même accéder aux bases neurales de la décision. Cela n'est pas du tout contradictoire avec l'idée que la neuroscience décrive, de manière scientifique et objective, le cerveau de l'homme et ses fonctions cognitives comme l'accès à la conscience, sachant qu'il possède une plasticité cérébrale exceptionnelle et qu'il est capable d'apprentissage. Tout ceci fait que notre cerveau ne fonctionne pas comme un automate entièrement programmé mais qu'il est capable de s'autoprogrammer. La recherche en cours en neuroscience cognitives essaie précisément de développer ce paradigme.
Drogue et toxicomanie
Le problème des drogues et de la toxicomanie n'est pas traité de manière convenable par le législateur : c'est un point négatif. Par exemple plusieurs drogues toxiques majeures comme l'alcool ou le tabac sont tolérées alors que d'autres parfois moins toxiques sont hors la loi. D'une part, si le trafic de drogues est répréhensible, l'abus de drogues par addiction relève de la pathologie cérébrale et non d'actes criminels conduisant à la prison. Ils témoignent de prédispositions individuelles et du mal-être de nos sociétés. D'autre part, il existe une demande pressante et constante d'utilisation de drogues anxiolytiques comme, par exemple, contre l'hyperactivité et autres troubles du comportement des enfants. Il faut être attentif au risque d'une éventuelle hyper médicalisation, toxicomaniaque, de l'enfant. Toutefois le traitement pharmacologique peut être utilement demandé par le médecin. Une fois de plus il faut être attentif au rapport bénéfice-risque pour l'enfant plutôt qu'aux prises de positions politiques ou idéologiques.
La relation à autrui,
On constate que le cerveau de l'homme dispose d'une double caractéristique : il est à la fois rationnel et social, capable d'empathie et de sympathie, dispositions universelles propres au nouveau-né humain. L'empathie, à savoir percevoir et comprendre ce que l'autre ressent, peut être démontrée par l'imagerie cérébrale. Au sein d'un couple qui s'entend bien, on soumet l'un des deux sujets à un choc électrique, celui-ci en souffre et on enregistre une image cérébrale. Puis on soumet son partenaire au même choc et on enregistre l'image cérébrale produite par la vision de la scène par la personne qui a subi le premier choc. La comparaison des images de ce qui est vécu et de ce qui est vu, chez un même sujet révèle des points communs, qui constituent ce qui pourrait être appelé « réseaux neuronal de l'empathie ».
Il en va de même pour la sympathie qui consiste, lorsqu'on perçoit une souffrance chez autrui d'arrêter la cause qui la produit. Cela implique un inhibiteur de violence, très étudiée par Konrad Lorenz chez l'animal, et aussi chez l'enfant. RJR Blair a défini chez l'homme une pathologie antisociale appelée sociopathie, celle par exemple des tueurs en série, qui se manifeste par une perception de la souffrance provoquée mais l'absence d'inhibition de violence. Cette pathologie de la relation à autrui peut relever tant de l'inné que de l'acquis comme on l'a vu précédemment. Dès lors, on entrevoit bien les problèmes juridiques et éthiques que cela pose.
Ces connaissances sur le cerveau amélioreront-elles l'accès au bonheur?
Définir la vie heureuse, le bonheur, en termes scientifiques, relève quelque peu de la provocation. Depuis Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, nombreux sont les scientifiques et les philosophes qui s'y sont attaqués avec plus ou moins de succès. Reste que c'est bien avec leur cerveau que les hommes accèdent au bonheur, ce qui n'exclut en aucune manière, nous le savons, toutes les autres causes, sociales, personnelles ou autres. Lorsqu'on se demande pourquoi nombre de Français prennent tant de tranquillisants, c'est bien pour améliorer leur confort de vie, leur bonheur dans un environnement qui les accable !
L'une des grandes causes de conflits partout dans le monde est l'appartenance culturelle, comme l'a montré Claude Lévi-Strauss dans la « Pensée sauvage ». Nous possédons des structures sociales liées à l'histoire culturelle de notre société et donc qui varient de manière relative d'une société à l'autre ; néanmoins nous sommes des individus appartenant à la même espèce dont les individus sont dotés de cerveaux ayant des propriétés communes. Des recherches sont en cours à travers le monde sur les bases neurales des règles de conduite éthiques, des règles sociales ; c'est le champ de la « neuroéthique » (K Evers Neuroéthique 2009 O. Jacob). Au-delà de la variabilité génétique et des histoires épigénétiques de chacun, il convient de réfléchir à ce qui pourrait donner accès à un meilleur vivre ensemble au-delà des différences culturelles et des intégrismes politiques et religieux. On peut penser à des règles de conduites universelles qui s'inspirent d'une réflexion neuroscientifique humaniste et conduiront peut-être, à un renouvellement de notre conception de l'homme et de l'humanité. Je défends cette thèse depuis des années, dans la tradition des objectifs de René Cassin et Eleanor Roosevelt et de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
En conclusion, il convient de souligner l'impact très important de la neuroscience sur l'économie, l'innovation, l'emploi, l'organisation du travail, l'industrie, le système juridique. Il faut s'attendre à une utilisation élargie, après les données génétique, de l'imagerie cérébrale et des données neuroscientifiques, dans des domaines aussi divers que l'éducation, la santé, les institutions. Je dirai, avec Pasteur, il faut l'espérer, pour le bien de l'humanité. Dans le cas de la législation et la justice criminelle, il s'agit par exemple de la question de la responsabilité pénale, de l'acte criminel dans l'état de démence. Aux États-Unis, les avocats présentent fréquemment des images cérébrales devant les tribunaux pour désengager la responsabilité du client. Autre problème, doit-on juger les malades mentaux, question très difficile d'autant que les troubles des malades mentaux sont parfois cycliques et entrecoupés de moments où le patient parait « normal » ? En France, le système juridique renvoie la personne accusée d'un crime soit vers l'hôpital psychiatrique, (tel Louis Althusser qui n'a jamais été jugé), soit vers la police. Sur quelles bases ? Les problèmes posés par les personnes âgées démentes, et en déni de maladie restent difficiles à résoudre. Quel doit être leur liberté d'action ?
La question du diagnostic génétique précoce des maladies neuropsychiatriques et du droit de savoir se trouve posée. Les tests génétiques n'offrent qu'une prédisposition statistique à la survenue ultérieure des troubles. Si la personne se trouve prise en charge dans un environnement adéquat, l'apparition du phénotype cérébral pathologique peut être retardé ou même ne pas s'exprimer. Il existe des possibilités de compensation et une grande hétérogénéité des individus. Le diagnostic précoce comporte aussi des dangers de stigmatisation, et la frontière entre la discrimination et la prévention est toujours très délicate. Il convient d'être prudent, d'abord essayer de ne pas nuire primum non nocere et tenter d'améliorer la qualité de vie des patients. La connaissance en elle-même n'est pas négative, mais son application peut l'être. Attention, même si c'est un sujet tabou, aux détournements de la recherche neuroscientifique à des fins militaires !
Or le Comité consultatif national d'éthique n'a jamais débattu ni pris position sur les applications de la recherche biologique dans le domaine militaire, en dépit de risques impliqués. A ma connaissance, le pouvoir politique ne l'en a jamais saisi...
Les questions en suspens sur le thème éthique et neuroscience sont très nombreuses, et touchent à bien des activités de la vie de nos concitoyens bien que souvent difficiles à aborder. L'impact de l'environnement éducatif, la formidable plasticité du cerveau et ses limites sont des aspects fondamentaux. Le cerveau n'est pas une éponge : il se développe étapes par étapes encadré par des dispositions génétiques propres à l'espèce. Il est essentiel que l'enfant reçoive les signaux adéquats au moment où ses réseaux cérébraux sont prêts à accepter ces stimuli. Telle serait une éducation harmonieuse. La recherche en neurosciences en est encore aux prémices sur les questions d'accès à la conscience, mais des progrès considérables sont attendus dans les dix prochaines années. La neuroscience offre les possibilités d'un renouveau extraordinaire du connais-toi-toi-même socratique.
COMPTE-RENDU DE L'AUDITION DU 7 DÉCEMBRE 2011 DE M. CHRISTIAN BYK, MAGISTRAT À LA COUR D'APPEL DE PARIS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT, ÉTHIQUE ET SCIENCE
Je vais essayer de vous présenter une courte synthèse des questions concernant l'exploration du cerveau et les enjeux éthiques et juridiques des neurosciences. La réalité est que l'on se trouve face à un champ d'investigation global en pleine effervescence, concernant des domaines assez vastes, compétitifs à l'international pour les chercheurs, mais que cela reste encore mal défini sur le plan scientifique et mal connu quant aux perspectives. On observe une prise de conscience émergente et réelle de la dimension éthique des problèmes, à laquelle l'Office parlementaire contribue largement, et au final on constate quand même une certaine prudence quant à l'évaluation des avantages et des inconvénients sur ce que l'on va faire, y compris dans les débats du Conseil d'Analyse Stratégique (CAS), auxquels j'ai participé.
Le législateur s'est engagé par un signe visible avec la loi du 7 juillet 2011, mais, au-delà des finalités légales, il n'a pas défini de régime juridique. Donc, on reste encore dans une prudente expectative. Les neurosciences s'inscrivent dans un débat social et politique des finalités des technosciences, de l'outil pour la société, des équilibres des politiques publiques, en termes de libertés, de contraintes, de développement industriel ou scientifique. C'est la logique de notre société technoscientifique. J'ai choisi de traiter d'abord des neurosciences et des libertés publiques, ce qui me permettra de voir ces questions d'équilibres et de contraintes en liaison avec l'intérêt social, puis d'aborder le thème des neurosciences, de la santé et de la recherche.
I-Neurosciences et libertés publiques
Neurosciences et identité
En quoi les neurosciences peuvent-elles être au service de l'individu ? C'est Hervé Chneiweiss dans son introduction historique lors de l'audition que l'Office avait organisée en juin 2011, qui faisait état du fait que le cerveau apparaissait déjà dans les débats médicaux philosophiques anciens (la question de l'âme et de la raison) et que l'on peut se demander aujourd'hui s'il n'est pas un élément de notre identité. En quoi la connaissance des neurosciences appliquée à tel ou tel individu permet-elle d'aider à définir les éléments caractéristiques d'une identité ? On a bien dit à propos du génome, même s'il n'est pas toute l'identité d'un individu et s'il n'est pas question de le réduire à cela, qu'il contribue à définir notre identité. Aujourd'hui, avec le débat sur la carte d'identité nationale biométrique, on s'interroge pour savoir si des éléments tirés de la biométrie peuvent servir à définir une identité au sens de l'identification policière de l'individu. Demain, ce sera peut-être la même chose avec les neurosciences et l'imagerie. Au début des années quatre-vingt avec les scanners, il fallait plusieurs minutes pour faire une seule tranche et de nos jours, en quelques secondes on fait l'individu tout entier.
Je pose donc la question de savoir si ce ne sera pas aussi demain pour le législateur un élément caractéristique de la définition de l'identité.
Protection des données
Cela amène aussi à réfléchir sur la protection des données par rapport aux informations qui vont se multiplier, données médicales d'abord, mais qui pourraient servir à d'autres finalités : assurances, accès à l'emploi par exemple. Il existe des dispositions spécifiques interdisant l'utilisation des données de la génétique dans ces deux domaines, dont la CNIL assure le contrôle de façon efficace et considérable. Pourra-t-elle intégrer aussi bien la nouvelle dimension des neurosciences ? C'est tout le problème à venir des préoccupations sur les libertés publiques et la façon de les gérer.
II-Neurosciences, qualité de la vie et sciences humaines
Deux aspects sont à prendre en compte: la question du « human enhancement ». Sera-t-il possible d'utiliser les neurosciences pour apporter une amélioration de la vie de la personne ? Certainement, la réponse est oui pour traiter les maladies de la dégénérescence du cerveau. C'est aussi le problème plus classique du dopage, sportif notamment; en sens inverse la question de la détérioration humaine, des maladies dégénératives, surtout si on ne fait rien, pose de gros problèmes. Ce sont les milliers de dossiers de tutelle, de protection judiciaire des personnes et qui, avant cela, sont sous la protection de leur famille. C'est la question, sans doute classique mais lourde de conséquences, des patrimoines, quelquefois considérables avec l'immobilier, l'assurance-vie... C'est aussi et c'est plus novateur, la gestion des personnes vieillissantes elles-mêmes, des problèmes relationnels avec leur famille, la vie sociale, la démocratie de proximité (capacité à voter lors des élections). Anne Fagot-Largeault en avait fort bien parlé lors de l'audition de l'OPECST de juin dernier. Or, le nombre d'individus âgés souffrant de maladies dégénératives est appelé à énormément augmenter dans les prochaines années.
Les manipulations du cerveau
Deux domaines peuvent nous éclairer
-Les neurosciences et les sectes, où quel que soit le nom qu'on leur donne, ce sont des relations où des gourous utilisent la psychologie et la parapsychologie au sein de groupes pour exercer une influence sur le comportement des individus. On s'interroge sur le rôle que les neurosciences risquent à l'avenir de jouer dans la manipulation des comportements.
-Les neurosciences et les techniques de vente : le législateur français s'est certes montré exemplaire dans la protection des personnes en matière de démarchage. Mais, dans nos sociétés de consommation, les gens sont de plus en plus sollicités et dans les moments de tentation, on va chercher ce qu'il y a d'impulsif, de latent dans les comportements. À la longue, cela peut poser des problèmes à certains individus.
Les neurosciences au service de la société, les buts légitimes
Les neurosciences pourraient devenir un nouvel outil de l'expertise judiciaire. J'ai eu l'occasion d'intervenir sur ce sujet au Centre d'Analyses Stratégiques (CAS). Depuis une dizaine d'années, on émet des doutes sérieux sur les aspects trop subjectifs des analyses faites par la psychologie et la psychiatrie et il est sûr que l'apparence d'une discipline nouvelle qui objectivise (avec de belles photos en couleur) peut apparaître comme un complément d'approche pour mieux cerner la personnalité et le comportement en termes de culpabilité, de responsabilité et surtout pour la question centrale aujourd'hui de la dangerosité.
Les experts psychiatriques se refusent la plupart du temps à parler de dangerosité sociale. Des tentatives ont eu lieu aux États-Unis pour se servir de l'imagerie comme système de preuve en justice. Chez nous ce n'est pas encore le cas, mais ce serait dans la logique de notre système de preuve pénale. Par rapport aux expertises classiques psychiatriques et médico-psychologiques obligatoires en matière criminelle, des examens (scanners, IRM) qui permettraient d'apporter des éléments tangibles ne seraient pas interdits dans certaines circonstances pour des individus atteints de certaines maladies à interprétation difficile.
Cependant ni la doctrine, ni le législateur ne sont encore allés jusqu'à suggérer le recours à ces techniques en justice en complément des expertises traditionnelles. La loi du 7 juillet 2011 a éclairci la possibilité de les utiliser comme expertise dans le système judiciaire et a en quelque sorte légitimé les techniques des neurosciences notamment à des fins judiciaires, mais elle n'a pas défini de cadre spécifique, ni changé les règles en vigueur. C'est donc à la jurisprudence que reviendra l'interprétation éventuelle.
Un autre domaine possible d'intervention des neurosciences est celui des soins sous contrainte, y compris ailleurs qu'à l'hôpital. On commence à utiliser une pharmacopée plus ciblée et tout aussi active. C'est un système qui vient de débuter et qui a l'avantage d'être contrôlé par le juge actuellement.
III-Neurosciences, santé et recherche
On peut distinguer deux types de recherches :
-la recherche sur le cerveau en tant qu'organe physique. Si on considère que le cerveau a une sorte de primat par rapport aux autres organes, car il a une certaine vulnérabilité et un lien avec notre identité, on peut se demander si des règles plus contraignantes que la loi du 20 décembre 1988 modifiée ne devraient pas être édictées si on veut intervenir sur le cerveau par exemple pour des interventions qui pourraient supprimer la mémoire, endommager le libre arbitre de la personne
-Que faire quand des anomalies sont découvertes à l'occasion de certaines recherches sur des personnes qui s'y soumettent volontairement ? Ce sujet a été largement abordé au cours de l'audition de l'OPECST de juin dernier. Il me parait au moins nécessaire que les personnes qui s'y soumettent, lorsqu'elles donnent leur consentement, soient tenues de préciser ce qu'elles souhaitent par rapport à leur état de santé présent et futur et aussi si elles sont d'accord pour recevoir l'information trouvée et éventuellement la communiquer à un tiers. C'est pourquoi, il me semble indispensable de maintenir dans ces recherches la présence d'un médecin ; même une recherche, simplement comportementale, peut faire courir des risques, par exemple lorsqu'on met l'individu dans une situation d'angoisse. Donc, je ne partage pas l'opinion de certains chercheurs qui se disent brimés vis-à-vis de leurs collègues étrangers par des règles trop contraignantes en France.
Finalités légitimes
On sait bien que certaines recherches ont une finalité militaire, d'autres peuvent être liées à des techniques d'interrogatoires, de lutte contre le terrorisme (formation de policiers par exemple)... Il faut donc s'interroger sur les finalités scientifiques.
Neurosciences, prédictivité, diagnostic précoce et soins
Les tests prédictifs posent toutes sortes d'interrogations : qui informer ? Le patient seul ? Sa famille ? Sa parentèle ? Quand ? Sur quoi ? Ces questions d'application pratique ne sont pas nouvelles, mais sont nombreuses.
Les neurosciences sont en première ligne sur les avancées en matière de diagnostic précoce ce qui a des conséquences sur les politiques de santé : à quel coût, sur quoi ? Hervé Chneiweiss et Anne Fagot-Largeault ont bien souligné en juin dernier le coût énorme qu'allaient représenter les politiques de fin de vie : des personnes encore lucides et bien informées auront besoin d'être aidées et auront aussi droit à une bonne qualité de vie, comme la Cour européenne des droits de l'homme l'a récemment rappelé.
Conclusions
Tous les sujets évoqués mériteraient des développements bien plus longs.
-Les neurosciences, comme les autres technosciences, posent la question de leur appréhension à la fois dans leur spécificité technique et dans la transversalité car elles touchent des situations très diverses. Définir une politique pour les neurosciences implique une vision globale, large, pour la société.
-La transversalité conduit au questionnement sur le renvoi au droit commun ou à l'élaboration d'un droit spécifique.
-Quelles institutions doivent en assurer la vigilance, tirer la sonnette d'alarme des limites éthiques à respecter ? Certaines institutions existent déjà. Comment maintenir leur spécialité et obtenir en même temps cette nécessaire transversalité ? Va-t-on aboutir à la création d'un défenseur des droits dans le domaine des sciences et des technologies ? La fonction de vigilance et de régulation est essentielle et doit être assurée dans une diversité des approches par rapport aux préoccupations concrètes.
En réponse aux diverses questions posées par MM. Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte, députés-rapporteurs, M. Christian Byk a apporté les précisions suivantes.
Nous sommes passés du temps des comités techniques de vigilance à celui des agences. C'est une autre logique qui déplace les enjeux de pouvoir et qui est apparue à la suite des crises sanitaires de ces dernières années (sida, vache folle...) qui avaient conduit à des condamnations de l'État pour carence de l'administration. C'est sans doute une bonne solution à condition que ces agences ne manquent pas de transversalité, que soit reposée périodiquement la question de leur configuration, de l'ampleur de leurs missions, et qu'on évite les conflits d'intérêts de leurs experts. L'Agence de la biomédecine, qui a une compétence très large et lourde, qui va de la réglementation au contrôle dans certains domaines, fonctionne de façon plutôt satisfaisante jusqu'à présent.
-En l'état actuel de la législation, le médecin qui découvre par imagerie médicale les signes d'une maladie future avant l'apparition des premiers symptômes, n'a aucune obligation d'informer la parentèle. La seule obligation existante serait la dénonciation d'un crime qui risquerait d'être commis.
-Le fait d'être rendu addictif ou violent par un traitement médical ne pourrait entraîner une éventuelle responsabilité médicale que si on parvenait à prouver le lien de causalité et si le patient ne connaissait pas les risques encourus. Mais des implants ayant une fonction spécifique qui fonctionneraient mal ou provoqueraient des pathologies, pourraient ouvrir droit à responsabilité ; cela s'est déjà produit avec des pacemakers ou aujourd'hui avec la question des implants mammaires de mauvaise qualité.
NOTE DU CENTRE
D'ANALYSE STRATÉGIQUE - DÉPARTEMENT QUESTIONS
SOCIALES
PROGRAMME DE TRAVAIL « NEUROSCIENCES, COGNITION ET
POLITIQUES PUBLIQUES »
- Direction générale : M. Vincent Chriqui
- Chef du Département questions sociales : M. Sylvain Lemoine
- Responsable du programme « Neurosciences, cognition et politiques publiques » : M. Olivier Oullier , conseiller scientifique au Département questions sociales du Centre d'analyse stratégique ; professeur des universités, Aix-Marseille université.
- Chargée de mission au Département questions sociales du Centre d'analyse stratégique : Mme Sarah Sauneron
1. Présentation du Centre d'analyse stratégique
Le Centre d'analyse stratégique (CAS) est une institution d'expertise et d'aide à la décision placée auprès du Premier ministre. Il a pour mission d'éclairer le Gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre de ses orientations stratégiques en matière économique, sociale, environnementale ou technologique. Créé par décret en date du 6 mars 2006, il succède au Commissariat général du Plan. Il préfigure, à la demande du Premier ministre, les principales réformes gouvernementales. Il mène par ailleurs, de sa propre initiative, des études et analyses dans le cadre d'un programme de travail annuel. Les travaux du CAS qui sont rendus publics prennent la forme de documents écrits (notes d'analyse, rapports et documents) disponibles sur son site Internet : www.strategie.gouv.fr . Tout au long de l'année, le CAS organise de nombreux colloques, journée d'études ou séminaires. Il élabore enfin un rapport annuel, bilan de ses travaux consacrés aux principaux enjeux stratégiques pour les politiques publiques françaises.
2. Le programme de travail « Neurosciences cognition et politiques publiques »
2.1. Historique
En 2008, le Président de la République et le Premier ministre ont souhaité que le Secrétaire d'État à la Prospective, à l'Évaluation des politiques publiques et au Développement de l'économie numérique conduise un diagnostic stratégique de la France à l'horizon des quinze prochaines années (France 2025). Le Centre d'analyse stratégique a reçu la charge de ce projet charge de l'organisation du projet et de produire un diagnostic stratégique pour les quinze ans à venir, qui décrive les différentes évolutions possibles pour la France, et définisse les moyens d'embrasser les opportunités les meilleures et d'éviter les scénarios les plus sombres. Le lancement officiel eut lieu le 22 avril 2008 et 10 groupes de travail furent formés. Le rapport fut remis au Premier ministre le 14 janvier 2009.
Le groupe de travail n°7, intitulé « Vivre ensemble » et présidé par Jean-Paul Fitoussi et Julie Grèzes, a auditionné plusieurs psychologues et neuroscientifiques. Une réflexion sur les neurosciences fut par la suite mise au programme de travail du CAS l'année suivante.
Début 2009, la direction générale du Centre d'analyse stratégique a mis en place le programme « Neurosciences, cognition et politiques publiques » au sein de son Département Questions sociales. La responsabilité des travaux fut confiée à Olivier Oullier (conseiller scientifique et universitaire) et Sarah Sauneron (chargée de mission).
2.2. Objectifs
Le but des travaux du CAS sur les neurosciences est dans un premier temps de faire un état des lieux des utilisations des sciences du cerveau hors du cadre originel dans lesquelles elles sont pratiquées : les laboratoires de recherche scientifique et médicale. Le développement de l'imagerie cérébrale fonctionnelle et la production d'images du cerveau qu'une technique comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), apparue il y a 20 ans, permet suscite l'intérêt des chercheurs en neurosciences mais également du secteur privé et de celui des politiques publiques.
C'est dans un souci constant de pédagogie et de rigueur que le CAS a fait appel dans l'ensemble de ces travaux à des spécialistes nationaux et internationaux afin d'éclairer ses productions. Le but de ce programme de travail n'étant pas de proposer une utilisation systématique des neurosciences dans certains domaines des politiques publiques, mais d'évaluer la pertinence des apports potentiels de ce champ scientifique à la compréhension de conduites sociales et de décisions. Pour ce faire, les neurosciences n'ont jamais été considérées de manière exclusives dans les travaux du CAS mais s'inscrivant dans une approche plus holistique incluant la philosophie, la psychologie, l'économie comportementale, les sciences cognitives, la neuropsychologie, la neurologie et la psychiatrie : l'étude du cerveau isolé (de ses environnements physiques et sociaux) ne représentant que peu d'intérêt dans le cadre des politiques publiques.
L'absence d'initiative comparable au programme « Neurosciences, cognition et politiques publiques » en France comme à l'étranger a permis, pour la première fois d'engager une réflexion sur la durée sur un ensemble de thèmes qui nous apparaissaient les plus pertinents eu égard aux différentes convocations dont faisaient l'objet les neurosciences dans des domaines aussi divers que l'économie, la finance, la prévention en santé publique, la santé mentale, le vieillissement cognitif ou encore le droit. Bien évidemment, nos travaux, toujours en cours, ne sont pas exhaustifs puisque qu'une réflexion sur les neurosciences doit être menée dans le domaine de l'éducation, de la réhabilitation fonctionnelle, du marketing et de la communication ou encore de l'addiction.
2.3. Principaux thèmes de travail
2.3.1. Neuroéthique
La première publication du Centre d'analyse stratégique sur les neurosciences fut la note d'analyse n°128 sur les questions d'éthique liées à l'utilisation des neurosciences hors des laboratoires de recherche scientifique et médicale. Cette première étape était indispensable afin de faire proposer un état des lieux en France à l'aune du développement international de ce qui est désormais qualifié de neuroéthique -la réflexion éthique sur l'utilisation des sciences du cerveau au sein des établissements de recherche comme en dehors. Une deuxième publication a ensuite abordé plus précisément les questions d'interfaces cerveau-machine t, par la même, celles liées à l'humain potentiellement « augmenté » par les neurosciences
Alors que les travaux préparatoires pour la révision de la loi de bioéthique (déjà révisée en 2004) ont été entamés en 2008 et ont abouti en juillet 2011, la réflexion (neuro)éthique, déontologique et juridique est le fil conducteur des travaux du CAS dans le domaine des neurosciences depuis leur initiation début 2009. En effet, à l'instar de l'engouement pour la génétique, et notamment les tentatives de naturalisation des comportements en liant l'expression de gènes à des conduites, l'imagerie cérébrale fonctionnelle suscite fantasmes voire craintes au sein de la société.
2.3.2. Neurodroit
L'utilisation des neurosciences dans l'appareil judiciaire représente à l'heure actuelle l'un des domaines dans lequel les avancées en sciences du cerveau pourraient engendrer le plus de changements au sein de notre société. Le législateur français n'est pas resté insensible à ce fait, proposant un droit d'exception dans la loi du 7 juillet 2011 à l'utilisation des neurosciences dans le cadre des expertises judiciaires alors qu'il restreint l'utilisation de l'imagerie cérébrale aux seuls applications scientifiques et médicales.
Aux États-Unis, cette thématique, que l'on désigne sous le néologisme « neurodroit », est l'objet d'un programme de coopération interuniversitaire et inter-administration sans précédent ni équivalent dans le monde, intitulé « The Law and Neuroscience Project ». Ce projet soutenu par la MacArthur Foundation à hauteur de 10 millions de dollars comme première dotation. Même si le financement ne de ce projet ne devrait pas être renouvelé, sa simple existence est un signal fort de l'intérêt suscité par les sciences du cerveau pour la justice. Pour certains, les notions de responsabilité et de libre arbitre pourraient ainsi être à repensées à l'aune des découvertes en neurosciences. Dans les tribunaux américains, des facteurs biologiques sont de plus en plus invoqués par les défenses afin d'obtenir l'irresponsabilité pénale pour leur client. Véracité des propos tenus, risques de récidive, impartialité du juge, biais émotionnels potentiels des jurés, sont autant d'aspects qui pourraient être impactés par les neurosciences. Les enjeux sont donc importants et sensibles, et dépassent le cadre technique et scientifique.
En Europe, à l'exception de la « neuro-détection de mensonges », et plus récemment de modulations de peines survenues en Italie suite à la production d'images cérébrales durant un procès, la question demeure très peu traitée, notamment en ce qui concerne les modifications potentielles du système judiciaire (expertise par exemple) et de la loi. A travers une journée d'étude et la publication d'une note de veille, le Centre d'analyse stratégique a été la première institution à initier une réflexion sur le neurodroit en France. Courant 2012, le CAS publiera un rapport circonstancié sur le sujet qui proposera une analyse critique éclairée par des spécialistes français et internationaux venus du droit, de la psychiatrie, des neurosciences, de la psychologie et de la criminologie.
2.3.3. Prévention en santé publique
En 2010, le Cas a publié le premier rapport proposant l'apport des neurosciences, des sciences cognitives et des sciences comportementales dans la mise en place de politiques préventives et incitatives en santé publique. Trois exemples, qui bénéficient à l'heure actuelle d'un grand intérêt sociétal, politique et médiatique ont été traités :
- la lutte contre l'épidémie d'obésité et de surpoids (déterminants cérébraux et contextuels de l'obésité, optimisation des stratégies de communication de type « Manger/Bouger », développement de l'apprentissage à la nutrition et à la diététique, évaluation des mises en garde sur les emballages de produits) ;
- la lutte contre le tabagisme (déterminants cérébraux de l'addiction à la cigarette, stratégies de communication et de prévention médiatiques, nature des mises en garde à apposer sur les paquets de cigarettes) ;
- la prévention des empoisonnements et intoxications accidentels dus aux produits chimiques domestiques dont les emballages peuvent induire une confusion avec des produits alimentaires et le développement de nouvelles stratégies de mise en garde (« warnings ») sur ces emballages.
Les sujets de la lutte contre l'obésité et le tabagisme renvoient tous deux au problème de l'addiction au produit d'intérêt (tabac, nourriture) et à la nécessité de - toujours plus et mieux - communiquer, éduquer, et prévenir sur les méfaits de l'abus de ces substances (à l'échelle collective grâce aux campagnes de sensibilisation, mais aussi individuelle via notamment les emballages). Ces stratégies se nourrissant certes de neurosciences mais aussi de sciences comportementales et notamment de nudges pourraient, à terme, avoir des conséquences positives d'un point de vue sanitaire, mais aussi économique et social. En outre, les sujets de l'obésité et du tabagisme bénéficient d'un corpus scientifique et médical conséquent dans lequel les neurosciences ont une place importante.
Ce travail sur les neurosciences et la prévention en santé publique est susceptible d'intéresser aussi bien le décideur politique, que le consommateur, l'industriel ou le législateur. Il a permis des échanges entre le CAS et la Behavioural Insights Team du Premier ministre britannique et le Global Agenda Council on Brain and Cognitive Sciences du Forum Economique Mondiale.
2.3.4. Décision économique
La décision économique a été le thème de la première manifestation organisée dans le cadre de ce programme. Son but était de montrer comment les données des sciences comportementales et du cerveau peuvent enrichir les débats d'actualité, à l'image de ceux relatifs à la crise financière. En effet, face à l'ampleur de cette crise et aux limites des modèles et méthodes classiques de gestion du risque qu'elle a révélées, les neurosciences pourraient apporter un éclairage nouveau sur la gestion du risque, de l'incertitude et de l'ambiguïté. Les points de vue de trois experts, un économiste, un neurophysiologiste et un spécialiste de la finance comportementale, ont permis de faire le lien entre la théorie et la réalité des marchés.
2.3.5. Vieillissement cognitif
Le CAS a également travaillé sur le thème du vieillissement cognitif. Depuis plusieurs décennies, la science s'est emparée du vieillissement, afin d'en identifier les causes, les conséquences et les mécanismes biologiques. Toutefois, l'étude approfondie de son retentissement sur la cognition, c'est-à-dire sur les fonctions mentales élémentaires et de haut niveau, est d'inspiration plus récente. La notion de vieillissement cognitif a alors été introduite afin de définir l'évolution des performances cognitives avec l'âge. Si l'intégralité des facultés intellectuelles est affectée lors du processus naturel de vieillissement, elles ne le sont pas toutes de façon équivalente et homogène. En outre,
Les individus ne sont pas atteints de la même manière et au même rythme, la variabilité interindividuelle allant croissant avec l'âge et étant étroitement associée à la diversité des parcours de vie. Dans une société caractérisée par une révolution de la longévité, ces observations sortent des laboratoires et soulèvent des enjeux dans la sphère professionnelle, pour l'emploi des plus de 50 ans ; dans la sphère de l'aide à la personne âgée, pour les aidants professionnels et familiaux ; et plus généralement dans une visée de promotion de la qualité de la vie et du vieillissement en bonne santé.
2.4. Recommandations
Au cours du processus de révision de la loi de bioéthique initié entre 2008 et qui a aboutipar la promulgation de la loi le 7 juillet 2011, le CAS a participé à de nombreuses auditions parlementaires au cours desquelles, il a proposé des recommandations dans le domaine des neurosciences issues de ses productions écrites et des événements qu'il a organisés. Un premier constant a été que les pays anglo-saxons étaient en 2009 très en avance dans le domaine de recherche en neuroéthique mais leur approche était principalement basée sur l'éducation du grand public et le dialogue, sans que cela n'ait jamais abouti à des dispositions législatives. Intégrer les neurosciences dans la loi de bioéthique française constituerait une position singulière, position soutenue par l'OPESCT, le CCNE, et l'Agence de biomédecine.
Les questions qui ont dès lors animées la réflexion du CAS pendant le processus de révision de la loi de bioéthique ont été les suivantes : les régulations existantes sont-elles suffisantes ? Est-il prématuré de mettre en oeuvre des régulations spécifiques ? Celles-ci doivent-elles porter sur la recherche ou sur ses applications ?
Concernant la réalisation d'expérimentations scientifiques et médicales: établissement de protocoles de recherche et encadrement des recherches médicales, sont des enjeux partagés par un grand nombre de disciplines de la biologie, et sont déjà pris en compte par les pouvoirs publics de manière satisfaisante.
2.4.1. Recommandations faites par le CAS en 2009 à la mission de préparation de la révision de la loi de bioéthique
A. Concernant l'utilisation des avancées des neurosciences hors des laboratoires et les possibles risques de mésusages. Plusieurs dispositions législatives apparaissent nécessaires afin de répondre à ces enjeux :
B. Pas de droit d'exception pour les neurosciences, une loi-cadre permettrait de répondre à de nombreuses interrogations éthiques déjà suscitées par diverses disciplines de la biologie et ravivées par les neurosciences, plutôt qu'une loi détaillée qui se révélera tôt ou tard incomplète.
C. Principes éthiques fondamentaux transversaux aux disciplines de la biologie : principe de primauté de la dignité de la personne, l'inviolabilité et la non-commercialité du corps humain, consentement libre et éclairé, accès équitable aux soins.
D. Un système plus souple et réactif : la loi révisée dès lors qu'elle apparaîtrait inadaptée à une situation, sur suggestion d'un organisme français travaillant sur la bioéthique (CCNE, Agence de Biomédecine, OPECST) pourrait faire l'objet d'amendements.
E. Confier à l'agence de biomédecine et au CCNE un rôle régulateur.
F. Enjeu de la protection des données sensibles et personnelles issues de la génétique recoupe en grande partie celui des connaissances apportées par les neurosciences. Le champ de compétence de la CNIL pourrait être étendu à neuroimagerie.
G. Régulation de l'utilisation éventuelle de la neuroimagerie dans les domaines judiciaire, sécuritaire, ou social ; le Code du travail, de la santé publique ou des assurances interdisant d'ores et déjà la discrimination génétique.
H. Envisager l'inclusion dans les programmes scolaires d'une éducation à la bioéthique et d'enseignements favorisant une meilleure compréhension des sciences et de la technologie, fondement des progrès d'une démocratie technique.
I. Sensibiliser les étudiants en neurosciences aux pratiques émergentes de leur discipline, notamment l'utilisation de la neuroimagerie par le secteur privé. L'enseignement de la neuroéthique devrait être systématique, alors qu'encore trop peu d'établissement le proposent.
2.4.2. Recommandations en prévention en santé publique
2.4.2.1. Utiliser les résultats offerts par l'analyse de la poursuite oculaire
Dans cette perspective, le rapport du CAS fait tout d'abord état de résultats inédits sur l'utilisation de la technique de la poursuite oculaire (qui permet d'enregistrer la trajectoire du regard et les points de fixation visuelle) montrant sans équivoque que les bandeaux sanitaires apposés sous les images des spots télévisuels pour les aliments gras, sucrés et salés ne sont quasiment jamais lus par les téléspectateurs (Cf. exemple ci-dessous). Ces bandeaux seraient en grande partie inadaptés, car trop petits, non variés et sobres, face aux effets d'accoutumance et de sur-stimulation sensorielle générés par les publicités éclatantes et dynamiques pour attirer l'attention et susciter l'envie. Une relative inefficacité d'autant plus préjudiciable que l'apposition de ces messages évite aux industries agroalimentaires de s'acquitter d'une taxe reversée à l'INPES. Utilisée au cours du processus du développement de la stratégie de communication, la technique de la poursuite oculaire, peu couteuse, aurait permis d'éviter ce biais. De nombreux laboratoires de recherche publique possédant et maîtrisant cette technique seraient certainement très intéressés par une collaboration avec l'INPES sur ces thématiques.
2.4.2.2. Intégrer le plaisir dans la stratégie de communication
Deuxièmement, un effort de communication est nécessaire afin que manger équilibré, ne soit plus associé à l'idée d'une perte de goût mais à une notion de plaisir gustatif. Des résultats récents d'imagerie cérébrale illustrent que le plaisir, au niveau neurophysiologique, ne dépend pas uniquement des propriétés intrinsèques d'un aliment mais aussi de la façon dont il est décrit et présenté. Dans ces expériences, alors que la nourriture est toujours la même, plus ces facteurs contextuels ont une valence positive, plus l'activité dans le système de la récompense du cerveau est élevée sans pour autant que les consommateurs ne le réalisent et n'arrivent à en faire part dans un questionnaire. L'imagerie cérébrale pourrait aider à développer une présentation publicitaire des aliments sains, comme les fruits et légumes, plus susceptible d'améliorer la propension des consommateurs à en manger, plutôt que de seulement leur dire que la ration recommandée est de cinq par jour.
2.4.2.3. Développer une approche variée de la communication
En santé publique comme dans d'autres secteurs, il convient d'alterner la nature des messages. Dans la lutte contre l'obésité cela reviendrait à communiquer sur les méfaits d'une alimentation déséquilibrée, mais aussi sur le plaisir de manger des fruits et des légumes tout en insérant des « périodes de repos » pendant lesquelles le consommateur n'est pas sollicité par la prévention afin d'éviter les effets de saturation et d'accoutumance. Jouer sur la surprise plus que sur la peur s'avère à cet effet une stratégie payante (ce type d'observation est confirmé par une étude d'imagerie montrant la nécessité de varier les avertissements textuels et graphiques sur les paquets de cigarette). Pour ce, l'efficacité des messages de prévention, à l'instar des messages publicitaires, ne doit pas se cantonner à de l'information visuelle difficilement lisible mais doit jouer sur le contraste et la nouveauté, tout en faisant appel à l'animation et au son.
2.4.3. Recommandations en matière de vieillissement cognitif
A. Entrer dans un cercle vertueux de la prévention en santé cognitive et de la lutte contre les inégalités sociales en santé par l'accès à une éducation de qualité pour le plus grand nombre.
B. Multiplier les expérimentations en entreprise de bonnes pratiques de « préservation cognitive » (à la fois en ce qui concerne les environnements de travail et les formations).
C. Engager un effort important pour développer les formations aux métiers d'aide aux personnes âgées, afin d'encourager les vocations.
D. Développer les efforts de recherche pour comprendre les liens de causalité entre vieillissement physiologique et atteinte pathologique et pour permettre une détection précoce des troubles.
E. Promouvoir un style de vie actif en ciblant particulièrement les quadra- et quinquagénaires.
F. Soutenir l'innovation afin d'adapter les nouvelles technologies aux besoins des populations les plus âgées (interfaces conviviales, jeux adaptés, réseaux sociaux...).
* 1 Les expériences sur l'homme (notamment d'imagerie cérébrale mais pas uniquement) ne peuvent être réalisées dans notre pays sans l'accord préalable d'un Comité de protection de la personne (CPP) et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).
* 2 Olesen J, Baker MG, Freund T, di Luca M, Mendlewicz J, Ragan I, Westphal M. (2006) Consensus document on European brain research. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 77 Suppl 1: i1-49.
* 3 Di Luca M, Baker M, Corradetti R, Kettenmann H, Mendlewicz J, Olesen J, Ragan I, Westphal M. (2011) Consensus document on European brain research. Eur J Neurosci. 33: 768-818.
* 4 Smith, K., 2011, Trillion dollars brain drain , Nature. 478: 15
* 6 Van Horn et al. (2008) Individual variability in brain activity: A nuisance or an opportunity? Brain Imaging & Behavior, 2(4), 327-334.
* 7 Anton J.L. (1996). De l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle aux activations des populations de neurones chez l'homme : étude du cortex sensori-moteur dans l'exploration tactile. Thèse de doctorat en sciences cognitives (dir. : Y. Burnod). Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris.
* 8 Oullier O. (2010). The useful brain: Why neuroeconomics might change our views on rationality and a couple of other things. In E. Michel-Kerjan & P. Slovic (Eds). The irrational economist: Making decisions in a dangerous world (pp. 88-96). New-York: Public Affairs
* 9 Oullier O. & Basso F. (2010 ). Embodied economics: How bodily information shapes the social coordination dynamics of decision making. Philosophical Transcations of the Royal Society: B Biological Sciences , 365 (1538), 291-301
* 10 Tahmasebi A.M. (2010). Quantification of inter-subject variability in human brain and its impact on analysis of fMRI data. Thèse de doctorat en traitement du signal (dir. : I.S. Johnsrude & P. Abolmaesumi), Queen's University, Kingston, Canada
* 11 Friedman L. et al. (2006) Reducing inter-scanner variability of activation in a multicenter fMRI study: Role of smoothness equalization . Neuroimage, 32(4), 1656-1668.
* 12 Hariri A.R. (2009). The neurobiology of individual differences in complex behavioral traits. Annual Reviews of Neuroscience, 32, 225-247
* 13 Henrich J. et al. (2010) The weirdest people in the world? Behavioral and Brain Sciences, 33(2-3), 61-83
* 14 Oullier O. & Sauneron S. (2010). Nouvelles approches de la prévention en santé publique : l'apport des sciences comportementales, cognitives et des neurosciences (rapport n°25, Centre d'analyse stratégique). La Documentation Française, Paris (192 p.)
* 15 Bennett C.M. & Miller M.B. (2010). How reliable are the results from functional magnetic resonance imaging? Annals of the New York Academy of Science, 1191, 133-155
* 16 Oullier O., Kirman A.P. & Kelso J.A.S. (2008). The coordination dynamics of economic decision-making: A multi-level approach to social neuroeconomics. IEEE Transactions on Neural and Rehabilitation Systems Engineering, 16(6), 557-571
* 17 Kelso J.A.S. (1995) Dynamic patterns : The self-organization of brain and Behavior. Cambridge : MIT Press
* 18 Deco G., Jirsa V.K. & McIntosh A.R. (2011). Emerging concepts for the dynamical organization of resting-state activity in the brain. Nature Reviews Neuroscience, 12, 43-56
* 20 Fuchs A., Kelso J.A.S. & Haken H. (1992) Phase transitions in the human brain: Spatial mode dynamics. International Journal of Bifurcation & Chaos , 2, 917-939
* 21 Oullier O. & Sauneron S. (2009). Perspectives scientifiques et éthiques de l'utilisation des neurosciences dans le cadre des procédures judiciaires. Centre d'analyse stratégique, Note d'analyse n°159, 1-10
* 22 « Perspectives scientifiques et légales sur l'utilisation des sciences du cerveau dans le cadre des procédures judiciaires ». Séminaire organisé par le Département Questions sociales du Centre d'analyse stratégique à Paris le 10 décembre 2009. Actes : http://www.strategie.gouv.fr/content/actes-du-seminaire-perspectives-scientifiques-et-legales-sur-l%E2%80%99utilisation-des-neuroscienc-0
* 23 No lie MRI ( http://noliemri.com/ et Cephos ( http://www.cephoscorp.com/
* 24 JORF n°0157 du 8 juillet 2011, page 1186
* 25 Rapport n° 1325 sur l'évaluation de l'application de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, La loi bioéthique de demain, déposé le 20 novembre au Sénat et 17 décembre 2008 à l'Assemblée nationale, cinquième partie portant sur les neurosciences et l'imagerie cérébrale.
* 26 Art. 45, Titre VIII, Neurosciences et imagerie cérébrale), de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique
* 27 C. Vidal, Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie?, Ed Le Pommier, 2009 ; L 'IRM pour le meilleur et pour le pire ; Ch Byk, Neurosciences et administration de la preuve pénale devant les juridictions des États-Unis, in Actes du colloque « Avancées biomédicales et protection des libertés », (ss dir. H. Gaumont-Prat), Revue Médecine et Droit, Fév 2011, n°106 ; H. Gaumont-Prat, La loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique et l'encadrement juridique des neurosciences, Les Petites Affiches, novembre 2011, p. 10 à 19, Ed Lextenso.
* 28 Fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, par M. J. Leonetti , AN 26 janvier 2011)
* 29 Kevin Murphy, Robustly Robustly measuring vascular reactivity differences with breath-hold: Normalising stimulus-evoked and resting state BOLD fMRI data, in NeuroImage 54 (2011) 369-379, Ed. Elsevier.
* 30 Benveniste E., le vocabulaire des institutions indo-européennes, Minuit, Paris, 1969, t.2, pp. 123 ss.
* 31 V. Canguilhem G, Le normal et le pathologique, Puf, Paris, 2005.
* 32 Harris J., Enhancing evolution, The etical case for making better people, Princeton University Press, Princeton, 2007.
* 33 Harris J., ibidem, p. 33.
* 34 Jonas H., Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung, Insel Verlag, Frankfurt und Main, 1985. En français : Technique, médecine et éthique. La pratique du principe de responsabilité. Nous utiliserons ici sa traduction en italien : Technica, medicina ed etica. Prassi del principio di responsabilità, Einaudi, Torino, 1997.
* 35 Jonas H., ibidem, p. 128.
* 36 Schiavone A., Storia e destino, Einaudi, Torino, 2007.
* 37 Schiavone A., ididem, p. 71.
* 38 V. Girolami P., La salute e le regole, Edi-Ermes, Milano, 2010, p. 61.
* 39 V. Nietzsche F., Le gai savoir, Flammarion, Paris, 2000.
* 40 Jonas H., op. cit., p. 92, p. 120 et 128.
* 41 V. Monaco F., Cavanna A.E., The Neuropsychiatry of Consciousness, Nova Science Publishers, New York, 2007
* 42 V. Lombroso C., L'homme criminel, Étude anthropologique et médico-légale, Alcan, Paris, 1887.
* 43 Feuillet, L. H. Dufour and J. Pelletier, "Brain of a white-collar worker" The Lancet, vol 307, 2007;
* 44 J Moll. et al. " The neural basis of human moral cognition " Nature reviews Neuroscience, vol 6, 2005 ;
* 45 Vidal C. Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie? Ed Le Pommier, 2009 ;
* 46 Gaser C. and Schlaug G. Brain structures differ between musicians and non-musicians J. Neuroscience, vol 23, 2003;
* 47 Draganski, B. et al. Changes in grey matter induced by training Nature, vol 427, 2004 ;
* 48 Vidal, C., Vers une neuro-justice? Revue Ravages, n°4, 2011
* 49 Boes, A. et al. Right anterior cingulate cortex volume is a neuroanatomical correlate of aggression and defiance in boys Behavioral Neuroscience , vol 122, 2008 ;
* 50 ) Vidal, C. et Benoit-Browaeys, D. Cerveau, Sexe et Pouvoir , Ed. Belin. 2005 ; Vidal, C., Neuro-sexisme Revue Ravages, n°6, 2011 ;
* 51 http://neurocultures2012.univie.ac.at ;
* 52 Racine, E., Waldman, S., Rosenberg, J. and J. Illes. Contemporary neuroscience in the media. Social Science & Medicine, vol 71, 2010
* 53 McCabe D and Castel A " Seeing is believing: the effect of brain images on judgments of scientific reasoning" Cognition , vol 107, 2008 .
* 54 Le Monde Avril 2004
* 55 « Exploration du cerveau, neurosciences : avancées scientifiques, enjeux éthiques », audition par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, 26 mars 2008, Assemblée Nationale, Paris http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-oecst/CR_Neurosciences.pdf
* 56 http://www.strategie.gouv.fr
* 57 Belliveau J.W., Kennedy D.N., McKinstry R.C., Buchbinder B.R., Weisskoff R.M., Cohen M.S., Vevea J.M., Brady T.J. & Rosen B.R. (1991) « Functional mapping of the human visual cortex by magnetic resonance imaging », Science, 254, 716- 719
* 58 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
* 59 Abbréviation anglo-saxonne d'IRM fonctionnelle.
* 60 Trout J. D. (2008) « Seduction without cause: Uncovering explanatory neurophilia », Trends in Cognitive Science, 12,281-282
*
61
Lindstrom M. (2011)
«You love your iphone. Literaly». New York Times, edition du 30
septembre
http://www.nytimes.com/2011/10/01/opinion/you-love-your-iphone-literally.html?_r=1&pagewanted=print
* 62 http://www.russpoldrack.org/2011/10/nyt-letter-to-editor-uncut-version.html
*
63
Iacoboni M., Freedman
J., Kaplan J. (2007) « This is your brain on politics »,
New York Times, édition du 11 novembre
http://www.nytimes.com/2007/11/11/opinion/11freedman.html?ei=5090&en=e0ca987ad4bd515f&ex=1352437200&partner=rssuserland&emc=rss&pagewanted=print
* 64 Oullier O. & Sauneron S. (2010) « Nouvelles approches de la prévention en santé publique - L'apport des sciences comportementales, cognitives et des neurosciences », Centre d'analyse stratégique, Rapport n°25, Paris : La Documentation Française (192 p.)
* 65 http://www.planrechercheobesite.fr/
* 66 Basso F. (2011) « L'incorporation des food imitating products : la métaphore alimentaire des produits d'hygiène entre marketing, santé publique et neurosciences sociales », Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion de l'Université de Rennes 1 soutenue le 29 novembre 2011, dir. : Ph Robert-Demontrond et O. Oullier, 624 p.
* 67 Présentation de Frédéric Basso sur les Food Imitating Products à la DG SANCO (Commission européenne), Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS), Working Group on Food Imitating Products, Bruxelles, 03 mars 2010.
* 68 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C8E13F464AD08DEC5707630800D46A1B.tpdjo14v_2?idArticle=JORFARTI000024323310&cidTexte=JORFTEXT000024323102&dateTexte=29990101&categorieLien=id
* 69 Oullier O. & Sauneron S. (2009). Perspectives scientifiques et éthiques de l'utilisation des neurosciences dans le cadre des procédures judiciaires. Centre d'Analyse Stratégique, Note d'analyse n°159, 1-10
* 70 « Perspectives scientifiques et légales sur l'utilisation des sciences du cerveau dans le cadre des procédures judiciaires », séminaire organisé par le Département Questions sociales du Centre d'analyse stratégique, le 10 décembre 2009, Paris. Actes (73 p.) :
* 71 McCabe D. P., Castel A. D. (2008) « Seeing is believing: The effect of brain images on judgments
of scientific reasoning », Cognition, 107(1), 343-352 ; Weisberg D. S., Keil F. C., Goodstein J., Rawson E., Gray J. R.
* 72 McCabe D., Castel A., Rhodes M. (2011). « The influence of fMRI lie detection evidence on juror decision-making ».
Behavioral Sciences and the Law, 29, 566-577
* 73 Kahneman D. (2011) « Think fast, think slow », Farrar, Straus and Giroux : New York.
* 74 http://blogs.nature.com/news/2011/09/italian_court_reduces_murder_s.html
* 75 http://thevirtualbrain.org/
* 76 Ponseti J., Granert O., Jansen O., Wolff S., Beier K., Neutze J., Deuschl G., Mehdorn H., Siebner H., Bosinski H. (2011) « Assessment of pedophilia using hemodynamic brain response to sexual stimuli » Archives of General Psychiatry, sous presse.
* 77 Houdé, O. (2009). Les enfants prêtent leur cerveau à la science, La Recherche , Portfolio pour Les Dossiers de la Recherche: « L'intelligence », n°34, pp. 60-67. Houdé, O. et al. (2010). Mapping numerical processing, reading, and executive functions in the developing brain: An fMRI meta-analysis on 52 studies including 842 children. Developmental Science , 13, 876-885. Houdé, O. et al. (2011). Functional MRI study of Piaget's conservation-of-number task in preschool and school-age children: A neo-Piagetian approach. Journal of Experimental Child Psychology , 110, 332-346. Houdé, O. (2011). L'intelligence se construit par l'inhibition, La Recherche , Dossier « Le développement de l'intelligence », n°457, pp. 48-51. Houdé, O. (2011). Interview pour l'article « Les neurosciences au service de la pédagogie », La Recherche , Dossier « Le développement de l'intelligence », n°457, pp. 54-58. Houdé, O. (2011). Imagerie cérébrale, cognition et pédagogie. Médecine/Sciences, 27, 535-539.
* 78 H. U. Wittchen et al. Eur. Neuropsychopharmacol. 21, 655-679; 2011







